Faux-père
Le nouveau livre de Philippe Vilain, Faux-père (Grasset) dresse l'autoportrait sans concession d'un salaud désinvolte, libertin, cynique, vautré avec plaisir dans son ennui, son égoïsme (il y a du Drieu antipathique dans ce roman), agrippé à son oisiveté comme la moule au rocher, brandissant la peur du néant comme on agite un drapeau blanc au bout d'une baïonnette, qui engrosse une jeune turinoise amoureuse folle de lui, qui écrit dans son journal intime qu'il ne veut pas de cet enfant et souhaite une fausse couche, qui laisse trainer ce journal, que la pure et belle Stefania découvre... C'est le roman (écrit avec précision, au scalpel, et avec une économie de mots redoutablement efficace), de la peur de l'engagement, d'un affligeant manque de courage, de la frousse du bonheur peut-être, et de la trahison qui survient par négligence -avec la découverte du carnet-, lorsque la résignation a enfin gagné l'homme lâche... Cette femme allait faire du narrateur un homme et voilà que celui-ci fuit Turin, regagne Paris, abandonne une femme profondément disgraziata. Puis il regrette (comme c'est étrange!), retourne à Turin, mais trop tard : elle a avorté dangereusement, elle est à l'hôpital, la tendre et douce Stefania. Alors, oui, il écrit que: "Tout se passait comme si, en refusant d'être père, j'avais à jamais voulu rester un fils." Mais on s'en fout. On s'en fout complètement.
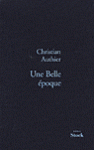 Le quatrième roman de Christian Authier, Une Belle époque, (lire la note intitulée Province, publiée le 26 août), possède l’épaisseur, le corps tranquille et l’amplitude des livres de la maturité, comme on dit dans les feuilles littéraires. Authier sait construire un roman de 300 pages qui alterne le récit des péripéties politico-humanitaires, légères, d’une bande de potes, tous anciens de Sciences-Po Toulouse, dans les années quatre-vingt-dix, jusqu’aux élections de 95 (la machine politique, véreuse, et le clan Baudis en particulier, sont ici laminés en règle), la peinture ironique d'une droite qui essaya de devenir la plus sympa après avoir été la plus bête du monde, et une histoire d’amour avec une Clémence au charme envoûtant. Sans oublier de traiter au vitriol La Dépêche du Midi (à peine déguisée en Gazette) et le passé nauséabond de la famille qui possède encore le journal toulousain. Je serais d’ailleurs curieux de connaître les provisions pour procès de Stock, son éditeur. Authier détruit avec humour les suffisants, les parvenus de l'économie locale, les emperlousées des cocktails de préfecture, comme Muriel Barbéry a su le faire dans les cent premières pages de son élégant Hérisson. Authier y ajoute une distance qui est la marque des auteurs de fond. Ceux qui savent être sans concession, y compris avec eux-mêmes. Qui n'ont pas besoin de décrire le tragique des événements pour que nous le ressentions jusqu'à la moelle, avec le recours, simple à première vue, au verbe rare, à l’adjectif pudique, à la phrase courte et néanmoins souple : il faut parfois sacrifier à la tentation littéraire authentique, qui est de dire ces choses réputées indicibles que le lecteur a déjà vécues. La mélancolie d’Authier navigue au plus près du fil de l’eau lorsqu’il décrit Clémence, dont « la fraîcheur me ramenait vers ces contrées où l’impatience se marie à la langueur et à l’assurance qu’un soleil de printemps réchauffera toujours l’eau froide des grands âges ». Page 248, la jeune femme devient une déesse. L'image de la vérité, qui ne dure jamais. Rappelle que tout le reste n'est pas littérature. Authier, qui ne lâche son lecteur qu'à la dernière ligne, l'étreint avec la ceinture de l’émotion, par touches, à pas de loup, vers ce plaisir étrange que l’on dit textuel. Une réussite.
Le quatrième roman de Christian Authier, Une Belle époque, (lire la note intitulée Province, publiée le 26 août), possède l’épaisseur, le corps tranquille et l’amplitude des livres de la maturité, comme on dit dans les feuilles littéraires. Authier sait construire un roman de 300 pages qui alterne le récit des péripéties politico-humanitaires, légères, d’une bande de potes, tous anciens de Sciences-Po Toulouse, dans les années quatre-vingt-dix, jusqu’aux élections de 95 (la machine politique, véreuse, et le clan Baudis en particulier, sont ici laminés en règle), la peinture ironique d'une droite qui essaya de devenir la plus sympa après avoir été la plus bête du monde, et une histoire d’amour avec une Clémence au charme envoûtant. Sans oublier de traiter au vitriol La Dépêche du Midi (à peine déguisée en Gazette) et le passé nauséabond de la famille qui possède encore le journal toulousain. Je serais d’ailleurs curieux de connaître les provisions pour procès de Stock, son éditeur. Authier détruit avec humour les suffisants, les parvenus de l'économie locale, les emperlousées des cocktails de préfecture, comme Muriel Barbéry a su le faire dans les cent premières pages de son élégant Hérisson. Authier y ajoute une distance qui est la marque des auteurs de fond. Ceux qui savent être sans concession, y compris avec eux-mêmes. Qui n'ont pas besoin de décrire le tragique des événements pour que nous le ressentions jusqu'à la moelle, avec le recours, simple à première vue, au verbe rare, à l’adjectif pudique, à la phrase courte et néanmoins souple : il faut parfois sacrifier à la tentation littéraire authentique, qui est de dire ces choses réputées indicibles que le lecteur a déjà vécues. La mélancolie d’Authier navigue au plus près du fil de l’eau lorsqu’il décrit Clémence, dont « la fraîcheur me ramenait vers ces contrées où l’impatience se marie à la langueur et à l’assurance qu’un soleil de printemps réchauffera toujours l’eau froide des grands âges ». Page 248, la jeune femme devient une déesse. L'image de la vérité, qui ne dure jamais. Rappelle que tout le reste n'est pas littérature. Authier, qui ne lâche son lecteur qu'à la dernière ligne, l'étreint avec la ceinture de l’émotion, par touches, à pas de loup, vers ce plaisir étrange que l’on dit textuel. Une réussite.
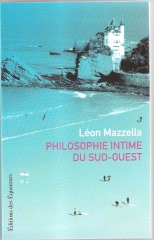
 "Martine a épousé la baie. Catalane de Perpignan, elle a récemment posé son sac au Grand-Hôtel, dont elle supervise le spa, après avoir passé plusieurs années en Sardaigne et n’envisage plus de reprendre la route des spas prestigieux du monde, sauf peut-être pour Bali, « mais dans longtemps », car sa fille y vit. Martine se baigne chaque jour dans cet océan maté par des brise-lames et des seuils de garantie qui en ont fait une maquette de Méditerranée au pays du surf.
"Martine a épousé la baie. Catalane de Perpignan, elle a récemment posé son sac au Grand-Hôtel, dont elle supervise le spa, après avoir passé plusieurs années en Sardaigne et n’envisage plus de reprendre la route des spas prestigieux du monde, sauf peut-être pour Bali, « mais dans longtemps », car sa fille y vit. Martine se baigne chaque jour dans cet océan maté par des brise-lames et des seuils de garantie qui en ont fait une maquette de Méditerranée au pays du surf. Myriam vient de Brest. Encyclopédie gracieuse de l’histoire luzienne, elle raconte mieux qu’un Basque –désolé, l’architecture des maisons d’armateurs, la pêche à la baleine, le mariage de Louis XIV, les Kaskarots, Agotak (cagots), Bohémiens et autres proscrits refoulés dans les faubourgs, à Ciboure, ou la lutte des hommes de Napoléon contre les éléments naturels. Antienne : le Parisien est celui qui connaît le moins bien le Louvre. Il en va des musées comme des baies. Celle de Saint-Jean a l’accent de celle de « San Seba » et de celle de Naples. Rhune, Monte Igueldo, Vésuve ont partie liée. Montagnes douces –volcanique la dernière, elles embrassent concha et baies dans un quotidien sans vagues, d’un mouvement curviligne, que seul le second baiser de Maman Proust réclamé par le petit Marcel peut égaler en soulagement. (...)
Myriam vient de Brest. Encyclopédie gracieuse de l’histoire luzienne, elle raconte mieux qu’un Basque –désolé, l’architecture des maisons d’armateurs, la pêche à la baleine, le mariage de Louis XIV, les Kaskarots, Agotak (cagots), Bohémiens et autres proscrits refoulés dans les faubourgs, à Ciboure, ou la lutte des hommes de Napoléon contre les éléments naturels. Antienne : le Parisien est celui qui connaît le moins bien le Louvre. Il en va des musées comme des baies. Celle de Saint-Jean a l’accent de celle de « San Seba » et de celle de Naples. Rhune, Monte Igueldo, Vésuve ont partie liée. Montagnes douces –volcanique la dernière, elles embrassent concha et baies dans un quotidien sans vagues, d’un mouvement curviligne, que seul le second baiser de Maman Proust réclamé par le petit Marcel peut égaler en soulagement. (...) Myriam Touati rappelle que de nombreux pêcheurs Bretons vinrent à Saint-Jean dans les années 1914. Leurs femmes travaillaient aux conserveries (la dernière a fermé en 1996). Ceci justifie d’une certaine manière la présence, jugée insolite par d’aucuns, d’une boutique à l’enseigne de La Belle-Iloise, sardines en boîte de qualité, dans la rue Gambetta, artère truffée de boutiques de produits basques. À Saint-Jean-de-Luz, on est Adam ou Pariès, c’est-à-dire macaron ou mouchou. Bar Le Suisse ou bar de La Baleine. J’ai un faible pour le second, planqué en retrait de la place Louis XIV. La Baleine, à la naissance de la rue éponyme, est ma querencia luzienne. Je m’y sens bécasse retrouvant sa remise de novembre, hirondelle de retour au nid sous cette poutre et aucune autre. J’aime le côté « pité » du bar, à l’affût, derrière les touristes aux terrasses des bars de la Marine et Majestic. J’aime son unique platane béquillé à la façon d’une toile de Dali et dont les racines soulèvent le goudron. J’y vois une expression dérivée de la force basque." ©L.M.
Myriam Touati rappelle que de nombreux pêcheurs Bretons vinrent à Saint-Jean dans les années 1914. Leurs femmes travaillaient aux conserveries (la dernière a fermé en 1996). Ceci justifie d’une certaine manière la présence, jugée insolite par d’aucuns, d’une boutique à l’enseigne de La Belle-Iloise, sardines en boîte de qualité, dans la rue Gambetta, artère truffée de boutiques de produits basques. À Saint-Jean-de-Luz, on est Adam ou Pariès, c’est-à-dire macaron ou mouchou. Bar Le Suisse ou bar de La Baleine. J’ai un faible pour le second, planqué en retrait de la place Louis XIV. La Baleine, à la naissance de la rue éponyme, est ma querencia luzienne. Je m’y sens bécasse retrouvant sa remise de novembre, hirondelle de retour au nid sous cette poutre et aucune autre. J’aime le côté « pité » du bar, à l’affût, derrière les touristes aux terrasses des bars de la Marine et Majestic. J’aime son unique platane béquillé à la façon d’une toile de Dali et dont les racines soulèvent le goudron. J’y vois une expression dérivée de la force basque." ©L.M.

 Un buste de Jules César a été découvert en Arles en 2007. La nouvelle, secrètement gardée, est "tombée" il y a quelques jours seulement (Une du Monde, jeudi ou vendredi dernier). Il pourrait s'agir du seul buste réalisé du vivant du dictateur romain.
Un buste de Jules César a été découvert en Arles en 2007. La nouvelle, secrètement gardée, est "tombée" il y a quelques jours seulement (Une du Monde, jeudi ou vendredi dernier). Il pourrait s'agir du seul buste réalisé du vivant du dictateur romain.












