"La maison de là-bas" de Lydie Arickx
Reportage paru en janvier 2010 dans feu le magazine Maisons Sud-Ouest.
Comme il y a une actualité Arickx ces temps-ci : exposition marquante, Le Grand Être, au centre d'art contemporain d'Anglet en mars dernier, exposition actuelle en plein air, À Ciel Ouvert, à Hossegor, j’ai cherché le texte que voici. Sans photos. Pour voir le travail de l'artiste => ARICKX
-----
La scène se passe à l'automne 2009 quelque part au sud des Landes, à Angresse. Visite à Lydie Arickx, peintre et sculpteur qui décoiffe, au cœur de sa maison de lumières...
---
À l’origine, c’est la matrice, la maison des racines adoptives. Des origines flamandes n’empêchent pas l’élection du lieu, le choix du cœur, si fort qu’il dépasse le déterminisme des racines. « Ma mère adorait les Landes et, à force d’y passer des vacances, elle voulut y établir les siens. » Ainsi la famille Arickx vécut-elle là. Dans une petite basco-béarnaise ordinaire, plutôt sombre, étroite, ramassée sur elle-même, entourée de friches gourmandes qui gagnaient du terrain à la manière des végétaux froissés dans les contes fantastiques que l’on raconte le soir à des enfants fascinés. C’est la maison des parents, la maison de famille. Là où Lydie Arickx a grandi avant de s’envoler, de papillonner ici et là : études à l’ESAG (école supérieure d’arts graphiques) de Paris, ville où elle vécut jusqu’en 1991. À partir de ce moment-là, tout bascule : elle part s’installer dans les Landes, à Saint-Geours-de-Maremne, douze années durant, puis elle revient, en 2003, là où elle a passé son enfance, à quelques lieues de là, à Angresse, dans la maison des parents, une fois ceux-ci décédés. Ni son frère ni sa sœur ne souhaitant reprendre la matrice, c’est Lydie, son compagnon Alex Bianchi, photographe qui travaille chaque jour dans l’immense atelier de Lydie à maroufler, monter des châssis, photographier tout, et leurs deux fils Baptiste et César, qui vont faire de la maison de l’enfance de Lydie un chef d’ œuvre de demeure contemporaine ouverte à la lumière comme un corps vivant offert à l’amour, et aux prolongements comme des membres faits pour entourer ceux qui y vivent et y accueillent leurs amis ou des rencontres de passage avec ce qu’il faut de génie naturel pour que chacun s’y sente chez soi, entouré d’art et d’amitié. Le contraire de la pieuvre : ici, nul tentacule, mais que des bras aimants.
Lydie a tout cassé, tout contrôlé aussi. Avec, toujours, l’œil complice d’Alex, sa moitié au sens premier du terme, son soutien permanent, son châssis fondamental, l’armature d’une femme peintre et sculpteur, célèbre en Europe, et dont les œuvres font partie du fond du Musée National d’Art Moderne de Paris. Du patrimoine. Elle a vécu dans cette maison de l’âge de cinq ans à l’âge de vingt ans. Elle est revenue s’y établir dans les grandes largeurs à l’âge de quarante-neuf ans. « On a tout agrandi, tout ouvert. Les enfants ont fait pousser des ailes à la maison-mère, à la matrice centrale, au berceau originel. Alex, mon mur porteur, a veillé à tout à mes côtés. Et je n’ai pas perdu un geste de ce que chaque personne chargée des grands travaux a fait. » Lydie a aimé charnellement vivre ce chantier comme si elle avait assisté à la réalisation d’une œuvre gigantesque. Habituée aux immenses toiles, aux fresques de quinze mètres de long, aux lourdes et imposantes sculptures en bronze, la conduite à distance des travaux de renaissance de la « domus » fut pour l’artiste une jubilation permanente. « Bien sûr, les travaux ont été confiés à un architecte Bayonnais de renom, Patrick Arotcharen et à un maçon exceptionnel qui a pratiquement construit la maison tout seul, Alain Lemonnier, mais j’ai infléchi les actes au fur et à mesure de leur apparition. » Lydie considère qu’il est indispensable d’habiter une maison en chantier. Assister chaque coup de pelle, tout accompagner, épauler sans jamais conduire les travaux, apporter les touches nécessaires à l’harmonie des goûts fut une aventure formidable pour la famille. Lydie se souvient de cette période de camping sauvage dans un chantier sans fenêtres, sans toit un temps, des intempéries, des difficultés tournées en dérision, comme d’une expérience créative et de plein contact avec la matière de ce qui devenait, au fil du temps, la maison du bonheur. Une telle « performance », il n’y a pas d’autre mot lorsqu’il s’agit de la maison d’un couple d’artistes, est un incessant ballet de réajustements, un flux constant de personnalisation, de mise en adéquation, de projection dans un quotidien que l’on souhaite parfaitement adapté, sur mesure, fondu enchaîné, souple, en écho à soi-même.
« Une maison, c’est notre espace du corps », dit-elle. Son père et son frère avaient construit une première fois cette maison dans les années soixante-cinq. Le corps originel, c’est eux. La maison-mère, ce sont les hommes du clan qui l’ont bâtie. Ses splendides prolongements, c’est la fille qui les a signés, avec l’aide d’une poignée de spécialistes à l’écoute de chaque membre du clan. « Aujourd’hui, c’est une maison de jubilation. Les lumières y entrent différemment à chaque moment de la journée et ne sont jamais les mêmes selon la saison, le temps… C’est aussi une maison de sons et de bruits sympathiques. L’un de ceux que nous préférons, loin d’être désagréable ou inquiétant, est celui de la pluie d’orage qui avance, avec la force variable du vent, en martelant l’étang depuis la forêt jusqu’aux murs et aux verrières. » La maison de Lydie et Alex est un lieu fondamentalement ouvert. C’est un jeu d’interfaces. Dans l’espace, nous voyons toujours ce qui se passe d’une pièce à l’autre, les gens qui y évoluent ne se sentent pas pour autant regardés. « C’est une maison de communication, au sens fort du terme. Car une maison est davantage qu’un simple abri pour le cocon familial, c’est aussi le reflet de ce que l’on vit chacun, et comment nous vivons ensemble ce cocon, ces relations entre nous et notre relation globale au lieu. » De fait, la maison de Lydie est un lieu d’échanges, de vie, un espace de respect et de liberté de chacun, pris dans une communauté de communication. « Chacun s’affaire à son occupation et tous se sentent rassurés car rassemblés. » L’architecture de la maison a considérablement œuvré dans ce sens : on y évolue, on passe d’une pièce à l’autre en cheminant, en effectuant une sorte de voyage d’une zone commune à un espace privé, et en étant constamment escorté par des œuvres d’art de Lydie, des photos d’Alex, de nombreuses peintures et sculptures d’artistes amis, aussi. Certains meubles sont également sortis des mains imaginatives et adroites d’Alex. Il faut dire que ces deux-là forment un couple insécable d’amoureux réputés fusionnels comme ces oiseaux d’oisellerie nommés inséparables. À la question : êtes-vous attachée à une galerie parisienne comme celle de Jean Briance, Lydie répond spontanément : « je ne suis attachée à rien, sauf à Alex. » Et lui se plait à dire qu’il a arrêté la cigarette, mais qu’il continue de fumer – uniquement - des Arickx… L’addiction est identique.
Il y a beaucoup d’angles de murs en verre, afin que le regard de Lydie ne puisse jamais se trouver arrêté, bloqué par une impossibilité de voir à travers. Ainsi, la nature est omniprésente, puisqu’on peut l’admirer de n’importe quel endroit de cette grande maison aux multiples prolongements et recoins. « Notre maison est devenue en moins de cinq années, une maison de rencontre qui marche beaucoup à l’instinct. Chacun s’y sent libre, y évolue tout de suite sans crainte, naturellement. Qu’il s’agisse de la famille, des amis proches et fréquemment présents, ou bien d’amis de passage, de rencontres nouvelles. Et c’est un grand bonheur de s’apercevoir de cela, que cette connivence entre le lieu et l’Autre opère facilement. C’est magique et ce n’est pas un hasard. » Pour Lydie comme pour Alex, leur maison est le reflet de leur « posture de vie », de leur attitude face à la vie. « La maison parle d’ailleurs pour nous, enchérit-elle, et la refaire complètement m’a considérablement ouverte. Nous sommes, elle et moi, entièrement tournées vers la lumière. » L’atelier de l’artiste, où elle se rend chaque jour avec Alex, est l’ancienne usine de son père, où étaient fabriqués des socles en béton pour compteurs électriques. Elle est au bout d’un chemin, sur la propriété, et il s’agit d’un espace gigantesque, à la mesure des travaux de Lydie, avec une partie dédiée à la peinture, et une autre à la sculpture. Une hauteur sous plafond de cathédrale –une chance, eu égard à la production incessante de l’artiste-, permet de stocker toiles, dessins et sculptures. « Prendre ce chemin à pied m’est une respiration indispensable. Il me permet à la fois de lâcher prise et de me préparer à attaquer une œuvre. » La maison de Lydie Arickx n’a pas de nom. « Nous avons pensé à la maison de là-bas, à la maison du bout du rien, à la maison du bout du chemin de là-bas, aussi. Elle n’a en réalité pas besoin d’être nommée. De toute façon, ces choses-là, ce baptême-là ne se décident pas, si elle doit porter un nom, celui-ci s’imposera un jour à elle-même. Et à nous. Nos chats non plus n’ont pas de nom. » Pas plus que les canards colverts et les oies grises, d’Égypte et bernaches nonettes qui volent, broutent ou barbotent près du magnifique étang. Un étang artificiel qui a une histoire singulière. Il n’a pas cinq ans. Un jour, Alex et ses fils se sont attaqués à la jungle de vergnes qui envahissait le parc devant la maison, bouchait l’horizon, menaçait d’étrangler le terrain. Ce jour-là, un sourcier de la région vint les voir. Personne ne l’avait requis, cependant il avait senti qu’il lui fallait venir. Comme Gérard Gauyat connaissait parfaitement le terrain, il indiqua avec précision la nature du sol de chaque parcelle et la présence de chaque source. Ainsi, une fois le terrain élagué, totalement défriché, puis creusé, il fut relativement simple de le mettre en eau et de faire un étang artificiel. Le rêve de Lydie se réalisa. Et Gérard lui apprit aussi que c’était le rêve secret de son géniteur. Ainsi, la fille accomplît-elle sans le savoir un double souhait profond. Gérard Gauyat est mort peu de temps avant la fin des travaux, en 2003. Aujourd’hui, il semble avoir toujours existé, apporte une atmosphère infiniment paisible, qui tranche avec le tumulte des chairs, contenu dans la peinture de Lydie. Entre la maison, l’étang et l’immense atelier, il y a un chemin de paix. Et entre Lydie et son art, il y a l’esprit du lieu. La magie de « la maison de là-bas »… L.M.



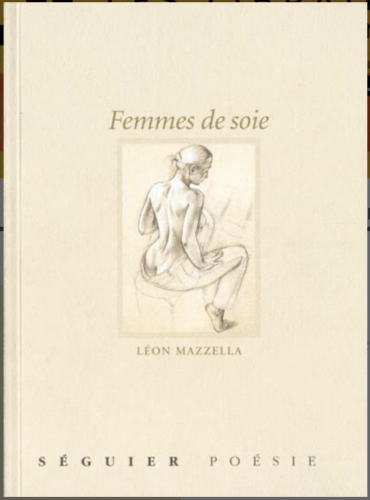



 Venez tous). L’espace s’y prête « qui autorise une vue d’ensemble, de loin, et aussi de pouvoir s’approcher très près de chaque cadre afin d’en lire les détails », dit-elle, « d’observer les traits, le regard, les tâches, les écailles de chaque poisson mis en scène en noir de seiche... & blanc ». C’est en réalité à une visite d’un « aquarium à sec » qu'il s'agit, qui n’est ni le musée de la Mer de Biarritz ni l’aquarium de La Rochelle ou celui de San Diego, mais la projection scénographiée d’une femme audacieuse et créative jusqu’au bout des ongles, ayant à cœur de faire œuvre de la pêche de son homme avant de la lui cuisiner. L’intention est donc, philosophiquement et sans le vouloir, puissante. Et admirable. Et cela passe par l’encre de seiche dont
Venez tous). L’espace s’y prête « qui autorise une vue d’ensemble, de loin, et aussi de pouvoir s’approcher très près de chaque cadre afin d’en lire les détails », dit-elle, « d’observer les traits, le regard, les tâches, les écailles de chaque poisson mis en scène en noir de seiche... & blanc ». C’est en réalité à une visite d’un « aquarium à sec » qu'il s'agit, qui n’est ni le musée de la Mer de Biarritz ni l’aquarium de La Rochelle ou celui de San Diego, mais la projection scénographiée d’une femme audacieuse et créative jusqu’au bout des ongles, ayant à cœur de faire œuvre de la pêche de son homme avant de la lui cuisiner. L’intention est donc, philosophiquement et sans le vouloir, puissante. Et admirable. Et cela passe par l’encre de seiche dont  elle enduit chaque poisson pris dans le Gouf, au lancer, au leurre souple, au madaï, à la turlutte, à l’ascenseur, les techniques variant chaque jour, à chaque marée, selon d’ésotériques critères, parfois...
elle enduit chaque poisson pris dans le Gouf, au lancer, au leurre souple, au madaï, à la turlutte, à l’ascenseur, les techniques variant chaque jour, à chaque marée, selon d’ésotériques critères, parfois... Ainsi, tout a... maille à partir avec la pêche, puisque « je fabrique des poissons, des crustacés, des mollusques avec ce qui a permis de les capturer : les fils du filet ou d’une ligne. Chaque poisson ou crustacé reprend sa forme avec l’outil de sa prise et donc de sa mise à mort ». La boucle. L’omniprésence de l’esprit de la boucle... « J’étais devant mon premier aquarium de poissons-filets, lorsque, au cours du premier confinement, au printemps 2019, une amie m’a parlé de la technique japonaise inventée en 1862, du Gyotaku (titre de l’exposition en cours). Il s’agit de « l’art d’immortaliser des poissons en prenant leur empreinte sur du papier afin de réaliser une estampe ». Cette technique est née du désir d’un seigneur d’offrir à l’empereur l’image d’une magnifique daurade, symbole de bonheur.
Ainsi, tout a... maille à partir avec la pêche, puisque « je fabrique des poissons, des crustacés, des mollusques avec ce qui a permis de les capturer : les fils du filet ou d’une ligne. Chaque poisson ou crustacé reprend sa forme avec l’outil de sa prise et donc de sa mise à mort ». La boucle. L’omniprésence de l’esprit de la boucle... « J’étais devant mon premier aquarium de poissons-filets, lorsque, au cours du premier confinement, au printemps 2019, une amie m’a parlé de la technique japonaise inventée en 1862, du Gyotaku (titre de l’exposition en cours). Il s’agit de « l’art d’immortaliser des poissons en prenant leur empreinte sur du papier afin de réaliser une estampe ». Cette technique est née du désir d’un seigneur d’offrir à l’empereur l’image d’une magnifique daurade, symbole de bonheur. 






 Et puis le père de Manu est présent aussi, il est « dans la boucle », car il a appris à sa fille à cuisiner le poisson (et pas que), ce qu’elle fait quotidiennement avec amour et application. « Lorsque Poupi – alias Jean-Louis Poupinel – apporte le fruit de sa pêche quotidienne, « je prends donc l’empreinte de chaque poisson en le badigeonnant d’encre de seiche, puis je pose le poisson sur du papier ou sur du drap. Le corps s’imprime, y compris les tâches, l’œil, les blessures, des rayures par exemple, et je les travaille grâce à ma mémoire visuelle, je retouche en quelque sorte. Je fais ça à l’instinct aussi, je restitue du mieux que je peux l’âme du poisson à travers son œil ». C’est le lieu de toutes les concentrations, comme pour le regard humain, en somme. Ainsi les poissons morts retrouvent-ils une vivacité. Un vrai regard de vivant. « Certains sont romantiques, d’autres semblent apeurés, d’autres encore expriment leur colère ». Nous parcourons lentement l’expo. Manu Dubarry s’arrête devant un chinchard encadré. « Il était très bon en ceviche, lui ». Et avoue adorer manger les « parpaillettes », les bas-joues des poissons, situées sur les côtés de la tête (à ne pas confondre avec les kokotxas de merlu, par exemple, qui se situent sous la mâchoire inférieure de cette espèce-là).
Et puis le père de Manu est présent aussi, il est « dans la boucle », car il a appris à sa fille à cuisiner le poisson (et pas que), ce qu’elle fait quotidiennement avec amour et application. « Lorsque Poupi – alias Jean-Louis Poupinel – apporte le fruit de sa pêche quotidienne, « je prends donc l’empreinte de chaque poisson en le badigeonnant d’encre de seiche, puis je pose le poisson sur du papier ou sur du drap. Le corps s’imprime, y compris les tâches, l’œil, les blessures, des rayures par exemple, et je les travaille grâce à ma mémoire visuelle, je retouche en quelque sorte. Je fais ça à l’instinct aussi, je restitue du mieux que je peux l’âme du poisson à travers son œil ». C’est le lieu de toutes les concentrations, comme pour le regard humain, en somme. Ainsi les poissons morts retrouvent-ils une vivacité. Un vrai regard de vivant. « Certains sont romantiques, d’autres semblent apeurés, d’autres encore expriment leur colère ». Nous parcourons lentement l’expo. Manu Dubarry s’arrête devant un chinchard encadré. « Il était très bon en ceviche, lui ». Et avoue adorer manger les « parpaillettes », les bas-joues des poissons, situées sur les côtés de la tête (à ne pas confondre avec les kokotxas de merlu, par exemple, qui se situent sous la mâchoire inférieure de cette espèce-là).

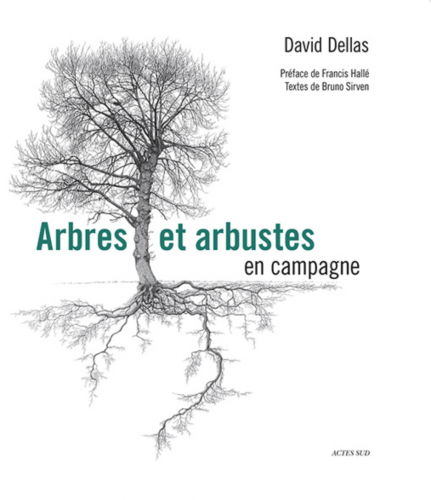 C’est un livre magnifique composé essentiellement (de plus de 120) dessins de David Dellas, artiste de grand talent, conseiller technique au sein d’Arbre & Paysage 32, rugbyman, ainsi que de textes de Bruno Sirven, géographe, et d’une préface du botaniste Francis Hallé. « Arbres et arbustes en campagne » (Actes Sud, 30€, 2è éd. Juillet 2019), fait écho à l’exposition « Nous les Arbres », qui se tient à la Fondation Cartier pour l’art contemporain (Paris) jusqu’au 10 novembre. Ces dessins d’un réalisme puissant, méticuleux, délicat, d’arbres et arbustes champêtres : frêne, aulne, érable, buis, charme, bouleau, peuplier, chêne, marronnier, figuier, sureau, pommier, mûrier, haies... sont formidables de précision et de poésie. Ils nous permettent de renouer avec une tradition des sciences naturelles, en particulier la botanique, qui est de représenter le vivant, le végétal par le dessin ou la gravure. Ainsi, la pédagogie s’associe-t-elle à l’art. Les arbres sont représentés nus, ce qui permet le détail, et avec leurs racines. Les feuilles et les fruits font l’objet de planches distinctes. Ce sont des arbres familiers, que l’on a coutume de voir dans le paysage des campagnes, mais que nous négligeons d’observer, qui sont ici l’objet d’une véritable performance esthétique obéissant à un sens de l’observation hors du commun, allié à une grande sobriété. Les textes s’attardent avec justesse aux bienfaits de chaque « arbre hors forêt », inscrit dans un biotope qu’il épouse – comme l’aulne et la rivière, à la quantité de ressources qu’il produit, à ses rôles bienfaiteurs pour l’écologie, la biodiversité, les agrosystèmes, et pour l’homme – qu’il soit agriculteur ou promeneur. L’arbre purifie l’eau, retient les sols et les protège, accueille quantité d’êtres vivants (insectes, oiseaux, petits mammifères), stocke l’excès de carbone, oxygène l’air, produit de la biomasse, de l’énergie, des écomatériaux, protège du vent, rend les sols vivants, il paysage et aménage l’espace qu’il occupe, redistribue l’énergie solaire, réconcilie l’agriculture avec l’environnement, longtemps opposés, car le modèle agro-sylvo-pastoral souffre souvent d’un manque de complémentarité. L’arbre n’est-il pas tout à la fois paravent, parapluie, parasol, garde-boue, garde-manger, et bien plus encore ? Il doit cesser d’être perçu et utilisé comme « une astuce cosmétique pour camoufler des sites disgracieux », et d'être combattu, abattu par l'agriculture intensive. Plaidoyer pour le « réarbrement », militant d’une politique de l’arbre – non forestier - au sein du territoire, l’ouvrage n’est pas qu’artistique, élégant, sensible, bouleversant par son dénuement chromatique, sa texture, même s’il se contemple bien davantage qu’il ne se lit. Les textes qui l’ornent sont brefs mais denses, ligneux... Ils nous apprennent enfin un glossaire singulier où il est question de taille (émondage et étêtage), de têtards, de trognes, de ragosses, de cépée, de sessille, de drageon, de marcotte, de mycorhize, de nodosité, de phrygane, et autres suber et tire-sève. Un petit bijou, ce bouquin. L.M.
C’est un livre magnifique composé essentiellement (de plus de 120) dessins de David Dellas, artiste de grand talent, conseiller technique au sein d’Arbre & Paysage 32, rugbyman, ainsi que de textes de Bruno Sirven, géographe, et d’une préface du botaniste Francis Hallé. « Arbres et arbustes en campagne » (Actes Sud, 30€, 2è éd. Juillet 2019), fait écho à l’exposition « Nous les Arbres », qui se tient à la Fondation Cartier pour l’art contemporain (Paris) jusqu’au 10 novembre. Ces dessins d’un réalisme puissant, méticuleux, délicat, d’arbres et arbustes champêtres : frêne, aulne, érable, buis, charme, bouleau, peuplier, chêne, marronnier, figuier, sureau, pommier, mûrier, haies... sont formidables de précision et de poésie. Ils nous permettent de renouer avec une tradition des sciences naturelles, en particulier la botanique, qui est de représenter le vivant, le végétal par le dessin ou la gravure. Ainsi, la pédagogie s’associe-t-elle à l’art. Les arbres sont représentés nus, ce qui permet le détail, et avec leurs racines. Les feuilles et les fruits font l’objet de planches distinctes. Ce sont des arbres familiers, que l’on a coutume de voir dans le paysage des campagnes, mais que nous négligeons d’observer, qui sont ici l’objet d’une véritable performance esthétique obéissant à un sens de l’observation hors du commun, allié à une grande sobriété. Les textes s’attardent avec justesse aux bienfaits de chaque « arbre hors forêt », inscrit dans un biotope qu’il épouse – comme l’aulne et la rivière, à la quantité de ressources qu’il produit, à ses rôles bienfaiteurs pour l’écologie, la biodiversité, les agrosystèmes, et pour l’homme – qu’il soit agriculteur ou promeneur. L’arbre purifie l’eau, retient les sols et les protège, accueille quantité d’êtres vivants (insectes, oiseaux, petits mammifères), stocke l’excès de carbone, oxygène l’air, produit de la biomasse, de l’énergie, des écomatériaux, protège du vent, rend les sols vivants, il paysage et aménage l’espace qu’il occupe, redistribue l’énergie solaire, réconcilie l’agriculture avec l’environnement, longtemps opposés, car le modèle agro-sylvo-pastoral souffre souvent d’un manque de complémentarité. L’arbre n’est-il pas tout à la fois paravent, parapluie, parasol, garde-boue, garde-manger, et bien plus encore ? Il doit cesser d’être perçu et utilisé comme « une astuce cosmétique pour camoufler des sites disgracieux », et d'être combattu, abattu par l'agriculture intensive. Plaidoyer pour le « réarbrement », militant d’une politique de l’arbre – non forestier - au sein du territoire, l’ouvrage n’est pas qu’artistique, élégant, sensible, bouleversant par son dénuement chromatique, sa texture, même s’il se contemple bien davantage qu’il ne se lit. Les textes qui l’ornent sont brefs mais denses, ligneux... Ils nous apprennent enfin un glossaire singulier où il est question de taille (émondage et étêtage), de têtards, de trognes, de ragosses, de cépée, de sessille, de drageon, de marcotte, de mycorhize, de nodosité, de phrygane, et autres suber et tire-sève. Un petit bijou, ce bouquin. L.M.











 Valloton franc de la fesse molle (oui, je sais, je fais mon snob : ayant raté l'expo à Paris, je suis allé la voir à Amsterdam. Carrément - au musée Van Gogh, et ouais : prononcez van-kkhhheeuuhh comme si vous crachiez un vieux glaviot n°3 dans les tournesols arlésiens). Des sucettes à l'amende (même pas!). Des lieux d'aisance aériens. Des vélos partout, même là. Un commerce de bouche qui ne vexera personne.
Valloton franc de la fesse molle (oui, je sais, je fais mon snob : ayant raté l'expo à Paris, je suis allé la voir à Amsterdam. Carrément - au musée Van Gogh, et ouais : prononcez van-kkhhheeuuhh comme si vous crachiez un vieux glaviot n°3 dans les tournesols arlésiens). Des sucettes à l'amende (même pas!). Des lieux d'aisance aériens. Des vélos partout, même là. Un commerce de bouche qui ne vexera personne.








 pote Spinoza! Un magasin avec que des capotes à vendre.
pote Spinoza! Un magasin avec que des capotes à vendre. 

 C'est un lumineux jeu de mots. Nous devons c
C'est un lumineux jeu de mots. Nous devons c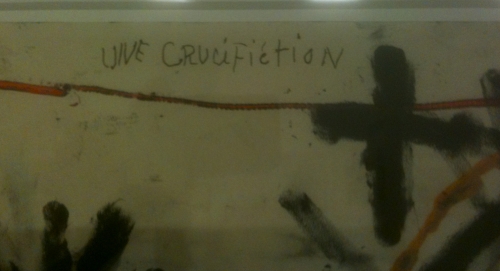
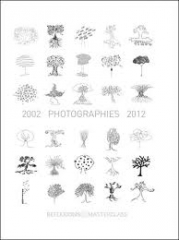




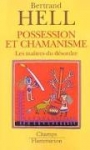

 premier mai, de 11h à 20h.
premier mai, de 11h à 20h. 
 C'est l'année Klimt : ça ne se rate pas, si l'on aime ce peintre génial. Et l'occasion d'aller voir plus de toiles du maître Gustav Klimt qu'il n'y en a jamais eu à Vienne, est aussi celle de contempler l'oeuvre de son disciple Egon Schiele (sans Klimt, pas de Schiele). Pour cela seulement, et à condition d'admirer l'un et l'autre peintres, le voyage est indispensable en 2012 (rendez vous aux musées Leopold et Belvedere, principalement). Vienne, c'est aussi se faire plaisir en revoyant des toiles fétiches, un petit Friedrich ici, un Velasquez là. Cette ville musée, qui est aussi celle du bon café,
C'est l'année Klimt : ça ne se rate pas, si l'on aime ce peintre génial. Et l'occasion d'aller voir plus de toiles du maître Gustav Klimt qu'il n'y en a jamais eu à Vienne, est aussi celle de contempler l'oeuvre de son disciple Egon Schiele (sans Klimt, pas de Schiele). Pour cela seulement, et à condition d'admirer l'un et l'autre peintres, le voyage est indispensable en 2012 (rendez vous aux musées Leopold et Belvedere, principalement). Vienne, c'est aussi se faire plaisir en revoyant des toiles fétiches, un petit Friedrich ici, un Velasquez là. Cette ville musée, qui est aussi celle du bon café,  du bon chocolat et des bars à vins, est également le repaire d'une certaine mémoire littéraire que l'on s'efforce de chercher en flânant dans les rues, en traînant dans les cafés (certains ont conservé
du bon chocolat et des bars à vins, est également le repaire d'une certaine mémoire littéraire que l'on s'efforce de chercher en flânant dans les rues, en traînant dans les cafés (certains ont conservé 
 tombai en arrêt, littéralement, devant ma peinture préférée à cette époque et dont j'avais une copie à l'échelle 1 dans ma chambre d'adolescent -nous vivions ensemble, en quelque sorte (il s'agit des "Chasseurs dans la neige", de Bruegel) et comme j'ignorais que l'original se trouvait là, ce me fut un choc pictural énorme. Revoir ce tableau la semaine dernière fut forcément moins terrible. De même, tandis qu'on cherche dans la nuit viennoise et dans un dédale de ruelles un bon Heurige (taverne à vins), tomber
tombai en arrêt, littéralement, devant ma peinture préférée à cette époque et dont j'avais une copie à l'échelle 1 dans ma chambre d'adolescent -nous vivions ensemble, en quelque sorte (il s'agit des "Chasseurs dans la neige", de Bruegel) et comme j'ignorais que l'original se trouvait là, ce me fut un choc pictural énorme. Revoir ce tableau la semaine dernière fut forcément moins terrible. De même, tandis qu'on cherche dans la nuit viennoise et dans un dédale de ruelles un bon Heurige (taverne à vins), tomber Une importante exposition de l’artiste catalan : « Antoni Tapies. Les Lieux de l’art », accompagne une réouverture très attendue.
Une importante exposition de l’artiste catalan : « Antoni Tapies. Les Lieux de l’art », accompagne une réouverture très attendue.


 L'expo qui lui est consacrée (car il aurait 100 ans le 14 juin prochain) à la BNF à Paris, est Extra-Ordinaire. Il est infiniment émouvant de lire le manuscrit de fragments qui nous portent depuis des kilos d'années, qui sont comme des bouées en cas d'avarie, des papillons contre les scaphandres (allez voir le film tiré du très beau texte de Jean-Do. Bauby, au passage : Le Scaphandre et le Papillon) des visas contre le désenchantement du monde...
L'expo qui lui est consacrée (car il aurait 100 ans le 14 juin prochain) à la BNF à Paris, est Extra-Ordinaire. Il est infiniment émouvant de lire le manuscrit de fragments qui nous portent depuis des kilos d'années, qui sont comme des bouées en cas d'avarie, des papillons contre les scaphandres (allez voir le film tiré du très beau texte de Jean-Do. Bauby, au passage : Le Scaphandre et le Papillon) des visas contre le désenchantement du monde... Carmen est de plus en plus belle. Picasso l'a magnifiée puissamment. Il disait : La peinture est plus forte que moi, elle fait ce qu'elle veut de moi, ou quelque chose approchant. La peinture gagne ainsi sur la musique (l'Opéra funèbre de Bizet) et sur la littérature (la nouvelle de Mérimée). Le mythe à la peau fine et mate, dure. Carmen signifie charme, en Espagnol. Ce portrait (repris pour l'affiche de l'émouvante expo qui se tient au Musée Picasso, rue de Thorigny, Paris
Carmen est de plus en plus belle. Picasso l'a magnifiée puissamment. Il disait : La peinture est plus forte que moi, elle fait ce qu'elle veut de moi, ou quelque chose approchant. La peinture gagne ainsi sur la musique (l'Opéra funèbre de Bizet) et sur la littérature (la nouvelle de Mérimée). Le mythe à la peau fine et mate, dure. Carmen signifie charme, en Espagnol. Ce portrait (repris pour l'affiche de l'émouvante expo qui se tient au Musée Picasso, rue de Thorigny, Paris 3ème) le confirme. Précision : il ne s'agit pas d'un Picasso, mais d'une carte postale brodée dans le plus pur kitsch Madrilène des grandes années, signée Esperon et intitulée Femme à la mantille. A chacun sa Carmen. Et celle de Picasso, c'est plutôt dans le registre accouplement de Dora et du Minotaure (à droite) qu'il faut aller la chercher, je crois...
3ème) le confirme. Précision : il ne s'agit pas d'un Picasso, mais d'une carte postale brodée dans le plus pur kitsch Madrilène des grandes années, signée Esperon et intitulée Femme à la mantille. A chacun sa Carmen. Et celle de Picasso, c'est plutôt dans le registre accouplement de Dora et du Minotaure (à droite) qu'il faut aller la chercher, je crois...