My Funny Ventoline
Il ne s'agit pas d'un hommage à Chet Baker (My Funny Valentine), mais d'un texte très personnel que j'ai donné en mai 2021 à un magazine en ligne que j'aime beaucoup, L'Intimiste.
C'est mon ami Didier Pourquery qui m'avait incité à le faire auprès de Sandrine Tolotti, qui pilote cette délicate lettre littéraire à laquelle je recommande de s'abonner.
Je suis retombé dessus après avoir discuté ce matin avec un ami d'asthme littéraire (voir la note précédente).
Je le re-délivre (l'heure est à la reprise). Cliquez sur le lien ci-dessous, et déroulez jusqu'à La carte blanche => My funny Ventoline Ou bien lisez ci-dessous.
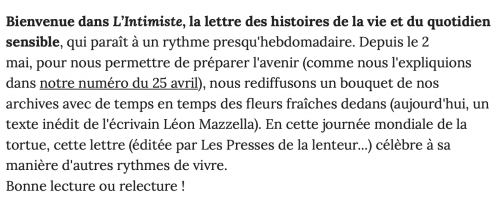
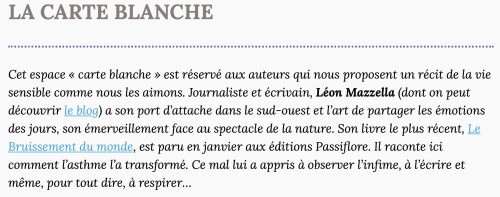
Par Léon Mazzella
Surtout, je ne parvenais pas à l’exprimer, comme s’il s’agissait d’une honte, oui, d’une honte. Pire, je crois qu’il m’était acquis que cela devait se passer ainsi. Ne pas parler de ce qui ne va pas, de ce qui fait mal, de ce qui empêche. Telle me semblait être la règle unique. Garder la bouche fermée, les dents serrées. As-tu bien dormi mon fils – Oui papa. Tiens, mange tes tartines, ne te mets pas en retard. Never complain. Et, davantage, en l’occurrence, never explain ; travail d’amont. Les années douloureuses furent nombreuses. Une vingtaine. C’est beaucoup. Vraiment. Ma seule paix, durant tant et tant de nuits, je la trouvai debout, me forçant à lutter contre le sommeil qui m’envahissait pourtant, et à marcher dans la maison, en bas, entre salon et cuisine, et dans le jardin, pieds nus l’été, chaussé l’hiver.
Puisque c’est dehors la nuit que j’ai commencé d’éprouver la nature, je remercie l’asthme de m’avoir familiarisé avec la voûte céleste, avec la voie lactée que j’ai apprise, avec le hululement de la chouette effraie, de la hulotte, de la chevêche, avec l’air chargé de vase et de marée – nous habitions au-dessus de la Nive, à Bayonne, qui charriait deux fois par jour ses remugles montagnards et campagnards à l’aller, et marins au retour. Je le remercie de m’avoir permis d’apprivoiser cette tisane froide des parfums nocturnes de l’herbe, et aussi l’odeur de la rosée, cette autre qui composait un bouquet lié d’une infusion précieuse, une liasse dans laquelle le chèvrefeuille se frottait à la menthe, la rose trémière au tilleul, le gazon tondu à la terre gorgée d’eau. J’écoutais les grenouilles, les crapauds aussi, le chuintement du vol des hiboux, le passage d’un sphinx, gros papillon de nuit, qui venait se cogner au lampadaire municipal, devant le portail de la maison, le passage furtif d’un chat de gouttière, la fuite suave d’un ragondin au poil gominé, car il en traînait, qui remontaient de la rivière, pour venir brouter à l’aise et à l’insu des chiens de garde.
Nous n’avions pas le droit d’être malade, à la vérité. Une sorte d’inhibition causée par la peur de mes parents de voir un de leurs enfants souffrant – mes deux sœurs et moi-même -, m’envahissait. Au moindre éternuement, notre père déclenchait un plan de riposte médical qui, par sa démesure, était grotesque. Mais ça, un enfant le ressent, mais il ne peut encore le dire. Aussi, ai-je toujours étouffé mes éternuements. Le moindre chatouillement de la gorge entrainant un début de toux m’effrayait : ne pouvant la retenir, j’étais aussitôt démasqué, je perdais ma paix, je ne m’appartenais plus. Repéré, objet d’une attention stupide, j’étais aussitôt diminué, réduit à une chose fragile et en danger, dépendante, qu’il fallait calfeutrer, confiner, enfermer, soigner afin d’endiguer le spectre d’un mal plus grand. Je ne sais d’où venait cette frousse de perdre leurs enfants qui animait des parents devenus tellement protecteurs que leur prudence excessive interdisait que nous puissions nous armer en fabriquant des anticorps. En conséquence, ma petite crainte m’obligeait à taire toute égratignure, toute douleur. Mon oreiller absorbait les sons de la toux et de chaque éternuement. La honte d’être malade prit ainsi le relais de la peur. Le sentiment d’être en faute, de faire mal en tombant malade m’étreignait à chaque bronchite. Ainsi passèrent la fin de mon enfance, mon adolescence, et les premières années de ma vie d’homme. L’apparition de l’asthme avait enclenché ces années clandestines.
En 1980, j’avais vingt-deux ans, la disparition de mon grand-père augmenta le rythme de mes crises nocturnes, bien que celles-ci survenaient surtout le week-end, désormais, car j’étais étudiant à Bordeaux, où mes nuits étaient plus paisibles, parfois profondes. Une question d’humidité, sans doute. Mes bronches rétrécirent de tristesse, je ne m’habituais pas à leur chuintement aigu à chaque respiration forcée. Les muscles des épaules et du torse étaient fourbus de devoir se distendre afin d’augmenter la capacité d’une cage thoracique continuellement sollicitée ; par force. Un jour, un copain de lycée, « grand » asthmatique de naissance, me tendit son flacon coudé bleu ciel recouvert d’un bouchon bleu marine. Mais, comme il m’avait déjà dit que son usage l’avait conduit à plusieurs reprises à l’hôpital car il y avait un risque cardiaque à l’utiliser, je refusai. La peur, sans doute, de me retrouver hospitalisé et de recevoir la visite de mes parents, qui transformeraient ma chambre en cellule stérile, en prison à vie, me paniqua. Même si l’étau ne prenait pas de vacances, je choisis de continuer de lutter, de ne pas dormir, d’entamer mes journées épuisé, perclus de courbatures, vermoulu, avec l’impression d’avoir été roué de coups.
Ainsi jusqu’à ce jour de 1991, en pleine brousse, au nord du Burkina Faso. Une crise m’avait soudain saisi à la tombée de la nuit, alors que l’asthme commençait à me laisser en paix depuis quelques années. Il ne s’acharnait plus, mais lorsqu’il resurgissait, il devenait intraitable, ses mâchoires ne desserraient pas. Me voyant empêtré, ayant reconnu les sifflements caractéristiques, un voyageur présent au campement me lança : « Vous semblez avez oublié votre Ventoline en France ». Je répondis que je n’en avais pas, et que je n’en avais encore jamais utilisé. En guise de réponse, il me tendit le petit spray bleu qui ne le quittait pas : « Tenez, vous allez voir, ça va passer tout de suite. Retournez-le, mettez-le dans la bouche et inspirez à fond tout en appuyant dessus. C’est comme ça que ça marche. Allez-y ! ». Je ne réfléchis pas, ôtai le capuchon et envoyai ma première bouffée dans les poumons. Ce fut un choc. La naissance d’un nouveau bonheur. Un miracle. L’apparition de la Vierge. Un orgasme. Un coup de foudre. L’expérience de la sidération. Subjugué, car instantanément débarrassé des griffes du mal, j’éclatais de rire bêtement comme un enfant qui ouvre une pochette-surprise. L’effet fulgurant du salbutamol, la molécule unique composant la Ventoline, son effet bronchodilatateur, m’apparut comme quelque chose d’absolument magique. D’un seul pschitt, d’une seule bouffée de rien du tout, je pouvais annihiler une crise sur l’instant, lors qu’il m’avait fallu jusque-là patienter douloureusement une nuit entière jusqu’à l’aube et au-delà, pour en voir diminuer chacune à mesure, ce jusqu’à l’effacement total. Seule l’anesthésie générale que je subis longtemps après – cette impression de partir inexorablement, de glisser comme du sable entre les doigts disjoints -, produisit un effet comparable mais à l’envers sur mon corps et ma conscience. Je ne conçus aucun regret d’avoir perdu tant de temps. Je n’en voulus jamais à mes parents de m’avoir d’une certaine façon empêché de leur parler du mal dont je souffrais. Je tirais au contraire une certaine fierté de m’être débrouillé par moi-même, de façon empirique certes, mais tout seul.
Depuis, comme chaque allergique, je ne puis me déplacer sans ma Ventoline. Et même si je n’en ai plus l’usage, mon asthme ayant fini par capituler, il me faut quand même (s)avoir un, voire plusieurs sprays pas loin : table de chevet, boîte à gants, sac de week-end. L’oublier pourrait provoquer une angoisse telle qu’elle déclencherait une crise. Aussi, le flacon bleu ciel à bout bleu marine fait-il constamment partie de mon viatique. Aujourd’hui, lorsque la date de péremption est dépassée, je les jette sans les avoir utilisés une seule fois. Et je m’en procure d’autres. Au cas où.
Je remercie aussi cette tentation de mettre ses enfants en couveuse, car se sentir épié en permanence – pour son bien -, génère un besoin de fuir, une soif de solitude. L’envie de s’en sortir. D’apprendre à. Engendre l’aversion pour toute aide. Entretient le devoir de ne jamais se plaindre. Voire celui d’endurer avec stoïcisme. De ne jamais passer pour une victime. D’affronter les éléments, de regarder le soleil en face sans le recours aux lunettes protectrices, d’endurcir son corps, de marcher pieds nus sur le sable brûlant, de prendre des coups et d’en donner parfois. De braver le froid comme la chaleur, la faim et la soif, les ronces comme les vagues. Je pris très tôt le contrepied. J’en conçus une urgente nécessité, un besoin vital. Il me fallut d’abord vérifier qu’un rhume n’est pas mortel et qu’une chute de vélo ne rend pas tétraplégique. Puis, que le surf ou l’escalade ne sont pas des activités si périlleuses qu’on le prétend. Plus tard, que voyager forge la jeunesse. Que courir l’encierro à Pampelune devant les toros envoie sa dose merveilleuse d’adrénaline. C’est donc peut-être grâce à cette surprotection initiale que j’ai toujours aimé braver le risque, faire l’expérience de mes limites, me mettre en danger. Aussi, n’est-ce pas un hasard si j’ai découvert la Ventoline en brousse, après une journée d’approche d’un troupeau de buffles, armé de jumelles, au cours de laquelle je fis une rencontre décisive avec le regard d’un lion.
Reste que l’asthmatique manque d’air, s’il ne manque pas de courage. La course de fond ne sera jamais une discipline dans laquelle il brillera. La course de vitesse sur courte distance (80, 100 m) oui. La nouvelle davantage que le roman. Les histoires d’amour brèves. L’aventure forte, puis classée sans suite. Faire court, ce n’est pas si mal. Que Proust, asthmatique notoire, ait pu écrire une œuvre si ample, aux phrases si longues qu’elles essoufflent leur lecteur à voix haute, laisse penser en somme que son encre était du salbutamol. Funny Ventoline… L.M.