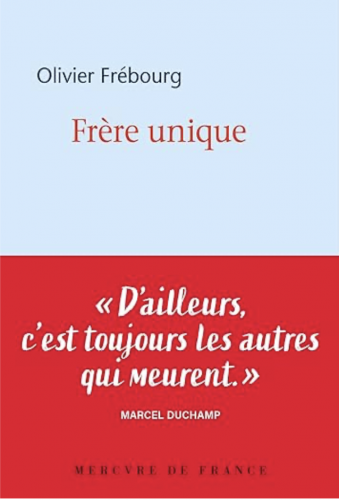 Parmi mes lectures marquantes au cours de cette année qui s’achève ce soir, je retiendrai une petite poignée de livres émouvants, à commencer par « Frère unique », d’Olivier Frébourg (Mercure de France), récit poignant, à la limite de l’insoutenable parfois, sur la disparition tragique, accidentelle, et injuste de son frère Thierry, « ponte » de la médecine, chercheur généticien de renommée mondiale et victime d’une minable erreur médicale sur le lieu même où il officia tant d’années : l’hôpital de Rouen – rendu coupable de n’avoir de surcroît jamais vraiment reconnu sa faute, ce qui donne lieu à des pages enragées de la part du frère meurtri et inconsolable ; révolté. Double peine. Mais ce livre intime (Olivier Frébourg avait déjà donné « Gaston et Gustave » sur la disparition d’un de ses fils grand prématuré, et – ai-je envie d’ajouter, « La grande nageuse », sur la douloureuse séparation d’avec la mère de tous ses fils) brille avant tout par les souvenirs d’enfance heureuse de deux frères sous le soleil des Antilles où la famille vécut un temps, de 1969 à 1972, puis en Normandie, berceau familial, car le père est un brillant commandant de Marine (officier de la Transat, il fut pressenti pour prendre le commandement du France). Nous savons Olivier Frébourg, écrivain de Marine, habité par la mer. Nous le découvrons ici « frère et fier » de son frère, son « pilier lumineux », qu’il admire sans ambages. « Nous étions des brotherships », écrit-il joliment. « J’étais enfant de la mélancolie. Il était le soleil. J’étais la lune ». L’écrivain Frébourg appelle alors à la rescousse ses vieux compagnons, Hemingway, Ovide, Dante, Virgile, Hugo, Reverzy, Buzzati, Chatwin, Brauquier et autres trafiquants d’exotisme, les poètes, les oiseaux aussi, tout fait baume, ou devrait pouvoir panser... L’ouvrage est bouleversant de bout en bout qui vous traverse de part en part. Je me souviens que, le livre achevé, mes mains tremblaient et j’avais le cœur serré comme une gorge.
Parmi mes lectures marquantes au cours de cette année qui s’achève ce soir, je retiendrai une petite poignée de livres émouvants, à commencer par « Frère unique », d’Olivier Frébourg (Mercure de France), récit poignant, à la limite de l’insoutenable parfois, sur la disparition tragique, accidentelle, et injuste de son frère Thierry, « ponte » de la médecine, chercheur généticien de renommée mondiale et victime d’une minable erreur médicale sur le lieu même où il officia tant d’années : l’hôpital de Rouen – rendu coupable de n’avoir de surcroît jamais vraiment reconnu sa faute, ce qui donne lieu à des pages enragées de la part du frère meurtri et inconsolable ; révolté. Double peine. Mais ce livre intime (Olivier Frébourg avait déjà donné « Gaston et Gustave » sur la disparition d’un de ses fils grand prématuré, et – ai-je envie d’ajouter, « La grande nageuse », sur la douloureuse séparation d’avec la mère de tous ses fils) brille avant tout par les souvenirs d’enfance heureuse de deux frères sous le soleil des Antilles où la famille vécut un temps, de 1969 à 1972, puis en Normandie, berceau familial, car le père est un brillant commandant de Marine (officier de la Transat, il fut pressenti pour prendre le commandement du France). Nous savons Olivier Frébourg, écrivain de Marine, habité par la mer. Nous le découvrons ici « frère et fier » de son frère, son « pilier lumineux », qu’il admire sans ambages. « Nous étions des brotherships », écrit-il joliment. « J’étais enfant de la mélancolie. Il était le soleil. J’étais la lune ». L’écrivain Frébourg appelle alors à la rescousse ses vieux compagnons, Hemingway, Ovide, Dante, Virgile, Hugo, Reverzy, Buzzati, Chatwin, Brauquier et autres trafiquants d’exotisme, les poètes, les oiseaux aussi, tout fait baume, ou devrait pouvoir panser... L’ouvrage est bouleversant de bout en bout qui vous traverse de part en part. Je me souviens que, le livre achevé, mes mains tremblaient et j’avais le cœur serré comme une gorge.
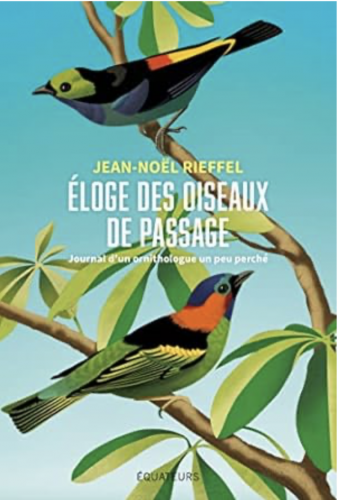 « Éloge des oiseaux de passage », de Jean-Noël Rieffel (Équateurs, vénérable maison dirigée par Olivier Frébourg) est un de mes chouchous car je suis un peu à l’origine de cette publication, puisque mon ami Jean-Noël m’avait envoyé son texte (devenant son premier lecteur, ce qui m’honora), que j’ai aussitôt aimé et transmis à mon autre ami Olivier Frébourg, qui s’enthousiasma à son tour. Ce premier livre est une ode à la migration, au pouvoir des oiseaux sur l’esprit de l’homme et donc sur son bonheur. Je partage avec son auteur trois passions : les oiseaux, la poésie et les vins purs. Il en est question dans ses pages, notamment de l’œuvre sensible et précieuse de Philippe Jaccottet. Quant aux oiseaux, ils imprègnent tant l’ouvrage qu’il me semble être composé de plumes et de chants. Je sais que le livre a connu un joli succès, et c’est justice qui me réjouit.
« Éloge des oiseaux de passage », de Jean-Noël Rieffel (Équateurs, vénérable maison dirigée par Olivier Frébourg) est un de mes chouchous car je suis un peu à l’origine de cette publication, puisque mon ami Jean-Noël m’avait envoyé son texte (devenant son premier lecteur, ce qui m’honora), que j’ai aussitôt aimé et transmis à mon autre ami Olivier Frébourg, qui s’enthousiasma à son tour. Ce premier livre est une ode à la migration, au pouvoir des oiseaux sur l’esprit de l’homme et donc sur son bonheur. Je partage avec son auteur trois passions : les oiseaux, la poésie et les vins purs. Il en est question dans ses pages, notamment de l’œuvre sensible et précieuse de Philippe Jaccottet. Quant aux oiseaux, ils imprègnent tant l’ouvrage qu’il me semble être composé de plumes et de chants. Je sais que le livre a connu un joli succès, et c’est justice qui me réjouit.
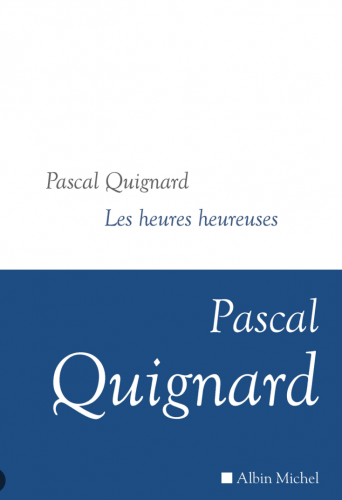 Fervent lecteur de Pascal Quignard, dont je lis absolument tout, j’ai été une fois encore enthousiasmé par « Les heures heureuses » (Albin Michel) qui poursuit la quête spirituelle de la sensation, des émotions pures, de la source de l’amour, de l'émoi originel, l’ensemble dans une langue tendue et on ne peut plus baroque (depuis « Tous les matins du monde »), minérale, d’une précision d’horloger genevois, à la limite du jansénisme littéraire, en tous cas d’une rigueur admirable qui n’exclut jamais – et c’est l’un des talents de Quignard, la dimension extrêmement poétique de sa prose. L’auteur aborde une foule de petits sujets universels par le biais de l’anecdote historique, de la description de l’événement au demeurant insignifiant. Chacun de ses livres, notamment cette « suite » intitulée « Dernier royaume » et dont c’est le XIIe opus, renvoie - à mes yeux en tous cas - à la phrase célèbre de Miguel Torga, « l’universel, c’est le local moins les murs ». Et n’est-ce pas la première vertu de la littérature, sa mission que de rendre universel le village de Macondo dans « Cent ans de solitude » – par exemple. Aussi, et c’est un sacré atout, « un » Quignard se dévore en picorant, le lecteur peut l’aborder comme des pintxos au comptoir d’un bar de San Sebastian. Et, par surcroît, il instruit considérablement, car il n’est jamais avare de détails étymologiques, philologiques, historiques, littéraires et philosophiques, qu’il évoque La Rochefoucauld ou un inconnu, la regrettée Emmanuèle Bernheim ou Spinoza. Et nous sortons de ces « heures heureuses » galvanisé et comme abasourdi lorsque, dans une salle obscure, d’un film exceptionnel nous lisons le générique de fin avec une scrupuleuse gourmandise...
Fervent lecteur de Pascal Quignard, dont je lis absolument tout, j’ai été une fois encore enthousiasmé par « Les heures heureuses » (Albin Michel) qui poursuit la quête spirituelle de la sensation, des émotions pures, de la source de l’amour, de l'émoi originel, l’ensemble dans une langue tendue et on ne peut plus baroque (depuis « Tous les matins du monde »), minérale, d’une précision d’horloger genevois, à la limite du jansénisme littéraire, en tous cas d’une rigueur admirable qui n’exclut jamais – et c’est l’un des talents de Quignard, la dimension extrêmement poétique de sa prose. L’auteur aborde une foule de petits sujets universels par le biais de l’anecdote historique, de la description de l’événement au demeurant insignifiant. Chacun de ses livres, notamment cette « suite » intitulée « Dernier royaume » et dont c’est le XIIe opus, renvoie - à mes yeux en tous cas - à la phrase célèbre de Miguel Torga, « l’universel, c’est le local moins les murs ». Et n’est-ce pas la première vertu de la littérature, sa mission que de rendre universel le village de Macondo dans « Cent ans de solitude » – par exemple. Aussi, et c’est un sacré atout, « un » Quignard se dévore en picorant, le lecteur peut l’aborder comme des pintxos au comptoir d’un bar de San Sebastian. Et, par surcroît, il instruit considérablement, car il n’est jamais avare de détails étymologiques, philologiques, historiques, littéraires et philosophiques, qu’il évoque La Rochefoucauld ou un inconnu, la regrettée Emmanuèle Bernheim ou Spinoza. Et nous sortons de ces « heures heureuses » galvanisé et comme abasourdi lorsque, dans une salle obscure, d’un film exceptionnel nous lisons le générique de fin avec une scrupuleuse gourmandise...
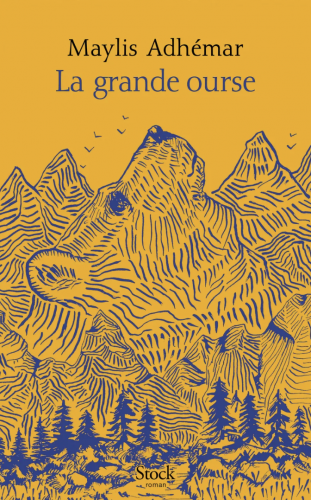 « La grande ourse », de Maylis Adhémar (Stock) est un roman brillant sur un thème devenu « à la mode » : la difficile cohabitation de l’homme en milieu pastoral avec (le retour) des grands prédateurs comme le loup et l’ours – le lynx croquant surtout les chevreuils des forêts vosgiennes. En l’occurrence, il s’agit des bergers ariégeois du Couserans – cette si belle région que l’auteur(e), toulousaine, connait dans les recoins, et de l’ours. L’écriture est sensible, précise, ciselée, les personnages parfois caricaturés (les rugbymen des bars de l’arrière-pays, le chasseur bourru, le berger bucolico-gionesque, la bergère dure à la tâche...), les paysages ne sont à mon goût pas assez
« La grande ourse », de Maylis Adhémar (Stock) est un roman brillant sur un thème devenu « à la mode » : la difficile cohabitation de l’homme en milieu pastoral avec (le retour) des grands prédateurs comme le loup et l’ours – le lynx croquant surtout les chevreuils des forêts vosgiennes. En l’occurrence, il s’agit des bergers ariégeois du Couserans – cette si belle région que l’auteur(e), toulousaine, connait dans les recoins, et de l’ours. L’écriture est sensible, précise, ciselée, les personnages parfois caricaturés (les rugbymen des bars de l’arrière-pays, le chasseur bourru, le berger bucolico-gionesque, la bergère dure à la tâche...), les paysages ne sont à mon goût pas assez 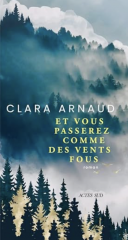 magnifiés, la narration d’un conflit qui enfle l'est bien davantage, et la jalousie de l’héroïne pour l’ex de son amoureux un peu too much. Une économie d’une cinquantaine de pages sur le sujet eut été bénéfique. Mais bon, cela n’exclut pas que ce livre soit pétri de qualités, et je le rapproche d’un autre grand texte franchement admirable, sur le même sujet, de Clara Arnaud, « Et vous passerez comme des vents fous » (Actes Sud).
magnifiés, la narration d’un conflit qui enfle l'est bien davantage, et la jalousie de l’héroïne pour l’ex de son amoureux un peu too much. Une économie d’une cinquantaine de pages sur le sujet eut été bénéfique. Mais bon, cela n’exclut pas que ce livre soit pétri de qualités, et je le rapproche d’un autre grand texte franchement admirable, sur le même sujet, de Clara Arnaud, « Et vous passerez comme des vents fous » (Actes Sud).
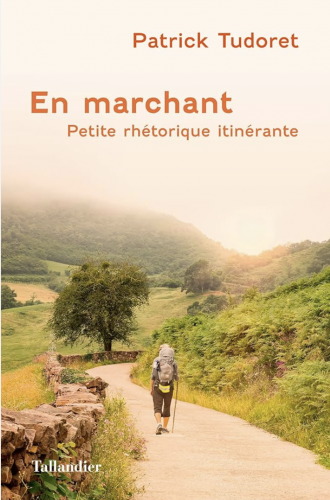 Sous-titré « Petite rhétorique itinérante », « En marchant », de Patrick Tudoret (Tallandier) est un précieux livre total car il entremêle érudition (sans frime aucune) et petite philosophie de la marche avec brio. Le tout piqué de souvenirs très personnels comme un gigot d’agneau l’est de gousses d’ail. Souvenons-nous que Montaigne, marcheur (et cavalier) impénitent, prétendait « penser par les pieds », et songeons avec Eugenio de Andrade, que « la démarche crée le chemin ». Tudoret est dans cette mouvance-là. Contemplatif et jamais sportif acharné, il prend le lecteur par la main, lequel prend son bâton de pèlerin, et c’est parti. Véritable anthologie littéraire à dominante poétique, le livre devient vite un compagnon que l’on est tenté de glisser dans le sac à dos pour nos prochaines haltes dans la montagne basque – où l’auteur randonne également. « Il y a une ivresse de la marche comme il y a une ivresse d’écrire », note-t-il. Tudoret aime à sentir « la pulpe d’un lieu », à en saisir « le pouls intime », et aussi marcher dans les pas des écrivains qu’il aime. Il en appelle à Saint-Augustin : « Qui n’avance pas piétine », souligne : « La marche comme école de détachement, d’affranchissement. On largue les amarres. La marche art du délestage, de l’allègement. Délestage physique, matériel, mais aussi moral : se déprendre de soi ». Et précise salutairement : « Les assis m’ennuient, ceux qui courent me fatiguent, j’aime ceux qui marchent ». Nous tous aussi, non ?..
Sous-titré « Petite rhétorique itinérante », « En marchant », de Patrick Tudoret (Tallandier) est un précieux livre total car il entremêle érudition (sans frime aucune) et petite philosophie de la marche avec brio. Le tout piqué de souvenirs très personnels comme un gigot d’agneau l’est de gousses d’ail. Souvenons-nous que Montaigne, marcheur (et cavalier) impénitent, prétendait « penser par les pieds », et songeons avec Eugenio de Andrade, que « la démarche crée le chemin ». Tudoret est dans cette mouvance-là. Contemplatif et jamais sportif acharné, il prend le lecteur par la main, lequel prend son bâton de pèlerin, et c’est parti. Véritable anthologie littéraire à dominante poétique, le livre devient vite un compagnon que l’on est tenté de glisser dans le sac à dos pour nos prochaines haltes dans la montagne basque – où l’auteur randonne également. « Il y a une ivresse de la marche comme il y a une ivresse d’écrire », note-t-il. Tudoret aime à sentir « la pulpe d’un lieu », à en saisir « le pouls intime », et aussi marcher dans les pas des écrivains qu’il aime. Il en appelle à Saint-Augustin : « Qui n’avance pas piétine », souligne : « La marche comme école de détachement, d’affranchissement. On largue les amarres. La marche art du délestage, de l’allègement. Délestage physique, matériel, mais aussi moral : se déprendre de soi ». Et précise salutairement : « Les assis m’ennuient, ceux qui courent me fatiguent, j’aime ceux qui marchent ». Nous tous aussi, non ?..
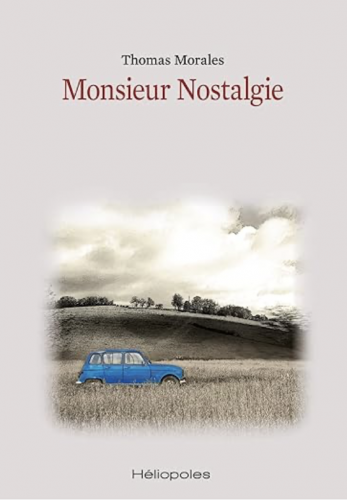 « Monsieur Nostalgie », de Thomas Morales (Heliopoles), déclaration d’amour aux Trente Glorieuses, hymne au « c’était - tellement - mieux avant », est un livre délicieux d’un grand styliste dans la lignée hussarde de Blondin, qui assume avec talent son attachement aux choses surannées et passées de mode. Mais qui pourrait prétendre que Claude Sautet, Bébel, le culte de la langue française, le panache hexagonal, les livres paillards de Boudard, la voix de Michel Delpech, le plat Berry qui est le sien puissent passer un jour de mode ? Morales possède ce passé brillant, truculent, hédoniste, cultivé, amical, gascon et rastignacien, épris de clochers et de ballons de rouge partagés au zinc, du mythe B.B. et des fromages bien faits, chevillé à l’âme comme au corps. Et nous le suivons, page à page, avec une gourmandise qui augmente à mesure, en lisant en ronronnant. « Arrière les esquimaux ! » Olé...
« Monsieur Nostalgie », de Thomas Morales (Heliopoles), déclaration d’amour aux Trente Glorieuses, hymne au « c’était - tellement - mieux avant », est un livre délicieux d’un grand styliste dans la lignée hussarde de Blondin, qui assume avec talent son attachement aux choses surannées et passées de mode. Mais qui pourrait prétendre que Claude Sautet, Bébel, le culte de la langue française, le panache hexagonal, les livres paillards de Boudard, la voix de Michel Delpech, le plat Berry qui est le sien puissent passer un jour de mode ? Morales possède ce passé brillant, truculent, hédoniste, cultivé, amical, gascon et rastignacien, épris de clochers et de ballons de rouge partagés au zinc, du mythe B.B. et des fromages bien faits, chevillé à l’âme comme au corps. Et nous le suivons, page à page, avec une gourmandise qui augmente à mesure, en lisant en ronronnant. « Arrière les esquimaux ! » Olé...
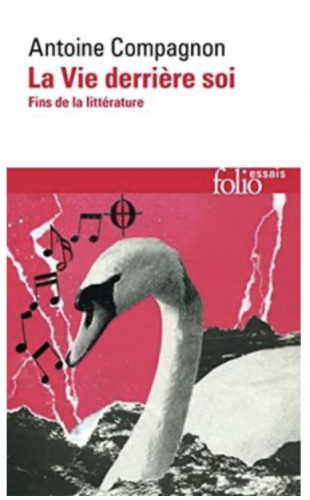 « La Vie derrière soi. Fins de la littérature », d’Antoine Compagnon (folio essais) est un essai aussi important que sombre. « La littérature a un lien essentiel avec la mort, le deuil et la mélancolie », prévient d’emblée l’ex-universitaire et essayiste des « Antimodernes » et le biographe inspiré (et à succès) de Montaigne, Proust et quelques autres. Est-ce l’âge, le décès de son épouse, la retraite prise... Compagnon se penche sur les œuvres tardives, évidemment pas comme Narcisse sur son reflet dans l’eau, mais en intellectuel constamment en question, à l’écoute, notamment sur ce qui pourrait constituer ce fléchissement de l’âme, sur ce qui préfigure chaque chant du cygne, sur les faiblesses physiques aussi – qu’il ne faut pas négliger, car elles gouvernent le mouvement de la main sur la feuille... L’érudition de l’ancien professeur au Collège de France (dont je suivais les cours, parfois dehors devant un écran géant, pour cause de succès, lorsque je vivais dans le Ve arrondissement, à un jet de galet du Collège...) brille par mille feux en voie d’extinction, et cette plongée dans les eaux profondes de l’ultima verba donne à voir et à réfléchir sur la teneur des dernières pages de « La Recherche », sur la théâtralisation du « Journal » de Gide, sur tant de récits de la vieillesse qui se révèlent parfois, souvent, plus toniques que ceux de la jeunesse, aussi. Stimulant.
« La Vie derrière soi. Fins de la littérature », d’Antoine Compagnon (folio essais) est un essai aussi important que sombre. « La littérature a un lien essentiel avec la mort, le deuil et la mélancolie », prévient d’emblée l’ex-universitaire et essayiste des « Antimodernes » et le biographe inspiré (et à succès) de Montaigne, Proust et quelques autres. Est-ce l’âge, le décès de son épouse, la retraite prise... Compagnon se penche sur les œuvres tardives, évidemment pas comme Narcisse sur son reflet dans l’eau, mais en intellectuel constamment en question, à l’écoute, notamment sur ce qui pourrait constituer ce fléchissement de l’âme, sur ce qui préfigure chaque chant du cygne, sur les faiblesses physiques aussi – qu’il ne faut pas négliger, car elles gouvernent le mouvement de la main sur la feuille... L’érudition de l’ancien professeur au Collège de France (dont je suivais les cours, parfois dehors devant un écran géant, pour cause de succès, lorsque je vivais dans le Ve arrondissement, à un jet de galet du Collège...) brille par mille feux en voie d’extinction, et cette plongée dans les eaux profondes de l’ultima verba donne à voir et à réfléchir sur la teneur des dernières pages de « La Recherche », sur la théâtralisation du « Journal » de Gide, sur tant de récits de la vieillesse qui se révèlent parfois, souvent, plus toniques que ceux de la jeunesse, aussi. Stimulant.
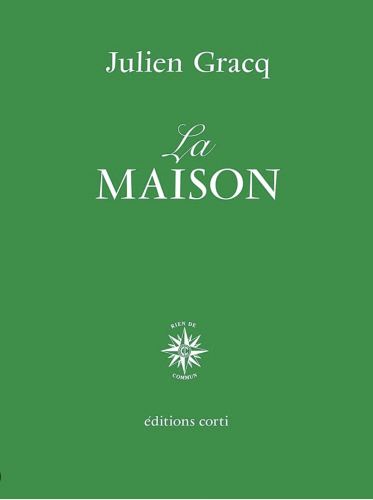 Bien sûr il y eut la divine surprise – oh, vingt-neuf pages à peine -, mais de l’indépassable Julien Gracq, avec « La Maison » (Corti), nouvel inédit, cadeau du ciel et des étoiles, condensé du talent immense du « patron » comme disait Nourissier. L’histoire, mais en est-ce une, est mince come un papier Rizla+, et en faut-il d’ailleurs une pour faire œuvre (à vocation) universelle ? cf. supra. L’apparition énigmatique d’une maison enfouie dans une friche sur le trajet du bus, « comme l’affût précautionneux et tendu d’une bête lourde au milieu de ces solitudes », « de ces fourrés sans oiseaux ». Nous sommes aussitôt chez Poe que Gracq vénérait autant que Verne. Son approche furtive un jour, à pied, « le besoin de me sentir le cœur net de l’envoûtement bizarre de ces bois sans joie », « une extraordinaire suggestion d’abandon et de tristesse », et tout à trac le chant à peine perçu d’une femme, « une voix nue », la vue, l’espace d’un court instant, de « quelque chose d’elle », « la pointe de deux pieds nus », et il n’en faut pas davantage pour générer une montagne d’un désir retenu serré par l’écriture comme jamais maîtrisée de l’auteur du « Balcon en forêt ». La charge érotique de ce très court texte est d’une intensité sublime puisque tout est suggéré, entrevu, et enfin la chute, que je délivre ici car elle n’empêche aucunement le plaisir du texte, sa montée en puissance comme le mercure dans le thermomètre, « ... plus nue encore, et plus secrète que les pieds nus, la masse ondée, prodiguée, déployée, comme une draperie, d’une longue chevelure blonde, la chevelure défaite d’une femme ». Qui écrit mieux ?
Bien sûr il y eut la divine surprise – oh, vingt-neuf pages à peine -, mais de l’indépassable Julien Gracq, avec « La Maison » (Corti), nouvel inédit, cadeau du ciel et des étoiles, condensé du talent immense du « patron » comme disait Nourissier. L’histoire, mais en est-ce une, est mince come un papier Rizla+, et en faut-il d’ailleurs une pour faire œuvre (à vocation) universelle ? cf. supra. L’apparition énigmatique d’une maison enfouie dans une friche sur le trajet du bus, « comme l’affût précautionneux et tendu d’une bête lourde au milieu de ces solitudes », « de ces fourrés sans oiseaux ». Nous sommes aussitôt chez Poe que Gracq vénérait autant que Verne. Son approche furtive un jour, à pied, « le besoin de me sentir le cœur net de l’envoûtement bizarre de ces bois sans joie », « une extraordinaire suggestion d’abandon et de tristesse », et tout à trac le chant à peine perçu d’une femme, « une voix nue », la vue, l’espace d’un court instant, de « quelque chose d’elle », « la pointe de deux pieds nus », et il n’en faut pas davantage pour générer une montagne d’un désir retenu serré par l’écriture comme jamais maîtrisée de l’auteur du « Balcon en forêt ». La charge érotique de ce très court texte est d’une intensité sublime puisque tout est suggéré, entrevu, et enfin la chute, que je délivre ici car elle n’empêche aucunement le plaisir du texte, sa montée en puissance comme le mercure dans le thermomètre, « ... plus nue encore, et plus secrète que les pieds nus, la masse ondée, prodiguée, déployée, comme une draperie, d’une longue chevelure blonde, la chevelure défaite d’une femme ». Qui écrit mieux ?
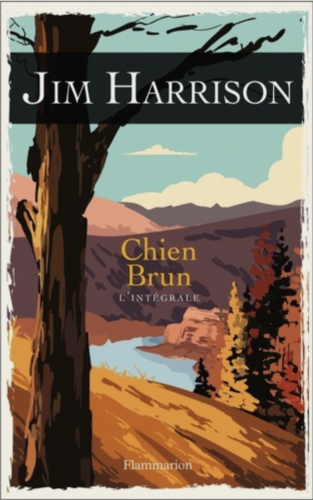 Grâce soit rendue à Brice Matthieussent, traducteur magnifique de tout l’œuvre – volumineuse (trente ouvrages) de « Big Jim » et à Flammarion d’avoir rassemblé tout ce que ce corpus compte de récits et d’extraits de romans, de « novelas » aussi, placés sous la personne emblématique de Chien Brun, double de Jim Harrison, « Chien Brun. L’intégrale » (Flammarion), donc. Il s’agit d’un livre en surnuméraire lorsqu’on possède une étagère pleine à ras-bord des bouquins de Jim, et qui – pour l’anecdote, faillit un jour me priver de vieillir, en tombant brusquement sur ma tête. Je m’en tirai avec un éclat de rire étrange et une bosse énorme. Ah, Chien Brun, mélancolique bâtard supposé d’Indien mais n’ayant que du sang chaud qui circule ardemment dans les veines, Chien Brun l’anar broussard du Michigan dépourvu de numéro de sécurité sociale – notez la poésie insolite de ces mots, Chien Brun pêcheur de truites et devant l’éternel, Chien Brun chasseur et trousseur, sauvage comme on aime les personnages de cette Amérique des grands espaces, court ici sur près de six cents pages, et plus on les feuillette, s’y arrête, plus Jim nous manque. Mais ce n’est pas si grave, Chien Brun se retourne, décèle votre peine, et vous embarque, et c’est bon de le suivre à nouveau, de le lire...
Grâce soit rendue à Brice Matthieussent, traducteur magnifique de tout l’œuvre – volumineuse (trente ouvrages) de « Big Jim » et à Flammarion d’avoir rassemblé tout ce que ce corpus compte de récits et d’extraits de romans, de « novelas » aussi, placés sous la personne emblématique de Chien Brun, double de Jim Harrison, « Chien Brun. L’intégrale » (Flammarion), donc. Il s’agit d’un livre en surnuméraire lorsqu’on possède une étagère pleine à ras-bord des bouquins de Jim, et qui – pour l’anecdote, faillit un jour me priver de vieillir, en tombant brusquement sur ma tête. Je m’en tirai avec un éclat de rire étrange et une bosse énorme. Ah, Chien Brun, mélancolique bâtard supposé d’Indien mais n’ayant que du sang chaud qui circule ardemment dans les veines, Chien Brun l’anar broussard du Michigan dépourvu de numéro de sécurité sociale – notez la poésie insolite de ces mots, Chien Brun pêcheur de truites et devant l’éternel, Chien Brun chasseur et trousseur, sauvage comme on aime les personnages de cette Amérique des grands espaces, court ici sur près de six cents pages, et plus on les feuillette, s’y arrête, plus Jim nous manque. Mais ce n’est pas si grave, Chien Brun se retourne, décèle votre peine, et vous embarque, et c’est bon de le suivre à nouveau, de le lire...
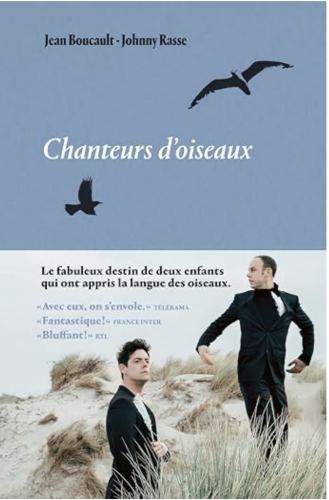 Voici un ouvrage singulier que Jim Harrison aurait sans doute aimé. « Chanteurs d’oiseaux », de Jean Boucault et Johnny Rasse (Les Arènes/PUG), ou l’histoire de deux surdoués de l’imitation des chants d’oiseaux – l’un est spécialiste du goéland argenté, l’autre du merle noir, qui raflent tous les concours (ce qui semble très étrange, pour un citadin) ayant cours notamment en baie de Somme, d’où ils sont issus. Terre d’oiseaux de passage, ils ont grandi parmi eux, du côté d’Arrest, leur parcours est narré en alternance, et ils se donnent aujourd’hui en spectacle, et c’est paraît-il bluffant (mais j’ai la chance immense de pouvoir les écouter bientôt, vers la mi-janvier, à Paris, à la faveur du Salon du Livre de Nature, où se tiendra leur prestation). Leur récit alterné est touchant, simple, qui décrit leur quotidien, l’école – surtout buissonnière, l’amour infini des oiseaux, l’apprentissage de leur parole, de l’infinie subtilité des « modulations de fréquence » de chacune d’elles, la naissance d’une passion dévorante, tout cela est décrit dans une langue directe et sensible, naturellement sauvage et saumâtre, avec des adjectifs beaux comme des marécages à l’aube, des joncs éclairés par un soleil timide. « Je t’apprendrai à faire le courlis cendré ». Juste cette phrase et je frissonne. Comprenne qui sait déjà...
Voici un ouvrage singulier que Jim Harrison aurait sans doute aimé. « Chanteurs d’oiseaux », de Jean Boucault et Johnny Rasse (Les Arènes/PUG), ou l’histoire de deux surdoués de l’imitation des chants d’oiseaux – l’un est spécialiste du goéland argenté, l’autre du merle noir, qui raflent tous les concours (ce qui semble très étrange, pour un citadin) ayant cours notamment en baie de Somme, d’où ils sont issus. Terre d’oiseaux de passage, ils ont grandi parmi eux, du côté d’Arrest, leur parcours est narré en alternance, et ils se donnent aujourd’hui en spectacle, et c’est paraît-il bluffant (mais j’ai la chance immense de pouvoir les écouter bientôt, vers la mi-janvier, à Paris, à la faveur du Salon du Livre de Nature, où se tiendra leur prestation). Leur récit alterné est touchant, simple, qui décrit leur quotidien, l’école – surtout buissonnière, l’amour infini des oiseaux, l’apprentissage de leur parole, de l’infinie subtilité des « modulations de fréquence » de chacune d’elles, la naissance d’une passion dévorante, tout cela est décrit dans une langue directe et sensible, naturellement sauvage et saumâtre, avec des adjectifs beaux comme des marécages à l’aube, des joncs éclairés par un soleil timide. « Je t’apprendrai à faire le courlis cendré ». Juste cette phrase et je frissonne. Comprenne qui sait déjà...
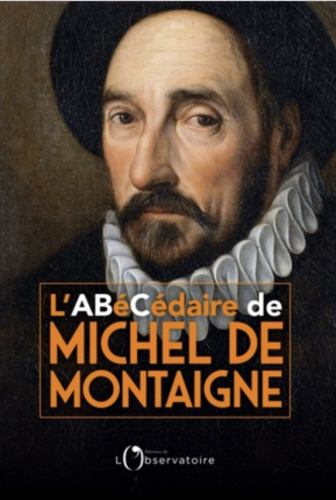 « L’ABéCédaire de Michel de Montaigne », choisi par Michel Magnien (L’Observatoire) est issu d’une collection particulièrement attachante (celui de Romain Gary nous avait ravi, il y a quelques mois). Il agit comme un « memo », un rappel, un vaccin, on le feuillette en cherchant des entrées moins convenues, laissant tomber amitié, cannibales, apprendre à mourir, éducation... en musardant du côté de bordel, branloire, chasse, constance, cul, délectation morose, désir, difformité, écrivaillerie, garde-robe, ivrognerie, etc. Inépuisable Montaigne. Ce livre est à rapprocher du (déjà ancien) « Le meilleur de Montaigne », concocté par Claude Pinganaud pour arléa. Revenir, toujours, à Montaigne.
« L’ABéCédaire de Michel de Montaigne », choisi par Michel Magnien (L’Observatoire) est issu d’une collection particulièrement attachante (celui de Romain Gary nous avait ravi, il y a quelques mois). Il agit comme un « memo », un rappel, un vaccin, on le feuillette en cherchant des entrées moins convenues, laissant tomber amitié, cannibales, apprendre à mourir, éducation... en musardant du côté de bordel, branloire, chasse, constance, cul, délectation morose, désir, difformité, écrivaillerie, garde-robe, ivrognerie, etc. Inépuisable Montaigne. Ce livre est à rapprocher du (déjà ancien) « Le meilleur de Montaigne », concocté par Claude Pinganaud pour arléa. Revenir, toujours, à Montaigne.
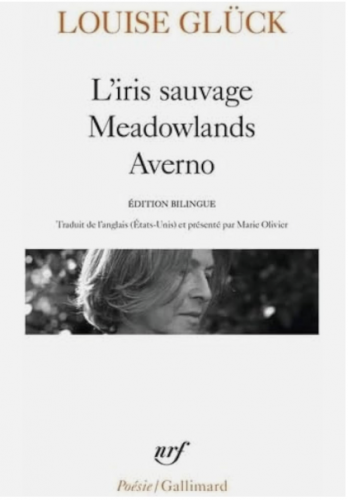 J’en attendais plus. Je fus déçu. Comme souvent, avec le choix de l’Académie Nobel. Louise Glück ne profita pas longtemps du sien, obtenu en 2020, car elle vient de nous quitter. La « grande » poétesse américaine se voit compilée par Poésie/Gallimard, avec « L’Iris sauvage, Meadowlands, et Averno » lesquels m’ont laissé sur ma faim de poésie profonde, dense, parce que, page 193, je ne me contente pas du début du poème intitulé
J’en attendais plus. Je fus déçu. Comme souvent, avec le choix de l’Académie Nobel. Louise Glück ne profita pas longtemps du sien, obtenu en 2020, car elle vient de nous quitter. La « grande » poétesse américaine se voit compilée par Poésie/Gallimard, avec « L’Iris sauvage, Meadowlands, et Averno » lesquels m’ont laissé sur ma faim de poésie profonde, dense, parce que, page 193, je ne me contente pas du début du poème intitulé
« Anniversaire :
J’ai dit que tu pouvais faire un câlin.
Ça ne veut pas dire tes pieds froids sur ma bite.
Quelqu’un devrait t’apprendre les bonnes manières au lit. »
Un poème, un seul (sur 450 pages, c’est léger) a trouvé grâce à mes propres critères, « Rotonde bleue :
J’en ai assez d’avoir des mains
dit-elle
Je veux des ailes –
Mais que feras-tu sans tes mains
Pour être humain ?
J’en ai assez de l’humain
dit-elle
Je veux vivre sur le soleil »...
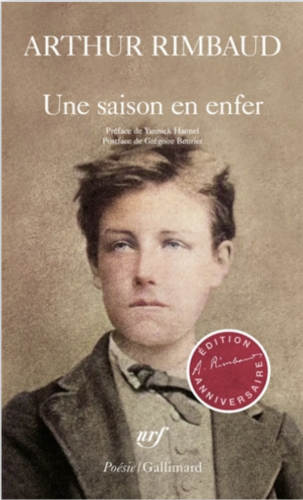 Approcherions-nous, via cette dernière image, de l’éternité décrite (« Quoi? »..) par Rimbaud, dont on célèbre le 150eanniversaire de l’impression à compte d’auteur à Bruxelles, des cinquante-quatre pages d’« Une saison en enfer » (Poésie/Gallimard), soit une mince plaquette de textes en prose sertie de sept poèmes en vers, avec des pages blanches, des fautes typographiques demeurées (il s’agit d’un fac-similé, comme celui qu’arléa offrit à ses fidèles clients il y a quelques années). La mention PRIX : UN FRANC qui barre la page de titre (intérieure) comme une ceinture de bourreau, possède finalement l’élégance surréaliste d’un aquoibonisme de belle facture. Rimbaud détruisit le faible tirage, non sans avoir offert un exemplaire à Verlaine. C’est grâce à celui-ci que le texte fut sauvé, nous est parvenu, et nous touche encore de plein fouet :
Approcherions-nous, via cette dernière image, de l’éternité décrite (« Quoi? »..) par Rimbaud, dont on célèbre le 150eanniversaire de l’impression à compte d’auteur à Bruxelles, des cinquante-quatre pages d’« Une saison en enfer » (Poésie/Gallimard), soit une mince plaquette de textes en prose sertie de sept poèmes en vers, avec des pages blanches, des fautes typographiques demeurées (il s’agit d’un fac-similé, comme celui qu’arléa offrit à ses fidèles clients il y a quelques années). La mention PRIX : UN FRANC qui barre la page de titre (intérieure) comme une ceinture de bourreau, possède finalement l’élégance surréaliste d’un aquoibonisme de belle facture. Rimbaud détruisit le faible tirage, non sans avoir offert un exemplaire à Verlaine. C’est grâce à celui-ci que le texte fut sauvé, nous est parvenu, et nous touche encore de plein fouet :
« Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s’ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient.
Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux. – Et je l’ai trouvée amère. – Et je l’ai injuriée. »
Ainsi débute cet ouvrage iconique, comme on dit, que nous ne nous lasserons jamais de rouvrir.
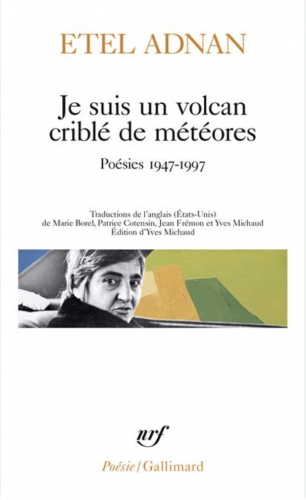 « Je suis un volcan criblé de météores », de Etel Adnan (Poésie/Gallimard), m’est une découverte majeure. Cette somme de poésies qui couvre les années 1947 à 1997 provient d’une poétesse prolixe (1925-2021) tardivement reconnue, peintre aussi, issue du carrefour de plusieurs cultures (turque, grecque, libanaise, française, américaine). Il y a des poèmes militants à connotation politique, je les ai écartés d’instinct, considérant avec Stendhal que « la politique dans un roman, c’est un coup de pistolet dans un concert », et avec Proust que des idées dans une fiction « sont comme l’étiquette du prix laissée sur un cadeau ». En revanche, de très nombreux textes sont infiniment sensibles, touchants. Extraits :
« Je suis un volcan criblé de météores », de Etel Adnan (Poésie/Gallimard), m’est une découverte majeure. Cette somme de poésies qui couvre les années 1947 à 1997 provient d’une poétesse prolixe (1925-2021) tardivement reconnue, peintre aussi, issue du carrefour de plusieurs cultures (turque, grecque, libanaise, française, américaine). Il y a des poèmes militants à connotation politique, je les ai écartés d’instinct, considérant avec Stendhal que « la politique dans un roman, c’est un coup de pistolet dans un concert », et avec Proust que des idées dans une fiction « sont comme l’étiquette du prix laissée sur un cadeau ». En revanche, de très nombreux textes sont infiniment sensibles, touchants. Extraits :
« Le soleil dit la mer est la vie originelle,
je suis les vignes futures et la vigueur des panthères.
La mer est femme sur les genoux de l’aube. »
-----
« La nuit coulait plus lentement
qu’un étang. L’ange comptait
les étoiles. Tu disais : L’amour
est une eau qui revient à son
aube. »
-----
« J’ai épousé la lumière
j’ai enfanté la folie
je suis un fleuve mon amour
tu ne peux que pleurer
sur mes bords. »
-----
« et la chaleur de ta
passion
prend
la couleur du givre
blanc comme un perpétuel printemps. »
-----
« Elle avait des yeux qui faisaient
briller le soleil au-dessus de mon lit
et tomber la pluie
c’est de ma mère que je parle... »
-----
« La solitude du monde animal
est entrée dans mon cerveau :
Une femme m’a aimée au-delà de toute raison »
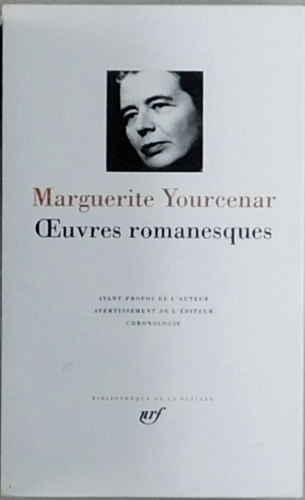 À la faveur de retards homériques des trains de la SNCF la veille de Noël et son surlendemain, et ayant pris soin, au cas où si probable, de me munir d’une Pléiade, j’ai relu les Oeuvres romanesques de Marguerite Yourcenar, la grande Marguerite Yourcenar. « Alexis ou le traité du vain combat », Le coup de grâce », « Feux », « « Nouvelles orientales », un peu de « l’Œuvre au Noir », des « Mémoires d’Hadrien »... Un bonheur réitéré une journée durant entre Bayonne et Nîmes, via Bordeaux et Toulouse. Je suis soudain tenté de reproduire ici tout ce que j’ai pu annoter au crayon sur le papier bible, tant de fulgurances, de traits, de percussion, de vérité, de subtilité extrême... Allez, juste deux ou trois comme ça, pour frissonner :
À la faveur de retards homériques des trains de la SNCF la veille de Noël et son surlendemain, et ayant pris soin, au cas où si probable, de me munir d’une Pléiade, j’ai relu les Oeuvres romanesques de Marguerite Yourcenar, la grande Marguerite Yourcenar. « Alexis ou le traité du vain combat », Le coup de grâce », « Feux », « « Nouvelles orientales », un peu de « l’Œuvre au Noir », des « Mémoires d’Hadrien »... Un bonheur réitéré une journée durant entre Bayonne et Nîmes, via Bordeaux et Toulouse. Je suis soudain tenté de reproduire ici tout ce que j’ai pu annoter au crayon sur le papier bible, tant de fulgurances, de traits, de percussion, de vérité, de subtilité extrême... Allez, juste deux ou trois comme ça, pour frissonner :
« On dit : fou de joie. On devrait dire : sage de douleur. »
-----
« Posséder, c’est la même chose que connaître : l’Écriture a toujours raison. L’amour est sorcier : il sait les secrets ; il est sourcier : il sait les sources. L’indifférence est borgne ; la haine est aveugle ; elles trébuchent côte à côte dans le fossé du mépris. L’indifférence ignore ; l’amour sait, il épelle la chair. Il faut jouir d’un être pour avoir l’occasion de le contempler nu. Il m’a fallu t’aimer pour comprendre que la plus médiocre ou la pire des personnes humaines est digne d’inspirer là-haut l’éternel sacrifice de Dieu. »
-----
« Où me sauver ? Tu emplis le monde. Je ne puis te fuir qu’en toi ? »
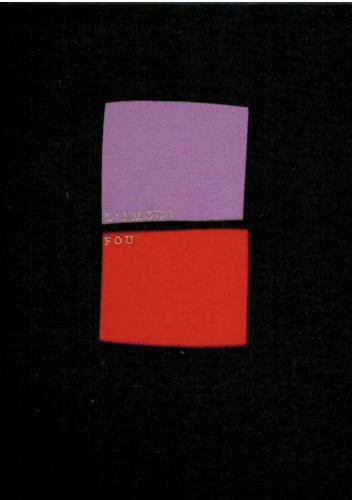 J’achèverai cette brève liste (j’en oublie, c’est certain, car une année c’est long, mais je la rectifierai, le cas échéant)... Avec une relecture, « L’Amour fou », d’André Breton dans une belle édition rare, illustrée et numérotée du Club français du livre, j'ai éprouvé le besoin parallèle de reprendre le « André Breton. Quelques aspects de l’écrivain », de Julien Gracq (José Corti) pour ce qui y est souligné par celui qui fut fasciné par le père du surréalisme : ce
J’achèverai cette brève liste (j’en oublie, c’est certain, car une année c’est long, mais je la rectifierai, le cas échéant)... Avec une relecture, « L’Amour fou », d’André Breton dans une belle édition rare, illustrée et numérotée du Club français du livre, j'ai éprouvé le besoin parallèle de reprendre le « André Breton. Quelques aspects de l’écrivain », de Julien Gracq (José Corti) pour ce qui y est souligné par celui qui fut fasciné par le père du surréalisme : ce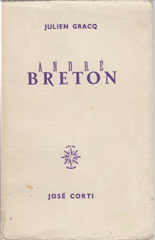 pouvoir prodigieux d’associer sans contrainte pour le lecteur la poésie et l’essai, la beauté de la phrase et la réflexion sur le motif. Avec Breton, comment dire... l’émulsion, pour une fois, semble pouvoir prendre : l’eau à l’huile s’allie et la fusion procède d’un alliage unique. « L’Amour fou », donc, offert par une main experte en surréalisme, « parce que la neige demeure sous la cendre », et ses inoxydables fulgurances, pour le plaisir du texte, soit pour ne jamais changer...
pouvoir prodigieux d’associer sans contrainte pour le lecteur la poésie et l’essai, la beauté de la phrase et la réflexion sur le motif. Avec Breton, comment dire... l’émulsion, pour une fois, semble pouvoir prendre : l’eau à l’huile s’allie et la fusion procède d’un alliage unique. « L’Amour fou », donc, offert par une main experte en surréalisme, « parce que la neige demeure sous la cendre », et ses inoxydables fulgurances, pour le plaisir du texte, soit pour ne jamais changer...
« La beauté convulsive sera érotique-voilée, explosante-fixe, magique-circonstancielle ou ne sera pas. »
-----
Et cette célèbre citation que l’on voudrait faire inscrire sur notre pierre tombale ou bien sur notre urne, au choix :
« J’aimerais que ma vie ne laissât après elle d’autre murmure que celui d’une chanson de guetteur, d’une chanson pour tromper l’attente. Indépendamment de ce qui arrive, n’arrive pas, c’est l’attente qui est magnifique. »
----------
Bonne Saint-Sylvestre. « Je vous souhaite d’être follement aimé(es) ». A.B.
Léon Mazzella
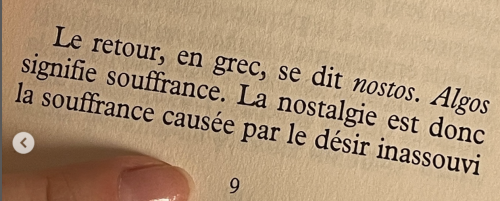
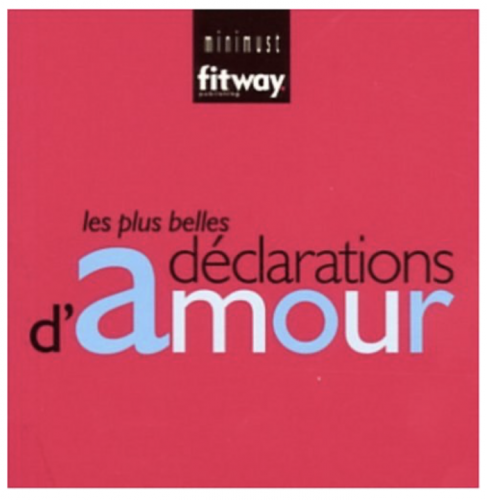
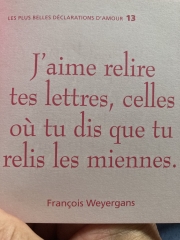
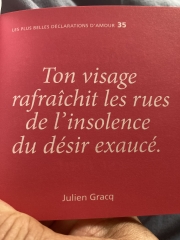
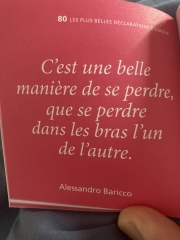
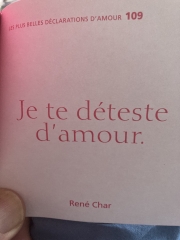
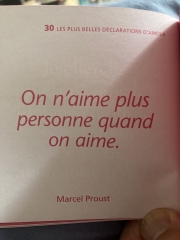
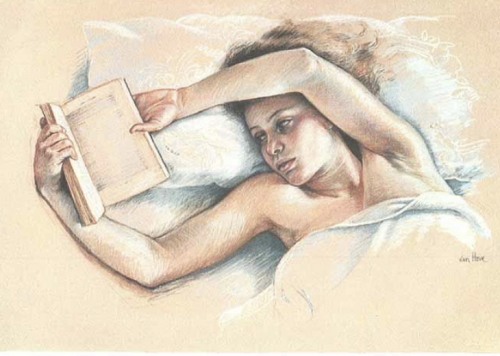
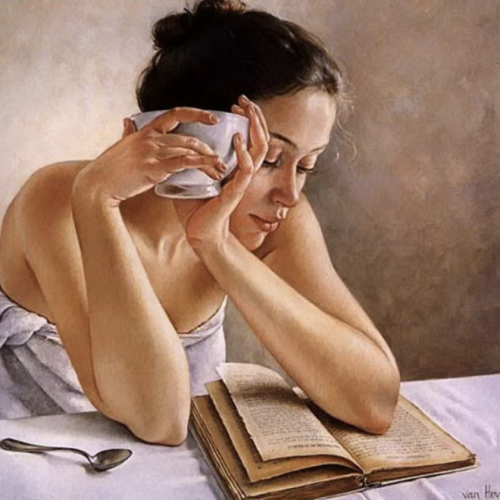

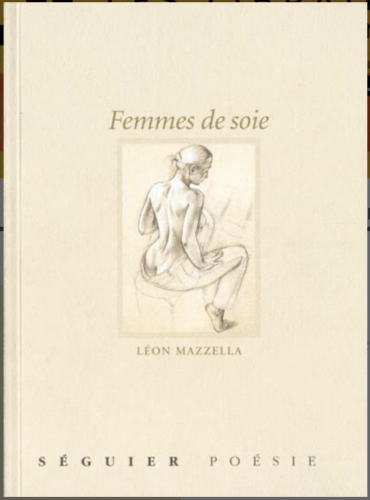
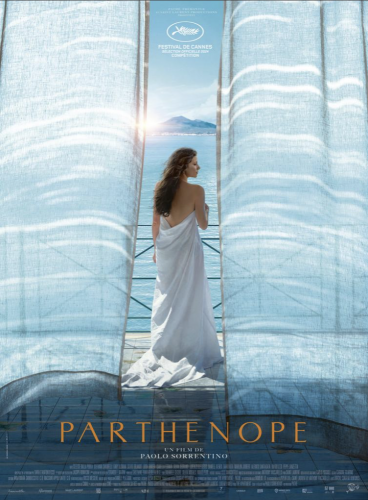


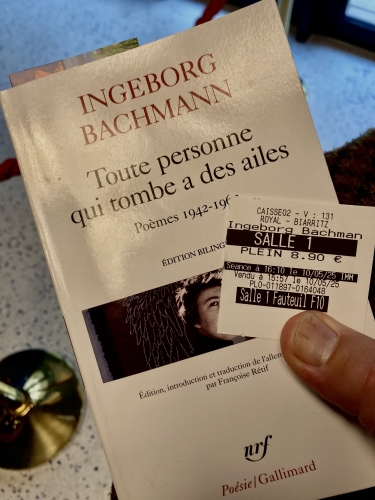
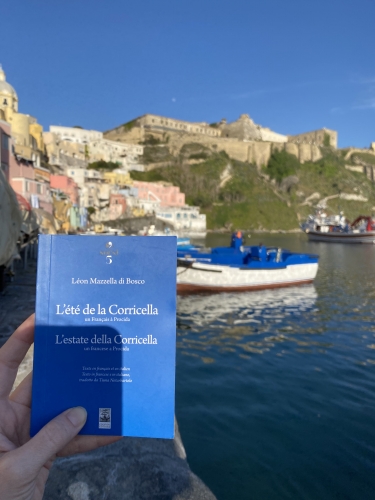
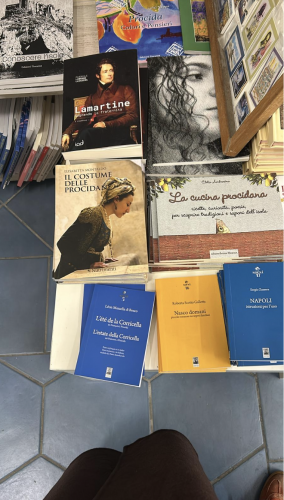


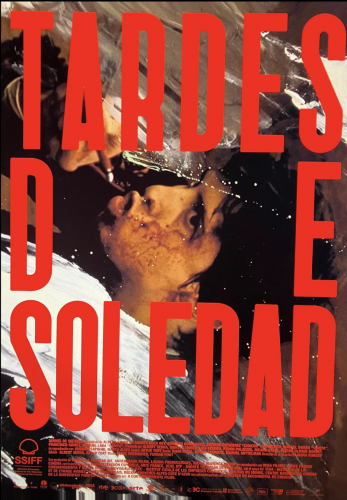


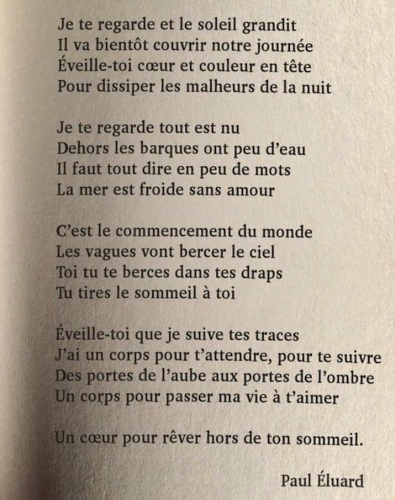
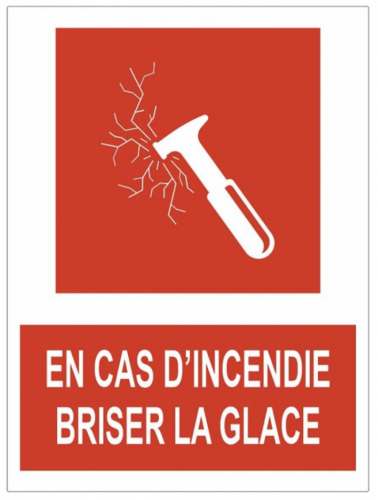


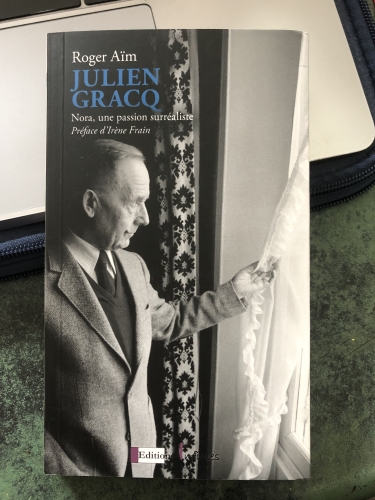
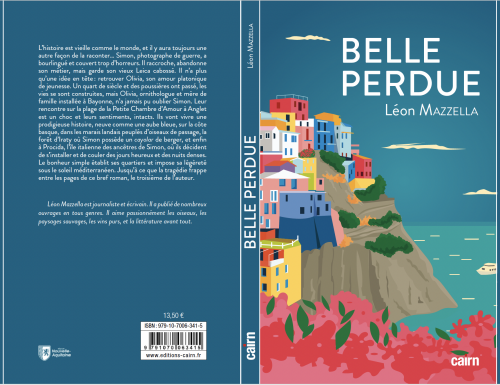
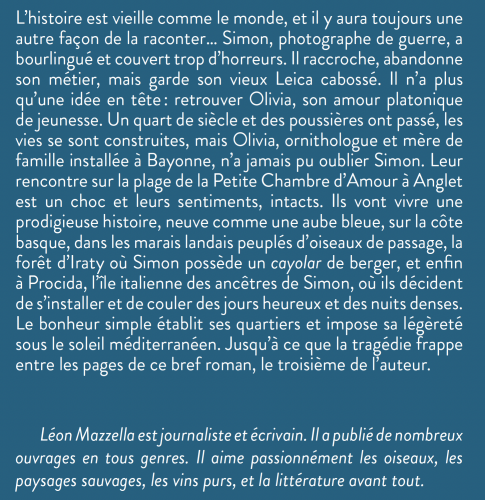
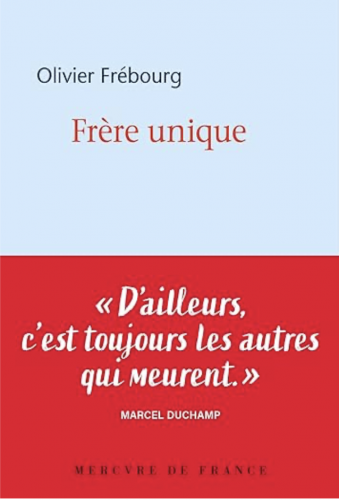 Parmi mes lectures marquantes au cours de cette année qui s’achève ce soir, je retiendrai une petite poignée de livres émouvants, à commencer par « Frère unique », d’Olivier Frébourg (Mercure de France), récit poignant, à la limite de l’insoutenable parfois, sur la disparition tragique, accidentelle, et injuste de son frère Thierry, « ponte » de la médecine, chercheur généticien de renommée mondiale et victime d’une minable erreur médicale sur le lieu même où il officia tant d’années : l’hôpital de Rouen – rendu coupable de n’avoir de surcroît jamais vraiment reconnu sa faute, ce qui donne lieu à des pages enragées de la part du frère meurtri et inconsolable ; révolté. Double peine. Mais ce livre intime (Olivier Frébourg avait déjà donné « Gaston et Gustave » sur la disparition d’un de ses fils grand prématuré, et – ai-je envie d’ajouter, « La grande nageuse », sur la douloureuse séparation d’avec la mère de tous ses fils) brille avant tout par les souvenirs d’enfance heureuse de deux frères sous le soleil des Antilles où la famille vécut un temps, de 1969 à 1972, puis en Normandie, berceau familial, car le père est un brillant commandant de Marine (officier de la Transat, il fut pressenti pour prendre le commandement du France). Nous savons Olivier Frébourg, écrivain de Marine, habité par la mer. Nous le découvrons ici « frère et fier » de son frère, son « pilier lumineux », qu’il admire sans ambages. « Nous étions des brotherships », écrit-il joliment. « J’étais enfant de la mélancolie. Il était le soleil. J’étais la lune ». L’écrivain Frébourg appelle alors à la rescousse ses vieux compagnons, Hemingway, Ovide, Dante, Virgile, Hugo, Reverzy, Buzzati, Chatwin, Brauquier et autres trafiquants d’exotisme, les poètes, les oiseaux aussi, tout fait baume, ou devrait pouvoir panser... L’ouvrage est bouleversant de bout en bout qui vous traverse de part en part. Je me souviens que, le livre achevé, mes mains tremblaient et j’avais le cœur serré comme une gorge.
Parmi mes lectures marquantes au cours de cette année qui s’achève ce soir, je retiendrai une petite poignée de livres émouvants, à commencer par « Frère unique », d’Olivier Frébourg (Mercure de France), récit poignant, à la limite de l’insoutenable parfois, sur la disparition tragique, accidentelle, et injuste de son frère Thierry, « ponte » de la médecine, chercheur généticien de renommée mondiale et victime d’une minable erreur médicale sur le lieu même où il officia tant d’années : l’hôpital de Rouen – rendu coupable de n’avoir de surcroît jamais vraiment reconnu sa faute, ce qui donne lieu à des pages enragées de la part du frère meurtri et inconsolable ; révolté. Double peine. Mais ce livre intime (Olivier Frébourg avait déjà donné « Gaston et Gustave » sur la disparition d’un de ses fils grand prématuré, et – ai-je envie d’ajouter, « La grande nageuse », sur la douloureuse séparation d’avec la mère de tous ses fils) brille avant tout par les souvenirs d’enfance heureuse de deux frères sous le soleil des Antilles où la famille vécut un temps, de 1969 à 1972, puis en Normandie, berceau familial, car le père est un brillant commandant de Marine (officier de la Transat, il fut pressenti pour prendre le commandement du France). Nous savons Olivier Frébourg, écrivain de Marine, habité par la mer. Nous le découvrons ici « frère et fier » de son frère, son « pilier lumineux », qu’il admire sans ambages. « Nous étions des brotherships », écrit-il joliment. « J’étais enfant de la mélancolie. Il était le soleil. J’étais la lune ». L’écrivain Frébourg appelle alors à la rescousse ses vieux compagnons, Hemingway, Ovide, Dante, Virgile, Hugo, Reverzy, Buzzati, Chatwin, Brauquier et autres trafiquants d’exotisme, les poètes, les oiseaux aussi, tout fait baume, ou devrait pouvoir panser... L’ouvrage est bouleversant de bout en bout qui vous traverse de part en part. Je me souviens que, le livre achevé, mes mains tremblaient et j’avais le cœur serré comme une gorge.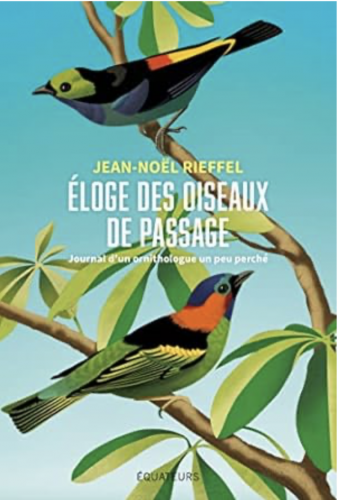 « Éloge des oiseaux de passage », de Jean-Noël Rieffel (Équateurs, vénérable maison dirigée par Olivier Frébourg) est un de mes chouchous car je suis un peu à l’origine de cette publication, puisque mon ami Jean-Noël m’avait envoyé son texte (devenant son premier lecteur, ce qui m’honora), que j’ai aussitôt aimé et transmis à mon autre ami Olivier Frébourg, qui s’enthousiasma à son tour. Ce premier livre est une ode à la migration, au pouvoir des oiseaux sur l’esprit de l’homme et donc sur son bonheur. Je partage avec son auteur trois passions : les oiseaux, la poésie et les vins purs. Il en est question dans ses pages, notamment de l’œuvre sensible et précieuse de Philippe Jaccottet. Quant aux oiseaux, ils imprègnent tant l’ouvrage qu’il me semble être composé de plumes et de chants. Je sais que le livre a connu un joli succès, et c’est justice qui me réjouit.
« Éloge des oiseaux de passage », de Jean-Noël Rieffel (Équateurs, vénérable maison dirigée par Olivier Frébourg) est un de mes chouchous car je suis un peu à l’origine de cette publication, puisque mon ami Jean-Noël m’avait envoyé son texte (devenant son premier lecteur, ce qui m’honora), que j’ai aussitôt aimé et transmis à mon autre ami Olivier Frébourg, qui s’enthousiasma à son tour. Ce premier livre est une ode à la migration, au pouvoir des oiseaux sur l’esprit de l’homme et donc sur son bonheur. Je partage avec son auteur trois passions : les oiseaux, la poésie et les vins purs. Il en est question dans ses pages, notamment de l’œuvre sensible et précieuse de Philippe Jaccottet. Quant aux oiseaux, ils imprègnent tant l’ouvrage qu’il me semble être composé de plumes et de chants. Je sais que le livre a connu un joli succès, et c’est justice qui me réjouit.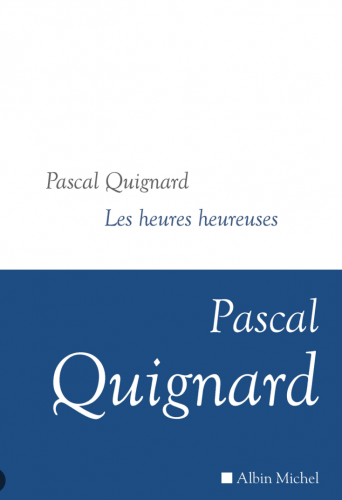 Fervent lecteur de Pascal Quignard, dont je lis absolument tout, j’ai été une fois encore enthousiasmé par « Les heures heureuses » (Albin Michel) qui poursuit la quête spirituelle de la sensation, des émotions pures, de la source de l’amour, de l'émoi originel, l’ensemble dans une langue tendue et on ne peut plus baroque (depuis « Tous les matins du monde »), minérale, d’une précision d’horloger genevois, à la limite du jansénisme littéraire, en tous cas d’une rigueur admirable qui n’exclut jamais – et c’est l’un des talents de Quignard, la dimension extrêmement poétique de sa prose. L’auteur aborde une foule de petits sujets universels par le biais de l’anecdote historique, de la description de l’événement au demeurant insignifiant. Chacun de ses livres, notamment cette « suite » intitulée « Dernier royaume » et dont c’est le XIIe opus, renvoie - à mes yeux en tous cas - à la phrase célèbre de Miguel Torga, « l’universel, c’est le local moins les murs ». Et n’est-ce pas la première vertu de la littérature, sa mission que de rendre universel le village de Macondo dans « Cent ans de solitude » – par exemple. Aussi, et c’est un sacré atout, « un » Quignard se dévore en picorant, le lecteur peut l’aborder comme des pintxos au comptoir d’un bar de San Sebastian. Et, par surcroît, il instruit considérablement, car il n’est jamais avare de détails étymologiques, philologiques, historiques, littéraires et philosophiques, qu’il évoque La Rochefoucauld ou un inconnu, la regrettée Emmanuèle Bernheim ou Spinoza. Et nous sortons de ces « heures heureuses » galvanisé et comme abasourdi lorsque, dans une salle obscure, d’un film exceptionnel nous lisons le générique de fin avec une scrupuleuse gourmandise...
Fervent lecteur de Pascal Quignard, dont je lis absolument tout, j’ai été une fois encore enthousiasmé par « Les heures heureuses » (Albin Michel) qui poursuit la quête spirituelle de la sensation, des émotions pures, de la source de l’amour, de l'émoi originel, l’ensemble dans une langue tendue et on ne peut plus baroque (depuis « Tous les matins du monde »), minérale, d’une précision d’horloger genevois, à la limite du jansénisme littéraire, en tous cas d’une rigueur admirable qui n’exclut jamais – et c’est l’un des talents de Quignard, la dimension extrêmement poétique de sa prose. L’auteur aborde une foule de petits sujets universels par le biais de l’anecdote historique, de la description de l’événement au demeurant insignifiant. Chacun de ses livres, notamment cette « suite » intitulée « Dernier royaume » et dont c’est le XIIe opus, renvoie - à mes yeux en tous cas - à la phrase célèbre de Miguel Torga, « l’universel, c’est le local moins les murs ». Et n’est-ce pas la première vertu de la littérature, sa mission que de rendre universel le village de Macondo dans « Cent ans de solitude » – par exemple. Aussi, et c’est un sacré atout, « un » Quignard se dévore en picorant, le lecteur peut l’aborder comme des pintxos au comptoir d’un bar de San Sebastian. Et, par surcroît, il instruit considérablement, car il n’est jamais avare de détails étymologiques, philologiques, historiques, littéraires et philosophiques, qu’il évoque La Rochefoucauld ou un inconnu, la regrettée Emmanuèle Bernheim ou Spinoza. Et nous sortons de ces « heures heureuses » galvanisé et comme abasourdi lorsque, dans une salle obscure, d’un film exceptionnel nous lisons le générique de fin avec une scrupuleuse gourmandise...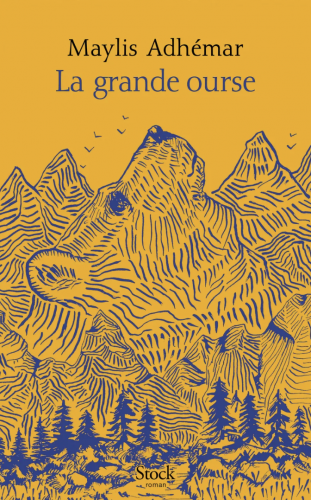 « La grande ourse », de Maylis Adhémar (Stock) est un roman brillant sur un thème devenu « à la mode » : la difficile cohabitation de l’homme en milieu pastoral avec (le retour) des grands prédateurs comme le loup et l’ours – le lynx croquant surtout les chevreuils des forêts vosgiennes. En l’occurrence, il s’agit des bergers ariégeois du Couserans – cette si belle région que l’auteur(e), toulousaine, connait dans les recoins, et de l’ours. L’écriture est sensible, précise, ciselée, les personnages parfois caricaturés (les rugbymen des bars de l’arrière-pays, le chasseur bourru, le berger bucolico-gionesque, la bergère dure à la tâche...), les paysages ne sont à mon goût pas assez
« La grande ourse », de Maylis Adhémar (Stock) est un roman brillant sur un thème devenu « à la mode » : la difficile cohabitation de l’homme en milieu pastoral avec (le retour) des grands prédateurs comme le loup et l’ours – le lynx croquant surtout les chevreuils des forêts vosgiennes. En l’occurrence, il s’agit des bergers ariégeois du Couserans – cette si belle région que l’auteur(e), toulousaine, connait dans les recoins, et de l’ours. L’écriture est sensible, précise, ciselée, les personnages parfois caricaturés (les rugbymen des bars de l’arrière-pays, le chasseur bourru, le berger bucolico-gionesque, la bergère dure à la tâche...), les paysages ne sont à mon goût pas assez 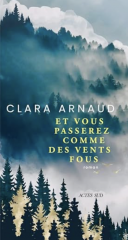 magnifiés, la narration d’un conflit qui enfle l'est bien davantage, et la jalousie de l’héroïne pour l’ex de son amoureux un peu too much. Une économie d’une cinquantaine de pages sur le sujet eut été bénéfique. Mais bon, cela n’exclut pas que ce livre soit pétri de qualités, et je le rapproche d’un autre grand texte franchement admirable, sur le même sujet, de Clara Arnaud, « Et vous passerez comme des vents fous » (Actes Sud).
magnifiés, la narration d’un conflit qui enfle l'est bien davantage, et la jalousie de l’héroïne pour l’ex de son amoureux un peu too much. Une économie d’une cinquantaine de pages sur le sujet eut été bénéfique. Mais bon, cela n’exclut pas que ce livre soit pétri de qualités, et je le rapproche d’un autre grand texte franchement admirable, sur le même sujet, de Clara Arnaud, « Et vous passerez comme des vents fous » (Actes Sud).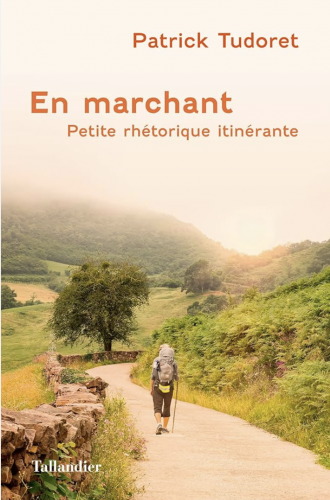 Sous-titré « Petite rhétorique itinérante », « En marchant », de Patrick Tudoret (Tallandier) est un précieux livre total car il entremêle érudition (sans frime aucune) et petite philosophie de la marche avec brio. Le tout piqué de souvenirs très personnels comme un gigot d’agneau l’est de gousses d’ail. Souvenons-nous que Montaigne, marcheur (et cavalier) impénitent, prétendait « penser par les pieds », et songeons avec Eugenio de Andrade, que « la démarche crée le chemin ». Tudoret est dans cette mouvance-là. Contemplatif et jamais sportif acharné, il prend le lecteur par la main, lequel prend son bâton de pèlerin, et c’est parti. Véritable anthologie littéraire à dominante poétique, le livre devient vite un compagnon que l’on est tenté de glisser dans le sac à dos pour nos prochaines haltes dans la montagne basque – où l’auteur randonne également. « Il y a une ivresse de la marche comme il y a une ivresse d’écrire », note-t-il. Tudoret aime à sentir « la pulpe d’un lieu », à en saisir « le pouls intime », et aussi marcher dans les pas des écrivains qu’il aime. Il en appelle à Saint-Augustin : « Qui n’avance pas piétine », souligne : « La marche comme école de détachement, d’affranchissement. On largue les amarres. La marche art du délestage, de l’allègement. Délestage physique, matériel, mais aussi moral : se déprendre de soi ». Et précise salutairement : « Les assis m’ennuient, ceux qui courent me fatiguent, j’aime ceux qui marchent ». Nous tous aussi, non ?..
Sous-titré « Petite rhétorique itinérante », « En marchant », de Patrick Tudoret (Tallandier) est un précieux livre total car il entremêle érudition (sans frime aucune) et petite philosophie de la marche avec brio. Le tout piqué de souvenirs très personnels comme un gigot d’agneau l’est de gousses d’ail. Souvenons-nous que Montaigne, marcheur (et cavalier) impénitent, prétendait « penser par les pieds », et songeons avec Eugenio de Andrade, que « la démarche crée le chemin ». Tudoret est dans cette mouvance-là. Contemplatif et jamais sportif acharné, il prend le lecteur par la main, lequel prend son bâton de pèlerin, et c’est parti. Véritable anthologie littéraire à dominante poétique, le livre devient vite un compagnon que l’on est tenté de glisser dans le sac à dos pour nos prochaines haltes dans la montagne basque – où l’auteur randonne également. « Il y a une ivresse de la marche comme il y a une ivresse d’écrire », note-t-il. Tudoret aime à sentir « la pulpe d’un lieu », à en saisir « le pouls intime », et aussi marcher dans les pas des écrivains qu’il aime. Il en appelle à Saint-Augustin : « Qui n’avance pas piétine », souligne : « La marche comme école de détachement, d’affranchissement. On largue les amarres. La marche art du délestage, de l’allègement. Délestage physique, matériel, mais aussi moral : se déprendre de soi ». Et précise salutairement : « Les assis m’ennuient, ceux qui courent me fatiguent, j’aime ceux qui marchent ». Nous tous aussi, non ?..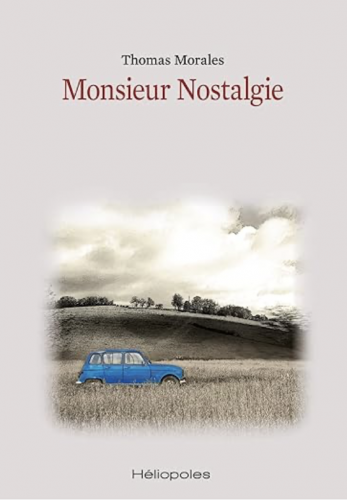 « Monsieur Nostalgie », de Thomas Morales (Heliopoles), déclaration d’amour aux Trente Glorieuses, hymne au « c’était - tellement - mieux avant », est un livre délicieux d’un grand styliste dans la lignée hussarde de Blondin, qui assume avec talent son attachement aux choses surannées et passées de mode. Mais qui pourrait prétendre que Claude Sautet, Bébel, le culte de la langue française, le panache hexagonal, les livres paillards de Boudard, la voix de Michel Delpech, le plat Berry qui est le sien puissent passer un jour de mode ? Morales possède ce passé brillant, truculent, hédoniste, cultivé, amical, gascon et rastignacien, épris de clochers et de ballons de rouge partagés au zinc, du mythe B.B. et des fromages bien faits, chevillé à l’âme comme au corps. Et nous le suivons, page à page, avec une gourmandise qui augmente à mesure, en lisant en ronronnant. « Arrière les esquimaux ! » Olé...
« Monsieur Nostalgie », de Thomas Morales (Heliopoles), déclaration d’amour aux Trente Glorieuses, hymne au « c’était - tellement - mieux avant », est un livre délicieux d’un grand styliste dans la lignée hussarde de Blondin, qui assume avec talent son attachement aux choses surannées et passées de mode. Mais qui pourrait prétendre que Claude Sautet, Bébel, le culte de la langue française, le panache hexagonal, les livres paillards de Boudard, la voix de Michel Delpech, le plat Berry qui est le sien puissent passer un jour de mode ? Morales possède ce passé brillant, truculent, hédoniste, cultivé, amical, gascon et rastignacien, épris de clochers et de ballons de rouge partagés au zinc, du mythe B.B. et des fromages bien faits, chevillé à l’âme comme au corps. Et nous le suivons, page à page, avec une gourmandise qui augmente à mesure, en lisant en ronronnant. « Arrière les esquimaux ! » Olé...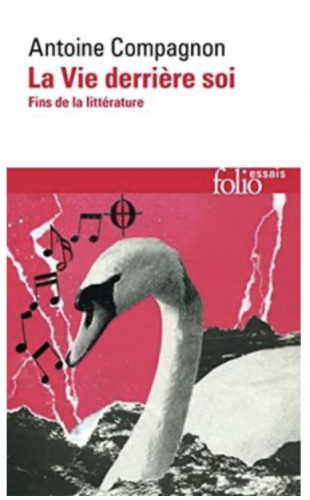 « La Vie derrière soi. Fins de la littérature », d’Antoine Compagnon (folio essais) est un essai aussi important que sombre. « La littérature a un lien essentiel avec la mort, le deuil et la mélancolie », prévient d’emblée l’ex-universitaire et essayiste des « Antimodernes » et le biographe inspiré (et à succès) de Montaigne, Proust et quelques autres. Est-ce l’âge, le décès de son épouse, la retraite prise... Compagnon se penche sur les œuvres tardives, évidemment pas comme Narcisse sur son reflet dans l’eau, mais en intellectuel constamment en question, à l’écoute, notamment sur ce qui pourrait constituer ce fléchissement de l’âme, sur ce qui préfigure chaque chant du cygne, sur les faiblesses physiques aussi – qu’il ne faut pas négliger, car elles gouvernent le mouvement de la main sur la feuille... L’érudition de l’ancien professeur au Collège de France (dont je suivais les cours, parfois dehors devant un écran géant, pour cause de succès, lorsque je vivais dans le Ve arrondissement, à un jet de galet du Collège...) brille par mille feux en voie d’extinction, et cette plongée dans les eaux profondes de l’ultima verba donne à voir et à réfléchir sur la teneur des dernières pages de « La Recherche », sur la théâtralisation du « Journal » de Gide, sur tant de récits de la vieillesse qui se révèlent parfois, souvent, plus toniques que ceux de la jeunesse, aussi. Stimulant.
« La Vie derrière soi. Fins de la littérature », d’Antoine Compagnon (folio essais) est un essai aussi important que sombre. « La littérature a un lien essentiel avec la mort, le deuil et la mélancolie », prévient d’emblée l’ex-universitaire et essayiste des « Antimodernes » et le biographe inspiré (et à succès) de Montaigne, Proust et quelques autres. Est-ce l’âge, le décès de son épouse, la retraite prise... Compagnon se penche sur les œuvres tardives, évidemment pas comme Narcisse sur son reflet dans l’eau, mais en intellectuel constamment en question, à l’écoute, notamment sur ce qui pourrait constituer ce fléchissement de l’âme, sur ce qui préfigure chaque chant du cygne, sur les faiblesses physiques aussi – qu’il ne faut pas négliger, car elles gouvernent le mouvement de la main sur la feuille... L’érudition de l’ancien professeur au Collège de France (dont je suivais les cours, parfois dehors devant un écran géant, pour cause de succès, lorsque je vivais dans le Ve arrondissement, à un jet de galet du Collège...) brille par mille feux en voie d’extinction, et cette plongée dans les eaux profondes de l’ultima verba donne à voir et à réfléchir sur la teneur des dernières pages de « La Recherche », sur la théâtralisation du « Journal » de Gide, sur tant de récits de la vieillesse qui se révèlent parfois, souvent, plus toniques que ceux de la jeunesse, aussi. Stimulant.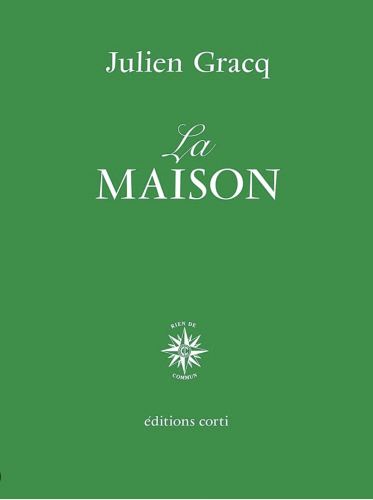 Bien sûr il y eut la divine surprise – oh, vingt-neuf pages à peine -, mais de l’indépassable Julien Gracq, avec « La Maison » (Corti), nouvel inédit, cadeau du ciel et des étoiles, condensé du talent immense du « patron » comme disait Nourissier. L’histoire, mais en est-ce une, est mince come un papier Rizla+, et en faut-il d’ailleurs une pour faire œuvre (à vocation) universelle ? cf. supra. L’apparition énigmatique d’une maison enfouie dans une friche sur le trajet du bus, « comme l’affût précautionneux et tendu d’une bête lourde au milieu de ces solitudes », « de ces fourrés sans oiseaux ». Nous sommes aussitôt chez Poe que Gracq vénérait autant que Verne. Son approche furtive un jour, à pied, « le besoin de me sentir le cœur net de l’envoûtement bizarre de ces bois sans joie », « une extraordinaire suggestion d’abandon et de tristesse », et tout à trac le chant à peine perçu d’une femme, « une voix nue », la vue, l’espace d’un court instant, de « quelque chose d’elle », « la pointe de deux pieds nus », et il n’en faut pas davantage pour générer une montagne d’un désir retenu serré par l’écriture comme jamais maîtrisée de l’auteur du « Balcon en forêt ». La charge érotique de ce très court texte est d’une intensité sublime puisque tout est suggéré, entrevu, et enfin la chute, que je délivre ici car elle n’empêche aucunement le plaisir du texte, sa montée en puissance comme le mercure dans le thermomètre, « ... plus nue encore, et plus secrète que les pieds nus, la masse ondée, prodiguée, déployée, comme une draperie, d’une longue chevelure blonde, la chevelure défaite d’une femme ». Qui écrit mieux ?
Bien sûr il y eut la divine surprise – oh, vingt-neuf pages à peine -, mais de l’indépassable Julien Gracq, avec « La Maison » (Corti), nouvel inédit, cadeau du ciel et des étoiles, condensé du talent immense du « patron » comme disait Nourissier. L’histoire, mais en est-ce une, est mince come un papier Rizla+, et en faut-il d’ailleurs une pour faire œuvre (à vocation) universelle ? cf. supra. L’apparition énigmatique d’une maison enfouie dans une friche sur le trajet du bus, « comme l’affût précautionneux et tendu d’une bête lourde au milieu de ces solitudes », « de ces fourrés sans oiseaux ». Nous sommes aussitôt chez Poe que Gracq vénérait autant que Verne. Son approche furtive un jour, à pied, « le besoin de me sentir le cœur net de l’envoûtement bizarre de ces bois sans joie », « une extraordinaire suggestion d’abandon et de tristesse », et tout à trac le chant à peine perçu d’une femme, « une voix nue », la vue, l’espace d’un court instant, de « quelque chose d’elle », « la pointe de deux pieds nus », et il n’en faut pas davantage pour générer une montagne d’un désir retenu serré par l’écriture comme jamais maîtrisée de l’auteur du « Balcon en forêt ». La charge érotique de ce très court texte est d’une intensité sublime puisque tout est suggéré, entrevu, et enfin la chute, que je délivre ici car elle n’empêche aucunement le plaisir du texte, sa montée en puissance comme le mercure dans le thermomètre, « ... plus nue encore, et plus secrète que les pieds nus, la masse ondée, prodiguée, déployée, comme une draperie, d’une longue chevelure blonde, la chevelure défaite d’une femme ». Qui écrit mieux ?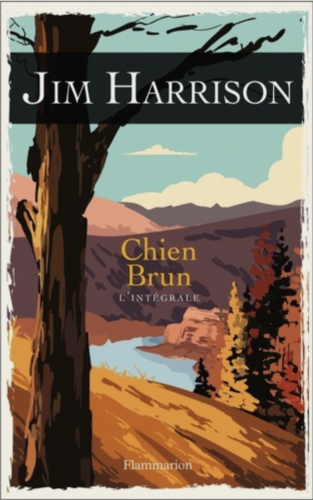 Grâce soit rendue à Brice Matthieussent, traducteur magnifique de tout l’œuvre – volumineuse (trente ouvrages) de « Big Jim » et à Flammarion d’avoir rassemblé tout ce que ce corpus compte de récits et d’extraits de romans, de « novelas » aussi, placés sous la personne emblématique de Chien Brun, double de Jim Harrison, « Chien Brun. L’intégrale » (Flammarion), donc. Il s’agit d’un livre en surnuméraire lorsqu’on possède une étagère pleine à ras-bord des bouquins de Jim, et qui – pour l’anecdote, faillit un jour me priver de vieillir, en tombant brusquement sur ma tête. Je m’en tirai avec un éclat de rire étrange et une bosse énorme. Ah, Chien Brun, mélancolique bâtard supposé d’Indien mais n’ayant que du sang chaud qui circule ardemment dans les veines, Chien Brun l’anar broussard du Michigan dépourvu de numéro de sécurité sociale – notez la poésie insolite de ces mots, Chien Brun pêcheur de truites et devant l’éternel, Chien Brun chasseur et trousseur, sauvage comme on aime les personnages de cette Amérique des grands espaces, court ici sur près de six cents pages, et plus on les feuillette, s’y arrête, plus Jim nous manque. Mais ce n’est pas si grave, Chien Brun se retourne, décèle votre peine, et vous embarque, et c’est bon de le suivre à nouveau, de le lire...
Grâce soit rendue à Brice Matthieussent, traducteur magnifique de tout l’œuvre – volumineuse (trente ouvrages) de « Big Jim » et à Flammarion d’avoir rassemblé tout ce que ce corpus compte de récits et d’extraits de romans, de « novelas » aussi, placés sous la personne emblématique de Chien Brun, double de Jim Harrison, « Chien Brun. L’intégrale » (Flammarion), donc. Il s’agit d’un livre en surnuméraire lorsqu’on possède une étagère pleine à ras-bord des bouquins de Jim, et qui – pour l’anecdote, faillit un jour me priver de vieillir, en tombant brusquement sur ma tête. Je m’en tirai avec un éclat de rire étrange et une bosse énorme. Ah, Chien Brun, mélancolique bâtard supposé d’Indien mais n’ayant que du sang chaud qui circule ardemment dans les veines, Chien Brun l’anar broussard du Michigan dépourvu de numéro de sécurité sociale – notez la poésie insolite de ces mots, Chien Brun pêcheur de truites et devant l’éternel, Chien Brun chasseur et trousseur, sauvage comme on aime les personnages de cette Amérique des grands espaces, court ici sur près de six cents pages, et plus on les feuillette, s’y arrête, plus Jim nous manque. Mais ce n’est pas si grave, Chien Brun se retourne, décèle votre peine, et vous embarque, et c’est bon de le suivre à nouveau, de le lire...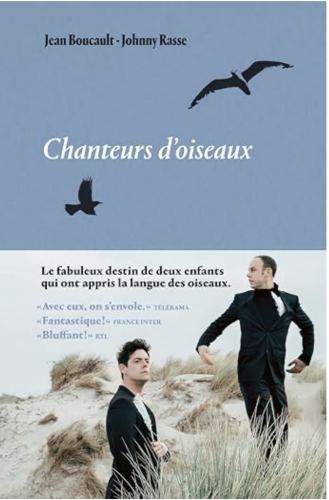 Voici un ouvrage singulier que Jim Harrison aurait sans doute aimé. « Chanteurs d’oiseaux », de Jean Boucault et Johnny Rasse (Les Arènes/PUG), ou l’histoire de deux surdoués de l’imitation des chants d’oiseaux – l’un est spécialiste du goéland argenté, l’autre du merle noir, qui raflent tous les concours (ce qui semble très étrange, pour un citadin) ayant cours notamment en baie de Somme, d’où ils sont issus. Terre d’oiseaux de passage, ils ont grandi parmi eux, du côté d’Arrest, leur parcours est narré en alternance, et ils se donnent aujourd’hui en spectacle, et c’est paraît-il bluffant (mais j’ai la chance immense de pouvoir les écouter bientôt, vers la mi-janvier, à Paris, à la faveur du Salon du Livre de Nature, où se tiendra leur prestation). Leur récit alterné est touchant, simple, qui décrit leur quotidien, l’école – surtout buissonnière, l’amour infini des oiseaux, l’apprentissage de leur parole, de l’infinie subtilité des « modulations de fréquence » de chacune d’elles, la naissance d’une passion dévorante, tout cela est décrit dans une langue directe et sensible, naturellement sauvage et saumâtre, avec des adjectifs beaux comme des marécages à l’aube, des joncs éclairés par un soleil timide. « Je t’apprendrai à faire le courlis cendré ». Juste cette phrase et je frissonne. Comprenne qui sait déjà...
Voici un ouvrage singulier que Jim Harrison aurait sans doute aimé. « Chanteurs d’oiseaux », de Jean Boucault et Johnny Rasse (Les Arènes/PUG), ou l’histoire de deux surdoués de l’imitation des chants d’oiseaux – l’un est spécialiste du goéland argenté, l’autre du merle noir, qui raflent tous les concours (ce qui semble très étrange, pour un citadin) ayant cours notamment en baie de Somme, d’où ils sont issus. Terre d’oiseaux de passage, ils ont grandi parmi eux, du côté d’Arrest, leur parcours est narré en alternance, et ils se donnent aujourd’hui en spectacle, et c’est paraît-il bluffant (mais j’ai la chance immense de pouvoir les écouter bientôt, vers la mi-janvier, à Paris, à la faveur du Salon du Livre de Nature, où se tiendra leur prestation). Leur récit alterné est touchant, simple, qui décrit leur quotidien, l’école – surtout buissonnière, l’amour infini des oiseaux, l’apprentissage de leur parole, de l’infinie subtilité des « modulations de fréquence » de chacune d’elles, la naissance d’une passion dévorante, tout cela est décrit dans une langue directe et sensible, naturellement sauvage et saumâtre, avec des adjectifs beaux comme des marécages à l’aube, des joncs éclairés par un soleil timide. « Je t’apprendrai à faire le courlis cendré ». Juste cette phrase et je frissonne. Comprenne qui sait déjà...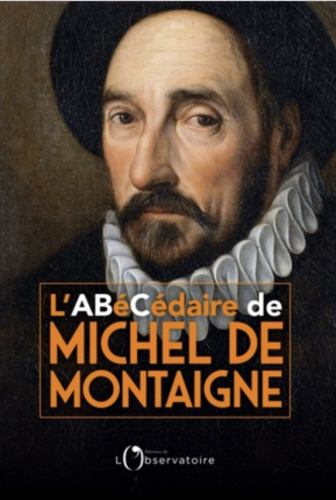 « L’ABéCédaire de Michel de Montaigne », choisi par Michel Magnien (L’Observatoire) est issu d’une collection particulièrement attachante (celui de Romain Gary nous avait ravi, il y a quelques mois). Il agit comme un « memo », un rappel, un vaccin, on le feuillette en cherchant des entrées moins convenues, laissant tomber amitié, cannibales, apprendre à mourir, éducation... en musardant du côté de bordel, branloire, chasse, constance, cul, délectation morose, désir, difformité, écrivaillerie, garde-robe, ivrognerie, etc. Inépuisable Montaigne. Ce livre est à rapprocher du (déjà ancien) « Le meilleur de Montaigne », concocté par Claude Pinganaud pour arléa. Revenir, toujours, à Montaigne.
« L’ABéCédaire de Michel de Montaigne », choisi par Michel Magnien (L’Observatoire) est issu d’une collection particulièrement attachante (celui de Romain Gary nous avait ravi, il y a quelques mois). Il agit comme un « memo », un rappel, un vaccin, on le feuillette en cherchant des entrées moins convenues, laissant tomber amitié, cannibales, apprendre à mourir, éducation... en musardant du côté de bordel, branloire, chasse, constance, cul, délectation morose, désir, difformité, écrivaillerie, garde-robe, ivrognerie, etc. Inépuisable Montaigne. Ce livre est à rapprocher du (déjà ancien) « Le meilleur de Montaigne », concocté par Claude Pinganaud pour arléa. Revenir, toujours, à Montaigne.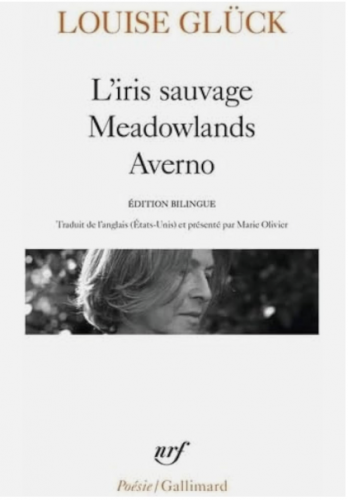 J’en attendais plus. Je fus déçu. Comme souvent, avec le choix de l’Académie Nobel. Louise Glück ne profita pas longtemps du sien, obtenu en 2020, car elle vient de nous quitter. La « grande » poétesse américaine se voit compilée par Poésie/Gallimard, avec « L’Iris sauvage, Meadowlands, et Averno » lesquels m’ont laissé sur ma faim de poésie profonde, dense, parce que, page 193, je ne me contente pas du début du poème intitulé
J’en attendais plus. Je fus déçu. Comme souvent, avec le choix de l’Académie Nobel. Louise Glück ne profita pas longtemps du sien, obtenu en 2020, car elle vient de nous quitter. La « grande » poétesse américaine se voit compilée par Poésie/Gallimard, avec « L’Iris sauvage, Meadowlands, et Averno » lesquels m’ont laissé sur ma faim de poésie profonde, dense, parce que, page 193, je ne me contente pas du début du poème intitulé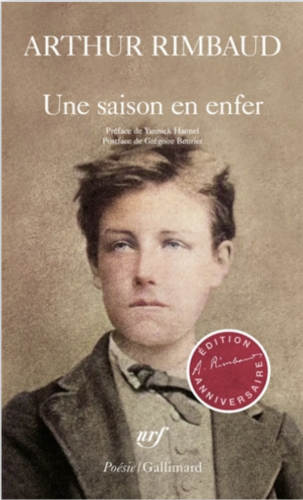 Approcherions-nous, via cette dernière image, de l’éternité décrite (« Quoi? »..) par Rimbaud, dont on célèbre le 150eanniversaire de l’impression à compte d’auteur à Bruxelles, des cinquante-quatre pages d’« Une saison en enfer » (Poésie/Gallimard), soit une mince plaquette de textes en prose sertie de sept poèmes en vers, avec des pages blanches, des fautes typographiques demeurées (il s’agit d’un fac-similé, comme celui qu’arléa offrit à ses fidèles clients il y a quelques années). La mention PRIX : UN FRANC qui barre la page de titre (intérieure)
Approcherions-nous, via cette dernière image, de l’éternité décrite (« Quoi? »..) par Rimbaud, dont on célèbre le 150eanniversaire de l’impression à compte d’auteur à Bruxelles, des cinquante-quatre pages d’« Une saison en enfer » (Poésie/Gallimard), soit une mince plaquette de textes en prose sertie de sept poèmes en vers, avec des pages blanches, des fautes typographiques demeurées (il s’agit d’un fac-similé, comme celui qu’arléa offrit à ses fidèles clients il y a quelques années). La mention PRIX : UN FRANC qui barre la page de titre (intérieure)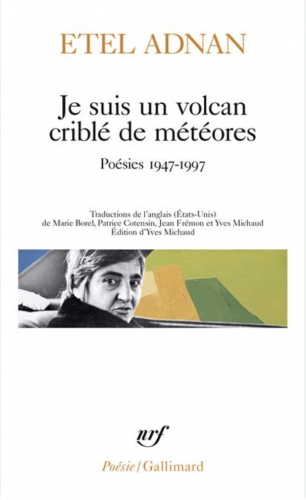 « Je suis un volcan criblé de météores », de Etel Adnan (Poésie/Gallimard), m’est une découverte majeure. Cette somme de poésies qui couvre les années 1947 à 1997 provient d’une poétesse prolixe (1925-2021) tardivement reconnue, peintre aussi, issue du carrefour de plusieurs cultures (turque, grecque, libanaise, française, américaine). Il y a des poèmes militants à connotation politique, je les ai écartés d’instinct, considérant avec Stendhal que « la politique dans un roman, c’est un coup de pistolet dans un concert », et avec Proust que des idées dans une fiction « sont comme l’étiquette du prix laissée sur un cadeau ». En revanche, de très nombreux textes sont infiniment sensibles, touchants. Extraits :
« Je suis un volcan criblé de météores », de Etel Adnan (Poésie/Gallimard), m’est une découverte majeure. Cette somme de poésies qui couvre les années 1947 à 1997 provient d’une poétesse prolixe (1925-2021) tardivement reconnue, peintre aussi, issue du carrefour de plusieurs cultures (turque, grecque, libanaise, française, américaine). Il y a des poèmes militants à connotation politique, je les ai écartés d’instinct, considérant avec Stendhal que « la politique dans un roman, c’est un coup de pistolet dans un concert », et avec Proust que des idées dans une fiction « sont comme l’étiquette du prix laissée sur un cadeau ». En revanche, de très nombreux textes sont infiniment sensibles, touchants. Extraits : 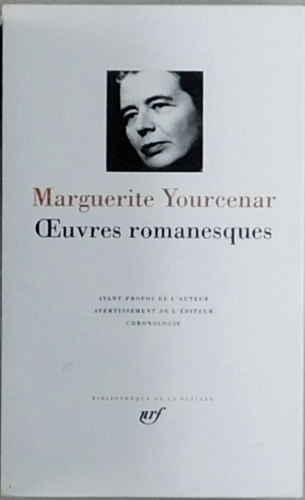 À la faveur de retards homériques des trains de la SNCF la veille de Noël et son surlendemain, et ayant pris soin, au cas où si probable, de me munir d’une Pléiade, j’ai relu les Oeuvres romanesques de Marguerite Yourcenar, la grande Marguerite Yourcenar. « Alexis ou le traité du vain combat », Le coup de grâce », « Feux », « « Nouvelles orientales », un peu de « l’Œuvre au Noir », des « Mémoires d’Hadrien »... Un bonheur réitéré une journée durant entre Bayonne et Nîmes, via Bordeaux et Toulouse. Je suis soudain tenté de reproduire ici tout ce que j’ai pu annoter au crayon sur le papier bible, tant de fulgurances, de traits, de percussion, de vérité, de subtilité extrême... Allez, juste deux ou trois comme ça, pour frissonner :
À la faveur de retards homériques des trains de la SNCF la veille de Noël et son surlendemain, et ayant pris soin, au cas où si probable, de me munir d’une Pléiade, j’ai relu les Oeuvres romanesques de Marguerite Yourcenar, la grande Marguerite Yourcenar. « Alexis ou le traité du vain combat », Le coup de grâce », « Feux », « « Nouvelles orientales », un peu de « l’Œuvre au Noir », des « Mémoires d’Hadrien »... Un bonheur réitéré une journée durant entre Bayonne et Nîmes, via Bordeaux et Toulouse. Je suis soudain tenté de reproduire ici tout ce que j’ai pu annoter au crayon sur le papier bible, tant de fulgurances, de traits, de percussion, de vérité, de subtilité extrême... Allez, juste deux ou trois comme ça, pour frissonner :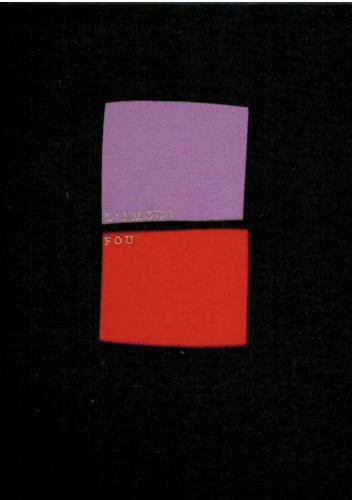 J’achèverai cette brève liste (j’en oublie, c’est certain, car une année c’est long, mais je la rectifierai, le cas échéant)... Avec une relecture, « L’Amour fou », d’André Breton dans une belle édition rare, illustrée et numérotée du Club français du livre, j'ai éprouvé le besoin parallèle de reprendre le « André Breton. Quelques aspects de l’écrivain », de Julien Gracq (José Corti) pour ce qui y est souligné par celui qui fut fasciné par le père du surréalisme : ce
J’achèverai cette brève liste (j’en oublie, c’est certain, car une année c’est long, mais je la rectifierai, le cas échéant)... Avec une relecture, « L’Amour fou », d’André Breton dans une belle édition rare, illustrée et numérotée du Club français du livre, j'ai éprouvé le besoin parallèle de reprendre le « André Breton. Quelques aspects de l’écrivain », de Julien Gracq (José Corti) pour ce qui y est souligné par celui qui fut fasciné par le père du surréalisme : ce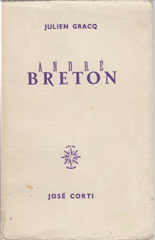 pouvoir prodigieux d’associer sans contrainte pour le lecteur la poésie et l’essai, la beauté de la phrase et la réflexion sur le motif. Avec Breton, comment dire... l’émulsion, pour une fois, semble pouvoir prendre : l’eau à l’huile s’allie et la fusion procède d’un alliage unique. « L’Amour fou », donc, offert par une main experte en surréalisme, « parce que la neige demeure sous la cendre », et ses inoxydables fulgurances, pour le plaisir du texte, soit pour ne jamais changer...
pouvoir prodigieux d’associer sans contrainte pour le lecteur la poésie et l’essai, la beauté de la phrase et la réflexion sur le motif. Avec Breton, comment dire... l’émulsion, pour une fois, semble pouvoir prendre : l’eau à l’huile s’allie et la fusion procède d’un alliage unique. « L’Amour fou », donc, offert par une main experte en surréalisme, « parce que la neige demeure sous la cendre », et ses inoxydables fulgurances, pour le plaisir du texte, soit pour ne jamais changer...
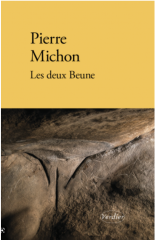
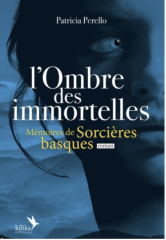
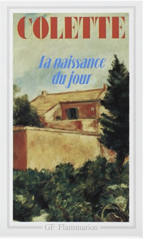
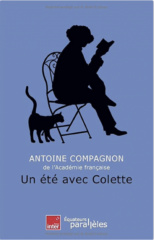
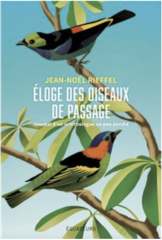
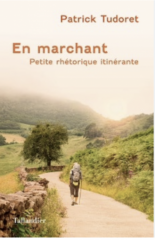
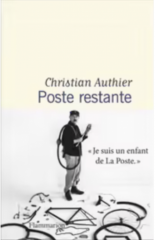
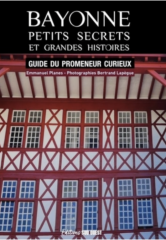
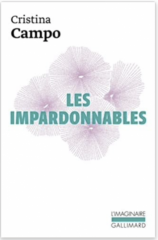
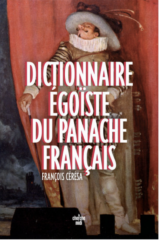

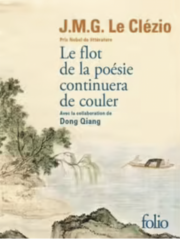
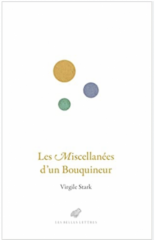
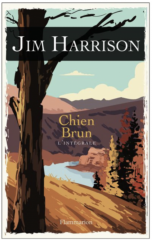
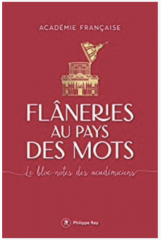
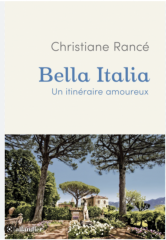
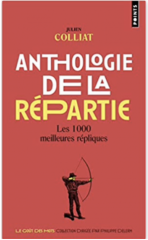
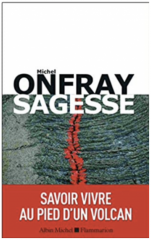

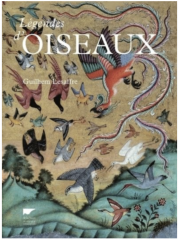
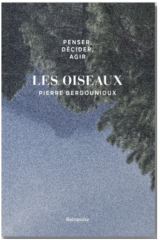
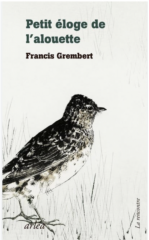
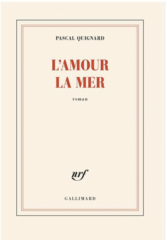

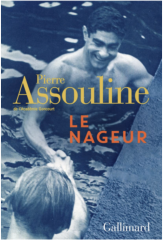
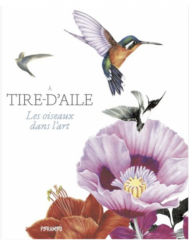
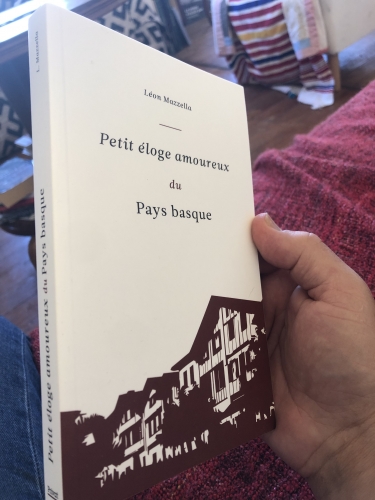
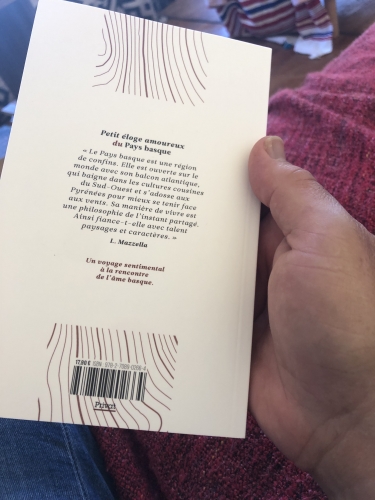
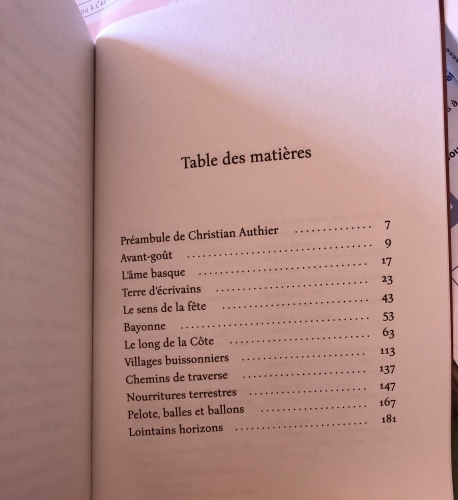
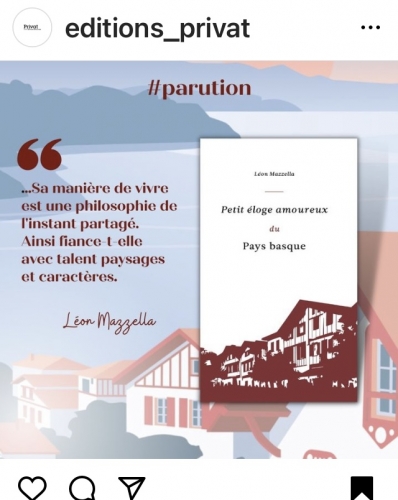
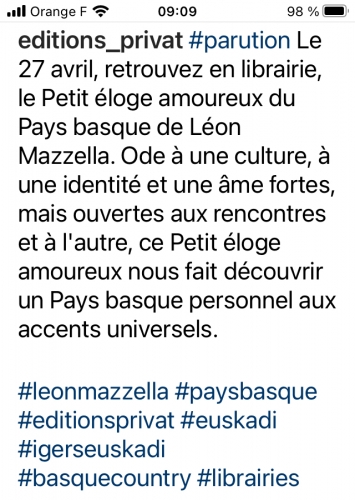
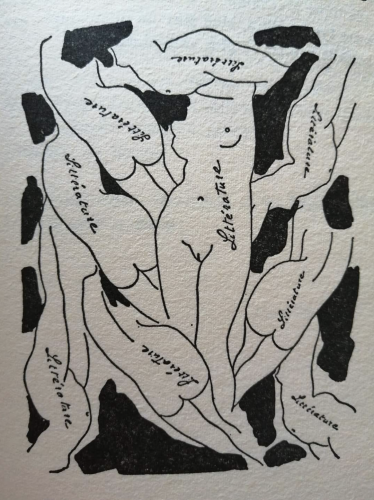

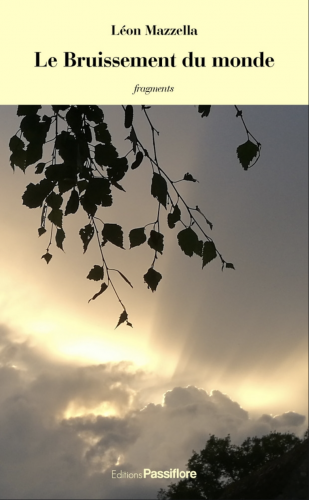
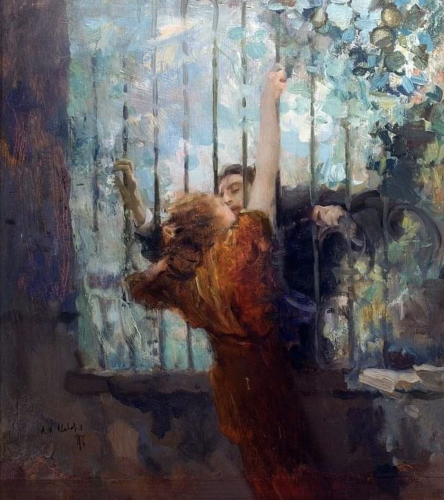
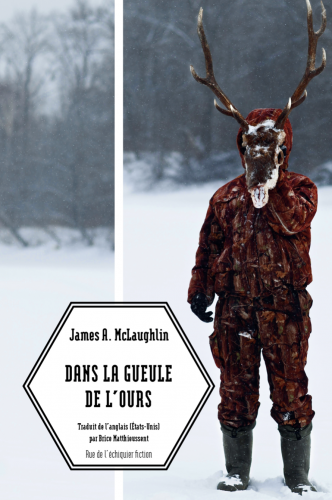 Ça se confirme. Dans la gueule de l'ours, de James A. McLaughlin (Rue de l'échiquier) - déjà évoqué ici, lire plus bas -, est un grand (premier) roman de nature sauvage qui sent bon les veines nouées, fluides, riches de Jim Harrison, Norman McLean, Rick Bass, James Crumley, Thomas Mc Guane... C'est puissant, rugueux, âpre, rude, fort en muscles, en alcool, en mots, en regards, en gestes, en sentiments exacerbés. La langue est somptueuse, qui abonde de descriptions tantôt lyriques tantôt sèches. Rice Moore, ce criminel en cavale devenu garde forestier au fin fond des Appalaches, ne nous quitte pas. Le cartel mexicain de la drogue à ses trousses devient anecdotique, lorsqu'il nous emporte dans son enquête sur ces ours mutilés pour en extraire la vésicule qui vaut de l'or en Chine. La mafia est là, nous la sentons partout. Mais nous ressentons davantage, pour notre bonheur, la nature brute de l'environnement aussi hostile qu'apprivoisable qui chatouille un héros peu ordinaire, au caractère trempé; inoubliable.
Ça se confirme. Dans la gueule de l'ours, de James A. McLaughlin (Rue de l'échiquier) - déjà évoqué ici, lire plus bas -, est un grand (premier) roman de nature sauvage qui sent bon les veines nouées, fluides, riches de Jim Harrison, Norman McLean, Rick Bass, James Crumley, Thomas Mc Guane... C'est puissant, rugueux, âpre, rude, fort en muscles, en alcool, en mots, en regards, en gestes, en sentiments exacerbés. La langue est somptueuse, qui abonde de descriptions tantôt lyriques tantôt sèches. Rice Moore, ce criminel en cavale devenu garde forestier au fin fond des Appalaches, ne nous quitte pas. Le cartel mexicain de la drogue à ses trousses devient anecdotique, lorsqu'il nous emporte dans son enquête sur ces ours mutilés pour en extraire la vésicule qui vaut de l'or en Chine. La mafia est là, nous la sentons partout. Mais nous ressentons davantage, pour notre bonheur, la nature brute de l'environnement aussi hostile qu'apprivoisable qui chatouille un héros peu ordinaire, au caractère trempé; inoubliable.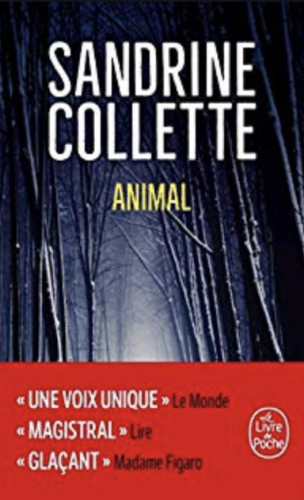 Idem pour Animal, - évoqué lui aussi il y a quelques jours -, de Sandrine Collette (Livre de poche), championne en intrigues sinueuses. Mara se fera prendre (euphémisme) par l'ours au Kamtchatka, puis elle ira à la rencontre du tigre en Asie, plus loin. Et de son enfance. La recherche de ses propres limites, la quête du sauvage en soi, la part d'animalité que nous possédons tous, que d'aucuns refoulent par commodité, mais que d'autres fouillent et s'efforcent d'extraire afin de la regarder en face comme le crâne dans la main d'Hamlet, Collette nous la pose sur la table comme on y dépose un coeur sanguinolent ou un foie frais, brut. Les territoires d'une impossible approche mais d'une certaine rencontre, à travers Lior, cette Diane chasseresse d'un outre-monde, deviennent un lieu inconnu des cartes, seulement repérable par les membres d'une communauté invisible. Celles des chamans de l'impossible. En faites-vous partie?
Idem pour Animal, - évoqué lui aussi il y a quelques jours -, de Sandrine Collette (Livre de poche), championne en intrigues sinueuses. Mara se fera prendre (euphémisme) par l'ours au Kamtchatka, puis elle ira à la rencontre du tigre en Asie, plus loin. Et de son enfance. La recherche de ses propres limites, la quête du sauvage en soi, la part d'animalité que nous possédons tous, que d'aucuns refoulent par commodité, mais que d'autres fouillent et s'efforcent d'extraire afin de la regarder en face comme le crâne dans la main d'Hamlet, Collette nous la pose sur la table comme on y dépose un coeur sanguinolent ou un foie frais, brut. Les territoires d'une impossible approche mais d'une certaine rencontre, à travers Lior, cette Diane chasseresse d'un outre-monde, deviennent un lieu inconnu des cartes, seulement repérable par les membres d'une communauté invisible. Celles des chamans de l'impossible. En faites-vous partie?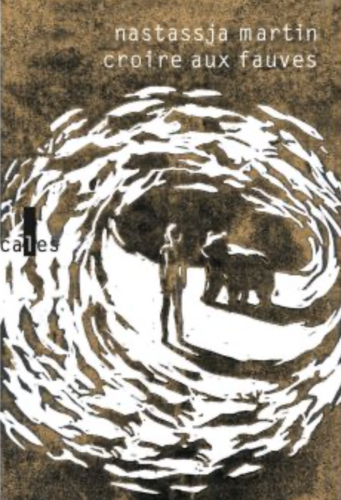 C'est un peu ce que Natassja Martin nous chuchote à voix basse, avec son magnifique récit, Croire aux fauves (Verticales), d'une beauté renversante. Ethnologue, elle faillit disparaître dans la gueule d'un ours, au Kamtchatka, elle aussi. L'animal lui fit grâce, ce qui la lia indéfiniment à lui, non sans la défigurer et lui faire endurer un temps long dans les hopîtaux russes - ce qui vaut de superbes passages sur l'univers médical, loin du confort d'une Pitié-Salpetrière... Natassja devient incarnée, habitée, intriquée, possédée. Autre. Devenue mathuka (ourse), l'auteur se métamorphose à son corps défendant en devenant mieux : miedka, marquée par l'ours. Soit moitié humaine, moitié animale. Le récit devient mystique. La quête de l'auteure mutilée sublime par ses évocations douces d'un corps à corps d'un autre temps et d'un autre monde, d'une dimension immesurable, ce que personne ne peut imaginer dans son tranquille quotidien. Ecrit dans une langue percutante et dépouillée, Croire aux fauves (*) transcende la littérature qui croit au qui-vive, au miroir dans le silence de l'autre, à la territorialité, à la puissance, à la grâce, au baiser qui ne tue pas, à la paternité, au don, à la fluidité complexe des rôles, à la fascination. À l'essence même de la chasse dans ce qu'elle a de plus sublime, philosophique, sage, essentiel.
C'est un peu ce que Natassja Martin nous chuchote à voix basse, avec son magnifique récit, Croire aux fauves (Verticales), d'une beauté renversante. Ethnologue, elle faillit disparaître dans la gueule d'un ours, au Kamtchatka, elle aussi. L'animal lui fit grâce, ce qui la lia indéfiniment à lui, non sans la défigurer et lui faire endurer un temps long dans les hopîtaux russes - ce qui vaut de superbes passages sur l'univers médical, loin du confort d'une Pitié-Salpetrière... Natassja devient incarnée, habitée, intriquée, possédée. Autre. Devenue mathuka (ourse), l'auteur se métamorphose à son corps défendant en devenant mieux : miedka, marquée par l'ours. Soit moitié humaine, moitié animale. Le récit devient mystique. La quête de l'auteure mutilée sublime par ses évocations douces d'un corps à corps d'un autre temps et d'un autre monde, d'une dimension immesurable, ce que personne ne peut imaginer dans son tranquille quotidien. Ecrit dans une langue percutante et dépouillée, Croire aux fauves (*) transcende la littérature qui croit au qui-vive, au miroir dans le silence de l'autre, à la territorialité, à la puissance, à la grâce, au baiser qui ne tue pas, à la paternité, au don, à la fluidité complexe des rôles, à la fascination. À l'essence même de la chasse dans ce qu'elle a de plus sublime, philosophique, sage, essentiel.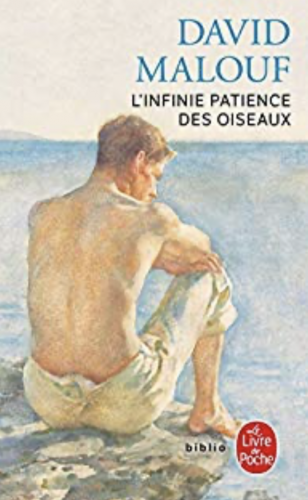 David Malouf, avec L'infinie patience des oiseaux (Livre de Poche), offre un roman d'une fluidité envoûtante. Deux hommes se retrouvent sur le terrain de l'ornithologie, leur passion. Ils ambitionnent de créer un sanctuaire dédié aux oiseaux en Australie, où cela se déroule. Jim et Ashley sont complices d'une certaine approche de la Nature. Les descriptions des marais qu'ils arpentent et étudient sont splendides. Un personnage féminin (comme dans tout roman aux clés basiques) interfère, et Imogen, photographe, surgit. L'amour aussi, entre Jim et elle. Mais la Grande Guerre explose. Les garçons s'engagent et se retrouvent sur le Front, du côté d'Ypres, de sinistre mémoire. L'horreur est méticuleusement décrite, sans filtre, et l'insoutenable devient tolérable à la lecture, grâce aux oiseaux migrateurs - alouettes, notamment -, à un torcol aussi, décrits avec amour par deux jeunes soldats - égarés fondamentaux comme le furent tous les soldats australiens, anglais, français, allemands... -, et trouvant la force de s'émouvoir de l'insouciance des volatiles que le vacarme des obus ne semblait pas déranger outre mesure. Magnifique. Quatre bijoux. L.M.
David Malouf, avec L'infinie patience des oiseaux (Livre de Poche), offre un roman d'une fluidité envoûtante. Deux hommes se retrouvent sur le terrain de l'ornithologie, leur passion. Ils ambitionnent de créer un sanctuaire dédié aux oiseaux en Australie, où cela se déroule. Jim et Ashley sont complices d'une certaine approche de la Nature. Les descriptions des marais qu'ils arpentent et étudient sont splendides. Un personnage féminin (comme dans tout roman aux clés basiques) interfère, et Imogen, photographe, surgit. L'amour aussi, entre Jim et elle. Mais la Grande Guerre explose. Les garçons s'engagent et se retrouvent sur le Front, du côté d'Ypres, de sinistre mémoire. L'horreur est méticuleusement décrite, sans filtre, et l'insoutenable devient tolérable à la lecture, grâce aux oiseaux migrateurs - alouettes, notamment -, à un torcol aussi, décrits avec amour par deux jeunes soldats - égarés fondamentaux comme le furent tous les soldats australiens, anglais, français, allemands... -, et trouvant la force de s'émouvoir de l'insouciance des volatiles que le vacarme des obus ne semblait pas déranger outre mesure. Magnifique. Quatre bijoux. L.M.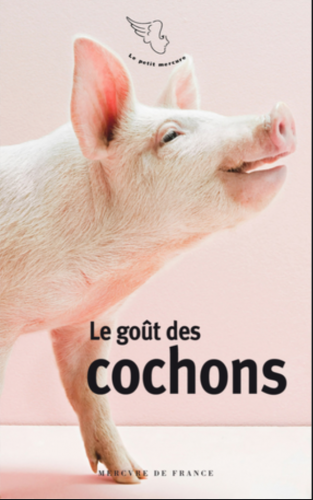 Blandine Vié est une sacrée auteure gourmande, passionnée de cochon au point de lui consacrer un ouvrage il y a peu et des articles à la ribambelle sur le site Greta Garbure qu’elle co-anime avec son complice Patrick de Mari. D’ailleurs, l’un de ses « posts » mis en ligne a été retenu dans une mini-anthologie de la fameuse collection « le goût de » au Mercure de France. Dans « Le goût des cochons » (8,20€) figure, aux côtés de classiques comme Renard (avec un extrait célèbre des « Histoires Naturelles »), Claudel (et un délicieux poème en prose décrivant la bête), Maupassant (avec un texte de jeunesse), Huysmans (un extrait de « En route »), Hugo (et un émouvant poème, « Le porc et le sultan »), Verlaine (avec un détonnant pastiche des « Amants » de Baudelaire, intitulé « La Mort des cochons », pornographique à souhait, tiré de « L’Album zutique » qu’il coécrivit avec Léon Valade) et, plus près de nous, Jérôme Ferrari (et un extrait brut de son « Sermon sur la chute de Rome », décrivant un paysan Corse occupé à châtrer les verrats), ou Philippe Sollers (en amoureux délicat de la chair du cochon, dont il fait l’éloge)... Figure donc un texte délicieux de Blandine Vié au sujet de l’étymologie des mots du cochon, de la truie et de ses attributs, intitulé « Une vulve de truie peut en cacher une autre ! » À l’arrière-train où vont les choses, et sans évoquer la peste porcine africaine qui fait des ravages en Chine, donc le bonheur des éleveurs bretons, et qui est provisoirement circonscrite dans les Ardennes belges, mieux vaut en rire en s’instruisant - grâce à ce texte bref et dense, érudit et drôle à la fois. Blandine y enchaîne comme dans un rébus le sens caché des mots, dont les évocations rebondissent et jouent à ... saute-cochon. Remarque : ce
Blandine Vié est une sacrée auteure gourmande, passionnée de cochon au point de lui consacrer un ouvrage il y a peu et des articles à la ribambelle sur le site Greta Garbure qu’elle co-anime avec son complice Patrick de Mari. D’ailleurs, l’un de ses « posts » mis en ligne a été retenu dans une mini-anthologie de la fameuse collection « le goût de » au Mercure de France. Dans « Le goût des cochons » (8,20€) figure, aux côtés de classiques comme Renard (avec un extrait célèbre des « Histoires Naturelles »), Claudel (et un délicieux poème en prose décrivant la bête), Maupassant (avec un texte de jeunesse), Huysmans (un extrait de « En route »), Hugo (et un émouvant poème, « Le porc et le sultan »), Verlaine (avec un détonnant pastiche des « Amants » de Baudelaire, intitulé « La Mort des cochons », pornographique à souhait, tiré de « L’Album zutique » qu’il coécrivit avec Léon Valade) et, plus près de nous, Jérôme Ferrari (et un extrait brut de son « Sermon sur la chute de Rome », décrivant un paysan Corse occupé à châtrer les verrats), ou Philippe Sollers (en amoureux délicat de la chair du cochon, dont il fait l’éloge)... Figure donc un texte délicieux de Blandine Vié au sujet de l’étymologie des mots du cochon, de la truie et de ses attributs, intitulé « Une vulve de truie peut en cacher une autre ! » À l’arrière-train où vont les choses, et sans évoquer la peste porcine africaine qui fait des ravages en Chine, donc le bonheur des éleveurs bretons, et qui est provisoirement circonscrite dans les Ardennes belges, mieux vaut en rire en s’instruisant - grâce à ce texte bref et dense, érudit et drôle à la fois. Blandine y enchaîne comme dans un rébus le sens caché des mots, dont les évocations rebondissent et jouent à ... saute-cochon. Remarque : ce florilège fait la part belle au côté immonde du cochon davantage qu’à ses qualités. C’est toujours comme ça ! La relation de l’homme avec cette « bête singulière » (titre d’un ouvrage capital, de référence, sur le sujet et dont un extrait aurait pu figurer dans ce petit bouquin : « La Bête singulière. Les juifs, les chrétiens et le cochon », de Claudine Fabre-Vassas (Gallimard, Bibliothèque des Sciences humaines), est ambiguë depuis les origines. Nous lui ressemblons tant ! Je laisse le dernier mot à Churchill : « Donnez-moi un cochon ! Il vous regarde dans les yeux et vous considère comme son égal. » L.M.
florilège fait la part belle au côté immonde du cochon davantage qu’à ses qualités. C’est toujours comme ça ! La relation de l’homme avec cette « bête singulière » (titre d’un ouvrage capital, de référence, sur le sujet et dont un extrait aurait pu figurer dans ce petit bouquin : « La Bête singulière. Les juifs, les chrétiens et le cochon », de Claudine Fabre-Vassas (Gallimard, Bibliothèque des Sciences humaines), est ambiguë depuis les origines. Nous lui ressemblons tant ! Je laisse le dernier mot à Churchill : « Donnez-moi un cochon ! Il vous regarde dans les yeux et vous considère comme son égal. » L.M.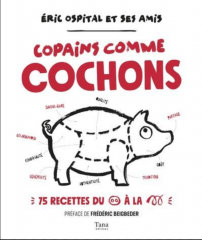

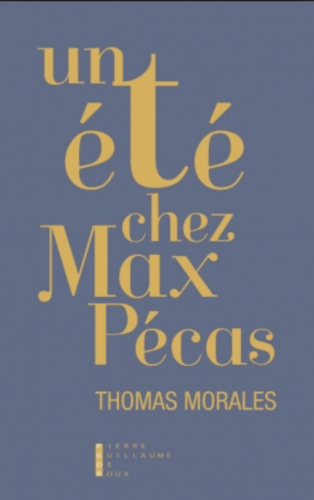
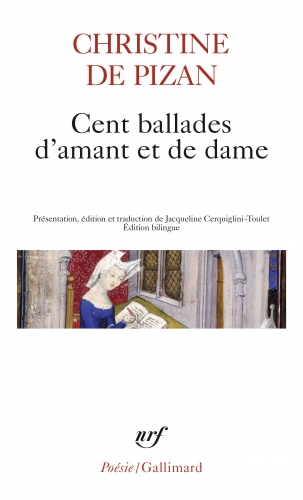 Savez-vous - mais qui peut prétendre savoir ce qui suit, aujourd'hui? - savez-vous donc que dans la théorie courtoise, le baiser représente le quatrième degré de l'amour dans une hiérarchie qui en compte cinq, selon le modèle des cinq sens? Le baiser correspond à celui du goût. Et cela nous est déjà si délicieux de l'apprendre. C'est Jacqueline Cerquiglini-Toulet (un lien de parenté avec Paul-Jean? - J'ai demandé, elle l'ignore), fervente préfacière et éditrice de ces ballades de Christine de Pizan, qui l'écrit. L'ouvrage, Cent ballades d'amant et de dame, est d'importance (Poésie/Gallimard, 10€). D'une part nous lisons un homme d'une loyauté sans faille, quoique, et d'autre part, les réponses d'une femme aimante mais infiniment prudente. Les amants dialoguent au fil de cent poèmes, ce qui n'est pas rien lorsque le désir attise. Ce sont des lettres, des messages, des hommages, des envois, des plaintes parfois, de fougueuses adresses, des reproches aussi, des invites, un faux dialogue peut-être, la distance entretient l'absence en tentant de la dissoudre, le choix du mot fait le reste, maintient, magnifie, tient tout cet édifice d'une intense fragilité droit. À l'époque de Christine de Pizan (1364, Venise - 1430, Poissy), la ballade est une forme à trois strophes avec un refrain d'un ou deux vers. Dans ces Cent ballades d'amant et de dame, si pressantes, la longueur des strophes est délicieusement écourtée parfois, et la taille des vers varie au gré de la disposition des rimes... Les 336 pages du recueil nous offrent ainsi un bouquet de retenue,
Savez-vous - mais qui peut prétendre savoir ce qui suit, aujourd'hui? - savez-vous donc que dans la théorie courtoise, le baiser représente le quatrième degré de l'amour dans une hiérarchie qui en compte cinq, selon le modèle des cinq sens? Le baiser correspond à celui du goût. Et cela nous est déjà si délicieux de l'apprendre. C'est Jacqueline Cerquiglini-Toulet (un lien de parenté avec Paul-Jean? - J'ai demandé, elle l'ignore), fervente préfacière et éditrice de ces ballades de Christine de Pizan, qui l'écrit. L'ouvrage, Cent ballades d'amant et de dame, est d'importance (Poésie/Gallimard, 10€). D'une part nous lisons un homme d'une loyauté sans faille, quoique, et d'autre part, les réponses d'une femme aimante mais infiniment prudente. Les amants dialoguent au fil de cent poèmes, ce qui n'est pas rien lorsque le désir attise. Ce sont des lettres, des messages, des hommages, des envois, des plaintes parfois, de fougueuses adresses, des reproches aussi, des invites, un faux dialogue peut-être, la distance entretient l'absence en tentant de la dissoudre, le choix du mot fait le reste, maintient, magnifie, tient tout cet édifice d'une intense fragilité droit. À l'époque de Christine de Pizan (1364, Venise - 1430, Poissy), la ballade est une forme à trois strophes avec un refrain d'un ou deux vers. Dans ces Cent ballades d'amant et de dame, si pressantes, la longueur des strophes est délicieusement écourtée parfois, et la taille des vers varie au gré de la disposition des rimes... Les 336 pages du recueil nous offrent ainsi un bouquet de retenue, 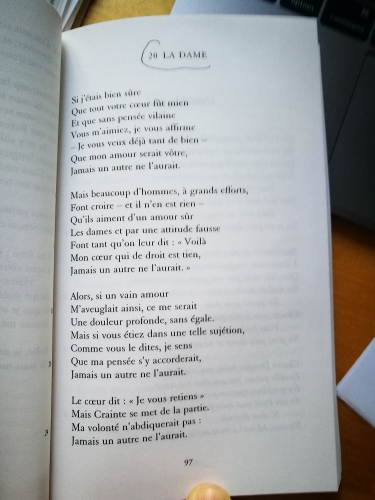 l'expression parfaite de l'amour courtois cher aux troubadours : Que votre doux amour soit vers moi tourné / Car mon coeur est déjà plus noir qu'une mûre, lit-on dès le premier envoi. Ce qui fait délice, c'est la nomination de l'alternance : L'Amant, La Dame, L'Amant, La Dame, se répondent et nous suivons un ping-pong amoureux d'une fine délicatesse, un échange d'une stupéfiante modernité : Le dard d'amour qui, comme il se doit, / T'enverra des pensers / Pleins de désir, par divers sentiers, / Tantôt joyeux, tantôt douloureux... La ballade 20 (photo jointe) exprime une affirmation féministe de bon aloi. À laquelle la Dame ajoute, quelques pages plus loin, des vers à nos yeux définitifs : À rien ne sert de résister, / Amour est mon adversaire, / Je ne peux m'y soustraire. Car, il s'agit là, au détour de quelque strophe, d'une joute jouant sur le désir de l'autre : Car je ne veux que votre doux vouloir. / Votre volonté seule est la mienne... dit-il, tandis qu'elle semble, semble seulement, lâcher prise : Je suis vôtre, vous m'avez justement conquise, / Il n'est plus besoin que j'en sois requise, / Amour le veut; vous avez trouvé le chemin /Pour prendre mon coeur / Sans mauvaise ruse, par
l'expression parfaite de l'amour courtois cher aux troubadours : Que votre doux amour soit vers moi tourné / Car mon coeur est déjà plus noir qu'une mûre, lit-on dès le premier envoi. Ce qui fait délice, c'est la nomination de l'alternance : L'Amant, La Dame, L'Amant, La Dame, se répondent et nous suivons un ping-pong amoureux d'une fine délicatesse, un échange d'une stupéfiante modernité : Le dard d'amour qui, comme il se doit, / T'enverra des pensers / Pleins de désir, par divers sentiers, / Tantôt joyeux, tantôt douloureux... La ballade 20 (photo jointe) exprime une affirmation féministe de bon aloi. À laquelle la Dame ajoute, quelques pages plus loin, des vers à nos yeux définitifs : À rien ne sert de résister, / Amour est mon adversaire, / Je ne peux m'y soustraire. Car, il s'agit là, au détour de quelque strophe, d'une joute jouant sur le désir de l'autre : Car je ne veux que votre doux vouloir. / Votre volonté seule est la mienne... dit-il, tandis qu'elle semble, semble seulement, lâcher prise : Je suis vôtre, vous m'avez justement conquise, / Il n'est plus besoin que j'en sois requise, / Amour le veut; vous avez trouvé le chemin /Pour prendre mon coeur / Sans mauvaise ruse, par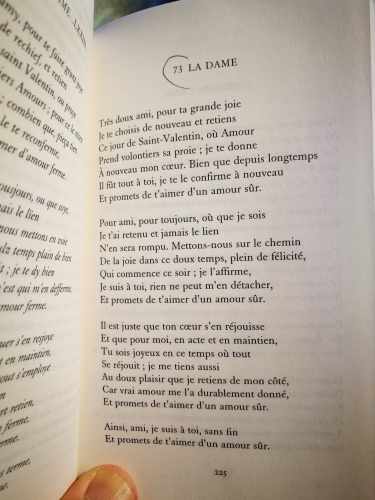 une très loyale quête. / Je le sais en vérité, je m'en suis bien enquise, / Et puisqu'il me plaît ainsi, en toute guise, / Du bien en résultera pour moi. Ce à quoi répond tardivement, et c'est agaçant, l'amant balourd mais lucide et d'une belle patience - à sa décharge, ainsi que d'une capacité à accepter les coups portés : Vrais amants courtois, sachez qu'il n'est dureté / Que de se séparer de sa dame et maîtresse. L'Amant se déclare, sans forfaiture aucune, comme étant un serviteur lige, et cela est d'une
une très loyale quête. / Je le sais en vérité, je m'en suis bien enquise, / Et puisqu'il me plaît ainsi, en toute guise, / Du bien en résultera pour moi. Ce à quoi répond tardivement, et c'est agaçant, l'amant balourd mais lucide et d'une belle patience - à sa décharge, ainsi que d'une capacité à accepter les coups portés : Vrais amants courtois, sachez qu'il n'est dureté / Que de se séparer de sa dame et maîtresse. L'Amant se déclare, sans forfaiture aucune, comme étant un serviteur lige, et cela est d'une 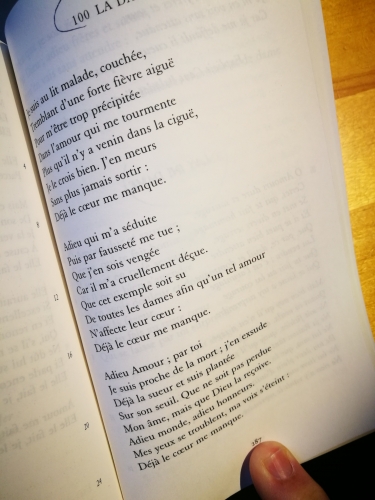
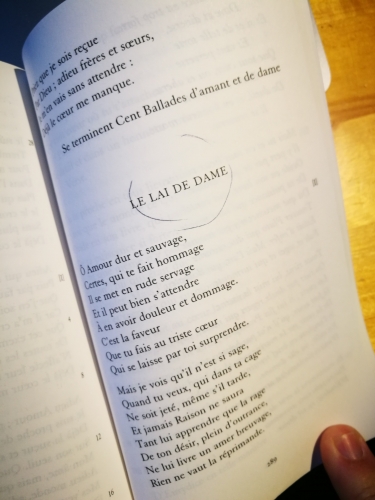 100, jointe), qu'une réalité va corroborer : Je m'y fiai : mon coeur se fend en deux / Car sa parole séduisante, trompeuse, / Et son maintien courtois et aimable / M'affirmaient qu'il disait vérité, / Et tel n'était le cas, c'est bien prouvé : / Il a déshérité mon coeur de la joie. Tout est déjà dit, là, sur la légendaire lâcheté masculine. Le cuir me part (Mon coeur se brise), déclare la Dame. Le lecteur est subjugué par tant de droiture sans ambages, de franchise intérieure sans détour. L.M.
100, jointe), qu'une réalité va corroborer : Je m'y fiai : mon coeur se fend en deux / Car sa parole séduisante, trompeuse, / Et son maintien courtois et aimable / M'affirmaient qu'il disait vérité, / Et tel n'était le cas, c'est bien prouvé : / Il a déshérité mon coeur de la joie. Tout est déjà dit, là, sur la légendaire lâcheté masculine. Le cuir me part (Mon coeur se brise), déclare la Dame. Le lecteur est subjugué par tant de droiture sans ambages, de franchise intérieure sans détour. L.M.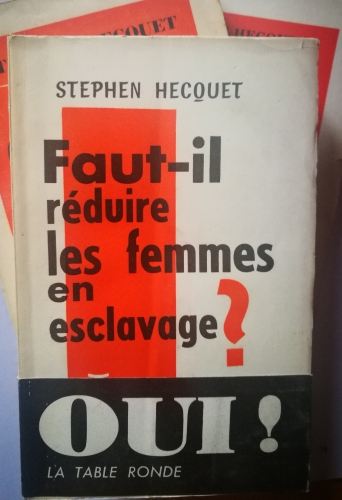
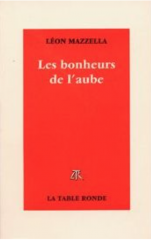 Je pensais l'avoir signalé ici, mais non. J'eus la surprise au coeur de l'été dernier de découvrir un papier élogieux et délicieusement tardif sur l'un de mes livres paru fin 2001 et qui, finaliste du Prix Goncourt de la Nouvelle, manqua cette distinction d'un cheveu. Le voici - il est signé Rita, blogueuse littéraire - et si cela vous incite, hâtez-vous, car le bouquin est en voie d'épuisement chez l'éditeur, lequel n'envisage pas de le réimprimer ou de le reprendre en format de poche dans La Petite Vermillon =>
Je pensais l'avoir signalé ici, mais non. J'eus la surprise au coeur de l'été dernier de découvrir un papier élogieux et délicieusement tardif sur l'un de mes livres paru fin 2001 et qui, finaliste du Prix Goncourt de la Nouvelle, manqua cette distinction d'un cheveu. Le voici - il est signé Rita, blogueuse littéraire - et si cela vous incite, hâtez-vous, car le bouquin est en voie d'épuisement chez l'éditeur, lequel n'envisage pas de le réimprimer ou de le reprendre en format de poche dans La Petite Vermillon => 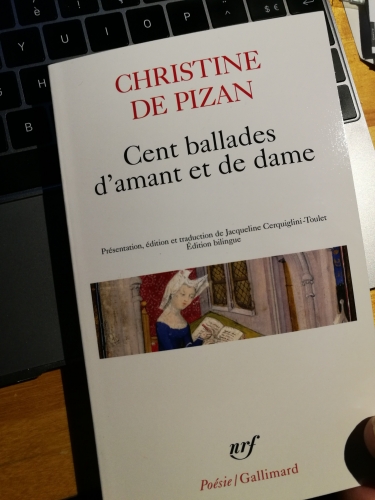
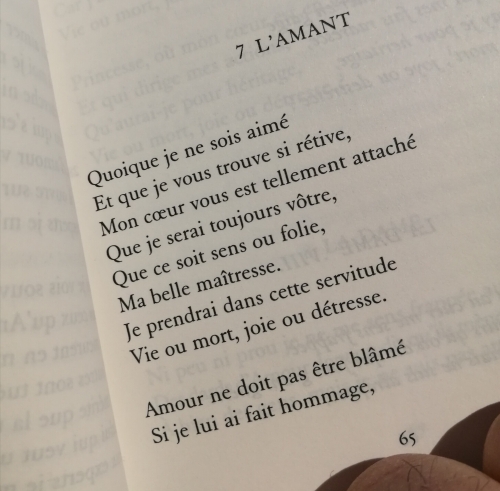
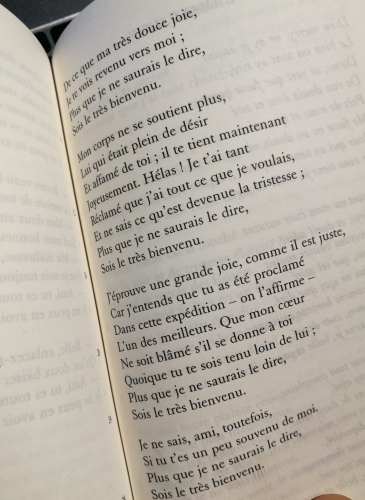


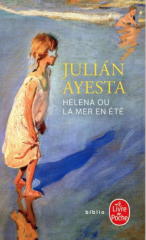 Ce ne peut être le hasard, puisqu’il n’existe pas. J’ai lu hier soir un bref roman, Helena ou la mer en été, de l’Espagnol Juliàn Ayesta, paru en 1952 à Madrid, et seulement en juin dernier en France, directement en format de poche (traduit et postfacé par Xavier Mauméjean). Il y a un air de famille littéraire avec la touchante Gioconda précédemment évoquée ici, du Grec Nikos Kokàntzis. Mêmes émois adolescents, même tendresse, une poésie méditerranéenne en partage avec, au menu : mer, sel, sable, soleil, sieste, rires, et onirisme aussi, mais surtout un fin moins tragique chez Ayesta que dans le récit grec. Le roman est cependant décousu : la première partie a des allures de comédie italienne : un repas dominical au jardin décrit avec talent car, en peu de mots la
Ce ne peut être le hasard, puisqu’il n’existe pas. J’ai lu hier soir un bref roman, Helena ou la mer en été, de l’Espagnol Juliàn Ayesta, paru en 1952 à Madrid, et seulement en juin dernier en France, directement en format de poche (traduit et postfacé par Xavier Mauméjean). Il y a un air de famille littéraire avec la touchante Gioconda précédemment évoquée ici, du Grec Nikos Kokàntzis. Mêmes émois adolescents, même tendresse, une poésie méditerranéenne en partage avec, au menu : mer, sel, sable, soleil, sieste, rires, et onirisme aussi, mais surtout un fin moins tragique chez Ayesta que dans le récit grec. Le roman est cependant décousu : la première partie a des allures de comédie italienne : un repas dominical au jardin décrit avec talent car, en peu de mots la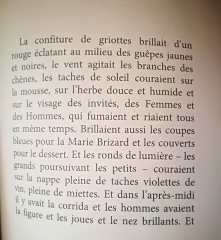 joie, les hommes avant la corrida de l’après-midi, les verres de Marie-Brizard, les cigares au bord des lèvres, les enfants qui posent des questions et qui agacent les adultes, puis qui s’échappent, crient, s’amusent, les miettes sur la nappe, les bouteilles de cidre vidées, le soleil qui perce entre les branches, les tantes qui pérorent et médisent par bonté, les cousins de Madrid qui surgissent, la fiesta simple qui se poursuit... Le ton du souvenir de l’enfance est donné sans compter, avec force détails, et nous ressentons le plaisir que l'auteur a eu à écrire ces 36 premières pages. Puis, une partie austère évoque la religion catholique et ses méandres, un
joie, les hommes avant la corrida de l’après-midi, les verres de Marie-Brizard, les cigares au bord des lèvres, les enfants qui posent des questions et qui agacent les adultes, puis qui s’échappent, crient, s’amusent, les miettes sur la nappe, les bouteilles de cidre vidées, le soleil qui perce entre les branches, les tantes qui pérorent et médisent par bonté, les cousins de Madrid qui surgissent, la fiesta simple qui se poursuit... Le ton du souvenir de l’enfance est donné sans compter, avec force détails, et nous ressentons le plaisir que l'auteur a eu à écrire ces 36 premières pages. Puis, une partie austère évoque la religion catholique et ses méandres, un  pensionnat, le tabou sexuel, qui nous fait tourner les pages en soupirant. Enfin, une troisième partie tonique et un rien débridée, voit revenir Helena, aperçue dans la première, chargée d’amour retenu pour un narrateur débordant d’amour lyrique et sensuel. C’est tendre, ingénu, sans excès, limpide et ensoleillé. La lecture idoine pour rentrer en douceur. L.M.
pensionnat, le tabou sexuel, qui nous fait tourner les pages en soupirant. Enfin, une troisième partie tonique et un rien débridée, voit revenir Helena, aperçue dans la première, chargée d’amour retenu pour un narrateur débordant d’amour lyrique et sensuel. C’est tendre, ingénu, sans excès, limpide et ensoleillé. La lecture idoine pour rentrer en douceur. L.M.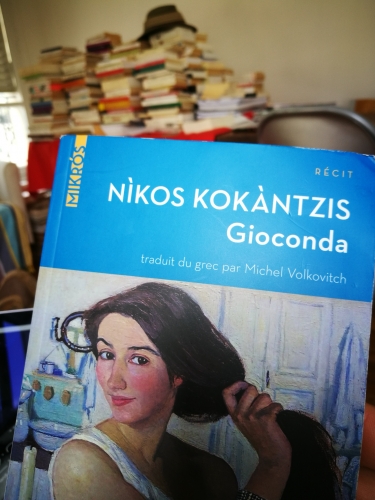 Très en marge de cette rentrée littéraire, notre regard s’est inexorablement porté vers un fulgurant et tendre récit (paru en juin) d’une désarmante vérité, limpide comme une source de montagne, fragile comme ta peau au lit à l’aube, touchant tant il est habité par une bouleversante sincérité. Oh, vous lirez en une heure à peine cette centaine de pages empreintes de délicatesse et d’une impudeur paradoxale. Son auteur n’était pas écrivain. Nikos Kokàntzis (1930-2009) a simplement vécu à Thessalonique une histoire d’amour, la première, la fondatrice, la fondamentale à l’âge de treize ans avec Gioconda, une juive de son âge qui sera déportée et gazée à Auschwitz une poignée de mois après leur rencontre. Leur idylle possède les charmes subtils et écorchés vifs, mais si délicieusement douloureux de la découverte des sentiments et des corps, que la lecture de Gioconda en devient admirablement suffocante. Et cela est dit, décrit, avec une infinie beauté, une immense ingénuité surtout, qui donnent à ce récit toute sa saveur primale. Les scènes des premiers émois, des premiers frissons, des premières pénétrations sont un long tremblement détaillé comme par souci entomologique – il fallait sans doute à l’auteur marquer profondément ce départ double dans la vie, vers un bonheur coupé net.
Très en marge de cette rentrée littéraire, notre regard s’est inexorablement porté vers un fulgurant et tendre récit (paru en juin) d’une désarmante vérité, limpide comme une source de montagne, fragile comme ta peau au lit à l’aube, touchant tant il est habité par une bouleversante sincérité. Oh, vous lirez en une heure à peine cette centaine de pages empreintes de délicatesse et d’une impudeur paradoxale. Son auteur n’était pas écrivain. Nikos Kokàntzis (1930-2009) a simplement vécu à Thessalonique une histoire d’amour, la première, la fondatrice, la fondamentale à l’âge de treize ans avec Gioconda, une juive de son âge qui sera déportée et gazée à Auschwitz une poignée de mois après leur rencontre. Leur idylle possède les charmes subtils et écorchés vifs, mais si délicieusement douloureux de la découverte des sentiments et des corps, que la lecture de Gioconda en devient admirablement suffocante. Et cela est dit, décrit, avec une infinie beauté, une immense ingénuité surtout, qui donnent à ce récit toute sa saveur primale. Les scènes des premiers émois, des premiers frissons, des premières pénétrations sont un long tremblement détaillé comme par souci entomologique – il fallait sans doute à l’auteur marquer profondément ce départ double dans la vie, vers un bonheur coupé net. 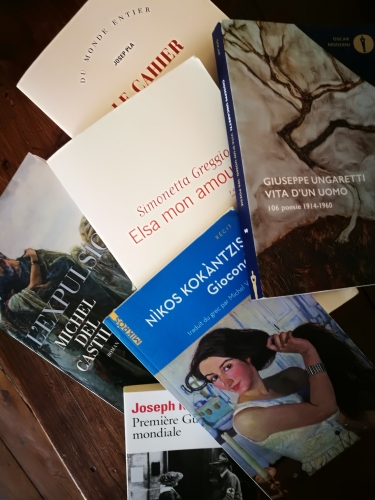
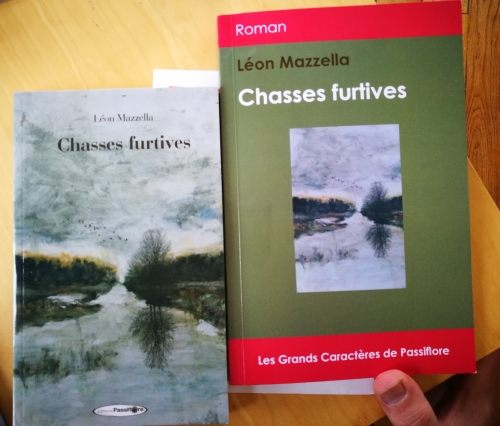 Me voici donc, avec quatre consoeurs des merveilleuses éditions Passiflore - pilotées par les talentueuses Florence Defos du Rau et Patricia Martinez -, décliné en édition grand format, saisie en corps 18 à l'attention de ceux qui aiment lire mais qui ont la vue basse, comme on dit : il s'agit, pour mes consoeurs, de Fabienne Thomas, Marie-Laure Hubert Nasser, Pascale Dewambrechies, et Chantal Detcherry.
Me voici donc, avec quatre consoeurs des merveilleuses éditions Passiflore - pilotées par les talentueuses Florence Defos du Rau et Patricia Martinez -, décliné en édition grand format, saisie en corps 18 à l'attention de ceux qui aiment lire mais qui ont la vue basse, comme on dit : il s'agit, pour mes consoeurs, de Fabienne Thomas, Marie-Laure Hubert Nasser, Pascale Dewambrechies, et Chantal Detcherry. 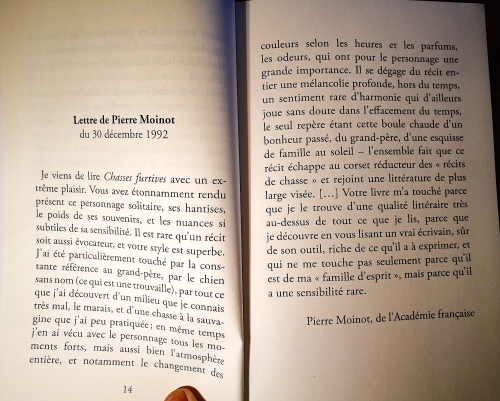
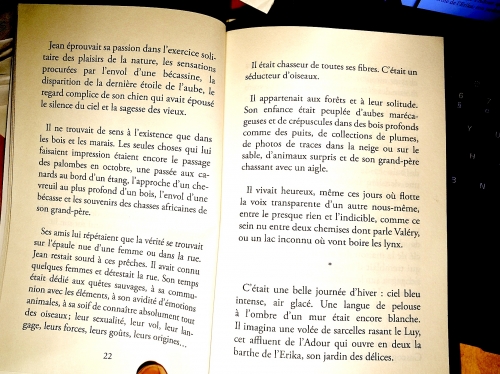

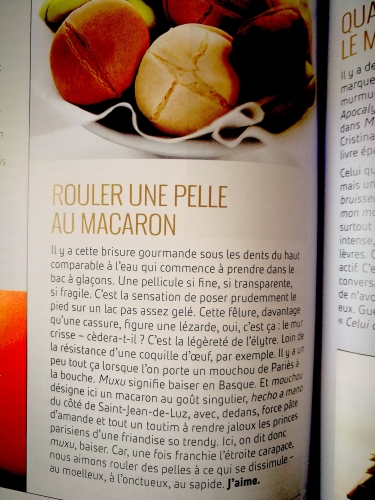
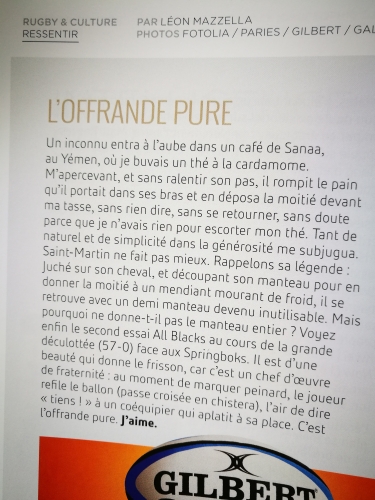
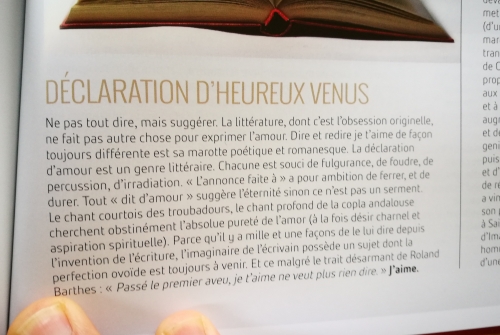
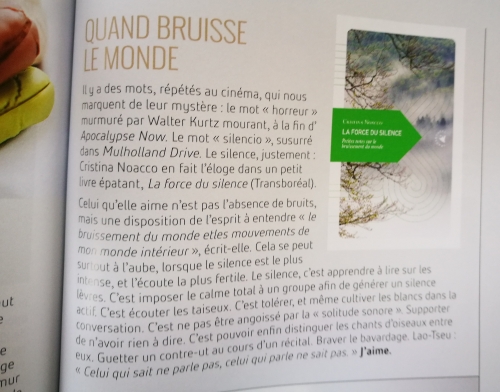
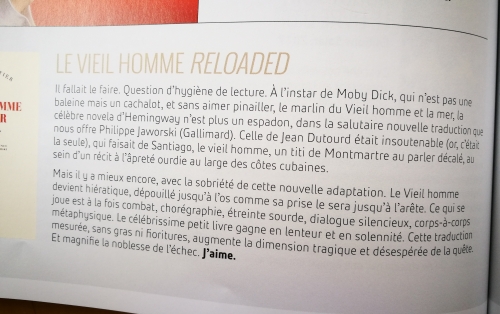

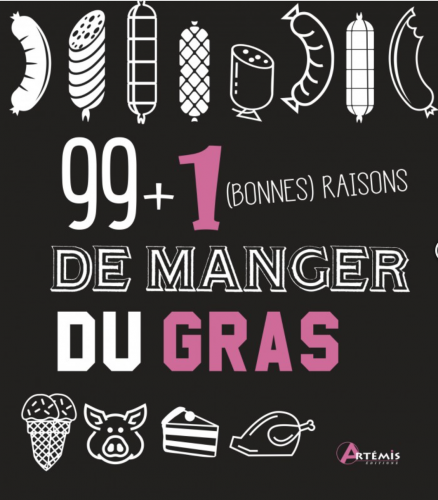 Elle récidive, l'experte en couenneries, avec sa plume gourmande, saupoudrée de traits à l'humour vif de son complice Patrick de Mari. A eux deux, ils animent le site
Elle récidive, l'experte en couenneries, avec sa plume gourmande, saupoudrée de traits à l'humour vif de son complice Patrick de Mari. A eux deux, ils animent le site  contre le sien, nous rappelle Rabelais. Tous les lipophiles décomplexés liront par conséquent avec délice ce livre léger et sans recettes, cette fête des mots et de la liberté d'aimer dévorer ce que la morale réprouve. Noël aux dindons, Pâques aux jambons, clame un proverbe gretagarburien. On approuve! L'art, le vrai, n'est pas en reste, puisque les peintres préférés de l'auteur sont, évidemment, Eugène Boudin et Francis Bacon... Achetez ce bouquin tordant, et lisez-le à haute voix à votre voisin(e) de matelas, un dimanche de grasse matinée avec des croissants beurre plein le plateau. L.M.
contre le sien, nous rappelle Rabelais. Tous les lipophiles décomplexés liront par conséquent avec délice ce livre léger et sans recettes, cette fête des mots et de la liberté d'aimer dévorer ce que la morale réprouve. Noël aux dindons, Pâques aux jambons, clame un proverbe gretagarburien. On approuve! L'art, le vrai, n'est pas en reste, puisque les peintres préférés de l'auteur sont, évidemment, Eugène Boudin et Francis Bacon... Achetez ce bouquin tordant, et lisez-le à haute voix à votre voisin(e) de matelas, un dimanche de grasse matinée avec des croissants beurre plein le plateau. L.M. Nous le savons, mais nous ne pouvons nous en empêcher : Écrire à chaud est néfaste, car peu clairvoyant. J’ai pourtant envie de dire combien « je suis Françoise Sagan », ce lundi soir, et combien « je suis » aussi (quelle prétention !) « Catherine Deneuve » au sommet de sa beauté dans « La Chamade », d’après le roman éponyme du « charmant petit monstre ». Merci à Arte, qui nous a offert un doublé, ce 30 janvier, avec le film d’Alain Cavalier (1968), et le documentaire « Françoise Sagan, l’élégance de vivre », réalisé par Marie Brunet-Debaines, enrichi de la voix et des témoignages infiniment touchants de Denis Westhoff, le fils de Sagan. Cela a permis d'oublier Brigitte Bardot (pourtant si présente, par palimpseste), devant la plastique inouïe de Deneuve. Et de découvrir en profondeur le personnage iconique de Françoise Sagan. Merci Arte pour cette soirée tout en tact, en légèreté, en vol de libellule au-dessus du torrent : Bien davantage qu'un James Dean féminin, Sagan est une hussarde, une femme pétrie de vie, cette chose qu’elle s’employa à brûler (avec élégance) chaque jour, chaque nuit par les deux bouts.
Nous le savons, mais nous ne pouvons nous en empêcher : Écrire à chaud est néfaste, car peu clairvoyant. J’ai pourtant envie de dire combien « je suis Françoise Sagan », ce lundi soir, et combien « je suis » aussi (quelle prétention !) « Catherine Deneuve » au sommet de sa beauté dans « La Chamade », d’après le roman éponyme du « charmant petit monstre ». Merci à Arte, qui nous a offert un doublé, ce 30 janvier, avec le film d’Alain Cavalier (1968), et le documentaire « Françoise Sagan, l’élégance de vivre », réalisé par Marie Brunet-Debaines, enrichi de la voix et des témoignages infiniment touchants de Denis Westhoff, le fils de Sagan. Cela a permis d'oublier Brigitte Bardot (pourtant si présente, par palimpseste), devant la plastique inouïe de Deneuve. Et de découvrir en profondeur le personnage iconique de Françoise Sagan. Merci Arte pour cette soirée tout en tact, en légèreté, en vol de libellule au-dessus du torrent : Bien davantage qu'un James Dean féminin, Sagan est une hussarde, une femme pétrie de vie, cette chose qu’elle s’employa à brûler (avec élégance) chaque jour, chaque nuit par les deux bouts.  Négligence
Négligence « Chroniques, 1954-2003 » (Le Livre de Poche, dans une édition reliée, comme les « poche » ont pris l’habitude d’en produire à l’approche des fêtes, et qui hisse le format au rang d’ouvrage de collection). Ce sont ses articles (les chroniques sont des articles endormis, écrit Denis Westhoff dans l'avant-propos) sur tout et rien, parus dans L’Express, ELLE, Femme, Egoïste, Vogue, La Parisienne… Les textes sur Verlaine, Depardieu, sur Capri, Naples, sur la mode, le rugby, la lecture ou encore Orson Welles… sont des petits joyaux. C'est stylé, diraient les jeunes, espiègle (une marque de fabrique) et perspicace. L’auteur de tant de romans délivre aussi une écriture journalistique de talent.
« Chroniques, 1954-2003 » (Le Livre de Poche, dans une édition reliée, comme les « poche » ont pris l’habitude d’en produire à l’approche des fêtes, et qui hisse le format au rang d’ouvrage de collection). Ce sont ses articles (les chroniques sont des articles endormis, écrit Denis Westhoff dans l'avant-propos) sur tout et rien, parus dans L’Express, ELLE, Femme, Egoïste, Vogue, La Parisienne… Les textes sur Verlaine, Depardieu, sur Capri, Naples, sur la mode, le rugby, la lecture ou encore Orson Welles… sont des petits joyaux. C'est stylé, diraient les jeunes, espiègle (une marque de fabrique) et perspicace. L’auteur de tant de romans délivre aussi une écriture journalistique de talent. 

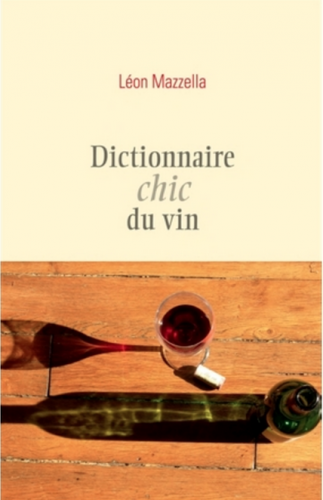
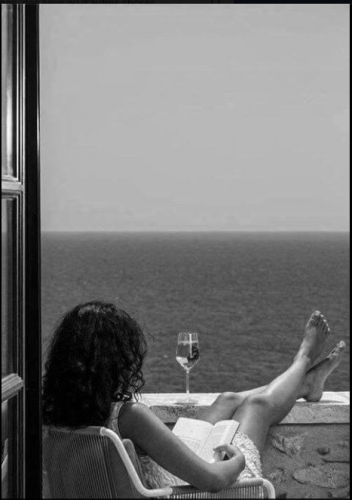
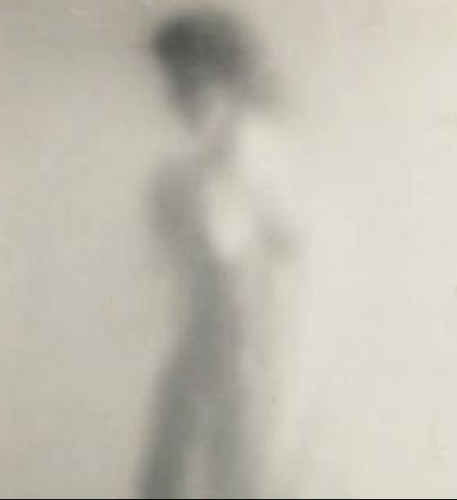
 pourtant pas un. Le cul de Nora, les fesses de l'auteur de Rose au coeur violet, qui devint la compagne de Julien Gracq en 1953, après avoir quitté Bellmer. C'est elle. La compagne du grand écrivain... Nue. De dos... Lorsque je rendais visite à Julien Gracq, chez lui à Saint-Florent-le-Vieil, je me tenais en général, un peu en décalé, sous un portrait de lui signé Hans Bellmer, encadré et accroché là. L'extrême pudeur, la réserve monacale vis à vis de tout ce qui relève du privé, de l'auteur de Prose pour l'étrangère, m'ont toujours empêché d'évoquer sa vie amoureuse, même si cette relation était connue, mais à peine. Pensez! Je crois même que l'idée ne m'
pourtant pas un. Le cul de Nora, les fesses de l'auteur de Rose au coeur violet, qui devint la compagne de Julien Gracq en 1953, après avoir quitté Bellmer. C'est elle. La compagne du grand écrivain... Nue. De dos... Lorsque je rendais visite à Julien Gracq, chez lui à Saint-Florent-le-Vieil, je me tenais en général, un peu en décalé, sous un portrait de lui signé Hans Bellmer, encadré et accroché là. L'extrême pudeur, la réserve monacale vis à vis de tout ce qui relève du privé, de l'auteur de Prose pour l'étrangère, m'ont toujours empêché d'évoquer sa vie amoureuse, même si cette relation était connue, mais à peine. Pensez! Je crois même que l'idée ne m'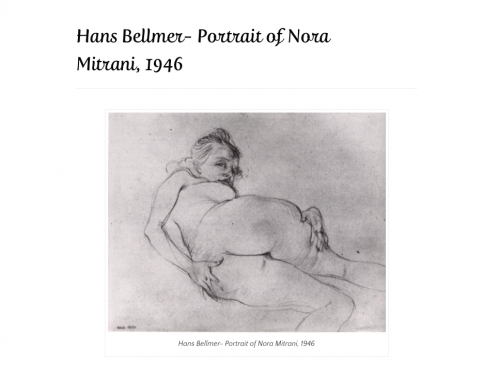

 Purée! C'est dans Ovide et ça n'a pas pris une ride. C'est splendide, mais ressenti comme audacieux, 2000 ans après. Inquiétant, non...
Purée! C'est dans Ovide et ça n'a pas pris une ride. C'est splendide, mais ressenti comme audacieux, 2000 ans après. Inquiétant, non... 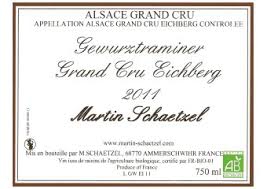 Le Gewurztraminer Grand Cru
Le Gewurztraminer Grand Cru 
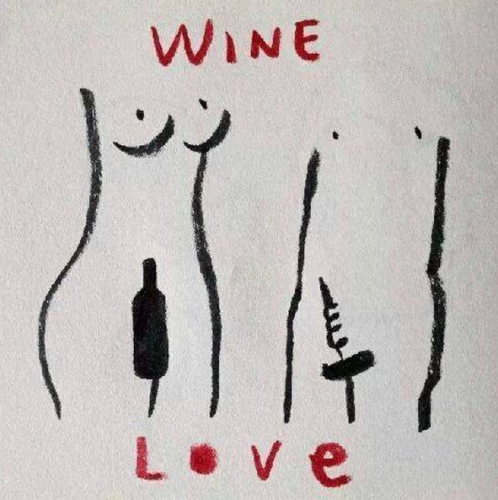
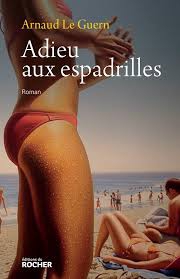 Voilà un vers de Baudelaire qui aurait pu faire le bandeau de couverture de cette longue lettre d’amour fou, si le mot adieu n’était pas déjà contenu dans un titre à rendre jaloux nombre de romanciers. Adieu aux espadrilles (*), du délicat Arnaud Le Guern, est un roman à peine fictif (même les noms des chats, Pablo et Malcolm, sont vrais), très Nouvelle Vague, très morandien – mais sans la vitesse, et avec une touche du Henry Jean-Marie Levet des Cartes Postales. Entre les pages de ce livre, nous (res) sentons ce parfum sentimental, précieux et léger comme la rosée du matin, l’été, au bord de la piscine, lorsqu’on s’est levé avant elle en prenant soin de ne pas la réveiller, pour aller fumer la première cigarette, tout en respirant les parfums tiédis du figuier à l’ombre bienfaisante; sous le soleil exactement. Arnaud Le Guern aime une femme, les actrices aussi, sa fille Louise surtout, l’insouciance, et les mots avec une gourmandise hussarde. Cette longue adresse est un joli pied-de-nez à la génération sms, qui dit avec tact et tendresse ce qu’aimer avec pureté veut dire. Le couple fait l’amour, se taquine sans jamais se griffer, les draps froissent, les jours passent, l’oisiveté chante sur la terrasse, les peaux se suffisent à elles-mêmes, les souvenirs affluent et repartent d’un revers de sa main à elle, afin d’empêcher toute nostalgie de surgir, et continuer de manger le présent à pleine bouche, comme on plante ses dents dans la peau duveteuse et craquante d’une pêche. Nous sommes dans Slogan, avec Birkin et Gainsbourg, nous feuilletons la sensualité pudique du Claire de Chardonne. Le couple est à des années lumière de Paris et son spectre de « rentrée » automnale. Les amoureux sacrifient avec délice au rite de l’apérotique : ils « apérotisent », dégustent un anjou de Mosse ou un rosé de Bandol, avant de s’entre-goûter. Ils ont le talent de savoir prendre le temps, mais avec Le Guern, le temps compte, se cueille, il frappe aux tempes du narrateur, et celui-ci a la délicatesse de ne jamais faire sentir le vertige de sa fuite. L’été est encore là, mais les saisons sont comme les coquelicots qui fanent dès qu’on les dépose sur le skai brûlant de la plage arrière du cabriolet. C’est « la vie comme à Lausanne » en plus souple, car « les espadrilles sont mes semelles de vent », écrit l’auteur. Jamais l’urgence n’ouvre ses yeux noirs, sauf peut-être sous le gouvernement du désir, et pourtant il plane comme une épée de Damoclès au-dessus de cette chambre d’hôtel. Qu’importe ! Les amants sont des aveugles. « Enlacés, nous laissons infuser une unique certitude : l’été, c’est l’amour une fin d’après-midi, au retour de la plage, nos corps fatigués de n’avoir rien fait, sinon nager, lire et bronzer ». Et c’est ainsi qu’Arnaud est grand. Léon Mazzella
Voilà un vers de Baudelaire qui aurait pu faire le bandeau de couverture de cette longue lettre d’amour fou, si le mot adieu n’était pas déjà contenu dans un titre à rendre jaloux nombre de romanciers. Adieu aux espadrilles (*), du délicat Arnaud Le Guern, est un roman à peine fictif (même les noms des chats, Pablo et Malcolm, sont vrais), très Nouvelle Vague, très morandien – mais sans la vitesse, et avec une touche du Henry Jean-Marie Levet des Cartes Postales. Entre les pages de ce livre, nous (res) sentons ce parfum sentimental, précieux et léger comme la rosée du matin, l’été, au bord de la piscine, lorsqu’on s’est levé avant elle en prenant soin de ne pas la réveiller, pour aller fumer la première cigarette, tout en respirant les parfums tiédis du figuier à l’ombre bienfaisante; sous le soleil exactement. Arnaud Le Guern aime une femme, les actrices aussi, sa fille Louise surtout, l’insouciance, et les mots avec une gourmandise hussarde. Cette longue adresse est un joli pied-de-nez à la génération sms, qui dit avec tact et tendresse ce qu’aimer avec pureté veut dire. Le couple fait l’amour, se taquine sans jamais se griffer, les draps froissent, les jours passent, l’oisiveté chante sur la terrasse, les peaux se suffisent à elles-mêmes, les souvenirs affluent et repartent d’un revers de sa main à elle, afin d’empêcher toute nostalgie de surgir, et continuer de manger le présent à pleine bouche, comme on plante ses dents dans la peau duveteuse et craquante d’une pêche. Nous sommes dans Slogan, avec Birkin et Gainsbourg, nous feuilletons la sensualité pudique du Claire de Chardonne. Le couple est à des années lumière de Paris et son spectre de « rentrée » automnale. Les amoureux sacrifient avec délice au rite de l’apérotique : ils « apérotisent », dégustent un anjou de Mosse ou un rosé de Bandol, avant de s’entre-goûter. Ils ont le talent de savoir prendre le temps, mais avec Le Guern, le temps compte, se cueille, il frappe aux tempes du narrateur, et celui-ci a la délicatesse de ne jamais faire sentir le vertige de sa fuite. L’été est encore là, mais les saisons sont comme les coquelicots qui fanent dès qu’on les dépose sur le skai brûlant de la plage arrière du cabriolet. C’est « la vie comme à Lausanne » en plus souple, car « les espadrilles sont mes semelles de vent », écrit l’auteur. Jamais l’urgence n’ouvre ses yeux noirs, sauf peut-être sous le gouvernement du désir, et pourtant il plane comme une épée de Damoclès au-dessus de cette chambre d’hôtel. Qu’importe ! Les amants sont des aveugles. « Enlacés, nous laissons infuser une unique certitude : l’été, c’est l’amour une fin d’après-midi, au retour de la plage, nos corps fatigués de n’avoir rien fait, sinon nager, lire et bronzer ». Et c’est ainsi qu’Arnaud est grand. Léon Mazzella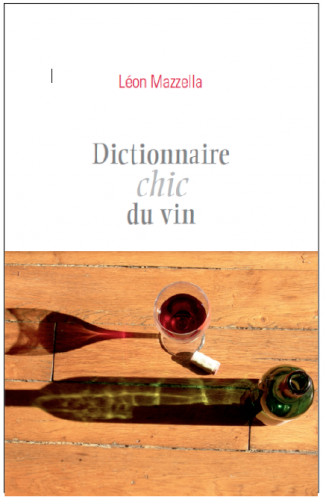
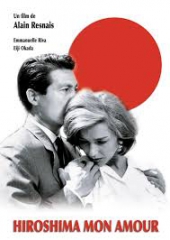
 Cliquez à nouveau, puis lisez :
Cliquez à nouveau, puis lisez : 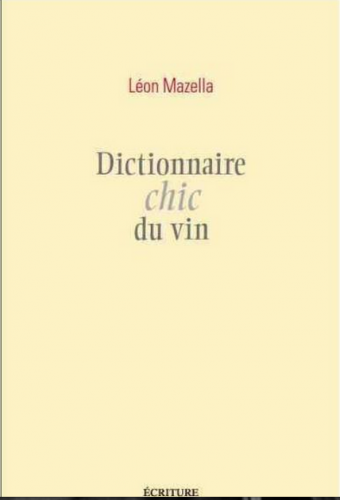
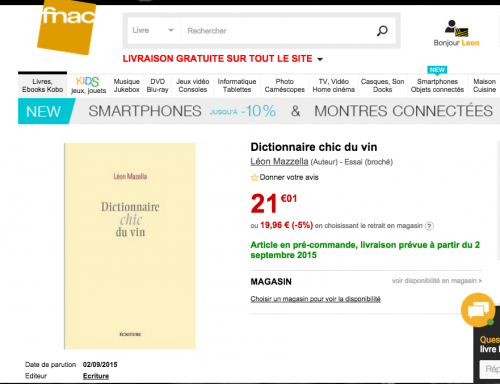
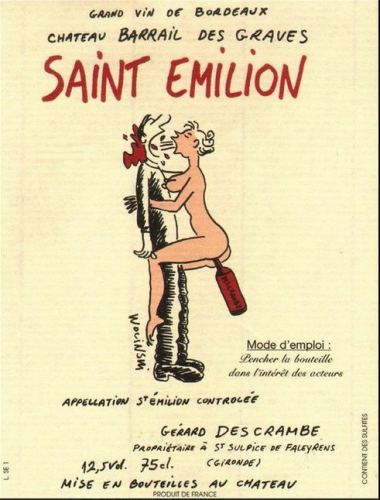
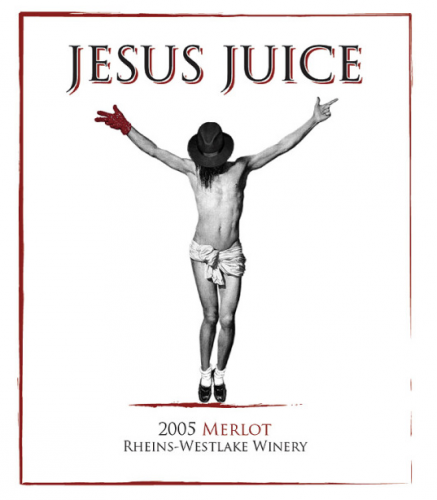
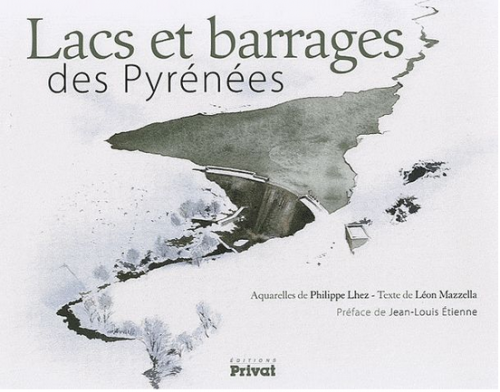

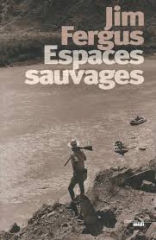

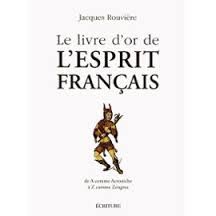
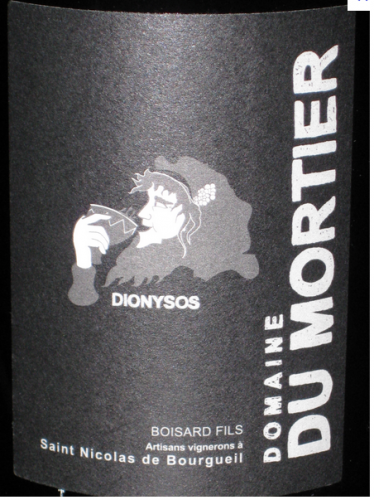
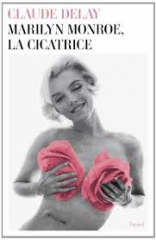


 Dans Billebaude n°3, le magnifique "mook" des éditions Glénat consacré à la prédation cynégétique sous toutes ses formes : sensible, artistique, ethnologique, esthétique, historique, poétique, philosophique... Cet hommage :
Dans Billebaude n°3, le magnifique "mook" des éditions Glénat consacré à la prédation cynégétique sous toutes ses formes : sensible, artistique, ethnologique, esthétique, historique, poétique, philosophique... Cet hommage : 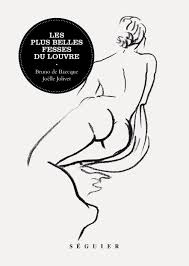 ...Se retrouvent commentées dans un délicieux petit livre (que j'ai rewrité comme on dit, pour les éditions Séguier, et qui paraît le 3 octobre. 96 p. 16€). Il est co-signé Bruno de Baecque (texte) et Joëlle Jolivet (dessins), sur une idée de Jean Le Gall, qui préside aux destinées (je n'aime pas cette expression pontifiante et pourtant elle vient de me venir), de Séguier et Atlantica.
...Se retrouvent commentées dans un délicieux petit livre (que j'ai rewrité comme on dit, pour les éditions Séguier, et qui paraît le 3 octobre. 96 p. 16€). Il est co-signé Bruno de Baecque (texte) et Joëlle Jolivet (dessins), sur une idée de Jean Le Gall, qui préside aux destinées (je n'aime pas cette expression pontifiante et pourtant elle vient de me venir), de Séguier et Atlantica. 
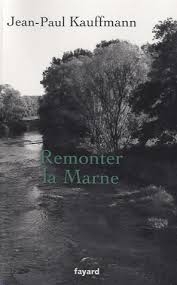 Le livre majeur paru ces derniers mois est Remonter la Marne, de Jean-Paul Kauffmann (Fayard). J'ai lu deux fois ce livre : en l'achevant, je l'ai aussitôt recommencé afin de rester dans la musique, dans la phrase, dans la subtilité des descriptions, l'analyse aiguë des personnages croisés, le choix du mot juste et parfois rare ou oublié, la remarque qui touche, l'extrême sensibilité de l'auteur et puis bien sûr la démarche générale : une pérégrination à la manière des travel-writers comme Jacques Lacarrière (Kauffmann avait d'ailleurs promis à l'auteur de
Le livre majeur paru ces derniers mois est Remonter la Marne, de Jean-Paul Kauffmann (Fayard). J'ai lu deux fois ce livre : en l'achevant, je l'ai aussitôt recommencé afin de rester dans la musique, dans la phrase, dans la subtilité des descriptions, l'analyse aiguë des personnages croisés, le choix du mot juste et parfois rare ou oublié, la remarque qui touche, l'extrême sensibilité de l'auteur et puis bien sûr la démarche générale : une pérégrination à la manière des travel-writers comme Jacques Lacarrière (Kauffmann avait d'ailleurs promis à l'auteur de 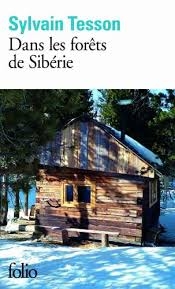 un périple semblable
un périple semblable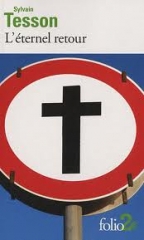 possèdent une écriture somptueuse de surcroît. Je les ai rangés côte à côte à présent, pas trop loin de (presque) tous les autres livres de ces deux auteurs précieux. A noter un folio 2€ de Tesson, extrait de Une vie à coucher dehors (folio) et qui s'intitule L'éternel retour -cinq nouvelles coups de poing. Un petit régal.
possèdent une écriture somptueuse de surcroît. Je les ai rangés côte à côte à présent, pas trop loin de (presque) tous les autres livres de ces deux auteurs précieux. A noter un folio 2€ de Tesson, extrait de Une vie à coucher dehors (folio) et qui s'intitule L'éternel retour -cinq nouvelles coups de poing. Un petit régal. 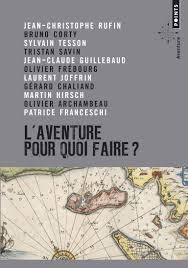 des bourlingueurs nommés Patrice Franceschi (il pilote la collection), Jean-Claude Guillebaud (beau texte intitulé Vers l'autre et vers soi-même), Olivier Frébourg (superbe texte intitulé Fuir seul, vers le seul -le mot est emprunté à Plotin), Sylvain
des bourlingueurs nommés Patrice Franceschi (il pilote la collection), Jean-Claude Guillebaud (beau texte intitulé Vers l'autre et vers soi-même), Olivier Frébourg (superbe texte intitulé Fuir seul, vers le seul -le mot est emprunté à Plotin), Sylvain 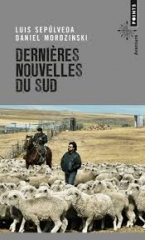
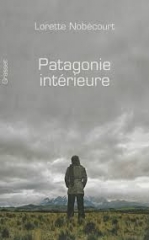 Tesson, Tristan Savin (qui pilote le "mook" Long Cours, auteur ici de la nouvelle forte Le lion de Belfort), Gérard Chaliand, Bruno Corty, Jean-Christophe Rufin, Martin Hirsch, Laurent Joffrin et Olivier Archambeau. L'aventure peut elle encore avoir un sens dans un siècle exploré jusqu'à l'os, où la technologie interdit à l'homme de se perdre, où le principe de précaution et la recherche de sécurité sont des diktats ordinaires digérés ?.. L'altérité, la rencontre vraie, l'esprit de liberté demeurent. "L'aventure ou l'antidote au suicide collectif", écrit l'ami
Tesson, Tristan Savin (qui pilote le "mook" Long Cours, auteur ici de la nouvelle forte Le lion de Belfort), Gérard Chaliand, Bruno Corty, Jean-Christophe Rufin, Martin Hirsch, Laurent Joffrin et Olivier Archambeau. L'aventure peut elle encore avoir un sens dans un siècle exploré jusqu'à l'os, où la technologie interdit à l'homme de se perdre, où le principe de précaution et la recherche de sécurité sont des diktats ordinaires digérés ?.. L'altérité, la rencontre vraie, l'esprit de liberté demeurent. "L'aventure ou l'antidote au suicide collectif", écrit l'ami 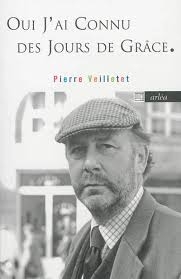 Frébourg, qui pense aussi que "la liberté, ça ne se négocie pas : c'est la part des anges".
Frébourg, qui pense aussi que "la liberté, ça ne se négocie pas : c'est la part des anges".  genèse, la création, la composition de l'emblématique recueil avec un flip-book qui montre des photos (datant de 1914) d'Apollinaire et de son ami André Rouveyre en train de rire. Il y a aussi des textes admirables de Paul Léautaud, Blaise Cendrars, Pierre Reverdy, Max Jacob, René Guy Cadou, Maurice Fombeure, Louis Aragon, Allan Ginsberg et, plus près de nous, de Jacques Réda, André Velter, Guy Goffette, et Adonis, qui rendent hommage à la beauté d'Alcools. A noter également la publication d'un folioplus sur le recueil, doté d'un solide dossier analytique signé Sophie-Aude Picon.
genèse, la création, la composition de l'emblématique recueil avec un flip-book qui montre des photos (datant de 1914) d'Apollinaire et de son ami André Rouveyre en train de rire. Il y a aussi des textes admirables de Paul Léautaud, Blaise Cendrars, Pierre Reverdy, Max Jacob, René Guy Cadou, Maurice Fombeure, Louis Aragon, Allan Ginsberg et, plus près de nous, de Jacques Réda, André Velter, Guy Goffette, et Adonis, qui rendent hommage à la beauté d'Alcools. A noter également la publication d'un folioplus sur le recueil, doté d'un solide dossier analytique signé Sophie-Aude Picon.  Soixante-dix poèmes écrits au cours des deux dernières années de la vie de Celan, 1967-68, fortement teintés d'un érotisme discret.
Soixante-dix poèmes écrits au cours des deux dernières années de la vie de Celan, 1967-68, fortement teintés d'un érotisme discret.  est
est 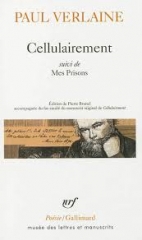 puis à Mons entre 1873 et 1875. La Chanson de Gaspard Hauser et L'Art poétique, entre autres poèmes célèbres, figurent dans ce livre.
puis à Mons entre 1873 et 1875. La Chanson de Gaspard Hauser et L'Art poétique, entre autres poèmes célèbres, figurent dans ce livre.

 premier mai, de 11h à 20h.
premier mai, de 11h à 20h. 
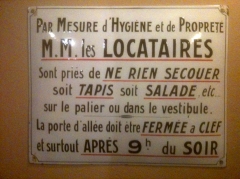

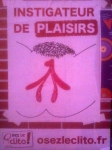

 avec
avec Acqua fresca
Acqua fresca la rentrée. Le voilà enfin!
la rentrée. Le voilà enfin! 

