Des Mille et une nuits à Proust, du Cantique des cantiques à Kafka et Flaubert, en passant par Yourcenar ou Ji Cheng et Claude Simon, les grands textes, et de nombreux écrivains, ont célébré le jardin. Florilège et promenade dans les allées, avec larges extraits prélevés parmi les livres de ma bibliothèque verte...
Voltaire, d’abord. Avant La Genèse. Candide, chapitre XXX : « Il faut cultiver son jardin ». Dont acte. Le précepte est indestructible. Ecrit à l’anti-rides. Et l’avantage, c’est que chacun l’interprète à sa guise ou selon son humeur. Telle est la non-leçon voltairienne. Sa lumineuse liberté.
La Genèse, donc : « Iahvé Elohim planta un jardin en Eden, à l’Orient, et il y plaça l’homme qu’il avait formé. Iahvé Elohim fit germer du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, ainsi que l’arbre de vie au milieu du jardin et l’arbre de la science du bien et du mal. Un fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin… » (C’était commode).
Depuis, le jardin n’a cessé d’inspirer. L’existence même du jardin est source d’inspiration : avant d’être sujet d’écriture, le jardin comme espace et environnement de l’écrivain, est propice à l’écriture. Il n’est qu’ à lire ce petit bijou qu’est Ecrit dans un jardin, de Marguerite Yourcenar, pour s’en convaincre. L’art du jardin, spécialité extrême-orientale classique, est éminemment littéraire : en effet, comment ne pas oser la métaphore des plantes et des fleurs que l’on plante avec les mots et les phrases que l’on pose ?
Yuan Ye (Le Traité du jardin, publié en 1635), du maître jardinier chinois Ji Cheng, inscrit l’action dans la durée. Comme l’écrivain l’écriture : « Au bord du ruisseau, on plantera des orchidées et des iris. Les sentiers seront bornés des Trois Bons Amis (le prunier, le bambou et le rocher). Il s’agit d’une œuvre qui doit durer mille automnes. (…) Quoique fait par l’homme, le jardin semblera l’œuvre de la nature ». Et le livre, légende. Un « livre de sable », une notion chère à Jorge Luis Borges. Sensuelle, pensée avec méticulosité, l’art du jardin est un bouquet de vertus pour l’âme et les sens. C’est un art qui veille au bien-être et prédispose à la création, en somme : « Dans la nuit, la pluie tombera sur les bananiers, comme les larmes de sirènes en pleurs. Quant à la brise matinale, elle soufflera à travers les saules qui se balanceront comme des selves danseuses. (…) Il faut planter les bambous devant les fenêtres et les poiriers dans les cours. Le vent, murmurant à travers les arbres, viendra effleurer doucement le luth et les livres posés sur le chevet ». Avec une poésie subtile, le maître jardinier qui conçut de nombreux jardins sous la dynastie Ming, disait encore : « Bien que tout ceci ne soit qu'une création humaine, elle peut paraître œuvre du Ciel »…
Remonter au Poème de la Bible, Le Cantique des cantiques permet d’y cueillir d’admirables pétales sur le motif. « C’est un jardin fermé que ma sœur fiancée, une source fermée, une fontaine scellée ; un bosquet où le grenadier se mêle aux plus beaux fruits, le troène au nard, le nard, le safran, la cannelle, le cinname à toutes sortes d’arbres odorants, la myrrhe et l’aloès à toutes les plantes embaumées ; une fontaine dans un jardin, une source d’eau vive, un ruisseau qui coule du Liban. Levez-vous, aquilons ; venez, autans ; soufflez sur mon jardin pour que ses parfums se répandent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu’il mange de ses beaux fruits ! ».
Les Mille et Une Nuits ne sont pas non plus en reste d’évocations merveilleuses. Une parmi cent : « J’ouvris la première porte, et j’entrai dans un jardin fruitier, auquel je crois que dans l’univers il n’y en a point de comparable. Je ne pense pas même que celui que notre religion nous promet après la mort puisse le surpasser. (…) J’en sortis l’esprit rempli de ces merveilles ; je fermais la porte et ouvris celle qui suivait. Au lieu d’un jardin de fruits, j’en trouvai un de fleurs, qui n’était pas moins singulier dans son genre… ».
Verlaine, dans ses Poèmes saturniens, pousse lui aussi la porte qui ouvre sur le jardin merveilleux : « Ayant poussé la porte étroite qui chancelle,/Je me suis promené dans le petit jardin/Qu’éclairait doucement le soleil du matin,/Pailletant chaque fleur d’une humide étincelle… ».
La beauté des jardins a toujours captivé les poètes. Les fruits, les fleurs –depuis Ronsard (« Mignonne, allons voir si la rose… »)-, produisent par ailleurs des métaphores tantôt libidineuses, tantôt amoureuses. Question de sève.
Venant de Victor Hugo, cela peut étonner : « Nous allions au verger cueillir des bigarreaux. / Avec ses beaux bras blancs en marbre de Paros. (…)/Ses petits doigts allaient chercher le fuit vermeil,/Semblable au feu qu’on voit dans le buisson qui flambe./Je montais derrière elle ; elle montrait sa jambe/Et disait : « Taisez-vous ! » à mes regards ardents ; (…) Penchée, elle m’offrait la cerise à sa bouche ;/Et ma bouche riait, et venait s’y poser,/Et laissait la cerise et prenait le baiser ».
Alexandre Vialatte, lui, aime les jardins municipaux : « L’homme ne vit réellement sa vie que dans la paix végétale des squares municipaux, devant le canard de Barbarie. (…) Si bien qu’on se croit au paradis et qu’il ne faut toucher à rien, ni aux fleurs, ni au séquoia, ni au canard, ni au silence, ni au jet d’eau, ni aux instruments de précision, de peur de fausser le mécanisme ; qui est certainement celui du bonheur ». Et c’est ainsi qu’Alexandre est grand !
Dans un registre différent, l’immense Claude Simon, dans Le Jardin des Plantes (il vécut Place Monge, dans le 5ème à Paris, à deux pas du Jardin de Buffon, Lacépède, Cuvier, et Jussieu), évoque avec une minutie saisissante, et dans une prose somptueuse, l’atmosphère du Jardin : les gens qui cassent la croûte, les clochards qui roupillent sur les bancs, le jardin zoologique, le Museum, les joggeurs, sur lesquels « les pastilles de soleil criblées par les feuillages glissent… (…) De nouveau, jaillissant des épaisses et vertes frondaisons des acacias, des peupliers, des frênes, des platanes et des hêtres l’oiseau lance son ricanement strident, moqueur et catastrophique qui monte par degrés, se déploie et retombe en cascade ».
Autre géant trop souvent réduit à certains aspects de sa vie privée, André Gide, qui vécut rue de Médicis, en face des Jardins du Luxembourg, à Paris, décrit fréquemment le « Luco », notamment dans Les Faux-Monnayeurs.
Comme Louis Aragon le fit, dans Le Paysan de Paris, au parc des Buttes-Chaumont, en y observant sa faune nocturne en compagnie d’André Breton. Il a notamment cette remarque sibylline : « Tout le bizarre de l’homme, et ce qu’il y a en lui de vagabond, et d’égaré, sans doute pourrait-il tenir dans ces deux syllables : jardin. Jamais, qu’il se pare de diamants ou souffle dans le cuivre, une proposition plus étrange, une plus déroutante idée ne lui était venue que lorsqu’il inventa les jardins »…
Flaubert nous montre quant à lui un Pécuchet complètement absorbé par son jardin, habité par l’obsession de la bonne conduite des tailles et autres semis, sous l’œil critique de Bouvard. Car Pécuchet n’a pas la main verte… Le passage suivant vaut par son humour : « Les boutures ne reprirent pas, les greffes se décollèrent, la sève des marcottes s’arrêta, les arbres avaient le blanc dans leurs racines ; les semis furent une désolation. Le vent s’amusait à jeter bas les rames des haricots. L’abondance de la gadoue nuisit aux fraisiers, le défaut de pinçage aux tomates. Il manqua les brocolis, les aubergines, les navets, et du cresson de fontaine, qu’il avait voulu élever dans un baquet. Après le dégel, tous les artichauts étaient perdus. Les choux le consolèrent. Un, surtout, lui donna des espérances. Il s’épanouissait, montait, finit par être prodigieux et absolument incomestible. N’importe, Pécuchet fut content de posséder un monstre. Alors il tenta ce qui lui semblait être le summum de l’art : l’élève du melon ». Ce sera, on s’en doute, un échec cuisant.
Nous pourrions ainsi citer, à l’envi, Les Géorgiques de Virgile, L’Odyssée d’Homère, Esope (plagié plus tard par La Fontaine), Boileau, Huysmans, Balzac, pour ne citer que quelques grands classiques. Tous ont magnifié le jardin comme espace, tantôt foisonnant, tantôt raidi par l’ordre. Le génie du lieu, ouvert et façonné, a donné des pages éblouissantes chez Horace Walpole, auteur d’un Essai sur l’art des jardins modernes, et pour qui « créer un jardin, c’est peindre un paysage ». Le père fondateur du roman gothique louait le jardin à l’anglaise et vilipendait le jardin français façonné « à la Le Nôtre »… Vieille querelle, que les jardins japonais, subtils, font taire en étant seulement.
Colette, avec la fluidité de sa prose enchanteresse, aimait passionnément les jardins, même si la nature sauvage mais douce de sa Puisaye natale, avait sa préférence : « Demain je surprendrai à l’aube rouge sur les tamaris mouillés de rosée saline, sur les faux bambous qui retiennent, à la pointe de chaque lance bleue, une perle… ».
À l’opposé, Marguerite Duras décrit, superbement, et comme un pied de nez aux jardins bien ordonnés, un jardin de banlieue triste, du côté de Vitry, dans La Pluie d’été. L’auteur des Journées entières dans les arbres, adorait décrire tous les jardins, même luxuriants et indochinois (voir Le Square).
Il y a encore le jardin intérieur, « les roses fleurissent à l’intérieur », disait Jean Jaurès. À distinguer du nénuphar qui pousse à l’intérieur du poumon de Chloé (dans L’écume des jours, de Boris Vian), et du Roman de la rose, d’un Moyen-Âge qui aimait enclore l’amour courtois : la rose symbolisait la femme et le jardin, le lieu clos où elle se cachait.
Il y a enfin le jardin secret, là où poussent nos rêves et nos désirs. Et je laisserai, par paresse et par admiration, le mot de la fin à Antoine Blondin : « Un peu plus aventureux, je me serais fait jardinier ».
L. M.
Lire absolument : Le goût des jardins, et Les jardins secrets (Mercure de France), et chercher obstinément Eloge du jardin, offert il y a deux ans par Arléa pour l’achat de quelques livres. Car ce sont trois anthologies très précieuses.

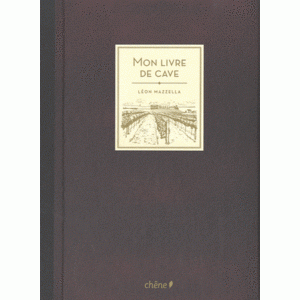
 Pour plus de détails :
Pour plus de détails :  Je reçois à l'instant Humour et rugby, de Serge Laget (La Martinière). Et je me marre. Les illustrations sont chouettes et désuètes, mais bon, il y a de nombreux dessins d'Iturria et je n'en ai jamais supporté aucun, dans le journal Sud-Ouest comme là. Ici, là, partout un peu, ce bouquin en fait trop : il est loin d'être léger, il est plutôt bourrin marteleur de clous, sous la mêlée, c'est dommage. Coïncidence, je porte aujourd'hui un polo noir que j'aime bien, et sur lequel on peut lire (lado pecho) : Gentleman ou voyou? et (côté dos) : rugbyman. Il y a de la trombine dans ce bouquin, des souvenirs de Roger Couderc -en voyant sa tronche, j'entends sa voix, le dimanche soir, annoncer que les Poules ont du pain sur la planche... Et les troisièmes mi-temps sont au rendez-vous, de même que l'hommage aux frères Boni. L'auteur souligne plus ou moins finement que le H du mot humour figure les poteaux. Mais c'est vrai, té!
Je reçois à l'instant Humour et rugby, de Serge Laget (La Martinière). Et je me marre. Les illustrations sont chouettes et désuètes, mais bon, il y a de nombreux dessins d'Iturria et je n'en ai jamais supporté aucun, dans le journal Sud-Ouest comme là. Ici, là, partout un peu, ce bouquin en fait trop : il est loin d'être léger, il est plutôt bourrin marteleur de clous, sous la mêlée, c'est dommage. Coïncidence, je porte aujourd'hui un polo noir que j'aime bien, et sur lequel on peut lire (lado pecho) : Gentleman ou voyou? et (côté dos) : rugbyman. Il y a de la trombine dans ce bouquin, des souvenirs de Roger Couderc -en voyant sa tronche, j'entends sa voix, le dimanche soir, annoncer que les Poules ont du pain sur la planche... Et les troisièmes mi-temps sont au rendez-vous, de même que l'hommage aux frères Boni. L'auteur souligne plus ou moins finement que le H du mot humour figure les poteaux. Mais c'est vrai, té!  L'agence de communication lyonnaise
L'agence de communication lyonnaise  Je préfère penser, en feuilletant les Fragments inédits de Marilyn Monroe, que les histoires oiseuses sur les blondes vont pouvoir prendre leur revanche. (Etait-il nécessaire de déguiser la publication de ces textes intimes qui disent un amour pour la littérature et des qualités littéraires évidentes, en réhabilitation?..). Antonio Tabucchi, dans sa préface, souligne un signe dans l'existence d'une femme trop belle et réduite au statut encombrant de bombe sexuelle absolue. A l'intérieur de ce corps qu'à certains moments de sa vie Marilyn porta comme on porte une valise, vivait l'âme d'une intellectuelle et d'une poétesse dont personne n'avait le soupçon. Est-ce exagéré? En tout cas, cela explique sans doute pour partie la mélancolie de Marilyn, voire sa dépression. MM rêvait de se réincarner en papillon. Cette légèreté ne manque pas de grâce. Et m'émeut.
Je préfère penser, en feuilletant les Fragments inédits de Marilyn Monroe, que les histoires oiseuses sur les blondes vont pouvoir prendre leur revanche. (Etait-il nécessaire de déguiser la publication de ces textes intimes qui disent un amour pour la littérature et des qualités littéraires évidentes, en réhabilitation?..). Antonio Tabucchi, dans sa préface, souligne un signe dans l'existence d'une femme trop belle et réduite au statut encombrant de bombe sexuelle absolue. A l'intérieur de ce corps qu'à certains moments de sa vie Marilyn porta comme on porte une valise, vivait l'âme d'une intellectuelle et d'une poétesse dont personne n'avait le soupçon. Est-ce exagéré? En tout cas, cela explique sans doute pour partie la mélancolie de Marilyn, voire sa dépression. MM rêvait de se réincarner en papillon. Cette légèreté ne manque pas de grâce. Et m'émeut. la rentrée. Le voilà enfin!
la rentrée. Le voilà enfin!  Il faut en finir avec les adresses réputées indéboulonnables : la pizzeria Da Michele (1, via Sersale) fait l'unanimité à Naples -en tout cas dans les guides touristiques. Or, la pizzeria Trianon Da Ciro (voisine : 44-46 via Colletta) ainsi que la pizzeria Vesi (115,
Il faut en finir avec les adresses réputées indéboulonnables : la pizzeria Da Michele (1, via Sersale) fait l'unanimité à Naples -en tout cas dans les guides touristiques. Or, la pizzeria Trianon Da Ciro (voisine : 44-46 via Colletta) ainsi que la pizzeria Vesi (115, 
 Au Musée d'art moderne de Lisbonne
Au Musée d'art moderne de Lisbonne







 Richard Escot, qui dirige le rugby à L'Equipe, oui môssieur! a piloté un diable de bouquin magnifique (les photos ont vraiment le sentido) où les textes de l'ami Benoît Jeantet, d'Escot lui-même et aussi de Catherine Kintzler -philosophe de l'ovale, ou encore de Jacques Rivière, parmi d'autres, sont autant de bijoux taillés par des plumes qui connaissent le sujet de l'intérieur de l'intérieur. Et c'est ce qui singularise Rugby, une passion (La Martinière) de tant d'ouvrages sur le motif.
Richard Escot, qui dirige le rugby à L'Equipe, oui môssieur! a piloté un diable de bouquin magnifique (les photos ont vraiment le sentido) où les textes de l'ami Benoît Jeantet, d'Escot lui-même et aussi de Catherine Kintzler -philosophe de l'ovale, ou encore de Jacques Rivière, parmi d'autres, sont autant de bijoux taillés par des plumes qui connaissent le sujet de l'intérieur de l'intérieur. Et c'est ce qui singularise Rugby, une passion (La Martinière) de tant d'ouvrages sur le motif.  J.J.Rousseau, nous offre un parcours intellectuel et humain, concocté par un hyper-spécialiste, Raymond Trousson. J'y ai particulièrement aimé les lettres d'amour adressées à Mme de Warens, bien sûr, ainsi que les échanges à bazookas mouchetés avec Voltaire... Le plus surprenant est d'y sentir un Rousseau pataud, voire malhabile avec la correspondance, tandis qu'il est, dans le même temps, un écrivain au style magnifique. Inhibition? Paresse? Négligence? J'accuse Rousseau de mépriser parfois son correspondant. Son attitude est volontiers hautaine, et cela nous fait réviser notre jugement sur l'humaniste plébiscité, sur l'apôtre de la Nature et des rêveries d'un promeneur -forcément solitaire... Néanmoins, cette sélection est un pur jus, un concentré de plusieurs épais volumes, et le choix établi nous apparaît -mais comment savoir?- judicieux (éd. Sulliver).
J.J.Rousseau, nous offre un parcours intellectuel et humain, concocté par un hyper-spécialiste, Raymond Trousson. J'y ai particulièrement aimé les lettres d'amour adressées à Mme de Warens, bien sûr, ainsi que les échanges à bazookas mouchetés avec Voltaire... Le plus surprenant est d'y sentir un Rousseau pataud, voire malhabile avec la correspondance, tandis qu'il est, dans le même temps, un écrivain au style magnifique. Inhibition? Paresse? Négligence? J'accuse Rousseau de mépriser parfois son correspondant. Son attitude est volontiers hautaine, et cela nous fait réviser notre jugement sur l'humaniste plébiscité, sur l'apôtre de la Nature et des rêveries d'un promeneur -forcément solitaire... Néanmoins, cette sélection est un pur jus, un concentré de plusieurs épais volumes, et le choix établi nous apparaît -mais comment savoir?- judicieux (éd. Sulliver).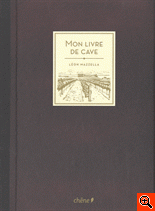

 Une semaine sur l'île de Procida regonfle, donne envie de continuer d'écrire, d'écrire là-bas aussi, à défaut d'y vivre; entre deux balades en scooter d'une plage l'autre, et deux terrasses de restaurants de poissons et de fruits de mer. L'île n'est-elle pas devenue un jardin d'écriture, où Elsa Morante écrivit plusieurs de ses livres, dans la propriété Mazzella di Bosco ou hôtel Eldorado (
Une semaine sur l'île de Procida regonfle, donne envie de continuer d'écrire, d'écrire là-bas aussi, à défaut d'y vivre; entre deux balades en scooter d'une plage l'autre, et deux terrasses de restaurants de poissons et de fruits de mer. L'île n'est-elle pas devenue un jardin d'écriture, où Elsa Morante écrivit plusieurs de ses livres, dans la propriété Mazzella di Bosco ou hôtel Eldorado ( Corricella, avec la côte amalfitaine et Capri à l'horiz
Corricella, avec la côte amalfitaine et Capri à l'horiz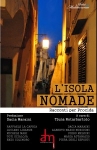 de récits sur Procida rassemblés par Tjuna Notarbartolo, écrivain et présidente du Prix Elsa-Morante, augmente cette fois d'une joie singulière, celle qui rassérène car elle est fleurie de promesses et de bonheurs à venir, encore, bientôt ; là-bas.
de récits sur Procida rassemblés par Tjuna Notarbartolo, écrivain et présidente du Prix Elsa-Morante, augmente cette fois d'une joie singulière, celle qui rassérène car elle est fleurie de promesses et de bonheurs à venir, encore, bientôt ; là-bas. 
 Le magazine Fromage gourmand m'a demandé un texte sur mon fromage fétiche pour leur rubrique littérature (un écrivain, un fromage) -Pourquoi pas! Le papier est paru hier, extraits :
Le magazine Fromage gourmand m'a demandé un texte sur mon fromage fétiche pour leur rubrique littérature (un écrivain, un fromage) -Pourquoi pas! Le papier est paru hier, extraits :  un délice. D’estive, il est plus tendre. Sec, il est fort comme la montagne à l’automne, lorsque la hêtraie fait pâlir d’envie les images du couvert canadien au cours de l’été indien. Une confrérie de l’Ardi Gasna tient chapitre chaque année à Saint-Jean-Pied-de-Port. J’y fus intronisé un matin de septembre (sans doute parce que j’étais alors rédacteur en chef de « GaultMillau »), juste avant un déjeuner d’anthologie chez Firmin Arrambide, aux « Pyrénées », et une corrida bayonnaise de la feria de l’Atlantique, dont on fit un fromage à l’heure de la tertulia, ce moment exquis où l’on refait le monde de la tauromachie, gestes à l’appui, verre de fino en main, avant d’aller dîner quelque part…
un délice. D’estive, il est plus tendre. Sec, il est fort comme la montagne à l’automne, lorsque la hêtraie fait pâlir d’envie les images du couvert canadien au cours de l’été indien. Une confrérie de l’Ardi Gasna tient chapitre chaque année à Saint-Jean-Pied-de-Port. J’y fus intronisé un matin de septembre (sans doute parce que j’étais alors rédacteur en chef de « GaultMillau »), juste avant un déjeuner d’anthologie chez Firmin Arrambide, aux « Pyrénées », et une corrida bayonnaise de la feria de l’Atlantique, dont on fit un fromage à l’heure de la tertulia, ce moment exquis où l’on refait le monde de la tauromachie, gestes à l’appui, verre de fino en main, avant d’aller dîner quelque part… 


 (Photos prises avec mon iPhone : Sebastian Castella, Mateo Julian, novillero prometteur, Dax, samedi 11. Arènes de Bayonne, samedi 4)
(Photos prises avec mon iPhone : Sebastian Castella, Mateo Julian, novillero prometteur, Dax, samedi 11. Arènes de Bayonne, samedi 4) C'est un refrain : il faut en voir beaucoup pour... Ainsi ces derniers jours, aux arènes de Bayonne et de Dax, parfois matin et soir...
C'est un refrain : il faut en voir beaucoup pour... Ainsi ces derniers jours, aux arènes de Bayonne et de Dax, parfois matin et soir...
 Photo volée avec mon téléphone, dans la rue, cet après-midi.
Photo volée avec mon téléphone, dans la rue, cet après-midi. Une fois n'est pas coutume : l'été, je suis rosé et blanc et cet été davantage rosé que blanc. Mais là, il s'agit d'un rouge. D'un Vacqueyras. J'adore cette AOC (je fus d'ailleurs intronisé en son sein en 1996 ou 97), située au pied du Mont Ventoux et aux abords des Dentelles de Montmirail, là où l'on éprouve Pétrarque et où l'on entend la voix grave et puissante de René Char, rien qu'en foulant le sol aride, en recevant avec bonheur une gifle de mistral et en observant les vieux pieds, noirs et noueux, de syrah, de mourvèdre et de grenache. MonTirius (élaboré par Christine et Eric Sorel) est un vacqueyras rare, car élevé en agriculture biodynamique et 100% non boisé. Il est composé de 70% de grenache et de 30% de syrah, des vignes d'un demi-siècle qui plantent leurs racines dans un sol de garrigues (Garrigues est d'ailleurs le nom de la cuvée dégustée) argilo-calcaires et des poches de marnes argileuses bleues réputées difficiles à pénétrer. Le vin est bichonné, après une éraflage total, un léger foulage et une préfermentation à froid. Ses levures sont indigènes et son nez profond comme un tombeau baudelairien. Les fruits rouges et noirs (comme la robe de ce vin) se disputent vos narines et, en bouche, l'attaque est féline, vive et douce à la fois. J'y ai retrouvé la fraîcheur de la garrigue à l'aube et le sous-bois d'arrière-septembre, lorsque le cèpe parvient à nous faire oublier la grive. Un magret de canard l'escorta, hier soir. L'audacieux MonTirius releva avec superbe ma provocation en forme de poudre de piment d'Espelette, versée d'abondance. Pour voir. Et j'ai vu. Et bu. Ceci est un vin de plaisir et de partage. Un vin de copains. Franc, droit, il ne se la joue pas et c'est pour cela qu'on l'aime.
Une fois n'est pas coutume : l'été, je suis rosé et blanc et cet été davantage rosé que blanc. Mais là, il s'agit d'un rouge. D'un Vacqueyras. J'adore cette AOC (je fus d'ailleurs intronisé en son sein en 1996 ou 97), située au pied du Mont Ventoux et aux abords des Dentelles de Montmirail, là où l'on éprouve Pétrarque et où l'on entend la voix grave et puissante de René Char, rien qu'en foulant le sol aride, en recevant avec bonheur une gifle de mistral et en observant les vieux pieds, noirs et noueux, de syrah, de mourvèdre et de grenache. MonTirius (élaboré par Christine et Eric Sorel) est un vacqueyras rare, car élevé en agriculture biodynamique et 100% non boisé. Il est composé de 70% de grenache et de 30% de syrah, des vignes d'un demi-siècle qui plantent leurs racines dans un sol de garrigues (Garrigues est d'ailleurs le nom de la cuvée dégustée) argilo-calcaires et des poches de marnes argileuses bleues réputées difficiles à pénétrer. Le vin est bichonné, après une éraflage total, un léger foulage et une préfermentation à froid. Ses levures sont indigènes et son nez profond comme un tombeau baudelairien. Les fruits rouges et noirs (comme la robe de ce vin) se disputent vos narines et, en bouche, l'attaque est féline, vive et douce à la fois. J'y ai retrouvé la fraîcheur de la garrigue à l'aube et le sous-bois d'arrière-septembre, lorsque le cèpe parvient à nous faire oublier la grive. Un magret de canard l'escorta, hier soir. L'audacieux MonTirius releva avec superbe ma provocation en forme de poudre de piment d'Espelette, versée d'abondance. Pour voir. Et j'ai vu. Et bu. Ceci est un vin de plaisir et de partage. Un vin de copains. Franc, droit, il ne se la joue pas et c'est pour cela qu'on l'aime.  Voilà un beau cadeau de derrière les fagots, ou les tiroirs, c'est comme on voudra. Les éditions Finitude (magnifique catalogue comme on les aime, façon Le temps qu'il fait ou le dilettante des débuts,
Voilà un beau cadeau de derrière les fagots, ou les tiroirs, c'est comme on voudra. Les éditions Finitude (magnifique catalogue comme on les aime, façon Le temps qu'il fait ou le dilettante des débuts,  synthétique, et prévient : « Il y a une chose dont vos esprits doivent bien se pénétrer (il s'adresse à des étudiants) : l'oeuvre n'est pas autobiographique, le narrateur n'est pas Proust en tant qu'individu, et les personnages n'ont jamais existé ailleurs que dans l'esprit de l'auteur. » (...) « Proust est un prisme. Son seul objet est de réfracter, et, par réfraction, de recréer rétrospectivement un monde. « (...) « Les créatures prismatiques de Proust n'ont pas d'emploi, leur emploi est d'amuser l'auteur. » Nous entrons ainsi dans une oeuvre d'art dont l'ampleur est considérable. Nous sommes au sein d'une évocation gigantesque et aux ramifications qui semblent infinies, pas d'une description. Ni d'une autofiction, suis-je tenté d'ajouter. Ce serait trop facile! Et les Doubrovsky et autres Vilain se réjouiraient en hâte. Non. Proust est autrement plus complexe tout en restant limpide, par la force surhumaine de son style, par la grâce dont la Recherche est empreinte de la première ligne à la dernière (pour peu que l'on sache tourner les pages lorsqu'il le faut; à bon escient). « En matière de générosité verbale, dit Nabokov à propos de l'usage de la métaphore par Proust, c'est un véritable Père Noël. » Chez Proust, poursuit-il, « conversations et descriptions s'entremêlent, créant une nouvelle unité où fleur et insecte appartiennent à un seul et même arbre en fleurs. » Je pense alors à la peinture d'EkAT. Aux remarques de Christiane à ce sujet et à propos de ses propres créations graphiques. Et je retourne illico à Nabokov : celui-ci souligne avec tact une façon de déplier l'image comme un éventail, procédé caractéristiquement proustien. Prenons « le » personnage. Proust, selon Nabokov, l'appréhende comme une personnalité connue de façon comparative seulement, jamais de façon absolue. Aussi, « au lieu de le hacher menu (façon Joyce avec Ulysse), il nous montre tel personnage à travers l'idée que d'autres personnages se font de ce personnage. Et il espère, après avoir donné une série de ces prismes et de ces reflets, les combiner pour en faire une réalité artistique. » Bien sûr, Nabokov évoque –avec une infinie douceur, pas comme un chirurgien de l’Université ou un critique littéraire armé de sourds couteaux revanchards -, la madeleine, le baiser de maman, Combray, la flèche pourpre, la crème au chocolat, Méséglise, Vinteuil, Léonie, la jalousie –qui éclatera beaucoup plus loin avec Albertine, Guermantes, les cattleyas… Mais il ne brille jamais aussi intensément que lorsqu’il parle de cette notion du temps incorporé, de ce quelque chose de plus que la mémoire. « Un bouquet de sensations dans le présent et la vision d’un événement ou d’une sensation dans le passé, voilà où la sensation et la mémoire se rejoignent, où le temps perdu se retrouve. » Chef d’œuvre, vous dis-je!
synthétique, et prévient : « Il y a une chose dont vos esprits doivent bien se pénétrer (il s'adresse à des étudiants) : l'oeuvre n'est pas autobiographique, le narrateur n'est pas Proust en tant qu'individu, et les personnages n'ont jamais existé ailleurs que dans l'esprit de l'auteur. » (...) « Proust est un prisme. Son seul objet est de réfracter, et, par réfraction, de recréer rétrospectivement un monde. « (...) « Les créatures prismatiques de Proust n'ont pas d'emploi, leur emploi est d'amuser l'auteur. » Nous entrons ainsi dans une oeuvre d'art dont l'ampleur est considérable. Nous sommes au sein d'une évocation gigantesque et aux ramifications qui semblent infinies, pas d'une description. Ni d'une autofiction, suis-je tenté d'ajouter. Ce serait trop facile! Et les Doubrovsky et autres Vilain se réjouiraient en hâte. Non. Proust est autrement plus complexe tout en restant limpide, par la force surhumaine de son style, par la grâce dont la Recherche est empreinte de la première ligne à la dernière (pour peu que l'on sache tourner les pages lorsqu'il le faut; à bon escient). « En matière de générosité verbale, dit Nabokov à propos de l'usage de la métaphore par Proust, c'est un véritable Père Noël. » Chez Proust, poursuit-il, « conversations et descriptions s'entremêlent, créant une nouvelle unité où fleur et insecte appartiennent à un seul et même arbre en fleurs. » Je pense alors à la peinture d'EkAT. Aux remarques de Christiane à ce sujet et à propos de ses propres créations graphiques. Et je retourne illico à Nabokov : celui-ci souligne avec tact une façon de déplier l'image comme un éventail, procédé caractéristiquement proustien. Prenons « le » personnage. Proust, selon Nabokov, l'appréhende comme une personnalité connue de façon comparative seulement, jamais de façon absolue. Aussi, « au lieu de le hacher menu (façon Joyce avec Ulysse), il nous montre tel personnage à travers l'idée que d'autres personnages se font de ce personnage. Et il espère, après avoir donné une série de ces prismes et de ces reflets, les combiner pour en faire une réalité artistique. » Bien sûr, Nabokov évoque –avec une infinie douceur, pas comme un chirurgien de l’Université ou un critique littéraire armé de sourds couteaux revanchards -, la madeleine, le baiser de maman, Combray, la flèche pourpre, la crème au chocolat, Méséglise, Vinteuil, Léonie, la jalousie –qui éclatera beaucoup plus loin avec Albertine, Guermantes, les cattleyas… Mais il ne brille jamais aussi intensément que lorsqu’il parle de cette notion du temps incorporé, de ce quelque chose de plus que la mémoire. « Un bouquet de sensations dans le présent et la vision d’un événement ou d’une sensation dans le passé, voilà où la sensation et la mémoire se rejoignent, où le temps perdu se retrouve. » Chef d’œuvre, vous dis-je!
 J'ajoute, ce 27 juillet, une info que je viens de découvrir : voir le lien ci-dessous avec un blog (recommandable) qui annonce une série de festivités (théâtre, lectures...) à l'occasion de ce centenaire.
J'ajoute, ce 27 juillet, une info que je viens de découvrir : voir le lien ci-dessous avec un blog (recommandable) qui annonce une série de festivités (théâtre, lectures...) à l'occasion de ce centenaire.



 Je pose cette photo, que j'ai prise dans la forêt des Ardennes, à la faveur d'un reportage récent sur Rimbaud paru dans Le Nouvel Observateur (lire ici à la date du 8 avril 10 et à celle du 25 mars 10), car elle figure la Meuse en fer à cheval au village de Monthermé, et que c'est précisément ce paysage qui servit de décor à Julien Gracq pour planter celui de son roman Un balcon en forêt. Je me demande surtout comment j'ai pu oublier cela lorsque je me trouvais derrière l'objectif. Etait-ce à cause de Rimbaud? - Non, je pensais aussi aux premières pages du Balcon. Je m'étonne. Du coup, l'émotion monte en moi. Rimbaud, Gracq. La forêt profonde et ses sangliers sombres et furtifs. Me reviennent le souvenir de l'aspirant Grange -personnage principal du Balcon- embarqué dans la drôle de guerre, celui -central, comme souvent dans l'oeuvre de J.G.-, de l'attente (voir à ce sujet le film que Michel Mitrani tira du roman en 1979), et le personnage si sensuel de Mona, qui montait le long de lui (Grange) comme un petit espalier... Mais je reprends plutôt le somptueux poème en prose intitulé La sieste en Flandre hollandaise (dans Liberté grande), et je pense au premier colloque posthume sur Gracq qui vient de se tenir à Paris -soit aux discours certes profonds, intelligents et intéressants des intervenants, mais malheureusement empreints de scalpels et de carbone 14 littéraires. Au lieu de quoi, je choisis comme toujours de retourner au mot, à la poésie, à la sensation; soit à la marque de fabrique Gracq. Je lirai aussi les poèmes de Rose au coeur violet, de Nora Mitrani, qui fut sans doute (mais comment vraiment savoir? Et est-il nécessaire de le savoir?) le grand amour de Julien Gracq jusqu'à la mort de celle-ci en 1961. Et, dans la foulée je reprendrai Jünger (Sur les falaises de marbre) et Buzzati (Le désert des Tartares) -car quand me revient, régulièrement d'ailleurs, une bouffée de Gracq, autrement dit une fringale semblable à celle que l'on peut ressentir pour un jambon-beurre avec un demi demandés dans une urgence gourmande-, une sorte de boulimie pointe, qui me fait amasser plusieurs piles de livres autour de moi comme une sorte de nid vite construit, et dans lequel je puise à l'envi, rassuré. En picorant, en feuilletant, cherchant une annotation seulement, une page là, un truc ici, la jouissance commence à opérer. Cela s'appelle le plaisir de lire. Simplement. Il s'apparente à l'ivresse. Une ivresse douce et calme, silencieuse et toute intérieure. Une ivresse qui propulse, car le ou les voyages que l'on y fait sont les plus lointains et les plus précieux. Ils ressemblent à l'imaginaire de l'enfance que l'on devine dans le regard émerveillé d'un gamin au sortir de la lecture d'un conte faite par l'un de ses parents. Surtout s'il s'agit d'une (énième) relecture, car comme l'enfant, nous aimons retourner à nos impressions premières que nous avons pris soin de consigner. Nous aimons passionnément reconnaître. Ces voyages-là ressemblent aussi au souvenir de nos rêves les plus enfouis, les plus éloignés, les plus ingénus -les plus merveilleux en somme. Et je comprends d'autant mieux l'absence de virgule dans le titre d'un des essais les plus fameux de Gracq : En lisant en écrivant. Car les deux activités sont radicalement indissolubles, comme paraît inséparable un couple qui fait l'amour, en dépit de l'horizon de ses jouissances.
Je pose cette photo, que j'ai prise dans la forêt des Ardennes, à la faveur d'un reportage récent sur Rimbaud paru dans Le Nouvel Observateur (lire ici à la date du 8 avril 10 et à celle du 25 mars 10), car elle figure la Meuse en fer à cheval au village de Monthermé, et que c'est précisément ce paysage qui servit de décor à Julien Gracq pour planter celui de son roman Un balcon en forêt. Je me demande surtout comment j'ai pu oublier cela lorsque je me trouvais derrière l'objectif. Etait-ce à cause de Rimbaud? - Non, je pensais aussi aux premières pages du Balcon. Je m'étonne. Du coup, l'émotion monte en moi. Rimbaud, Gracq. La forêt profonde et ses sangliers sombres et furtifs. Me reviennent le souvenir de l'aspirant Grange -personnage principal du Balcon- embarqué dans la drôle de guerre, celui -central, comme souvent dans l'oeuvre de J.G.-, de l'attente (voir à ce sujet le film que Michel Mitrani tira du roman en 1979), et le personnage si sensuel de Mona, qui montait le long de lui (Grange) comme un petit espalier... Mais je reprends plutôt le somptueux poème en prose intitulé La sieste en Flandre hollandaise (dans Liberté grande), et je pense au premier colloque posthume sur Gracq qui vient de se tenir à Paris -soit aux discours certes profonds, intelligents et intéressants des intervenants, mais malheureusement empreints de scalpels et de carbone 14 littéraires. Au lieu de quoi, je choisis comme toujours de retourner au mot, à la poésie, à la sensation; soit à la marque de fabrique Gracq. Je lirai aussi les poèmes de Rose au coeur violet, de Nora Mitrani, qui fut sans doute (mais comment vraiment savoir? Et est-il nécessaire de le savoir?) le grand amour de Julien Gracq jusqu'à la mort de celle-ci en 1961. Et, dans la foulée je reprendrai Jünger (Sur les falaises de marbre) et Buzzati (Le désert des Tartares) -car quand me revient, régulièrement d'ailleurs, une bouffée de Gracq, autrement dit une fringale semblable à celle que l'on peut ressentir pour un jambon-beurre avec un demi demandés dans une urgence gourmande-, une sorte de boulimie pointe, qui me fait amasser plusieurs piles de livres autour de moi comme une sorte de nid vite construit, et dans lequel je puise à l'envi, rassuré. En picorant, en feuilletant, cherchant une annotation seulement, une page là, un truc ici, la jouissance commence à opérer. Cela s'appelle le plaisir de lire. Simplement. Il s'apparente à l'ivresse. Une ivresse douce et calme, silencieuse et toute intérieure. Une ivresse qui propulse, car le ou les voyages que l'on y fait sont les plus lointains et les plus précieux. Ils ressemblent à l'imaginaire de l'enfance que l'on devine dans le regard émerveillé d'un gamin au sortir de la lecture d'un conte faite par l'un de ses parents. Surtout s'il s'agit d'une (énième) relecture, car comme l'enfant, nous aimons retourner à nos impressions premières que nous avons pris soin de consigner. Nous aimons passionnément reconnaître. Ces voyages-là ressemblent aussi au souvenir de nos rêves les plus enfouis, les plus éloignés, les plus ingénus -les plus merveilleux en somme. Et je comprends d'autant mieux l'absence de virgule dans le titre d'un des essais les plus fameux de Gracq : En lisant en écrivant. Car les deux activités sont radicalement indissolubles, comme paraît inséparable un couple qui fait l'amour, en dépit de l'horizon de ses jouissances. Il a la peau dure, ce mythe. Aussi dure que la peau de Jimmy l’écorché était fine. Le prince inconsolé par la disparition de sa mère alors qu’il n’avait que neuf ans, vivra toutes les expériences possibles de la vie en homme pressé, boulimique, libre, provocateur ; suicidaire. « La nuit, je sortais en cachette de chez mon oncle et j’allais pleurer sur sa tombe : maman, pourquoi m’as-tu laissé ? Dis, pourquoi m’as-tu abandonné ? J’ai besoin de toi ». La blessure restera ouverte.
Il a la peau dure, ce mythe. Aussi dure que la peau de Jimmy l’écorché était fine. Le prince inconsolé par la disparition de sa mère alors qu’il n’avait que neuf ans, vivra toutes les expériences possibles de la vie en homme pressé, boulimique, libre, provocateur ; suicidaire. « La nuit, je sortais en cachette de chez mon oncle et j’allais pleurer sur sa tombe : maman, pourquoi m’as-tu laissé ? Dis, pourquoi m’as-tu abandonné ? J’ai besoin de toi ». La blessure restera ouverte. Très tôt, Jimmy a su. Il a su qu’il lui fallait s’exprimer avec le corps et la parole. Le théâtre autant que les sports casse-cou lui confirmeront son intuition. Sûr de lui, il n’aura de cesse de forger son esprit et son allure, ingurgitant les lectures, se donnant à pleins poumons dans la déclamation de pièces de théâtre, et prenant goût, déjà, à la vitesse sous toutes ses formes. « Je n’ai même pas envie d’être seulement le meilleur. Je veux devenir si grand que les autres n’arriveront pas à m’atteindre. Ce n’est pas pour prouver quoi que ce soit, c’est pour arriver là où on doit arriver quand on consacre toute sa vie et tout son être à une seule et même chose ».
Très tôt, Jimmy a su. Il a su qu’il lui fallait s’exprimer avec le corps et la parole. Le théâtre autant que les sports casse-cou lui confirmeront son intuition. Sûr de lui, il n’aura de cesse de forger son esprit et son allure, ingurgitant les lectures, se donnant à pleins poumons dans la déclamation de pièces de théâtre, et prenant goût, déjà, à la vitesse sous toutes ses formes. « Je n’ai même pas envie d’être seulement le meilleur. Je veux devenir si grand que les autres n’arriveront pas à m’atteindre. Ce n’est pas pour prouver quoi que ce soit, c’est pour arriver là où on doit arriver quand on consacre toute sa vie et tout son être à une seule et même chose ». Mullholand Drive, ou sur toutes les autoroutes qu’il empruntait la nuit, pour la seule ivresse de lancer à fond les chevaux vapeur et sa voix. Jusqu’à l’extinction. « La famille Dean vient de s’agrandir. Je viens d’acheter une MG 53 rouge. Mon sexe s’évade dans les courbes pleines, les descentes vertigineuses, les embouteillages… Tu as de la concurrence. Ma moto, ma MG. Ca marche entre nous, ma chérie… », écrit-il, désinvolte, à une fille.
Mullholand Drive, ou sur toutes les autoroutes qu’il empruntait la nuit, pour la seule ivresse de lancer à fond les chevaux vapeur et sa voix. Jusqu’à l’extinction. « La famille Dean vient de s’agrandir. Je viens d’acheter une MG 53 rouge. Mon sexe s’évade dans les courbes pleines, les descentes vertigineuses, les embouteillages… Tu as de la concurrence. Ma moto, ma MG. Ca marche entre nous, ma chérie… », écrit-il, désinvolte, à une fille. A l’instar d’un Albert Camus qui « ne se sentait jamais aussi bien que sur un stade de foot ou sur les planches », James Dean confia : « Le seul moment où je me se sens réellement moi-même, c’est lorsque je suis sur un circuit (automobile) ». Cela ne l’empêcha pas d’entrer dans la peau de ses personnages, que ce fut son propre rôle -guidon, volant ou rênes de cheval bien en mains-, ou dans des rôles d’emprunt. Dans la peau de Frankenstein, pour « Autant en emporte le vaurien », une pièce qu’il bricola au lycée, qui subjugua les parents d’élèves et médusa les profs réunis.
A l’instar d’un Albert Camus qui « ne se sentait jamais aussi bien que sur un stade de foot ou sur les planches », James Dean confia : « Le seul moment où je me se sens réellement moi-même, c’est lorsque je suis sur un circuit (automobile) ». Cela ne l’empêcha pas d’entrer dans la peau de ses personnages, que ce fut son propre rôle -guidon, volant ou rênes de cheval bien en mains-, ou dans des rôles d’emprunt. Dans la peau de Frankenstein, pour « Autant en emporte le vaurien », une pièce qu’il bricola au lycée, qui subjugua les parents d’élèves et médusa les profs réunis.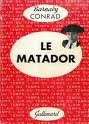 Bavard, James Dean avait deux sujets de conversation favoris dont il soûlait ses auditeurs : les courses de moto et la corrida. Son appartement de la 68ème Rue Ouest, à New-York, avait les murs tapissés d’affiches de corridas, de capes et de cornes, et mangés par le bas par des piles de disques de musique africaine, afro-cubaine, de jazz, de Berlioz et Tchaïkovsky, et de livres bien sûr (Kafka, Lawrence, Baudelaire, Hemingway, Cocteau, Rimbaud et Verlaine…, Saint-Exupéry).
Bavard, James Dean avait deux sujets de conversation favoris dont il soûlait ses auditeurs : les courses de moto et la corrida. Son appartement de la 68ème Rue Ouest, à New-York, avait les murs tapissés d’affiches de corridas, de capes et de cornes, et mangés par le bas par des piles de disques de musique africaine, afro-cubaine, de jazz, de Berlioz et Tchaïkovsky, et de livres bien sûr (Kafka, Lawrence, Baudelaire, Hemingway, Cocteau, Rimbaud et Verlaine…, Saint-Exupéry). Jean-Luc Coatalem apparaît comme l'un des écrivains français dont la prose chaloupée, dense, précieuse sans être emphatique,
Jean-Luc Coatalem apparaît comme l'un des écrivains français dont la prose chaloupée, dense, précieuse sans être emphatique, Saber Mansouri récidive. Après La Démocratie athénienne, une affaire d’oisifs ? (André Versaille) –lire ici même à la date du 15 avril dernier, voici L’Islam confisqué, manifeste pour un sujet libéré (Sindbad). Cet essai remet les pendules à l’heure et part posément en guerre contre le mal le plus banalisé du monde depuis l’aube de l’humanité : le préjugé. Le vite dit. Le caricatural. La confusion intellectuelle originelle. Sujet : l’islam. Auteur : un helléniste certes, mais d’abord un « immigré arabe choisi » (ainsi se présente-t-il). Cet intellectuel tunisien désormais inféodé à Saint-Germain-des-Prés, qui enseigne à l'Ecole pratique des hautes études, nous dit son agacement à propos de l’agglomération des genres, de l’auberge espagnole qu’est devenue le mot islam, et du mélange du religieux et du politique, surtout. Le sacré et le profane, le spirituel et le temporel, Dieu et ses représentants sur terre… Bref : il est ici question de la vision globalisante de l’islam comme d'une horrible théocratie qui brouille (c'est le moins qu'on puisse dire) la vision nécessairement claire des choses importantes du monde actuel. Et des dangers redoutables que cela engendre quotidiennement, dans la perception, dans la conscience, dans le discours et aussi dans les faits. Le racisme ordinaire comme le lynchage médiatique en sont deux exemples. Car le nœud du problème est là : l’islam désigne aussitôt dans l’inconscient collectif occidental, le terrorisme au nom du religieux. Or la réalité est infiniment plus complexe. L’historien juge malhonnête, partial, d’invoquer le fanatisme catholique pour tenter de justifier l’intégrisme musulman. L’essayiste ne cède jamais à la facilité ni aux travers pratiques trop souvent croisés dans de nombreux ouvrages. Chercher les origines du problème dans les textes originels, c’est faire fausse route, dit par ailleurs Saber Mansouri. Il explique les représentations de l’islam et ses réalités au fil de l’espace-temps. Car le monde musulman, ce sont quinze siècles que l’on ne peut résumer à Ben Laden et à la burqa. Mansouri cite Mahmoud Darwich : « L’Histoire ne peut se réduire à une compensation de la géographie perdue. » Il combat l'emprise du théologico-politique. Et revient aux fondamentaux, en historien scrupuleux qui se méfie des discours hâtifs d’une « littérature journalistique » bâcleuse et speedée, comme des « orientalistes de bureau » qu’il déteste cordialement. Il effectue le voyage permanent entre l’hier et l’aujourd’hui sans être bêtement comparatiste (le monde « arabo-musulman » de 2010 n’est pas celui des Mille et une nuits), évite les pièges tentateurs que sont : l’anachronisme, le passéisme (nous fûmes), le victimisme (ils sont les responsables de notre malheur présent), ainsi que le complot (on complote contre nous). Autrement dit l’attirail paranoïaque sociologique que la dictature de l’image et sa médiocrité gluante nous donnent à bouffer à longueur de temps et à largeur d’écran. Il s'agit, on l'aura compris, d'un traité intelligent sur un sujet trop souvent mal traité. Ainsi Saber Mansouri s’attache-t-il à chaque page de son brillant essai, à « rendre présent l’islam comme objet d’étude et d’analyse. » Il illustre son propos de faits réels récents : l’affaire des caricatures parues dans un journal danois en 2005 (qui fut d’emblée politique et qui illustre la confusion fulgurante et donc dangereuse, du religieux et de l’idéologique). La place et le rôle de l’image dans la culture islamique (il rappelle, citant Julien Gracq, que les grandes religions monothéistes ont jeté l’Image au feu et n’ont gardé que le Livre). L’arrivée du Hamas au pouvoir et la récurrence de la question palestinienne (avec une terrible réalité : une autorité politique divisée entre deux frères ennemis ; Hamas et Fatah). Le 11 septembre (et les Croisades selon Bush, ou « le terrorisme comme carrière de l’empire américain
Saber Mansouri récidive. Après La Démocratie athénienne, une affaire d’oisifs ? (André Versaille) –lire ici même à la date du 15 avril dernier, voici L’Islam confisqué, manifeste pour un sujet libéré (Sindbad). Cet essai remet les pendules à l’heure et part posément en guerre contre le mal le plus banalisé du monde depuis l’aube de l’humanité : le préjugé. Le vite dit. Le caricatural. La confusion intellectuelle originelle. Sujet : l’islam. Auteur : un helléniste certes, mais d’abord un « immigré arabe choisi » (ainsi se présente-t-il). Cet intellectuel tunisien désormais inféodé à Saint-Germain-des-Prés, qui enseigne à l'Ecole pratique des hautes études, nous dit son agacement à propos de l’agglomération des genres, de l’auberge espagnole qu’est devenue le mot islam, et du mélange du religieux et du politique, surtout. Le sacré et le profane, le spirituel et le temporel, Dieu et ses représentants sur terre… Bref : il est ici question de la vision globalisante de l’islam comme d'une horrible théocratie qui brouille (c'est le moins qu'on puisse dire) la vision nécessairement claire des choses importantes du monde actuel. Et des dangers redoutables que cela engendre quotidiennement, dans la perception, dans la conscience, dans le discours et aussi dans les faits. Le racisme ordinaire comme le lynchage médiatique en sont deux exemples. Car le nœud du problème est là : l’islam désigne aussitôt dans l’inconscient collectif occidental, le terrorisme au nom du religieux. Or la réalité est infiniment plus complexe. L’historien juge malhonnête, partial, d’invoquer le fanatisme catholique pour tenter de justifier l’intégrisme musulman. L’essayiste ne cède jamais à la facilité ni aux travers pratiques trop souvent croisés dans de nombreux ouvrages. Chercher les origines du problème dans les textes originels, c’est faire fausse route, dit par ailleurs Saber Mansouri. Il explique les représentations de l’islam et ses réalités au fil de l’espace-temps. Car le monde musulman, ce sont quinze siècles que l’on ne peut résumer à Ben Laden et à la burqa. Mansouri cite Mahmoud Darwich : « L’Histoire ne peut se réduire à une compensation de la géographie perdue. » Il combat l'emprise du théologico-politique. Et revient aux fondamentaux, en historien scrupuleux qui se méfie des discours hâtifs d’une « littérature journalistique » bâcleuse et speedée, comme des « orientalistes de bureau » qu’il déteste cordialement. Il effectue le voyage permanent entre l’hier et l’aujourd’hui sans être bêtement comparatiste (le monde « arabo-musulman » de 2010 n’est pas celui des Mille et une nuits), évite les pièges tentateurs que sont : l’anachronisme, le passéisme (nous fûmes), le victimisme (ils sont les responsables de notre malheur présent), ainsi que le complot (on complote contre nous). Autrement dit l’attirail paranoïaque sociologique que la dictature de l’image et sa médiocrité gluante nous donnent à bouffer à longueur de temps et à largeur d’écran. Il s'agit, on l'aura compris, d'un traité intelligent sur un sujet trop souvent mal traité. Ainsi Saber Mansouri s’attache-t-il à chaque page de son brillant essai, à « rendre présent l’islam comme objet d’étude et d’analyse. » Il illustre son propos de faits réels récents : l’affaire des caricatures parues dans un journal danois en 2005 (qui fut d’emblée politique et qui illustre la confusion fulgurante et donc dangereuse, du religieux et de l’idéologique). La place et le rôle de l’image dans la culture islamique (il rappelle, citant Julien Gracq, que les grandes religions monothéistes ont jeté l’Image au feu et n’ont gardé que le Livre). L’arrivée du Hamas au pouvoir et la récurrence de la question palestinienne (avec une terrible réalité : une autorité politique divisée entre deux frères ennemis ; Hamas et Fatah). Le 11 septembre (et les Croisades selon Bush, ou « le terrorisme comme carrière de l’empire américain Christian Authier, auteur Stock/La Bleue, dont J'ai Lu vient de reprendre les deux premiers romans : Enterrement de vie de garçon et Les liens défaits, publie un texte très court, une sorte de tranche de jambon -mais c'est du pata negra, piqué par deux agrafes, publié aux éditions du Sandre à Paris, intitulé Callcut. Sous-titre : Boire pour se souvenir (au lieu de l'attendu boire pour oublier). Oun biyou!
Christian Authier, auteur Stock/La Bleue, dont J'ai Lu vient de reprendre les deux premiers romans : Enterrement de vie de garçon et Les liens défaits, publie un texte très court, une sorte de tranche de jambon -mais c'est du pata negra, piqué par deux agrafes, publié aux éditions du Sandre à Paris, intitulé Callcut. Sous-titre : Boire pour se souvenir (au lieu de l'attendu boire pour oublier). Oun biyou!

 Saber Mansouri : Remettre l’Athénien et l’autre – esclave, affranchi, étranger, métèque, femme – au travail et au cœur du jeu politique de la démocratie athénienne classique est sans doute une idée scandaleuse aux yeux de Platon, et des historiens modernes fascinés par la voix philosophique atemporelle du Maître, celui qui rédigea La République, Les Lois et Le Banquet. Et pourquoi ?
Saber Mansouri : Remettre l’Athénien et l’autre – esclave, affranchi, étranger, métèque, femme – au travail et au cœur du jeu politique de la démocratie athénienne classique est sans doute une idée scandaleuse aux yeux de Platon, et des historiens modernes fascinés par la voix philosophique atemporelle du Maître, celui qui rédigea La République, Les Lois et Le Banquet. Et pourquoi ? Un autre ami, Benoît Jeantet, publie Ne donnez pas à manger aux animaux au risque de modifier leur équilibre alimentaire (Atlantica). L’écriture de Jeantet crépite comme du feu de pin mêlé à du chêne. On dirait du Nougaro en ligne. Ca swingue à chaque page, car l’auteur jongle avec les mots. Ce saltimbanque de l’alphabet est un musicien et le stylo est son instrument. Sa phrase chante, rime et fait sens, et sous couvert de calembours à pleines fourches, Benoît nous dit cependant et surtout des choses fortes, des choses essentielles, intimes et indéfectibles. Le personnage du père, par exemple, de retour de la guerre d’Algérie, est flaulknérien, si je puis me permettre. (Et nous avons envie de goûter à son gâteau, lorsqu’il le sort du four…). Les descriptions sans concession pour la terre sans ânes de son enfance sont tendres comme le blé en herbe, et celles des personnages attachants comme le bûcheron Jocondo Cantoni, dit Fernando tréss caféss, ou Arezki, sont touchantes et sèches comme un démarrage de Motobécane dans la brume du matin paysan. En plus, Jeantet a son style propre : ses phrases sont les plus courtes du monde. Et même privées de verbe, elles contribuent à ce feu crépitant qui fait sa signature, en nous servant un coup à boire. Tchin, té!
Un autre ami, Benoît Jeantet, publie Ne donnez pas à manger aux animaux au risque de modifier leur équilibre alimentaire (Atlantica). L’écriture de Jeantet crépite comme du feu de pin mêlé à du chêne. On dirait du Nougaro en ligne. Ca swingue à chaque page, car l’auteur jongle avec les mots. Ce saltimbanque de l’alphabet est un musicien et le stylo est son instrument. Sa phrase chante, rime et fait sens, et sous couvert de calembours à pleines fourches, Benoît nous dit cependant et surtout des choses fortes, des choses essentielles, intimes et indéfectibles. Le personnage du père, par exemple, de retour de la guerre d’Algérie, est flaulknérien, si je puis me permettre. (Et nous avons envie de goûter à son gâteau, lorsqu’il le sort du four…). Les descriptions sans concession pour la terre sans ânes de son enfance sont tendres comme le blé en herbe, et celles des personnages attachants comme le bûcheron Jocondo Cantoni, dit Fernando tréss caféss, ou Arezki, sont touchantes et sèches comme un démarrage de Motobécane dans la brume du matin paysan. En plus, Jeantet a son style propre : ses phrases sont les plus courtes du monde. Et même privées de verbe, elles contribuent à ce feu crépitant qui fait sa signature, en nous servant un coup à boire. Tchin, té!
 toujours les messages de ses fans. Arthur Rimbaud n’aima guère les gens de Charleville, où il naquit en 1854, qui furent par conséquent peu nombreux à suivre la charrette qui portait sa dépouille jusqu’au cimetière de la ville, en 1891. Cependant Charleville entretient la mémoire juteuse d’Arthur. La grande librairie de la rue piétonne Pierre Bérégovoy s’appelle Rimbaud (La ville est encore épargnée par les grandes enseignes du genre). Au n°12 de cette rue, se trouve la maison natale du poète visionnaire. En face, il y a une bonne table de la ville et sa belle cave de vins à emporter, La table d’Arthur R. Passée la splendide place Ducale, sorte de mini-Place des Vosges parisienne, puisque ce sont deux frères architectes à l’inspiration partagée, qui érigèrent les deux : Clément Métezeau à Charleville et Louis à Paris, la même artère piétonne Bérégovoy conduit au Musée Rimbaud, au bord de la Meuse, au lieu et place du Vieux Moulin qui enjambe un bras de la Meuse et derrière laquelle la péniche restaurant La Bohême, offre un joli petit menu et propose des mini croisières jusqu’à Monthermé, situé à 20 km de là par la route.
toujours les messages de ses fans. Arthur Rimbaud n’aima guère les gens de Charleville, où il naquit en 1854, qui furent par conséquent peu nombreux à suivre la charrette qui portait sa dépouille jusqu’au cimetière de la ville, en 1891. Cependant Charleville entretient la mémoire juteuse d’Arthur. La grande librairie de la rue piétonne Pierre Bérégovoy s’appelle Rimbaud (La ville est encore épargnée par les grandes enseignes du genre). Au n°12 de cette rue, se trouve la maison natale du poète visionnaire. En face, il y a une bonne table de la ville et sa belle cave de vins à emporter, La table d’Arthur R. Passée la splendide place Ducale, sorte de mini-Place des Vosges parisienne, puisque ce sont deux frères architectes à l’inspiration partagée, qui érigèrent les deux : Clément Métezeau à Charleville et Louis à Paris, la même artère piétonne Bérégovoy conduit au Musée Rimbaud, au bord de la Meuse, au lieu et place du Vieux Moulin qui enjambe un bras de la Meuse et derrière laquelle la péniche restaurant La Bohême, offre un joli petit menu et propose des mini croisières jusqu’à Monthermé, situé à 20 km de là par la route. Uzerche, en Corrèze, est traversé par la Vézère. Simone de Beauvoir y passa son enfance. Ses « Mémoires d’une jeune fille rangée » (folio), ne préfigurent en rien l’auteur emblématique du « Deuxième sexe ». Nous y découvrons l’enfant, puis l’adolescente, qui fait l’apprentissage de la vie à la campagne. Simone dévore les livres et s’immerge dans la nature apprivoisée d’une province douce, découvre les champignons, les oiseaux, les arbres et des sensations sauvages que l’on dirait empruntées à Colette. Le « Castor passa de nombreux étés dans le Parc de Meyrignac, demeure de son grand-père, à Saint-Ybard. La ville d’Uzerche propose une balade courte qu’il est bon d’emprunter, depuis la Place de la Petite-Gare, les « Mémoires » en main, pour passer devant les deux propriétés familiales de la famille de Beauvoir, qui appartiennent encore à ses descendants et qui ne se visitent que sur demande. La seconde fut celle de sa tante. Le chemin est balisé sur 6 km à travers la Garenne de Puy-Grolier jusqu’au Pont-d’Espartignac, au lieu-dit Les Carderies. Il suffit alors de franchir un petit pont et de longer la Vézère pour ressentir, aux abords de la base de la Minoterie, où Simone se baignait avec sa sœur, les après-midi de grosse chaleur, les sensations de la jeune Simone : « Chez ma tante, comme chez mon grand-père, on me laissait courir en liberté sur les pelouses et je pouvais toucher à tout. (…) J’apprenais ce que n’enseignent ni les livres ni l’autorité. J’apprenais le bouton-d’or et le trèfle, le phlox sucré, le bleu fluorescent du volubilis, le papillon, la bête à bon Dieu, le ver luisant, la rosée, les toiles d’araignée et les fils de la Vierge ; j’apprenais que le rouge du houx est plus rouge que celui du laurier-cerise ou du sorbier, que l’automne dore les pêches et cuivre les feuillages ; que le soleil monte et descend dans le ciel sans qu’on ne le voie jamais bouger. » Après, il faut prendre la rue de l’Abreuvoir qui monte vers la ville ancienne et le charme de ses ruelles, pour retrouver le pont Turgot et revenir au point de départ. Là, et si l’on s’efforce de s’y rendre à la fraîche, nous ressentons « le premier des bonheurs » de Simone de Beauvoir, qui fut, « au petit matin, de surprendre le réveil des prairies ; un livre à la main, je quittais la maison endormie, je poussais la barrière ; impossible de m’asseoir dans l’herbe embuée de gelée blanche ; je marchais sur l’avenue, le long du pré planté d’arbres choisis que grand-père appelait le parc-paysage
Uzerche, en Corrèze, est traversé par la Vézère. Simone de Beauvoir y passa son enfance. Ses « Mémoires d’une jeune fille rangée » (folio), ne préfigurent en rien l’auteur emblématique du « Deuxième sexe ». Nous y découvrons l’enfant, puis l’adolescente, qui fait l’apprentissage de la vie à la campagne. Simone dévore les livres et s’immerge dans la nature apprivoisée d’une province douce, découvre les champignons, les oiseaux, les arbres et des sensations sauvages que l’on dirait empruntées à Colette. Le « Castor passa de nombreux étés dans le Parc de Meyrignac, demeure de son grand-père, à Saint-Ybard. La ville d’Uzerche propose une balade courte qu’il est bon d’emprunter, depuis la Place de la Petite-Gare, les « Mémoires » en main, pour passer devant les deux propriétés familiales de la famille de Beauvoir, qui appartiennent encore à ses descendants et qui ne se visitent que sur demande. La seconde fut celle de sa tante. Le chemin est balisé sur 6 km à travers la Garenne de Puy-Grolier jusqu’au Pont-d’Espartignac, au lieu-dit Les Carderies. Il suffit alors de franchir un petit pont et de longer la Vézère pour ressentir, aux abords de la base de la Minoterie, où Simone se baignait avec sa sœur, les après-midi de grosse chaleur, les sensations de la jeune Simone : « Chez ma tante, comme chez mon grand-père, on me laissait courir en liberté sur les pelouses et je pouvais toucher à tout. (…) J’apprenais ce que n’enseignent ni les livres ni l’autorité. J’apprenais le bouton-d’or et le trèfle, le phlox sucré, le bleu fluorescent du volubilis, le papillon, la bête à bon Dieu, le ver luisant, la rosée, les toiles d’araignée et les fils de la Vierge ; j’apprenais que le rouge du houx est plus rouge que celui du laurier-cerise ou du sorbier, que l’automne dore les pêches et cuivre les feuillages ; que le soleil monte et descend dans le ciel sans qu’on ne le voie jamais bouger. » Après, il faut prendre la rue de l’Abreuvoir qui monte vers la ville ancienne et le charme de ses ruelles, pour retrouver le pont Turgot et revenir au point de départ. Là, et si l’on s’efforce de s’y rendre à la fraîche, nous ressentons « le premier des bonheurs » de Simone de Beauvoir, qui fut, « au petit matin, de surprendre le réveil des prairies ; un livre à la main, je quittais la maison endormie, je poussais la barrière ; impossible de m’asseoir dans l’herbe embuée de gelée blanche ; je marchais sur l’avenue, le long du pré planté d’arbres choisis que grand-père appelait le parc-paysage  Colette vécut elle aussi en Corrèze à deux périodes de sa vie. De 1911 à 1923, lorsqu’elle fut l’épouse du baron Henri de Jouvenel des Ursins, au château de Castel Novel, là où elle se muait avec bonheur en fermière, architecte d’intérieur et en jardinière, puis au cours de l’été 1940, chez sa fille Colette de Jouvenel, surnommée Bel-Gazou, « fruit de la terre limousine », à Curemonte. Dans le maquis de son œuvre, il faut retenir les pages admirables des « Heures longues » pour savourer les descriptions que l’auteur de « Sido » fit de la campagne corrézienne. « Ici, dès l’arrivée, on sent le cours de la vie, ralenti, élargi, couler sans ride d’un bord à l’autre des longues journées. (…) Comme il resplendit, ce juillet limousin, aux yeux sevrés depuis trois ans de son azur, du vert, du rouge et de la terre sanguine ! Chaque heure fête tous les sens »… La communauté d’agglomération de Brive a ainsi créé en 2008 « Les jardins de Colette », un parc paysager de 4 ha qui retrace le parcours sensible de l’auteur. Situé à proximité du château de Castel Novel, nous y trouvons l’univers enchanteur d’un écrivain habité par le végétal, à travers plus de 10000 essences et 1200 arbres. Il y a le jardin de son enfance à Saint-Sauveur-en-Puisaye, les bois de Franche-Comté, la Bretagne de son amie Missy, la Provence de « La Treille-Muscate », à Saint-Tropez, le Palais-Royal de Paris et bien sûr la Corrèze de Varetz. (...) L.M.
Colette vécut elle aussi en Corrèze à deux périodes de sa vie. De 1911 à 1923, lorsqu’elle fut l’épouse du baron Henri de Jouvenel des Ursins, au château de Castel Novel, là où elle se muait avec bonheur en fermière, architecte d’intérieur et en jardinière, puis au cours de l’été 1940, chez sa fille Colette de Jouvenel, surnommée Bel-Gazou, « fruit de la terre limousine », à Curemonte. Dans le maquis de son œuvre, il faut retenir les pages admirables des « Heures longues » pour savourer les descriptions que l’auteur de « Sido » fit de la campagne corrézienne. « Ici, dès l’arrivée, on sent le cours de la vie, ralenti, élargi, couler sans ride d’un bord à l’autre des longues journées. (…) Comme il resplendit, ce juillet limousin, aux yeux sevrés depuis trois ans de son azur, du vert, du rouge et de la terre sanguine ! Chaque heure fête tous les sens »… La communauté d’agglomération de Brive a ainsi créé en 2008 « Les jardins de Colette », un parc paysager de 4 ha qui retrace le parcours sensible de l’auteur. Situé à proximité du château de Castel Novel, nous y trouvons l’univers enchanteur d’un écrivain habité par le végétal, à travers plus de 10000 essences et 1200 arbres. Il y a le jardin de son enfance à Saint-Sauveur-en-Puisaye, les bois de Franche-Comté, la Bretagne de son amie Missy, la Provence de « La Treille-Muscate », à Saint-Tropez, le Palais-Royal de Paris et bien sûr la Corrèze de Varetz. (...) L.M. Une importante exposition de l’artiste catalan : « Antoni Tapies. Les Lieux de l’art », accompagne une réouverture très attendue.
Une importante exposition de l’artiste catalan : « Antoni Tapies. Les Lieux de l’art », accompagne une réouverture très attendue.

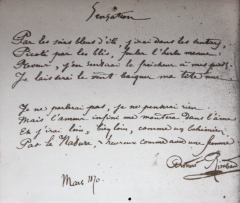
 embrasse les îles du Frioul et d'If, avec Marseille à tribord, les Calanques à babord, l'éternité à nom de femme dans les draps odo
embrasse les îles du Frioul et d'If, avec Marseille à tribord, les Calanques à babord, l'éternité à nom de femme dans les draps odo Plus ça va (zambrek, soit mal) dans ce monde et plus j'ai envie de montrer du doigt les dégâts incalculables de cette secte qui a prosperé, comme la nomme Michel Onfray dans Le souci des plaisirs. Construction d'une érotique solaire (J'ai Lu) : le Christianisme.
Plus ça va (zambrek, soit mal) dans ce monde et plus j'ai envie de montrer du doigt les dégâts incalculables de cette secte qui a prosperé, comme la nomme Michel Onfray dans Le souci des plaisirs. Construction d'une érotique solaire (J'ai Lu) : le Christianisme. Comme un bol d'air pur en pleine grisaille, ses photos ont la grâce du dénuement ingénu d'un regard d'enfant surpris en train de jouer dans sa chambre.
Comme un bol d'air pur en pleine grisaille, ses photos ont la grâce du dénuement ingénu d'un regard d'enfant surpris en train de jouer dans sa chambre.



 fresques de quinze mètres de long, aux lourdes et imposantes sculptures en bronze, la conduite à distance des travaux de renaissance de la « domus » fut pour l’artiste une jubilation permanente. « Bien sûr, les travaux ont été confiés à un architecte Bayonnais de renom, Patrick Arotcharen et à un maçon exceptionnel qui a pratiquement construit la maison tout seul, Alain Lemonnier, mais j’ai infléchi les actes au fur et à mesure de leur apparition. » Lydie considère qu’il est indispensable d’habiter une maison en chantier. Assister chaque coup de pelle, tout accompagner, épauler sans jamais conduire les travaux, apporter les touches nécessaires à l’harmonie des goûts fut une aventure formidable pour la famille. Lydie se souvient de cette période de camping sauvage dans un chantier sans fenêtres, sans toit un temps, des intempéries, des difficultés tournées en dérision, comme d’une expérience créative et de plein contact avec la matière de ce qui devenait, au fil du temps, la maison du bonheur. Une telle « performance » -il n’y a pas d’autre mot lorsqu’il s’agit de la maison d’un couple d’artistes, est un incessant ballet de réajustements, un flux constant de personnalisation, de mise en adéquation, de projection dans un quotidien que l’on souhaite parfaitement adapté, sur mesure, fondu enchaîné, souple, en écho à soi-même.
fresques de quinze mètres de long, aux lourdes et imposantes sculptures en bronze, la conduite à distance des travaux de renaissance de la « domus » fut pour l’artiste une jubilation permanente. « Bien sûr, les travaux ont été confiés à un architecte Bayonnais de renom, Patrick Arotcharen et à un maçon exceptionnel qui a pratiquement construit la maison tout seul, Alain Lemonnier, mais j’ai infléchi les actes au fur et à mesure de leur apparition. » Lydie considère qu’il est indispensable d’habiter une maison en chantier. Assister chaque coup de pelle, tout accompagner, épauler sans jamais conduire les travaux, apporter les touches nécessaires à l’harmonie des goûts fut une aventure formidable pour la famille. Lydie se souvient de cette période de camping sauvage dans un chantier sans fenêtres, sans toit un temps, des intempéries, des difficultés tournées en dérision, comme d’une expérience créative et de plein contact avec la matière de ce qui devenait, au fil du temps, la maison du bonheur. Une telle « performance » -il n’y a pas d’autre mot lorsqu’il s’agit de la maison d’un couple d’artistes, est un incessant ballet de réajustements, un flux constant de personnalisation, de mise en adéquation, de projection dans un quotidien que l’on souhaite parfaitement adapté, sur mesure, fondu enchaîné, souple, en écho à soi-même.

 travers. Ainsi, la nature est omniprésente, puisqu’on peut l’admirer de n’importe quel endroit de cette grande maison aux multiples prolongements et recoins. « Notre maison est devenue en moins de cinq années, une maison de rencontre qui marche beaucoup à l’instinct. Chacun s’y sent libre, y évolue tout de suite sans crainte, naturellement. Qu’il s’agisse de la famille, des amis proches et fréquemment présents, ou bien d’amis de passage, de rencontres nouvelles. Et c’est un grand bonheur de s’apercevoir de cela, que cette connivence entre le lieu et l’Autre opère facilement. C’est magique et ce n’est pas un hasard. » Pour Lydie comme pour Alex, leur maison est le reflet de leur « posture de vie », de leur attitude face à la vie. « La maison parle d’ailleurs pour nous, enchérit-elle, et la refaire complètement m’a considérablement ouverte. Nous sommes, elle et moi, entièrement tournées vers la lumière. » L’atelier de l’artiste, où elle se rend chaque jour avec Alex, est l’ancienne usine de son père, où étaient fabriqués des socles en béton pour compteurs électriques. Elle est au bout d’un chemin, sur la propriété, et il s’agit d’un espace gigantesque, à la mesure des travaux de Lydie, avec une partie dédiée à la peinture, et une autre à la sculpture. Une hauteur sous plafond de cathédrale –une chance, eu égard à la production incessante de l’artiste-, permet de stocker toiles, dessins et sculptures. « Prendre ce chemin à pied m’est une respiration indispensable. Il me
travers. Ainsi, la nature est omniprésente, puisqu’on peut l’admirer de n’importe quel endroit de cette grande maison aux multiples prolongements et recoins. « Notre maison est devenue en moins de cinq années, une maison de rencontre qui marche beaucoup à l’instinct. Chacun s’y sent libre, y évolue tout de suite sans crainte, naturellement. Qu’il s’agisse de la famille, des amis proches et fréquemment présents, ou bien d’amis de passage, de rencontres nouvelles. Et c’est un grand bonheur de s’apercevoir de cela, que cette connivence entre le lieu et l’Autre opère facilement. C’est magique et ce n’est pas un hasard. » Pour Lydie comme pour Alex, leur maison est le reflet de leur « posture de vie », de leur attitude face à la vie. « La maison parle d’ailleurs pour nous, enchérit-elle, et la refaire complètement m’a considérablement ouverte. Nous sommes, elle et moi, entièrement tournées vers la lumière. » L’atelier de l’artiste, où elle se rend chaque jour avec Alex, est l’ancienne usine de son père, où étaient fabriqués des socles en béton pour compteurs électriques. Elle est au bout d’un chemin, sur la propriété, et il s’agit d’un espace gigantesque, à la mesure des travaux de Lydie, avec une partie dédiée à la peinture, et une autre à la sculpture. Une hauteur sous plafond de cathédrale –une chance, eu égard à la production incessante de l’artiste-, permet de stocker toiles, dessins et sculptures. « Prendre ce chemin à pied m’est une respiration indispensable. Il me















 Il n'était pas connu hors de ses frontières parce que celles-ci n'existaient pas. Mais à Bayonne tout le monde le connaissait.
Il n'était pas connu hors de ses frontières parce que celles-ci n'existaient pas. Mais à Bayonne tout le monde le connaissait.

 Un quasi inédit de Camus, ça ne court plus les rues. La plaquette, un grand et beau format paru confidentiellement à 120 exemplaires, en 1965, reparaît ces jours-ci chez Gallimard. Il s'agit de splendides photos en noir & blanc de Henriette Grindat, d'aphorismes cinglants comme des haïkus, d'Albert Camus, et d'une postface ainsi que d'un poème, De moment en moment, de René Char, son ami. L'ensemble est magnifique et s'intitule La postérité du soleil. Je me le suis offert ce matin, et l'ai aussitôt dégusté, avec un armagnac de Laubade 1966 et un cigare Navarre. L'équation du bonheur, un dimanche après-midi maussade de fin novembre. Les photos montrent la région natale de Char et choisie de Camus : l'Isle-sur-Sorgue, la Sorgue, les Névons, le Thor, Lagnes, Calavon, Fontaine-de-Vaucluse... Des paysages si souvent présents dans l'oeuvre de René Char, ainsi que dans les Carnets d'Albert Camus. Il y a aussi trois portraits, dont celui d'Henri Curel. La vérité a un visage d'homme... C'est avant tout un livre qui respire l'amitié des deux écrivains. Le paysage comme l'amitié, est notre rivière souterraine. Paysage sans pays, écrivit Char à Camus.
Un quasi inédit de Camus, ça ne court plus les rues. La plaquette, un grand et beau format paru confidentiellement à 120 exemplaires, en 1965, reparaît ces jours-ci chez Gallimard. Il s'agit de splendides photos en noir & blanc de Henriette Grindat, d'aphorismes cinglants comme des haïkus, d'Albert Camus, et d'une postface ainsi que d'un poème, De moment en moment, de René Char, son ami. L'ensemble est magnifique et s'intitule La postérité du soleil. Je me le suis offert ce matin, et l'ai aussitôt dégusté, avec un armagnac de Laubade 1966 et un cigare Navarre. L'équation du bonheur, un dimanche après-midi maussade de fin novembre. Les photos montrent la région natale de Char et choisie de Camus : l'Isle-sur-Sorgue, la Sorgue, les Névons, le Thor, Lagnes, Calavon, Fontaine-de-Vaucluse... Des paysages si souvent présents dans l'oeuvre de René Char, ainsi que dans les Carnets d'Albert Camus. Il y a aussi trois portraits, dont celui d'Henri Curel. La vérité a un visage d'homme... C'est avant tout un livre qui respire l'amitié des deux écrivains. Le paysage comme l'amitié, est notre rivière souterraine. Paysage sans pays, écrivit Char à Camus.
 Je signais hier matin Lacs et barrages des Pyrénées à Bagnères-de-Bigorre, en compagnie de mon co-auteur, Philippe Lhez, aquarelliste de grand talent. Nous étions à la librairie Au pied de Pyrène, chez Marc Besson. Un grand bonheur, simple et amical.
Je signais hier matin Lacs et barrages des Pyrénées à Bagnères-de-Bigorre, en compagnie de mon co-auteur, Philippe Lhez, aquarelliste de grand talent. Nous étions à la librairie Au pied de Pyrène, chez Marc Besson. Un grand bonheur, simple et amical.
