Salon du livre d'Hossegor

J'y serai le samedi 5 pour y signer mes derniers ouvrages. Venez nombreux.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

J'y serai le samedi 5 pour y signer mes derniers ouvrages. Venez nombreux.
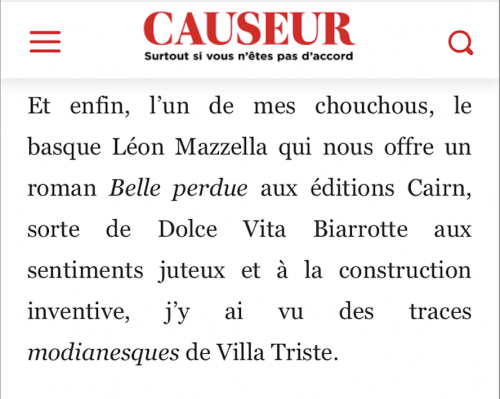
L'avais-je signalé ici ou seulement sur les réseaux sociaux que j'ai abandonnés?.. Cette comparaison audacieuse de Thomas Morales entre mon très modeste Belle perdue et Villa triste de l'immense Modiano est évidemment disproportionnée. Mais, bon, je retombe là-dessus, alors je le colle là.
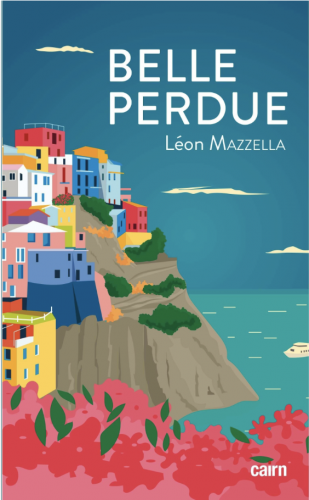
GREGUERÍAS
Grâce soit à nouveau rendue à Valery Larbaud d’avoir découvert Ramón Gomez de la Serna en 1917 pour le lecteur français. Nous tenons Le Torero Caracho pour le meilleur roman ayant la corrida pour thème, La Femme d’ambre comme celui qui évoque Naples la vénéneuse avec le plus de subtilité, Seins pour le livre le plus sensuel, le plus drôle, le plus abouti – 300 pages - sur le sujet, et son chef d’œuvre, Automoribundia, l'autobiographie de l'auteur (lire plus bas) pour un énorme livre-vie inclassable, et enfin Greguerías (le terme : humour+métaphore, « l'une de mes cendres quotidiennes », « oeillet sur le mur », disait lui-même l'inventeur de ce trait poétique), comme le recueil de micro-fragments le plus agréable à lire (éditions Cent pages), autant que le Journal de Jules Renard et les Carnets de Cioran, en plus humoristique.
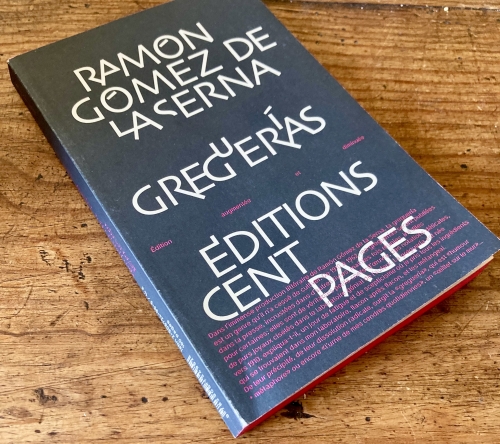
Je tape dedans au hasard afin que celle ou celui qui ne connaît pas encore le plaisir de lire Ramón ressente son ça : « Le poète se nourrit de croissants de lune. » « Les épis de blé chatouillent le vent. » « Il devrait exister des jumelles olfactives pour percevoir le parfum des jardins lointains. » « Le glaçon tinte dans le verre comme un grelot de cristal au cou du whisky. » « Le brouillard finit en haillons. » « L’âme quitte le corps comme s’il s’agissait d’une chemise intérieure dont le jour de lessive est venu. » « Le bon écrivain ne sait jamais s’il sait écrire. » « Lorsque le cygne plonge son cou dans l’eau, on dirait un bras de femme cherchant une bague au fond de la baignoire. » « Accroupies à l’ombre de l’arbre qui se trouve au milieu de la plaine, les idées du paysage tiennent salon. » « L’épouvantail a une allure d’espion fusillé. » « Les jours de vent, les joncs ont cours d’escrime. » « La migraine est cette femme pénible qu’on ne veut pas recevoir, mais qui se glisse chez vous en disant : Je sais que vous êtes là. »
AUTOMORIBUNDIA (1888-1948)
L’énorme, l’immense autobiographie, ces « mémoires d’un moribond » selon leur auteur lui-même, Ramón Gómez de la Serna (1888-1963), est un de ces livres si rares qu’on les compte sur les doigts au cours d’un siècle de littérature européenne. Larbaud comparait Ramón à Joyce et à Proust. Pas moins. Il y a aussi des accents borgésiens dans cet œuvre richissime, touche à tous les genres, et nous pouvons penser au Journal de Henri-Frédéric Amiel, ainsi qu’au Livre de l’intranquillité de Fernando Pessoa ; et aux accents toniques et désenchantés de José Bergamín lorsqu’il évoque le toreo dans L’art de Birlibirloque, et dans La solitude sonore du toreo. Des chefs-d’œuvre, donc. La prose de Ramón (ainsi le désigne-t-on d’ordinaire, lors que son patronyme signifie Seigneur de la terre. Gómez : seigneur, et Serna : la terre, précise l’auteur page 47), est envoûtante comme un arc-en-ciel, volumineuse comme une houle, elle vous piège, vous hypnotise et ne vous lâche pas. Nous sommes tentés de faire des sauts de pages pour aller voir plus loin, renifler l’air à deux ou trois chapitres de là, et puis nous revenons scrupuleusement là où nous avions suspendu notre lecture. Automoribundia (*) happe. Chaque événement, petit ou grand, de l’existence de Ramón depuis sa naissance « le 3 juillet 1888, à sept heures et vingt minutes du soir, à Madrid, rue de las Rejas, numéro 5, deuxième étage », nous est conté. Mais jamais amplifié.
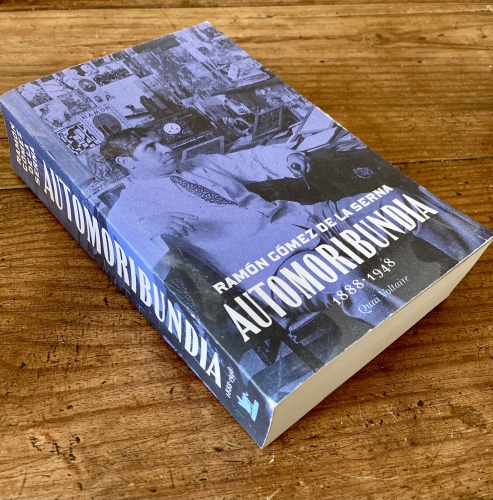
Proustien
Nul narcissisme dans ces 1040 pages. Juste une préoccupation du mot, de l’émotion de l’instant retranscrit (le côté proustien), du lyrisme aussi dans les descriptions des personnages, nombreux, des paysages urbains, souvent intérieurs, des âges de la vie, des sensations fugitives a priori insignifiantes, mais qui font littérature sous le regard, puis la plume d’un écrivain sagace et percutant comme Ramón. « Je ne lésine pas sur les détails (...) Je crois à tout ce que je dis, je ne passe sous silence aucun secret », précise l’auteur dans son Prologue. D’ailleurs, page 36, soit la seconde du chapitre premier, nous lisons le geste de révolte fondateur, « Mon premier acte sur terre fut de faire pipi... ». Nous l’attendions, ce livre publié pour la première fois à Buenos-Aires en 1948. Quelques éditeurs téméraires, au premier rang desquels André Dimanche, avait commencé d’entreprendre la traduction de l’œuvre protéiforme de l’auteur. Il y eut Seins, Le Torero Caracho, Greguerías, La Femme d’ambre (nos préférés), dix-huit autres, mais toujours pas son œuvre maitresse, dont les louanges étaient chuchotées ici et là pas nos amis hispanophones qui nous narguaient car ils l’avaient lu, ce pavé lourd des bonheurs de lecture qu'il procure avec générosité. Un exemple entre cent. Le chapitre V, « Aventure des cartouches et des mûres », est une sorte de nouvelle très proustienne en l’occurrence, à propos d’un jeu consistant à emplir de mûres des douilles laissées par des chasseurs, et auquel se livrent deux enfants, dont une fille et l’auteur, en compagnie du père de ce dernier. Extrait : « Je me rappelle que pendant le trajet nous restâmes silencieux et que j’appris ce jour-là ce qu’était la séduction féminine, son influence sur l’attention et sur la mécanique, incitant à introduire des mûres vivantes, mélange d’encre et de sang sur les doigts, dans des cartouches mortes, et à savourer de temps en temps le fruit sombre couleur de lèvres au goût de confiture. Plus tard, j’ai découvert les buissons fleuris des ronciers, où la mûre est un bouton au gilet de la nature, mais ces gros fruits du mûrier, dans le mystère de l’après-midi où riait sans relâche la femme tentatrice de l’homme prudent, celles-là, ah ! je ne les retrouverai jamais, sans cesser pourtant de les chercher toujours. » Avec Ramón, un rien fait texte, et c’est là la signature du véritable écrivain, faux diariste et vrai prosateur.
Il fait mouche
Que sa tante Milagros se lave les cheveux, que ses cousines Lola et Teresa sortent du couvent où elles étaient pensionnaires, qu’il résume l’année 1900 par les événements marquants (mort de Ruskin, et de Nietzsche notamment), les collèges castillans de Palencia et de Frechilla qui lui permirent de recevoir la « sur-lumière » dont a besoin, pour parler avec aisance, le jeune homme de retour à Madrid, qu’il évoque dans cette grande ville les heures chaudes recevant « leur afflux de sang optimiste », Ramón possède le talent incessant d’orner et piquer ses pages de formules qui font mouche, de touches, de notes pointues, « À la cuisine on jette des miettes dans le gazpacho, comme on jetterait du concombre aux poissons dans leur bocal », et le feuilletage aléatoire d’Automoribundia en devient un plaisir de cueilleur, de lecteur d’aphorismes gardant donc un doigt en guise de marque-page là où la lecture a été suspendue. Récréation. Ainsi du sablier acquis par le père de l’auteur, afin de savoir comment il dépensait ses heures, devenant, passé au prisme de la prose, le consciencieux contrôleur du temps familial, un personnage supplémentaire, et c’est prodigieux. Le jour du couronnement d’Alphonse XIII à sa majorité en 1902, Ramón note que « les feuilles des marronniers étaient plus grandes que d’habitude ». Au sujet de l’adolescence, son regard autocritique et dérisoire résume l’affaire, « c’est une chose barbare, c’est manger des yeux les gambas crues qu’on voit dans les poissonneries, vouloir chasser les ours blancs des vitrines des fourreurs, réclamer un journal qui ne se vend pas et qu’on ne trouve pas dans les kiosques, craindre de perdre la tête et croire qu’une belle femme pure et libre va nous arrêter dans la rue pour nous avouer qu’elle nous adore. » Et le lecteur, là, adore l’auteur de ces lignes-là. Nous n’en sommes qu’à la page 222 et nous nous pourléchons les babines, sachant que nous en avons 750 sous le coude.
Les pages de la maturité
Lorsque Ramón raconte qu’il devient un « monomaniaque littéraire », les pages de ce livre fleuve prennent une autre consistance. Nous cheminons, autobiographie chronologique oblige, aux côtés d’un personnage que nous voyons grandir, changer, mûrir, publier trop tôt à son goût – à seize ans - son premier livre, Entrant dans le feu. Un (petit) four. Ramón aura l’élégance de ne pas faire de la disparition de sa mère une contribution au genre littéraire dédié. Une phrase est à retenir sur le motif, « Ma mère était maintenant dans un tombeau, j’avais une mère dans la mort, la mort était maintenant ma mère. » Le talent. Il devient avocat à Oviedo, rencontre des femmes, publie dans les revues littéraires en vogue, gagne Paris où il s’émerveille de tout deux années durant, « j’apprends que, sur les ponts, les réverbères possèdent une monocle rouge afin que les bateaux ôtent le haut de forme de leur cheminée quand ils passent dessous », il voyage en Angleterre, en Italie, en Suisse, regagne Madrid, se lie d’amitié avec les écrivains en vue, devient leur coqueluche, sa revue Prometeo est emblématique, le Café de Pombo où il réunit ce que Madrid et donc l’Espagne compte d’intelligence et de subtilité, sera le salon des débats littéraires qui comptent, et où il écrit fréquemment « face à l’un des miroirs ». Ramón découvre le Portugal en 1915, s’émerveille et revient « pétri de saudades ».
Livre-monstre
Larbaud surgit, traduit en français quelques Greguerías, sous le titre Echantillons, dans Les Cahiers Verts. Et nous n’allons pas raconter ici la vie de ce géant des lettres espagnoles qui prétendait que « on est dans la vie un triste noceur de la mort », puisque son autobiographie moribonde s’achève lorsqu’il a soixante ans. Mais les pages sur le chalet qu’il fait construire à Estoril, au Portugal, celles consacrées à Naples, « lieu d’élection pour vivre et mourir », ville qu’il adorera sans limites, les notes et impressions sur les femmes qui traversent son existence, y compris cette énigmatique poupée de cire, sans parler de sa femme Luisa Sofovich, avec laquelle il s’exilera en Argentine en 1936, et où Ramón mourra en 1963, sont autant de visages d’une œuvre foisonnante, dans laquelle – et c’est sa précieuse singularité, aucune phrase n’est laissée au hasard, tant dans sa forme scrupuleusement écrite que par son sens. Tout ceci bouleverse durablement. Ainsi, la densité rarissime de ces mille et quelques pages font d’Automoribundia un livre exceptionnel, « un livre-monstre », avance sa traductrice dans la postface. Un livre de chevet écrit par un artiste, soit « celui qui ne réalise pas ses rêves », mais dont la vie fut bien remplie, et résumée ainsi par son auteur, « Mon triomphe, c’est de m’être dissimulé sans cesser d’apparaître ». Un livre-clé, enfin, auquel nous reviendrons souvent, comme nous retournons inlassablement à Montaigne, à Proust, à Jules Renard. L.M.
------
(*) Admirablement traduit par Catherine Vasseur, éditions Quai Voltaire/La Table Ronde, 34€. Nombreuses illustrations. Nous saluons derechef la prouesse éditoriale de l’équipe d’Alice Déon pour la réalisation d'un livre qui marquera l'édition.
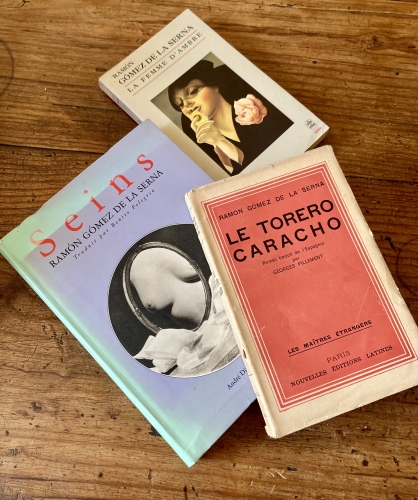
Un pan assez long de cet hommage ayant étrangement disparu de Kallyvasco à la date du 2 octobre 2020, je le re publie aujourd'hui.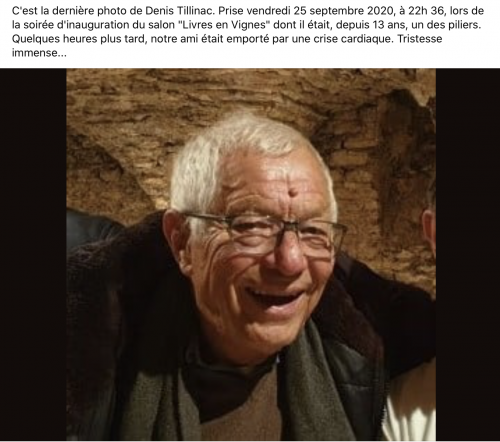
Évoquer Denis Tillinac, qui vient de nous quitter parce que son cœur sans filtre l’a lâché dans la nuit du 25 au 26 septembre au Clos de Vougeot – quelle élégance du destin -, serait ajouter ici ce que tout le monde a déjà écrit : une belle et solide « nécro » bien ficelée à la manière d’un rôti dominical. Il y serait question des mêmes choses aux mêmes paragraphes. La Corrèze contre le Zambèze, Chirac et les Hussards, la presse de droite et l’édition, le rugby et la clope, l’amitié mousquetaire et la rue de l’Odéon... Je choisis, dussé-je regretter d'ores et déjà de me mettre en avant par ricochet en évoquant ce que j’ai vécu à ses côtés, de rassembler quelques bons souvenirs qui, à mes yeux, résument à leur façon le caractère de Denis. Nous nous étions perdus de vue depuis des années, mais pas de vie. Il vient de perdre la vie. Voici mon point de vue. Que l’on me pardonne ce parti-pris impudique.
-------
... et il me lance pousse toi, je prends le volant. Je l’avais cueilli à la gare de Bordeaux Saint-Jean et nous nous rendions à la réunion annuelle des Amis de Valery Larbaud, à Vichy, association dont nous étions membres cotisants inactifs. En réalité, la raison officielle fut ainsi formulée : on va boire une coupe de champagne au Casino de Vichy, et après on verra. Le soleil brillait en baissant et le pare-soleil de la voiture tombait lentement en chuintant. Au lieu de le remonter, il l’arracha d’un geste sec. Puis lorgna le mien, et l’arracha aussi. Jeta les deux en arrière, sans regarder. Il mit le chauffage à fond, lors que la température était plutôt clémente. J’ai froid, dit-il en allumant la huitième ou sixième cigarette depuis dix minutes. Il péta. Et re-péta. Et encore et encore. J’ouvris ma fenêtre. Il hurla ferme, j’ai froid. Il péta et fuma encore tant et plus, un « fog » aux relents d’arrêt à Facture du train Bordeaux-Bayonne, ou de traversée de Lacq via Mourenx, du temps des colonnes ELF rouge et blanc et de leur fumée sentant l’œuf pourri, envahissaient l’habitacle de ma Golf noire (*). Je hurlai ma désapprobation et la liberté de mon sens olfactif. Rien à foutre. J’ai froid. Voici Denis le « caractériel ». Notre côté ours en partage nous unît très vite. J’aurais pu faire pareil, un jour de mauvaise lune. Ce qui me surprit de prime abord, fut d'entendre l'expression désuète Plait-il? lorsqu'il entendait mal un mot (au lieu d'un banal Quoi?, Hein? ou encore Pardon?). Cela tranchait tellement avec l'allure trapue et bourrue du personnage. J'ai hérité de ce tic verbal, ce qui ne manque jamais de surprendre mon entourage... Parvenus à Vichy, nous vidâmes plusieurs coupes de Brut au Casino afin de tenir parole, avant de rejoindre la bande d’écrivains présents autour de Monique Kuntz, cheville ouvrière de l'association. Je me souviens de Bernard Delvaille, Robert Mallet, Georges-Emmanuel Clancier, Louis Calaferte... On s’y ennuya vite, alors nous filèrent à l’anglaise et éclatâmes de rire sur le perron, retrouvant notre liberté de gamins faisant le mur et l'école buissonnière. Denis me confia qu’il n’aimait guère les écrivains professionnels, et qu’il préférait de loin ceux qui, comme certains Américains, avaient les mains dans le cambouis, qui sont camionneurs, agriculteurs, mécanos, et qui écrivent aussi (de merveilleux livres).
En 1984, journaliste de 26 ans officiant à Pyrénées-Presse, à Pau (La République des Pyrénées et Éclair Pyrénées), je publie un article sur son « Spleen en Corrèze », intitulé « La mélancolie du localier », qui lui parvient via le service de presse des éditions Robert Laffont. Il m’appelle au journal, me propose un rendez-vous au Noailles, brasserie bordelaise mythique des Allées Tourny, afin de faire connaissance. Je m’y rends, la sole meunière et le vin des graves de Pessac-Léognan nous ravissent, la conversation fuse, plus ou moins aérienne, littéraire, hussarde, on rigole, il gueule, nous sifflons des gorgeons, il fume comme une caserne de pompiers, je grille un ou deux havanes, le serveur iconique, goitreux et bedonnant dont j’ai oublié le prénom nous offre des huîtres en guise de dessert, une amitié naît spontanément. Le déjeuner s’achève aux alentours de 17 h, après avoir fait le tour de nos connaissances communes, avoir dit du mal de la moitié d’entre elles, et infiniment de bien du tiers. Il faut tenir jusqu’à l’heure de l’apéro, pris dans la grotte du Castan, sur les quais de Garonne, à l’entrée du quartier Saint-Pierre. Nous tenons ferme. Puis, nous nous appelons régulièrement, nous nous revoyons, je passe une semaine à Tulle, on monte chaque matin à Auriac, où nous travaillons à mon futur premier roman, « Chasses furtives ». Dans la maison de Tulle, au-dessus de la pharmacie, il m’enferme dans la pièce où il acheva son « Mystère Simenon », me disant qu’il ne se lavait alors plus, qu’il se nourrissait à peine, et que son slip, s’il me l’avait jeté à la figure, m’aurait coupé la tête. Denis... Je me voyais comme Antoine Blondin séquestré par Roland Laudenbach dans une chambre d’hôtel, mais sans les feuillets à passer sous la porte en échange d’une bouteille de rouge... Monique, la sainte femme de Denis, pharmacienne sur la place, « femme de peu », comme il la nommait avec un respect dix-septiémiste en lisant à voix haute le Journal de Samuel Pepys, et tout en me commandant de relire Mauriac plus attentivement (il m’avait offert à Barbezieux le premier tome de ses romans en Pléiade), figurait la permanence, le pilier central, l’abnégation, le mur porteur. Une perle fine et rare.
Il y a le Denis qui, m’attendant à son tour, plus tard, gare Saint-Jean, s’étant garé sur la voie des taxis, s’était vu conspuer par la profession. En guise de réponse, il avait sorti un cric ou une manivelle et menaçait de fracasser le crâne du premier venu. Par bonheur, je surgissais et calmais le jeu en arrondissant les angles in extremis. Une virée surréaliste s’ensuivit, qui eut pour but imbécile de trouver l’appartement genevois où vécût Lénine. Un type dont on se fichait bien. Et nous voici sur les routes conduisant à la Suisse, échouant bien évidemment à trouver le local, mais vidant des bouteilles de Fendant en savourant des filets de perche dans une auberge chaleureuse, avec feu de cheminée, du Vieux Genève, recommandée à Denis depuis une cabine téléphonique par Gilles Pudlowski. Ronds comme des queues de pelle, nous échouâmes également à retrouver le ticket de parking souterrain. Qu’à cela ne tint, je tordis la barrière métallique qui empêchait la sortie, manquant de me faire un tour de reins, et la voiture put se frayer un étroit passage au prix de généreuses rayures qui provoquèrent un immense éclat de rire à Denis. Nous ne savions alors pas, non plus, comment regagner notre hôtel. Le lendemain (puisque nous parvînmes cependant à dormir sur une couche accorte), pari fut lancé de nous rendre à l’aéroport helvète, d’abandonner l’automobile et de prendre le premier vol annoncé au départ, qu’il fut à destination de Lausanne, de Mars ou de Hong-Kong. J’avoue ne plus me souvenir pourquoi nous restâmes dans l’aérogare. Pourtant, ni Monique, ni Sophie, ma future épouse et mère de mes deux enfants, ne nous enjoignirent de regagner notre bercail en claquant dans leurs doigts délicats, ce que nous n’aurions d’ailleurs sûrement pas fait. Aucune contrainte matérielle, professionnelle ne pouvait alors nous faire renoncer à quoi que ce soit. Je ne me souviens plus, et c’est dommage. Encore que. Quelle importance ! Reste cette envie de se barrer n’importe où, pourvu qu’on ait l’ivresse du départ, qui lui chevillait, serré, le corps et l’âme. Denis, quoi. Je crois que c’est cette fois-là que nous avons pris la route de la Dombes. Pas sûr. Comment vérifier à présent. Peine perdue. Denis avait la bougeotte.
Parfois, il y avait un coup de fil lapidaire lancé depuis Auriac. Cette fois, c’était depuis Paris. Tu fais quoi ? - Pas grand-chose, je rédige des articles à droite à gauche, pourquoi ? Viens, il y a des sacs postaux de manuscrits en souffrance rue du Bac. Je viens tout juste de reprendre La Table Ronde. Je n’y arriverai pas tout seul, enfin j’ai des femmes autour de moi, mais viens. Saute dans un train, je te raconterai, on va bosser ensemble. L’aventure LTR commença. Deux jours a minima par semaine, je laissais Bordeaux et devenais plus ou moins responsable du service des manuscrits des mythiques éditions de La Table Ronde sises encore au 40, rue du Bac. Stéphane Guibourgé me rejoignit bientôt et on se marrait bien tous les deux, mais notre présence alternait souvent, notre emploi du temps respectif étant aussi élastique qu'une paire de chaussettes fatiguées ou qu'un zlip comme on dit chez moi (Bayonne). C'est d'ailleurs Stéphane qui assista à l'accouchement douloureux des « Mémoires d'un jeune homme dérangé », premier roman de Frédéric Beigbeder. Denis, déjà happé par Jacques Chirac, la francophonie, l’Afrique bientôt, la rédaction de discours, la Corrèze qui le rappelait à la mi-semaine, Marie-Thérèse Caloni avec laquelle il s’enfermait des heures entières dans l’ancien bureau de Laudenbach pour relancer la splendide et juteuse collection étrangère Quai Voltaire, et sans aucun doute afin d’explorer au passage des chemins érotiques buissonniers (Laurence Caracalla, qui avait alors en charge le Service de Presse, ne me contredira pas et fermera ses yeux doux sur le motif), me laissait le champ tellement libre que, parfois, j’étais le comité de lecture à moi tout seul. Allo Denis ! Je tiens un truc, là, c’est très bon. Enfin un manuscrit qui sort du lot (j’en renvoyais une pelletée par jour avec des lettres-type néanmoins personnalisées). Bloque, dit-il. Mais... Il faut que tu le lises. Bloque je te dis. J’ai confiance. Je venais de me mettre en arrêt comme un setter irlandais devant une bécasse, devant celle qui devint la cinquième auteure la plus lue en France de nos jours. J’ai nommé Françoise Bourdin. Jointe au fil, elle me dit que Actes Sud prenait aussi son roman, « Sang et or ». J’insistai. J’eus gain de cause. Nous le publiâmes. J’étais heureux. Je la rencontrai au cours de la Feria de Nîmes, contrat en poche à faire signer. Depuis, elle fait la carrière que nous savons chez Belfond. Pressé, caractériel, impatient, manquant parfois de vigilance, séduisant pour cela, et puis cette fougue, ces emportements immatériels, son urgence à filer au stade pour ne pas rater le coup d’envoi d’un match, et surtout le Capitole qui le ramenait sur ses terres viscérales, ainsi était Denis. À La Table Ronde, arrachée de son adresse historique, je le suivis rue Huysmans, puis rue Stanislas je crois, puis j’y retournais, rue Corneille, LTR déménagea si souvent. Denis avait transmis sa frousse de l'immobilité, sa nervosité, aux meubles et aux archives. Il fallait que ça bouge, que ça swingue. Denis, quoi... Et puis, à l’automne 1992, un boulot de rédacteur en chef de Pyrénées magazine me fut proposé à Toulouse au moment même – pile-poil -, où Denis me confia, au comptoir du Danton, Carrefour de l’Odéon, où nous avions nos habitudes de fin de journée, qu’il ne pourrait faire ça toute sa vie, et que d’autres taches l’attendait (la Chiraquie, l'écriture d'essais et de moins de romans), bref, qu’il fallait que je fasse office d’une sorte de directeur littéraire. Pam. Je venais donc de signer à Milan-Presse, préférant poursuivre une carrière de journaliste en province, en charge d’un massif sauvage, plutôt que celle d’un éditeur parisien confiné dans un bureau du sixième arrondissement, fut-ce celui-ci. Je crois que Denis m’en voulut un peu, voire beaucoup, de refuser un si beau cadeau...
Olivier Frébourg honora cette charge douze années durant avec l’immense talent que nous savons et qu'il exerce aux Équateurs depuis 2003, et c’est sous sa férule, via Cécile Guérard, qui devint sa femme et la mère de leurs fils, que je publiais plus tard, suite à un envoi postal volontairement banalisé, mes « Bonheurs de l’aube », puis « Flamenca ». Denis planait dans les hautes sphères élyséennes et ne savait plus où donner de la tête, sinon dans la réédition et la publication des grands classiques du rugby. Son côté mi-Haedens, mi-Herrero. Tout lui. Denis, quoi...
Souvenirs, souvenirs... Un soir, en sortant à pas d’heure de la rue du Bac, nous traînons rue de Verneuil et tombons dans un bistro de peu de hasard sur Françoise Blondin. Antoine, à l’extrême soir de sa vie, était déjà fin bourré et donc incapable de sortir en compagnie de sa femme (avec laquelle il passait beaucoup de temps à s'engueuler). Il devait réécrire inlassablement au stylo, de son écriture fleurie, enfantine et rondelette, sur la table de la cuisine, entouré de bouteilles vides, la première phrase du « P.C. des Maréchaux »... Nous buvons des coups. Sur coup. Et re-coup. Au bout de trois heures, Denis et moi sommes faits comme des rats, et Françoise Blondin entonne un classique « patron, remettez-nous ça ! ». À ce moment-là, Denis me glisse tu as une bagnole. Oui, dis-je. On va voir Frédéric Fajardie chez lui en Normandie. Tu es fou, Denis, il est bientôt minuit, tu sais où il habite au moins. Non, on trouvera bien, c’est dans le Pays d’Auge, c’est pas aussi grand que la Sibérie ! Putain, Denis, c’est immense, tu déconnes, là. Nous ramenons avec une titubante courtoisie Madame Blondin chez elle, et nous prenons la route avec un peu de sang dans l’alcool, mais suffisamment d’essence dans le réservoir pour nous permettre d’aviser la priorité à droite aux carrefours. L’époque n’était pas encore au téléphone portable et au GPS, et je n’avais que des cartes IGN Top 25 des Pyrénées à déplier sur le capot. J’ai déjà raconté cette virée dans « Dictionnaire chic du vin », à l’entrée Blondin, de même que ma première rencontre avec Jean-Paul Kauffmann à Auriac en 1984, peu de temps avant qu’il ne soit pris comme otage au Liban. En voici de courts extraits : Un soir de soif tardive, nous voilà partis au fin fond des routes normandes à la recherche du ranch perdu de l’auteur de « Brouillard d’automne ». Une échappée blondinienne en diable, comme nous en avions déjà vécues plusieurs. Arrivés – par la grâce de Dieu – et à une heure improbable chez Fajardie, klaxonnant à qui mieux mieux, pleins phares devant sa maison reconnaissable en raison de l’imposant GMC kaki de l’armée américaine garé dans le jardin, qui lui servait de véhicule, et tandis qu’un fusil de chasse pointait sa paire de canons juxtaposés par l’entrebâillement d’une fenêtre à l’étage, Denis sortait la tête hors de la voiture, et que les canons se relevaient, je dessaoulais tout à trac. Et repensais à Blondin. « Tout le reste est litres et ratures ». Fajardie nous avoua que deux secondes de plus, et il tirait dans le pare-brise. S’ensuivirent deux jours de liesse. Avec Kauffmann, ce fut différent. La première fois que je rencontrai Jean-Paul, ce fut à la fin de l’été 1984, chez Denis à Auriac, peu de temps avant son départ malheureux au Liban. Denis m’avait invité au pied levé à déjeuner. Magne-toi, saute dans ta bagnole. Je quittai Bordeaux, où je vivais alors, avec un retard considérable, et je forçais ma vieille Alfasud break rouge, dont la malle s’ouvrait à chaque virage, à dépasser ses capacités, comme on éperonne un canasson qui n’a plus l’âge de galoper follement. J’annonçai mon retard depuis une cabine téléphonique de fortune. Arrivé à pas d’heure (entre quinze et seize), et sitôt claquée la porte de la guimbarde en tentant de masquer ma confusion, je fus accueilli sur le seuil par un inconnu qui me chanta la chanson de Jeanne Moreau, « La peau, Léon », dans son intégralité et sans une faute, avant de me tendre une main ferme, en ajoutant Bonjour, Jean-Paul Kauffmann, à table ! L'autre main tenait une verre à pied de bordeaux qu'il m'offrit. À l’ombre, la malle ouverte de sa voiture débordait de bordelaises de belle extraction. Denis affichait un sourire large comme l’horizon. Il y avait Joëlle, Monique, un feu de cheminée (la frilosité de Denis), ils m’avaient attendu, ils étaient affamés et d’une infinie courtoisie.
Nous fîmes d’autres virées, dans le Gers avec arrêt à Condom, dans le Lot, dans l’Allier du côté de Moulins, à la rencontre de cousins plus ou moins éloignés de Denis, notamment ce riche cultivateur qui avait explosé sa télévision le 10 mai 1981 d’un coup de fusil lorsque le profil de François Mitterrand était apparu, pixelisé, à vingt heures pétantes. Un mur portait les stigmates de cette accession au pouvoir... Du côté de Brive et jusqu’à Foix, nous allions à la rencontre de légendes du rugby local, des mastodontes rangés des crampons, reconvertis en patrons de bars ornés de maillots boueux et froissés mais encadrés sous verre, de ballons ovales maculés de signatures au marqueur, rangés entre les bouteilles de Ricard et de Suze. Des bestiaux des stades dont j’ai égaré les noms, des mecs velus et doux comme des agneaux de lait. À Tyrosse, il se sentait revivre à cause de l’histoire de ce petit « clup » (écrirait l'ami Christian Authier) de la légende ovale. Et puis Saint-Vincent (de Tyrosse) était le village de Sophie, mon épouse à l'époque, qui nous accueillit deux fois. Denis prenait toujours de ses nouvelles avant de me demander comment tu vas ! (Il m'engueula comme un malpropre lorsque je lui annonçai notre divorce en 2002). Lorsqu’il prenait le volant, ou plutôt lorsqu’il le battait froid avec ses mains à plat, ce qui n'était pas rassurant, il chantait à tue-tête, de sa voix éraillée, et dans un Anglais très approximatif, des chansons d’Elvis Presley qui le faisait retomber dans son songe insondable de « Rêveur d’Amérique ». Denis aimait virer de bord. Il avait le pied terrien et sans doute le mal de mer – je n’ai pas pu le vérifier, même à Anglet, un après-midi de tempête, où il me fit comprendre qu’il lui fallait regagner un bistrot hermétique. Toujours sa frilosité, ses polos Lacoste fermés parfois jusqu’en haut, son pull col ras ou bien en V par-dessus, sa veste à chevrons avec laquelle il devait parfois dormir, et ses paquets de clopes à répétition comme une incessante rafale de mitraillette qui agissait sur sa diction. Denis maugréait ses phrases à venir, puis les éructait, lorsqu’il était en pétard contre une idée, un fait, quelqu’un. Soit fréquemment. Un jour que je pilotais un hors-série pour VSD sur la Coupe du Monde de rugby 2007, je l’appelais pour lui demander de me donner un article du fond de ses tripes sur l’âme du rugby, l’âme des peuples, et surtout son âme à lui. Il me fit parvenir la veille du bouclage par coursier un cahier d’écolier inachevé, rédigé au bic vert, comme à son habitude. J’aimerais bien remettre la main sur ce cahier, ce soir.

La dernière fois que nous avons bavardé et partagé quelques verres, ce fut il y a cinq ans dans le VIIIe arrondissement de Paris, après une émission de Frédéric Taddei sur Europe 1, à laquelle nous avions été conviés. Il venait pour un roman fraîchement paru chez Plon, moi pour le dictionnaire chic du vin. Le regard de Denis était plus tendre qu’à l’accoutumée, ce soir-là. Au Clos de Vougeot, l’année d’après, pour le salon Lire en Vignes, je ne l’ai pas vu. Étrange. Certaines mauvaises langues me susurraient qu’il délaissait un à un ses amis. Je ne pouvais l’entendre, encore moins le croire. Je me suis résigné, je ne l’ai plus appelé, je l’ai lu parfois dans « Valeurs », et comme je ne recevais plus ses livres, je les achetais sans lui dire le bonheur qu’ils me procuraient, amoindri cependant, en regard de la jubilation procurée par les premiers, ceux des années « Le Bonheur à Souillac », « L'Été anglais », « Maisons de familles », « À la santé des conquérants », « Rugby blues »... Je viens de les retrouver, tous ceux-là, en éventrant les cartons de mon nouveau déménagement à Bayonne. C’est bien sûr au bic qu’il les a tous signés. Voilà ce que j’emporte avec moi, cette nuit. Ce sont les traces de cette encre, voilà ce que je garde – avant de reprendre l’un de ses bouquins au hasard, et puis non, ce sera « Le Dictionnaire amoureux de la France », allez ! Même s’il pêche par certaines facilités et redondances. Mais Denis était familier de certaines redites, du type « j’ai été déniaisé à l’âge de seize ans, sur une falaise du Dorset, par une Linda aux cheveux platinés, qui n’en menait pas large... ».
Ce sera donc bouquin en mains, afin de retrouver son rire préhistorique, son regard de rapace dubitatif, ses gestes brusques d’homme délicat des cavernes de l’esprit, sa gouaille amicale, sa fidélité, son impossibilité à rester tranquille – chien fou, chiot de chasse dans une bagnole -, le Denis que j’aime, le Denis que nous aimions, le Denis qui nous manque. Déjà. Allo, tu fais quoi ?.. – J’arrive !
Léon Mazzella, 30 septembre 2020.
---
(*) Le fait est joliment reporté par Benoît Lasserre dans son hommage, publié dans Sud-Ouest dimanche dernier 27 septembre...
Photo anonyme (en haut) capturée sur Facebook. Que l'auteur se manifeste et je créditerai ce document. Photo ci-dessous : © Jean-Pierre Muller/AFP. Au milieu, une photo prise (par je ne sais qui) au cours de l'émission d'Europe 1. Taddei de dos, Tilli à gauche, ma pomme à droite.


Il est paru et il est gratuit. J'y ai écrit plusieurs articles : Ville culturelle & artistique - Ville commerçante & artisanale - Ode gourmande à Bayonne - Ville animée toute l'année - Ville sportive... C'est bourré d'adresses, de bons plans, d'idées de balades et de sorties. 100 pages pour mieux connaître Bayonne et l'avoir dans sa poche.
Visit Bayonne 2025 est une coproduction de l'Office de Tourisme de Bayonne et de l'agence Atlantica.



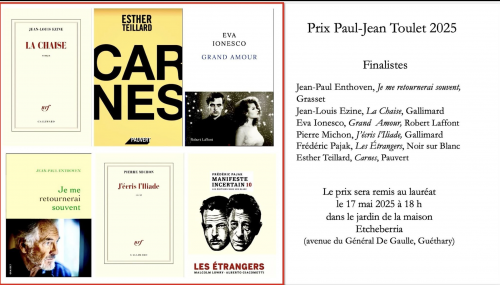

Le jury du Prix littéraire Paul-Jean Toulet s'est réuni hier soir au restaurant Getaria de l'ami Claude Calvet. Voici la liste des finalistes. Rendez-vos à Guéthary le 17 mai prochain à 18h, en présence du lauréat.
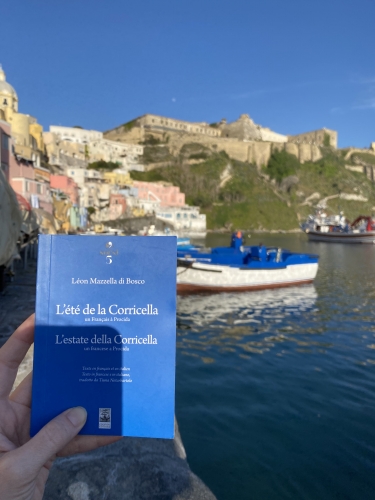

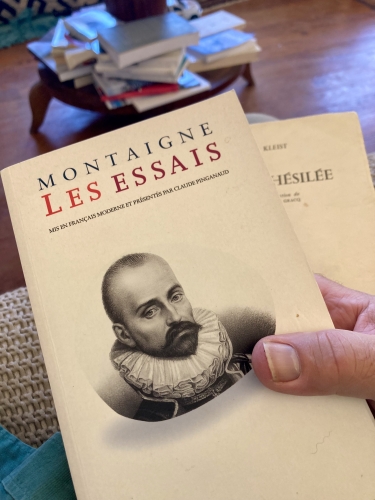
En direct : J'écoute Leonard Cohen, Ten new songs, puis j'écoute Alain Bashung, Bleu pétrole, je relis Hypérion de Hölderlin au hasard, je reprends les Hymnes à la nuit de Novalis, n'en relis que les annotations en marge, faites au crayon, de mes premières lectures. Manciet, Juliet, Cadou, Neruda, Ungaretti me lancent des oeillades - et nous alors, ohé !... Je contemple sans le regarder un ciel bleu pâle. Novembre. Fin novembre doux au lieu d'être givré jusqu'à l'os, soit l'opposé d'un novembre classiquement vigoureux, capable de glacer notre oesophage lorsque nous inspirons à fond, à l'aube, face à lui tout entier. Droit dans les yeux déjà gentiment agressés par une froidure que l'on accueille "comme la nuque en sueur trouve bon le mouchoir aride" (Char). Un vent à décorner les ânes dirait mon ami Benoît génère à l'instant une rauque musique de mes volets mal arrimés. Je les ai pourtant coincés avec des bouchons. Je veux ignorer le prénom de ce nouvel ouragan - ou prétendu tel... La plage de la petite Chambre d'amour était plate tout à l'heure. Marée haute. Plate comme une crêpe sèche. Oubliée au-dessus du placard lorsqu'on a (volontairement) raté son saut dans la poêle. Cela porte bonheur, disait Maman. L'Adour (et j'aime que le correcteur rectifie aussitôt ma frappe avec une aveugle autorité : L'Amour...), uniformément beige, semblait prêt à déborder, dans l'arc de Blancpignon qui figure un mol croissant de lune. Nous connaîtrons de plus en plus de débordements. Ils ne seront pas toujours pétris de sentiments généreux, amoureux. Plutôt d'excès haineux, rugueux. Je chasse la douceur en ce dimanche comme on quémande un regard complice, une connivencia sourde. Tue. Forcément tue. En choisissant par défaut l'affût au lieu de l'approche. Preuve que je ravale à l'instar d'une biche bréhaigne, ou comme un grand vieux solitaire, une carne repliée au -fin- fond d'une forêt forcément noire. Et crue. Une page des Essais de Montaigne quotidien - plus indispensable que le pain - me sauvera, j'en suis certain. Il me faut juste me lever et l'attraper. Dresser le bras gauche, empoigner le volume avec le même délice de chaque jour. Puis, l'ouvrir au hasard, ainsi que je pratique cet exercice sportif avec La Recherche, de Proust. Nous avons les Ventoline que nous pouvons. Montaigne prescrit comme bronchodilatateur. Pourquoi pas? La belle affaire sans ordonnance... L.M.
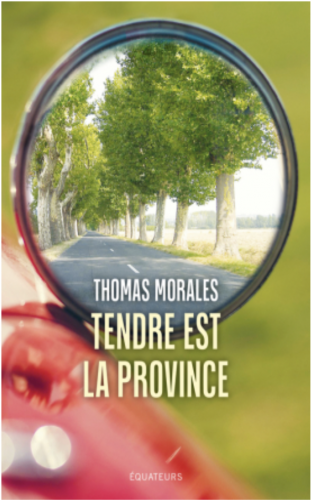
Que ne sacrifierions-nous pas pour un jeu de mots, même tiré par les cheveux ? Si Thomas Morales était un débauché, je titrerais cet article « Le rétroviveur ». C’est ainsi que je surnommais mon père lorsqu’il rabachait ad nauseam sa nostalgérie d’italo-pied-noir. C’est quand même tentant, et la couverture de son nouveau livre au titre fitzgeraldien, « Tendre est la province », essai littéraire qui caracole, publié sous casaque des Équateurs de l’ami Olivier Frébourg, y incite fortement. Le mot province est celui que Morales, issu de « commerçants berrichons et de forçats venus d’Andalousie », préfère entre tous. Il nous en conte et raconte au fil de 230 pages avec un ton fleuri qui figure sa patte, un style vigoureux qui lui est propre, de cette province française qu’il chérit, bien qu’elle se dilue, disparaisse, s’efface avec élégance. Lire Morales, c’est prendre un ballon de menetou-salon au zinc d’un rade de village en avalant un œuf mayo tout en écoutant Brassens ou pourquoi pas Tino Rossi. Cet ouvrage écrit avec talent à la première personne est une sorte d’autobiographie par anticipation d’un quinqua continuant d’enfourcher une mob bleue ou orange (délaissant un instant la Ford Mustang) pour partir à l’aventure sur les chemins vicinaux et les routes départementales, entre clocher, école désaffectée, bar des chasseurs, mairie riquiqui et vieux en voie de disparition. Monsieur Nostalgie, fils unique qui naquit à Bourges, est habité par ce pays qui « s’inscrit dans nos gènes par décalcomanie, par abstraction ». Mais, poursuit l’auteur, la nostalgie est « balise dans l’océan, tuteur solidement enfoncé dans les terres effacées. » Notre styliste, qui confesse avoir eu le béguin pour une Léonarde (du pays du Léon), puis avoir convolé en justes noces à Carantec avec cette fille d’un fusilier marin breton portant la légion d’honneur au revers de son veston, nous attache durablement. Sa France figure une brocante personnelle où d’aucuns se retrouve(ro)nt comme dans un costume sur mesures. « Elle flirte avec les marges, les écrivains vipérins et les bombances débridées », écrit ce fils spirituel de feu l’ami Denis Tillinac. Une phrase seulement nous rappelle l’incipit d’un des premiers romans de Denis. Page 52 de « Tendre est la province », nous lisons : « J’ai été langé par une nourrice corso-espagnole qui portait un chignon façon mater dolorosa et était pieuse comme un moine de Tibhirine. » Dans « Le bonheur à Souillac », cela donne à la première page : « J’ai été déniaisé à l’âge de seize ans, sur une falaise du Dorset, par une Linda aux cheveux platinés, qui n’en menait pas large. » La filiation est établie et ce n’est pas un hasard si Morales fut le premier lauréat, en 2022, du tout neuf Prix Denis Tillinac (disparu le 26 septembre 2020 : C'était Denis )... Morales aime la structure mentale, la fierté de la province, voire son délitement, en romantique sensible à l’évanouissement de la beauté, de la sincérité, de la simplicité. « Ma France grince comme la maison de mon enfance », écrit-il joliment. Entre les pages, nous croisons Yvette Horner, des gamins en culottes courtes fiers de commémorer le 11 novembre au monument aux morts, des bouteilles de rosé pour les barbecues de l’été, une étape du Tour de France, un standard d’Eros Ramazzotti, un livre écorné de Daphné du Maurier, un slow-braguette du samedi soir dans le dancing du chef-lieu de canton en compagnie de boutonneux de bringue inoffensive, des fraternités indéfectibles, un Opinel inoxydable à force de gras de saucisson tranché, le break Volvo du paternel, refuge majuscule en cas d’alerte nucléaire sentimentale. Il y a encore du fromage de tête et des rognons entiers comme des grappes bodybuildées, des rires larges et des nappes à carreaux, les paysages doux et sans aspérités du plat Berry qui est le sien. Il y a la défense du parler paysan, des « r » roulés avec suavité et franchise intérieure, moqués par les néo-ruraux, il y a du Grand Meaulnes et du Jean Chalosse, moutonnier des Landes dans ces contrées de patience. On trouve dans ce bric-à-brac qui redonne goût à la chine et aux vide-greniers, des remontrances : « Quand je braise, je me cache ; quand je fume (mon saumon) je disperse mes cendres sous mon prunus ; quand je débouche un flacon de gevrey, j’ai l’impression de sniffer une ligne de coke, quand j’ouvre des belons, suis-je un génocidaire des mers ? » Morales se libère aussi, et les pages à l’adresse de son père sont émouvantes, comme celles touchant à la blessure qu’infligea le divorce de ses parents. Thomas avait dix ans. Revigorantes sont celles qui animèrent tout son être lorsqu’il découvrit le métier de journaliste dans la PQR (je suis également passé par la Presse quotidienne régionale, et je comprends par conséquent cet adoubement initiatique qui me fut un bonheur indépassable). Amoureux des livres de Blondin et des films de Philippe de Broca, Morales le chroniqueur brillant au verbe claquant et à l’adjectif qui fouette, que nous suivons dans Causeur ou Le Figaro, signe ici une somme vibrante et sans ambages. Le tout avec une plume des plus précieuses du paysage littéraire ambiant. L.M.


Ce bel article dans le grand quotidien italien sur L'Été de la Corricella / L'Estate della Corricella (récit bilingue) paru en septembre dernier chez Giannini editore.
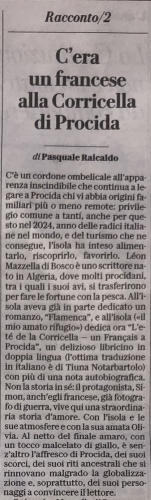


Fier d'avoir pas mal collaboré, avec une poignée d'articles introductifs, à cette nouvelle édition (92 pages) du guide bayonnais publiée par Atlantica pour l'Office de Tourisme. Elle est gratuite, et bourrée d'infos non seulement gourmandes, mais également culturelles, patrimoniales, sportives, pratiques...




Anne Dubarry est une femme entreprenante couverte de récompenses. Ou plutôt, ce sont ses merveilleuses sauces tomate qui récoltent des médailles. La dernière en date (ce mois-ci) , la treizième en six ans d’existence, est le prix du Bien-Manger attribué par Santé Magazine, lequel valorise la nutrition, l’environnement et le goût. Voici, à gros traits, l’histoire de Variette, entreprise sous-titrée « de graines et de goût », soit une petite structure 100 % Bio qui connaît un succès vraiment mérité. Après des études de commerce à Paris, Anne Dubarry travaille à Madrid, puis à Paris comme acheteur dans la distribution. Elle rejoint ensuite Les Ducs de Gascogne, fameuse entreprise familiale sise à Gimont (Gers), soixante ans d’existence en 2006, avec Laurence sa grande sœur et leur père. Elle y restera dix années, s’occupant de marketing, du commercial, de la communication et des achats (Laurence s’occupant de la production, de la direction administrative et des finances). « Nous sommes des sœurs complémentaires », dit Anne, « et je me suis personnellement formée solidement à une palette de compétences transversales. Lorsque je me suis sentie prête, j’ai projeté de voler de mes propres ailes ». Il faut préciser que Variette, c’est à ce jour une seule et unique personne : Anne Dubarry. Et pas mal de sous-traitants, cela va de soi. En 2016, l’entreprise Les Ducs de Gascogne, 70 employés, est vendue à des repreneurs : ni licenciement ni délocalisation. « Dans la famille, on avait fait le tour de la question foie gras, canard et traditions, et puis la filière subissait une forte concurrence », déclare Anne. « En 2017, j’ai fait des choses inhabituelles, à commencer par une première pause dans ma carrière, j’ai passé un CAP de boulangerie par défi, que j’ai obtenu un peu par miracle, en catégorie amateur, j’ai effectué un stage chez des paysans boulangers, et là j’ai beaucoup appris sur le vivant et les variétés de blé anciennes... »

Anne, engagée intellectuellement depuis toujours dans le domaine de l’écologie et du développement durable dans son ensemble, mais pas par mode ni opportunisme, en toute franchise intérieure, se détourne alors du monde de la viande, de l’élevage en se tournant résolument vers le végétal. « Ma famille, c’est trois générations de charcutiers conserveurs, ce sont les créateurs en 1908 de La Comtesse du Barry, c’est une réelle compétence de conserveurs. Moi, j’ai eu envie de créer une conserverie végétale axée sur le vivant. » Anne s’emploie alors à monter un cadre contraignant, fondé sur des variétés anciennes issues de semences paysannes libres de brevets et reproductibles. Son cahier des charges est volontairement drastique car elle est d’une exigence sans limites lorsqu’il est question de qualité, de respect de l’environnement et des goûts originels, s’agissant de ses « variétés originales, colorées et goûteuses ». Elle donne volontiers dans l’agro-écologie, l’agro-foresterie et tous les produits de sa gamme sont certifiés « 100% Bio ». On est tenté d'écrire 101 % !.. Anne travaille dans une dynamique de commerce équitable avec ses partenaires agriculteurs. « Je m’engage sur un volume en début d’année, je réduis les délais de paiement... Le respect est une valeur fondamentale à cultiver sans cesse. » De même, Variette se fournit dans un rayon de 100 km autour du site de production gersois, sis à Fleurance, et son rayon d’action s’étend en Occitanie. La production, entièrement artisanale, c’est 80 000 bocaux annuels, un travail de chaque instant avec nombre de partenaires engagés comme Anne elle-même. Baladez-vous sur son site, Variette - et vous découvrirez les engagements de cette petite entreprise en faveur de la biodiversité cultivée, du goût sain, des bonnes pratiques culturales, des actions exclusivement positives, au sein du très sérieux Réseau Semences Paysannes. Par ailleurs, Variette soutient, en faisant des dons, des associations œuvrant en faveur de la transition écologique comme Jardin Bellevalia (à Gimont).

Anne Dubarry pense 24/24 aux démarches éthiques et vertueuses. Et ce ne sont pas que des mots, mais des faits. Du réel. Depuis un an, Variette est engagée également dans la démarche RSE, pour Responsabilité Sociétale des Entreprises, « qui signifie conduire une structure de taille modeste en continuant de veiller aux soins, en toute logique avec ma philosophie du travail, fondée sur le respect total de la nature », précise-t-elle. Au début, Variette, ce fut une gamme de dix sauces tomates monovariétales, afin de mettre en avant la singularité savoureuse de chaque espèce. De la (vraie) Cœur de bœuf rouge à la Valencia en passant par la Green Zebra (la chouchou d’Anne), la Costoluto genovese, la Tomate ananas, ou encore la Brandy Wine (elles ont toutes été primées). La Noire de Crimée n’est pas en reste, pas plus que la tomate ancienne Beauté Blanche, la rose de Berne ou l’Andine cornue... « Pour chacune, la recette est identique : 95% de tomates, un peu d’huile d’olive et un soupçon d’ail auxquels j’ajoute un tout petit peu de sel et de sucre de canne non raffiné issu du commerce équitable ». Pourquoi la tomate ? « Parce que dans ma famille, on fait beaucoup de coulis l’été, c’est cette sorte de madeleine qui m’a donné envie de commencer comme ça, en 2018. Et puis, comme il existe plus de 800 variétés de tomates, Variette a du fruit sur la planche ! ». Le succès de la petite entreprise a été immédiat, entre autres grâce à un sacré coup de pouce médiatique survenu quatre mois à peine après le lancement de la marque. François-Régis Gaudry et son émission « On va déguster » sur France Inter vanta les qualités gustatives des sauces dégustées par son équipe. Ce coup de cœur (de bœuf) propulsa la machine auprès du grand public. Aujourd’hui, les revendeurs de Variette sont tous de qualité, de La Grande Épicerie du Bon Marché à Paris à l’ensemble des épiceries fines de province, le réseau Biocoop, ou des boutiques curieuses et exigeantes dans leur référencement comme Sardine à Ciboure, et puis des chefs de renom comme Jean-François Piège passent régulièrement commande à Anne.

« Je vends aussi via Internet, où le panier moyen de ma clientèle de particuliers est de 70€. Je remarque souvent un effet wouaouh ! lorsque l’on goûte à mes sauces. Cela réveille des saveurs de l’enfance, c’est ce que j’appelle l’effet riz au lait... » Au-delà des sauces tomates qui magnifient les spaghettis et autres penne rigate (après avoir goûté à la formidable Cœur de bœuf, par exemple, vous ne pourrez plus acheter une sauce tomate industrielle à la supérette du coin. On parie?..), Variette propose plusieurs autres gammes, du pesto de basilic à la crème de poivrons Corno di toro, des légumineuses : pois chiches noirs, blancs, houmous de lentilles multicolores, ou bien noir au cumin, le petit épeautre (un cousin du blé très ancien, 12 000 ans) des petits haricots Saint-Esprit, « blancs avec une tache lie de vin sur le côté... ». Anne en parle comme s’il s’agissait d’enfants dans une pouponnière. Et puis il y a cette rafale de médailles qui récompense le travail têtu d’Anne l’exigeante. « Cela joue à fond sur l’esprit du consommateur, qui fait totalement confiance à mes gammes ». Anne, que l’on surnommait Nanette lorsqu’elle était enfant, « c’est comme Danette mais avec un N », dit-elle en riant, a baptisé naturellement sa marque Variette, « une collection de sauces mais pas que, au positionnement réussi au bout de six années. En résumé, ce sont des produits très goûteux en plus d’être attractifs, sains, naturels, et locaux », dit-elle avec beaucoup trop de modestie. Ne l'écoutez pas. Goûtez plutôt. Léon Mazzella
---

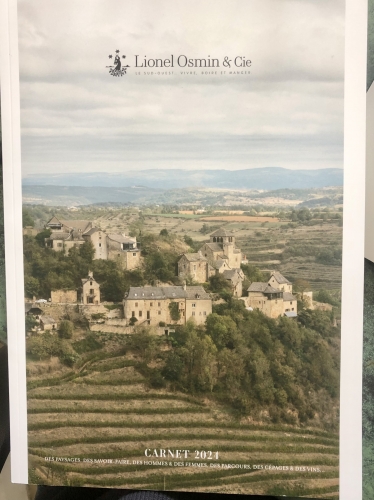
Il est paru. Joie d'avoir en mains ce magazine de 80 pages que j'ai le plaisir de rédiger intégralement. Au sommaire, que des choses qui fâchent : la saga Michel Guérard, la race Aubrac, le cépage Malbec, l'appellation Marcillac, les boeufs gras de Bazas, le chef béarnais Gérard Lasbarrères, le domaine Berthoumieu en Madiran, la poterie Goicoechea, le Canal du Midi... Gratuit, on peut le trouver chez les cavistes qui vendent les vins du grand Sud-Ouest de la gamme Lionel Osmin & Cie. L.M.
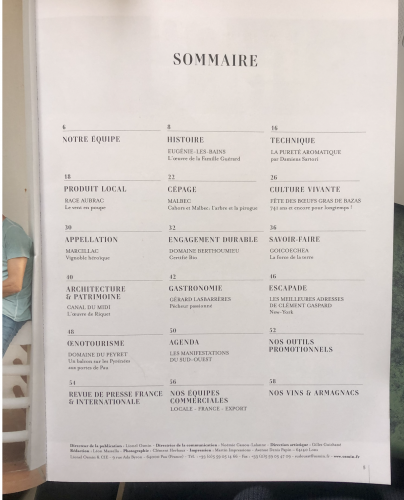

Je ne pensais pas pouvoir être ému un jour par un texte de Francis Jammes, tant sa poésie m’a toujours laissé un goût mièvre en arrière-bouche, De l’Angelus de l’aube à l’Angelus du soir et en dépit du Deuil des primevères et des Clairières dans le ciel... Or, à la faveur d’un salon du livre ancien qui s’est tenu à Bayonne dimanche dernier, j’ai fait l’acquisition d’un petit bijou intitulé Portrait de la France, Basses-Pyrénées, Histoire naturelle et poétique, par Francis Jammes, aux éditions Émile-Paul frères, avec un frontispice sous calque signé Daragnès figurant deux pelotaris. La collection était dirigée par Jean-Louis Vaudoyer auquel nous devons notamment un très beau texte sur La Havane. Le propos de Jammes n’est évidemment pas celui d’un scientifique et sa description de la géologie manque de rigueur, comme les parties consacrées à la botanique et à la zoologie souffrent d’approximations sur lesquelles nous fermons volontiers les yeux tout en regrettant que l’ouvrage ne soit visiblement pas passé sous les fourches caudines d’un éditeur scrupuleux. Jammes écrit par exemple que « Louhossoa signifie la mer » (Itsasoa, en Basque), et que l’alose est « une sardine d’environ cinq livres dont la chair délicate a le goût de la brise du premier printemps ». Il lui est beaucoup pardonné pour cette comparaison. La pibale, du temps de Jammes, semblait mal cuisinée : « Fraîche, elle est difficile à bien frire à cause du mastic poisseux qu’en grand nombre elle forme ». C’est avec son florilège consacré aux oiseaux que Jammes émeut : « Les palombes ont la couleur des nuages orageux où se lève l’arc-en-ciel (leur gorge) ». Au sujet du lagopède en plumage hivernal : « La perdrix blanche est une poignée de flocons qui a pris vie ». Aux yeux du poète, « la bécasse a l’air d’un bouquin de cuisine savante, relié en feuilles mortes, et chiné aux marges ». Mouais... « Fauvettes et rossignols enchantent successivement, c’est-à-dire la nuit après le jour, les fiancés et les époux ». L’écureuil, quant à lui, « ressemble, quand il s’ébroue au sommet d’un chêne, à un éclaboussement de soleil ». La flore suggère également des images tendres, comme les « lianes élancées, vertes, luisantes, retombantes, des églantines telles que des cascades où frissonneraient des jeunes filles ». À la page 62 de ce petit ouvrage, j’ai fait une découverte bouleversante en apprenant que la cardère - cette plante haute et piquante qui ressemble au chardon et qui pousse à la faveur des parcelles laissées en friche - est surnommée le cabaret des oiseaux parce que ses feuilles « rembrassantes », soit réunies à leur base en godet, retiennent l’eau de pluie et désaltèrent les passereaux, notamment le chardonneret, les jours de forte chaleur. Le chardonneret apprécie aussi, surtout l'hiver, les petites graines riches en huile contenues dans la fleur de la cardère. Le cabaret des oiseaux m’a laissé rêveur, d’autant que le chardonneret est l’un de mes trois passereaux préférés, avec le merle et le rouge-gorge... L.M.
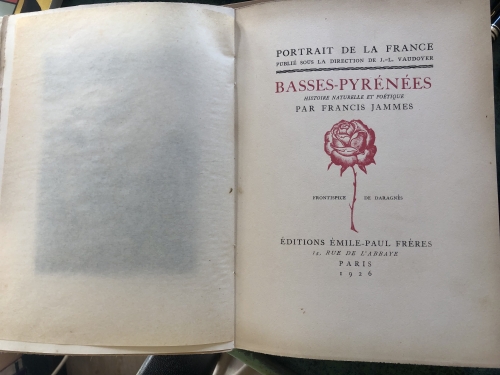

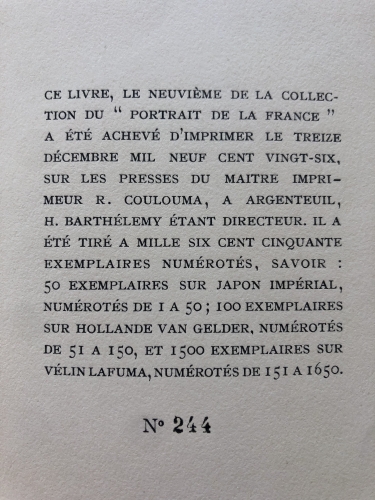

©fotoloco

©le jardin de lucie
... au moment où reparaissent en format "poche" (chez Cairn) mes Bonheurs de l'aube.
Merci à son auteur(e), Rita des Roziers.
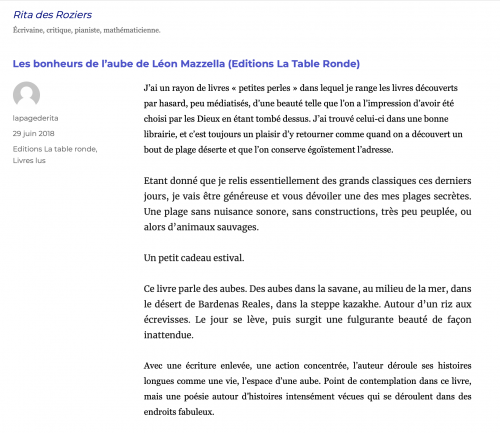
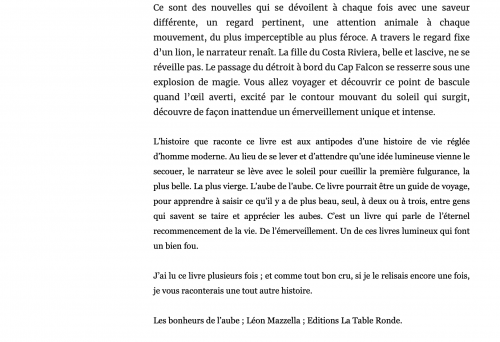
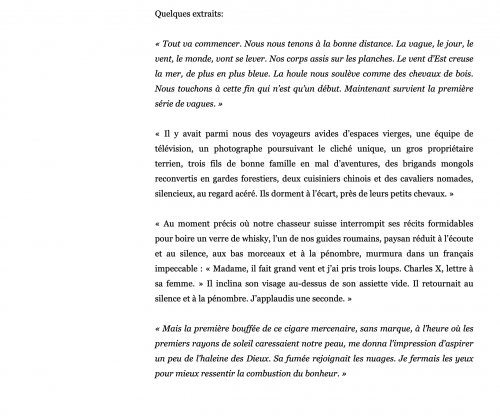
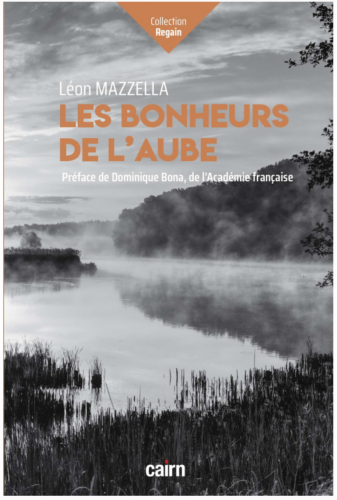





Avec Manu Dubarry, la boucle de l'art et celle du couple passent par le poisson. Gyotaku mode d'emploi.
Elle a le sens de la boucle et elle ne la boucle jamais car elle a, a minima, une idée par minute. Manu Dubarry – fille de Pierre, qui fonda Les Ducs de Gascogne, ou le foie gras dans tous ses états, a lâché Gimont pour Hossegor, son port d’attache, et les longues plages voisines de Seignosse, soit la généreuse terre gersoise pour l’océan infini de la côte landaise ; ce depuis belle lurette. Les vagues, l’horizon, le sable - et ce qui y échoue surtout, le Gouf et ses insondables mystères à tenter de deviner devant Capbreton, n’ont fait qu’attiser son imaginaire prolixe comme les vagues. Manu créé par séries continuelles. Elle figure le rythme des marées, réputé infini. Artiste autodidacte, après avoir travaillé comme peintre de décors pour le cinéma, elle transforme tout ce qu’elle touche, de ses dix doigts armés par un esprit fertile, en œuvre délicate à tirage unique et à haute valeur ajoutée sensible ; puissamment mais tendrement poétique.


Là, elle expose plus d’une soixantaine de ses créations singulières à Olatu (100, avenue de l’Adour à Anglet, juste avant le Brise-Lames, le port de plaisance, et notre querencia gourmande, le restaurant Le Poisson à Voile). Depuis le 15 janvier et jusqu’au 28 mars (le vernissage aura lieu le 15 février à 18h. Venez tous). L’espace s’y prête « qui autorise une vue d’ensemble, de loin, et aussi de pouvoir s’approcher très près de chaque cadre afin d’en lire les détails », dit-elle, « d’observer les traits, le regard, les tâches, les écailles de chaque poisson mis en scène en noir de seiche... & blanc ». C’est en réalité à une visite d’un « aquarium à sec » qu'il s'agit, qui n’est ni le musée de la Mer de Biarritz ni l’aquarium de La Rochelle ou celui de San Diego, mais la projection scénographiée d’une femme audacieuse et créative jusqu’au bout des ongles, ayant à cœur de faire œuvre de la pêche de son homme avant de la lui cuisiner. L’intention est donc, philosophiquement et sans le vouloir, puissante. Et admirable. Et cela passe par l’encre de seiche dont
Venez tous). L’espace s’y prête « qui autorise une vue d’ensemble, de loin, et aussi de pouvoir s’approcher très près de chaque cadre afin d’en lire les détails », dit-elle, « d’observer les traits, le regard, les tâches, les écailles de chaque poisson mis en scène en noir de seiche... & blanc ». C’est en réalité à une visite d’un « aquarium à sec » qu'il s'agit, qui n’est ni le musée de la Mer de Biarritz ni l’aquarium de La Rochelle ou celui de San Diego, mais la projection scénographiée d’une femme audacieuse et créative jusqu’au bout des ongles, ayant à cœur de faire œuvre de la pêche de son homme avant de la lui cuisiner. L’intention est donc, philosophiquement et sans le vouloir, puissante. Et admirable. Et cela passe par l’encre de seiche dont
 elle enduit chaque poisson pris dans le Gouf, au lancer, au leurre souple, au madaï, à la turlutte, à l’ascenseur, les techniques variant chaque jour, à chaque marée, selon d’ésotériques critères, parfois...
elle enduit chaque poisson pris dans le Gouf, au lancer, au leurre souple, au madaï, à la turlutte, à l’ascenseur, les techniques variant chaque jour, à chaque marée, selon d’ésotériques critères, parfois...
Les poissons-filets
« Il y a sept ou huit, ans, j’ai commencé de faire ce que j’appelle mes poissons-filets ou mes poissons démaillés, des poissons reconstitués à partir les fils multicolores de filets de pêche échoués sur les plages de Seignosse, que j’ai remaillés, reconstruits », dit Manu. « Je démaille et je couds, rien de plus, je n’ajoute rien, tout a été ramassé sur le sable ».
 Ainsi, tout a... maille à partir avec la pêche, puisque « je fabrique des poissons, des crustacés, des mollusques avec ce qui a permis de les capturer : les fils du filet ou d’une ligne. Chaque poisson ou crustacé reprend sa forme avec l’outil de sa prise et donc de sa mise à mort ». La boucle. L’omniprésence de l’esprit de la boucle... « J’étais devant mon premier aquarium de poissons-filets, lorsque, au cours du premier confinement, au printemps 2019, une amie m’a parlé de la technique japonaise inventée en 1862, du Gyotaku (titre de l’exposition en cours). Il s’agit de « l’art d’immortaliser des poissons en prenant leur empreinte sur du papier afin de réaliser une estampe ». Cette technique est née du désir d’un seigneur d’offrir à l’empereur l’image d’une magnifique daurade, symbole de bonheur.
Ainsi, tout a... maille à partir avec la pêche, puisque « je fabrique des poissons, des crustacés, des mollusques avec ce qui a permis de les capturer : les fils du filet ou d’une ligne. Chaque poisson ou crustacé reprend sa forme avec l’outil de sa prise et donc de sa mise à mort ». La boucle. L’omniprésence de l’esprit de la boucle... « J’étais devant mon premier aquarium de poissons-filets, lorsque, au cours du premier confinement, au printemps 2019, une amie m’a parlé de la technique japonaise inventée en 1862, du Gyotaku (titre de l’exposition en cours). Il s’agit de « l’art d’immortaliser des poissons en prenant leur empreinte sur du papier afin de réaliser une estampe ». Cette technique est née du désir d’un seigneur d’offrir à l’empereur l’image d’une magnifique daurade, symbole de bonheur.



« Les pêcheurs », enchérit Manu, « auraient utilisé la technique Gyotaku pour immortaliser leurs plus belles prises en indiquant scrupuleusement les mensurations de chaque poisson. » Et c’est d’ailleurs ce que nous lisons en parcourant cette exposition d’une richesse confondante, qui n’est pas avare en émotions. Le voyage est infiniment poétique – nous nous répétons -, et nous cheminons comme Wang-Fô se sauva dans le conte éponyme extrait des Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar. Le parcours de droite à gauche avec des poissons qui se croisent sans se rentrer dedans car ils vont et viennent mûs par une fluidité instinctive, et l’encre de seiche qui les définit en les dessinant, les fossilisent – ils ressemblent en effet à des fossiles multi millénaires inscrits dans le minéral. Or, nous sommes devant du papier de qualité acheté chez Sennelier à Paris, ou devant de vieux draps récupérés, parfois brodés, blanc cassé ou uniformément immaculés, et tout cela tracé de noir animal, organique ; pur. Très pur (*). Il y a là non seulement des silhouettes, mais des détails effarants de vérité, y compris lorsque certains poissons sont reproduits, retranscrits les yeux « vides », vidés, liquéfiés, soit morts depuis un certain temps après leur prise, « les yeux cavés » comme les pendus de la Ballade de Villon. Manu ne cache rien. Elle est d’une franchise intérieure totale. C’est brut enduit de douceur, animal fourré de satin, sauvage doublé de soie.


Chaque poisson est ainsi à plat, sauf ce couple de lieus noirs qui jaillit à l’unisson, verticalement, et semble initier une danse nuptiale. Ou ce banc de marbrés fuyant et dont on éprouve la vitesse grande. Une technique voisine dédiée au végétal se nomme le Tataki-zomé, et Manu s’y frotte déjà avec gourmandise (à suivre)...
La révélation Gyotaku
« La découverte du Gyotaku correspondait tellement à mon histoire, lorsque cette amie m’en parla, que ce fut un choc, en écho à mon for intérieur, à ma force intérieure également, habitée que je suis par le monde des poissons depuis trente ans. C’est ma culture, c’est mon patrimoine. Mon mari (qui n’a pas encore d’écailles sur le dos, mais peu s’en faut), après avoir travaillé un quart de siècle pour Quiksilver, et surtout après avoir été sacré champion d’Europe de surf – il était alors surnommé Le Prince des Landes », ce qui génère un sourire amoureux et ravi à Manu lorsqu’elle prononce lentement ces quatre mots... « s’est mis à pêcher chaque jour que Dieu fait « de manière obsessionnelle », précise-t-elle. Poupi, les jours de gros temps qui l’interdisent, sombre dans la mélancolie des gens de mer saisis du mal de terre. Il ne fait qu’attendre le lendemain. » Il est happé par la bile noire (qui a peut-être partie liée avec l’encre de seiche, chi lo sa) comme un bar distrait par l’hameçon dissimulé.


 Et puis le père de Manu est présent aussi, il est « dans la boucle », car il a appris à sa fille à cuisiner le poisson (et pas que), ce qu’elle fait quotidiennement avec amour et application. « Lorsque Poupi – alias Jean-Louis Poupinel – apporte le fruit de sa pêche quotidienne, « je prends donc l’empreinte de chaque poisson en le badigeonnant d’encre de seiche, puis je pose le poisson sur du papier ou sur du drap. Le corps s’imprime, y compris les tâches, l’œil, les blessures, des rayures par exemple, et je les travaille grâce à ma mémoire visuelle, je retouche en quelque sorte. Je fais ça à l’instinct aussi, je restitue du mieux que je peux l’âme du poisson à travers son œil ». C’est le lieu de toutes les concentrations, comme pour le regard humain, en somme. Ainsi les poissons morts retrouvent-ils une vivacité. Un vrai regard de vivant. « Certains sont romantiques, d’autres semblent apeurés, d’autres encore expriment leur colère ». Nous parcourons lentement l’expo. Manu Dubarry s’arrête devant un chinchard encadré. « Il était très bon en ceviche, lui ». Et avoue adorer manger les « parpaillettes », les bas-joues des poissons, situées sur les côtés de la tête (à ne pas confondre avec les kokotxas de merlu, par exemple, qui se situent sous la mâchoire inférieure de cette espèce-là).
Et puis le père de Manu est présent aussi, il est « dans la boucle », car il a appris à sa fille à cuisiner le poisson (et pas que), ce qu’elle fait quotidiennement avec amour et application. « Lorsque Poupi – alias Jean-Louis Poupinel – apporte le fruit de sa pêche quotidienne, « je prends donc l’empreinte de chaque poisson en le badigeonnant d’encre de seiche, puis je pose le poisson sur du papier ou sur du drap. Le corps s’imprime, y compris les tâches, l’œil, les blessures, des rayures par exemple, et je les travaille grâce à ma mémoire visuelle, je retouche en quelque sorte. Je fais ça à l’instinct aussi, je restitue du mieux que je peux l’âme du poisson à travers son œil ». C’est le lieu de toutes les concentrations, comme pour le regard humain, en somme. Ainsi les poissons morts retrouvent-ils une vivacité. Un vrai regard de vivant. « Certains sont romantiques, d’autres semblent apeurés, d’autres encore expriment leur colère ». Nous parcourons lentement l’expo. Manu Dubarry s’arrête devant un chinchard encadré. « Il était très bon en ceviche, lui ». Et avoue adorer manger les « parpaillettes », les bas-joues des poissons, situées sur les côtés de la tête (à ne pas confondre avec les kokotxas de merlu, par exemple, qui se situent sous la mâchoire inférieure de cette espèce-là).
Boucler la boucle, une obsession
Toutes les œuvres de Manu Dubarry sont issues de poissons pêchés dans le Gouf, aux noirs mystères réputés abyssaux, bis repetita à dessein. Et Manu de préciser qu’elles sont bien sûr toutes à l’échelle 1 :1. Forcément. Et que tous les tableaux qui sont exposés, comme les précédents qui ont été vendus, représentent des pièces ayant été cuisinées par Manu. « Je les sers soit crues, en tartare, en ceviche, soit fumées avec mon petit fumoir de table, soit cuites bien sûr mais sans les cuisiner « de trop », très simplement afin de respecter l’authenticité des saveurs originelles, comme un indispensable hommage. » Cette exposition, ce travail, sont une histoire d’amour, et de poésie forte. On boucle véritablement la boucle avec Manu, et Poupi, lequel a toujours vécu sur l’eau, une planche de surf sous ses pieds ou une ligne en mains sur son bateau.
 « Il tue ses poissons selon la technique japonaise ancestrale et douce qui évite la souffrance, et augmente le goût de la chair, appelée Ikejimé (en perçant instantanément le cerveau et la moelle épinière). Sa démarche globale est très nature, respectueuse jusqu’au bout... », souhaite préciser son épouse. En résumé, Poupi pêche, Manu fait œuvre d’art du produit de la quête de son homme, puis elle cuisine cela pour lui et toute la famille. « Je fais aussi bouillir chaque tête, et je garde les crânes (exposés également à Olatu) car ils sont tous différents, et fascinants par leur force évocatrice : un dragon ici comme issu de Games of Thrones, un profil de rapace là... De même, elle recueille les « plumes » de calamar qui sont d’une beauté transparente stupéfiante. « Avec Poupi, on ne se voit pas de la journée, il part pêcher très tôt et rentre tard, et nous avons peut-être inconsciemment cherché à nous rapprocher, à nous lier de cette façon. Il y a, oui, cette boucle, ce prolongement que je crée, et le retour en cuisine. Je le nourris de sa propre pêche, ainsi peut-il repartir pêcher le lendemain... » Un regard circulaire sur cette exposition en tous points unique relève ce banc de marbrés sur de la toile de drapeau tendue comme les deux battants d’un paravent japonais. Plus loin, une table de bistro offre des poissons imprimés sur son rond. L’empreinte, la trace, le patrimoine océanique... « Mon rêve serait de faire une expo à Capbreton de tous les poissons présents dans le Gouf, y compris dans ses profondeurs noires. » Cette exposition qui se tient à Olatu, c’est l’aquarium sec et kaléidoscopique, fantasmatique et poétique de Manu Dubarry. Il nous invite à nager pas à pas devant le palimpseste à l’envers de poissons imprimés à l’encre de seiche. Et c’est d’un parcours unique qu’il s’agit. D’un long poème qui réclame un livre hommage composé de haïkus et de dessins. Affaire en cours...
« Il tue ses poissons selon la technique japonaise ancestrale et douce qui évite la souffrance, et augmente le goût de la chair, appelée Ikejimé (en perçant instantanément le cerveau et la moelle épinière). Sa démarche globale est très nature, respectueuse jusqu’au bout... », souhaite préciser son épouse. En résumé, Poupi pêche, Manu fait œuvre d’art du produit de la quête de son homme, puis elle cuisine cela pour lui et toute la famille. « Je fais aussi bouillir chaque tête, et je garde les crânes (exposés également à Olatu) car ils sont tous différents, et fascinants par leur force évocatrice : un dragon ici comme issu de Games of Thrones, un profil de rapace là... De même, elle recueille les « plumes » de calamar qui sont d’une beauté transparente stupéfiante. « Avec Poupi, on ne se voit pas de la journée, il part pêcher très tôt et rentre tard, et nous avons peut-être inconsciemment cherché à nous rapprocher, à nous lier de cette façon. Il y a, oui, cette boucle, ce prolongement que je crée, et le retour en cuisine. Je le nourris de sa propre pêche, ainsi peut-il repartir pêcher le lendemain... » Un regard circulaire sur cette exposition en tous points unique relève ce banc de marbrés sur de la toile de drapeau tendue comme les deux battants d’un paravent japonais. Plus loin, une table de bistro offre des poissons imprimés sur son rond. L’empreinte, la trace, le patrimoine océanique... « Mon rêve serait de faire une expo à Capbreton de tous les poissons présents dans le Gouf, y compris dans ses profondeurs noires. » Cette exposition qui se tient à Olatu, c’est l’aquarium sec et kaléidoscopique, fantasmatique et poétique de Manu Dubarry. Il nous invite à nager pas à pas devant le palimpseste à l’envers de poissons imprimés à l’encre de seiche. Et c’est d’un parcours unique qu’il s’agit. D’un long poème qui réclame un livre hommage composé de haïkus et de dessins. Affaire en cours...
Léon Mazzella
---
(*) « Il est fort probable qu'avec le temps, le noir organique de ces dessins vire au sépia », confie Manu. Ce n'est que justice : sépia signifie seiche, c'est son nom latin, son étymologie. C'est ancré... L'esprit de la boucle aura le dernier mot.

J'ai longtemps fréquenté professionnellement, en tant que critique gastronomique, les-restaurants-étoilés comme on dit (et c'était pour leur attribuer des toques). Ils ne m'ont jamais fait rêver comme une auberge d'une simplicité naturelle, d'un dépouillement et d'une humilité touchants peuvent me transporter. Dimanche, une fois encore, j'ai franchi le col d'Izpegui, passées Saint-Étienne-de-Baïgorry et la Nive devant chez Arcé. En haut, j'ai pris traditionnellement un verre de Navarre (pour un euro !) en terrasse de la venta Irigoieneko, chez Peio (non sans faire quelques provisions de bouche à vil prix), dont la vue sur la vallée du Baztan est splendide, et vaut celle que nous offre le parking, côté français, soit à trente mètres de là, sur la vallée de Baïgorry (photo), puis j'ai dégouliné en voiture les lacets de la route qui conduit à Elizondo. Mais je me suis arrêté avant, à Erratzu, bourg pourvu d'un caractère architectural séduisant, où je me rendais clandestinement pendant le confinement de l'automne 2020 car, en France les restaurants étaient alors fermés, pour y déjeuner à pas d'heure (15h30), mais ici c'est possible, et j'ai d'ailleurs du patienter une demi-heure en terrasse, au soleil, peinard; à l'auberge Kastonea. La soupe de poissons, riche en palourdes, fut délicieuse, comme la morue rôtie et gambas très correcte (j'avais envie de mer, en montagne), ainsi que la tarte au fromage, pourvue de relief. Pour un billet de 20€ (prix du menu imposé), la bouteille de vin de Navarre (une pour deux) et l'eau minérale gazeuse (un peu salée, façon Vichy Catalan) compris, on y fait un déjeuner mémorable, grâce à l'environnement aussi : les milans royaux planaient bas, le soleil brillait fort, l'immense tablée voisine célébrait gentiment un faux mariage fellinien en costumes sortis de Cinecittà, et le service de cette auberge est toujours d'une gentillesse extrême. Pur bonheur. Le but de cette note est surtout de vous montrer la "carte", el menú, rédigé au stylo bille sur un petit bout de papier (le verso d'un prospectus pour une tombola). En haut à gauche, les entrées, à droite les desserts, et en bas les plats. J'adore... L.M.


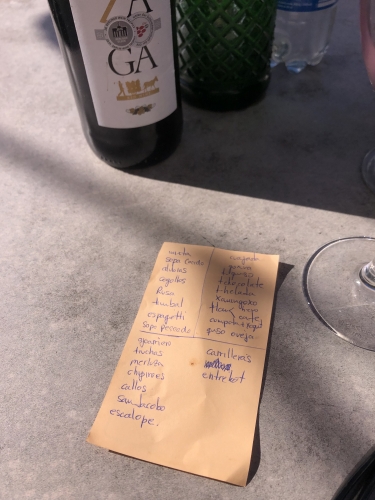
Il est paru ! Seconde édition d'un magazine/guide que j'ai eu plaisir à rédiger. Il est gratuit, Atlantica l'a édité et l'Office de Tourisme le distribue.
Cliquez ici pour feuilleter et lire l'ensemble => BG2023





Je causerai dans le poste demain matin (France Bleu Pays basque, à 9h), et je signerai ce week-end (samedi, et dimanche matin) dans un lieu inédit pour cela : les halles Biltoki d'Anglet Cinq Cantons...



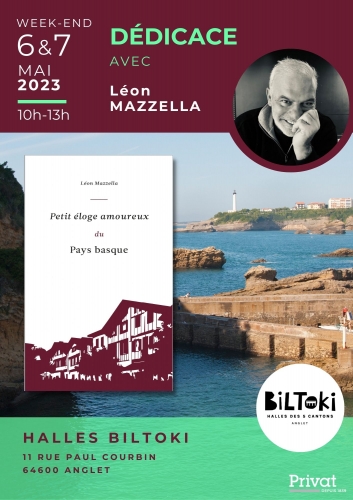
La flemme. Elle m'étreint. Je veux seulement parler de ma nouvelle flemme à évoquer, critiquer les livres que je lis ainsi que je le fais depuis plus de quarante ans (mes débuts furent aux pages livres de Sud Ouest Dimanche). J'ai juste la force, là, de citer mes derniers bonheurs de lecture, en exposant la couverture des ouvrages (il y en a vingt-sept, ci-dessous). J'en parlerai plus tard. Peut-être. Je dirai combien le nouvel inédit de Gracq, mince comme un After Eight, est dense comme une truffe melanosporum, je dirai que la seconde Beune de Michon est torride, sexuelle, mais toute en retenue, en frôlement d'une forme de tantrisme littéraire (à rapprocher de la tentative gracquienne d'exploration d'une maison découverte fortuitement, en voyeur têtu et, à la faveur d'une apparition, d'une voix, d'un pied féminin, sujet romantique à l'imaginaire hölderlinien le plus débridé). Et qu'il faut reprendre la Grande Beune, puis lire la Petite aussitôt après. Je dirai que Patricia Perello possède une prose happante, captivante, et un sacré don de récitante (au coin du feu, du côté d'Iraty - genre). Je dirai que prendre et reprendre Colette par son meilleur (Sido, Les vrilles de la vigne) comme aussi La naissance du jour, ou bien par le prisme de l'excellent Antoine Compagnon, procure un bonheur bucolique intense qui transforme chacun de nos soupirs en détente absolue, augmentée de chants de passereaux comme une guirlande de fleurs des champs dans les cheveux. Je dirai que l'ouvrage précieux de l'ami Jean-Noël Rieffel (je puis dire que je suis à l'origine de la publication de ce touchant récit d'un ornithologue chevronné amateur de poésie - notamment celle de l'immense Jaccottet, et de vins purs) fait un éloge vibrant de la migration et de ce qu'elle génère en nous, observateurs amoureux invétérés. Je dirai que l'excellent essai de Patrick Tudoret sur une philosophie certaine de la marche conçue comme une démarche littéraire autant que poétique, est un bréviaire que j'offrirai souvent; c'est sûr. Dire que mon ami Christian Authier brille une fois encore, sur un sujet qu'il possède, La Poste, avec humour, fantaisie, connaissance fine, dérision, sarcasme et nostalgie sera une mission fortement possible. Je dirai que mon ami (décidément) Emmanuel Planes m'a étonné en m'apprenant plein de choses sur une ville, la mienne (Bayonne), que je pensais connaître comme le fond de ma poche trouée. Justement... Je dirai que s'il est un seul livre (inclassable) à retenir de cette liste, et donc à lire en priorité, ce sont ces Impardonnables de l'érudite subtile Cristina Campo. Il n'est qu'à citer ses pages sur la sprezzatura, concept italien que je vous laisse le soin de découvrir, car il est si rare dans son impossible définition que je n'ose l'évoquer. Je dirai que François Cérésa nous offre un livre salutaire, puisque notre époque marquée du sceau du nivellement par le bas, manque cruellement de panache. Et que sa galerie de portraits habilement choisis renfloue notre humeur à marée basse lorsque nous observons le monde tel qu'il va médiocrement. Je dirai que Robert Desnos continue de me bouleverser chaque fois que j'ouvre n'importe lequel de ses recueils de poèmes, je dirai qu'il m'est nécessaire de frissonner au contact de ses mots tendres et dotés d'une force douce, amoureuse et candide. Je dirai que la poésie chinoise classique - davantage que l'exégèse de Le Clézio, est un viatique pour le voyageur ne sachant pas quoi caler dans la poche extérieure de son sac à dos, fut-ce pour faire un aller-retour en basse montagne dans la journée, ou bien pour partir aux antipodes. (Pour ces derniers, je conseillerai plutôt Bouvier et Thoreau, Chatwin et Hamsun, Charles Wright et André Suarès, et puis Tesson bien entendu). Je dirai que tout amateur de littérature aime l'objet livre, le tenir en mains, le humer, l'entendre flapper ses pages du bout des doigts, et affectionne donc charnellement la police des caractères - laquelle ne nous demande jamais nos papiers... Ainsi, les Miscellanées d'un bouquineur figurent-ils une déclaration d'amour au physique du livre. Je dirai que le traducteur historique de Jim Harrison, Brice Matthieussent, a eu l'idée géniale de rassembler tous les textes évoquant Chien Brun, double de Big Jim, éparpillés dans son oeuvre accomplie, en un seul et épais, et par conséquent très précieux volume. Gloire à Brice ! Je dirai que quelques académiciens ont mille fois raison de s'insurger contre la dévalorisation de la langue française, surtout à l'heure où d'aucuns écrivent franglais, ou langage sms, à une époque inquiétante où l'invective au Palais-Bourbon touche à la sémantique poissonnière, et ce fabuleux livre rouge intitulé légèrement Flânerie au pays des mots est une invite à revoir le sujet avec beaucoup de sérieux, car il y a péril en la demeure. Je dirai que Christiane Rancé, dont nous avions loué ici même le Dictionnaire amoureux des saints, est une amoureuse totale de la Botte, et qu'elle a, ancré en elle, le talent pour la dire, avec l'élégance du semeur lorsqu'il déploie son bras : Italie je t'aime. Je dirai que Colliat est un gars malin qui a eu l'idée formidable de collectionner un millier traits d'esprit sarcastiques, cyniques, claquants, tous brillants, des réparties donc, et son anthologie figure un bréviaire du tac au tac de génie. Sur la table de chevet, svp ! Je dirai que mon philosophe chouchou Michel Onfray (je suis l'un de ces rares Mohicans qui le lisent, l'aiment et le défendent) procure comme toujours une jubilation intellectuelle en nous augmentant avec son savoir et son invitation permanente à l'interrogation en forme de bousculade qui n'est jamais bourrue, mais plutôt une douce douche froide sur le cerveau. Je dirai que Bérénice Levet nous offre un essai indispensable pour monter à l'assaut du wokisme et son insondable bêtise, et que j'ai failli surligner chaque ligne de ce livre à brandir dans toute contre-manif - et à offrir à chaque dîner en ville (comme on dit). Je dirai, s'agissant de ma passion pour les oiseaux, que Légendes... apprend quantité d'histoires, comme celle du rouge-gorge, lequel doit la couleur (orangée, cependant) de sa poitrine au frôlement avec celle, ensanglantée, du Christ sur la Croix... Mais ça, Jean-Noël Rieffel l'évoque aussi. Les deux ouvrages se font écho à certaines pages, et c'est heureux. Le mince texte du grand Pierre Bergougnioux sur les oiseaux est une sorte de tendre thriller de l'enfance circonscrit en vingt pages, et je n'en dirai pas davantage sur cette nouvelle parfaite comme un oeuf. Je dirai que l'alouette mérite encore et toujours tout notre respect, notre déférence, notre admiration face à un vol stationnaire et un chant entre tous envoûtants. Un éloge lui rend joliment grâce (la mode éditoriale serait donc à l'éloge. D'ailleurs, moi-même, avec le Pays basque...). Je dirai que Pascal Quignard, avec L'amour, la mer, semble être à son paroxysme littéraire, mais comme nous nous sommes déjà fait cette réflexion avec quelques uns de ses livres précédents, nous ne savons, je ne sais plus quoi dire, écrire. Attendons les suivants, car il y en aura bientôt. Je dirai que Ramón Gómez de la Serna est définitivement un auteur majeur de chez majeur. Et que, passé le choc produit par la lecture de son monumental Automoribundia (narré ici), il n'y aurait plus qu'à savourer le plaisir de la relecture - et bien non, voici l'Aube, mini chef-d'oeuvre de plus. Je dirai que Le nageur est un bon Assouline, qui raconte avec talent le destin singulièrement tragique d'Alfred Nakache, champion olympique de natation, juif, dénoncé à la Gestapo par une crevure immonde nommée Cartonnet, son rival dans les piscines. Je dirai que À tire d'ailes est une jolie anthologie de l'oiseau dans l'art pictural, augmentée d'illustrations fidèlement imprimées, connues ou peu connues, propices à la rêverie. Je dirai... Passée la flemme, je dirai. Ou peut-être pas. Peut-être même que je bartlebyriserai mon intention première, et que j'écrirai je préfèrerais ne pas. Chi lo sa... L.M.

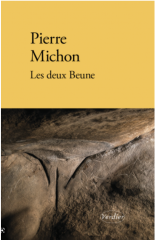



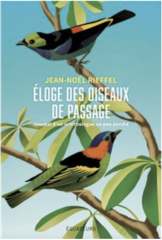

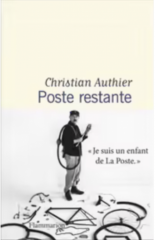

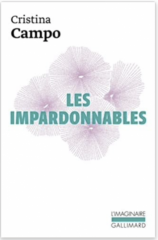




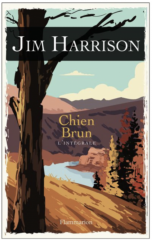


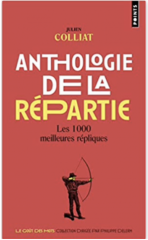
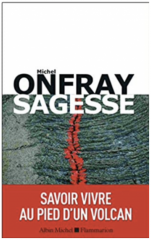

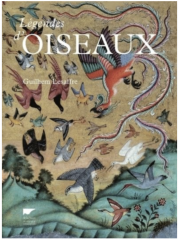
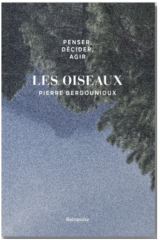
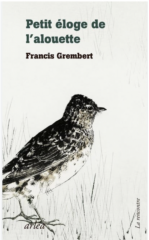


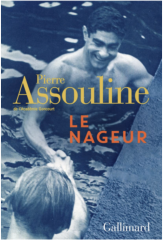


Bon, ça y est, il m'est parvenu, ainsi qu'à la presse. Il sera en librairie le 27 de ce mois (première signature officielle le 29 à Cultura/Anglet).
Réservez-le auprès de votre libraire. On en reparle bientôt.
(Je l'ai aussitôt relu pour me livrer à une chasse à la coquille. Je n'en ai trouvé aucune parmi ses 190 pages. À la bonne heure).


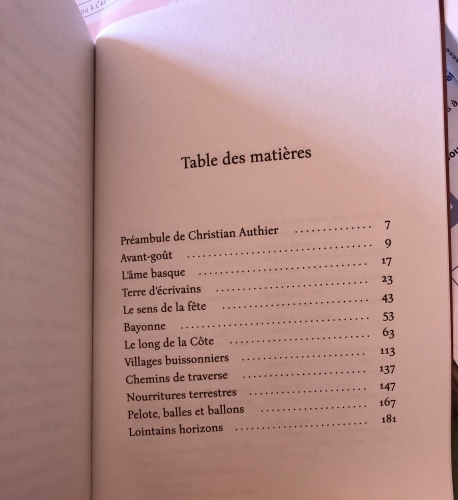
Voici ce que mon éditeur publie ce matin sur son compte Instagram :
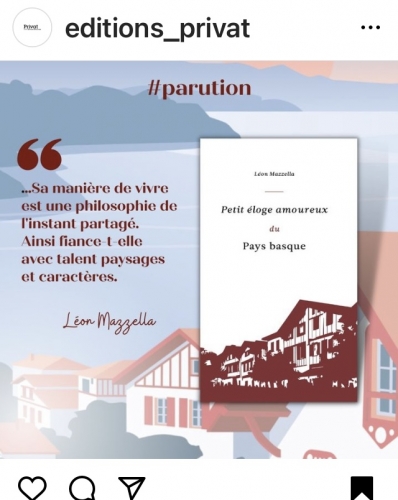
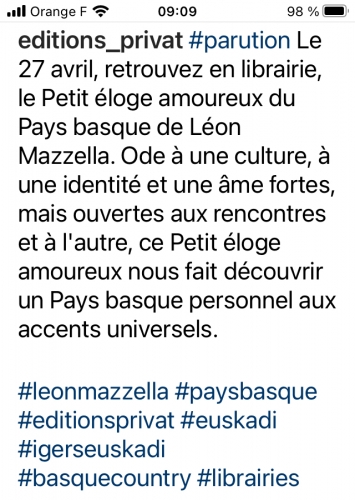

Je ne suis pas peu fier d'avoir rédigé les 64 pages du premier magazine du négociant hédoniste en vins du Grand Sud-Ouest Lionel Osmin (& Cie). Il paraît, il est beau, il est riche, gouleyant, friand, convivial, sympa, généreux, très très Sud-Ouest, et il est gratuit. C'est bien plus qu'un catalogue pour les nombreux vins proposés par l'enseigne paloise. C'est la première version de l'expression d'un art de vivre certain. J'ai mis mon coeur à l'écrire, si cela peut se dire. L.M.
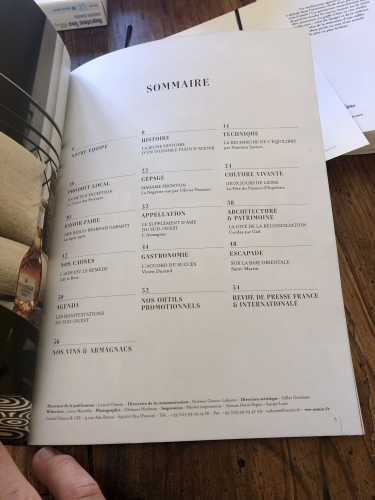

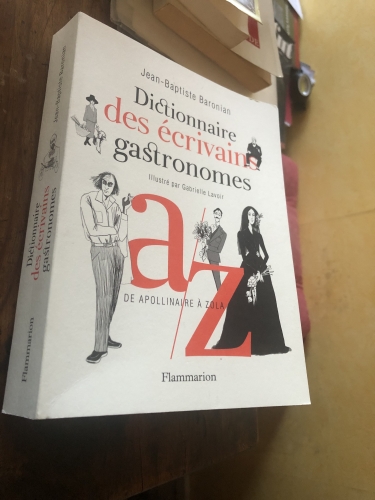
Surprise, ce matin, lorsqu'un ami m'informa de la parution, en octobre dernier, d'un épais (430 pages) Dictionnaire des écrivains gastronomes chez Flammarion, signé Jean-Baptiste Baronian, et dans lequel je figure aux pages 257 et 258, entre Harry Mathews et Jay McInerney, pensant que j'étais au courant, ajoutant un tu crois qu'il nous aurait prévenus, ce petit cachottier? à l'adresse d'un mini groupe WhatsApp de quatre personnes... Je m'enquis de sa disponibilité en librairie et en trouvai un exemplaire dans la journée, dont voici des images. L'ouvrage est passionnant, qui va en effet d'Apollinaire à Zola en passant par les classiques Balzac, Baudelaire, Blixen, Boileau, Brillat-Savarin, et les modernes comme Barbery, Barnes, Barjavel, Boudard, pour ne citer que quelques noms épinglés à la lettre B. C'est dire si l'ouvrage est riche. Et savoureux. L.M.
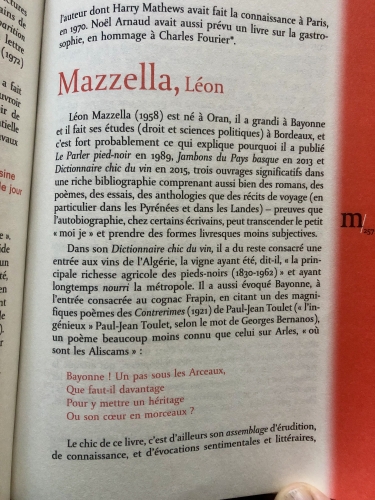
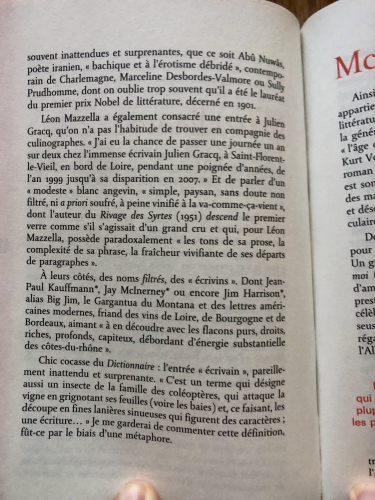
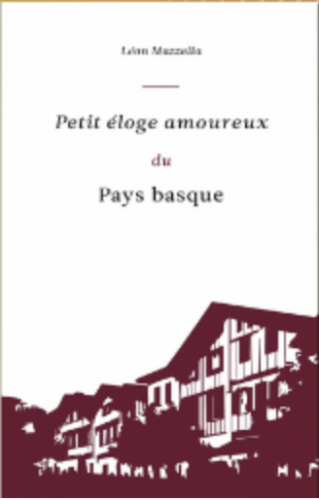 Il est certes trop tôt pour évoquer cela, mais puisque les sites marchands proposent de le pré-commander, je vous montre les "prière d'insérer" de l'éditeur de mon prochain livre, trouvés ce matin sur les sites divers comme la fnac, amazon, Babelio (ce dernier donne un texte plus touchant, mais les deux sont signés de mon éditeur chez Privat, Christian Authier). Patience jusqu'au 27 avril, jour de sortie de mon (très subjectif) Petit éloge amoureux du Pays basque.
Il est certes trop tôt pour évoquer cela, mais puisque les sites marchands proposent de le pré-commander, je vous montre les "prière d'insérer" de l'éditeur de mon prochain livre, trouvés ce matin sur les sites divers comme la fnac, amazon, Babelio (ce dernier donne un texte plus touchant, mais les deux sont signés de mon éditeur chez Privat, Christian Authier). Patience jusqu'au 27 avril, jour de sortie de mon (très subjectif) Petit éloge amoureux du Pays basque.


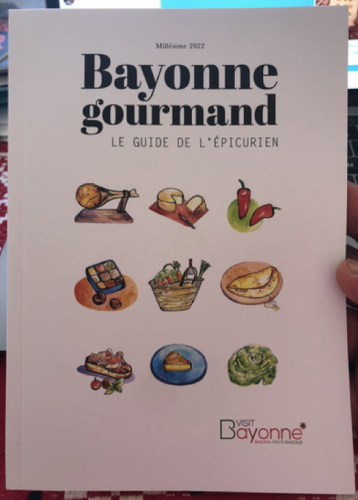
Un 64 pages "hecho a mano" (gauche, avé stylo au bout des doigts : j'ai quasiment tout rédigé). Réalisé avec le concours de l'Office de Tourisme et de l'agence Atlantica : Bertrand, Yaelle, Théoline, Mathieu. Il paraît et il est gratuit. Chipez-le, bonnes emplettes, cuisine et restos ! L.M.






 Retour d'une salle obscure où la lumière, la Lumière, vint, divine, de la voix rocailleuse de Big Jim, notre cher, si cher Jim Harrison, disparu il y aura six ans dans trois jours. Le film que lui consacrent François Busnel et Adrien Soland est une ode aux grands espaces, à la poésie, à la Nature, aux animaux, aux rivières, aux arbres, aux femmes de la trempe de Dalva, l'inoubliable héroïne de son plus puissant roman, et aussi de Linda son épouse cinquante-quatre années durant. Jim est au bout du rouleau, il titube, tousse, ahane, fume sans relâche, s'aide d'une canne, s'essuie fréquemment la paupière qui abrite un oeil de verre depuis ses dix ans, il est lui-même. Cash. Tellement naturel, à Paradise Valley, dans le Michigan, avec sa bedaine qui jaillit du tee-shirt, ses gris-gris punaisés sur le mur de sa table de travail, où il écrivit tout son œuvre au stylo noir, et jusqu'au volant ganté de cuir indien de son 4x4 qui conduisit l'équipée jusqu'à Patagonia (Arizona), où il résida parfois et où la Faucheuse le cueillit. Ce film est émouvant car il est pudique, franc du collier, sans fard, silencieux, ouvert sur des territoires traversés par un pygargue, un vautour, un chevreuil, des bisons, deux chiens de chasse appartenant à Jim Fergus, une truite hameçonnée, des forêts et des montagnes larges comme l'univers, dans un clair-obscur de circonstance. On y voit aussi les villages américains poussiéreux, leurs commerces, leurs véhicules garés, une station-service à vendre, une désolation palpable, une barmaid sexy que Jim ne peut s'empêcher d'alpaguer en lui baisant élégamment la main droite avec la dégaine de Charles Denner à la fin du film L'homme qui aimait les femmes, de Truffaut. Tout est dit, en sourdine, sur la subtilité, le tact de l'oeuvre d'un grand écrivain américain. J'ai tout lu de lui. Absolument tout, sauf ce que l'édition nous réserve sans doute encore d'inédits, de raclures bonnes à déguster, d'articles récupérés, de nouvelles inédites, de poèmes retrouvés (ce fut un immense poète de la Nature). Je regretterai éternellement cette annulation forcée
Retour d'une salle obscure où la lumière, la Lumière, vint, divine, de la voix rocailleuse de Big Jim, notre cher, si cher Jim Harrison, disparu il y aura six ans dans trois jours. Le film que lui consacrent François Busnel et Adrien Soland est une ode aux grands espaces, à la poésie, à la Nature, aux animaux, aux rivières, aux arbres, aux femmes de la trempe de Dalva, l'inoubliable héroïne de son plus puissant roman, et aussi de Linda son épouse cinquante-quatre années durant. Jim est au bout du rouleau, il titube, tousse, ahane, fume sans relâche, s'aide d'une canne, s'essuie fréquemment la paupière qui abrite un oeil de verre depuis ses dix ans, il est lui-même. Cash. Tellement naturel, à Paradise Valley, dans le Michigan, avec sa bedaine qui jaillit du tee-shirt, ses gris-gris punaisés sur le mur de sa table de travail, où il écrivit tout son œuvre au stylo noir, et jusqu'au volant ganté de cuir indien de son 4x4 qui conduisit l'équipée jusqu'à Patagonia (Arizona), où il résida parfois et où la Faucheuse le cueillit. Ce film est émouvant car il est pudique, franc du collier, sans fard, silencieux, ouvert sur des territoires traversés par un pygargue, un vautour, un chevreuil, des bisons, deux chiens de chasse appartenant à Jim Fergus, une truite hameçonnée, des forêts et des montagnes larges comme l'univers, dans un clair-obscur de circonstance. On y voit aussi les villages américains poussiéreux, leurs commerces, leurs véhicules garés, une station-service à vendre, une désolation palpable, une barmaid sexy que Jim ne peut s'empêcher d'alpaguer en lui baisant élégamment la main droite avec la dégaine de Charles Denner à la fin du film L'homme qui aimait les femmes, de Truffaut. Tout est dit, en sourdine, sur la subtilité, le tact de l'oeuvre d'un grand écrivain américain. J'ai tout lu de lui. Absolument tout, sauf ce que l'édition nous réserve sans doute encore d'inédits, de raclures bonnes à déguster, d'articles récupérés, de nouvelles inédites, de poèmes retrouvés (ce fut un immense poète de la Nature). Je regretterai éternellement cette annulation forcée 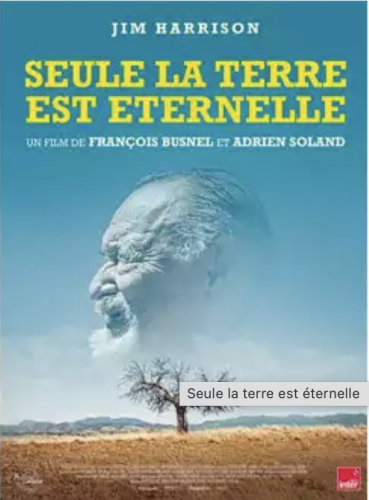 (Maman était bien trop malade pour que je parte longtemps) d'un rendez-vous pris avec lui dans le Michigan afin de "tirer" son portrait sur quelques pages dans le magazine (La Chasse) que je pilotais dans les années 1995 à 2000. Je me souviens avoir déchiré avec mélancolie mon billet d'avion. Ce soir, je reprendrai Légendes d'automne et Dalva au hasard des pages, au gré du vent, en entendant le timbre craquelé - you know... - de sa voix de grizzly édenté et romantique. L.M.
(Maman était bien trop malade pour que je parte longtemps) d'un rendez-vous pris avec lui dans le Michigan afin de "tirer" son portrait sur quelques pages dans le magazine (La Chasse) que je pilotais dans les années 1995 à 2000. Je me souviens avoir déchiré avec mélancolie mon billet d'avion. Ce soir, je reprendrai Légendes d'automne et Dalva au hasard des pages, au gré du vent, en entendant le timbre craquelé - you know... - de sa voix de grizzly édenté et romantique. L.M.
Cliquez là => LE BRUISSEMENT DU MONDE
Le choix de la première chronique littéraire de l’année s’apparente à la cueillette des champignons, dans un sous-bois, à l’automne, quand la feuille morte rythme le pas, quand l’incertitude guide la main du critique. La pluie grise les sentiments, la nature protège et isole; le critique hésite, il tâtonne, il se rétracte parfois, puis il se lance, il a enfin trouvé le livre qui correspond à son souffle intérieur, à son émotion du moment, à sa volonté de ne pas ensorceler le monde. En 2021, l’esprit ne sera ni à la querelle incestueuse, ni à la légèreté béate, plutôt à la beauté qui s’efface peu à peu, elle s’échappe, nous le sentons charnellement, et pourtant, il faut la retenir, s’incliner une dernière fois devant elle, la remercier encore et toujours. Se rappeler que sans elle, nous sommes des êtres désarticulés, surnuméraires fantômes. Cette beauté fugace n’est pas grandiloquente, elle ne bombe pas le torse, elle ne nous fait pas du gringue au coin d’une rue ou à la lecture d’un paragraphe trop étincelant; discrète, elle sait tenir ses distances.
Elle s’apprivoise difficilement. L’écrivain Léon Mazzella, styliste des terres basques, grand spécialiste du vin, part à sa recherche dans Le Bruissement du monde aux éditions Passiflore. Il est de ces explorateurs esthètes qui ne surjouent pas la surprise ou l’émerveillement. Ce gracquien sème la chronique au vent, sans charger sa phrase d’un affect débordant, elle garde sa pureté originelle tout en susurrant son pouvoir d’abstraction. Là, réside le charme vivifiant de ce recueil buissonnier qui promène son bonheur de vivre entre fragments, souvenirs d’enfance, nostalgie du cœur, sens de la transmission et plaisir du palais. Mazzella nous touche car, avouons-le, il caresse notre vieux monde, il cajole notre désenchantement, il ouvre la volière de notre mémoire. Ne vous méprenez pas sur son dessein, il ne panthéonise pas le passé, ce n’est pas un embaumeur, plutôt un exhausteur de goût. Son toucher de plume lifte l’existence, lui donne du rebond. Nous avons les mêmes codes d’entrée, les mêmes marottes, les Renault Floride et les chevauchées landaises de Christine de Rivoyre
Avec ce compagnon hussard, on se rappelle d’un texte lu à l’adolescence qui a fait chavirer notre suffisance, on se met alors à dessiner des volutes de Havane dans le ciel laiteux de la province française, à rêver aux seins obuesques de Silvana Mangano dans « Riz amer » ou à la bouche désirable de l’impénétrable Monica Vitti. À nous extraire simplement de notre quotidien par le talent des autres, voilà un résumé de ce que fut notre jeunesse. Pour nous, garçons ahuris, bouffis de caractères d’imprimerie et de cinéphilie, la réalité passe souvent par le tamis de la fiction. Mazzella est un merveilleux brouilleur de météo, il détraque toutes les horloges. Avec lui, la chronologie s’émancipe des dates. On le suit avec gourmandise dans cette belle littérature, giboyeuse et sauvage des Trente Glorieuses puis, le texte suivant, il nous ramène au présent, dans le spectacle chantant d’une bergeronnette grise ou la pesanteur ensoleillée d’un champ de maïs. Tantôt mélodiste d’antan, tantôt aquarelliste du paysage en mouvement, sa mélancolie sous-jacente n’est ancrée dans aucun port d’attache. Elle est libre, elle se moque des convenances, elle cabote sur des côtes intimes. C’est pourquoi nous prenons autant de plaisir à le lire, surtout quand il écrit: « Je suis Claude Sautet » ou qu’il fait l’éloge du stylo à plume: « Bonheur de retrouver le glissement de l’encre, sa fluidité, et le crissement sur le papier vergé ivoire, cette teinte bleu nuit qui forme les lettres, les mots qui naissent, le mouvement du poignet, le sang qui afflue sur la dernière phalange de l’index comme si nous labourions ». Mazzella sait, par instinct, qu’un bon livre ne ressemble pas à une autoroute rectiligne, il doit cahoter, ne jamais utiliser le même instrument de musique, de la variété naît l’harmonie. Mazzella ose passer de Gracq au Bricomarché, sublime impertinence et poésie de l’infiniment petit, de Calet à Anouk Aimée, de Larbaud à une libellule indisciplinée, de Gómez de la Serna au croquant du chipiron. Vive 2021 !
Le Bruissement du monde de Léon Mazzella – éditions Passiflore.
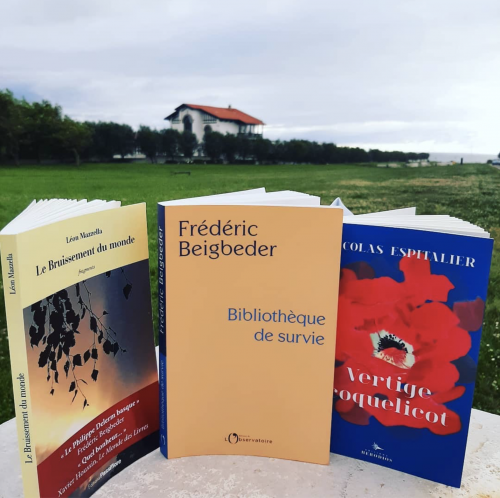
J'ajoute que Karine Beddouk lira des extraits du "Bruissement du monde" à la Mairie de Guéthary à 18h30 (Bonjour les urnes !)...
Le monde du vin sacrifie lui aussi au marketing de la Saint-Valentin, à l’instar d’une autre fête comme celle des mères. L’appellation beaujolaise Saint-Amour surfe par exemple la vague de la fête des amoureux depuis des lustres (même si la Saint-Amour est inscrite dans le calendrier à la date du 9 août, mais que celle-ci passe curieusement inaperçue). Parmi les nombreuses cuvées au nom évocateur, nous avons sélectionné neuf flacons alliant l'appel de Cupidon avec la qualité.
 Les bulles étant inévitables dimanche prochain, voici pour commencer en fanfare, Petite Douceur, champagne rosé de la plus ancienne maison de vins de la Champagne, Gosset. Et pourquoi pas déboucher cette petite douceur au lit à l’heure du brunch, avec viennoiseries, brioche bien beurrée et des œufs au bacon ! Oubliez les boissons chaudes et les jus de fruits. Ce champagne à la robe délicatement saumonée et au nez de petits fruits rouges maintient également son cap de pureté face à un financier, un macaron, et saura escorter plus tard un plat sucré-salé, ou bien exotique et volontiers épicé (55€). Notre coup de cœur effervescent.
Les bulles étant inévitables dimanche prochain, voici pour commencer en fanfare, Petite Douceur, champagne rosé de la plus ancienne maison de vins de la Champagne, Gosset. Et pourquoi pas déboucher cette petite douceur au lit à l’heure du brunch, avec viennoiseries, brioche bien beurrée et des œufs au bacon ! Oubliez les boissons chaudes et les jus de fruits. Ce champagne à la robe délicatement saumonée et au nez de petits fruits rouges maintient également son cap de pureté face à un financier, un macaron, et saura escorter plus tard un plat sucré-salé, ou bien exotique et volontiers épicé (55€). Notre coup de cœur effervescent.
Le Champagne Chassenay d’Arce propose sa cuvée Confidences (rosé 2012,  66,30€). Belle robe intense, bulle généreuse, joli nez de fruits rouges et blancs, d’épices et légèrement réglissé. 86% de pinot noir (dont 13% de vin rouge), dopés par 12% de chardonnay et 2% de pinot blanc. C’est élégant, profond, charnu, friand, riche et persistant en bouche, avec des notes florales et minérales. Six ans de vieillissement en bouteilles sont nécessaires à l’élaboration de ce champagne digne d’accompagner un carpaccio de Saint-Jacques, puis un dos de cabillaud très peu cuit au four, juteux à souhait.
66,30€). Belle robe intense, bulle généreuse, joli nez de fruits rouges et blancs, d’épices et légèrement réglissé. 86% de pinot noir (dont 13% de vin rouge), dopés par 12% de chardonnay et 2% de pinot blanc. C’est élégant, profond, charnu, friand, riche et persistant en bouche, avec des notes florales et minérales. Six ans de vieillissement en bouteilles sont nécessaires à l’élaboration de ce champagne digne d’accompagner un carpaccio de Saint-Jacques, puis un dos de cabillaud très peu cuit au four, juteux à souhait.
 Plus modeste mais bluffant en le dégustant à l’aveugle, Sainchargny Extatic Brut Blanc est un Crémant de Bourgogne de la Cave de Lugny, issu de pinot noir (45%), de chardonnay (35%) et de gamay (20%). Sa robe pâle laisse apparaître des cordons de bulles plutôt fines. La bouche, noisettée, va vers d’autres fruits secs, et ce crémant élaboré selon la méthode traditionnelle s’accorde bien avec les tartelettes aux fruits et le kouglof, comme avec un curry d’agneau, ou encore un Brie de Meaux coulant (9,55€).
Plus modeste mais bluffant en le dégustant à l’aveugle, Sainchargny Extatic Brut Blanc est un Crémant de Bourgogne de la Cave de Lugny, issu de pinot noir (45%), de chardonnay (35%) et de gamay (20%). Sa robe pâle laisse apparaître des cordons de bulles plutôt fines. La bouche, noisettée, va vers d’autres fruits secs, et ce crémant élaboré selon la méthode traditionnelle s’accorde bien avec les tartelettes aux fruits et le kouglof, comme avec un curry d’agneau, ou encore un Brie de Meaux coulant (9,55€).
 Beauregard est le nom de la cuvée du Domaine Roux, un Santenay Premier Cru (subtile AOC située à l’extrême sud de la Côte de Beaune). Ce 2017, 100% chardonnay (29€) se révèle splendide au nez : fleurs blanches, acacia, verveine, noisette, pain grillé et beurré. Sa bouche, opulente, d’une grande douceur, mêle la poire et un léger miellé. Servez-lui du saumon cru mariné, une volaille de belle naissance (Challans, Bresse), un foie gras au torchon de votre fabrication, et vos papilles participeront à la fête.
Beauregard est le nom de la cuvée du Domaine Roux, un Santenay Premier Cru (subtile AOC située à l’extrême sud de la Côte de Beaune). Ce 2017, 100% chardonnay (29€) se révèle splendide au nez : fleurs blanches, acacia, verveine, noisette, pain grillé et beurré. Sa bouche, opulente, d’une grande douceur, mêle la poire et un léger miellé. Servez-lui du saumon cru mariné, une volaille de belle naissance (Challans, Bresse), un foie gras au torchon de votre fabrication, et vos papilles participeront à la fête.
Les Vignerons artisans de Carcastel (Corbières) proposent la cuvée L’Ange Blanc,  en IGP Vallée du Paradis. (2019, 7€). Ce blanc issu de roussanne (85%) et de marsanne (15%) est idéal pour un apéritif amoureux, à condition d’avoir préparé, pour deux, deux tranches (calibrées) d’aubergine passées au four, beurrées de tapenade noire maison et deux filets de rougets saisis (sur peau) à l’unilatérale que l'on allonge sur ce beau matelas. Un filet d’huile d’olive, une pincée de sel, et hop ! Vin d’une grande fraîcheur, doté d’une nervosité agréable, il exprime le chèvrefeuille, l’abricot, le miel (la délicate roussane) d’une part, les fruits jaunes et blancs, les fleurs, le noisetté (la vigoureuse marsanne) d’autre part. Un couple dans la bouteille.
en IGP Vallée du Paradis. (2019, 7€). Ce blanc issu de roussanne (85%) et de marsanne (15%) est idéal pour un apéritif amoureux, à condition d’avoir préparé, pour deux, deux tranches (calibrées) d’aubergine passées au four, beurrées de tapenade noire maison et deux filets de rougets saisis (sur peau) à l’unilatérale que l'on allonge sur ce beau matelas. Un filet d’huile d’olive, une pincée de sel, et hop ! Vin d’une grande fraîcheur, doté d’une nervosité agréable, il exprime le chèvrefeuille, l’abricot, le miel (la délicate roussane) d’une part, les fruits jaunes et blancs, les fleurs, le noisetté (la vigoureuse marsanne) d’autre part. Un couple dans la bouteille.
 Du côté du Muscadet de Sèvre-et-Maine, en Cru Clisson (Cru communal depuis 2011), le Château d’Amour 2014 (14,50€) doit son nom aux amoureux du village de Maisdon-sur-Sèvre qui se retrouvaient en cachette derrière le chai de ce domaine, dans les années 1890, alors délaissé après le passage du phylloxera. Blanc sec issu de melon de Bourgogne, riche, structuré, élégant, Château d’Amour exprime un nez de fruits mûrs et confits. Sa bouche, ronde, grasse, flirte avec le coing, les agrumes mûrs, et ses notes légères de miel ne contraignent pas sa minéralité. Un régal avec une cuisine de la mer (Saint-Jacques snackées, queue de lotte rôtie, dos de merlu à l’Espagnole...). Notre coup de cœur en blanc.
Du côté du Muscadet de Sèvre-et-Maine, en Cru Clisson (Cru communal depuis 2011), le Château d’Amour 2014 (14,50€) doit son nom aux amoureux du village de Maisdon-sur-Sèvre qui se retrouvaient en cachette derrière le chai de ce domaine, dans les années 1890, alors délaissé après le passage du phylloxera. Blanc sec issu de melon de Bourgogne, riche, structuré, élégant, Château d’Amour exprime un nez de fruits mûrs et confits. Sa bouche, ronde, grasse, flirte avec le coing, les agrumes mûrs, et ses notes légères de miel ne contraignent pas sa minéralité. Un régal avec une cuisine de la mer (Saint-Jacques snackées, queue de lotte rôtie, dos de merlu à l’Espagnole...). Notre coup de cœur en blanc.
À Régnié (quel drôle de nom, dirait Prévert), appellation d’origine protégée, Cru du Beaujolais, le Domaine Franck Chavy propose la cuvée Paradis (2019, 9,60€) issue de gamay noir. Vieilles vignes, petits rendements, utilisation de la micro-oxygénation afin d’accompagner le mûrissement avec précision, tout est pensé chez Chavy. Cette cuvée paradisiaque s’accorde à merveille avec la charcuterie ibérique à l’apéritif, puis avec une viande rouge grillée au barbecue ou bien à la cheminée, ainsi qu’avec un fromage de brebis basque (ardi gasna), grâce à son nez de petits fruits noirs (mûre, myrtille), et rouges (cerise, surtout), et à sa bouche gourmande et souple donnant l’agréable sentiment de croquer dans une pêche de vigne.
d’origine protégée, Cru du Beaujolais, le Domaine Franck Chavy propose la cuvée Paradis (2019, 9,60€) issue de gamay noir. Vieilles vignes, petits rendements, utilisation de la micro-oxygénation afin d’accompagner le mûrissement avec précision, tout est pensé chez Chavy. Cette cuvée paradisiaque s’accorde à merveille avec la charcuterie ibérique à l’apéritif, puis avec une viande rouge grillée au barbecue ou bien à la cheminée, ainsi qu’avec un fromage de brebis basque (ardi gasna), grâce à son nez de petits fruits noirs (mûre, myrtille), et rouges (cerise, surtout), et à sa bouche gourmande et souple donnant l’agréable sentiment de croquer dans une pêche de vigne.
 La célèbre maison Vidal-Fleury (sise à Tupin-et-Semons) propose une Côte-Rôtie, Brune & Blonde (2018, 60€) issue de syrah et de 5% de viognier (nos deux cépages fétiches). Le nom de la cuvée fait référence aux deux vignobles de l’AOC. La brune évoque la tendresse et la puissance, la blonde la vivacité et la délicatesse. Ce nectar-ci est élevé « sous bois » (fûts et foudres) deux années durant. Sa robe a de beaux reflets carmin (Carmen n’est jamais loin, avec la syrah). Son nez vif, intense, possède des notes caractéristiques de fruits noirs frais, de violette, de poivre blanc et d’olive noire. La bouche, riche, ample, est « pleine », profondément fraîche, épicée. Belle longueur. C’est le vin qui se fiance à un gibier à poil (chevreuil, sanglier) avec panache et sans ambages. ¡ Olé !
La célèbre maison Vidal-Fleury (sise à Tupin-et-Semons) propose une Côte-Rôtie, Brune & Blonde (2018, 60€) issue de syrah et de 5% de viognier (nos deux cépages fétiches). Le nom de la cuvée fait référence aux deux vignobles de l’AOC. La brune évoque la tendresse et la puissance, la blonde la vivacité et la délicatesse. Ce nectar-ci est élevé « sous bois » (fûts et foudres) deux années durant. Sa robe a de beaux reflets carmin (Carmen n’est jamais loin, avec la syrah). Son nez vif, intense, possède des notes caractéristiques de fruits noirs frais, de violette, de poivre blanc et d’olive noire. La bouche, riche, ample, est « pleine », profondément fraîche, épicée. Belle longueur. C’est le vin qui se fiance à un gibier à poil (chevreuil, sanglier) avec panache et sans ambages. ¡ Olé !
Afin d’achever ce florilège aux noms évocateurs, toujours en Côte-Rôtie (notre appellation favorite : nous ne sommes pas difficile !..), le Domaine Christophe Pichon, à Chavanay, propose la cuvée Promesse (2019, 42€), laquelle représente à peine 4 ha. Le vin est issu de syrah (90%) et de viognier (10%). Il passe 13 mois en fûts neufs (75%) et en fûts d’un an (25%). Puissance et élégance sont sa double signature. Sa robe sombre et profonde, son nez fruité mais aussi fleuri et épicé (cassis, myrtille, léger grillé), sa bouche généreuse et longue, accentuent la typicité de l’appellation. La syrah tient sa promesse d’excellence, elle est présente, pulpeuse, fraîche, d’une élégance rare. Idéal avec une côte de boeuf de Galice maturée quelques semaines, ou bien une paire de sarcelles d'hiver rôties à la goutte de sang. Notre (grand) coup de cœur en rouge. L.M.
pas difficile !..), le Domaine Christophe Pichon, à Chavanay, propose la cuvée Promesse (2019, 42€), laquelle représente à peine 4 ha. Le vin est issu de syrah (90%) et de viognier (10%). Il passe 13 mois en fûts neufs (75%) et en fûts d’un an (25%). Puissance et élégance sont sa double signature. Sa robe sombre et profonde, son nez fruité mais aussi fleuri et épicé (cassis, myrtille, léger grillé), sa bouche généreuse et longue, accentuent la typicité de l’appellation. La syrah tient sa promesse d’excellence, elle est présente, pulpeuse, fraîche, d’une élégance rare. Idéal avec une côte de boeuf de Galice maturée quelques semaines, ou bien une paire de sarcelles d'hiver rôties à la goutte de sang. Notre (grand) coup de cœur en rouge. L.M.

Je tombe à l'instant sur l'annonce de la parution de mon prochain livre en surfant sur la Toile, à la recherche d'une référence bibliographique. J'ignorais qu'il était déjà signalé, notamment sur les plateformes de vente comme FNAC, Decitre, Amazon, etc. Il en va des livres comme des maillots de bain ou des manteaux : on achète les premiers en hiver et les seconds en été, lorsqu'ils apparaissent aux vitrines. Il en va ainsi de tout, au fond, sauf des fraises des quatre saisons qui naissent sous serre. Anticiper, cela me connait. Le métier de journaliste consiste aussi à avoir un temps d'avance, ne serait-ce que pour des questions de dates de bouclage. Sauf que là, il faut attendre. On peut juste réserver, pré-acheter (directement sur le site de l'éditeur, d'ailleurs). Bien, puisque ce n'est plus un secret, voici ce qu'en dit, justement, mon éditeur => Le Bruissement du monde À présent, il me tarde de distribuer le faire-part de naissance du petit dernier... L.M.
Voici un tandem, un jeune couple, Mathilde et Tristan, des fous de gastronomie de grande qualité qui, ayant fondé le club MOICHEF, https://bit.ly/30FNzPU, sont devenus des chasseurs de bon goût, d'excellents produits qu'ils proposent via leur club. Leur niouzzelaiteure est déjà un régal d'humour, de pertinence, de qualité d'écriture, de bonne humeur (regardez les vidéos de Tristan), et de créativité (lisez Mathilde, elle en a sous le pied). À présent, ils effectuent un périple d'une année en minibus dans tous les coins où niche, pousse, croît, nait, prospère le meilleur qui se mange et se boit. Ils sont donc sur le terrain, à la rencontre de ceux qui font. Suivez-les, adhérez, commandez et... appelez-moi la veille d'un dîner. J'apporterai les fleurs (pas forcément comestibles). Hardi-petit !
=> Le Tour de France gastronomique des Hardis
(En tant qu'ex-directeur des rédactions du magazine et des guides GaultMillau, - et même s'il s'agit là d'un club, marchand, et pas d'un média - je m'autorise à tirer mon chapeau devant cette initiative innovante, car elle dépoussière le milieu, le genre, l'approche, en lui insufflant une tonicité que la presse écrite, par exemple a(vait) perdue, et un souci fondamental - la quête du très bon -, qui justifie à lui seul une telle démarche. Et si je risque la comparaison du bout de le plume, c'est parce que, justement, MOICHEF a une façon d'aborder le monde de la gastronomie qui flirte avec les techniques de la presse, sans mélanger les genres. Cette synthèse est bluffante). L.M.

Parmi les flaconfinés débouchés à l’heure du déconfinement, été oblige, les rosés ont la part belle. Quelques blancs les poussent du col, et un rouge s’invite discrètement. Passage en revue.
 Folio, cuvée en blanc 2019 du domaine Coume del Mas en appellation Collioure est dense, sérieux, et soutient les chipirons à l’ail comme les crevettes en persillade avec flegme.
Folio, cuvée en blanc 2019 du domaine Coume del Mas en appellation Collioure est dense, sérieux, et soutient les chipirons à l’ail comme les crevettes en persillade avec flegme.
Le Domaine les Perserons, Charnay-les-Mâcon Vieilles Vignes 2017 est un bourgogne blanc bluffant de fraîcheur et d’intensité. Remarquable sur les filets de merlu à l’huile vierge.
Vignes 2017 est un bourgogne blanc bluffant de fraîcheur et d’intensité. Remarquable sur les filets de merlu à l’huile vierge.
 Le château des Bois Mathieu 2019, rosé de Saint-Mont à l’habillage rappelant les flacons de Saint-Tropez comme Miraval, est un brin canaille. Il excelle sur la charcuterie saisie avec les doigts, et avec les sardines à la plancha.
Le château des Bois Mathieu 2019, rosé de Saint-Mont à l’habillage rappelant les flacons de Saint-Tropez comme Miraval, est un brin canaille. Il excelle sur la charcuterie saisie avec les doigts, et avec les sardines à la plancha.
En Languedoc, Abbots & Delaunay propose À tire d’aile 2019, à l’étiquette ornée d'une grive mauvis gazouillante. Référence aux oiseaux qui s’envolent lorsque l’homme arrive entre les rangs de vignes gorgées de baies qui font leur régal. Fraîcheur, léger citronné, verveine fraîche. Une réussite, sur des filets épais de volaille à la crème et à la sauge.
2019, à l’étiquette ornée d'une grive mauvis gazouillante. Référence aux oiseaux qui s’envolent lorsque l’homme arrive entre les rangs de vignes gorgées de baies qui font leur régal. Fraîcheur, léger citronné, verveine fraîche. Une réussite, sur des filets épais de volaille à la crème et à la sauge.
 Pause champagne : Couvent Fils, rosé de caractère, soutient agréablement le saumon cru mariné rehaussé de soja et de wasabi. Et oui !
Pause champagne : Couvent Fils, rosé de caractère, soutient agréablement le saumon cru mariné rehaussé de soja et de wasabi. Et oui !
Quant au Gosset Blanc de Blancs Brut, né à Aÿ, il se déguste seul. Non, à deux, à l’heure du partage des confidences. (Zut, j'ai égaré sa photo).
Majestueux de douceur et de force retenue, le Condrieu 2018 de Vidal-Fleury est un viognier bien élevé qu’on a envie d’emmener en vacances. À déguster pour lui-même à l’heure où le soleil se couche et au chant du merle.
Vidal-Fleury est un viognier bien élevé qu’on a envie d’emmener en vacances. À déguster pour lui-même à l’heure où le soleil se couche et au chant du merle.
 Voici un Crémant de Bourgogne rosé brut produit par Veuve Ambal avec des notes sincères de fruits rouges et florales aussi. Parfait sur une tarte aux prunes cueillies tièdes à l’arbre.
Voici un Crémant de Bourgogne rosé brut produit par Veuve Ambal avec des notes sincères de fruits rouges et florales aussi. Parfait sur une tarte aux prunes cueillies tièdes à l’arbre.
Expression est un rosé 2019 en appellation Costières de Nîmes produit par le château Beaubois, et c’est un peu notre chouchou, car les sœur et frère Fanny et François Boyer sont des virtuoses dans cette belle région. C’est subtil, dense, charnu, syrah, grenache et cinsault semblent s’amuser en s’assemblant. Idéal pour un apéro élégant, pieds nus sur l’herbe, avec juste du pata negra bien gras.
peu notre chouchou, car les sœur et frère Fanny et François Boyer sont des virtuoses dans cette belle région. C’est subtil, dense, charnu, syrah, grenache et cinsault semblent s’amuser en s’assemblant. Idéal pour un apéro élégant, pieds nus sur l’herbe, avec juste du pata negra bien gras.
 Batti-Batti signifie picotement, émotion, en provençal. C’est le nom d’un flacon rosé (2019) fruité, gourmand, simple comme une soirée de juillet en famille, lorsque le silence reprend sa place. Le domaine Fontainebleau se situe en Provence et cela se ressent dès l’ouverture. Le Petit Ballon en a
Batti-Batti signifie picotement, émotion, en provençal. C’est le nom d’un flacon rosé (2019) fruité, gourmand, simple comme une soirée de juillet en famille, lorsque le silence reprend sa place. Le domaine Fontainebleau se situe en Provence et cela se ressent dès l’ouverture. Le Petit Ballon en a fait son étendard. Nous l’avons prié d’escorter des poivrons en « salade juive » (recette de ma mère, au four, puis ail, huile d’olive e basta così), et une tortilla de papas bravas, et ça l’a fait (photo=>).
fait son étendard. Nous l’avons prié d’escorter des poivrons en « salade juive » (recette de ma mère, au four, puis ail, huile d’olive e basta così), et une tortilla de papas bravas, et ça l’a fait (photo=>).
 Le rosé volubile nommé Les Insouciants (IGP Comté tolosan 2019), merlot de belle tenue, est signé Comtesse du Barry pour Lionel Osmin, le prince des vins de cépages du grrrrand Sud-Ouest. Corpulent, il mena la danse avec un magret grillé à trrrrès basse température.
Le rosé volubile nommé Les Insouciants (IGP Comté tolosan 2019), merlot de belle tenue, est signé Comtesse du Barry pour Lionel Osmin, le prince des vins de cépages du grrrrand Sud-Ouest. Corpulent, il mena la danse avec un magret grillé à trrrrès basse température.
Enfin, un rouge médocain, château Laujac appartenant au clan Cruse, cru bourgeois depuis 1932 (vu de dos, ci-contre), encépagé pour moitié en cabernet-sauvignon et en merlot (avec un soupçon de petit-verdot qui aurait tiré une grimace à Antoine Blondin), plongé dans un seau d’eau fraîche une heure avant ouverture, veilla à ne point contrarier un onglet ayant séjourné trois semaines en chambre froide, d’une tendreté d’anthologie. Pas mal... L.M.
Cruse, cru bourgeois depuis 1932 (vu de dos, ci-contre), encépagé pour moitié en cabernet-sauvignon et en merlot (avec un soupçon de petit-verdot qui aurait tiré une grimace à Antoine Blondin), plongé dans un seau d’eau fraîche une heure avant ouverture, veilla à ne point contrarier un onglet ayant séjourné trois semaines en chambre froide, d’une tendreté d’anthologie. Pas mal... L.M.
Prix : Mes lecteurs le savent, je ne parle jamais de vins chers. Achetez ceux-là peinards.
Photos : Quoi? Certaines ne sont pas rognées... Oui, l'été, à la maison, c'est racinaire (roots, disent les mômes, et j'entends chaque fois rouste)...
Ce conteur professionnel,, Nicolas Bourdon, que je ne connais que par cette fantastique vidéo et par un bref échange de mails, a acheté mon "Parler pied-noir" (Payot) et m'a adressé cette vidéo. J'estime qu'elle mérite une grande audience, à l'image de son talent. Faites passer, les concernés ! LM => Pataouète et l'armateur

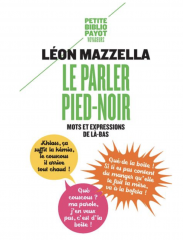

Lors du passage de janvier à février 2020, la pureté vint d’une gorgée de champagne Drappier, cuvée Clarevallis, du nom de l’abbaye cistercienne de Clairvaux fondée par Saint Bernard en 1115. De sa délicate effervescence, l’inattendu renversa la table, occupée pourtant par un viognier ardéchois chargé d'escorter une ventrèche de thon rouge. Nous avions décidé que le dessert serait une coupe de ce nouveau champagne et rien d'autre. La charge semblait audacieuse, mais le défi était lancé : le chevau-léger aurait la mission de forcer une ligne de cavalerie lourde, Eylau à l’envers, en somme... Pinot noir (75%), meunier (10%), chardonnay (10%), blanc vrai (5%) issus des parcelles d’Urville labourées à l’aide d’un cheval de trait justement, et conduites en agriculture biologique (certification Ecocert), composent Clarevallis. Pur est l’adjectif idoine, je le répète, pour désigner cette cuvée. Une sensation, rare, de lissé franc comme une source vive roulant les galets d’un torrent de montagne, cette source au bord de laquelle on s’allonge pour la cueillir entre nos paumes, envahit l’esprit et chasse tout ce qui précède d’un revers de fraîcheur. C’est d’un champagne vrai qu’il s’agit, d’un jus au fruité subtil et droit, teinté de violette à peine, de sureau, et caréné d’une minéralité souple. C’est non filtré, à peine soufré (20 mg/l.). C’est un Extra-brut, de surcroît (dosage : 4 g/l.). Pur, dis-je. Un plaisir confondant. La marque Drappier a coutume d’en pourvoir. Alors, ne cherchez pas plus loin, mais n’attendez pas le passage vers le Printemps. Nota : c’est Charline Drappier qui a conçu l’étiquette, fort réussie, en s’inspirant de la Grande Bible de Clairvaux. L.M.
---
39€ chez votre caviste.


Bernard de Clairvaux.

L'embouchure de l'Adour est un bouche-à-bouche d'amour. Le port du Boucau tremble dans un vacarme de ferraille. Une grue charge la coque d’un cargo. Au médian du fleuve, un bateau de pêche teufe-teufe. Des goélands rasent ma tête, toisent le merlu que je déguste. Juché sur une bouée, un cormoran sèche ses ailes en croix. Des remous lui offrent une danse du ventre. Calé, j’ai l'océan devant, Bayonne dans le dos, la forêt de Chiberta et les Landes sur les flancs. Paré à appareiller pour l’horizon vertical. J'aime. L.M.
Je suis en train de faire mariner un lièvre, les mains dans le sang, l’ail, l’échalote, l’armagnac, et dans le tannat aussi, lorsque j’apprends qu’Alexandre est passé de l’autre côté. Je ne l’appelais pas André à cause de Dumas, auquel il me faisait penser, et parce que la première fois que je lui ai tiré le portrait, c’était pour et dans Gault-Millau, et j’avais titré mon papier « Alexandre Daguin ». Ça l’avait fait bien marrer, le Cadet, le Mousquetaire. Nous nous sommes vus parfois. À Auch, à la radio pour des enregistrements des Grandes Gueules auxquels il me convia, à Paris pour des raouts de promo gastro à la con, et je regrette de n’avoir jamais partagé un seul repas avec Son Altesse André Daguin (comme client à sa table, pour une soupe de châtaignes, une brochette de chevreuil, un magret de palombe - et oui -, c'était différent : nous étions assis, tout petit, et il était très grand, tout blanc). Une autre fois, dans quelle gazette je ne sais plus, je titrais à son sujet : « Commissaire Magret ». Fastoche, avec le recul. Chouïa décalé, dans les années 80.
¡ Suerte, là-haut, sacré Gascon d’altitude !
Ci-dessous, un chapitre sur lui et son fils Arnaud, paru dans mon livre « Le Sud-Ouest vu par Léon Mazzella » (Hugo & Cie, pp.120-125) =>
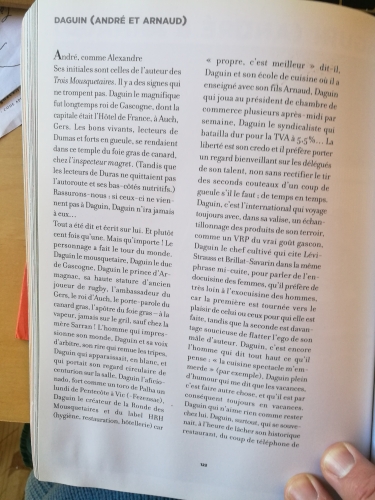

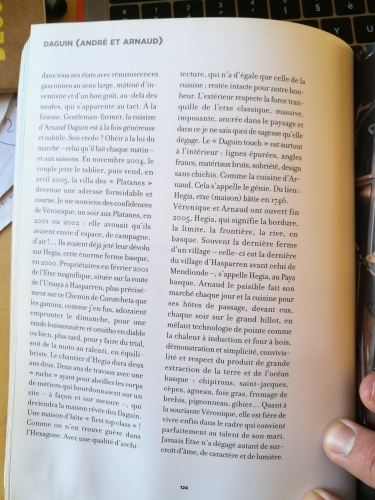

J’ai quinze ans. Mon père tient à ce que je l’accompagne à Rotterdam pour l’acquisition d’un nouveau cargo de l’armement familial, le Niels Frelsen, qui deviendra le Cap Falcon. Nous prenons la route depuis Bayonne dans la DS blanche immatriculée 813 LY 64 (j’ai toujours eu la mémoire inutile des plaques d’immatriculation – je peux en réciter une douzaine -, de véhicules ayant appartenu à des proches : 426 HW 64, la 404 rouge étrange, mi bordeaux, mi grenache de Naphtali, 714 GG 64, la Ford Anglia jaune pâle de mon grand-père maternel, 278 LZ 64, la Simca 1100 bleu métallisé de Maman - et nous prononcions alors l'adjectif avec le sentiment d'être à la mode -, et sa Floride décapotable blanche : 837 GQ 64, tant d'autres - mes propres véhicules à deux et quatre roues. Je retenais aussi les numéros de téléphone, c'était plus utile). J’ai en stock des détails gravés. Au Park Hôtel, où nous séjournons quatre nuits, nous mangeons rituellement des T-bone steacks et nous buvons (moi, à peine) de la bière Amstel. Sur le port, je suis captivé par le ballet incessant de centaines d’étourneaux, dont beaucoup sont immatures, en plumage beige, et par les goélands qui agacent les colverts nageant le long des canaux. Au fond de la cale sèche, l’énorme bateau gris à coque rouge mat est posé sur de simples traverses en bois. Cela m’impressionne. Je prends des photos avec mon Phokina 35 aux allures de boîtier 24/36 soviétique. Je sens dans le regard de mon père un plaisir immense de me voir là, avec lui. Je ne pense qu’aux oiseaux. De longues années après, je m’intéresserai à la mer, aux bateaux, au métier d'armateur qu’il pratiqua. Devenu père, j’ai ressenti ce grand bonheur de partager quelque chose d’essentiel dans la vie avec l’un de mes enfants. Hier soir, quarante-cinq ans après ce voyage à Rotterdam qui marqua tant mon père, j’ai eu la chance de montrer à mes deux enfants des traces de sangliers venus boire à la mare la nuit dernière, une crotte de renard audacieusement laissée presque devant notre porte, les plumes d’une palombe qui fut empiétée par une buse, à la pointe de l’aube sans doute, et d’autres de la chouette effraie qui niche dans l’une des granges. Dans les jumelles, nous avons observé tour à tour deux, trois, puis cinq chevreuils et quelques lièvres. Enfin, nous avons trinqué avec du cidre élaboré par un presque voisin, et dîné devant la cheminée d'une quasi rituelle côte de boeuf généreusement maturée, sur la longue table de ferme en chêne qui ne me quitte pas depuis mes seize ans. L.M.
 Blandine Vié est une sacrée auteure gourmande, passionnée de cochon au point de lui consacrer un ouvrage il y a peu et des articles à la ribambelle sur le site Greta Garbure qu’elle co-anime avec son complice Patrick de Mari. D’ailleurs, l’un de ses « posts » mis en ligne a été retenu dans une mini-anthologie de la fameuse collection « le goût de » au Mercure de France. Dans « Le goût des cochons » (8,20€) figure, aux côtés de classiques comme Renard (avec un extrait célèbre des « Histoires Naturelles »), Claudel (et un délicieux poème en prose décrivant la bête), Maupassant (avec un texte de jeunesse), Huysmans (un extrait de « En route »), Hugo (et un émouvant poème, « Le porc et le sultan »), Verlaine (avec un détonnant pastiche des « Amants » de Baudelaire, intitulé « La Mort des cochons », pornographique à souhait, tiré de « L’Album zutique » qu’il coécrivit avec Léon Valade) et, plus près de nous, Jérôme Ferrari (et un extrait brut de son « Sermon sur la chute de Rome », décrivant un paysan Corse occupé à châtrer les verrats), ou Philippe Sollers (en amoureux délicat de la chair du cochon, dont il fait l’éloge)... Figure donc un texte délicieux de Blandine Vié au sujet de l’étymologie des mots du cochon, de la truie et de ses attributs, intitulé « Une vulve de truie peut en cacher une autre ! » À l’arrière-train où vont les choses, et sans évoquer la peste porcine africaine qui fait des ravages en Chine, donc le bonheur des éleveurs bretons, et qui est provisoirement circonscrite dans les Ardennes belges, mieux vaut en rire en s’instruisant - grâce à ce texte bref et dense, érudit et drôle à la fois. Blandine y enchaîne comme dans un rébus le sens caché des mots, dont les évocations rebondissent et jouent à ... saute-cochon. Remarque : ce
Blandine Vié est une sacrée auteure gourmande, passionnée de cochon au point de lui consacrer un ouvrage il y a peu et des articles à la ribambelle sur le site Greta Garbure qu’elle co-anime avec son complice Patrick de Mari. D’ailleurs, l’un de ses « posts » mis en ligne a été retenu dans une mini-anthologie de la fameuse collection « le goût de » au Mercure de France. Dans « Le goût des cochons » (8,20€) figure, aux côtés de classiques comme Renard (avec un extrait célèbre des « Histoires Naturelles »), Claudel (et un délicieux poème en prose décrivant la bête), Maupassant (avec un texte de jeunesse), Huysmans (un extrait de « En route »), Hugo (et un émouvant poème, « Le porc et le sultan »), Verlaine (avec un détonnant pastiche des « Amants » de Baudelaire, intitulé « La Mort des cochons », pornographique à souhait, tiré de « L’Album zutique » qu’il coécrivit avec Léon Valade) et, plus près de nous, Jérôme Ferrari (et un extrait brut de son « Sermon sur la chute de Rome », décrivant un paysan Corse occupé à châtrer les verrats), ou Philippe Sollers (en amoureux délicat de la chair du cochon, dont il fait l’éloge)... Figure donc un texte délicieux de Blandine Vié au sujet de l’étymologie des mots du cochon, de la truie et de ses attributs, intitulé « Une vulve de truie peut en cacher une autre ! » À l’arrière-train où vont les choses, et sans évoquer la peste porcine africaine qui fait des ravages en Chine, donc le bonheur des éleveurs bretons, et qui est provisoirement circonscrite dans les Ardennes belges, mieux vaut en rire en s’instruisant - grâce à ce texte bref et dense, érudit et drôle à la fois. Blandine y enchaîne comme dans un rébus le sens caché des mots, dont les évocations rebondissent et jouent à ... saute-cochon. Remarque : ce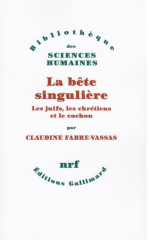 florilège fait la part belle au côté immonde du cochon davantage qu’à ses qualités. C’est toujours comme ça ! La relation de l’homme avec cette « bête singulière » (titre d’un ouvrage capital, de référence, sur le sujet et dont un extrait aurait pu figurer dans ce petit bouquin : « La Bête singulière. Les juifs, les chrétiens et le cochon », de Claudine Fabre-Vassas (Gallimard, Bibliothèque des Sciences humaines), est ambiguë depuis les origines. Nous lui ressemblons tant ! Je laisse le dernier mot à Churchill : « Donnez-moi un cochon ! Il vous regarde dans les yeux et vous considère comme son égal. » L.M.
florilège fait la part belle au côté immonde du cochon davantage qu’à ses qualités. C’est toujours comme ça ! La relation de l’homme avec cette « bête singulière » (titre d’un ouvrage capital, de référence, sur le sujet et dont un extrait aurait pu figurer dans ce petit bouquin : « La Bête singulière. Les juifs, les chrétiens et le cochon », de Claudine Fabre-Vassas (Gallimard, Bibliothèque des Sciences humaines), est ambiguë depuis les origines. Nous lui ressemblons tant ! Je laisse le dernier mot à Churchill : « Donnez-moi un cochon ! Il vous regarde dans les yeux et vous considère comme son égal. » L.M.
---
 Rappel : N’oubliez pas le superbe album, richement illustré, de Éric Ospital (le charcutier star d'Hasparren) et ses amis, intitulé « Copains comme cochons » (Tana, 24,95€), car il offre, outre 75 recettes du groin à la queue, signées de chefs très gourmands, un énorme hommage à la convivialité et à l’art de vivre... dans l’esprit du Sud-Ouest, ainsi qu'une ode à l'amitié qui fait plaisir à lire et à voir. Nous croisons, au fil des pages, pêle-mêle, Joël Dupuch, Julien Duboué, Sébastien Lapaque, Jean-Luc Poujauran, Yves Camdeborde, et aussi Sébastien Gravé, Vivien Durand, Christian Constant, Stéphane Carrade, Antoine Arena, Stéphane Jégo, tant d'autres. Ils sont tous là! Afaria!..
Rappel : N’oubliez pas le superbe album, richement illustré, de Éric Ospital (le charcutier star d'Hasparren) et ses amis, intitulé « Copains comme cochons » (Tana, 24,95€), car il offre, outre 75 recettes du groin à la queue, signées de chefs très gourmands, un énorme hommage à la convivialité et à l’art de vivre... dans l’esprit du Sud-Ouest, ainsi qu'une ode à l'amitié qui fait plaisir à lire et à voir. Nous croisons, au fil des pages, pêle-mêle, Joël Dupuch, Julien Duboué, Sébastien Lapaque, Jean-Luc Poujauran, Yves Camdeborde, et aussi Sébastien Gravé, Vivien Durand, Christian Constant, Stéphane Carrade, Antoine Arena, Stéphane Jégo, tant d'autres. Ils sont tous là! Afaria!..
Cela se passait le 19 juin dernier et il faisait une chaleur inhumaine dans ce restaurant nommé Elmer, planté dans le Marais à Paris, rue Notre-Dame de Nazareth pour être précis. Pour preuve, je sifflai une bouteille d’eau glacée avec des bulles qui piquaient fort mais tant pis et en quelques libations, à peine arrivé, non sans avoir salué ma charmante hôtesse Anne-Sophie, visiblement zen et comme thermo-régulée de la tête aux pieds.
Mes confrères transpiraient et ça ne semblait pas les gêner d’avoir la chemise collée aux poils visibles sur leur peau, à travers un tissu comme passé sous la douche. Moi si. Cette vue me gênait, et j’enrageais qu’un choc thermique puisse faire apparaître un pareil spectacle sur moi, sitôt débarqué, jeté au hammam comme un homard dans le bouillon. Pour un peu, je repartais, ce que j’ai déjà fait maintes fois pour moins que cela. Or, je restai, car le sujet était friand, sinon affriolant : déguster des vins d’Ardèche dans les trois couleurs, et nous aimons beaucoup, vraiment, les vins de cette région-là. La thématique était d’ailleurs plus choisie : « Les Exceptions du Sud Ardèche ». Vingt-cinq vins à (re)découvrir.

Mes pensées, assorties d’un regard et de quelques mots amicaux, allèrent immédiatement à la petite brigade qui souffrait à plus de 50° Celsius afin d’achever avec peine et plaisir de préparer ce qui devait nous régaler (ah, ces filets de canette avec des petits pois à la crème de sarriette et leur surprenant jus à la cerise, qui suivirent un inoubliable vinaigre de bonite juste déposé comme ça, goutte à goutte, sur un tartare de bœuf au couteau de belle extraction). Anne-Sophie et Manon avaient les yeux qui virevoltaient, elles contrôlaient tout, y compris la température de la salle. Elles veillaient aux groins...
Je faillis défaillir, ne pouvant me résoudre à « attaquer » quelque flacon avec mon verre à pied, eu égard aussi au rang de soldats – j’ai nommé les bouteilles, nombreuses, alignées, pleurant leurs larmes car le journaliste en dégustation est un goujat qui ne respecte rien, plus rien, à commencer par ses congénères qu’il bouscule, toise, salue de loin ou ne salue pas (tiens, je repense à l’opuscule nécessaire de Stéphane Méjanès : lire plus bas la lecture que j’en fis tout récemment), car que ça coule ne les gène guère, tu penses, ils se font rincer, alors le liquide, c’est naturel qu’il dégouline, lors qu’ils ne découlent, eux, d’aucune source buvable... J’ai reconnu dans le tas de chairs amassées un pique-assiette notoire, qui est de tous les râteliers du midi et du soir, et qui déguste aussi bien que je récite la messe en Latin...
 Et que c’est donc à hue et à dia, à la va comme je te pousse carrément qu'il faut alors tendre un bras que l’on voudrait télescopique afin d’attraper une première bouteille de hasard, le rosé 2018 friand en diable du Domaine du Père Léon (cela ne s’invente pas, et je ne fis pas exprès, croyez-moi). Grenache, syrah, cinsault d’une rondeur, d’un fruité charmant, flatteur mais convaincant car conquérant, et ça vaut la bagatelle de 6€ - prenez la clé de la malle du 4x4, Nathalie, et garnissez avec vos caisses, car l’été sera long et les amis nombreux, à la campagne !.. Bon, je commence ?.. Je sais, Laurent, que tu ne m’en voudras pas pour ce « compte-rendu » atipico.
Et que c’est donc à hue et à dia, à la va comme je te pousse carrément qu'il faut alors tendre un bras que l’on voudrait télescopique afin d’attraper une première bouteille de hasard, le rosé 2018 friand en diable du Domaine du Père Léon (cela ne s’invente pas, et je ne fis pas exprès, croyez-moi). Grenache, syrah, cinsault d’une rondeur, d’un fruité charmant, flatteur mais convaincant car conquérant, et ça vaut la bagatelle de 6€ - prenez la clé de la malle du 4x4, Nathalie, et garnissez avec vos caisses, car l’été sera long et les amis nombreux, à la campagne !.. Bon, je commence ?.. Je sais, Laurent, que tu ne m’en voudras pas pour ce « compte-rendu » atipico.
So, : le viognier (blanc, 2017) succulent de la Gamme Réserve du Domaine du Colombier, qui naît sur des coteaux argilo-silicieux et volontiers caillouteux, et qui jouit le veinard d’une fermentation lente sur lies en fûts de chêne avec batonnage durant trois à quatre mois (on croirait lire du Ponge mâtiné d’un compte-rendu de stage chez Sade), est renversant de pureté. Rien à dire de plus. Le mot pureté ¡ Basta ya ! Un autre viognier (quel cépage magnifique, en Ardèche, oublions un instant Condrieu ! Nous repensons à celui, adoré, de notre pote Christophe Reynouard, du Domaine du Grangeon – notre querencia ardéchoise, car le bonhomme te fait aussi un chatus et une syrah à tomber raide par terre).
Colombier, qui naît sur des coteaux argilo-silicieux et volontiers caillouteux, et qui jouit le veinard d’une fermentation lente sur lies en fûts de chêne avec batonnage durant trois à quatre mois (on croirait lire du Ponge mâtiné d’un compte-rendu de stage chez Sade), est renversant de pureté. Rien à dire de plus. Le mot pureté ¡ Basta ya ! Un autre viognier (quel cépage magnifique, en Ardèche, oublions un instant Condrieu ! Nous repensons à celui, adoré, de notre pote Christophe Reynouard, du Domaine du Grangeon – notre querencia ardéchoise, car le bonhomme te fait aussi un chatus et une syrah à tomber raide par terre).
 Viognier, disais-je : Terroir « Grès du Trias » des méritoires et salutaires Vignerons Ardéchois, « cave coop » d’exception, est à féliciter pour sa belle présence en bouche, un rien grasse, sa générosité, son élégance, sa belle tenue d’apéro, pas de soirée (2018, 8,10€).
Viognier, disais-je : Terroir « Grès du Trias » des méritoires et salutaires Vignerons Ardéchois, « cave coop » d’exception, est à féliciter pour sa belle présence en bouche, un rien grasse, sa générosité, son élégance, sa belle tenue d’apéro, pas de soirée (2018, 8,10€).
La Cuvée 1799 du Château des Lebres (rouge, 2017), souligne la bienvenue de 20% de cabernet-franc qui offre vigueur et fraîcheur comme nous tendons, genou fléchi et tête baissée, un bouquet d’hortensias parce que nous accusons un retard d’une minute, voire davantage, à une promise de passage...
Arrêt sur écran : un couple de faucons crécerelle nichant dans la grange en face vient de se poser sur le faîte du splendide toit de tuiles qui, lorsque je pose mon regard sur lui, m'évoque aussitôt « Tous les matins du monde », de Pascal Quignard, et le film sublime qu'il engendra : le son du clavier pourrait les déranger. Oui, j'écris dehors. Magie concomitante : un chevreuil que je reconnais, passe. Ce chevreuil, je l'aime, c'est désormais un compagnon de l'aube surtout, un complice qui m'évite...
en face vient de se poser sur le faîte du splendide toit de tuiles qui, lorsque je pose mon regard sur lui, m'évoque aussitôt « Tous les matins du monde », de Pascal Quignard, et le film sublime qu'il engendra : le son du clavier pourrait les déranger. Oui, j'écris dehors. Magie concomitante : un chevreuil que je reconnais, passe. Ce chevreuil, je l'aime, c'est désormais un compagnon de l'aube surtout, un complice qui m'évite...
Or, Les Lebres! Le reste est composé de syrah à 50% et de merlot à 30%. Cela vous coûtera 11,5€ mon bon, et c’est cadeau, pour la puissance que ce feu vous envoie d’emblée, mais avec tact et galanterie. Car la garrigue sait y faire, avec ses subtilités chaleureuses, au nez comme en arrière-bouche.
 Désolé Orélie (Vignerons ardéchois), ce coup-ci tu m’as déçu, toi qui tant de fois m’enchanta. Je suis en conséquence au regret d’écrire que tu m’apparus fade, buvardée, en rouge 2018, sur
Désolé Orélie (Vignerons ardéchois), ce coup-ci tu m’as déçu, toi qui tant de fois m’enchanta. Je suis en conséquence au regret d’écrire que tu m’apparus fade, buvardée, en rouge 2018, sur ce tartare privé de désert à cause de toi...
ce tartare privé de désert à cause de toi...
Le 2017 du Domaine Coulange (Côtes du Rhône Village Saint Andeol) fut plus accort, et accordé comme un luth théorbe sur une cantate de Bach, friand immédiatement. Ses 60% de grenache (et 40% de syrah pour suivre) y sont pour beaucoup je pense, moi qui ne pense jamais lorsque je déguste. À 10€, je passe commande illico.
 Idem pour le Château de Rochecolombe (Côtes du Rhône Village Saint Andeol), nez intense, épicé à souhait, avec des notes de fruits noirs à s’en balancer sur le cou et la nuque, une bouche ample. Un vin enchanteur (genache et syrah, 10,60€).
Idem pour le Château de Rochecolombe (Côtes du Rhône Village Saint Andeol), nez intense, épicé à souhait, avec des notes de fruits noirs à s’en balancer sur le cou et la nuque, une bouche ample. Un vin enchanteur (genache et syrah, 10,60€).
Le Domaine du Chapitre, (Côtes du Rhône Village Saint Andeol) piloté par un ténor qui se produit à l’opéra, Frédéric Dorthe (mon vis-à-vis, à table. En face, j’avais un soliste quelque peu aviné qui louchait et vacillait tout en balbutiant des propos incongrus – bref, le mec était bourré, car il effectuait son trip à Paris en forme d’échappée belle, façon Salon de l’agriculture, le Crazy Horse en moins (quoique). Ce Chapitre, donc, vante la grenache (60%) avec maestria et dominio comme on dit dans l’arène. C’est riche de fruits rouges et noirs mûrs à souhait, c’est large, ample, grand, il y a là matière à discussion avec le sanglier que je tuerai à la fin de l’été. 12€ le flacon.
Dorthe (mon vis-à-vis, à table. En face, j’avais un soliste quelque peu aviné qui louchait et vacillait tout en balbutiant des propos incongrus – bref, le mec était bourré, car il effectuait son trip à Paris en forme d’échappée belle, façon Salon de l’agriculture, le Crazy Horse en moins (quoique). Ce Chapitre, donc, vante la grenache (60%) avec maestria et dominio comme on dit dans l’arène. C’est riche de fruits rouges et noirs mûrs à souhait, c’est large, ample, grand, il y a là matière à discussion avec le sanglier que je tuerai à la fin de l’été. 12€ le flacon.
 Je ne suis pas dessert, mais je me dois d'être complet. Aussi, dirai-je le bien que je pense de la Cuvée des Patriarches du domaine Les Hauts de Vigier, 100% syrah (bravo la cuisine pour les abricots rôtis, faisselle, oseille et citron vert !), aux notes de fruits secs, de pain grillé, car selon moi, ce flacon aurait sa place pour escorter une viande rouge maturée, une côte épaisse, un onglet long et large. À 6,55€, prenez-en d’avance pour inonder la grosse cocotte Staub des premières
Je ne suis pas dessert, mais je me dois d'être complet. Aussi, dirai-je le bien que je pense de la Cuvée des Patriarches du domaine Les Hauts de Vigier, 100% syrah (bravo la cuisine pour les abricots rôtis, faisselle, oseille et citron vert !), aux notes de fruits secs, de pain grillé, car selon moi, ce flacon aurait sa place pour escorter une viande rouge maturée, une côte épaisse, un onglet long et large. À 6,55€, prenez-en d’avance pour inonder la grosse cocotte Staub des premières daubes de l’automne. C’est un ordre.
daubes de l’automne. C’est un ordre.
Finissons-en avec Ninon, car il faut finir avec elle, vous ne pensez pas ? Ce muscat à petit grain 100%, passerillé, son nez d’acacia, de pêche blanche, ses notes d’abricot mûr en bouche, ce vin « parcellaire », donc suivant une mode certaine, « je fais du parcellaire... » entend-on souvent (mais un bon point pour une cave-coop : le Caveau des Vignerons Alba-la-Romaine, 13,40€ le col), nous a charmé, même si, dessus ou avec, nous eussions préféré un roquefort des familles. L.M.
 Voici un petit livre à l’insolence tranquille, au ton nonchalant qui fait penser à la voix de François Simon – c’est, comment dire... slow. Voilà. Diablement efficace. Et remarquablement écrit, précis, scrupuleux, ironique souvent, caustique aussi, acide parfois, vrai et semblable toujours. Lorsqu’on peut être soi-même l’objet, voire la cible d’un tel opuscule (nous pratiquons le métier d’explorer et noter tables, chambres, bouteilles, assiettes depuis 1987, même si l’on est un peu rangé des fourchettes, mais pas encore des verres), on se cale bien pour lire ce mini traité d’observation d’un microcosme, d’une petite tribu où chacun lorgne l’autre, le méprise ou le jalouse, le toise ou le peinturlure d’un onguent faux-cul. Tailler une plume, titre sibyllin pour qui connait l’argot, sous-titré croquons la critique gastronomique, signé par l’un de nos pairs, Stéphane Méjanès, est publié aux délicieuses éditions de l’épure de la gourmande libre, de l’hédoniste dans les grandes largeurs Sabine Bucquet-Grenet. 90 pages sans vitriol, composées comme une galerie de portraits, à la manière des Caractères de La Bruyère. Je vous récite le sommaire : la diva, le stakhanoviste, le pique-assiette, l’incognito, l’influenceur, le glouton, le blasé, le tyran, l’antique, l’ingénu. Il ne manque personne à l’appel. Ces portraits fictifs, car sans aucun doute échafaudés à partir d’une galerie de personnages-types, façon puzzle agrégé, sont tellement réels. Et avant tout savoureux, drôles, pertinents davantage qu'impertinents, car subtils, et pointus – ils piquent là où il faut. Côté style, nous avons annoté en marge pas mal d’images justes, de traits, de formules qui font mouche. Un petit régal, à l’instar du goût d’un blanc sur une fine appellation. Mesdames... L.M.
Voici un petit livre à l’insolence tranquille, au ton nonchalant qui fait penser à la voix de François Simon – c’est, comment dire... slow. Voilà. Diablement efficace. Et remarquablement écrit, précis, scrupuleux, ironique souvent, caustique aussi, acide parfois, vrai et semblable toujours. Lorsqu’on peut être soi-même l’objet, voire la cible d’un tel opuscule (nous pratiquons le métier d’explorer et noter tables, chambres, bouteilles, assiettes depuis 1987, même si l’on est un peu rangé des fourchettes, mais pas encore des verres), on se cale bien pour lire ce mini traité d’observation d’un microcosme, d’une petite tribu où chacun lorgne l’autre, le méprise ou le jalouse, le toise ou le peinturlure d’un onguent faux-cul. Tailler une plume, titre sibyllin pour qui connait l’argot, sous-titré croquons la critique gastronomique, signé par l’un de nos pairs, Stéphane Méjanès, est publié aux délicieuses éditions de l’épure de la gourmande libre, de l’hédoniste dans les grandes largeurs Sabine Bucquet-Grenet. 90 pages sans vitriol, composées comme une galerie de portraits, à la manière des Caractères de La Bruyère. Je vous récite le sommaire : la diva, le stakhanoviste, le pique-assiette, l’incognito, l’influenceur, le glouton, le blasé, le tyran, l’antique, l’ingénu. Il ne manque personne à l’appel. Ces portraits fictifs, car sans aucun doute échafaudés à partir d’une galerie de personnages-types, façon puzzle agrégé, sont tellement réels. Et avant tout savoureux, drôles, pertinents davantage qu'impertinents, car subtils, et pointus – ils piquent là où il faut. Côté style, nous avons annoté en marge pas mal d’images justes, de traits, de formules qui font mouche. Un petit régal, à l’instar du goût d’un blanc sur une fine appellation. Mesdames... L.M.
 Il n’y a pas de mauvais sujet. C’est ce que l’on répète au journaliste stagiaire faisant la fine bouche parce qu’on l’envoie couvrir un marronnier. C’est comme ça que le métier rentre, assène-t-on. A priori, mener une enquête très approfondie sur l’univers du fast-food, si l’on n’est pas un McDolescent attardé, en focalisant forcément celle-ci sur la gigantesque entreprise aux arches jaunes, peut sembler sinon suspect, au moins audacieux. Didier Pourquery, sans doute aficionado léger du petit pain rond et mou, régressif et transgressif, nocif parce qu’addictif, l’a menée car il souhaitait le faire depuis longtemps, lui qui dévora avec plaisir son premier hamburger-frites à l’âge de 17 ans, en 1971, et pas n’importe où : dans un Dairy Queen Brazier de Chicago. Ça marque. Et nous lisons, grâce à son talent narratif, un essai comme on lit une (belle) histoire avec des personnages, tout ça. Découpée en tranches, l’étude : historique, sociologique (les rites), géographique, économique bien sûr, et aussi sur le plan capital de la nutrition (ça nuit grave !), celui de la mode (comment ça mute ?), et enfin sous l’angle du mauvais esprit, confesse d’emblée l’auteur. Mais l’analyse est totalement sérieuse, d’une précision d’horloger genevois, gavée de références, c’est bien sourcé comme on dit, c’est drôle souvent, et l’on sent le journaliste scrupuleux glissant tantôt vers l’aveu culpabilisant (j’aime ça), tantôt vers l’affirmation dédouanante (c’est vraiment dégueu, tant le système précis mis en place pour « piéger » le consommateur, quelle que soit sa culture, que la charge en lipides et en glucides de tout hamburger-frites). Grâce à plusieurs brassées de chiffres, de statistiques, nous apprenons énormément de choses sur l’univers, la grosse machine dissimulée sous ce « simulacre de repas ». Pourquery se réfère immédiatement au chapitre des « Mythologies » de Roland Barthes (1961) consacré au bifteck-frites (*). L’emblématique plat français, en terre de gastronomie, qui résonnait « sang », a depuis longtemps été détrôné par le hamburger, lequel résonne « sans » : bientôt sans viande, sans bœuf, sans personnel humain... 1961 voit aussi l’apparition des restaurants de fast-food Wimpy, en écho à Popeye, dont le personnage goinfre nommé Gontran dans l’adaptation française, ami de Popeye, se nomme J. Wellington Wimpy. C’est le premier addict aux hamburgers. Jacques Borel, célèbre pour les restauroutes, ouvrit cette année-là le premier Wimpy français. En 1972, le premier McDonald’s de France ouvre à Créteil. Depuis, on en compte 1 300 au pays du foie gras et des grands crus classés, et la filiale française est la plus rentable au monde derrière le réseau US. Déroutante France. C’est le French paradox... Le bouquin de Didier Pourquery devient captivant au fil des pages, car outre l’histoire des KFC, Burger King, Freetime (souvenez-vous de Christophe Salengro disant : my teinturier is rich), et autres concurrents du géant McDo et ses 37 000 « restaurants », la préhistoire du hamburger (Hambourg), l’histoire du steack haché, l’idée de le placer entre deux tranches de pain, jusqu’à la Hamburger University, « le Princeton du fast-food » qui a déjà form(at)é 80 000 managers de McDo, dans les veines desquels on est en droit de se demander si ce n’est pas du ketchup qui circule, il y a le décodage sociologique et psychologique de l’acte de se rendre dans un fast-food et d’y consommer, auquel se livre l’auteur avec un savoir et un tact qui emporte le lecteur. Il est question d’« expérience » pour désigner ces actes, de la « production d’une histoire comestible plus que d’une nourriture concrète ». Chacun sait que c’est de la junk-food, soit de la malbouffe, mais nous savons que les horribles photos qui ornent les paquets de cigarettes n’empêchent pas davantage le fumeur de tirer sur sa clope (12 millions de décès dans le monde dus à la malbouffe, contre 7 millions au tabac en 2015. Quand même...). Cela m’évoque les épouvantails dans les champs sur lesquels se posent les oiseaux... L'efficacité des firmes de fast-food est vraiment redoutable. Pourquery s’attarde à juste titre sur des petites choses, comme ça, qui relèvent du rite : manger – forcément - avec ses mains, piquer une frite sur le plateau avant de s’asseoir, puis dans le plateau de l'autre, cette lenteur que nous craignons, et notre impatience qui monte comme du lait dans la casserole lorsque la commande n’arrive pas dans la seconde, les néo-burgers revisitant aujourd’hui le mythe et le simulacre en même temps, en tentant de « purifier » tout ça. L’archétype étant la petite chaîne tellement friendly Big Fernand. Le moment le plus tragique peut-être est cet article de Lorraine de Foucher paru dans Le Monde du 2 novembre 2018, intitulé « Le McDo a remplacé le café du village », cité par Didier Pourquery. Ce papier m'avait alerté. Le mot village y est un peu exagéré, car la chaîne ne s’installe pas encore dans de petits bleds désormais dépourvus d’école, d’épicerie fourre-tout, où un office mensuel est célébré à l’église, et où le dernier bar, en fermant définitivement sa porte, sonne le glas de la dernière possibilité de se retrouver, d’être encore socialisés, ensemble – au moins entre hommes, comme dans le baitemannageo, ou « maison des hommes » bâti au centre de chaque village Bororo, et décrit par Claude Lévi-Strauss dans « Tristes Tropiques » (Plon/Terre Humaine, page 248). Mais force est d’admettre que dans des bourgs et des villes de petite taille, lorsqu’un McDo ouvre, c’est un peu de vie qui revient... dans un cadre particulier. Reste que cette « Histoire de hamburger-frites » sous-titrée « comment un simulacre de repas a-t-il séduit le monde entier ? » se lit comme on boit un demi un jour de canicule, ou comme on dévore un Big Mac. L.M.
Il n’y a pas de mauvais sujet. C’est ce que l’on répète au journaliste stagiaire faisant la fine bouche parce qu’on l’envoie couvrir un marronnier. C’est comme ça que le métier rentre, assène-t-on. A priori, mener une enquête très approfondie sur l’univers du fast-food, si l’on n’est pas un McDolescent attardé, en focalisant forcément celle-ci sur la gigantesque entreprise aux arches jaunes, peut sembler sinon suspect, au moins audacieux. Didier Pourquery, sans doute aficionado léger du petit pain rond et mou, régressif et transgressif, nocif parce qu’addictif, l’a menée car il souhaitait le faire depuis longtemps, lui qui dévora avec plaisir son premier hamburger-frites à l’âge de 17 ans, en 1971, et pas n’importe où : dans un Dairy Queen Brazier de Chicago. Ça marque. Et nous lisons, grâce à son talent narratif, un essai comme on lit une (belle) histoire avec des personnages, tout ça. Découpée en tranches, l’étude : historique, sociologique (les rites), géographique, économique bien sûr, et aussi sur le plan capital de la nutrition (ça nuit grave !), celui de la mode (comment ça mute ?), et enfin sous l’angle du mauvais esprit, confesse d’emblée l’auteur. Mais l’analyse est totalement sérieuse, d’une précision d’horloger genevois, gavée de références, c’est bien sourcé comme on dit, c’est drôle souvent, et l’on sent le journaliste scrupuleux glissant tantôt vers l’aveu culpabilisant (j’aime ça), tantôt vers l’affirmation dédouanante (c’est vraiment dégueu, tant le système précis mis en place pour « piéger » le consommateur, quelle que soit sa culture, que la charge en lipides et en glucides de tout hamburger-frites). Grâce à plusieurs brassées de chiffres, de statistiques, nous apprenons énormément de choses sur l’univers, la grosse machine dissimulée sous ce « simulacre de repas ». Pourquery se réfère immédiatement au chapitre des « Mythologies » de Roland Barthes (1961) consacré au bifteck-frites (*). L’emblématique plat français, en terre de gastronomie, qui résonnait « sang », a depuis longtemps été détrôné par le hamburger, lequel résonne « sans » : bientôt sans viande, sans bœuf, sans personnel humain... 1961 voit aussi l’apparition des restaurants de fast-food Wimpy, en écho à Popeye, dont le personnage goinfre nommé Gontran dans l’adaptation française, ami de Popeye, se nomme J. Wellington Wimpy. C’est le premier addict aux hamburgers. Jacques Borel, célèbre pour les restauroutes, ouvrit cette année-là le premier Wimpy français. En 1972, le premier McDonald’s de France ouvre à Créteil. Depuis, on en compte 1 300 au pays du foie gras et des grands crus classés, et la filiale française est la plus rentable au monde derrière le réseau US. Déroutante France. C’est le French paradox... Le bouquin de Didier Pourquery devient captivant au fil des pages, car outre l’histoire des KFC, Burger King, Freetime (souvenez-vous de Christophe Salengro disant : my teinturier is rich), et autres concurrents du géant McDo et ses 37 000 « restaurants », la préhistoire du hamburger (Hambourg), l’histoire du steack haché, l’idée de le placer entre deux tranches de pain, jusqu’à la Hamburger University, « le Princeton du fast-food » qui a déjà form(at)é 80 000 managers de McDo, dans les veines desquels on est en droit de se demander si ce n’est pas du ketchup qui circule, il y a le décodage sociologique et psychologique de l’acte de se rendre dans un fast-food et d’y consommer, auquel se livre l’auteur avec un savoir et un tact qui emporte le lecteur. Il est question d’« expérience » pour désigner ces actes, de la « production d’une histoire comestible plus que d’une nourriture concrète ». Chacun sait que c’est de la junk-food, soit de la malbouffe, mais nous savons que les horribles photos qui ornent les paquets de cigarettes n’empêchent pas davantage le fumeur de tirer sur sa clope (12 millions de décès dans le monde dus à la malbouffe, contre 7 millions au tabac en 2015. Quand même...). Cela m’évoque les épouvantails dans les champs sur lesquels se posent les oiseaux... L'efficacité des firmes de fast-food est vraiment redoutable. Pourquery s’attarde à juste titre sur des petites choses, comme ça, qui relèvent du rite : manger – forcément - avec ses mains, piquer une frite sur le plateau avant de s’asseoir, puis dans le plateau de l'autre, cette lenteur que nous craignons, et notre impatience qui monte comme du lait dans la casserole lorsque la commande n’arrive pas dans la seconde, les néo-burgers revisitant aujourd’hui le mythe et le simulacre en même temps, en tentant de « purifier » tout ça. L’archétype étant la petite chaîne tellement friendly Big Fernand. Le moment le plus tragique peut-être est cet article de Lorraine de Foucher paru dans Le Monde du 2 novembre 2018, intitulé « Le McDo a remplacé le café du village », cité par Didier Pourquery. Ce papier m'avait alerté. Le mot village y est un peu exagéré, car la chaîne ne s’installe pas encore dans de petits bleds désormais dépourvus d’école, d’épicerie fourre-tout, où un office mensuel est célébré à l’église, et où le dernier bar, en fermant définitivement sa porte, sonne le glas de la dernière possibilité de se retrouver, d’être encore socialisés, ensemble – au moins entre hommes, comme dans le baitemannageo, ou « maison des hommes » bâti au centre de chaque village Bororo, et décrit par Claude Lévi-Strauss dans « Tristes Tropiques » (Plon/Terre Humaine, page 248). Mais force est d’admettre que dans des bourgs et des villes de petite taille, lorsqu’un McDo ouvre, c’est un peu de vie qui revient... dans un cadre particulier. Reste que cette « Histoire de hamburger-frites » sous-titrée « comment un simulacre de repas a-t-il séduit le monde entier ? » se lit comme on boit un demi un jour de canicule, ou comme on dévore un Big Mac. L.M.
---
(*) « Une histoire de hamburger-frites », par Didier Pourquery, Robert Laffont, collection Nouvelles Mytholgies, 12€
Si je puis me permettre l'encadré qui suit...
Anecdote perso, pour finir (mais ici, je m'autorise à peu près tout) : je confesse, moi le critique gastro qui ai notamment dirigé la rédaction de GaultMillau, moi qui suis entré pour la dernière fois dans un fast-food (il faut dire que c’est le plus beau du monde. Je désigne le McDo de la plage de La Barre, à Anglet – il a les pieds dans le sable -, avec mes deux enfants il y a au moins une quinzaine d’années. Puis, rien depuis, sinon des ortolans et du champagne), prévoyant de lire ce livre à la faveur d’un bon trajet en train (le lieu idéal), j’ai poussé la porte d’un McDo comme on entre par effraction dans une banque la nuit, cagoulé et à la vitesse du chat (pourvu que personne ne m'ait vu!), et j’ai d’abord été confronté à des écrans tactiles géants (bonjour l’échange de bactéries avec nos index !), ayant remplacé un personnel humain à casquette en carton débitant un questionnaire derrière une caisse, je me souviens, et d’ailleurs ça stressait car il fallait commander fissa pronto, le dos à une file d'attente, que j’ai emporté non pas un, mais deux hamburgers : un big bacon et un autre dont j'ai oublié le nom, animé soudain d’une faim viscérale, physique oui (et irrationnelle) de hamburgers de chez McDonald’s, que je n’ai pas attendu une seconde (en plus ça refroidit volontairement vite), que j’en ai entamé un dans ma voiture avant de démarrer celle-ci, et que j’ai englouti les deux en un quart d’heure, une fois passée la cinquième vitesse sur une route de campagne (en m'en foutant un peu partout). Et bé... Je n’ai pas trouvé ça bon. Était-ce dû au savoir-faire relatif de cette franchise-là ? Je n’ai retrouvé aucune saveur, aucune sensation positive, rien. Puis, j’ai lu le bouquin de Pourquery entre les deux gares, et ce fut bien meilleur. Parvenu à destination, je racontai cette anecdote et commençai d’embêter mes amis en tentant de les intéresser au sujet de ma lecture toute chaude. Il me fut répondu : « Assieds-toi, la côte de bœuf maturée un mois est bleue comme tu l’aimes, c’est une Blonde d’Aquitaine, elle n’attend pas. Tu veux aussi son prénom ?.. »
APÉRO
 Splendide Moulin-à-Vent AOC, le Domaine de la Tour de Bief 2018, un 100% gamay d’une pureté inouïe, due peut-être à son élevage exclusif en cuves. C’est mûr, puissant sans être agressif, suave même. Il fut dégusté seul, pour lui-même. Signe d’une autosuffisance rare et permettant la concentration.
Splendide Moulin-à-Vent AOC, le Domaine de la Tour de Bief 2018, un 100% gamay d’une pureté inouïe, due peut-être à son élevage exclusif en cuves. C’est mûr, puissant sans être agressif, suave même. Il fut dégusté seul, pour lui-même. Signe d’une autosuffisance rare et permettant la concentration.
ENTRÉES
Afin d’honorer une terrine du Perche à la pomme et
 une chiffonnade de jambon de Parme, L’Absolu 2018, en AOC Bordeaux rosé, issu de merlot et de cabernet-sauvignon, avec son nez discret de fraise, sa bouche d’un bel équilibre, sans acidité, le disputait - en qualité -, avec C’est la vie! 2018, AOC Bordeaux blanc, de la même famille Rochet. Cette cuvée quasi confidentielle (2 000 cols), est issue de sémillon à 100%. Son habillage moderne est rigolo (une 2CV sur papier craft, et un stop-gouttes détachable offert en guise de collerette, des plus élégants). Le vin s’affirme par un nez agréable de pêche blanche, de raisin croquant, et avec une bouche qui ne manque pas de vivacité. Le tartare de thon à l’huile d’olive vierge, à peine citronné, lui alla comme un gant.
une chiffonnade de jambon de Parme, L’Absolu 2018, en AOC Bordeaux rosé, issu de merlot et de cabernet-sauvignon, avec son nez discret de fraise, sa bouche d’un bel équilibre, sans acidité, le disputait - en qualité -, avec C’est la vie! 2018, AOC Bordeaux blanc, de la même famille Rochet. Cette cuvée quasi confidentielle (2 000 cols), est issue de sémillon à 100%. Son habillage moderne est rigolo (une 2CV sur papier craft, et un stop-gouttes détachable offert en guise de collerette, des plus élégants). Le vin s’affirme par un nez agréable de pêche blanche, de raisin croquant, et avec une bouche qui ne manque pas de vivacité. Le tartare de thon à l’huile d’olive vierge, à peine citronné, lui alla comme un gant.
PLAT
 À Sancerre, la Famille Bourgeois propose son fleuron, La Bourgeoise, dans le millésime 2016. Ce 100% pinot noir est d’une finesse et d’une douceur remarquables. Robe profonde, nez de fruits noirs, rouges et légèrement épicé, frais et ample en bouche, avec une note minérale qui rappelle le terroir de silex où naissent ses vignes, ainsi qu’une touche vanillée due à l’élevage en fûts d’environ une année. Idéal sur une belle entrecôte de bœuf saisie à la plancha.
À Sancerre, la Famille Bourgeois propose son fleuron, La Bourgeoise, dans le millésime 2016. Ce 100% pinot noir est d’une finesse et d’une douceur remarquables. Robe profonde, nez de fruits noirs, rouges et légèrement épicé, frais et ample en bouche, avec une note minérale qui rappelle le terroir de silex où naissent ses vignes, ainsi qu’une touche vanillée due à l’élevage en fûts d’environ une année. Idéal sur une belle entrecôte de bœuf saisie à la plancha.
FROMAGES
En Touraine Chenonceaux AOP, la famille Bougrier propose, au sein de sa Grande Réserve, une production limitée, parcellaire, du Domaine Guenault, propriété historique sise à Saint-Georges-sur-Cher. Baptisée Confidences, cette cuvée 2018 est un 100% sauvignon blanc aux arômes délicats d’agrumes, de foin fraîchement coupé et des notes légères de cassis. Formidable sur les fromages des 48 chèvres, frais et moelleux, du Bois Buisson, de Véronique Quinet, à Courgeout (61), qui travaille seule et à qui nous tirons notre béret.
propose, au sein de sa Grande Réserve, une production limitée, parcellaire, du Domaine Guenault, propriété historique sise à Saint-Georges-sur-Cher. Baptisée Confidences, cette cuvée 2018 est un 100% sauvignon blanc aux arômes délicats d’agrumes, de foin fraîchement coupé et des notes légères de cassis. Formidable sur les fromages des 48 chèvres, frais et moelleux, du Bois Buisson, de Véronique Quinet, à Courgeout (61), qui travaille seule et à qui nous tirons notre béret.
DESSERT
Afin d’escorter une tarte aux fruits rouges, un Anjou Villages Brissac 2017, la cuvée La Grande Chevalerie du château La Varière, issu à 100% de cabernet-sauvignon d’une belle maturité, et offrant ainsi une complexité aromatique que l’on peut attribuer aussi au passage d’un an « sous bois ». Un flacon sérieux signé Jacques Beaujeau, à la robe profonde, au nez de mûre et de cassis, légèrement vanillé, et une bouche intense avec des notes torréfiées et cacaotées. Puissant et souple à la fois. Un vrai vin de garde, à tester en saison avec du gibier à poil. L.M.
La Grande Chevalerie du château La Varière, issu à 100% de cabernet-sauvignon d’une belle maturité, et offrant ainsi une complexité aromatique que l’on peut attribuer aussi au passage d’un an « sous bois ». Un flacon sérieux signé Jacques Beaujeau, à la robe profonde, au nez de mûre et de cassis, légèrement vanillé, et une bouche intense avec des notes torréfiées et cacaotées. Puissant et souple à la fois. Un vrai vin de garde, à tester en saison avec du gibier à poil. L.M.
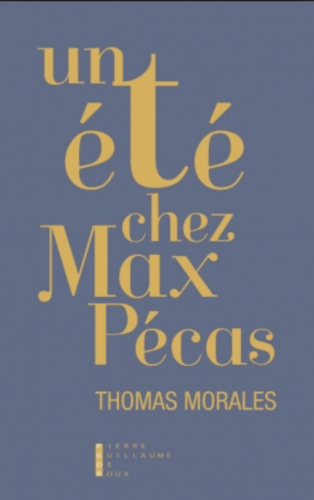 Ainsi désignais-je mon père. « Tu es un rétroviveur ! », lui répétais-je souvent afin de calmer sa nostalgérie et son c’était-mieux-avantisme chronique. Thomas Morales, fan de nobles carrosseries, appréciera le parallèle paternel. Cet écrivain n’est pas de son époque et c’est ce qui fait le charme de chacune de ses chroniques, que Pierre-Guillaume de Roux (fils du grand Dominique) publie en bouquet à un rythme agréable (*). Les dernières de cet irréconciliable avec ce siècle vingt-et-unième et sa morosité, sa cruelle absence d’humour, sa police des mœurs omniprésente jusque dans nos chiottes, le quotidien rogue de ses congénères qui en exaspèrent ou en désespèrent plus d’un, ont pour titre « Un été chez Max Pécas ». Vous savez – non, vous ne voulez pas vous souvenir, Pécas c’est ce réalisateur de films gras et beaufs, si l’on veut forcer un trait définitif, ou bien kitsch si on la joue gentiment bobo déambulant dans un bled un dimanche de vide-grenier. « Le Pagnol du nanar sous cagnard », résume Morales. Ça sent la Miss camping, le Ricard généreux à l’apéro avec la carafe beige chiffrée et servant peu, le bob qui va avec, ça pue la fumée épaisse dégagée par des rangs de chipos et des merguez au garde-à-vous sur le barbecue qui n’est pas le Weber dernier cri, non, juste le vieux qu’on ressort et qu’on décape avec la brosse métallique, joie, appétit, charbon de bois et journal local froissé, dès la fin du Printemps. Les chroniques de Morales sont décontractées, dégrafées de la ceinture lorsque les crêpes au Nutella ont été trop nombreuses, mais il est des overdoses fondantes et plus délicieuses que d’autres, avouables celles-là. Avec ce bouquin, Jean-Pierre Marielle ressuscite. Ses textes nous rappellent Auriac, hameau paumé, perché loin au-dessus de Tulle, tranquille, où nous nous sommes si souvent rendus pour passer des jours, voire des semaines peinardes mais sacrément vives chez l’ami Tillinac, à l’époque des spleens corréziens et des bonheurs assouvis avant d’atteindre la borne Michelin désignant Souillac sous son chapeau rouge déteint. Soit l’été au vert, avec taons et guêpes, panne de pain et emmerdeurs qui se trompent de route. Mais rosé frais toujours (les pages consacrées aux amateurs de vin qui se la pètent sont tordantes et si vraies). Ces chroniques débraillées disent, chuchotent - non : écrivent. Car le garçon a une sacrée plume que Blondin et Haedens auraient sans aucun doute louée à bas taux. Ses images frappent, touchent, ont le ton. Et l’image juste. Un talent, dis-je... Écrivent, donc, combien le bonheur peut être simple et jamais vulgaire, si l’on a encore le courage de mater une fille en bikini, et en monokini tiens !, sans craindre la guillotine d’un hashtag. Et si elle se prend pour une starlette devant le Carlton tandis qu’elle remonte la plage de Palavas, c’est encore meilleur. Si l’on a encore l’audace de regretter Stone et Charden (mais pourquoi avoir jeté leurs 45 tours !), d’adorer Umberto Tozzi ou Eros Ramazzotti tant qu’on y est, et de vouer un culte au forçats de la route du Tour (de France), ainsi qu’à l’accordéon, au sourire fixe et aux performances d’Yvette Horner, à la prose érotique, limite salace d’André Hardellet, à la gourmandise grivoise des livres de René Fallet, aux promesses démesurées d’un slow-braguette un soir de bal au village d’à côté avec une Marilyn de chef-lieu de canton ayant eu le bon goût de ne rien donner à rafistoler de sa plastique originelle... Thomas Morales réconcilie avec la vie, la vraie, celle que des bataillons de tristes sires et à la grise mine veulent nous interdire, et parmi eux une jeunesse, oui, de précoces empêcheurs de rire en rond ou en losange, des mal dans leur peau dès l’adolescence qui s’acharnent (un vrai job) à vouloir nous faire culpabiliser d’avoir eu une enfance à la Sagan, à la Sautet, à la Huguenin. Contre l’esprit de sérieux qui nous les brise menu (il ne faudrait jamais quitter Montauban), lisez Morales. Moi, j’aimerais voir « Un été chez Max Pécas », et entendre déclamer ses « traits » claquants, désinvoltes, brillants, partout entre les mains et sur les lèvres de chacun, sur le sable, dans les rues de Bayonne et de Paimpol, sur les aires d’autoroute, brandi entre les rangs de maïs de Peyrehorade, repris en chœur dans tous les Café des Amis et les Bar de la Marine. Le mien, lu, me servira jusqu’à l’automne à attiser les braises du barbecue. Et, ça aussi, je sens que ça pourrait plaire à l'auteur de ces précieuses, longues cartes postales. Léon Mazzella
Ainsi désignais-je mon père. « Tu es un rétroviveur ! », lui répétais-je souvent afin de calmer sa nostalgérie et son c’était-mieux-avantisme chronique. Thomas Morales, fan de nobles carrosseries, appréciera le parallèle paternel. Cet écrivain n’est pas de son époque et c’est ce qui fait le charme de chacune de ses chroniques, que Pierre-Guillaume de Roux (fils du grand Dominique) publie en bouquet à un rythme agréable (*). Les dernières de cet irréconciliable avec ce siècle vingt-et-unième et sa morosité, sa cruelle absence d’humour, sa police des mœurs omniprésente jusque dans nos chiottes, le quotidien rogue de ses congénères qui en exaspèrent ou en désespèrent plus d’un, ont pour titre « Un été chez Max Pécas ». Vous savez – non, vous ne voulez pas vous souvenir, Pécas c’est ce réalisateur de films gras et beaufs, si l’on veut forcer un trait définitif, ou bien kitsch si on la joue gentiment bobo déambulant dans un bled un dimanche de vide-grenier. « Le Pagnol du nanar sous cagnard », résume Morales. Ça sent la Miss camping, le Ricard généreux à l’apéro avec la carafe beige chiffrée et servant peu, le bob qui va avec, ça pue la fumée épaisse dégagée par des rangs de chipos et des merguez au garde-à-vous sur le barbecue qui n’est pas le Weber dernier cri, non, juste le vieux qu’on ressort et qu’on décape avec la brosse métallique, joie, appétit, charbon de bois et journal local froissé, dès la fin du Printemps. Les chroniques de Morales sont décontractées, dégrafées de la ceinture lorsque les crêpes au Nutella ont été trop nombreuses, mais il est des overdoses fondantes et plus délicieuses que d’autres, avouables celles-là. Avec ce bouquin, Jean-Pierre Marielle ressuscite. Ses textes nous rappellent Auriac, hameau paumé, perché loin au-dessus de Tulle, tranquille, où nous nous sommes si souvent rendus pour passer des jours, voire des semaines peinardes mais sacrément vives chez l’ami Tillinac, à l’époque des spleens corréziens et des bonheurs assouvis avant d’atteindre la borne Michelin désignant Souillac sous son chapeau rouge déteint. Soit l’été au vert, avec taons et guêpes, panne de pain et emmerdeurs qui se trompent de route. Mais rosé frais toujours (les pages consacrées aux amateurs de vin qui se la pètent sont tordantes et si vraies). Ces chroniques débraillées disent, chuchotent - non : écrivent. Car le garçon a une sacrée plume que Blondin et Haedens auraient sans aucun doute louée à bas taux. Ses images frappent, touchent, ont le ton. Et l’image juste. Un talent, dis-je... Écrivent, donc, combien le bonheur peut être simple et jamais vulgaire, si l’on a encore le courage de mater une fille en bikini, et en monokini tiens !, sans craindre la guillotine d’un hashtag. Et si elle se prend pour une starlette devant le Carlton tandis qu’elle remonte la plage de Palavas, c’est encore meilleur. Si l’on a encore l’audace de regretter Stone et Charden (mais pourquoi avoir jeté leurs 45 tours !), d’adorer Umberto Tozzi ou Eros Ramazzotti tant qu’on y est, et de vouer un culte au forçats de la route du Tour (de France), ainsi qu’à l’accordéon, au sourire fixe et aux performances d’Yvette Horner, à la prose érotique, limite salace d’André Hardellet, à la gourmandise grivoise des livres de René Fallet, aux promesses démesurées d’un slow-braguette un soir de bal au village d’à côté avec une Marilyn de chef-lieu de canton ayant eu le bon goût de ne rien donner à rafistoler de sa plastique originelle... Thomas Morales réconcilie avec la vie, la vraie, celle que des bataillons de tristes sires et à la grise mine veulent nous interdire, et parmi eux une jeunesse, oui, de précoces empêcheurs de rire en rond ou en losange, des mal dans leur peau dès l’adolescence qui s’acharnent (un vrai job) à vouloir nous faire culpabiliser d’avoir eu une enfance à la Sagan, à la Sautet, à la Huguenin. Contre l’esprit de sérieux qui nous les brise menu (il ne faudrait jamais quitter Montauban), lisez Morales. Moi, j’aimerais voir « Un été chez Max Pécas », et entendre déclamer ses « traits » claquants, désinvoltes, brillants, partout entre les mains et sur les lèvres de chacun, sur le sable, dans les rues de Bayonne et de Paimpol, sur les aires d’autoroute, brandi entre les rangs de maïs de Peyrehorade, repris en chœur dans tous les Café des Amis et les Bar de la Marine. Le mien, lu, me servira jusqu’à l’automne à attiser les braises du barbecue. Et, ça aussi, je sens que ça pourrait plaire à l'auteur de ces précieuses, longues cartes postales. Léon Mazzella
---
(*) Thomas Morales, Un été chez Max Pécas (PGDR, 15€)

 ROSÉS
ROSÉS
Parmi les grands rosés de Provence, le château Romanin occupe une place de choix, un fief, une place-forte organoleptique. En AOP Les Baux-de-Provence, le Grand Vin Rosé 2018 (grenache, mourvèdre, syrah. 17,50€), sa robe saumonée éclatante, son nez franc de petits fruits rouges et noirs (groseille, fraise des bois, cassis) et d’ananas, sa bouche minérale avec une finale saline en font le fiancé idéal d’un soir au jardin avec les langoustines, puis l’agneau grillés. Vin puissant et résolument « gastronomique », il se distingue de Romanin, IGP Alpilles (grenache, mourvèdre, cabernet-sauvignon, et 15% de rare counoise. 12,60€). Robe davantage saumonée, nez plus fleuri avec des notes d’abricot et de pêche jaune. Sa bouche est d’une grande fraîcheur avec une finale minérale (signature maison). Ce flacon, plus 4x4, aime à se frotter au thon rouge cru, aux épices, à l’anchoïade, et même à l’aïoli. Des Romanin complémentaires.
Du côté de Chinon, le château de La Grille, rosé 2018 (cabernet-franc. 11€), dont le
vignoble est certifié HVE (Haute valeur environnementale), brille par sa délicatesse. Robe saumon clair, nez de fruits rouges, bouche « croquante », jolie finale. Parfait pour conduire un poisson blanc de rivière, voire une friture d’éperlans relevée/révélée au citron.
BLANCS
La Vigne du Cloître, remarquable Mâcon-Péronne « en Chassigny » de la Cave de Lugny (2017, entre 7,50€ et 10€. À retrouver en septembre à la Foire aux Vins de Monoprix. Désolé pour ma photo prise avec le smartphone...), est vinifié sans sulfites. D’où une pureté aromatique  incomparable, mais hélas éphémère : dépêchez-vous donc de le déboucher. Robe claire et brillante, nez de mirabelle et de pêche blanche. Bouche souple puis intense, tendue même en finale, comme souvent avec les chardonnays de cette zone d’élection originelle. Flacon formidable en compagnie d’une bourriche d’huîtres de chez l'ami Joël Dupuch, et de quelques tourteaux (sans mayo !).
incomparable, mais hélas éphémère : dépêchez-vous donc de le déboucher. Robe claire et brillante, nez de mirabelle et de pêche blanche. Bouche souple puis intense, tendue même en finale, comme souvent avec les chardonnays de cette zone d’élection originelle. Flacon formidable en compagnie d’une bourriche d’huîtres de chez l'ami Joël Dupuch, et de quelques tourteaux (sans mayo !).
Chez Plaimont, dans le Gers, en AOC Saint-Mont , une nouveauté attire le nez : L’Absolu des 3 terroirs (gros manseng, petit manseng, petit courbu. 12,90€) assemble le meilleur des grands terroirs de l’appellation : argiles calcaires, argiles bigarrées et sables fauves. Robe pâle. Nez d’acacia et d’agrumes, mais pas trop, fort heureusement. Bouche ample, longue, plaisante jusqu’au bout. Parfait avec un poisson noble des rivières locales comme la truite fario (prise à la mouche, si possible), ou bien le bar de ligne si l’on revient d’une virée « surf-casting » sur la côte basque... Notons que L’Absolu des 3 terroirs se décline en rouge (tannat, cabernet-sauvignon, pinenc. Même prix). Ce dernier est à déguster pour ses notes de fruits noirs tout en faisant la cuisine (le salaire de base du cuistot amateur), et à achever à l’apéro quand les premiers copains déboulent. Et comme ça, « blanc sur rouge, rien ne bouge ! »
, une nouveauté attire le nez : L’Absolu des 3 terroirs (gros manseng, petit manseng, petit courbu. 12,90€) assemble le meilleur des grands terroirs de l’appellation : argiles calcaires, argiles bigarrées et sables fauves. Robe pâle. Nez d’acacia et d’agrumes, mais pas trop, fort heureusement. Bouche ample, longue, plaisante jusqu’au bout. Parfait avec un poisson noble des rivières locales comme la truite fario (prise à la mouche, si possible), ou bien le bar de ligne si l’on revient d’une virée « surf-casting » sur la côte basque... Notons que L’Absolu des 3 terroirs se décline en rouge (tannat, cabernet-sauvignon, pinenc. Même prix). Ce dernier est à déguster pour ses notes de fruits noirs tout en faisant la cuisine (le salaire de base du cuistot amateur), et à achever à l’apéro quand les premiers copains déboulent. Et comme ça, « blanc sur rouge, rien ne bouge ! »
À Chablis (en appellation Chablis-Village), découverte au domaine Laroche, de la superbe cuvée Saint-Martin 2018 (certifié HVE niveau 3 : le must! env. 20€), et son beau flacon, d'une grande fraîcheur, d'une très belle minéralité (typique avec les beaunnois, ou chardonnays, de ce terroir), et d'une force contenue en finale des plus agréables. Robe pâle à reflets bleutés. Nez crayeux, puis subtil de fleurs blanches, de beurre frais, avec une note de pomme. Bouche légèrement boisée (cèdre, sous-bois), voire toastée en finale. Superbe à avec de l'iode à pleines mains : vite, un plateau de fruits de mer!
domaine Laroche, de la superbe cuvée Saint-Martin 2018 (certifié HVE niveau 3 : le must! env. 20€), et son beau flacon, d'une grande fraîcheur, d'une très belle minéralité (typique avec les beaunnois, ou chardonnays, de ce terroir), et d'une force contenue en finale des plus agréables. Robe pâle à reflets bleutés. Nez crayeux, puis subtil de fleurs blanches, de beurre frais, avec une note de pomme. Bouche légèrement boisée (cèdre, sous-bois), voire toastée en finale. Superbe à avec de l'iode à pleines mains : vite, un plateau de fruits de mer!
 En Béarn, chez Henri Ramonteu et son fameux domaine Cauhapé (évoqué ici même il y a quelques jours encore), un jurançon sec, Les Vignes de Manon (2018. 100% gros manseng. 10-11€), exprime son talent avec de délicates notes de fruits exotiques et d'agrumes (avec mesure, ces dernières). C'est très frais, expressif à souhait, et parfait à l'apéritif pour lui-même. Cependant, si d'épaisses soles-filets débarquent entre les bras d'un pote, et bé y'aura plus qu'à faire fondre le beurre dans la poêle ! L.M.
En Béarn, chez Henri Ramonteu et son fameux domaine Cauhapé (évoqué ici même il y a quelques jours encore), un jurançon sec, Les Vignes de Manon (2018. 100% gros manseng. 10-11€), exprime son talent avec de délicates notes de fruits exotiques et d'agrumes (avec mesure, ces dernières). C'est très frais, expressif à souhait, et parfait à l'apéritif pour lui-même. Cependant, si d'épaisses soles-filets débarquent entre les bras d'un pote, et bé y'aura plus qu'à faire fondre le beurre dans la poêle ! L.M.
C'est paru samedi dernier, le 13 juillet. 48 pages effervescentes. J'y ai signé dix articles, notamment le dossier de couverture consacré au pique-nique chic (11 pages), ainsi que d'autres thématiques. Extraits :





Joie de me lire dans L'EXPRESS paru ce matin sur un sujet que j'aborde rarement : la bière. Pression, cette fois.
Et avec une photo de B.B. chope en main !..
Aux kiosques, citoyen(ne)s!




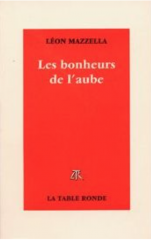 Je pensais l'avoir signalé ici, mais non. J'eus la surprise au coeur de l'été dernier de découvrir un papier élogieux et délicieusement tardif sur l'un de mes livres paru fin 2001 et qui, finaliste du Prix Goncourt de la Nouvelle, manqua cette distinction d'un cheveu. Le voici - il est signé Rita, blogueuse littéraire - et si cela vous incite, hâtez-vous, car le bouquin est en voie d'épuisement chez l'éditeur, lequel n'envisage pas de le réimprimer ou de le reprendre en format de poche dans La Petite Vermillon => Les Bonheurs de l'aube
Je pensais l'avoir signalé ici, mais non. J'eus la surprise au coeur de l'été dernier de découvrir un papier élogieux et délicieusement tardif sur l'un de mes livres paru fin 2001 et qui, finaliste du Prix Goncourt de la Nouvelle, manqua cette distinction d'un cheveu. Le voici - il est signé Rita, blogueuse littéraire - et si cela vous incite, hâtez-vous, car le bouquin est en voie d'épuisement chez l'éditeur, lequel n'envisage pas de le réimprimer ou de le reprendre en format de poche dans La Petite Vermillon => Les Bonheurs de l'aube
Il en va de l'essentiel Charles Juliet (cité ci-dessous avec deux extraits de ses Affûts parus chez P.O.L. en 1979), comme de Jacques Dupin, de Francis Ponge, de Philippe Jaccottet évoqué récemment ici même, de Pierre Reverdy, de Saint-John Perse, de Marceline Desbordes-Valmore, d'André Frénaud et de tous les autres passeurs de lumières et de frissons. Le mot de Hölderlin placé en titre est un étendard, une douce injonction faite à chacun. Chaque jour lire quelques poèmes de hasard et de bonne fortune nourrit plus sûrement que mes linguine alle vongole que je suis en train de concocter (quoique)... Enfin, les deux se fiancent agréablement, et si vous augmentez le sentiment avec le son, soit avec de la musique baroque (au hasard, encore), vous êtes armés pour combattre les mesquineries du quotidien, l'humeur rogue des gens dans la rue, et vous riez de cette neige qui tombe ce matin, car elle vous refile une envie forte de feu de cheminée après une marche sauvage, les pieds enfoncés profondément, les poumons glacés par un air vivifiant, et des oiseaux migrateurs plein les yeux et l'horizon... L.M.
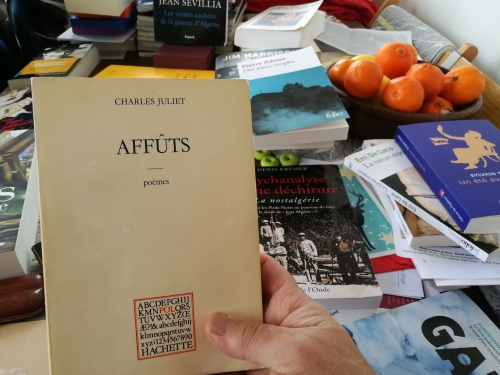
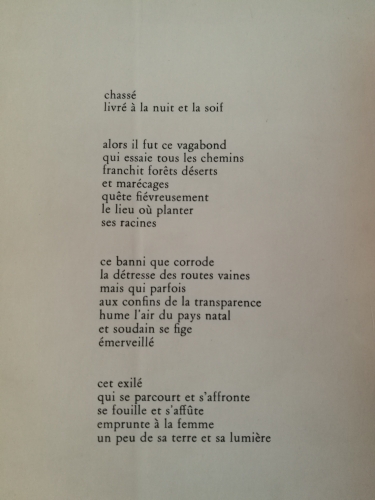
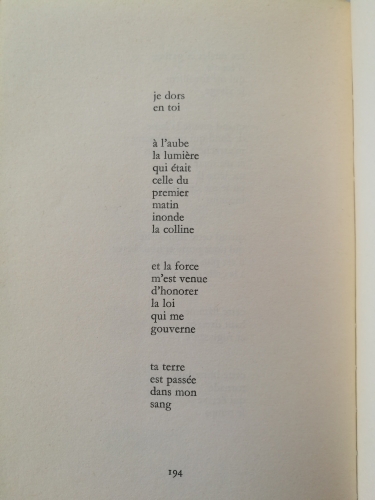
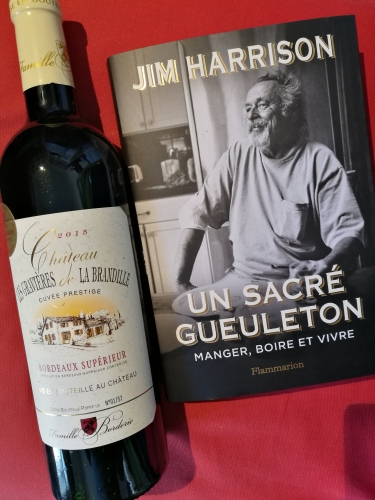
 Week-end de novembre dans le Perche. Les palombes luttent contre un vent mouillé, la pluie devient horizontale et piquante, il ne fait pas un temps à mettre un chevreuil dehors. D'ailleurs, on n'en surprend guère à l'orée des bois. Les grues cendrées ne passent plus, et les cendres menacent dans la grande cheminée. Il est temps de retourner aux affaires. Le château Les Gravières de La Brandille, Bordeaux Supérieur 2015 appartenant à la famille Borderie, sis à Saint-Médard-de-Guizières, est le flacon idéal pour escorter une viande rouge de sacré caractère comme une daube de sanglier mijotée des heures, un cuissot de chevreuil qui roupille lentement au four à 180°, ou une épaisse basse côte de bœuf des Flandres maturée trois semaines (photo), grillée sur de tendres braises, à bonne hauteur et devant la table de l'apéro, ce dimanche midi à la campagne, tandis que la pluie crépite encore sur les feuilles des chênes et des châtaigniers.
Week-end de novembre dans le Perche. Les palombes luttent contre un vent mouillé, la pluie devient horizontale et piquante, il ne fait pas un temps à mettre un chevreuil dehors. D'ailleurs, on n'en surprend guère à l'orée des bois. Les grues cendrées ne passent plus, et les cendres menacent dans la grande cheminée. Il est temps de retourner aux affaires. Le château Les Gravières de La Brandille, Bordeaux Supérieur 2015 appartenant à la famille Borderie, sis à Saint-Médard-de-Guizières, est le flacon idéal pour escorter une viande rouge de sacré caractère comme une daube de sanglier mijotée des heures, un cuissot de chevreuil qui roupille lentement au four à 180°, ou une épaisse basse côte de bœuf des Flandres maturée trois semaines (photo), grillée sur de tendres braises, à bonne hauteur et devant la table de l'apéro, ce dimanche midi à la campagne, tandis que la pluie crépite encore sur les feuilles des chênes et des châtaigniers.
Le flacon reflète bien le caractère viril de ses 90% de merlot (le reste est dans la fausse douceur des cabernet-sauvignon). Sur ces terres argilo-graveleuses, nous ne sommes pas loin de Saint-Émilion et nous retrouvons facilement dans le verre un air de ce terroir unique, à la fois raffiné et structuré, élégant et corpulent. La robe rubis est profonde, et le nez de fruits noirs légèrement épicé. Cette cuvée Prestige (9,80€ à peine) est élevée un an en fûts (un tiers de neufs). La bouche ample est longue, les tanins soyeux. L’écho (franchise, fraîcheur, suavité, léger confituré) avec la viande rouge, bleue mais chaude, est remarquable. C'est la tendresse du gentleman-farmer... L’idéal serait d’en avoir suffisamment pour élaborer la prochaine daube de joue de boeuf avec (penser à en commander). En attendant, il sera le compagnon idéal du livre posthume de « Big Jim » : Un sacré gueuleton. Manger, boire et vivre, qui paraît chez Flammarion. Et de Mozart. Santé ! (Pé-pèp!.. Remets deux ou trois bûches avant de sortir, s'il te plaît-merci). L.M.
 C comme Champagne. Le troisième numéro de ce magazine annuel (auquel nous collaborons depuis le n°0) paraît.
C comme Champagne. Le troisième numéro de ce magazine annuel (auquel nous collaborons depuis le n°0) paraît.
J'y signe pas mal de choses, notamment une enquête sur la guerre effervescente que se livrent champagnes, proseccos, cavas, et autres crémants et blanquette... Ainsi qu'une autre petite enquête sur les nouveaux consommateurs de champagne, ou encore la campagne choc du SGV (Syndicat général des vignerons de Champagne), que j'avais déjà évoquée dans L'Equipe magazine et son supplément Flacons le 14 juillet dernier.
Aux kiosques citoyens! Et vive la presse écrite imprimée.
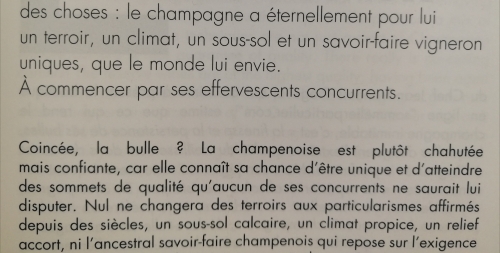

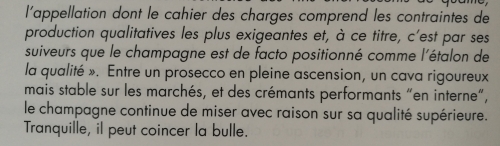
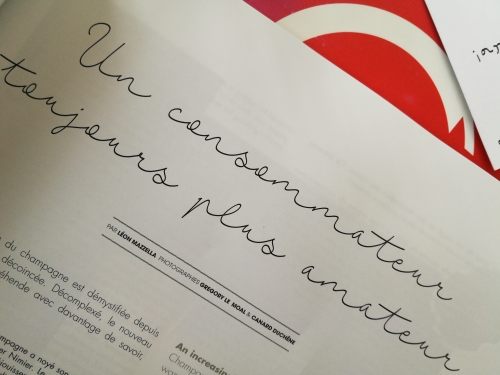
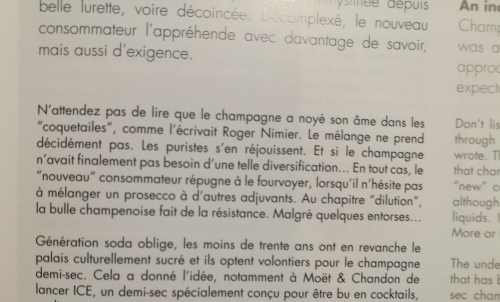
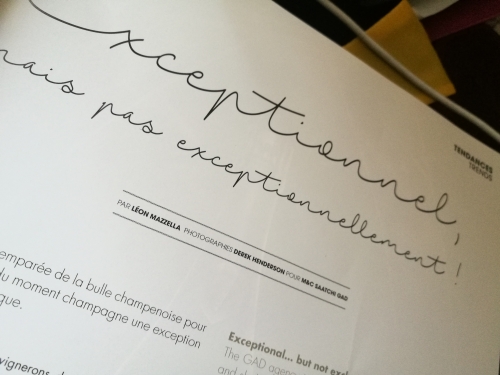

Note postée sur ma page Facebook il y a un instant (d'où certains détails), assortie d'une indispensable illustration à ne regarder qu'après avoir lu - On ne triche pas!..
DEMAIN J'ENLÈVE LE BAS
Vous souvenez-vous de cette brève campagne d’affichage (elle dura une dizaine de jours et fut visible sur 900 « 4x3 ») signée CLM/BBDO qui débuta il y a 37 ans, le 31 août 1981 ? Elle faisait la promotion de l’afficheur Avenir en montrant une jeune mannequin au corps svelte et sportif, aux cheveux courts et au regard malicieux nommée Myriam Szabo (une amie du grand photographe Jean-François Jonvelle dépêchée d’urgence pour la séance de shooting sur une plage des Bahamas après la défection du top-model pressenti). L’époque était au bien-être dans son corps de femme, et d’homme. Ma mère, mes sœurs, ma petite copine étaient seins nus à la plage de La Chambre d’Amour (seule maman remettait le haut de son maillot pour aller se baigner). Les slogans - comme on disait alors - de cette courte mais marquante campagne, étaient simples et reposaient sur le teasing avec trois affiches distinctes rendues publiques en moins d’une semaine : (En maillot deux pièces, devant un océan bleu turquoise) : « Le 2 septembre j’enlève le haut ». (Puis, seins nus) : « Le 4 septembre j’enlève le bas ». (Enfin, fesses nues, donc de dos, le 5 septembre) : « Avenir, l’afficheur qui tient ses promesses ». Cela fit grand bruit, et d’aucuns crièrent au scandale, mais il n'y eut aucun « lynchage » comme il y en aurait un en règle aujourd'hui, et assorti de violence (*). Myriam devint même une sorte d’icône. Depuis, le concept singulier de cette pub est enseigné dans les écoles de communication, car c'est un modèle du genre « pub pour la pub ». Pourquoi est-ce que j’en parle en décrivant rapidement les trois visuels au lieu de les montrer ? Et bien parce que Facebook me les a censurés illico, il y a quelques minutes. Mais le réseau social le plus partagé au monde n’est que l’illustration d’une époque qui a considérablement changé en devenant puritaine, susceptible, liberticide, tordue, triste en somme ; voire mortifère. Et très faux-cul surtout, car il suffira à chacun(e) d'écrire quelques mots-clés dans la barre, là-haut puis de cliquer pour qu'apparaissent en un instant ces trois charmantes photos. Ce que vous vous apprêtez à faire... L.M.
---
(*) Voir le récent déchaînement de haine à l'encontre de l'humoriste Constance (papier dans L'Obs), et la Vidéo de l'émission

Comme les temps changent, où plutôt combien nos esprits évoluent. Je quitte la Côte basque le 24 au soir. Et les Fêtes de Bayonne débutent le 25. Jadis, j'y étais pour elles, et en rouge & blanc dès avant l'heure. Francis Marmande (Bayonnais, collaborateur du "Monde" pour le jazz et les toros) me confiait hier soir à voix ourdie (je l'ai retrouvé par hasard au restaurant Chez Martin, rue d'Espagne*) qu'il partageait ma désaficiòn. Il regagnait d'ailleurs Paris ce matin, lors qu'une corrida à cheval s'annonce à Lachepaillet...
Que penser, sinon que nous devenons schnock, ce qui est tendance, me suis-je laissé dire. Jamais blasé -oh non, ni désabusé. Nostalgique assumé, certes. Cultivant nos souvenirs qui sont notre jardin voltairien, oui. Mais, quand même, hein. Se dire à soi-même, virant de bord en scooter devant la plage de La Petite Chambre d'Amour il y a une demi-heure : Trop de monde, je passe aux halles des Cinq-Cantons faire provision de bouche complémentaire vite fait, sans case apéro rosé ni jambon truffé chez Balme, et je file griller un paleron de chez Guillo avec les Raisins gaulois, si frais en bouche, de Lapierre. J'ai appelé Machin, il est libre, on refera le monde en général, et celui des femmes en particulier devant le barbecue. Autant dire que cela prendra du temps, même avec une cuisson lente obligée... Est-ce là un signe de réclusion, de repli, de... Non : Se préserver, pratiquer la stratégie de l'évitement contre tout ce qui agresse m'appert vital, désormais. Les bons moments sont comptés. Chacun d'entre eux doit, devra être bichonné. C'est comme ça. L.M.
 ----
----
*Extraordinaire déjeuner chez Sébastien Gravé, la veille (La Table de Pottoka), sans conteste la meilleure adresse bayonnaise du moment - et pourvu que ça dure!.. Surtout en compagnie (par hasard, encore, à l'apéro, puis au dijo - mais, par ici, les rencontres fortuites sont souvent ensoleillées), du débonnaire Éric Ospital (jambons Louis Ospital, dont j'ai abondamment parlé dans L'Express paru il y a deux semaines - en kiosque tout l'été dans la région), et de Stéphane Davet (réservé, pudique chroniqueur gastronomie et musique au "Monde").

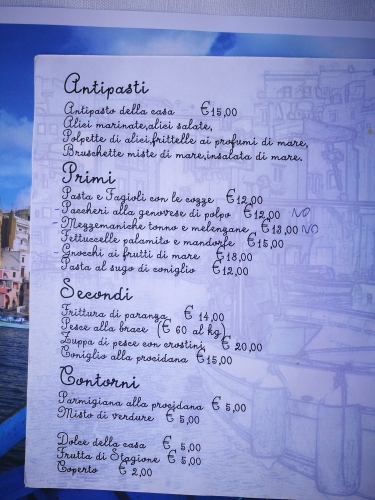


 Virée de quatre jours sur mon île, histoire - entre autres - de découvrir un nouveau restaurant, Da Maria alla Corricella. Maria est une femme à part, à l'abord dur, à l'abordage rêche. Elle fut la seule pêcheur(se) professionnelle de Campanie durant de très longues années. C'est une taiseuse comme la plupart des Procidiens. Je suis ami avec ses fils rugueux et soyeux à la fois Cesare et Giuseppe, depuis plus de vingt ans. À la retraite depuis des lustres, et tandis qu'elle régalait chaque jour son mari amateur de havanes, sa famille, et une partie de La Repubblica libre della Corricella (appellation absolument pas controllata), dont nous sommes membres à vie et avides, pour des agapes à l'intérieur, chez elle, ou bien le plus souvent en plein air, sur de longues tables face au porticcio, ses barques, les goélands, les chats, les filets entassés... Maria prit la décision - à force d'entendre que ses linguine aux oursins étaient des oursins iodés (ramassés tôt le matin avec une fourchette et sans masque, juste là, devant à trois cents mètres et à quatre ou cinq mètres de profondeur - prends bien ta respiration avant, bijou) aux linguine parfaitement al dente, que son sugo di coniglio était à se damner, et que, que, que... Son restaurant ouvrit donc, après pas mal de tracasseries administratives. Même ici, où tout semble permis, sinon autorisé (l'autorisation y étant une tolérance auto-proclamée), c'est parfois compliqué. Ah, les sortilèges de l'insularité... Mais nous y voilà : Sur cette Corricella devenue un chapelet de terrasses de restaurants légèrement inégaux. Les voisins immédiats de Maria, Vincenzo à La Graziella et Aniello à La Gorgonia - nous avons nos vieilles habitudes aux deux gargotes -, ont les dents qui grincent. Au-delà, soit à moins de dix mètres de part et d'autre, c'est déjà autre chose : Caracalè d'un côté, Maestrale de l'autre sont loin. Alors Il Postino, Fuego, La Lampara sont à des années-lumière, soit à cinquante mètres (sous le cañar, ça joue). Disons-le tout de suite : une seule chose cloche chez Maria, c'est le bruit de l'aération. Afin de ne pas s'évanouir sous sa charlotte, au fond de ces habitations semi-troglodytiques de toute la Corricella, et quand la cuisine est forcément calée contre la roche murée, il convient d'aérer puissamment. D'où l'intempestif et persistant ronronnement. Tout le reste fonctionne. L'antipasto della casa bon pour deux personnes sauf si vous avez mon appétit, doit obligatoirement être commandé (photo) avec un pichet de blanc local (très fruité, très frais ici - car son goût change d'une adresse l'autre), et une bouteille d'eau frizzante avant de commander plus avant. Puis, examiner la pêche du jour sur assiette, car elle peut convaincre de lancer quelque dorade ou sar (marbré) alla brace pour une cuisson vive sur peau non écaillée et au gros sel. Rayon pasta, demandez celles du jour qui ne figurent pas sur la carte. Aux fruits de mer (langoustines, gambas, moules, palourdes, cigales, calmars...), elles sont divines grâce au jus, ah ce jus qui mêle tomates cerise confites, ail frais, friarielli encore croquants, et eau des crustacés réduite à la cuisson... Maria a pris soin de cajoler les recettes typiquement locales de la cuisine povera, comme ces Pasta e fagioli con le cozze, des pâtes différentes de fins de paquet aux haricots blancs et aux moules. Côté Secondi piatti, notons le Coniglio alla Procidana (lapin à la Procidaine), et la Frittura di paranza, bouquet de petits poissons de roche divers et frits, à manger avec les doigts après les avoir citronnés. Rayon contorni, prenez sans hésiter le Misto di verdure, une assiette d'aubergines, courgettes, tomates, en petits dés et olives dénoyautées, le tout réduit comme une caponata gorgée de saveurs distinctes. Avant de tâter des desserts (tiramisu et tarte au citron maison évidemment, fort recommandables). Voilà. Da Maria va faire mal, j'en suis certain. Et pour finir? Avant de finir finir, une assiette de fruits (pastèque, ananas, raisin, abricot, prune - sur glace) avec un dernier pichet de bianco locale issu de falanghina ou de biancolella rempli de quartiers de pêche jaune ou blanche mêlés (variante procidienne du rosé-piscine). Puis, Un limoncello della casa con il caffè!.. Après, il sera temps de faire un tour de bateau pour aller piquer une tête au large en écoutant à fond Tu vuò fà l'americano, 'mericano, 'mericano... L.M.
Virée de quatre jours sur mon île, histoire - entre autres - de découvrir un nouveau restaurant, Da Maria alla Corricella. Maria est une femme à part, à l'abord dur, à l'abordage rêche. Elle fut la seule pêcheur(se) professionnelle de Campanie durant de très longues années. C'est une taiseuse comme la plupart des Procidiens. Je suis ami avec ses fils rugueux et soyeux à la fois Cesare et Giuseppe, depuis plus de vingt ans. À la retraite depuis des lustres, et tandis qu'elle régalait chaque jour son mari amateur de havanes, sa famille, et une partie de La Repubblica libre della Corricella (appellation absolument pas controllata), dont nous sommes membres à vie et avides, pour des agapes à l'intérieur, chez elle, ou bien le plus souvent en plein air, sur de longues tables face au porticcio, ses barques, les goélands, les chats, les filets entassés... Maria prit la décision - à force d'entendre que ses linguine aux oursins étaient des oursins iodés (ramassés tôt le matin avec une fourchette et sans masque, juste là, devant à trois cents mètres et à quatre ou cinq mètres de profondeur - prends bien ta respiration avant, bijou) aux linguine parfaitement al dente, que son sugo di coniglio était à se damner, et que, que, que... Son restaurant ouvrit donc, après pas mal de tracasseries administratives. Même ici, où tout semble permis, sinon autorisé (l'autorisation y étant une tolérance auto-proclamée), c'est parfois compliqué. Ah, les sortilèges de l'insularité... Mais nous y voilà : Sur cette Corricella devenue un chapelet de terrasses de restaurants légèrement inégaux. Les voisins immédiats de Maria, Vincenzo à La Graziella et Aniello à La Gorgonia - nous avons nos vieilles habitudes aux deux gargotes -, ont les dents qui grincent. Au-delà, soit à moins de dix mètres de part et d'autre, c'est déjà autre chose : Caracalè d'un côté, Maestrale de l'autre sont loin. Alors Il Postino, Fuego, La Lampara sont à des années-lumière, soit à cinquante mètres (sous le cañar, ça joue). Disons-le tout de suite : une seule chose cloche chez Maria, c'est le bruit de l'aération. Afin de ne pas s'évanouir sous sa charlotte, au fond de ces habitations semi-troglodytiques de toute la Corricella, et quand la cuisine est forcément calée contre la roche murée, il convient d'aérer puissamment. D'où l'intempestif et persistant ronronnement. Tout le reste fonctionne. L'antipasto della casa bon pour deux personnes sauf si vous avez mon appétit, doit obligatoirement être commandé (photo) avec un pichet de blanc local (très fruité, très frais ici - car son goût change d'une adresse l'autre), et une bouteille d'eau frizzante avant de commander plus avant. Puis, examiner la pêche du jour sur assiette, car elle peut convaincre de lancer quelque dorade ou sar (marbré) alla brace pour une cuisson vive sur peau non écaillée et au gros sel. Rayon pasta, demandez celles du jour qui ne figurent pas sur la carte. Aux fruits de mer (langoustines, gambas, moules, palourdes, cigales, calmars...), elles sont divines grâce au jus, ah ce jus qui mêle tomates cerise confites, ail frais, friarielli encore croquants, et eau des crustacés réduite à la cuisson... Maria a pris soin de cajoler les recettes typiquement locales de la cuisine povera, comme ces Pasta e fagioli con le cozze, des pâtes différentes de fins de paquet aux haricots blancs et aux moules. Côté Secondi piatti, notons le Coniglio alla Procidana (lapin à la Procidaine), et la Frittura di paranza, bouquet de petits poissons de roche divers et frits, à manger avec les doigts après les avoir citronnés. Rayon contorni, prenez sans hésiter le Misto di verdure, une assiette d'aubergines, courgettes, tomates, en petits dés et olives dénoyautées, le tout réduit comme une caponata gorgée de saveurs distinctes. Avant de tâter des desserts (tiramisu et tarte au citron maison évidemment, fort recommandables). Voilà. Da Maria va faire mal, j'en suis certain. Et pour finir? Avant de finir finir, une assiette de fruits (pastèque, ananas, raisin, abricot, prune - sur glace) avec un dernier pichet de bianco locale issu de falanghina ou de biancolella rempli de quartiers de pêche jaune ou blanche mêlés (variante procidienne du rosé-piscine). Puis, Un limoncello della casa con il caffè!.. Après, il sera temps de faire un tour de bateau pour aller piquer une tête au large en écoutant à fond Tu vuò fà l'americano, 'mericano, 'mericano... L.M.
Je signe les 12+2 pages (et quelques photos, dont la couv. locale) consacrées au Pays basque gourmand dans L'EXPRESS qui paraît ce matin.
À lire notamment : une longue randonnée savoureuse et zigzagante, de l'océan (La Chambre d'Amour, à Anglet) à la montagne (Iraty, et Larrau, en Soule). Un portrait de Cédric Béchade, chef de l'Auberge basque à St-Pée-sur-Nivelle. Un autre d'Éric Ospital, charcutier-salaisonnier à Hasparren. Un autre encore de Dominic Lagadec, encyclopédiste du sagarno (le cidre basque). Et enfin une brassée d'adresses de tables et d'hôtels (tous testés), sur la Côte et à l'intérieur du Pays.
Aux kiosques, citoyens! Et vive la presse écrite print. L.M.



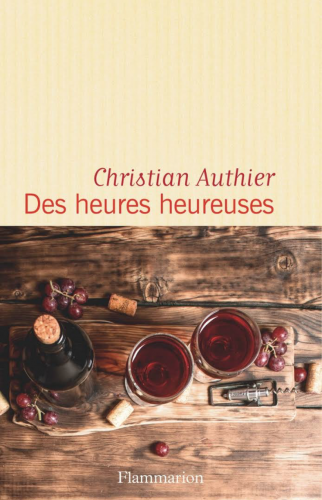 Ça commence avec un emprunt à deux incipits : ceux de « Aurélien » de Louis Aragon et du « Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline » dans la même première phrase, et ça finit par une allusion à l’excipit du « Singe en hiver » d’Antoine Blondin avec un épisode à la Roger Nimier ou à la Jean-René Huguenin. Des références en forme de révérences. On adore. Christian Authier aime le jeu et l’hommage. Avec « Des heures heureuses », son septième roman (Flammarion, 19€), il ne nous donne pas seulement à boire du bon vin à chaque page ou peu s’en faut – d’ailleurs, quand il est mauvais, cela déclenche la colère de Thomas (sa doublure) et celle de Robert Berthet son mentor. Il nous fait également rire avec une tripotée d’anecdotes (toutes vraies bien qu’invraisemblables) et jouer aux devinettes : quel écrivain ami, quel vigneron aimé, quel chef de talent se cachent derrière de vrais noms comme ceux de Maréchaux, Guégan, Lacoche, Maulin ? Alors on cherche à deviner, et Authier corse le jeu. Au rayon vignerons, Éric Callcut c’est Calcutt, Selosse c’est Selosse en substance, mais Jean-Christophe Besnard c’est Comor ! Comme Jean-Marc Filhol c’est Parisis au rayon écrivains, et Alain Laborde, Yves Camdeborde au compartiment cuisiniers. C’est relativement fastoche lorsqu’on est initié, soit un peu du club...
Ça commence avec un emprunt à deux incipits : ceux de « Aurélien » de Louis Aragon et du « Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline » dans la même première phrase, et ça finit par une allusion à l’excipit du « Singe en hiver » d’Antoine Blondin avec un épisode à la Roger Nimier ou à la Jean-René Huguenin. Des références en forme de révérences. On adore. Christian Authier aime le jeu et l’hommage. Avec « Des heures heureuses », son septième roman (Flammarion, 19€), il ne nous donne pas seulement à boire du bon vin à chaque page ou peu s’en faut – d’ailleurs, quand il est mauvais, cela déclenche la colère de Thomas (sa doublure) et celle de Robert Berthet son mentor. Il nous fait également rire avec une tripotée d’anecdotes (toutes vraies bien qu’invraisemblables) et jouer aux devinettes : quel écrivain ami, quel vigneron aimé, quel chef de talent se cachent derrière de vrais noms comme ceux de Maréchaux, Guégan, Lacoche, Maulin ? Alors on cherche à deviner, et Authier corse le jeu. Au rayon vignerons, Éric Callcut c’est Calcutt, Selosse c’est Selosse en substance, mais Jean-Christophe Besnard c’est Comor ! Comme Jean-Marc Filhol c’est Parisis au rayon écrivains, et Alain Laborde, Yves Camdeborde au compartiment cuisiniers. C’est relativement fastoche lorsqu’on est initié, soit un peu du club...
Références à Blondin à coups de citations planquées, répliques-cultes des « Tontons flingueurs », d’autres allusions plus subtiles à des ouvrages de Sébastien Lapaque par exemple (Les vins de copains, Théorie de la carte postale)... L’auteur s’amuse en écrivant et cela nous procure un bien fou. De même qu’il est franchement jouissif de lire (enfin) une satire en règle des faussaires de tout poil. Qu'il s'agisse des bobos adeptes aveuglés du vin « nature » non soufré au nez de pisse de chat et au goût de vieille serpillère, comme de ceux qui les « font » sans rien faire justement, et qui ont donc du temps pour prêcher la parole sectaire de leur confrérie intégriste du goût mauvais.
Il y a du Déon, du Nimier dans le style, et du Houellebecq dans le regard davantage mélancolique que désabusé que l’auteur porte au monde tel qu’il déçoit. Loin de surfer sur la vieille vague du c’était mieux avant, puisque « le passé qu’ils regrettaient ne datait que d’une vingtaine d’années », Authier instille par touches délicates, de manière pointilliste, ses avis sur la question contemporaine. Qu’il s’agisse de l’ère du tri sélectif, des parvenus que tout Guépard dans l'âme vilipende, de l’inculture assumée des jeunes – sans honte bue, de la dictature du portable ou – plus grave -, de la disparition du sourire. Il n’est pas tout à fait « antimoderne » non plus, mais loue à n’importe quel taux la douce fureur plutôt que la peur, de vivre.
Le sujet principal est ce monde des vins que l’on dit vivants, ou bios pour faire court. C’est le cadre. Le contenant. Le contenu est infiniment humain, infiniment Français, si sensible, fragile même, car sous les sautes d’humeur, les boutades, les engueulades et les mornifles engendrées par la picole, les bons mots à se bidonner comme : « Patron, du vin ou on encule le chien ! », ce sont là des hommes en rupture de ban avec leur époque qui se cachent derrière le masque du sourire. Ce ne sont pas des « Enfants tristes » pour autant, mais de « vieux enfants » au cœur gros comme ça, habités par « la nostalgie de l’insouciance et de l’innocence ». Des « frères d’âmes » sachant mieux ouvrir les boutanches que fendre l’armure. « Des heures heureuses » est ainsi un roman Hussard en diable pour la joie de boire et de rire, pour les copains d’abord, cette bande de singes toujours en hiver, et il contient aussi une touche à la Drieu pour « ce désenchantement intime (qui) les rendait touchants », ce qui lui donne une belle longueur en bouche. Il y a aussi du football et pas mal de cinéma (deux marottes de l’auteur) dans ce livre qui foisonne de bonnes choses comme un assortiment de tapas nocturnes.
Nous aimons partager les agapes toulousaines (au Tire-Bouchon notamment) et germanopratines (chez Yves Camdeborde au Comptoir du Relais, chez Michael au Moose) et fort arrosées des joyeux drilles, membres du « Clup ». Et surtout suivre les virées en voiture sur les routes des vignobles français de respect, d’un tandem de tendres fanfarons – Thomas l’élève de 26 ans au regard faussement candide, et Berthet l’agent en vins bons, la cinquantaine bougonne, voire soupe au lait. C’est Don Quichotte et Sancho Pança sans les moulins. Mais avec une Dulcinée nommée Zoé qui, surgissant tout à trac, fera flancher Thomas – et nous le comprenons en lisant le portrait de cette fée qui embarque l'amoureux pour Lisbonne, Berlin, Madrid, Istanbul et le Pays basque, histoire de l’extraire de la cave. Au point que le personnage songera à laisser tomber Berthet, les vins... Mais cet hymne à l’amitié – cheval de bataille de tous les romans d’Authier -, ne saurait dévier, sauf cas de force majeure. « Qu’est-ce qu’on boit après ? ». Je parie sur un Prieuré-Roch. On n’a pas de Romanée-Conti. L.M.
 Attiré d’abord par le nom, eu égard à ma passion des oiseaux, et même à l’affection particulière que je nourris à l’adresse des turdidés (eux qui m’ont jadis tant nourri), puis par l’écho vu plus que lu en musardant sur quelque gazette numérique à la mode se piquant de savoir reloader l’univers de la gastronomie, et enfin par un quartier que j’ai plaisir à voir rajeunir et prendre des couleurs grâce à ses tables accortes – le onzième arrondissement de Paris -, j’ai poussé la porte de Grive, ouvert en novembre dernier, qui est le mois de la migration de ces oiseaux, qu’ils soient mauvis, musicienne, litorne ou draine. Qu’elle ne fut pas ma surprise de voir qu’en fait de grive, il s’agissait d’un merle, plastronnant perpendiculairement, en l'enseigne plantée au mur du numéro 18 de la rue Bréguet, gravé sur d'élégants verres (si jolis que j'en ai acheté 18, à 4€ pièce) ou encore imprimé sur les facturettes. Plus noir que noir et aucunement grivelé.
Attiré d’abord par le nom, eu égard à ma passion des oiseaux, et même à l’affection particulière que je nourris à l’adresse des turdidés (eux qui m’ont jadis tant nourri), puis par l’écho vu plus que lu en musardant sur quelque gazette numérique à la mode se piquant de savoir reloader l’univers de la gastronomie, et enfin par un quartier que j’ai plaisir à voir rajeunir et prendre des couleurs grâce à ses tables accortes – le onzième arrondissement de Paris -, j’ai poussé la porte de Grive, ouvert en novembre dernier, qui est le mois de la migration de ces oiseaux, qu’ils soient mauvis, musicienne, litorne ou draine. Qu’elle ne fut pas ma surprise de voir qu’en fait de grive, il s’agissait d’un merle, plastronnant perpendiculairement, en l'enseigne plantée au mur du numéro 18 de la rue Bréguet, gravé sur d'élégants verres (si jolis que j'en ai acheté 18, à 4€ pièce) ou encore imprimé sur les facturettes. Plus noir que noir et aucunement grivelé.
« Faute de grives, on mange des merles » : Je poussai donc la porte à l’heure du déjeuner en plein proverbe vantant l’indigence sachant philosopher sur la disette en congédiant les papilles. J’objectai à peine assis, afin de manifester mon étonnement ornithologique. Il me fut répondu en me tendant la carte (courte, elle change souvent au gré de la fraîcheur du marché) que « c’était la même famille ». Certes, un porc d’élevage industriel et un sanglier sont eux aussi de la même famille, comme une tomate et un ananas sont des fruits. Je préférai donc y voir une silhouette en ombre chinoise... Cette absence de souci de la précision laissait-elle augurer un écho laxiste en cuisine ? Nous allions voir. La décoration est fraîche, dans cette salle aux dimensions menues et dont un mur expose des bouteilles d’assez bonne origine, mais convenue dans le quartier (du bio à bobo, mais pas que), avec vente à emporter (vins, huîtres). De vastes peintures figurant des produits (huître, pomme pelée), viennent d’être remplacées par des photographies évoquant notamment la pêche en mer. Couteaux Nontron sur table, du bois un peu partout...
Allons-y, allons-zo ! Une entrée pour deux attirait : tartare de truite de Banka (la fameuse saumonée de l’élevage en pleine montagne basque de Peyo Petricorena – j’en ai encore dit du bien dans L’Express récemment), voilà qui allait ouvrir l’appétit. Malheureusement, nous n’avons pas retrouvé la subtilité habituelle de la chair de ce poisson dans les petits morceaux crus marinés, ni dans le coeur de truite épais et ferme à souhait. Il ne suffit pas de nommer les « petits » producteurs comme on prénomme les vignerons (ça vous classe), de pratiquer le name dropping des suffisants-à-la-triste-mine-qui-savent, eux, pour qu'un passage en cuisine fasse de tout produit un bonheur dans l’assiette. Là, je fus perplexe, car en fait de transformation, hormis un assaisonnement basique...
Nous apprîmes que le cochon était de Bayeux, et élevé « à la ferme bio en circuit court », que les huîtres de Saint-Vaast-la-Hougue d'Yvan Dernis étaient « naturelles de pleine mer » (une huître artificielle serait-elle stérilisée?), et les poissons de « pêche durable ». Les herbes, comme l’oxalys, l'oseille rouge et le pissenlit, sont « ramassées à la main », mais nous ne voyons guère comment les cueillir mécaniquement, et le faire avec les pieds présente quelque inconvénient. Alors, oui, bien sûr qu’il est louable, ce souci de « sourcer » convenablement les produits, mais de là à s’agenouiller devant l’adjectif bio (lequel cache tant d'arnaques - Oui, mais bon, c'est cool, tu vois)... Encore faut-il ne pas en faire une carte de visite en forme de sésame, l’habit ne faisant pas le moine. Il faut surtout flatter le (bon) produit comme il convient.
La côte de porc était hélas sèche, dure, et sans saveur particulière. Le poulet choisi par mon vis à vis idem. Purée de céleri, champignons de Paris ici, pommes de terre là... Herbes et fleurs parsemées pour « la jouer Iñaki » peut-être, mais celles-ci n’épatent plus le chaland. Leur goût, en contrepoint, est en revanche utile, car il fait office de condiment. Les plats déçoivent donc par leur exécution sommaire, leur banalité dans la construction, leur manque de pertinence, et avant tout par leurs saveurs en berne. Nous n’avions évidemment pas envie de « tester » une table en prenant une douzaine d’huîtres (22€). J'hésitai cependant à prendre des couteaux en entrée, et les coques aussi... J'y retournerai afin de me risquer sur le homard, et tenter le lieu jaune : pleine mer en avant toute !
Quant au service, il est, comment dire... dans la lune, sinon distrait – mais fort aimable. Les prix sont chouia marxistes (Thierry), eu égard aux paramètres (notoriété, réputation), soit disproportionnés. Et, justement, les portions sont de surcroît chiches. Comptez 8 à 12€ l’entrée, 19 à 22€ le plat, 10€ le dessert (20€ l’assortiment de fromages), le verre de vin est à partir de 5€ (bien). Un acte de grivèlerie tenterait le malhonnête. Au lieu de quoi j’ai filé (pas loin de) cent sacs au toubib, pour parler comme Le Mexicain des Tontons flingueurs, qui sait être grivois. Grave. L.M.
prix sont chouia marxistes (Thierry), eu égard aux paramètres (notoriété, réputation), soit disproportionnés. Et, justement, les portions sont de surcroît chiches. Comptez 8 à 12€ l’entrée, 19 à 22€ le plat, 10€ le dessert (20€ l’assortiment de fromages), le verre de vin est à partir de 5€ (bien). Un acte de grivèlerie tenterait le malhonnête. Au lieu de quoi j’ai filé (pas loin de) cent sacs au toubib, pour parler comme Le Mexicain des Tontons flingueurs, qui sait être grivois. Grave. L.M.
 Après Tomy&Co (22, rue Surcouf, Paris 7), Tomy Gousset a ouvert Hugo&Co il y a environ un mois (48, rue Monge, Paris 5). Le jeune chef d’origine cambodgienne que l’on avait découvert au restaurant Pirouette – dont on peut dire qu’il a contribué à sculpter le succès (rue Mondétour, Paris 1) et qui, après être passé par l’école Ferrandi, a fait ses classes chez Yannick Alléno (Le Meurice), Daniel Boulud (à New York) et Alain Solivérès (Taillevent), des nuls n'est-ce pas, aime mélanger les styles culinaires (asiatique, espagnol, italien, français bien sûr) lorsqu’il sent que ça peut « tenir debout », et pas banalement pour la jouer fusion. Sa deuxième adresse – testée hier soir -, est plus cool côté carte que la première, mais aussi authentiquement bistronomique, davantage conviviale également avec, entre autres, sa grande table d’hôte trônant majestueusement, comme dans les établissements successifs de Julien Duboué (Afaria, Dans les Landes mais à Paris, A Noste). Il y a aussi un petit comptoir qui permet de déguster côte à côte tout en parlant « au vol » avec le chef, lequel achève de dresser chaque assiette avec une méticulosité d’horloger genevois de ses dix doigts que prolongent des avant-bras abondamment tatoués (désormais, les jeunes chefs non tatoués se comptent justement sur les doigts d’une main. Par bonheur, ils ne passent pas tous plusieurs heures par semaine chez leur coiffeur spécialiste de la coupe footeux). Tomy dresse donc, en gardant un œil sur la salle et l’autre en cuisine – appelons cela l’indispensable strabisme divergeant du boss, et non sans avoir les deux oreilles à l’écoute (totale), en lançant de temps à autre quelques mots (d’ordre) secs et d’une redoutable efficacité immédiate : c’est le côté chef d’orchestre sans baguette. La décoration est, disons : roots (cagettes aux murs ornées de bouteilles et de plantes, par exemple), qui rappelle les bistrots new-yorkais et les lieux actuellement branchés de la Côte basque espagnole. Le nom de l’établissement m’évoque celui de l’un de mes éditeurs : Hugo & Cie. Or, il fait simplement référence au prénom du fils de Tomy (et renvoie au nom du restaurant espagnol qui s’y trouvait précédemment : Casa Hugo). Dans l’assiette, la patte Gousset est assurément là : produits à forte identité, saveurs puissantes, associations justes, précises et efficaces : il s’agit plutôt d’une empreinte. La Brioche vapeur « Bao » à la queue de bœuf, légumes en pickles et cacahuètes (à droite sur la photo) figure une entrée bluffante et déjà plébiscitée par les amateurs. Notons que, à l’instar de Julien Dumas (Lucas Carton) mais pas d’un Alain Passard qui possède son propre potager, les légumes cuisinés par Tomy proviennent d’une parcelle de potager qu’il détient aux Jardins (bios) du Château de Courances, dans la région de Melun, via Tomato&Co (entreprise originale proposant – aux particuliers comme aux professionnels - des parcelles sur mesure, plantées à la carte, commandées à distance et entretenues par des jardiniers). Ainsi, les asperges vertes fendues qui recouvraient des morceaux généreux de joue de bœuf snackée (d’un fondant délicieux) eux-mêmes posés sur de bonnes panisses croustillantes, étaient-elles riches en saveurs originelles. Une autre entrée
Après Tomy&Co (22, rue Surcouf, Paris 7), Tomy Gousset a ouvert Hugo&Co il y a environ un mois (48, rue Monge, Paris 5). Le jeune chef d’origine cambodgienne que l’on avait découvert au restaurant Pirouette – dont on peut dire qu’il a contribué à sculpter le succès (rue Mondétour, Paris 1) et qui, après être passé par l’école Ferrandi, a fait ses classes chez Yannick Alléno (Le Meurice), Daniel Boulud (à New York) et Alain Solivérès (Taillevent), des nuls n'est-ce pas, aime mélanger les styles culinaires (asiatique, espagnol, italien, français bien sûr) lorsqu’il sent que ça peut « tenir debout », et pas banalement pour la jouer fusion. Sa deuxième adresse – testée hier soir -, est plus cool côté carte que la première, mais aussi authentiquement bistronomique, davantage conviviale également avec, entre autres, sa grande table d’hôte trônant majestueusement, comme dans les établissements successifs de Julien Duboué (Afaria, Dans les Landes mais à Paris, A Noste). Il y a aussi un petit comptoir qui permet de déguster côte à côte tout en parlant « au vol » avec le chef, lequel achève de dresser chaque assiette avec une méticulosité d’horloger genevois de ses dix doigts que prolongent des avant-bras abondamment tatoués (désormais, les jeunes chefs non tatoués se comptent justement sur les doigts d’une main. Par bonheur, ils ne passent pas tous plusieurs heures par semaine chez leur coiffeur spécialiste de la coupe footeux). Tomy dresse donc, en gardant un œil sur la salle et l’autre en cuisine – appelons cela l’indispensable strabisme divergeant du boss, et non sans avoir les deux oreilles à l’écoute (totale), en lançant de temps à autre quelques mots (d’ordre) secs et d’une redoutable efficacité immédiate : c’est le côté chef d’orchestre sans baguette. La décoration est, disons : roots (cagettes aux murs ornées de bouteilles et de plantes, par exemple), qui rappelle les bistrots new-yorkais et les lieux actuellement branchés de la Côte basque espagnole. Le nom de l’établissement m’évoque celui de l’un de mes éditeurs : Hugo & Cie. Or, il fait simplement référence au prénom du fils de Tomy (et renvoie au nom du restaurant espagnol qui s’y trouvait précédemment : Casa Hugo). Dans l’assiette, la patte Gousset est assurément là : produits à forte identité, saveurs puissantes, associations justes, précises et efficaces : il s’agit plutôt d’une empreinte. La Brioche vapeur « Bao » à la queue de bœuf, légumes en pickles et cacahuètes (à droite sur la photo) figure une entrée bluffante et déjà plébiscitée par les amateurs. Notons que, à l’instar de Julien Dumas (Lucas Carton) mais pas d’un Alain Passard qui possède son propre potager, les légumes cuisinés par Tomy proviennent d’une parcelle de potager qu’il détient aux Jardins (bios) du Château de Courances, dans la région de Melun, via Tomato&Co (entreprise originale proposant – aux particuliers comme aux professionnels - des parcelles sur mesure, plantées à la carte, commandées à distance et entretenues par des jardiniers). Ainsi, les asperges vertes fendues qui recouvraient des morceaux généreux de joue de bœuf snackée (d’un fondant délicieux) eux-mêmes posés sur de bonnes panisses croustillantes, étaient-elles riches en saveurs originelles. Une autre entrée remarquable (à gauche sur la photo) est composée de fines tranches de bœuf fumé (une chiffonade d’une délicatesse de dentellière) accompagnées de noisettes torréfiées. De même, un autre plat mémorable (puisque j’y dînais en compagnie de mon fils) – nous avons d'ailleurs parié qu’il serait appelé à connaître le succès, s’intitule maquereaux tiédis et sauce chimichurri (condiment argentin légèrement pimenté) fregolas (petites pâtes sardes en forme de mini boulettes) et shitakés (champignons), et enfin pignons de pin : un délice d’harmonie des flaveurs. Une impression générale se dégage de ce repas (sans desserts : une autre fois), c’est celle de douceur, de moelleux, de régressif même (ainsi que je l’avais fortement ressenti en découvrant il y a dix-neuf ans le talent de Philippe Conticini), même si Tomy Gousset prend soin de flatter l’ouïe avec du croquant, voire du croustillant ici et là : pickles, asperges, noisettes, pignons, surface des panisses comme celle des shitakés... Ça « envoie », et ça « ping-pongue » agréablement, mais la douceur l’emporte au gong, et il y a par ailleurs cette touche générale et délicate de fumé qui semble inspirer, survoler la cuisine. Un mot sur la remarquable carte des vins qui fait la part belle aux blancs, même si l’on y lit des noms de vignerons, en bio pour la plupart, et bien « dans le verre du temps », puisque nous les retrouvons dans nombre d’adresses – car, justement, cela fait toujours du bien de se dire : Té ! On va prendre Les Reflets, de Thierry Michon, c'est toujours super ! Et puis, ça rassure, on est bien, là. Un superlatif pour le service, car il est sincèrement formidable : efficace, prévenant, souriant, aimable, discret. La note ? Entrées de 7 à 16€ (12 pour les deux citées), de 16 à 19€ pour les plats (19 pour les deux cités), excepté les 600 g de faux filet maturé et fumé au foin & jus à la moelle, pour deux personnes : 70€, qui ne perdent d’ailleurs rien pour attendre !.. Desserts : 9€. Coefficient multiplicateur raisonnable pratiqué sur la cave. L’adresse étant d’ores et déjà full up, il est, comme on dit, prudent de réserver en composant le 09 53 92 62 77. L.M.
remarquable (à gauche sur la photo) est composée de fines tranches de bœuf fumé (une chiffonade d’une délicatesse de dentellière) accompagnées de noisettes torréfiées. De même, un autre plat mémorable (puisque j’y dînais en compagnie de mon fils) – nous avons d'ailleurs parié qu’il serait appelé à connaître le succès, s’intitule maquereaux tiédis et sauce chimichurri (condiment argentin légèrement pimenté) fregolas (petites pâtes sardes en forme de mini boulettes) et shitakés (champignons), et enfin pignons de pin : un délice d’harmonie des flaveurs. Une impression générale se dégage de ce repas (sans desserts : une autre fois), c’est celle de douceur, de moelleux, de régressif même (ainsi que je l’avais fortement ressenti en découvrant il y a dix-neuf ans le talent de Philippe Conticini), même si Tomy Gousset prend soin de flatter l’ouïe avec du croquant, voire du croustillant ici et là : pickles, asperges, noisettes, pignons, surface des panisses comme celle des shitakés... Ça « envoie », et ça « ping-pongue » agréablement, mais la douceur l’emporte au gong, et il y a par ailleurs cette touche générale et délicate de fumé qui semble inspirer, survoler la cuisine. Un mot sur la remarquable carte des vins qui fait la part belle aux blancs, même si l’on y lit des noms de vignerons, en bio pour la plupart, et bien « dans le verre du temps », puisque nous les retrouvons dans nombre d’adresses – car, justement, cela fait toujours du bien de se dire : Té ! On va prendre Les Reflets, de Thierry Michon, c'est toujours super ! Et puis, ça rassure, on est bien, là. Un superlatif pour le service, car il est sincèrement formidable : efficace, prévenant, souriant, aimable, discret. La note ? Entrées de 7 à 16€ (12 pour les deux citées), de 16 à 19€ pour les plats (19 pour les deux cités), excepté les 600 g de faux filet maturé et fumé au foin & jus à la moelle, pour deux personnes : 70€, qui ne perdent d’ailleurs rien pour attendre !.. Desserts : 9€. Coefficient multiplicateur raisonnable pratiqué sur la cave. L’adresse étant d’ores et déjà full up, il est, comme on dit, prudent de réserver en composant le 09 53 92 62 77. L.M.
 Je me souviens bien d'une poularde de Bresse, et avec davantage de précision du son que fit la croûte qu'il me fallut casser avec l'épaule d'une cuiller afin de découvrir et commencer d'absorber un petit lac circulaire : la soupe VGE à la truffe, ou plutôt le grouillant salmigondis d'une colonie de truffes en déroute, en morceaux et en soupe... Cela se passa à Bocuse-ville... Je me souviens surtout du regard gras, valisé, lippu même, mais palpitant comme un oiseau que l'on tient avec peine et délicatesse entre nos paumes juste jointes et pas serrées... Du regard - appuyé - de Monsieur Paul. Je me trouvais là plus ou moins pour GaultMillau comme on dit, dont j'assurais alors la direction des rédactions (du magazine et des guides), mais justement et délibérément sans aucune obligation, soit sans carnet de notes à noircir, décontracté du stylo; à la fraîche de surcroît... Pourvu du seul plaisir d'une errance mycologique choisie. En ouiquende, aurait écrit Roger Nimier, ou bien luxueusement en visite. Et aussi (car, même en roue libre j'ai un angle d'attaque en tête, c'est plus fort que moi) pour l'ineffable plaisir d'échanger avec la sensibilité vive et qui bouillait sous une longue toque blanche (coiffant une tête bien faite ayant toujours préféré la bonne vieille casquette en tweed qui renifle la sauvagine), à propos des sarcelles rebelles et des bécassines tellement furtives de la Dombes - oiseaux vénérés que j'ai toujours adoré décrocher du plus loin que je le pouvais avec mon léger calibre 20 et à contre vent, tandis que Monsieur Paul confessait sans ambages préférer son calibre 12, afin d'assurer, appuya-t-il de sa voix rétablissante. C'était son côté saucier. Celui que nous regretterons ce soir et à l'instar d'une épaule, au creux d'une époque light et rabougrie, pleutre et en manque de sel. L.M.
Je me souviens bien d'une poularde de Bresse, et avec davantage de précision du son que fit la croûte qu'il me fallut casser avec l'épaule d'une cuiller afin de découvrir et commencer d'absorber un petit lac circulaire : la soupe VGE à la truffe, ou plutôt le grouillant salmigondis d'une colonie de truffes en déroute, en morceaux et en soupe... Cela se passa à Bocuse-ville... Je me souviens surtout du regard gras, valisé, lippu même, mais palpitant comme un oiseau que l'on tient avec peine et délicatesse entre nos paumes juste jointes et pas serrées... Du regard - appuyé - de Monsieur Paul. Je me trouvais là plus ou moins pour GaultMillau comme on dit, dont j'assurais alors la direction des rédactions (du magazine et des guides), mais justement et délibérément sans aucune obligation, soit sans carnet de notes à noircir, décontracté du stylo; à la fraîche de surcroît... Pourvu du seul plaisir d'une errance mycologique choisie. En ouiquende, aurait écrit Roger Nimier, ou bien luxueusement en visite. Et aussi (car, même en roue libre j'ai un angle d'attaque en tête, c'est plus fort que moi) pour l'ineffable plaisir d'échanger avec la sensibilité vive et qui bouillait sous une longue toque blanche (coiffant une tête bien faite ayant toujours préféré la bonne vieille casquette en tweed qui renifle la sauvagine), à propos des sarcelles rebelles et des bécassines tellement furtives de la Dombes - oiseaux vénérés que j'ai toujours adoré décrocher du plus loin que je le pouvais avec mon léger calibre 20 et à contre vent, tandis que Monsieur Paul confessait sans ambages préférer son calibre 12, afin d'assurer, appuya-t-il de sa voix rétablissante. C'était son côté saucier. Celui que nous regretterons ce soir et à l'instar d'une épaule, au creux d'une époque light et rabougrie, pleutre et en manque de sel. L.M.

... Et je continuerai d'y publier ma chronique J'aime.
En voici un extrait, paru dans le n°6 actuellement en kiosque :

C'est en kiosque pour deux mois, et ce sont des extraits de ma chronique libre intitulée "J'aime" (séquence : Rugby et culture, rubrique : Ressentir).
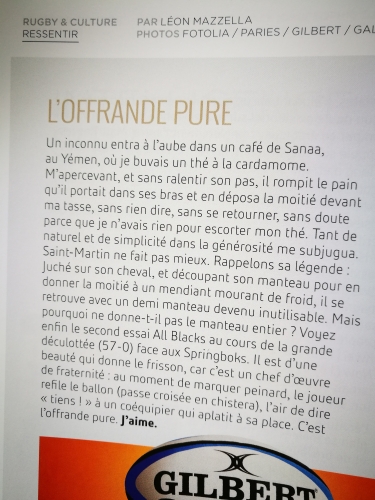
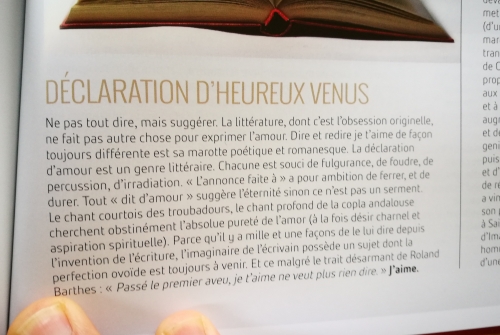

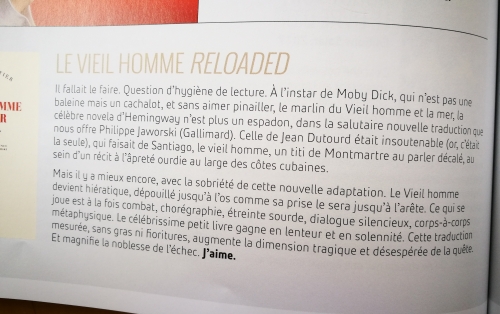

Les Foodies
L’ITHAÏLIE DANS LE MARAIS
Un trio international aux commandes d'un néo-bistrot gastro mais pas trop. Cuisine créative du jeune chef italo-thaï. Superbes produits mais pas trop chers. Inventivité ma non troppo, là encore. Service tendre. Déco chic. Un bon rapport subtilité/prix.
------

 D’emblée, c’est l'élégance de la décoration qui frappe agréablement le regard lancé large dans la salle : la pierre brute et patinée alterne sur les murs avec des vitraux multicolores cadrés façon Mondrian du meilleur effet, le sol est carrelé de noir, de gris et de blanc, un bleu roi – la couleur marquante du lieu – habille les cadres des grandes fenêtres, le plafond, ainsi que les fauteuils qui font face à de longues banquettes vertes, la vaisselle est design et chic (superbes verres à dégustation), comme l’accueil et le service de Keenan, qui vient d’Afrique du Sud. Tout cela est bienveillant, discret et de bon goût. La direction est assurée par Alex, Russe
D’emblée, c’est l'élégance de la décoration qui frappe agréablement le regard lancé large dans la salle : la pierre brute et patinée alterne sur les murs avec des vitraux multicolores cadrés façon Mondrian du meilleur effet, le sol est carrelé de noir, de gris et de blanc, un bleu roi – la couleur marquante du lieu – habille les cadres des grandes fenêtres, le plafond, ainsi que les fauteuils qui font face à de longues banquettes vertes, la vaisselle est design et chic (superbes verres à dégustation), comme l’accueil et le service de Keenan, qui vient d’Afrique du Sud. Tout cela est bienveillant, discret et de bon goût. La direction est assurée par Alex, Russe
 ayant bourlingué aux States. Une formule à 21€ à déjeuner (entrée + plat, ou plat + dessert), attire forcément le chaland. Les prix sont autrement élevés à la carte, mais la cuisine du chef Davide Galloni, mi-italien (Milan), mi-thaïlandais (ci-contre), à la fois originale et subtile, retient le même chaland. C’est que l’homme, encore jeune, a déjà roulé sa toque à travers le monde. D’où son sens pointu de la « fusion », et mesuré de l’expérimentation. Revue de détail :
ayant bourlingué aux States. Une formule à 21€ à déjeuner (entrée + plat, ou plat + dessert), attire forcément le chaland. Les prix sont autrement élevés à la carte, mais la cuisine du chef Davide Galloni, mi-italien (Milan), mi-thaïlandais (ci-contre), à la fois originale et subtile, retient le même chaland. C’est que l’homme, encore jeune, a déjà roulé sa toque à travers le monde. D’où son sens pointu de la « fusion », et mesuré de l’expérimentation. Revue de détail :
Inspirations croisées davantage que fusionnées
L’amuse-bouche (ci-dessus) est composé d'une chips de risotto à l’encre de seiche bien croustillante, surmontée d’un tartare de langoustine puissant et à l’agréable texture collante. Le ton est donné.
Puis, l’air de rien, soit sans nous en rendre compte, nous avons fait un repas italien type : antipasto, pasta, secondo piatto, dolce : la totale.

 L’entrée choisie (23€) ce 24 octobre dernier, fut un tartare de langoustine (plus morcelé, plus délié qu’en amuse-bouche) sur un lit de stracciatella (le cœur de la burrata, soit la crème de sa crème), croûtons de pain à l’encre de seiche (noir sur blanc, comme le carrelage), demi-tomates cerises et une eau de tomate riche en saveur pour arroser l’ensemble. Rien de saillant ne vient jouer les mâles dominants, dans ce plat onctueux, sinon le citronné léger mais salutaire du tartare, qui envoie son « pep’s » au détour d’une bouchée. C’est smooth, fin. Discret, en somme.
L’entrée choisie (23€) ce 24 octobre dernier, fut un tartare de langoustine (plus morcelé, plus délié qu’en amuse-bouche) sur un lit de stracciatella (le cœur de la burrata, soit la crème de sa crème), croûtons de pain à l’encre de seiche (noir sur blanc, comme le carrelage), demi-tomates cerises et une eau de tomate riche en saveur pour arroser l’ensemble. Rien de saillant ne vient jouer les mâles dominants, dans ce plat onctueux, sinon le citronné léger mais salutaire du tartare, qui envoie son « pep’s » au détour d’une bouchée. C’est smooth, fin. Discret, en somme.
Un nid de tagliatelle (maison) avec en son sein un jaune d’œuf cuit à basse température (déjà délayé sur la photo), l’ensemble parsemé de copeaux de truffe blanche d’Alba comme autant de plumes et de duvet éparpillés, constitue un plat simple (il n’y a pas lieu d’évoquer ici le prix du kilo de truffe blanche), brut, à trois ingrédients (plus un indispensable soupçon de beurre fondu avec de l’huile d’olive), des plus réussis car, c’est fort mais pas trop, onctueux encore, délicat. Direct (33€).
L’ancien sur le moderne et dessert reloaded
Les suprême et cuisse désossée (et reconstituée) de pintade (24€) sauce Penang, copieux,
 sur un lit de quinoa rouge, grains de raisin frais, et feuilles d’épinard fumées – c’est d’ailleurs servi sous cloche - translucide et pas en argenterie comme au resto de grand-papa -, afin de laisser la fumée se répandre sous les narines au moment de servir-, sans oublier un jus d’ail noir chinois (fermenté une année durant), qui signe l'ensemble sans pour autant donner dans la peinture sur assiette, devenue si ringarde, forme un recueil d’alliances surprenant. Le fumé ne nuit pas, au contraire. Le jus des raisins est bienvenu, même si le suprême n’est pas sec (mais sa peau manque de croustillant), et la cuisse grise est moelleuse. Le quinoa reste croquant, et l’épinard d’une fraîche fermeté. Un patchwork à reprendre une prochaine fois.
sur un lit de quinoa rouge, grains de raisin frais, et feuilles d’épinard fumées – c’est d’ailleurs servi sous cloche - translucide et pas en argenterie comme au resto de grand-papa -, afin de laisser la fumée se répandre sous les narines au moment de servir-, sans oublier un jus d’ail noir chinois (fermenté une année durant), qui signe l'ensemble sans pour autant donner dans la peinture sur assiette, devenue si ringarde, forme un recueil d’alliances surprenant. Le fumé ne nuit pas, au contraire. Le jus des raisins est bienvenu, même si le suprême n’est pas sec (mais sa peau manque de croustillant), et la cuisse grise est moelleuse. Le quinoa reste croquant, et l’épinard d’une fraîche fermeté. Un patchwork à reprendre une prochaine fois.
 Jardinmisu (8€) est un dessert pour jeune paysagiste créatif ou vieil accro du jardinage tiré au cordeau. Un carré de faux gazon pour tapis sur une assiette ronde (il vaudrait mieux insérer l’herbe synthétique dans un assiette carrée), sur lequel est posé un vrai petit pot de fleur, contient un tiramisu reloaded. Qu’on en juge : ne cherchez pas à retrouver le goût du café, il n’entre pas dans cette composition – aux deux sens du terme. En revanche, nous trouvons du thé vert (matcha) japonais à l’orange, des biscuits broyés Amaretti au bon goût d’amande, et surtout des morceaux de cartucci – fameux biscuits toscans croquants aux amandes -, au lieu des boudoirs, mais en dilution ; pas dressés. Le crémeux est idéal, et un léger goût de pralin surgit en arrière-bouche. Des fleurs roses et délicieuses d’hortensia et des feuilles en pâte d'amande décorent le tout. C’est réussi. En somme, hormis la musique d’ambiance peut-être un peu trop présente, et le manque de ce que j'appelle le « tsssk » (ou pep’s), ici ou là dans l’assiette, l’adresse se pose d’évidence parmi les néo-bistrots fusion qui comptent, dans le Marais.
Jardinmisu (8€) est un dessert pour jeune paysagiste créatif ou vieil accro du jardinage tiré au cordeau. Un carré de faux gazon pour tapis sur une assiette ronde (il vaudrait mieux insérer l’herbe synthétique dans un assiette carrée), sur lequel est posé un vrai petit pot de fleur, contient un tiramisu reloaded. Qu’on en juge : ne cherchez pas à retrouver le goût du café, il n’entre pas dans cette composition – aux deux sens du terme. En revanche, nous trouvons du thé vert (matcha) japonais à l’orange, des biscuits broyés Amaretti au bon goût d’amande, et surtout des morceaux de cartucci – fameux biscuits toscans croquants aux amandes -, au lieu des boudoirs, mais en dilution ; pas dressés. Le crémeux est idéal, et un léger goût de pralin surgit en arrière-bouche. Des fleurs roses et délicieuses d’hortensia et des feuilles en pâte d'amande décorent le tout. C’est réussi. En somme, hormis la musique d’ambiance peut-être un peu trop présente, et le manque de ce que j'appelle le « tsssk » (ou pep’s), ici ou là dans l’assiette, l’adresse se pose d’évidence parmi les néo-bistrots fusion qui comptent, dans le Marais.
Léon Mazzella
Texte et photos.
------
 Carte des vins française. Petit choix – suffisant – de vins au verre (de 6 à 9€). Bon pic saint-loup (Mas de l’Oncle, 2016).
Carte des vins française. Petit choix – suffisant – de vins au verre (de 6 à 9€). Bon pic saint-loup (Mas de l’Oncle, 2016).
Trois brunchs au choix le dimanche.
Les Foodies : 6-8, Square Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris.
 Elle récidive, l'experte en couenneries, avec sa plume gourmande, saupoudrée de traits à l'humour vif de son complice Patrick de Mari. A eux deux, ils animent le site gretagarbure Mais là, c'est Blandine Vié, auteur de tant de livres de cuisine ayant trait aux testicules, à la morue, à la cuisine aphrodisiaque... Qui mène la danse des canards gras. En ces temps light et veganisés de buveurs d'eau à la grise mine, soit en ces temps tristes à mourir de soif ou de faim de xingar, l'auteur publie 99+1 (bonnes) raisons de manger du gras (Artémis, 7,90€). Ce petit bouquin est un éloge lipide au beurre et à la graisse, une ode à l'huile et au saindoux , une apologie de la ventrèche et du colonnata, et c'est joliment bardé, ficelé et troussé d'une maquette pimpante. Les amateurs de lard contemporain apprécieront la mini anthologie littéraire qui s'est glissée entre deux tranches pages, et où Voltaire et Zola côtoient Audiard et Manchette. Dans ce florilège qui double sans coup férir les cinquante nuances de gras, la sensualité a la frite, puisqu'il faut frotter son lard
Elle récidive, l'experte en couenneries, avec sa plume gourmande, saupoudrée de traits à l'humour vif de son complice Patrick de Mari. A eux deux, ils animent le site gretagarbure Mais là, c'est Blandine Vié, auteur de tant de livres de cuisine ayant trait aux testicules, à la morue, à la cuisine aphrodisiaque... Qui mène la danse des canards gras. En ces temps light et veganisés de buveurs d'eau à la grise mine, soit en ces temps tristes à mourir de soif ou de faim de xingar, l'auteur publie 99+1 (bonnes) raisons de manger du gras (Artémis, 7,90€). Ce petit bouquin est un éloge lipide au beurre et à la graisse, une ode à l'huile et au saindoux , une apologie de la ventrèche et du colonnata, et c'est joliment bardé, ficelé et troussé d'une maquette pimpante. Les amateurs de lard contemporain apprécieront la mini anthologie littéraire qui s'est glissée entre deux tranches pages, et où Voltaire et Zola côtoient Audiard et Manchette. Dans ce florilège qui double sans coup férir les cinquante nuances de gras, la sensualité a la frite, puisqu'il faut frotter son lard contre le sien, nous rappelle Rabelais. Tous les lipophiles décomplexés liront par conséquent avec délice ce livre léger et sans recettes, cette fête des mots et de la liberté d'aimer dévorer ce que la morale réprouve. Noël aux dindons, Pâques aux jambons, clame un proverbe gretagarburien. On approuve! L'art, le vrai, n'est pas en reste, puisque les peintres préférés de l'auteur sont, évidemment, Eugène Boudin et Francis Bacon... Achetez ce bouquin tordant, et lisez-le à haute voix à votre voisin(e) de matelas, un dimanche de grasse matinée avec des croissants beurre plein le plateau. L.M.
contre le sien, nous rappelle Rabelais. Tous les lipophiles décomplexés liront par conséquent avec délice ce livre léger et sans recettes, cette fête des mots et de la liberté d'aimer dévorer ce que la morale réprouve. Noël aux dindons, Pâques aux jambons, clame un proverbe gretagarburien. On approuve! L'art, le vrai, n'est pas en reste, puisque les peintres préférés de l'auteur sont, évidemment, Eugène Boudin et Francis Bacon... Achetez ce bouquin tordant, et lisez-le à haute voix à votre voisin(e) de matelas, un dimanche de grasse matinée avec des croissants beurre plein le plateau. L.M.
Chaude ambiance à fond crozes-hermitage, hier soir chez Thibaut (dans le XVIII ème, à Paris) et ses dix amis attentifs, curieux, dont trois américains amateurs, et certains pourvus d'un nez exceptionnel. Le blanc de Laurent Habrard a séduit, le Rouvre de Yann Chave a fléchi, le Clos des grives de Laurent Combier a conquis, le domaine des Grands Chemins de Delas a bluffé. Comme quoi, les masterclass privées se suivent et ne se ressemblent pas. En dépit d'une température estivale, le vin, être bien vivant, demeure souverain, surtout avec des syrah imprévisibles comme autant de Carmen... ¡Olé! Léon Mazzella



 C'est un restaurant japonais comme il en existe des brochettes dans la rue Sainte-Anne, voisine. Nous sommes du côté de l'Opéra, à Paris, rue de Ventadour précisément. La table se nomme Sara, même s'il est écrit Soba à l'entrée. Et pour cause : On y entre pour manger des soba, soit des nouilles à base de farine de sarrasin (faites sur place, paraît-il - au sous-sol, sans doute) et servies chaudes ou froides avec, au choix : tofu, poulet, boeuf... Ca ne casse pas non plus trois pattes à un canard laqué. Mais ce n'est pas ça, le problème. Le problème vient du patron et de sa haine affichée (il a très visiblement un réel souci, le gonze), qui officie en salle, et traite le client - non Japonais - comme un caporal chef ses trouffions dans Full Metal Jacket... Malaise, malaise! A moins d'être maso (le Parisien aime bien se faire maltraiter par la gouaille des vieux serveurs, dans les brasseries, mais là, il s'agit d'un autre niveau d'agressivité), ça ne le fait pas et ça ne le fera jamais : Le client est houspillé, engueulé lorsqu'il demande quelque chose, le boss a une obsession, qui est de retirer, de confisquer même tout objet à peine utilisé, carafe d'eau comprise, il aboie au lieu de répondre, affecte une morgue impatiente et méprisante à la prise de la commande qui frise l'inconvenance. Il ne dit ni bonjour ni au revoir, a des gestes brusques, des attitudes plus que déplaisantes, violentes, oui : je pèse le mot. Du jamais vu. Et lorsque des clients japonais entrent et s'assoient, ils ont aussitôt droit à la danse du ventre, aux rires, à l'allant incroyable du même patron. Dr Jekyll et Mr Hyde. On croit rêver devant tant d'aplomb, d'ostentation, d'agression caricaturale. Ce n'est de surcroît pas donné (11€-22€ le soba). C'est la double peine, lorsqu'on vient de subir un tel traitement. Ciao, petit caporal!. L.M.
C'est un restaurant japonais comme il en existe des brochettes dans la rue Sainte-Anne, voisine. Nous sommes du côté de l'Opéra, à Paris, rue de Ventadour précisément. La table se nomme Sara, même s'il est écrit Soba à l'entrée. Et pour cause : On y entre pour manger des soba, soit des nouilles à base de farine de sarrasin (faites sur place, paraît-il - au sous-sol, sans doute) et servies chaudes ou froides avec, au choix : tofu, poulet, boeuf... Ca ne casse pas non plus trois pattes à un canard laqué. Mais ce n'est pas ça, le problème. Le problème vient du patron et de sa haine affichée (il a très visiblement un réel souci, le gonze), qui officie en salle, et traite le client - non Japonais - comme un caporal chef ses trouffions dans Full Metal Jacket... Malaise, malaise! A moins d'être maso (le Parisien aime bien se faire maltraiter par la gouaille des vieux serveurs, dans les brasseries, mais là, il s'agit d'un autre niveau d'agressivité), ça ne le fait pas et ça ne le fera jamais : Le client est houspillé, engueulé lorsqu'il demande quelque chose, le boss a une obsession, qui est de retirer, de confisquer même tout objet à peine utilisé, carafe d'eau comprise, il aboie au lieu de répondre, affecte une morgue impatiente et méprisante à la prise de la commande qui frise l'inconvenance. Il ne dit ni bonjour ni au revoir, a des gestes brusques, des attitudes plus que déplaisantes, violentes, oui : je pèse le mot. Du jamais vu. Et lorsque des clients japonais entrent et s'assoient, ils ont aussitôt droit à la danse du ventre, aux rires, à l'allant incroyable du même patron. Dr Jekyll et Mr Hyde. On croit rêver devant tant d'aplomb, d'ostentation, d'agression caricaturale. Ce n'est de surcroît pas donné (11€-22€ le soba). C'est la double peine, lorsqu'on vient de subir un tel traitement. Ciao, petit caporal!. L.M.
---
PS : Sara n'a rien à voir avec Yen, autre Japonais " à soba" créé par le même investisseur japonais (M. Kitada), sis rue St-Benoît dans le 6ème arr., mais autrement plus accueillant, raffiné, subtil, et carrément classe.
 L’endroit est avenant, comme l’accueil et le service. Nous nous trouvons au début de la rue Ramey, dans le 18ème arrondissement de Paris, soit en haut, dans une zone moins vivante qu'en bas, passée la rue Custine. C'est le Village Ramey.
L’endroit est avenant, comme l’accueil et le service. Nous nous trouvons au début de la rue Ramey, dans le 18ème arrondissement de Paris, soit en haut, dans une zone moins vivante qu'en bas, passée la rue Custine. C'est le Village Ramey.
L’espace de cette cave à manger est confortable avec ses salles, son bar, la mezzanine, la petite terrasse… La déco est vintage sympa, brune, roots et néanmoins claire. Joli carrelage d'époque, patine bienvenue sur le gros radiateur, bois, cuir : on se sent immédiatement bien.
La cuisine s’essaie à des tendances lourdes ayant cours encore actuellement (on ne parle plus de mode évanescente) dans le paysage des fourneaux parisiens, tenus par de plus ou moins jeunes chefs avisés et inspirés par les vents d’extrême-orient notamment (Adeline Grattard/Yam’Tcha, Iñaki Aizpitarte/Chateaubriand, William Ledeuil/The Kitchen Galerie, et KGB, pour n’en citer que trois parmi trente).
Mais l’imitation, à La Traversée, balbutie, elle est encore superficielle, les saveurs sont mal accordées, hésitantes, sans franchise ou bien trop concentrées, soit too much, et certains plats sont franchement huileux. L’harmonie n’est pas encore au rendez-vous - normal, ils ont ouvert à la mi septembre ! Leur intention est grande et c’est déjà louable. Il faudra « attendre de voir » comment cela évolue ces prochains mois.
mal accordées, hésitantes, sans franchise ou bien trop concentrées, soit too much, et certains plats sont franchement huileux. L’harmonie n’est pas encore au rendez-vous - normal, ils ont ouvert à la mi septembre ! Leur intention est grande et c’est déjà louable. Il faudra « attendre de voir » comment cela évolue ces prochains mois.
La carte des vins (bios, voire nature) est en revanche judicieuse, et des noms de vignerons « attendus » sont au rendez-vous. C’est bien, et le rapport qualité/prix du verre est bienvenu (4 à 6€), comme celui de la carte (trop courte cependant, trop tapas façon « raciones » à San Seba pour qui souhaite manger copieusement - à l’exception du très savoureux boeuf de Salers grillé).
Il faut surtout y aller pour boire des canons d'Olivier Pithon (Mon P'tit Pithon, cotes catalanes), du château Guibeau (montagne saint-émilion), le viognier de Freesia (mas d'Espanet, Cévennes), ou encore le gamay friand de Nicolas Dubost (Just drink it). Ou bien des bières tendance issues des nombreuses micro-brasseries qui fleurissent un peu partout, y compris en ville, et même d'un Gin fabriqué à un jet de cailloux, rue Labat : Lord Barbès. Tous ces verres seront dûment accompagnés d'une planche de fromages du Jura ou de charcuterie (14€ chacune), d'oeufs : pickled eggs bio (7€), curcuma et poireaux frits, de haricots verts en tempura (à condition qu'ils soient épongés), de croquettes de truite fumée et pomme de terre, sur lit de haricots de Paimpol, ou encore de cette savoureuse pièce de boeuf de Salers (16€) correctement grillée, donc, et surmontée de lamelles d'artichaut et d'allumettes de poireaux frits (bis repetita). L.M.
---
La Traversée, 2 rue Ramey, Paris 18, est pilotée par un petit groupe d'amis : Charles, Vincent (en cuisine), Witold, et Camille. Formules à déjeuner : 17€ et 20€.
https://www.latraverseeparis.com
Lipides... pourquoi s'offusque t-on d'un mot si proche de limpide, dès lors qu'il s'agit d'en ingérer? Et glucides, alors, qui sonne comme un suicide à la glu; une espèce de mariage. Quant à protides, je suis contre, comme tout ce qui semble pour.
L.M., pensée pendant que ça cuit, au four, et j'ai faim.
Découverte de mon papier sur les Fêtes de Bayonne (10 pages dans Pyrénées magazine, spécial Pays basque, qui paraît), chez Arcé, à Baïgorry.


EXTRAITS :


La seconde édition du salon des amateurs et des auteurs de dictionnaires se tient demain au Mans.
J'y signerai Le parler pied-noir (Payot), le Dictionnaire chic du vin (Ecriture) et Le Sud-Ouest vu par Léon Mazzella (Hugo & Cie).
Cliquer ci-dessous :
https://www.dicoplaisir.fr/auteurs

 Lisez FLAIR Play, le nouveau magazine qui parle de rugby en faisant considérablement bouger les lignes. On y cause ballon ovale, culture, sensibilité, franche philosophie, tact et pas tacle mais aussi tactique, rencontres et pas interviews, échanges et passes croisées, saveurs directes, partage authentiquement altruiste, arts beaux et bons, mouches du coach, transmission (ca-pi-tal!) et salutaires recentrages, et de tant d'autres choses appartenant à l'univers d'un sport vraiment pas comme les autres, et dont les valeurs (terme galvaudé) sont de plus en plus nécessaires dans notre monde en capilotade. Bravo à Sophie Surrullo et à Christophe Schaeffer, initiateurs et pilotes du projet. De belles plumes habitées par l'Ovalie y officient, comme celles de Richard Escot, Benoît Jeantet, Vincent Péré-Lahaille, Nemer Habib... J'y tiens chronique (totalement en roue libre) à partir du n°2 qui paraît. Cela s'appelle mes J'aime. Sous la têtière intelligence situationnelle. Excusez du peu. Voici deux extraits sur six, à exécution :
Lisez FLAIR Play, le nouveau magazine qui parle de rugby en faisant considérablement bouger les lignes. On y cause ballon ovale, culture, sensibilité, franche philosophie, tact et pas tacle mais aussi tactique, rencontres et pas interviews, échanges et passes croisées, saveurs directes, partage authentiquement altruiste, arts beaux et bons, mouches du coach, transmission (ca-pi-tal!) et salutaires recentrages, et de tant d'autres choses appartenant à l'univers d'un sport vraiment pas comme les autres, et dont les valeurs (terme galvaudé) sont de plus en plus nécessaires dans notre monde en capilotade. Bravo à Sophie Surrullo et à Christophe Schaeffer, initiateurs et pilotes du projet. De belles plumes habitées par l'Ovalie y officient, comme celles de Richard Escot, Benoît Jeantet, Vincent Péré-Lahaille, Nemer Habib... J'y tiens chronique (totalement en roue libre) à partir du n°2 qui paraît. Cela s'appelle mes J'aime. Sous la têtière intelligence situationnelle. Excusez du peu. Voici deux extraits sur six, à exécution :


... Avec L'Express Styles, sous la plume de Marianne Payot, et avec Sud-Ouest, sous la plume de Benoît Lasserre, pour évoquer la parution en format de poche de mon Parler pied-noir :
Cliquez => Le Parler pied-noir Sud-Ouest
L'EXPRESS
 Difficile d'admettre que le nom de Tartuffe provienne du mot truffe, via l'Italien tartufo, tartufolo, auxquels je préfèrerais pouvoir désigner un tatufo, tatoufo (t'as tout faux, FF)... Tant la truffe (Tuber melanosporum au premier chef) me semble dénuée d'interprétation pouvant être teintée d'hypocrisie, de roublardise, de malin calcul ourdi aux dépens, de bassesse et de couardise marquées des sceaux de l'abus et de l'injustice... Mais au contraire empreints de franchise intérieure. Et extérieure. En tout cas dans les parfums, les saveurs, la façon de se terrer - franche, directe :
Difficile d'admettre que le nom de Tartuffe provienne du mot truffe, via l'Italien tartufo, tartufolo, auxquels je préfèrerais pouvoir désigner un tatufo, tatoufo (t'as tout faux, FF)... Tant la truffe (Tuber melanosporum au premier chef) me semble dénuée d'interprétation pouvant être teintée d'hypocrisie, de roublardise, de malin calcul ourdi aux dépens, de bassesse et de couardise marquées des sceaux de l'abus et de l'injustice... Mais au contraire empreints de franchise intérieure. Et extérieure. En tout cas dans les parfums, les saveurs, la façon de se terrer - franche, directe : Je suis là, tu me trouves ou tu ne me trouves pas, mais je ne puis m'échapper ni ne me dissimuler davantage. Je n'ai que mon blindage, ma cuirasse, et mon enterrement pour défense. J'hérissonne, mon cochon! Or, truffe et Tartuffe, chez Molière en tout cas, ont partie liée. Dans L'Obs de ce jour, c'est autre chose. C'est même "à charge". Et en règle. FF peut se faire des cheveux (bouclés). Quelle truffe!
Je suis là, tu me trouves ou tu ne me trouves pas, mais je ne puis m'échapper ni ne me dissimuler davantage. Je n'ai que mon blindage, ma cuirasse, et mon enterrement pour défense. J'hérissonne, mon cochon! Or, truffe et Tartuffe, chez Molière en tout cas, ont partie liée. Dans L'Obs de ce jour, c'est autre chose. C'est même "à charge". Et en règle. FF peut se faire des cheveux (bouclés). Quelle truffe! (Mais, l'étymologie parfois... Voyez bécasse. Cet oiseau tellement subtil que je risque l'adjectif intelligent pour le désigner, avec ses ruses multiples qui mettent en déroute chiens et chasseurs. Le mot désigne une sotte. Or, qu'en réalité, c'est d'un compliment qu'il devrait s'agir). L.M.
(Mais, l'étymologie parfois... Voyez bécasse. Cet oiseau tellement subtil que je risque l'adjectif intelligent pour le désigner, avec ses ruses multiples qui mettent en déroute chiens et chasseurs. Le mot désigne une sotte. Or, qu'en réalité, c'est d'un compliment qu'il devrait s'agir). L.M.
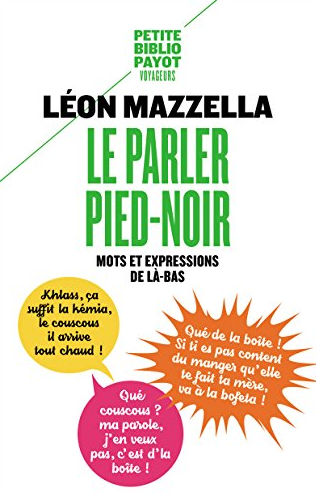
Il est paru ce matin. A vot' bon coeur!
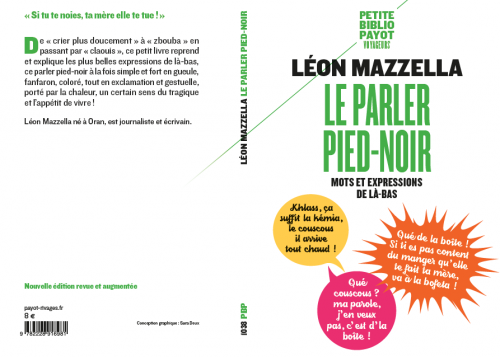
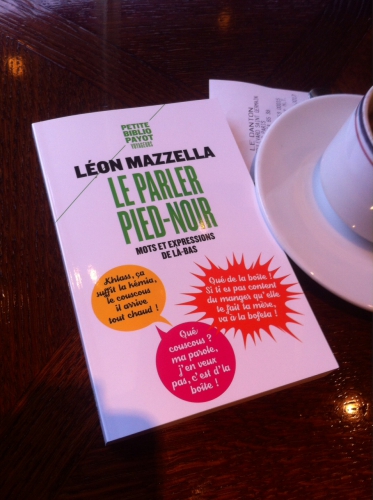
Mon Parler pied-noir arrivera donc en librairie le 18 janvier. Il s'agit de la réédition en format de poche de mon long-seller, paru en 1989 chez Rivages et constamment réimprimé depuis. Purée!..
J'ajoute qu'il s'agit d'une nouvelle édition revue et - considérablement - augmentée (192p. 8€)
 Des dizaines de dîners, et autant de déjeuners ensoleillés, surtout au moment de la palombe. Combien de fois nous sommes-nous assis aux Pyrénées ? - Dieu seul le sait. Avec Firmin (Fifi) Arrambide, nous avons même espéré l'oiseau bleu ensemble sur son petit col, à Saint-Sauveur, où je me rendais parfois dès avant l’aube, sans lui. Puis, je venais m’attabler. On grignotait, on rigolait. C’était devenu un ami. Au début, le critique gastronomique que j’étais pour GaultMillau m’interdisait toute familiarité, et puis nous avons vite su que chacun resterait intègre, honnête, et nous sommes devenus des potes, même si, avec le temps, je « montais » plus rarement à Garazi. Firmin possédait la discrétion des grands, la pudeur des talentueux qui ne la ramènent jamais. D’aucuns le disaient même trop effacé, lors qu’il était juste lui-même : simple et franc comme sa cuisine. Droite, pure, par amour du produit, et délicatement subtile. La meilleure du Pays basque nord durant tant et tant d’années. Ton saumon de l'Adour, Fifi, ton tronçon généreux de turbot, ton salmis de palombe reloaded, si allégé, ta salade d'ailes du même oiseau grand migrateur, avé son magret juste-aller-retourrr comme tu disais (à Paris, ils disent snacké), au cèpe cru croquant et à l'huile de noisette, tes ris d'agneau de lait chouria croustillants dehors et fondants dedans - purée ceux-là, et ton lièvre à la royale, ah celui-là... Je les ai tous convoqués, ce soir, au Quartier Général de ma mémoire gourmande, même tes huîtres chaudes, là, que bof, hein, oui, bon... Et je lève un verre d’Irouléguy de notre ami Jean Brana, ton voisin, à ta belle santé là-haut, Fifi. J’embrasse ta famille. Immense pensée pour Anne-Marie. Et gloire à Philippe! Léon
Des dizaines de dîners, et autant de déjeuners ensoleillés, surtout au moment de la palombe. Combien de fois nous sommes-nous assis aux Pyrénées ? - Dieu seul le sait. Avec Firmin (Fifi) Arrambide, nous avons même espéré l'oiseau bleu ensemble sur son petit col, à Saint-Sauveur, où je me rendais parfois dès avant l’aube, sans lui. Puis, je venais m’attabler. On grignotait, on rigolait. C’était devenu un ami. Au début, le critique gastronomique que j’étais pour GaultMillau m’interdisait toute familiarité, et puis nous avons vite su que chacun resterait intègre, honnête, et nous sommes devenus des potes, même si, avec le temps, je « montais » plus rarement à Garazi. Firmin possédait la discrétion des grands, la pudeur des talentueux qui ne la ramènent jamais. D’aucuns le disaient même trop effacé, lors qu’il était juste lui-même : simple et franc comme sa cuisine. Droite, pure, par amour du produit, et délicatement subtile. La meilleure du Pays basque nord durant tant et tant d’années. Ton saumon de l'Adour, Fifi, ton tronçon généreux de turbot, ton salmis de palombe reloaded, si allégé, ta salade d'ailes du même oiseau grand migrateur, avé son magret juste-aller-retourrr comme tu disais (à Paris, ils disent snacké), au cèpe cru croquant et à l'huile de noisette, tes ris d'agneau de lait chouria croustillants dehors et fondants dedans - purée ceux-là, et ton lièvre à la royale, ah celui-là... Je les ai tous convoqués, ce soir, au Quartier Général de ma mémoire gourmande, même tes huîtres chaudes, là, que bof, hein, oui, bon... Et je lève un verre d’Irouléguy de notre ami Jean Brana, ton voisin, à ta belle santé là-haut, Fifi. J’embrasse ta famille. Immense pensée pour Anne-Marie. Et gloire à Philippe! Léon
----
Firmin Arrambide, chef talentueux - quarante années durant - du fameux restaurant Les Pyrénées, à Saint-Jean-Pied-de-Port (64), est décédé dimanche d'un accident vasculaire, à l'âge de 70 ans. Son fils Philippe est aux commandes du piano depuis bientôt dix ans.
MoiChef, ça vous parle davantage que Moi, Président. Et, surtout, c'est meilleur, plus sûr, ça tient ses promesses. Côté saveurs, y'a pas photo. Alors, vous déroulez le site, vous vous baladez, vous faites votre choix, et puis vous appuyez sur Offrir MoiChef, et là, hop! zou! c'est parti. Il ne reste plus qu'à nouer une grande serviette blanche un peu rêche autour du cou, comme avant. BonAppétit.
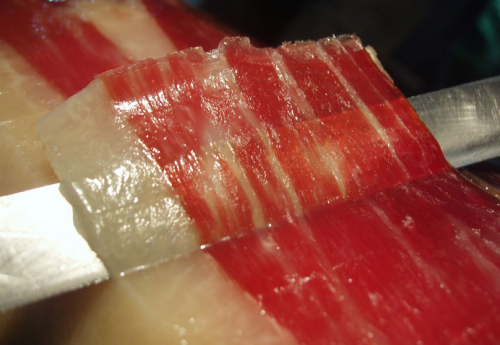 L’initiative revient à Septième Goût, le site gourmand que Jean Dusaussoy copilote avec Sébastien Ripari. L’idée d’associer des jambons ibériques de cochons de grande qualité, car nourris aux glands (bellotas), comme la palombe en migration s'abattant sur les chênaies du Sud-Ouest, avec des vins du Jura pourvu de cet accent andalou qui rappelle le fino, n’est somme toute pas si insolite. Cela se passait à la boucherie La Belle Epoque, dans le 17ème arrondissement parisien, tenue par un Patrick à la forte personnalité, et avec Vincent Grenelé (photo), un spécialiste, directeur de la maison Roble (le chêne), qui proposait à la dégustation quatre appellations d’origine qu'il importe : Extremadura, Huelva, Salamanca (Guijuelo) et Cordoba (Valle de Los Pedroches). Complice fournisseur des flacons de belle extraction et provenant du Comité interprofessionnel des Vins du Jura, puisqu’il s’agissait d’Arbois, de Château-
L’initiative revient à Septième Goût, le site gourmand que Jean Dusaussoy copilote avec Sébastien Ripari. L’idée d’associer des jambons ibériques de cochons de grande qualité, car nourris aux glands (bellotas), comme la palombe en migration s'abattant sur les chênaies du Sud-Ouest, avec des vins du Jura pourvu de cet accent andalou qui rappelle le fino, n’est somme toute pas si insolite. Cela se passait à la boucherie La Belle Epoque, dans le 17ème arrondissement parisien, tenue par un Patrick à la forte personnalité, et avec Vincent Grenelé (photo), un spécialiste, directeur de la maison Roble (le chêne), qui proposait à la dégustation quatre appellations d’origine qu'il importe : Extremadura, Huelva, Salamanca (Guijuelo) et Cordoba (Valle de Los Pedroches). Complice fournisseur des flacons de belle extraction et provenant du Comité interprofessionnel des Vins du Jura, puisqu’il s’agissait d’Arbois, de Château- Chalon, de Côtes du Jura et de L’Etoile : l’agence lyonnaise Rouge Granit. Une poignée d’invités aux papilles exercées, et zou ! Rappelons que seulement 10% des cochons ibériques sont nourris en plein air aux glands qui tombent des chênes de leur environnement, et d’herbe. 90% ne peuvent donc prétendre au complément sésame « de bellota », puisque ceux-là sont nourris en plein air « de cebo campo» (glands et fourrage), ou bien « de cebo » (fourrage, cochons parqués). Roble pratique un affinage long, de 18 à 40 mois et plus. L’Iberico Pata Negra jouit d’une DOP (dénomination d’origine contrôlée), mais il faut savoir que ce n’est pas forcément la couleur noire de la patte qui fait l’excellent jambon. J’en ai connu qui montraient patte blanche et qui vous envoyaient des saveurs de compétition, avec le gras idéal, l’onctuosité parfaite, le persillé de rêve, la subtilité extrême. Les vins jaunes, élevés sous voile (les levures en suspension) comme il se doit, issus exclusivement de cépage savagnin, passent du temps dans les fûts, et
Chalon, de Côtes du Jura et de L’Etoile : l’agence lyonnaise Rouge Granit. Une poignée d’invités aux papilles exercées, et zou ! Rappelons que seulement 10% des cochons ibériques sont nourris en plein air aux glands qui tombent des chênes de leur environnement, et d’herbe. 90% ne peuvent donc prétendre au complément sésame « de bellota », puisque ceux-là sont nourris en plein air « de cebo campo» (glands et fourrage), ou bien « de cebo » (fourrage, cochons parqués). Roble pratique un affinage long, de 18 à 40 mois et plus. L’Iberico Pata Negra jouit d’une DOP (dénomination d’origine contrôlée), mais il faut savoir que ce n’est pas forcément la couleur noire de la patte qui fait l’excellent jambon. J’en ai connu qui montraient patte blanche et qui vous envoyaient des saveurs de compétition, avec le gras idéal, l’onctuosité parfaite, le persillé de rêve, la subtilité extrême. Les vins jaunes, élevés sous voile (les levures en suspension) comme il se doit, issus exclusivement de cépage savagnin, passent du temps dans les fûts, et  offrent ce goût particulier de fruits secs, surtout la noix, et la noisette aussi, et des flaveurs de sous-bois à l’automne, qui appellent d’ordinaire à la rescousse le comté de 30 mois, le mont-d’or a gusto, la noix fraîche et la poularde à la
offrent ce goût particulier de fruits secs, surtout la noix, et la noisette aussi, et des flaveurs de sous-bois à l’automne, qui appellent d’ordinaire à la rescousse le comté de 30 mois, le mont-d’or a gusto, la noix fraîche et la poularde à la crème avec force morilles... Mais là, avec la bande des quatre ibericos de bellota, ce fut stupéfiant en termes d’accords idoines. La sécheresse qui flirte avec une austérité souriante, fut en partage, du côté du jamon de Salamanque et du vin des Côtes du Jura (domaine Pécheur 2008). Arbois (Henri Maire 2008) et Cordoue firent également la paire. La finesse, l’aromatique explosif, le gras distingué de l’un et de l’autre, une expression dédoublée en bouche fut révélatrice des alliances possibles entre un vin « oxydatif » et un jambon raffiné et « viandé », délicat et pourvu d’un fondant inouï. Le summum fut atteint avec le Huelva, fiancé à L’Etoile (domaine Philippe Vandelle 2007). De quoi vous propulser là-haut, afin de mieux contempler la Péninsule et la Franche-Comté. Et c’est ainsi que les jaunes sont de garde et les noirs bien gardés. L.M.
crème avec force morilles... Mais là, avec la bande des quatre ibericos de bellota, ce fut stupéfiant en termes d’accords idoines. La sécheresse qui flirte avec une austérité souriante, fut en partage, du côté du jamon de Salamanque et du vin des Côtes du Jura (domaine Pécheur 2008). Arbois (Henri Maire 2008) et Cordoue firent également la paire. La finesse, l’aromatique explosif, le gras distingué de l’un et de l’autre, une expression dédoublée en bouche fut révélatrice des alliances possibles entre un vin « oxydatif » et un jambon raffiné et « viandé », délicat et pourvu d’un fondant inouï. Le summum fut atteint avec le Huelva, fiancé à L’Etoile (domaine Philippe Vandelle 2007). De quoi vous propulser là-haut, afin de mieux contempler la Péninsule et la Franche-Comté. Et c’est ainsi que les jaunes sont de garde et les noirs bien gardés. L.M.
Notez qu’une boucherie 100% bio, une première à Paris, niche au creux du marché couvert de Batignolles (17ème arrondissement). Elle se nomme Dandelion, et elle a été créé par le même Vincent Gergelé, associé à Michel Vidalie.


Un sommelier dans mon canap', quatrième. C'était hier soir, chez Jérôme et Auriane, dans le 13ème, à Paris, avec leur sept amis, tous joyeux drilles, hédonistes ne s'en laissant pas compter, fous de course automobile - et surtout de vins de la vallée du Rhône, et excellents cuisiniers de surcroît : formidables caillettes ardéchoises, canapés à la truffe, cardons à la moelle, fromages coulants, sablés ganache/mousse... La soirée déborda dans l'alegria, d'autres flacons "de réserve" de crozes-hermitage furent débouchés (après le séduisant Premier Regard de Melody, ou le sérieux Cour de récré de François Villard) avec, paire de cerises sur le gâteau : un condrieu et un côte-rôtie. Parce que nous le valons bien... Léon M.
 Son blog, Di(s)vin! est subtil, délicat, connaisseur, c'est le blog d'un amateur - au sens dix-huitiémiste du terme. Jean-Noël Rieffel m'a interviewé au sujet des vins et des livres. Voici la première partie de ses produits d'entretien :
Son blog, Di(s)vin! est subtil, délicat, connaisseur, c'est le blog d'un amateur - au sens dix-huitiémiste du terme. Jean-Noël Rieffel m'a interviewé au sujet des vins et des livres. Voici la première partie de ses produits d'entretien :
 Ils sont jeunes, ils sont minces, ils sont beaux, ils sentent bon les sables fauves, leurs vins sont subtils, équilibrés, francs, purs et droits, leurs armagnacs sont à la fois profonds et aériens, sincères et sans ambages, le packaging des flacons est design et chic… Ils peuvent, oui, incarner une nouvelle génération de vignerons gascons, éloignée des clichés bedonnants et chargés de cholestérol, de terroir à béret et à toiles d’araignée dans le chai. Cyril et Julie Laudet sont à la tête d’une bien jolie propriété landaise, sise aux confins des Landes et du Gers, en Bas-Armagnac, à Parleboscq pour être précis, et Cyril représente la huitième génération de vignerons sur le domaine Laballe, dans l’ex « Grand-Bas ». Propriété d’abord dédiée à l’eau de vie gasconne, c’est sous l’impulsion de Noël Laudet qu’elle amorce un virage capital dans les années soixante-dix. Cet ancien régisseur du château Beychevelle, à Pauillac, se lance à domicile dans le vin blanc. Et le succès
Ils sont jeunes, ils sont minces, ils sont beaux, ils sentent bon les sables fauves, leurs vins sont subtils, équilibrés, francs, purs et droits, leurs armagnacs sont à la fois profonds et aériens, sincères et sans ambages, le packaging des flacons est design et chic… Ils peuvent, oui, incarner une nouvelle génération de vignerons gascons, éloignée des clichés bedonnants et chargés de cholestérol, de terroir à béret et à toiles d’araignée dans le chai. Cyril et Julie Laudet sont à la tête d’une bien jolie propriété landaise, sise aux confins des Landes et du Gers, en Bas-Armagnac, à Parleboscq pour être précis, et Cyril représente la huitième génération de vignerons sur le domaine Laballe, dans l’ex « Grand-Bas ». Propriété d’abord dédiée à l’eau de vie gasconne, c’est sous l’impulsion de Noël Laudet qu’elle amorce un virage capital dans les années soixante-dix. Cet ancien régisseur du château Beychevelle, à Pauillac, se lance à domicile dans le vin blanc. Et le succès
 rencontré par sa gamme d’armagnacs, est aussitôt entériné par celui de ses blancs secs, puis moelleux, et des rouges landais. Cyril reprend les rênes du domaine en 2007, des mains de son grand-père Noël. Son épouse Julie, femme issue du marketing dans l’artisanat du cuir haut de gamme du côté de Carcassonne, le rejoint en 2009. Elle est le complément d’objet direct de son vigneron de mari. Le terroir, de sables fauves, caractéristique de la région (le sable landais, les dépôts argilo-limoneux chargés en oxyde de fer venus du Gers) donne une belle minéralité et une grande fraîcheur aux vins. Laballe joue avec l'IGP Landes pour sa gamme Terroirs Landais – à laquelle Cyril tient, car il pourrait classer ces vins-là en Côtes de Gascogne, mais non… Avec, par exemple, un blanc sec 2015 formidable (gros manseng, ugni blanc, colombard et sauvignon), minéral, frais, au nez d’agrumes et pourvu de franches notes exotiques et d’abricot en bouche. Il existe en rosé et en rouge, mais nous ne les avons pas encore goûtés. Laballe propose aussi un audacieux chardonnay des Landes (a probar aussi). En appellation Côtes de Gascogne, nous avons goûté Les Terres Basses en rouge (2015) équilibré, corpulent, sans doute grâce au merlot qui partage le gâteau avec le cabernet sauvignon et le tannat. C’est rond, élégant, épicé, puissant mais doucement. Davantage que Raisin Volé, rouge goûté dans le millésime 2014, en AOC Tursan, et dans lequel tannat, cabernet franc et cabernet sauvignon s’assemblent
rencontré par sa gamme d’armagnacs, est aussitôt entériné par celui de ses blancs secs, puis moelleux, et des rouges landais. Cyril reprend les rênes du domaine en 2007, des mains de son grand-père Noël. Son épouse Julie, femme issue du marketing dans l’artisanat du cuir haut de gamme du côté de Carcassonne, le rejoint en 2009. Elle est le complément d’objet direct de son vigneron de mari. Le terroir, de sables fauves, caractéristique de la région (le sable landais, les dépôts argilo-limoneux chargés en oxyde de fer venus du Gers) donne une belle minéralité et une grande fraîcheur aux vins. Laballe joue avec l'IGP Landes pour sa gamme Terroirs Landais – à laquelle Cyril tient, car il pourrait classer ces vins-là en Côtes de Gascogne, mais non… Avec, par exemple, un blanc sec 2015 formidable (gros manseng, ugni blanc, colombard et sauvignon), minéral, frais, au nez d’agrumes et pourvu de franches notes exotiques et d’abricot en bouche. Il existe en rosé et en rouge, mais nous ne les avons pas encore goûtés. Laballe propose aussi un audacieux chardonnay des Landes (a probar aussi). En appellation Côtes de Gascogne, nous avons goûté Les Terres Basses en rouge (2015) équilibré, corpulent, sans doute grâce au merlot qui partage le gâteau avec le cabernet sauvignon et le tannat. C’est rond, élégant, épicé, puissant mais doucement. Davantage que Raisin Volé, rouge goûté dans le millésime 2014, en AOC Tursan, et dans lequel tannat, cabernet franc et cabernet sauvignon s’assemblent  avec une délicatesse remarquable. Le cabernet franc parvient à dompter le tannat, sous ces latitudes - c’est connu. Et le cabernet sauvignon est alors un suiveur galant. La Demoiselle de Laballe est un blanc doux classé en Côtes de Gascogne vif, nerveux, sans graisse, svelte et néanmoins doté d’un joli moelleux, comme on le dirait d’un édredon frais : léger et caressant. A noter que le mordant et souple Raisin Volé est élaboré par Cyril Laudet, en collaboration avec un confrère indépendant, le domaine Cazalet. Car Laballe possède une vingtaine d’hectares autour de Parleboscq pour ses armagnacs et ses vins, mais travaille aussi en collaboration - sur autant d'hectares en culture -, avec des vignobles voisins. Mention spéciale à L’Oustig 2015 (envie d’écrire loustic), un blanc sec atypique, classé en Vin de France, confidentiel (4 barriques) étonnant de franchise, de flaveurs d’abricot, de fruit de la passion, rond à souhait, avec un soupçon d’acidité posé comme des parenthèses davantage que comme des guillemets. Gros et petit manseng, et baroque (rare !) composent par tiers l’encépagement de ce « vin nature » qui n’est pas levuré, et qui est d’une pureté et d’une droiture confondantes.
avec une délicatesse remarquable. Le cabernet franc parvient à dompter le tannat, sous ces latitudes - c’est connu. Et le cabernet sauvignon est alors un suiveur galant. La Demoiselle de Laballe est un blanc doux classé en Côtes de Gascogne vif, nerveux, sans graisse, svelte et néanmoins doté d’un joli moelleux, comme on le dirait d’un édredon frais : léger et caressant. A noter que le mordant et souple Raisin Volé est élaboré par Cyril Laudet, en collaboration avec un confrère indépendant, le domaine Cazalet. Car Laballe possède une vingtaine d’hectares autour de Parleboscq pour ses armagnacs et ses vins, mais travaille aussi en collaboration - sur autant d'hectares en culture -, avec des vignobles voisins. Mention spéciale à L’Oustig 2015 (envie d’écrire loustic), un blanc sec atypique, classé en Vin de France, confidentiel (4 barriques) étonnant de franchise, de flaveurs d’abricot, de fruit de la passion, rond à souhait, avec un soupçon d’acidité posé comme des parenthèses davantage que comme des guillemets. Gros et petit manseng, et baroque (rare !) composent par tiers l’encépagement de ce « vin nature » qui n’est pas levuré, et qui est d’une pureté et d’une droiture confondantes.
Côté armagnacs, la gamme est somptueuse, qui fait la part belle aux millésimes, aux assemblages bien sûr, et à des flacons issus de monocépage : baco, ugni blanc, comme ce splendide 1991, 100% Baco, à la robe caramel luisant, miracle d’équilibre et de force contenue, avec son nez agréable -oui- de térébenthine furtive, et une bouche opulente où les fruits confits et les épices douces dominent avec une ténacité souple. Finesse, rondeur, charnu, longueur respectable, sont les termes qui définissent ordinairement les armagnacs racés de Laballe dans leur ensemble. Et, la tendance étant devenue structurelle, la volonté de développer la consommation de l’armagnac dilué en cocktail, est une carte que Laballe joue à fond. Pour ce faire, la gamme « 3 (Ice) -12 (Rich) -21 (Gold) », au look très moderne, est étalonnée, et elle fait un carton dans les bars dédiés.
agréable -oui- de térébenthine furtive, et une bouche opulente où les fruits confits et les épices douces dominent avec une ténacité souple. Finesse, rondeur, charnu, longueur respectable, sont les termes qui définissent ordinairement les armagnacs racés de Laballe dans leur ensemble. Et, la tendance étant devenue structurelle, la volonté de développer la consommation de l’armagnac dilué en cocktail, est une carte que Laballe joue à fond. Pour ce faire, la gamme « 3 (Ice) -12 (Rich) -21 (Gold) », au look très moderne, est étalonnée, et elle fait un carton dans les bars dédiés.
Une dégustation d'un large éventail de la maison (vins et eaux de vie), se tenait d’ailleurs ce 4 octobre dans un bar (restaurant) à cocktails parisien de haut-vol : Gravity Bar. Ouvert il y a un an et des poussières par Marc Longa (ancien journaliste), avec un associé, et un chef de talent, Frédérick Boucher, ce lieu freestyle à mort, au look très sports de glisse donc, mais classieux : épuré, boisé façon surf scandinave, connaît un succès mérité. La recette ? -Un mélange de mixologie (l’art de faire des cocktails) de grande qualité, et de restauration franchement gastro, et au petit point. Témoin, ce déjeuner, donc, en parfaite harmonie mets-vins de Laballe, qui proposa des huîtres bretonnes, bouillon d’anguille, mini concombre et pomelo avec le Sables Fauves blanc 2015 précité : un mariage presque trop raccord! Un délicieux foie gras au torchon audacieusement escorté d’une betterave au goût parfait, ni terreux, ni sucré, riz sauvage soufflé bien croustillant (en écho salutaire au moelleux total du reste) et pourvu d'une pointe de grillé idoine : idéal avec L’Oustig. Un cube de poitrine de cochon laquée à se damner, avec une purée d’aubergines fumée formidable, champignons de Paris marinés, oignon croquant et sésame – sur le Raisin Volé et le Terres Basses, afin d’éprouver le crescendo des deux rouges. Enfin, la poire pochée au vin blanc, faisselle de chèvre (un peu trop épais, pouf-pouf, pas assez chantilly, le chèvre), miel et noisettes correctement torréfiées – avec la Demoiselle de Laballe, à la vivacité de jeune fille espiègle s’échappant à la fraîche dans la pinède… L.M.
----
Domaine Laballe, à Parleboscq 40310.
Gravity Bar, 44, rue des Vinaigriers, Paris 10ème
Photos de Julie et Cyril Laudet, et des bouteilles : D.R.
ALLIANCES :
 Que lire avec tout ça? Le Vieux Saltimbanque, ultime roman de Jim Harrison (disparu en mars dernier), sorte d'autobiographie à la troisième personne d'un immense gourmand de la vie, amateur invétéré de grands vins de Bordeaux, de chasse, de pêche à la mouche, de poésie, et de (sa) femme(s). Flammarion - qui donne
Que lire avec tout ça? Le Vieux Saltimbanque, ultime roman de Jim Harrison (disparu en mars dernier), sorte d'autobiographie à la troisième personne d'un immense gourmand de la vie, amateur invétéré de grands vins de Bordeaux, de chasse, de pêche à la mouche, de poésie, et de (sa) femme(s). Flammarion - qui donne envie de reprendre illico son inoubliable Dalva et ses Légendes d'automne (10/18). Et Les lois de l'apogée, de Jean Le Gall (Robert Laffont), roman élégant et fulgurant, incisif et mordant, subtil et délicat, qui dépeint ces trente dernières années, en France, à travers les déambulations littéraro-politico-sensuelles d'un trio infernal.
envie de reprendre illico son inoubliable Dalva et ses Légendes d'automne (10/18). Et Les lois de l'apogée, de Jean Le Gall (Robert Laffont), roman élégant et fulgurant, incisif et mordant, subtil et délicat, qui dépeint ces trente dernières années, en France, à travers les déambulations littéraro-politico-sensuelles d'un trio infernal.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Ah, ces marchés récurrents et improvisés sur les trottoirs de Paris, avec des monceaux de charcuterie et de fromages corses, basques, auvergnats dégueulant jusque là, et tenus par des types ayant vissé un béret sur leur tête dès potron-minet, mais ne parvenant pas à dissimuler leur accent de Ménilmontant, et qui vous affirment être du cru, lors qu’ils ne savent pas situer avec leur index ledit cru sur la carte. Et qui confondent sans ambages les AOC entre elles, dès que vous leur posez une petite question sur l’affinage, le village, le machin, sans même aller trop loin, car cela deviendrait embarrassant. Ce n’est pas que je sois d’humeur grincheuse ou chafouine, mais j’en ai assez de l’arnaque à ciel ouvert, du rapt sans masque, et de la brutalité que cela produit, en somme. C’est comme ces graffiti au pochoir, sur les mêmes trottoirs, déposés non sans violence, devant les boucheries : « Go Vegan ». Mais merde, à la fin. J’aime la bidoche sans limite, les fromages qui puent, j’aime relever les matoles à ortolans, j’aime la bécasse faisandée de huit jours au moins, j’aime voir une demi-véronique signée José Tomas sur le sable, j’aime ferrer une fario d’altitude à la mouche, j'aime relire Hemingway dans la brousse, j'aime écouter les cerfs bramer, j’aime faire l’amour à l’arrière des berlines, après, mais je ne vais pas faire des pochoirs avec tout ça, au nom d’un instinct pongiste dont je suis de toute façon dépourvu. L.M.
Certaines attitudes assument leur insolence. Ce soir, je dînais, accompagné, dans un italien branchouille de Paris, à la cuisine d'assez bonne facture (focaccia correcte, bonne cuisson de linguine all'Amatriciana, relevée avec justesse). Lors de la réservation, il fut impossible de venir à l'heure désirée : 20h30. C'était 19h30 ou 21h30. Bon, va pour la première option. Nous avons certes pris notre temps, à l'étage d'une sorte de hall de gare (c'est l'emplacement de l'ancienne boutique de Jean-Paul Gaultier), en plus assourdissant, car toute conversation devint vite impossible. A 21h15, une jeune fille déposa l'addition en disant fermement : j'ai une réservation dans dix minutes. En d'autres termes : payez-dégagez. Et je déteste, mais je déteste, mais alors si vous saviez combien je déteste que l'on s'adresse ainsi aux clients d'un restaurant. Force est hélas de constater que cette jurisprudence fait florès : à midi, c'est une heure top chrono, et le soir, c'est deux. Capito? - Non, Addio!
(Daroco, 6, rue Vivienne, Paris 75002).

Le Dictionnaire chic du vin (éd. Ecriture), qui était provisoirement "épuisé", a été réimprimé : il est à nouveau disponible en librairie depuis lundi dernier. Qu'on se le dise au fond des bois-boit!
 Voici un petit livre dont nous suggérons la lecture à tous ceux qui aiment la gastronomie au-delà de l’assiette, qui aiment faire la cuisine, qui font profession de cuisinier, qui affectionnent le discours littéraire sur cette grande passion française, et à tous ceux qui auraient envie de suivre, en tournant les pages, l’itinéraire d’un jeune gourmand passionné. Ca commence à faire du monde... C’est un peu « L’enfance d’un chef cuisinier », ce court texte (une centaine de pages), signé Maylis de Kerangal, à qui nous devons le très émouvant, très beau, très fort « Réparer les vivants » (folio). Un chemin de tables (Seuil, collection « raconter sa vie », ou le roman vrai de la société française), nous conte l’histoire du jeune Mauro, qui n’aimait rien comme cuisiner pour ses potes de collège, puis chez lui. Il se lance très vite dans le métier, connaît mille misères, ne renâcle jamais. Animé d'une réelle passion, tendrement convaincu de posséder un brin de talent, il poursuit son apprentissage dans des brasseries parisiennes, et à Montreuil, puis chez des chefs, et des plus grands, passant des pizzas au fooding, via le classicisme façon tournedos Rossini. Il devient l’icône d’une cuisine fondée sur les deux piliers de l’inventivité et du partage. Ce que nous aimons, c’est d’abord l’écriture juste, précise, imagée et forte de l’auteur. Nous sentons tellement bien le personnage de Mauro, que son portrait, (page 59 et suivantes), devrait être lu, et cité en exemple dans les écoles de journalisme – c’est d’ailleurs ce que je ferai à la rentrée… Il y a aussi un personnage attachant qui grandit au fil des pages : il y a du reportage en immersion dans ce texte, et à travers ce récit, la photographie de notre gastronomie contemporaine se révèle avec, en prime, la description pointue des arcanes d’un milieu. L.M.
Voici un petit livre dont nous suggérons la lecture à tous ceux qui aiment la gastronomie au-delà de l’assiette, qui aiment faire la cuisine, qui font profession de cuisinier, qui affectionnent le discours littéraire sur cette grande passion française, et à tous ceux qui auraient envie de suivre, en tournant les pages, l’itinéraire d’un jeune gourmand passionné. Ca commence à faire du monde... C’est un peu « L’enfance d’un chef cuisinier », ce court texte (une centaine de pages), signé Maylis de Kerangal, à qui nous devons le très émouvant, très beau, très fort « Réparer les vivants » (folio). Un chemin de tables (Seuil, collection « raconter sa vie », ou le roman vrai de la société française), nous conte l’histoire du jeune Mauro, qui n’aimait rien comme cuisiner pour ses potes de collège, puis chez lui. Il se lance très vite dans le métier, connaît mille misères, ne renâcle jamais. Animé d'une réelle passion, tendrement convaincu de posséder un brin de talent, il poursuit son apprentissage dans des brasseries parisiennes, et à Montreuil, puis chez des chefs, et des plus grands, passant des pizzas au fooding, via le classicisme façon tournedos Rossini. Il devient l’icône d’une cuisine fondée sur les deux piliers de l’inventivité et du partage. Ce que nous aimons, c’est d’abord l’écriture juste, précise, imagée et forte de l’auteur. Nous sentons tellement bien le personnage de Mauro, que son portrait, (page 59 et suivantes), devrait être lu, et cité en exemple dans les écoles de journalisme – c’est d’ailleurs ce que je ferai à la rentrée… Il y a aussi un personnage attachant qui grandit au fil des pages : il y a du reportage en immersion dans ce texte, et à travers ce récit, la photographie de notre gastronomie contemporaine se révèle avec, en prime, la description pointue des arcanes d’un milieu. L.M.
 Une cage allait à la recherche d'un oiseau. Kafka (Journal).
Une cage allait à la recherche d'un oiseau. Kafka (Journal).
Cette phrase me hante depuis sa découverte il y a quarante ans.
De même, la métaphore du fruit appelé physalis (d'un mot grec signifiant vessie), surnommé amour en cage (photo), laisse rêveur.
De là à prendre ce qui fait battre mon coeur pour une lanterne...
Kafka, ce drôle d'oiseau, craignait peut-être la liberté. L.M.
 Alors les copains te disent, te répètent depuis des lustres « trop la chance », « arrête, je vais pleurer », « et moi tu sais où j’ai bouffé », et « plains toi », et j’en passe. Trente ans que ça dure. Que j’accepte de me faire rincer dans les plus beaux endroits, en vertu d’un système huilé, admis, et qui ne se pose plus de question (s’en est-il jamais posé ?), selon lequel il faut engraisser le journaliste comme une oie pour qu’il chie un papier, même pas son foie. Dans le domaine du journalisme gastro/oeno/art de vivre/chose, comme ailleurs (j’en ai connu d’autres, très différents, et c’était la même chose : le voyage en first, le petit cadeau à l’arrivée dans la chambre, le gros juste avant de repartir, qui te fait tellement rougir que tu es obligé de le refuser -question d'éthique, mec, et tout le toutim qui ne frise plus le ridicule). Alors, oui, la semaine dernière, j’ai déjeuné chez Pierre Gagnaire, invité par les grands vins bourguignons de Bouchard, et le lendemain aux Crayères, à Reims, pour une jolie histoire champenoise – et je rendrai compte bientôt des deux, l’ingratitude étant, dans mon top-ten des déconvenues rédhibitoires, un spectre voisin de la déception : si tu acceptes, tu joues le jeu, mais tu n'entres pas dans Troie!.. Deux gargotes de très haute volée ! (meilleur déj’ à la seconde, d’ailleurs). Et j’ai séché plusieurs choses : Dutournier, Apicius… Mais je sais aussi que je me suis régalé d’un jambon-beurre avec un demi, au comptoir d’un rade improbable du 18ème arrondissement de Paris, en filant à l’Anglaise d’un énième machin. Et qu’un jour, au moment de passer à table, au George V, invité par Bernard Magrez et son château Pape-Clément à partager un somptueux repas, en compagnie de « people » éparpillés ici et là, comme Depardieu, Weber, et je ne sais plus qui encore (mazette !), saisi d’un stress des grands jours –celui qui mouille la chemise plus rapidement qu’une douche, j’ai fissa fui (prétextant un bouclage anticipé plutôt hard), puis j’ai respiré un très grand coup une fois dehors, et je me suis alors précipité dans une pizzeria de rien du tout pour manger une Margherita avec les doigts, en repliant sa pâte hélas trop molle (et en pensant fort à celle –formidable-, de Vesi, à Naples)…
Alors les copains te disent, te répètent depuis des lustres « trop la chance », « arrête, je vais pleurer », « et moi tu sais où j’ai bouffé », et « plains toi », et j’en passe. Trente ans que ça dure. Que j’accepte de me faire rincer dans les plus beaux endroits, en vertu d’un système huilé, admis, et qui ne se pose plus de question (s’en est-il jamais posé ?), selon lequel il faut engraisser le journaliste comme une oie pour qu’il chie un papier, même pas son foie. Dans le domaine du journalisme gastro/oeno/art de vivre/chose, comme ailleurs (j’en ai connu d’autres, très différents, et c’était la même chose : le voyage en first, le petit cadeau à l’arrivée dans la chambre, le gros juste avant de repartir, qui te fait tellement rougir que tu es obligé de le refuser -question d'éthique, mec, et tout le toutim qui ne frise plus le ridicule). Alors, oui, la semaine dernière, j’ai déjeuné chez Pierre Gagnaire, invité par les grands vins bourguignons de Bouchard, et le lendemain aux Crayères, à Reims, pour une jolie histoire champenoise – et je rendrai compte bientôt des deux, l’ingratitude étant, dans mon top-ten des déconvenues rédhibitoires, un spectre voisin de la déception : si tu acceptes, tu joues le jeu, mais tu n'entres pas dans Troie!.. Deux gargotes de très haute volée ! (meilleur déj’ à la seconde, d’ailleurs). Et j’ai séché plusieurs choses : Dutournier, Apicius… Mais je sais aussi que je me suis régalé d’un jambon-beurre avec un demi, au comptoir d’un rade improbable du 18ème arrondissement de Paris, en filant à l’Anglaise d’un énième machin. Et qu’un jour, au moment de passer à table, au George V, invité par Bernard Magrez et son château Pape-Clément à partager un somptueux repas, en compagnie de « people » éparpillés ici et là, comme Depardieu, Weber, et je ne sais plus qui encore (mazette !), saisi d’un stress des grands jours –celui qui mouille la chemise plus rapidement qu’une douche, j’ai fissa fui (prétextant un bouclage anticipé plutôt hard), puis j’ai respiré un très grand coup une fois dehors, et je me suis alors précipité dans une pizzeria de rien du tout pour manger une Margherita avec les doigts, en repliant sa pâte hélas trop molle (et en pensant fort à celle –formidable-, de Vesi, à Naples)… 
Splendide dégustation orchestrée par Michèle Piron-Soulat et son équipe féminine, au restaurant Pinxo, spécialiste de la « tapa » de très haut-vol : extraordinaires bouchées de pieds de cochon, délicieuses saint-jacques bardées sur une purée de petit pois, formidable boudin noir landais, et jambon chipsé (de chez Aimé à Dax, ou de chez Montauzer à Guiche, c'est selon), entre autres merveilleuses tapas savoureuses comme à San Seba, ou à Bilbao (bravo, par conséquent, à Fabrice Dubos et à l’équipe très pro de ce restaurant de l'armada de l'ami Alain Dutournier, d’une qualité extrême, sis rue d’Alger). Cela escortait les nombreuses cuvées de vignerons indépendants, et de caves coop’ de respect. L’Abbé Dubois de Cécile et Claude Dumarcher, à St Remèze, propose un viognier 2015 en IGP Ardèche au nez de pêche et d’agrumes délicat, bouche friande et vive, au sein de laquelle acidité et douceur font bon ménage (6€ à peine). La cuvée Originel, nouvelle, vaut franchement le détour, car il s’agit d’un IGP Ardèche rouge issu de Plant de Brunel à 100% Kezaco ? Un cépage quasi inédit, reconnu par l’INRA depuis 2010, planté au domaine des Dumarcher, en 2011 : les vignes ont donc à peine 4 ans, et donnent leur premier vin : c’est très original : robe sombre, nez de fruits rouges vifs (cerise croquante, légère acidité), c’est franchement tannique en bouche, puissant et sans détour possible, cojonudo. 3000 bouteilles à peine pour cette curiosité totale (15€). Le domaine des Accoles, de Florence et Olivier Leriche, à Coux, en certif' Demeter depuis 2015, propose un blanc très grenaché (additionné de clairette blanche et rose), Recto  Verso 2015 (9€) aux notes d’agrumes affirmées. Rendez-vous des Accolytes 2014 bio, rouge, issu de grenache à 100%, très mûres (7€), une cuvée Miocène 2013 bio (13€), où grenache (70%) et carignan expriment une vivacité sans ambages, derrière un mentholé du meilleur effet. Le château Les Amoureuses, de Jean-Pierre Bedel, à Bourg St Andéol (07), donne un rouge assez rond, Black Sublim 2012, avec une jolie acidité délicate en bouche, et doté d’une belle présence en bouche, dans le millésime 2011 (25€, ça rigole pas). Et un Absolu Black 2012
Verso 2015 (9€) aux notes d’agrumes affirmées. Rendez-vous des Accolytes 2014 bio, rouge, issu de grenache à 100%, très mûres (7€), une cuvée Miocène 2013 bio (13€), où grenache (70%) et carignan expriment une vivacité sans ambages, derrière un mentholé du meilleur effet. Le château Les Amoureuses, de Jean-Pierre Bedel, à Bourg St Andéol (07), donne un rouge assez rond, Black Sublim 2012, avec une jolie acidité délicate en bouche, et doté d’une belle présence en bouche, dans le millésime 2011 (25€, ça rigole pas). Et un Absolu Black 2012  (grenache, syrah, mourvèdre, carignan) 41€, et oui. Très grenaché, sur le
(grenache, syrah, mourvèdre, carignan) 41€, et oui. Très grenaché, sur le  millésime 2011. Le domaine Arsac, de Sébastien Arsac (photo), en culture bio certifiée, est un domaine solide au discours construit, et aux cuvées ad hoc. Argence 2014, un chardonnay bichonné de la vigne au chai, est floral, beurré en bouche, et pourvu d’une impeccable fraîcheur (13,25€). La Chaumette 2015, un rosé de grenache à 95%, résolument gastronomique du début à la fin d’un repas, se fiche de sa couleur peu « modeuse », plutôt soutenue (comme on aime), et affirme sa clarté, sa délicatesse, et sa force en bouche (10,75€) : Respect, Sébastien!.. Mais Terra Occidens 2014, à fond merlot (85%), ne convainc pas, malgré son étonnante vivacité de cerise croquante (13,25€). Le domaine de Cassagnole, d’Audrey et Alex Biscarat, à Casteljau, propose un blanc (viognier 100%), Esprit de Cassagnole, vif, épicé et rond en bouche : réconciliateur, en somme (8€). Esprit de Cassagnole rosé 2015, issu de syrah corpulentes, de grenache et d’un chouia de viognier, possède une délicatesse et une suavité d’une jolie franchise (8€). Esprit de
millésime 2011. Le domaine Arsac, de Sébastien Arsac (photo), en culture bio certifiée, est un domaine solide au discours construit, et aux cuvées ad hoc. Argence 2014, un chardonnay bichonné de la vigne au chai, est floral, beurré en bouche, et pourvu d’une impeccable fraîcheur (13,25€). La Chaumette 2015, un rosé de grenache à 95%, résolument gastronomique du début à la fin d’un repas, se fiche de sa couleur peu « modeuse », plutôt soutenue (comme on aime), et affirme sa clarté, sa délicatesse, et sa force en bouche (10,75€) : Respect, Sébastien!.. Mais Terra Occidens 2014, à fond merlot (85%), ne convainc pas, malgré son étonnante vivacité de cerise croquante (13,25€). Le domaine de Cassagnole, d’Audrey et Alex Biscarat, à Casteljau, propose un blanc (viognier 100%), Esprit de Cassagnole, vif, épicé et rond en bouche : réconciliateur, en somme (8€). Esprit de Cassagnole rosé 2015, issu de syrah corpulentes, de grenache et d’un chouia de viognier, possède une délicatesse et une suavité d’une jolie franchise (8€). Esprit de  Cassagnole rouge 2014, ose le marselan, cépage réputé difficile à réussir. Et c’est bien travaillé, bravo. Accompagné de syrah et de carignan, ce rouge élégant, cru, fruité, sauvage, est néanmoins souple et fin en bouche (8,50€). Le domaine du Chapître, de Frédéric Dorthe, à St Marcel d’Ardèche, propose une syrah 100% avec la cuvée Aria 2012, puissante, avec de la matière (8€). Et un blanc, Exsultate 2015, issu de roussanne et de muscat à petits grains, peut-être trop muscaté, vif certes, épicé aussi (10€). Le domaine Coulange, de Christelle Coulange, à Bourg St Andéol, offre un côtes du Rhône blanc (grenache blanc, viognier, roussanne, marsanne) d’une grande rondeur, avec du gras et une belle acidité en bouche qui réveille l’ensemble (6,50€). Mistral 2015 est un côtes du Rhône rouge très grenache (80%, et syrah), mis en bouteille il y a moins d’un mois (nous sommes le 20 mai), et déjà prometteur, sans défaut majeur apparent. Fruits rouges, épicé délicat, réglissé fugitif (6€). Rochelette 2014, du même domaine, est très marqué par la syrah, c’est complexe et élégant, ça appelle l’entrecôte ou le carré d’agneau (7€). Le domaine du Grangeon,
Cassagnole rouge 2014, ose le marselan, cépage réputé difficile à réussir. Et c’est bien travaillé, bravo. Accompagné de syrah et de carignan, ce rouge élégant, cru, fruité, sauvage, est néanmoins souple et fin en bouche (8,50€). Le domaine du Chapître, de Frédéric Dorthe, à St Marcel d’Ardèche, propose une syrah 100% avec la cuvée Aria 2012, puissante, avec de la matière (8€). Et un blanc, Exsultate 2015, issu de roussanne et de muscat à petits grains, peut-être trop muscaté, vif certes, épicé aussi (10€). Le domaine Coulange, de Christelle Coulange, à Bourg St Andéol, offre un côtes du Rhône blanc (grenache blanc, viognier, roussanne, marsanne) d’une grande rondeur, avec du gras et une belle acidité en bouche qui réveille l’ensemble (6,50€). Mistral 2015 est un côtes du Rhône rouge très grenache (80%, et syrah), mis en bouteille il y a moins d’un mois (nous sommes le 20 mai), et déjà prometteur, sans défaut majeur apparent. Fruits rouges, épicé délicat, réglissé fugitif (6€). Rochelette 2014, du même domaine, est très marqué par la syrah, c’est complexe et élégant, ça appelle l’entrecôte ou le carré d’agneau (7€). Le domaine du Grangeon,  de Christophe Reynouard, à Rosières, est une référence absolue, selon nous : son viognier 2015, travaillé à l’ancienne, soit comme dans les années 1990 (à peine!), possède une sucrosité (3,8g/l) donc une douceur avenante, qui n’apparaît qu’après une fraîcheur superbe au nez (poire, pêche), et une vivacité en première bouche (pêche blanche, chèvrefeuille), et le tout explosa littéralement sur la coquille St-Jacques lardée du Pinxo ! (10,50€ : avec tant de soins apportés, c’est cadeau). Le Chatus 2013, un cépage adoré et minutieusement travaillé par Reynouard : nous avons là l’expression délicate du fruit, avec cette acidité nécessaire, ses tanins discrets, fondus, et qui nous font juste un clin d’œil amical; c’est joliment épicé, doucement alcooleux, fruité profondément (et sur certains millésimes, la nèfle s’invite pour adoucir la fin de bouche, mais pas là). 13€, re-cadeau. Et bravo. Bravo aussi à Benoît Chazallon, vigneron absolu, adepte instinctif de la bio culture biologique et biodynamique (label Ecocert AB) de son déjà célébrissime domaine de La Selve. Madame de 2014, que l’on ne présente plus à aucun aficionado, est un blanc en IGP Ardèche, « mention coteaux de l’Ardèche blanc », viognier 100%, d’une pureté droite, très floral, avec des notes
de Christophe Reynouard, à Rosières, est une référence absolue, selon nous : son viognier 2015, travaillé à l’ancienne, soit comme dans les années 1990 (à peine!), possède une sucrosité (3,8g/l) donc une douceur avenante, qui n’apparaît qu’après une fraîcheur superbe au nez (poire, pêche), et une vivacité en première bouche (pêche blanche, chèvrefeuille), et le tout explosa littéralement sur la coquille St-Jacques lardée du Pinxo ! (10,50€ : avec tant de soins apportés, c’est cadeau). Le Chatus 2013, un cépage adoré et minutieusement travaillé par Reynouard : nous avons là l’expression délicate du fruit, avec cette acidité nécessaire, ses tanins discrets, fondus, et qui nous font juste un clin d’œil amical; c’est joliment épicé, doucement alcooleux, fruité profondément (et sur certains millésimes, la nèfle s’invite pour adoucir la fin de bouche, mais pas là). 13€, re-cadeau. Et bravo. Bravo aussi à Benoît Chazallon, vigneron absolu, adepte instinctif de la bio culture biologique et biodynamique (label Ecocert AB) de son déjà célébrissime domaine de La Selve. Madame de 2014, que l’on ne présente plus à aucun aficionado, est un blanc en IGP Ardèche, « mention coteaux de l’Ardèche blanc », viognier 100%, d’une pureté droite, très floral, avec des notes  affirmées de pêche et d’abricot du meilleur effet (24,50€ le prix du voyage dans un verger rarissime). Serre de Berty 2013 est le vin étonnant de cette grande dégustation. Ce rouge issu de syrah (50%), grenache et cinsault à part égale, en culture bio et biodynamique sans aucun insecticide, intrant chimique et tout le bazar bordelais (oops !), jouit d’une cuvaison très longue (6-8 semaines). Levures indigènes, of course, ce n’est ni collé, ni filtré, ça donne un nez incroyable où domine la poire (!), il n’y a aucune extraction, ni aucun pigeage, c’est à peine-à peine soufré à la mise, et cela donne… « le toucher du vin ». Un concept aussi poétique qu’essentiel, retenez-le, c'est un peu comme le toucher de la hanche pour un danseur de tango, et pour un vin aussi puissant que délicat, cela figure une sorte de synthèse, une bouqet ramassé. Très longue fin de bouche... Et c'est armé d’une délicatesse infinie, d’un soyeux presque irréel : le coup de cœur absolu (15,40€). Solera tirage 2015, viognier 100% de Chazallon aussi, muté à mi fermentation, ouillé (pas comme à Jerez : pas de « flor »), est très liquoreux mais nerveux, et capable de se battre en duel avec un fromage bleu, un foie gras poêlé, et un chocolat amer (20€ le flacon de 50 cl). Le Mas de Libian, d’Hélène Thibon, à St Marcel d’Ardèche, en biodynamie certifié Demeter, c’est la classe et la pureté même. Cave Vinum 2015, un blanc issu de roussanne, viognier et clairette, exprime la fluidité, la
affirmées de pêche et d’abricot du meilleur effet (24,50€ le prix du voyage dans un verger rarissime). Serre de Berty 2013 est le vin étonnant de cette grande dégustation. Ce rouge issu de syrah (50%), grenache et cinsault à part égale, en culture bio et biodynamique sans aucun insecticide, intrant chimique et tout le bazar bordelais (oops !), jouit d’une cuvaison très longue (6-8 semaines). Levures indigènes, of course, ce n’est ni collé, ni filtré, ça donne un nez incroyable où domine la poire (!), il n’y a aucune extraction, ni aucun pigeage, c’est à peine-à peine soufré à la mise, et cela donne… « le toucher du vin ». Un concept aussi poétique qu’essentiel, retenez-le, c'est un peu comme le toucher de la hanche pour un danseur de tango, et pour un vin aussi puissant que délicat, cela figure une sorte de synthèse, une bouqet ramassé. Très longue fin de bouche... Et c'est armé d’une délicatesse infinie, d’un soyeux presque irréel : le coup de cœur absolu (15,40€). Solera tirage 2015, viognier 100% de Chazallon aussi, muté à mi fermentation, ouillé (pas comme à Jerez : pas de « flor »), est très liquoreux mais nerveux, et capable de se battre en duel avec un fromage bleu, un foie gras poêlé, et un chocolat amer (20€ le flacon de 50 cl). Le Mas de Libian, d’Hélène Thibon, à St Marcel d’Ardèche, en biodynamie certifié Demeter, c’est la classe et la pureté même. Cave Vinum 2015, un blanc issu de roussanne, viognier et clairette, exprime la fluidité, la suavité, oui... Cette limpidité que l’on est désormais forcé de « retrouver » devant un vin en biodynamie – c’est comme ça, cela commence à se reconnaître, et nous le savons, lorsque nous dégustons entre nosotros... Et cette nouvelle « distinction » passera désormais par là. Un blanc exotique, après les fleurs et les fruits à chair blanche, d’une élégance et d’une noblesse qui évoque la démarche droite et inflexible des Africaines traversant la brousse avec un énorme bac rempli d'eau, en plastique de couleur vive, posé sur leur tête (13€). Bout’zan 2015, très grenaché, est un rouge envoyant une jolie mâche virile (10€). Le domaine Notre Dame de Cousignac, de Raphaël Pommier, à Bourg St Andéol, propose un blanc marqué par la clairette, floral en diable, avec un léger gras (8€). Le domaine de Vigier, de Marjorie Dupré, à Lagorce, offre un viognier 100%, Inès 2014, au nez exotique (ananas) et « viennois » (beurre frais) bienvenu, le rapport qualité prix nous apparaît probant : 7,65€. Les méritants Vignerons Ardéchois, présidés par André Mercier, sis à Ruoms,
suavité, oui... Cette limpidité que l’on est désormais forcé de « retrouver » devant un vin en biodynamie – c’est comme ça, cela commence à se reconnaître, et nous le savons, lorsque nous dégustons entre nosotros... Et cette nouvelle « distinction » passera désormais par là. Un blanc exotique, après les fleurs et les fruits à chair blanche, d’une élégance et d’une noblesse qui évoque la démarche droite et inflexible des Africaines traversant la brousse avec un énorme bac rempli d'eau, en plastique de couleur vive, posé sur leur tête (13€). Bout’zan 2015, très grenaché, est un rouge envoyant une jolie mâche virile (10€). Le domaine Notre Dame de Cousignac, de Raphaël Pommier, à Bourg St Andéol, propose un blanc marqué par la clairette, floral en diable, avec un léger gras (8€). Le domaine de Vigier, de Marjorie Dupré, à Lagorce, offre un viognier 100%, Inès 2014, au nez exotique (ananas) et « viennois » (beurre frais) bienvenu, le rapport qualité prix nous apparaît probant : 7,65€. Les méritants Vignerons Ardéchois, présidés par André Mercier, sis à Ruoms, proposent une grande gamme séduisante : le viognier Tradition (6,40€), possède une douceur de bon aloi. Son frère (100% viognier, aussi), élevé en barriques, Terre d’Eglantier, est naturellement charnu, boisé donc, mais avec raison (8,50€). Terre d’Amandier 2015, chardonnay 100%, rond, équilibré, sur la pêche et l’aubépine, l’épicé doux aussi, voire le fruit sec torréfié, est une réussite recommandable (7€ à peine). Grotte Chauvet, une toute nouvelle gamme, existe déjà en rosé 2015, AOP Côtes du Vivarais : c’est friand à souhait, gourmand, et ça appelle les copains et le barbecue (6,30€). En rouge 2014, avec 70% de syrah et un complément de grenache, Grotte Chauvet est marqué, affirmé, c’est cohérent avec le visuel préhistorique : voici un vin offrant une belle matière (6,30€). Enfin, la cave La Cévenole, à Rosières, donne un Chatus Monnaie d’Or 2013 (100% chatus) d’une puissance contenue, avec une bouche généreusement épicée (7,65€).
proposent une grande gamme séduisante : le viognier Tradition (6,40€), possède une douceur de bon aloi. Son frère (100% viognier, aussi), élevé en barriques, Terre d’Eglantier, est naturellement charnu, boisé donc, mais avec raison (8,50€). Terre d’Amandier 2015, chardonnay 100%, rond, équilibré, sur la pêche et l’aubépine, l’épicé doux aussi, voire le fruit sec torréfié, est une réussite recommandable (7€ à peine). Grotte Chauvet, une toute nouvelle gamme, existe déjà en rosé 2015, AOP Côtes du Vivarais : c’est friand à souhait, gourmand, et ça appelle les copains et le barbecue (6,30€). En rouge 2014, avec 70% de syrah et un complément de grenache, Grotte Chauvet est marqué, affirmé, c’est cohérent avec le visuel préhistorique : voici un vin offrant une belle matière (6,30€). Enfin, la cave La Cévenole, à Rosières, donne un Chatus Monnaie d’Or 2013 (100% chatus) d’une puissance contenue, avec une bouche généreusement épicée (7,65€).
Léon Mazzella
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

 Là, avec deux potes, on s'est dit on y va, on verra. D'ailleurs, on se le dit souvent, ça. C'est (un peu) vivre, d'une certaine façon. Château Minuty 281, avec sa longue larme bleue intense, est une cuvée tropézienne très particulière (grenache et tibouren, vignes de 25 ans minimum, sélection parcellaire). François Matton, son co-propriétaire (avec son frère Jean-Etienne), souligne avec justesse sa belle longueur en bouche, et ajoute que ce 2015 est moins marqué par l'acidité que le 2014. Oh, combien! Nous n'avions franchement pas aimé le 2014, vraiment trop marqué agrumes verts. Celui-ci est davantage en rondeur,
Là, avec deux potes, on s'est dit on y va, on verra. D'ailleurs, on se le dit souvent, ça. C'est (un peu) vivre, d'une certaine façon. Château Minuty 281, avec sa longue larme bleue intense, est une cuvée tropézienne très particulière (grenache et tibouren, vignes de 25 ans minimum, sélection parcellaire). François Matton, son co-propriétaire (avec son frère Jean-Etienne), souligne avec justesse sa belle longueur en bouche, et ajoute que ce 2015 est moins marqué par l'acidité que le 2014. Oh, combien! Nous n'avions franchement pas aimé le 2014, vraiment trop marqué agrumes verts. Celui-ci est davantage en rondeur, très floral, délicat, avec une bouche légère de pomelo, et de pêche blanche résolument gourmande et, néanmoins (ou plutôt nez en plus), une force en retrait, comme un coup de reins salutaire. Un truc capable de soutenir des sardines du Phare d'Eckmühl au piment d'Espelette bio, lequel ne fait pas semblant d'être dans la boîte. Et oui, l'accord se fit. Minuty (45€ env. quand même), surnagea, et ces splendides petits poissons, d'une fermeté ad hoc, mon capitaine, expriment l'excellence de la conserve, avec un paquadjingue sobre et du meilleur effet, comme très souvent avec les sardines à l'huile (davantage qu'avec les Pataugas). A noter que Minuty, fondé par Ganriel Farnet, fête ses 80 ans, cette année (à suivre).
très floral, délicat, avec une bouche légère de pomelo, et de pêche blanche résolument gourmande et, néanmoins (ou plutôt nez en plus), une force en retrait, comme un coup de reins salutaire. Un truc capable de soutenir des sardines du Phare d'Eckmühl au piment d'Espelette bio, lequel ne fait pas semblant d'être dans la boîte. Et oui, l'accord se fit. Minuty (45€ env. quand même), surnagea, et ces splendides petits poissons, d'une fermeté ad hoc, mon capitaine, expriment l'excellence de la conserve, avec un paquadjingue sobre et du meilleur effet, comme très souvent avec les sardines à l'huile (davantage qu'avec les Pataugas). A noter que Minuty, fondé par Ganriel Farnet, fête ses 80 ans, cette année (à suivre).
 Qui l'eut cru? Le porto blanc extra sec, Extra Dry White Reserve, de la Quinta das Lamelas, soit un pur joyau (19€ le flacon de 50cl), qui naît dans Le Cima Corgo, un terroir exceptionnel du Douro, exprimant certes aussitôt la noix, l'amande torréfiée, l'abricot sec mais moelleux, avec une tension idéale qui l'empêche de flirter avec la douceur encombrante, le gras lourdingue, va à merveille -tenez vous bien-, avec des filets de hareng fumés, doux toutefois, augmentés (maison) d'oignon blanc, de poivre noir et d'huile neutre avec un chouia d'huile d'olive toscane, dûment marinés deux bonnes heures. L'accord est étonnamment symbiotique. L'iode, le gras, le salin, le fruité sec, la raideur douce, le croquant du vin et la douceur molle du poisson, tout cela dansait un tango sauvage dans la bouche. Et mes potes murmuraient, les yeux mi-clos. Nota : Si vous passez par la capitale (Paris), sachez qu'a ouvert une boutique unique en son genre : Portologia, rue Chapon, dans le 3ème arrondissement. C'est le temple du Porto, des portos, vins tranquilles blancs et rouges compris, et des produits dérivés : charcuterie, fromages, huiles... Plus de 200 références, une majorité de petits producteurs, même si nous trouvons un négociant comme Dalva (lequel nous évoque davantage le regretté Jim Harrison que les vins de la vallée du Douro...), des vins tranquilles, bien sûr, et qui sont si bons (Esencia, essayez donc ça!) et puis la gamme de Bulas, ou bien celle de la Quinta do Murao), et la grande palette, des tawnys au Late Bottled Vintage, en passant par les Colheitas... Julien Dos Santos, maître des lieux, est un specialista disert. Il vous en dira tant... Rappel : la France est le premier pays consommateur de Porto (et de whisky aussi. Nous cumulons!). Dernier détail, de taille : on peut déguster sur place, entre amis, en grignotant des choses superbes tout en débouchant des flacons. Convivial, cette cave, bar à vins, maison de dégustation (comme on parle de maison de thé), est un lieu qui devrait logiquement devenir fissa pronto une adresse sympa pour les apéros que l'on aime tant prolonger...
Qui l'eut cru? Le porto blanc extra sec, Extra Dry White Reserve, de la Quinta das Lamelas, soit un pur joyau (19€ le flacon de 50cl), qui naît dans Le Cima Corgo, un terroir exceptionnel du Douro, exprimant certes aussitôt la noix, l'amande torréfiée, l'abricot sec mais moelleux, avec une tension idéale qui l'empêche de flirter avec la douceur encombrante, le gras lourdingue, va à merveille -tenez vous bien-, avec des filets de hareng fumés, doux toutefois, augmentés (maison) d'oignon blanc, de poivre noir et d'huile neutre avec un chouia d'huile d'olive toscane, dûment marinés deux bonnes heures. L'accord est étonnamment symbiotique. L'iode, le gras, le salin, le fruité sec, la raideur douce, le croquant du vin et la douceur molle du poisson, tout cela dansait un tango sauvage dans la bouche. Et mes potes murmuraient, les yeux mi-clos. Nota : Si vous passez par la capitale (Paris), sachez qu'a ouvert une boutique unique en son genre : Portologia, rue Chapon, dans le 3ème arrondissement. C'est le temple du Porto, des portos, vins tranquilles blancs et rouges compris, et des produits dérivés : charcuterie, fromages, huiles... Plus de 200 références, une majorité de petits producteurs, même si nous trouvons un négociant comme Dalva (lequel nous évoque davantage le regretté Jim Harrison que les vins de la vallée du Douro...), des vins tranquilles, bien sûr, et qui sont si bons (Esencia, essayez donc ça!) et puis la gamme de Bulas, ou bien celle de la Quinta do Murao), et la grande palette, des tawnys au Late Bottled Vintage, en passant par les Colheitas... Julien Dos Santos, maître des lieux, est un specialista disert. Il vous en dira tant... Rappel : la France est le premier pays consommateur de Porto (et de whisky aussi. Nous cumulons!). Dernier détail, de taille : on peut déguster sur place, entre amis, en grignotant des choses superbes tout en débouchant des flacons. Convivial, cette cave, bar à vins, maison de dégustation (comme on parle de maison de thé), est un lieu qui devrait logiquement devenir fissa pronto une adresse sympa pour les apéros que l'on aime tant prolonger...
Château Larroque, un bordeaux blanc - propriété de la famille Ducourt (dans le millésime 2015 bien sûr), est très équilibré, tonique, fruité (exotique) à souhait, avec une acidité de bon aloi, un nez complexe que l'on retrouve en bouche. Ce vin-là fait d'ailleurs partie, avec 17 autres domaines, des Oscars des Bordeaux de l'été 2016. Et il est capable de soutenir une salade de cogollos (coeurs de laitue), avec force vinaigre balsamique et fleur de sel, ce qui n'est jamais évident, ainsi que des boulettes de ventre de veau (celui que l'on hache pour préparer l'axoa basque, avec du piment d'Espelette - encore lui!), roulées au plat de la main maison, puis poêlées (6,30€).
Ducourt (dans le millésime 2015 bien sûr), est très équilibré, tonique, fruité (exotique) à souhait, avec une acidité de bon aloi, un nez complexe que l'on retrouve en bouche. Ce vin-là fait d'ailleurs partie, avec 17 autres domaines, des Oscars des Bordeaux de l'été 2016. Et il est capable de soutenir une salade de cogollos (coeurs de laitue), avec force vinaigre balsamique et fleur de sel, ce qui n'est jamais évident, ainsi que des boulettes de ventre de veau (celui que l'on hache pour préparer l'axoa basque, avec du piment d'Espelette - encore lui!), roulées au plat de la main maison, puis poêlées (6,30€).
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
 Ils aiment les cochonneries. En faire, en manger, en dire. Et en écrire. Pour notre bonheur, Blandine Vié & Patrick de Mari adorent raconter des histoires cochonnes et gourmandes. Ils en ont commis un paquet en prenant sans doute leur pied (et sans bêler pour autant), rassemblé sous le titre Cochonneries en tous genres (Les Itinéraires). Et on y fait son marché : au total, vingt-huit nouvelles charcutières, tantôt tendres, drôles, voire désopilantes, douce-amères, souvent cocasses, émouvantes, burlesques, ou coquines. Toujours littéraires, c'est-à-dire écrites dans le souci primordial de la langue : ce n'est jamais du mauvais gras qui est servi. Il y a du boudin ici, du jambon là, de l'andouillette ou encore des rillettes là-bas, un air de polar ici, un faux-air de bluette là, une idylle romantico-grassouillette par là-bas, des histoires de rugby, des anecdotes de mecs, des trucs de
Ils aiment les cochonneries. En faire, en manger, en dire. Et en écrire. Pour notre bonheur, Blandine Vié & Patrick de Mari adorent raconter des histoires cochonnes et gourmandes. Ils en ont commis un paquet en prenant sans doute leur pied (et sans bêler pour autant), rassemblé sous le titre Cochonneries en tous genres (Les Itinéraires). Et on y fait son marché : au total, vingt-huit nouvelles charcutières, tantôt tendres, drôles, voire désopilantes, douce-amères, souvent cocasses, émouvantes, burlesques, ou coquines. Toujours littéraires, c'est-à-dire écrites dans le souci primordial de la langue : ce n'est jamais du mauvais gras qui est servi. Il y a du boudin ici, du jambon là, de l'andouillette ou encore des rillettes là-bas, un air de polar ici, un faux-air de bluette là, une idylle romantico-grassouillette par là-bas, des histoires de rugby, des anecdotes de mecs, des trucs de filles (prénommées Rosette ou Mariette), des fantasmes (ah, le boucher!..), des histoires d'ogres ne pouvant plus avaler le moindre gosse, à cause de la malbouffe dont il sont gavés! Ca devient dangereux, ces choses-là... Il y a de la poésie aussi, au détour d'un bouquet de paragraphes. Nous tombons même sur des rimes (voir la nouvelle intitulée Goret est un cochon!). Nous y croisons par ailleurs deux teckels baptisés Francfort et Strasbourg, et une baronne de Chambon-Parme. Et l'ensemble, loin de couper l'appétit, aiguise celui-ci. Assez peu Vegan, le livre des créateurs du site gourmand Greta Garbure résonne, de surcroît, comme une jolie provocation, en ces temps light et comme ourdis par une peur panique de s'avouer amateur de cochon... Alors, vive ces cochonneries en tous genres! Et leurs deux jolies plumes gourmandes à la commande. L.M.
filles (prénommées Rosette ou Mariette), des fantasmes (ah, le boucher!..), des histoires d'ogres ne pouvant plus avaler le moindre gosse, à cause de la malbouffe dont il sont gavés! Ca devient dangereux, ces choses-là... Il y a de la poésie aussi, au détour d'un bouquet de paragraphes. Nous tombons même sur des rimes (voir la nouvelle intitulée Goret est un cochon!). Nous y croisons par ailleurs deux teckels baptisés Francfort et Strasbourg, et une baronne de Chambon-Parme. Et l'ensemble, loin de couper l'appétit, aiguise celui-ci. Assez peu Vegan, le livre des créateurs du site gourmand Greta Garbure résonne, de surcroît, comme une jolie provocation, en ces temps light et comme ourdis par une peur panique de s'avouer amateur de cochon... Alors, vive ces cochonneries en tous genres! Et leurs deux jolies plumes gourmandes à la commande. L.M.
C'est au demeurant une adresse de quartier plutôt sympathique, et son exigüité ajoute à un charme intim(ist)e (un étroit couloir et une micro salle contre la cuisine) a priori non calculé. Ca sent bon, une jeune femme ignorant l'usage des zygomatiques, y fabrique les pâtes sur une table, la cuisine est familiale, genre mamma du sud de la Botte. Les plats du jour ne sont pas chers, la carte attirante, naturellement plus coûteuse, quoiqu'abordable. Mais je n'ai pas envie d'en dire davantage, ici, car ce n'est pas le sujet. Je n'y retournerai plus, et j'écris ces quelques lignes uniquement pour signaler un désagrément majeur, situé hors champ culinaire, qui ne manque ni de culot ni d'aplomb et qui, surtout, se distingue par sa couardise. C'est une raison, à mes yeux suffisante, voire rédhibitoire.
J'y ai déjeuné avant-hier. Nous nous étions attablés (à deux) vers midi trente, ou quarante, et tandis que nous commandions les cafés, la note fut déposée et il me fut dit : il va falloir partir, maintenant, car la réservation suivante est arrivée. Il était treize heures trente. Pile. Nul ne nous avait prévenu de quoi que ce soit. Indigné (mais l'indignation a le chic de me laisser coi), je payais, et laissais néanmoins - en guise de pourboire -, mon sentiment sur cette manière de faire : j'ai contesté uniquement le fait de ne pas prévenir le client, ce qui lui laisserait le choix de s'asseoir ou de passer son chemin. Il me fut vertement rétorqué, le verbe haut, qu'ici c'était toujours comme ça. C'est un peu court... Mais, soit : on ne te prévient pas, tu vas avoir une heure top chrono pour bouloter, donc, et puis cassos fissa pronto. Et bien je dis non. Ce n'est évidemment pas ainsi que l'on traite les clients d'un restaurant, quel que soit son standing. Ne pas les prévenir, c'est en outre les prendre en otages, et en traitre. Je déteste. Pour information, ce restaurant italien s'appelle L'Osteria dell'anima, et il a pignon sur la rue Oberkampf, au n° 37 précisément. C'est dans le onzième arrondissement de Paris, à un jet de polenta du Bataclan. Je vais le regretter, mais je tiendrai bon, eu égard au grand nombre de concurrents alentour...
P.S. : j'ajoute que je suis rangé des fourchettes depuis longtemps, et ce, après des années et des années de critique gastronomique quasi quotidienne (midi et soir, au cours de mes années GaultMillau notamment), et que je n'ai plus tellement envie de redonner dans ce registre-là. Mais, lorsque, d'aventure, quelque chose d'insolite se produit, je dégaine, m'estimant en devoir d'en informer le chaland; mon prochain. Appelons cela le syndrome des fourmis dans mon épée, cher à Cyrano (qui est l'un de mes maîtres).
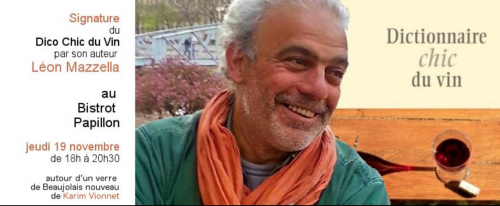
6, rue Papillon, 75009 Paris.
http://gretagarbure.com/2015/10/11/nos-mille-feuilles-nos-feuilletages-de-la-semaine-66/
Le début du papier (cliquez ci-dessus pour le lire in extenso) :
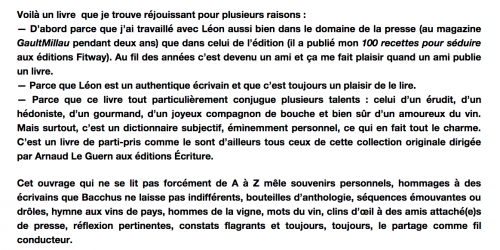
Au Clos de Vougeot (Bourgogne), le week-end dernier (salon Livres en Vignes) :
 Sur le chemin clos qui mène à Vougeot.
Sur le chemin clos qui mène à Vougeot.

Une élégante cherche l'auteur... qui la photographie.
Du beau monde venu signer.


Le dîner du chapitre (samedi) roboratif à souhait (Livres en Vignes ou l'autre salon du cholestérol)...