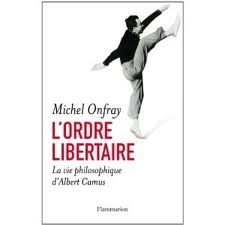 Onfray a des ennemis et j’aime ce qu’il écrit, donc je n'aime guère ses ennemis. Certes, il se répète beaucoup, à l’envi, comme un distributeur de litanies, dans le présent livre aussi, et si je me livrais à un exercice journalistique classique, celui du SR (secrétaire de rédaction), je saisirais les ciseaux de Sainte-Anastase et je taillerai là-dedans, je veux dire dans son dernier gros opus : « L’Ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert Camus » (Flammarion) pour ôter environ 150 pages de redondances aux 600 que j’ai cependant dévorées avec un immense plaisir et sans en sauter une demi-ligne.
Onfray a des ennemis et j’aime ce qu’il écrit, donc je n'aime guère ses ennemis. Certes, il se répète beaucoup, à l’envi, comme un distributeur de litanies, dans le présent livre aussi, et si je me livrais à un exercice journalistique classique, celui du SR (secrétaire de rédaction), je saisirais les ciseaux de Sainte-Anastase et je taillerai là-dedans, je veux dire dans son dernier gros opus : « L’Ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert Camus » (Flammarion) pour ôter environ 150 pages de redondances aux 600 que j’ai cependant dévorées avec un immense plaisir et sans en sauter une demi-ligne.
C’est un grand livre. Certes un chouia hagiographique, certes un poil anti-sartrien bichrome (c’est black or white), voire manichéen par endroits, avec force flot de citations à charge. Certes c’est également une espèce d’autobiographie (Nietzsche : « Toute philosophie constitue une autobiographie masquée ») :
PARALLÈLES
Camus et Onfray ont, il faut le préciser, un parcours comparable. Mêmes origines sociales -pauvres-, même mépris pour les paillettes germanopratines, mêmes inspirations nietzschéennes, voire gramsciennes (pas convaincu par le chapitre ad hoc, et je pense bien connaître mon Gramsci), même énergie solaire (sauf que Onfray n’est pas Méditerranéen, que l’on sache), même accueil par une certaine dictature du savoir et du pouvoir éditorial (laquelle vire peu à peu à l’endogamie mentale à force de manquer d’air –mais c’est tant pis pour elle. Même cette civilisation, par ailleurs mortifère, est mortelle!).
Même destinée libertaire aussi, voire anarchiste… Onfray n’a pas publié de fictions comme Camus, cependant. Et nous savons, à la lumière de cet essai brillant, combien « Noces », « L’Eté », « La Peste », « La chute », « L’Exil et le Royaume », etc., contiennent dans leur ventre une portée philosophique, à côté de laquelle nous étions passés jusque là, en nous attachant exclusivement à la prose sensuelle, solaire, méditerranéenne, hédoniste, algérienne, salée, profondément libre de notre Camus préféré. (Relire aussitôt « Noces », et « L’Eté », au sortir de la bio d’Onfray, fut un bonheur frais et comme neuf : garanti pièces et main d’oeuvre).
OBSCURES RANCOEURS
Mais il s’agit d’abord d’une biographie philosophique. Après avoir flingué Freud à la mitrailleuse lourde (« Le crépuscule d’une idole », Grasset), voici Michel Onfray en verve pour réhabiliter, car cela semblait nécessaire, le Camus philosophe pour classe d’agrég. (et non pas pour classes Terminales, pour paraphraser le titre d’un pamphlet qui m’opposa constamment à son auteur et ami, feu Jean-Jacques Brochier).
L’Ordre libertaire est un grand bouquin parce qu’il règle les comptes avec une certaine société parisienne nombriliste, étriquée, auto-intelligentisalisée et propriétaire (putschiste) du droit de dire, de publier, de faire et de défaire, mais dans un cercle tellement restreint qu’il semble (à le renifler et tant il est nauséabond au fil du temps), avoir oublié les structures élémentaires de la parenté. Autrement dit, la prohibition (métaphysique) de l’inceste (mental) ne semble pas avoir cours dans ce marigot-là. La suffisance semble gouverner sa morgue. Ainsi que la reproduction entre soi, façon « Les héritiers » selon Bourdieu & Passeron.
Du coup, Albert Camus le pied-noir, fils d’un père ouvrier mort au front en 14 et d’une mère analphabète (elle n'a jamais lu son fils!), n’ayant fait ni "H. IV", ni Ulm (Normale Sup), ne fait pas partie du Club Mickey, donc du sérail, de la famille bourgeoise bien-pensante. D’où leur haine, leur jalousie lorsque l’auteur de « L’étranger » obtint le Nobel en 57 (« Devant ma mère, je sens que je suis d’une race noble : celle qui n’envie rien », in « Le Premier homme »). Entre autres exemples.
Sur cet aspect de l’homme et du ressentiment parisien, Onfray excelle. Nous sentons un Camus décidé à ne pas s’approcher trop près de ces virus, qui préfère la compagnie de l'ami absolu et total, René Char, et la perspective de vivre à Lourmarin (où il repose d’ailleurs) plutôt que rue de Chanaleilles, même si c’était bien, le temps passé là-bas.
UN HOMME SIMPLE ET SOLAIRE
Ce qui séduit d’emblée dans le livre d’Onfray, c’est de retrouver un Camus absolument solaire (et c’est la première fois que je lis cela, car ni Emmanuel Roblès pourtant, ni José Lenzini, et même Frédéric Musso, ni Morvan Lebesque, ni Abdelkader Djemaï, ni Jean Daniel, Jean Grenier à peine, Macha Séry un tout petit peu, n'étaient parvenus à retranscrire cela avec autant de talent et d’exactitude), un Camus résolument hédoniste et tout entier tourné vers la sensualité de la vie intellectuelle, avec le corps et l’esprit.
Onfray fait de Camus un Zarathoustra venu d’Algérie. Et le prouve (le bonhomme connaît son Nietzsche sur le bout des doigts), mais on pourrait être tenté de lui reprocher de forcer le trait pour nous persuader de ses convictions. C’est le jeu. On le joue.
Plus intéressante est la manière dont Onfray souligne l’attachement inaliénable de Camus à la pauvreté dont il est issu et qui l’a forgé (les livres lui furent une conquête et pas un héritage, comme cela fut le cas pour un Sartre), ainsi qu'aux humiliés, aux taiseux comme sa mère, et donc au courage, à la noblesse humaine la plus nue, à la loyauté, au courage d’être un homme, au sens de l’honneur, à la dignité de son modeste rang ; à la philosophie d’une morale vraie, en somme.
UNE BIO EN EMPATHIE
Avec ce livre, nous sommes loin des gros pavés qui font autorité, comme le Herbert R. Lottman (monumentale enquête biographique à l’anglo-saxonne, irréprochable, totale, et d’une précision d’horloger genevois croisé avec une entomologiste teutonne), ou le Todd (Olivier), que j’aime moins, mais passons. Ici, avec Onfray, tout fait bonheur, poésie, liberté, détachement, regard vers le soleil les yeux ouverts, appel à Diogène et volonté de jouissance…
Onfray combat la légende : Non, Camus n’est pas un philosophe pour futurs bacheliers, ni un romancier à la prose douce et facile. Oui, Camus est un philosophe profond dans ses essais fameux comme « L’homme révolté » et dans ses œuvres de fiction. Oui, Camus est un anticolonialiste engagé mais mesuré, singulièrement consensuel dans une époque radicale (« la radicalité de la nuance », c’est de lui, et je n’ai pas retrouvé la formule dans le livre d'Onfray).
Oui Camus est un païen pragmatique, un homme droit qui se souvient de l’unique leçon de son père disparu trop tôt : « un homme, ça s’empêche ». C'est encore un homme fidèle aux siens –même contre la Justice. Fidèle à sa mère d’abord, fidèle à son instituteur Louis Germain (le « Discours de Suède » rappelle cela avec superbe) fidèle à cet espèce de père de substitution.
Fidèle aussi au maître absolu que fut Jean Grenier, son prof de philo et auteur des « Îles » et de « Inspirations méditerranéennes », qui lui fit lire aussi « La douleur », d’André de Richaud, lecture décisive. Mais avant tout parce que le professeur Grenier déclencha en Camus le désir d’écrire!..
Camus est un disciple du « Gai savoir » et du précepte nietzschéen fameux : « Deviens celui que tu es », il est un homme qui ne cessera de faire savoir qu’il faut faire en sorte que ne doivent exister ni bourreau, ni victime.
AU-DELA DU BAEDEKER
Bien sûr, il est aussi question dans ce livre de Belcourt, d'Alger, de la tuberculose à dix-sept ans, des femmes, du séducteur, de son look Bogart, des clopes, de Maria Casarès, du foot, du théâtre, de Francine après Hélène, d'« Alger Républicain », de « Combat », de Paris, de l’accident fatal dans la Facel-Vega conduite par Michel Gallimard, du manuscrit du "Premier homme"... tout cela que l'on sait déjà (peu ou prou), du succès de « La Peste », de l’arbre "Etranger" qui cache la forêt d'une oeuvre puissante et protéiforme (« Meursault c’est moi », eut pu dire "Albert Flaubert", à cause du soleil), de Tipasa enfin, et du retour à. Etc.
Tout le Baedeker Camus est forcément dans ce livre, mais par petites touches délicates. Onfray s’attachant à démontrer (avec talent et superbe) la dimension philosophique de Camus, son livre est un bréviaire indispensable. Cette dimension, incontestable pourtant, un certain Paris vétilleux, pincé du nez, coincé des neurones, refuse toujours de la reconnaître à l’auteur de « L’envers et l’endroit ».
Camus nous apparaît sous les traits d’un philosophe artiste –et adepte d’un art de vivre en temps de catastrophes, à l’aise dans son corps qu’il laisse s’exprimer en plongeant, en nageant, en faisant l'amour, en écrivant, en transpirant, en jouant, en lisant, en déclamant des auteurs grecs, en shootant dans un ballon rond, en chuchotant, en observant en silence l’horizon méditerranéen depuis la plage...
Car Camus possède le « castizo » espagnol, cette fierté si bien décrite par Michel del Castillo ici et là, ce cran donquichottesque qui n’ignore pas sa folie douce. Camus est un être charnel, exposé à la brûlure du soleil, au sel, à la cuirasse d’argent de la mer. Il n'est pas un de ces anémiés du 6ème arrondissement, perclus de rancoeurs, de jalousies et de comptes à régler avec ceux qui pourraient pisser peut-être plus loin qu'eux! –d’où les névroses auxquelles Albert est fondamentalement étranger, surtout vues depuis Alger ou Oran. Car tout cela manquerait un peu d'horizon. (Les natifs d’Oran -dont je suis- pardonnent à Camus de n’avoir pas aimé cette ville, cadre de sa "Peste", et de lui avoir préféré Alger).
UNE PULSION DE VIE SPINOZIENNE
Camus nomme imbécile "celui qui a peur de jouir parce qu’il n’éprouve pas de honte à être heureux".
Son hédonisme, avec les événements historiques dont il sera le témoin durant sa courte vie, est un antifascisme. La pulsion de vie, quasi spinozienne, de Camus, forge sa force. Celle qui lui fera éviter les pièges du communisme aveugle et ses haines recuites, sans oublier son cruel désir de vengeance. Nul ressentiment chez Camus, souligne avec bonheur Onfray. Juste un jugement mesuré. Antimarxiste, soit anti-obtus. Il estime qu'il serait encore possible de faire cohabiter les cultures arabes et européennes sur le sol algérien, aux premiers moments durs des « événements », qu’il ne connut qu’à peine.
Camus est enfant du melting-pot pied-noir, enfant d’un bouillon de culture sain, vivant, prodigieusement débarrassé de l’acnée parisienne et des remugles racistes ayant largement cours bien au-dessus de Gibraltar. Il est fils de l’ouverture, de l’écoute, de l’altérité, du soleil et des bonheurs simples.
Il se choisit Grec. Il appartient de toute façon –qui le contesterait ?- à la gauche dionysienne et laisse sur le bas-côté du chemin la gauche apollinienne, chichiteuse, pluvieuse, grisâtre, revancharde, aigrie toujours, et aussi exsangue du corps comme du cerveau.
Camus est un homme placé de naissance du côté de l’hospitalité et du cosmopolitisme, de la fierté castillane, de la loyauté, de l’héroïsme hérités de Cervantès.
L’armée et l’université ont refusé son admission lorsqu’il était jeune. A cause de sa santé faible. Camus taillera sa sculpture solaire dans ces refus aux relents métropolitains. Onfray circonscrit cela avec une grand justesse : Camus est un philosophe qui privilégie la sensation, l’émotion, la perception, sur le concept, l’idée, la théorie. Et c’est pourquoi il nous est si proche, si tutoyant, si populaire, si accessible aussi. Ce que d’aucuns lui reprochent, car il ne reproduisit aucun de leurs codes moisis.
UN TROPISME LIBERTAIRE
A commencer par le tropisme arriviste du Rastignac de sous-préfecture -ce que Camus n'est pas : il n’envie pas Paris. Comment pourrait-il avoir le désir de sa conquête ? Paris lui fera payer très cher ses origines modestes, son existence de petit pied-noir qui défendit même ceux-ci –ce qui constitua un crime de lèse-pensée-unique à l’époque des porteurs de valises, , et de France Observateur, des livres (admirables, d’ailleurs) publiés clandestinement par les éditions de Minuit (et qui ressortent ces jours-ci)… Même son insolence politique, ses prises de position méfiantes face à un Parti communiste avaleur et destructeur à l’époque, furent inscrites au débit de son compte…
La grandeur de Camus se trouve là aussi. Comme dans les métaphores de sa vie que sont ses pièces (« Caligula », « Les Justes », ou ses adaptations dramaturgiques diverses). Onfray souligne que Camus n’est pas un contre-révolutionnaire, mais un révolutionnaire contre. La nuance est de taille.
Je relisais hier « Misère dans la Kabylie », après avoir refermé le Onfray et avoir lu qu’il y neigeait en ce moment, comme souvent d'ailleurs. Les récits de Camus (ou reportages à rendre jaloux jusqu’à la torture, un BHL, mais certainement pas un J. Littell à propos de la Syrie –admirable série dans « Le Monde » de la semaine dernière), rappellent les journaux africains de Gide. Le talent narratif est là, profondément tourné vers l’Autre, ce qui est salutaire, et l'on trouve aussi une dimension lyrique qui fait souvent défaut dans les textes de ce genre.
Sur la Guerre d’Algérie (elle touche ma mémoire familiale), je juge utile de citer seulement ceci, de Camus : « Quatre-vingt pour cent des Français d’Algérie ne sont pas des colons, mais des salariés ou des commerçants ». Camus ne souscrivit jamais à la justice sélective, ni à la « justice française » de la torture, pas plus qu’à la « justice nationale » des massacres.
Il considèrera jusqu’au bout que les Pieds-Noirs, eu égard à l’histoire de l’Algérie (ses invasions successives depuis l'Antiquité l’ayant construite) étaient des indigènes (provisoires) comme tous les autres. Camus paiera cher pour cette loyauté-là, pour sa rectitude, son bon sens, ses fidélités (ma mère contre la justice des terroristes...).
Même des esprits réputés éclairés (Bernard Frank par exemple) le traînèrent dans la boue, suivant sûrement un courant de pensée comme on monte dans un train en marche : nous pardonnerons par conséquent beaucoup au ventriloque Frank de ce « mundillo » en mal d’espace et d’horizon...
A la sortie de ce monument à la gloire d’un philosophe négligé, nous n’avons qu’un désir : le relire, et donc le prolonger. "Le faire passer", encore et toujours. Sans oublier les Sartre et autres bâtisseurs de lotissements d’une tenue autre, certes.
Mais surtout de faire passer cet hédonisme de la jouissance du corps et de l’esprit mêlés, qui font trop souvent défaut au centralisme intellectuel de notre république des lettres.
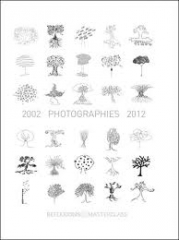 Giorgia Fiorio, célèbre photographe, a créé Réflexions Masterclass en 2002. Associée avec Gabriel Bauret, leur démarche constitue un singulier laboratoire dans le domaine du questionnement de la photographie et de sa pratique. Laboratoire d'idées, université nomade, pépinière de talents (jeunes, en devenir ou confirmés) révélés dans de nombreux pays, Réflexions Masterclass a hissé une centaine de photographes dont l'écriture, la démarche forment un corpus à la fois cohérent et protéiforme. La richesse des photos publiées dans ce gros livre (Actes Sud) est impressionnante. Comme l'est également la teneur des contributions écrites, qu'elles émanent de plumes célèbres comme Régis Debray (sur le concept de frontière -lire à ce propos son petit livre éponyme, repris en folio) ou de spécialistes de la question connus seulement dans leur milieu ou dans leur pays : Jean-Luc Monterosso, Victor I. Stoichita. Les textes des coauteurs eux-mêmes : Giorgia Fiorio (sur l'événement, l'immédiateté, l'ugence et l'ici-maintenant) et Gabriel Bauret (Parler photographie aujourd'hui?), sont d'une grande richesse. Réflexions Masterclass est tout sauf un workshop. Le livre rappelle le mot fameux de Jean-Luc Godard : Il ne s'agit pas de produire juste une image, mais une image juste. Cela pourrait résumer l'exigence de cette académie peu académique.
Giorgia Fiorio, célèbre photographe, a créé Réflexions Masterclass en 2002. Associée avec Gabriel Bauret, leur démarche constitue un singulier laboratoire dans le domaine du questionnement de la photographie et de sa pratique. Laboratoire d'idées, université nomade, pépinière de talents (jeunes, en devenir ou confirmés) révélés dans de nombreux pays, Réflexions Masterclass a hissé une centaine de photographes dont l'écriture, la démarche forment un corpus à la fois cohérent et protéiforme. La richesse des photos publiées dans ce gros livre (Actes Sud) est impressionnante. Comme l'est également la teneur des contributions écrites, qu'elles émanent de plumes célèbres comme Régis Debray (sur le concept de frontière -lire à ce propos son petit livre éponyme, repris en folio) ou de spécialistes de la question connus seulement dans leur milieu ou dans leur pays : Jean-Luc Monterosso, Victor I. Stoichita. Les textes des coauteurs eux-mêmes : Giorgia Fiorio (sur l'événement, l'immédiateté, l'ugence et l'ici-maintenant) et Gabriel Bauret (Parler photographie aujourd'hui?), sont d'une grande richesse. Réflexions Masterclass est tout sauf un workshop. Le livre rappelle le mot fameux de Jean-Luc Godard : Il ne s'agit pas de produire juste une image, mais une image juste. Cela pourrait résumer l'exigence de cette académie peu académique. Il serait commode de dire qu'il s'agit d'un roman à tiroirs. La grande maison, second roman traduit de Nicole Krauss (folio) est pourtant une prodigieuse construction qui présente, entrelace, mêle, démêle quatre histoires gravitant autour d'un bureau ayant appartenu à Federico Garcia Lorca et qui possèderait une âme capable de lier quatre destins éparpillés : à Londres, celui d'Athur Bender qui découvre que sa femme lui a caché une partie de sa vie. A Jérusalem, celui d'un père qui adresse une lettre émouvante à son fils Dov dont il n'a jamais su être proche. A Oxford où une Américaine, Isabelle, venue étudier outre-Atlantique, tombe éperdument amoureuse du fils d'une étrange antiquaire dont l'existence est dédiée à la restitution des biens juifs confisqués par les nazis. Et le destin du poète Daniel Varsky enfin, qui confie à une certaine Nadia le bureau si particulier. L'écriture envoûtante de Krauss, son sens prodigieux de la construction d'un roman (elle retombe toujours sur ses pattes et ne nous cause aucune peine à suivre l'écheveau de ces histoires) ainsi que sa capacité à ouvrir des tiroirs, à les refermer discrètement, à en laisser d'autres entrouverts, donne à ce roman une dimension mystérieuse singulière. Comme avec son précédent livre L'Histoire de l'amour (déjà évoqué ici l'an passé), on ne lâche pas les pages de cette grande maison.
Il serait commode de dire qu'il s'agit d'un roman à tiroirs. La grande maison, second roman traduit de Nicole Krauss (folio) est pourtant une prodigieuse construction qui présente, entrelace, mêle, démêle quatre histoires gravitant autour d'un bureau ayant appartenu à Federico Garcia Lorca et qui possèderait une âme capable de lier quatre destins éparpillés : à Londres, celui d'Athur Bender qui découvre que sa femme lui a caché une partie de sa vie. A Jérusalem, celui d'un père qui adresse une lettre émouvante à son fils Dov dont il n'a jamais su être proche. A Oxford où une Américaine, Isabelle, venue étudier outre-Atlantique, tombe éperdument amoureuse du fils d'une étrange antiquaire dont l'existence est dédiée à la restitution des biens juifs confisqués par les nazis. Et le destin du poète Daniel Varsky enfin, qui confie à une certaine Nadia le bureau si particulier. L'écriture envoûtante de Krauss, son sens prodigieux de la construction d'un roman (elle retombe toujours sur ses pattes et ne nous cause aucune peine à suivre l'écheveau de ces histoires) ainsi que sa capacité à ouvrir des tiroirs, à les refermer discrètement, à en laisser d'autres entrouverts, donne à ce roman une dimension mystérieuse singulière. Comme avec son précédent livre L'Histoire de l'amour (déjà évoqué ici l'an passé), on ne lâche pas les pages de cette grande maison. L'été se prête à la lecture des Journaux intimes d'écrivains. Voici une solide anthologie qui balaye le genre -car c'en est un, concoctée par Michel Braud, spécialiste de la question : Journaux intimes, de Madame de Staël à Pierre Loti (folio). Il permet de se souvenir que le Journal est un incomparable baromètre de l'âme qui donne ce que le roman ne donne pas encore. Arrière-boutique du work in progress, il en est aussi le laboratoire, le brouillon magnifique, la chambre des débats intérieurs, y compris lorsqu'il consigne le quotidien et son cortège de faits et gestes d'une banalité qui serait affligeante si elle n'était pas écrite. Produite par un écrivain. Et je pense à ce mot de Robert Kanters (je cite de mémoire) : le roman (en cours) et le Journal sont comme le vêtement et sa doublure et cette dernière est d'une étoffe si fine que l'on peut être tenté
L'été se prête à la lecture des Journaux intimes d'écrivains. Voici une solide anthologie qui balaye le genre -car c'en est un, concoctée par Michel Braud, spécialiste de la question : Journaux intimes, de Madame de Staël à Pierre Loti (folio). Il permet de se souvenir que le Journal est un incomparable baromètre de l'âme qui donne ce que le roman ne donne pas encore. Arrière-boutique du work in progress, il en est aussi le laboratoire, le brouillon magnifique, la chambre des débats intérieurs, y compris lorsqu'il consigne le quotidien et son cortège de faits et gestes d'une banalité qui serait affligeante si elle n'était pas écrite. Produite par un écrivain. Et je pense à ce mot de Robert Kanters (je cite de mémoire) : le roman (en cours) et le Journal sont comme le vêtement et sa doublure et cette dernière est d'une étoffe si fine que l'on peut être tenté 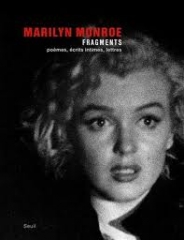 C'est l'année Marilyn. Le cinquantenaire de sa disparition (le 5 août prochain) est l'occasion d'une profusion d'hommages et de la publication de nombreux livres. Parmi ceux-ci, voici la réédition dans un agréable format semi-poche de ces Fragments (Points) qui nous firent découvrir l'année dernière une Marilyn Monroe intime et intello. Histoire de clouer le bec à tous les mysogynes et autres esprits réducteurs enclins à penser hâtivement qu'une blonde pulpeuse ne pouvait posséder le moindre neurone. Les cons. La sensibilité extrême d'une femme fragile et grande lectrice, amie de nombreux écrivains, apparaît au fil de ces pages précieuses qui permettent également de lire ses poèmes (de nombreux manuscrits sont reproduits), ses lettres, son Journal, ses états d'âme et l'ensemble produit un bouquet si délicat qu'on en oublierait le sex symbol; l'inoxydable icône. Une réussite.
C'est l'année Marilyn. Le cinquantenaire de sa disparition (le 5 août prochain) est l'occasion d'une profusion d'hommages et de la publication de nombreux livres. Parmi ceux-ci, voici la réédition dans un agréable format semi-poche de ces Fragments (Points) qui nous firent découvrir l'année dernière une Marilyn Monroe intime et intello. Histoire de clouer le bec à tous les mysogynes et autres esprits réducteurs enclins à penser hâtivement qu'une blonde pulpeuse ne pouvait posséder le moindre neurone. Les cons. La sensibilité extrême d'une femme fragile et grande lectrice, amie de nombreux écrivains, apparaît au fil de ces pages précieuses qui permettent également de lire ses poèmes (de nombreux manuscrits sont reproduits), ses lettres, son Journal, ses états d'âme et l'ensemble produit un bouquet si délicat qu'on en oublierait le sex symbol; l'inoxydable icône. Une réussite.  Sebastien Castella, l'immense torero français (il est Bitterois), l'équivalent de José Tomas en Espagne -les deux figuras les plus importantes du moment- ont en commun le partage du mystère. Austères, fermés, ils ne semblent pouvoir s'exprimer que devant un toro de combat. A coups de quarts d'heure d'une émotion parfois insoutenable de justesse, de lenteur (de temple) et de beauté. Le chroniqueur taurin Jacques Durand dit de l'un qu'il laisse son corps à l'hôtel lorsqu'il va toréer. Il y a de cela lorsqu'on voit l'un et/ou l'autre au centre d'une arène. Un livre magnifique vient de paraître sur Castella, signé Olga Holguin (Actes Sud). Cette photographe a suivi le torero pendant plusieurs années. Son livre tire la quintessence visuelle de l'art toreo du maestro. Des textes de grande teneur accompagne ces photos d'une sensibilité de chair de poule, signés Arevalo, Durand, Diusaba. Et des huiles de Robert Ryan enveloppent l'ensemble. Un beau livre; vraiment.
Sebastien Castella, l'immense torero français (il est Bitterois), l'équivalent de José Tomas en Espagne -les deux figuras les plus importantes du moment- ont en commun le partage du mystère. Austères, fermés, ils ne semblent pouvoir s'exprimer que devant un toro de combat. A coups de quarts d'heure d'une émotion parfois insoutenable de justesse, de lenteur (de temple) et de beauté. Le chroniqueur taurin Jacques Durand dit de l'un qu'il laisse son corps à l'hôtel lorsqu'il va toréer. Il y a de cela lorsqu'on voit l'un et/ou l'autre au centre d'une arène. Un livre magnifique vient de paraître sur Castella, signé Olga Holguin (Actes Sud). Cette photographe a suivi le torero pendant plusieurs années. Son livre tire la quintessence visuelle de l'art toreo du maestro. Des textes de grande teneur accompagne ces photos d'une sensibilité de chair de poule, signés Arevalo, Durand, Diusaba. Et des huiles de Robert Ryan enveloppent l'ensemble. Un beau livre; vraiment. 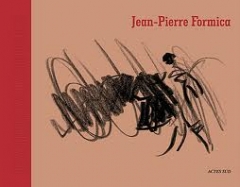 Le peintre Gardois Jean-Pierre Formica livre quant à lui ses Carnets taurins (Actes Sud, préface d'Alain Montcouquiol), réalisés à main levée pendant les corridas de Nîmes et d'ailleurs. Une sélection drastique de ses dix mille dessins à la craie et au fusain nous est proposée, qui choisit de traduire le mouvement, la durée, la retenue, l'instant où le temps semble se taire au détour d'une passe et au coeur de la chorégraphie particulière que livrent sous nos yeux un homme et un fauve. Il est question de geste dans ces dessins et du fameux silence sonore du toreo dont parlait le grand José Bergamin.
Le peintre Gardois Jean-Pierre Formica livre quant à lui ses Carnets taurins (Actes Sud, préface d'Alain Montcouquiol), réalisés à main levée pendant les corridas de Nîmes et d'ailleurs. Une sélection drastique de ses dix mille dessins à la craie et au fusain nous est proposée, qui choisit de traduire le mouvement, la durée, la retenue, l'instant où le temps semble se taire au détour d'une passe et au coeur de la chorégraphie particulière que livrent sous nos yeux un homme et un fauve. Il est question de geste dans ces dessins et du fameux silence sonore du toreo dont parlait le grand José Bergamin.
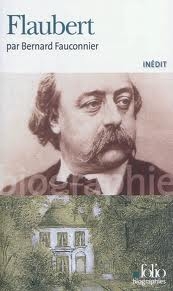 Voici une biographie, une vraie, signée Bernard Fauconnier, inédite et qui paraît directement en poche (folio) sur l'immense Flaubert. L'auteur avait déjà donné un Cézanne qui fut remarqué. Voici l'homme-livre décrit par le menu de l'oeuvre, chronologiquement, avec force documents, masse d'informations et dans un style captivant. On ne lâche pas ce petit bouquin une minute. Et l'envie de reprendre la Bovary, l'Education, les Trois contes, Salammbô et surtout la Correspondance est forte. Car Fauconnier nous prend par la main et nous fait cheminer à côté de Flaubert. Nous ressentons les atermoiements de Gustave, ses joies et ses peines, ses amitiés, ses déconvenues en amour et jusqu'à ses chaudepisses! Nous voyageons en Orient, nous allons par les champs et par les grèves en Normandie et ailleurs, nous compatissons pour lui lorsqu'il souffre de réécrire La tentation de Saint-Antoine, son obsession, lorsqu'il est couvert de lauriers ou bien de dettes, louangé ou bien laminé par une presse vengeresse ou encore vilipendé sournoisement par les précieux ridicules frères Goncourt. La maison de Croisset nous devient aussi familière que Louise Colet, George Sand,
Voici une biographie, une vraie, signée Bernard Fauconnier, inédite et qui paraît directement en poche (folio) sur l'immense Flaubert. L'auteur avait déjà donné un Cézanne qui fut remarqué. Voici l'homme-livre décrit par le menu de l'oeuvre, chronologiquement, avec force documents, masse d'informations et dans un style captivant. On ne lâche pas ce petit bouquin une minute. Et l'envie de reprendre la Bovary, l'Education, les Trois contes, Salammbô et surtout la Correspondance est forte. Car Fauconnier nous prend par la main et nous fait cheminer à côté de Flaubert. Nous ressentons les atermoiements de Gustave, ses joies et ses peines, ses amitiés, ses déconvenues en amour et jusqu'à ses chaudepisses! Nous voyageons en Orient, nous allons par les champs et par les grèves en Normandie et ailleurs, nous compatissons pour lui lorsqu'il souffre de réécrire La tentation de Saint-Antoine, son obsession, lorsqu'il est couvert de lauriers ou bien de dettes, louangé ou bien laminé par une presse vengeresse ou encore vilipendé sournoisement par les précieux ridicules frères Goncourt. La maison de Croisset nous devient aussi familière que Louise Colet, George Sand, 
 Martinez, et un bienvenu florilège de l'auteur de Bel-Ami, Contes au fil de l'eau (folio 2€) dans lequel un bonheur intact nous fait retrouver les pages denses de textes courts et forts comme Amour (in Le Horla) , Sur l'eau (extrait de Une partie de campagne), ou encore En mer (dans
Martinez, et un bienvenu florilège de l'auteur de Bel-Ami, Contes au fil de l'eau (folio 2€) dans lequel un bonheur intact nous fait retrouver les pages denses de textes courts et forts comme Amour (in Le Horla) , Sur l'eau (extrait de Une partie de campagne), ou encore En mer (dans  une peau m'incite à essayer d'écrire le goût de cette peau, la forme de mon désir, et le plaisir est grand de chercher, de trouver les mots pour décrire la chose minuscule et immense, l'élan de l'être. La narration du désir, y compris érotique, occupe cet essai sensuel dans les grandes largeurs. Comment édifier le bonheur à partir de notre connaissance du désastre? demande Cannone. Je crois la richesse de la langue miraculeuse, dit-elle. Grâce à elle, le mouvement d'écrire est une étreinte et une célébration. Même lorque les mots disent l'ombre, l'effroi et la souffrance.
une peau m'incite à essayer d'écrire le goût de cette peau, la forme de mon désir, et le plaisir est grand de chercher, de trouver les mots pour décrire la chose minuscule et immense, l'élan de l'être. La narration du désir, y compris érotique, occupe cet essai sensuel dans les grandes largeurs. Comment édifier le bonheur à partir de notre connaissance du désastre? demande Cannone. Je crois la richesse de la langue miraculeuse, dit-elle. Grâce à elle, le mouvement d'écrire est une étreinte et une célébration. Même lorque les mots disent l'ombre, l'effroi et la souffrance.  qui revigore l'esprit, notre mémoire des oeuvres, des dates, des pseudos d'écrivains, des Prix, des lieux, des personnages de romans, des incipit, du subjonctif imparfait... Tester ainsi ses connaissances littéraires est littéralement jouissif. On y joue comme avec un quizz ou avec un psycho-test sur la plage. Et l'on se casse parfois les dents avec un certain délice, si-si!
qui revigore l'esprit, notre mémoire des oeuvres, des dates, des pseudos d'écrivains, des Prix, des lieux, des personnages de romans, des incipit, du subjonctif imparfait... Tester ainsi ses connaissances littéraires est littéralement jouissif. On y joue comme avec un quizz ou avec un psycho-test sur la plage. Et l'on se casse parfois les dents avec un certain délice, si-si!  C'est fou ce que l'on peut changer quand même. Longtemps je n'ai pu supporter d’avoir un toit au-dessus de la tête, de me sentir prisonnier à l’intérieur avec des gens que cela ne gênait nullement, les fenêtres fermées, un silence confiné; voire du thé -tandis que la lumière du jour pouvait encore galvaniser tous mes sens. Question de musique et de mouvement. Peindre, selon Cézanne, c'est aussi écrire, danser, si j'en crois François Fédier et son admirable Ecouter voir
C'est fou ce que l'on peut changer quand même. Longtemps je n'ai pu supporter d’avoir un toit au-dessus de la tête, de me sentir prisonnier à l’intérieur avec des gens que cela ne gênait nullement, les fenêtres fermées, un silence confiné; voire du thé -tandis que la lumière du jour pouvait encore galvaniser tous mes sens. Question de musique et de mouvement. Peindre, selon Cézanne, c'est aussi écrire, danser, si j'en crois François Fédier et son admirable Ecouter voir
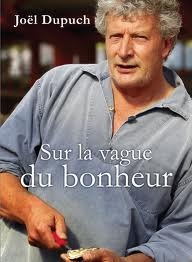 Oubliez un instant Jean-Louis-le-gars-des-huîtres-des-Petits-Mouchoirs, la marionnette un brin moralisatrice des Guignols, et penchez vous sur la belle leçon de vie, de courage, de bonheur, que donne cet homme, Joël Dupuch, ostréiculteur archi passionné par son métier et par le Bassin d’Arcachon –son jardin, et en particulier par sa cabane qui ouvre sur le Paradis selon lui-, en lisant, ou plutôt en avalant comme je viens de le faire cul-sec, son livre intitulé Sur la vague du bonheur (Michel Lafon). Je ne tairai pas (ce serait mentir et je sais pas faire), que Joël est un ami depuis plus de vingt-cinq ans, que j’habitais (dans les années 87-92) à deux pas de son bistrot de l’huître, Joël D., qui trônait rue des Piliers-de-Tutelle dans le Vieux Bordeaux tandis que je créchais rue des Faussets, que ses Quiberon n°3 sont depuis lors et pour toujours mes huîtres préférées (il me faudra goûter un jour ses Perles), qu’il a eu l’extrême gentillesse de me donner la parole à la page 45 de son livre, en reproduisant ce que j’ai écrit sur le mot Gascon dans mon bouquin Le Sud-Ouest vu par Léon Mazzella (Hugo & Cie) ; et que voilà.
Oubliez un instant Jean-Louis-le-gars-des-huîtres-des-Petits-Mouchoirs, la marionnette un brin moralisatrice des Guignols, et penchez vous sur la belle leçon de vie, de courage, de bonheur, que donne cet homme, Joël Dupuch, ostréiculteur archi passionné par son métier et par le Bassin d’Arcachon –son jardin, et en particulier par sa cabane qui ouvre sur le Paradis selon lui-, en lisant, ou plutôt en avalant comme je viens de le faire cul-sec, son livre intitulé Sur la vague du bonheur (Michel Lafon). Je ne tairai pas (ce serait mentir et je sais pas faire), que Joël est un ami depuis plus de vingt-cinq ans, que j’habitais (dans les années 87-92) à deux pas de son bistrot de l’huître, Joël D., qui trônait rue des Piliers-de-Tutelle dans le Vieux Bordeaux tandis que je créchais rue des Faussets, que ses Quiberon n°3 sont depuis lors et pour toujours mes huîtres préférées (il me faudra goûter un jour ses Perles), qu’il a eu l’extrême gentillesse de me donner la parole à la page 45 de son livre, en reproduisant ce que j’ai écrit sur le mot Gascon dans mon bouquin Le Sud-Ouest vu par Léon Mazzella (Hugo & Cie) ; et que voilà. 

 individuels, l'épaisseur des tranches de pain, l'embase des verres de margarita, la quadrature des lits, l'espace des chambres d'hôtel, la proéminence des ventres, la profondeur des fauteuils, la cuvette des toilettes, la visière des casquettes, la largeur des tables au restaurant, le volume des voitures et
individuels, l'épaisseur des tranches de pain, l'embase des verres de margarita, la quadrature des lits, l'espace des chambres d'hôtel, la proéminence des ventres, la profondeur des fauteuils, la cuvette des toilettes, la visière des casquettes, la largeur des tables au restaurant, le volume des voitures et 
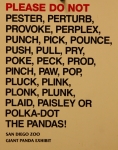 Marine- a établi ses quartiers les plus gigantesques des USA; avec trois autres confrères : une Italienne, un Espagnol et un Norvégien (invités par British Airways à tester la somptueuse nouvelle classe Premium à bord du vol Londres-San Diego. Cela est indécent, je sais).
Marine- a établi ses quartiers les plus gigantesques des USA; avec trois autres confrères : une Italienne, un Espagnol et un Norvégien (invités par British Airways à tester la somptueuse nouvelle classe Premium à bord du vol Londres-San Diego. Cela est indécent, je sais). bien rangé. Rien ne dépasse, à San Diego. L'ordre règne en silence et chaque activité a son espace dédié, y compris la promenade des chiens. Chacun cultive
bien rangé. Rien ne dépasse, à San Diego. L'ordre règne en silence et chaque activité a son espace dédié, y compris la promenade des chiens. Chacun cultive  son corps comme un jardin, circule gadgetisé, soit
son corps comme un jardin, circule gadgetisé, soit  public
public  mondialement connu, une Université prestigieuse... Mais le voyageur cherche l'âme dans tout cela, et échoue à la trouver. Sauf peut-être dans Little Italy, où l'on assiste à des scènes qui semblent empruntées à la série The Soprano, dans Old Town aussi, le San Diego mexicain (la frontière est à quelques kilomètres seulement, Tijuana à un quart d'heure de route) et ce malgré
mondialement connu, une Université prestigieuse... Mais le voyageur cherche l'âme dans tout cela, et échoue à la trouver. Sauf peut-être dans Little Italy, où l'on assiste à des scènes qui semblent empruntées à la série The Soprano, dans Old Town aussi, le San Diego mexicain (la frontière est à quelques kilomètres seulement, Tijuana à un quart d'heure de route) et ce malgré  les nombreuses boutiques de souvenirs et d'artisanat de pacotille, mais moins à Down Town, la ville moderne et son Waterfront garni de quelques gratte-ciel face à d'anciens bateaux, comme la goélette Star of India qui abrite un intéressant Musée de la Marine, deux ou trois sous-marins et le porte-avion Midway, reconverti en gigantesque musée. Pas davantage de supplément d'âme à La Jolla,
les nombreuses boutiques de souvenirs et d'artisanat de pacotille, mais moins à Down Town, la ville moderne et son Waterfront garni de quelques gratte-ciel face à d'anciens bateaux, comme la goélette Star of India qui abrite un intéressant Musée de la Marine, deux ou trois sous-marins et le porte-avion Midway, reconverti en gigantesque musée. Pas davantage de supplément d'âme à La Jolla, sorte de zone ouvertement huppée collée à la côte. A peine à Balboa, où de nombreux musées (admirables musée des Beaux-Arts, et de la Photo) ont investi les bâtiments baroques (façon Prado) des Expositions universelles de 1915 et 1935. Torrey Pines est plus sauvage, avec ses falaises et sa côte déchiquetée, à quelques kilomètres du centre et
sorte de zone ouvertement huppée collée à la côte. A peine à Balboa, où de nombreux musées (admirables musée des Beaux-Arts, et de la Photo) ont investi les bâtiments baroques (façon Prado) des Expositions universelles de 1915 et 1935. Torrey Pines est plus sauvage, avec ses falaises et sa côte déchiquetée, à quelques kilomètres du centre et  juste devant des bâtiments universitaires plutôt bien lotis, question environnement. L'avantage de San Diego est finalement d'être à la fois une immense ville aux dimensions suffisamment confortables pour que l'on ne s'y sente jamais oppressé (du coup, son côté suisse est moins palpable) est surtout sa proximité immédiate avec une côte sauvage et un arrière-pays qui l'est tout autant -lesquels procèdent du charme singulier de la cité.
juste devant des bâtiments universitaires plutôt bien lotis, question environnement. L'avantage de San Diego est finalement d'être à la fois une immense ville aux dimensions suffisamment confortables pour que l'on ne s'y sente jamais oppressé (du coup, son côté suisse est moins palpable) est surtout sa proximité immédiate avec une côte sauvage et un arrière-pays qui l'est tout autant -lesquels procèdent du charme singulier de la cité. 

 Pierre et Eliane Rolet sont des vignerons de légende dans le Jura. Leur Arbois 2007 Expression du terroir (30% de Savagnin et 70% de Chardonnay) élevé en petits fûts trois années durant, donne un blanc caractérisé par une robe dorée et luminescente. Le nez envoie de la noix au cerveau, de l'amande à peine fumée, de la compote de pommes de maman et des épices douces, jamais agressives, comme la cardamome. La bouche est d'une fraîcheur rare. Droite, elle reprend les flaveurs perçues au nez -ou qui lui sautèrent dessus-, en y ajoutant un rien de fruits confits bienvenu, une pointe exotique comme un soupçon d'esprit de curry. Ce vin est formidable sur un vieux comté de Marcel Petite affiné 36 mois. Et sur des noix fraîches en saison, bien sûr. L
Pierre et Eliane Rolet sont des vignerons de légende dans le Jura. Leur Arbois 2007 Expression du terroir (30% de Savagnin et 70% de Chardonnay) élevé en petits fûts trois années durant, donne un blanc caractérisé par une robe dorée et luminescente. Le nez envoie de la noix au cerveau, de l'amande à peine fumée, de la compote de pommes de maman et des épices douces, jamais agressives, comme la cardamome. La bouche est d'une fraîcheur rare. Droite, elle reprend les flaveurs perçues au nez -ou qui lui sautèrent dessus-, en y ajoutant un rien de fruits confits bienvenu, une pointe exotique comme un soupçon d'esprit de curry. Ce vin est formidable sur un vieux comté de Marcel Petite affiné 36 mois. Et sur des noix fraîches en saison, bien sûr. L



 Il n’y a pas que du vin en Champagne. Il y a aussi de l’eau. Il n’est qu’à citer le fameux lac du Der-Chantecoq, près de Saint-Dizier, l’un des plus grands lacs artificiels d’Europe avec près de 5000 ha en eau qui constitue un formidable réservoir de stockage des eaux de la Marne. Mais les lacs stars de Champagne, situés grosso modo entre Troyes et Saint-Dizier, occultent quelquefois des lacs et des étangs périphériques situées dans l’Aube, moins connus mais tout aussi riches en particulier d’une avifaune migratrice. Ainsi des lacs de la Forêt d’Orient et ceux du Temple-Auzon et d’Amance appartiennent-ils à ce patrimoine naturel exceptionnel. Cette « Champagne humide » a permis de constituer d’importants réservoirs de stockage de la Seine et de ses affluents, l’Aube et la Marne, afin de permettre aux Parisiens ne jamais manquer d’eau. Et lorsqu’ils manquent d’air, le Lac du Der et le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient, avec sa maison du parc située à Pinay, les attendent. La chance de ces sites est de se trouver sur l’un des plus importants couloirs migratoires de France et de permettre à de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau, à commencer par les grues cendrées
Il n’y a pas que du vin en Champagne. Il y a aussi de l’eau. Il n’est qu’à citer le fameux lac du Der-Chantecoq, près de Saint-Dizier, l’un des plus grands lacs artificiels d’Europe avec près de 5000 ha en eau qui constitue un formidable réservoir de stockage des eaux de la Marne. Mais les lacs stars de Champagne, situés grosso modo entre Troyes et Saint-Dizier, occultent quelquefois des lacs et des étangs périphériques situées dans l’Aube, moins connus mais tout aussi riches en particulier d’une avifaune migratrice. Ainsi des lacs de la Forêt d’Orient et ceux du Temple-Auzon et d’Amance appartiennent-ils à ce patrimoine naturel exceptionnel. Cette « Champagne humide » a permis de constituer d’importants réservoirs de stockage de la Seine et de ses affluents, l’Aube et la Marne, afin de permettre aux Parisiens ne jamais manquer d’eau. Et lorsqu’ils manquent d’air, le Lac du Der et le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient, avec sa maison du parc située à Pinay, les attendent. La chance de ces sites est de se trouver sur l’un des plus importants couloirs migratoires de France et de permettre à de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau, à commencer par les grues cendrées Les Palombières, de Rigal (château St Didier-Parnac) est un Côtes de Gascogne, 100% cabernet franc d’une franchise et d’une légèreté confondantes. Belle vinosité. Un rosé marqué par une grande fraîcheur aromatique. Nez délicat de petits fruits rouges. Jolie souplesse en bouche (2,90€ !).
Les Palombières, de Rigal (château St Didier-Parnac) est un Côtes de Gascogne, 100% cabernet franc d’une franchise et d’une légèreté confondantes. Belle vinosité. Un rosé marqué par une grande fraîcheur aromatique. Nez délicat de petits fruits rouges. Jolie souplesse en bouche (2,90€ !). Chez
Chez  Vallée de l’Aude. Rosé de pressurage direct subissant une fermentation très courte à 15° (pour les curieux). Belle robe pâle, nez de framboise et de cerise, bouche légèrement grasse. Fraîcheur intense.
Vallée de l’Aude. Rosé de pressurage direct subissant une fermentation très courte à 15° (pour les curieux). Belle robe pâle, nez de framboise et de cerise, bouche légèrement grasse. Fraîcheur intense.  Pour l’apéro avec du jambon espagnol.
Pour l’apéro avec du jambon espagnol. Le Jurançon de Cauhapé Noblesse du temps 2009 est une merveille de douceur et de vivacité, signée Henri Ramonteu. Le petit manseng s’exprime ici avec droiture et élégance, la palette aromatique va des fruits confits au miel et aux agrumes, c’est vigoureux et très long en bouche. La quintessence du jurançon comme nous l’aimons. Ni trop gras, ni trop liquoreux, juste vif et nerveux; équilibré en somme (28,50€).
Le Jurançon de Cauhapé Noblesse du temps 2009 est une merveille de douceur et de vivacité, signée Henri Ramonteu. Le petit manseng s’exprime ici avec droiture et élégance, la palette aromatique va des fruits confits au miel et aux agrumes, c’est vigoureux et très long en bouche. La quintessence du jurançon comme nous l’aimons. Ni trop gras, ni trop liquoreux, juste vif et nerveux; équilibré en somme (28,50€).  de nos Alsace préférés. Il est ici présenté dans le millésime 2007. Puissance, épices, sècheresse, radicalité et finesse, harmonie, compoté, fleurs blanches, fruits croquants (poire) sont les mots qui viennent pêle-mêle à l’esprit en goûtant ce gewurztraminer d'une grande noblesse, assurément (15,70€).
de nos Alsace préférés. Il est ici présenté dans le millésime 2007. Puissance, épices, sècheresse, radicalité et finesse, harmonie, compoté, fleurs blanches, fruits croquants (poire) sont les mots qui viennent pêle-mêle à l’esprit en goûtant ce gewurztraminer d'une grande noblesse, assurément (15,70€). Etonnants Cahors de la Maison Cantury ! Ils ne sont pas vraiment à la mode light, ces vins noirs d’une robe d’encre, profonde et d’une texture consistante, épaisse, capiteuse, voire lourde pour la cuvée Parenthèse. Les cuvées Paradoxe et Révélation sont à peine moins denses. Toutes expriment la richesse extraordinaire du malbec, sa plus pure expression, dans un souci de classicisme évident. Les trois terroirs –complémentaires- sont parmi les meilleurs de l’AOC. Les rendements sont faibles (le nombre de bouteilles est très limité) et la vinification millimétrée. Les tanins sont d’une rare finesse, le nez de ces trois vins est d’une grande expression : fruits noirs, moka, poivre, tabac, réglisse. L’identité minérale (délaissée) du malbec se révèle comme jamais sur Révélation. Quant à Parenthèse, cuvée ni collée ni filtrée, elle exprime avec vibration la puissance d’un vin vivant, mais jamais brutal. Une expérience (env.16€).
Etonnants Cahors de la Maison Cantury ! Ils ne sont pas vraiment à la mode light, ces vins noirs d’une robe d’encre, profonde et d’une texture consistante, épaisse, capiteuse, voire lourde pour la cuvée Parenthèse. Les cuvées Paradoxe et Révélation sont à peine moins denses. Toutes expriment la richesse extraordinaire du malbec, sa plus pure expression, dans un souci de classicisme évident. Les trois terroirs –complémentaires- sont parmi les meilleurs de l’AOC. Les rendements sont faibles (le nombre de bouteilles est très limité) et la vinification millimétrée. Les tanins sont d’une rare finesse, le nez de ces trois vins est d’une grande expression : fruits noirs, moka, poivre, tabac, réglisse. L’identité minérale (délaissée) du malbec se révèle comme jamais sur Révélation. Quant à Parenthèse, cuvée ni collée ni filtrée, elle exprime avec vibration la puissance d’un vin vivant, mais jamais brutal. Une expérience (env.16€).  Le Mas Amiel Vintage Blanc 2009 est d’une délicatesse confondante. Ce vin doux naturel remet le grenache gris au goût du jour. Sa robe blonde, son nez d’agrumes doux, sa bouche fraîche et minérale (sols schisteux), en font un vin qui a du claquant (16,50€).
Le Mas Amiel Vintage Blanc 2009 est d’une délicatesse confondante. Ce vin doux naturel remet le grenache gris au goût du jour. Sa robe blonde, son nez d’agrumes doux, sa bouche fraîche et minérale (sols schisteux), en font un vin qui a du claquant (16,50€).  Le VDN (vin doux naturel) de Rasteau Signature 2007, avec sa robe grenat, son nez de fruits rouges confits, de cacao, d’épices comme la cardamome et la muscade, exprime la grenache (100%, vieilles vignes) avec vigueur et douceur à la fois. C’est à la fois soyeux et frais (11,70€).
Le VDN (vin doux naturel) de Rasteau Signature 2007, avec sa robe grenat, son nez de fruits rouges confits, de cacao, d’épices comme la cardamome et la muscade, exprime la grenache (100%, vieilles vignes) avec vigueur et douceur à la fois. C’est à la fois soyeux et frais (11,70€). l’Hermitage (Drôme), exprime d'exceptionnelles syrah. Nez frais, épices douces, tabac blond, olive noire, réglissé leger, puissance et souplesse et léger cacaoté en arrière-bouche (15,40€).
l’Hermitage (Drôme), exprime d'exceptionnelles syrah. Nez frais, épices douces, tabac blond, olive noire, réglissé leger, puissance et souplesse et léger cacaoté en arrière-bouche (15,40€). Le Crémant brut rosé de la Cave des Vignerons de Pfaffeinheim, 100% pinot noir, doit être fier d’avoir été confondu avec des champagnes bruts dont nous tairons le nom, ici. C’était pour jouer, comme nous aimons le faire souvent avec des amis. Belle robe saumon, mousse fine, cordon délicat, fruits rouges frais en bouche, belle longueur, assez persistante. Une réussite (10€).
Le Crémant brut rosé de la Cave des Vignerons de Pfaffeinheim, 100% pinot noir, doit être fier d’avoir été confondu avec des champagnes bruts dont nous tairons le nom, ici. C’était pour jouer, comme nous aimons le faire souvent avec des amis. Belle robe saumon, mousse fine, cordon délicat, fruits rouges frais en bouche, belle longueur, assez persistante. Une réussite (10€).  légèrement moutardée, voici un vin surprenant et d’une fraîcheur magique : le Muscat première mise 2011 de la Cave de Pfaffeinheim (Haut-Rhin). Un miracle de fraîcheur, en effet, et de fruité délicat. Parfait, donc, sur de grosses asperges blanches des Landes, comme sur des petites vertes sauvages, maigres et tordues. Une alliance imprévue et efficace (7,20€).
légèrement moutardée, voici un vin surprenant et d’une fraîcheur magique : le Muscat première mise 2011 de la Cave de Pfaffeinheim (Haut-Rhin). Un miracle de fraîcheur, en effet, et de fruité délicat. Parfait, donc, sur de grosses asperges blanches des Landes, comme sur des petites vertes sauvages, maigres et tordues. Une alliance imprévue et efficace (7,20€).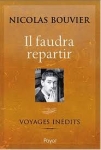 De Nicolas Bouvier, L’Usage du monde (PBP) est devenue la bible, le bréviaire du voyageur et du travel-writer. Voici que Payot nous donne des voyages inédits, avec un titre magnifique : Il faudra repartir, dont Cendrars aurait pu être jaloux. J’y ai retenu les pages admirables sur l’Algérie, que Bouvier traverse en 1958. Sa perception fine du petit peuple d’Oran, très Espagnol, très Juif aussi, constamment mêlé aux Arabes, laisse à penser que d’aucuns, dans ces années-là, auraient été bien inspirés d’écouter un observateur comme l’auteur du Journal d’Aran, dire qu’ici, les choses peuvent s’arranger, à cause des sangs mêlés justement. Mais il s’agit de melting-pot davantage que de métissage. En cela, Jules Roy avait raison de dire que là-bas, on était tous frères, mais rarement beaux-frères… Très belles pages également sur la Chine, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l’Indonésie.
De Nicolas Bouvier, L’Usage du monde (PBP) est devenue la bible, le bréviaire du voyageur et du travel-writer. Voici que Payot nous donne des voyages inédits, avec un titre magnifique : Il faudra repartir, dont Cendrars aurait pu être jaloux. J’y ai retenu les pages admirables sur l’Algérie, que Bouvier traverse en 1958. Sa perception fine du petit peuple d’Oran, très Espagnol, très Juif aussi, constamment mêlé aux Arabes, laisse à penser que d’aucuns, dans ces années-là, auraient été bien inspirés d’écouter un observateur comme l’auteur du Journal d’Aran, dire qu’ici, les choses peuvent s’arranger, à cause des sangs mêlés justement. Mais il s’agit de melting-pot davantage que de métissage. En cela, Jules Roy avait raison de dire que là-bas, on était tous frères, mais rarement beaux-frères… Très belles pages également sur la Chine, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l’Indonésie. Dans la même veine de ces écrivains-reporters-observateurs, capables de décrire un simple fait divers, une scène de rue a priori ordinaire et d’en faire un moment de littérature, prenez Vu sur la mer, de Jean Rolin (La Table ronde / La petite vermillon), recueil de reportages donnés à Lui, Libération, Géo… L’auteur nous embarque sur le fleuve Congo et nous pensons au Cœur des ténèbres de Conrad, bien sûr, il nous propulse à Singapour parmi des pirates, nous fait voyager à bord d’un port-conteneur depuis St-Louis-du-Rhône, Camargue, ou bien d’un autre bateau semblable, le Ville de Bordeaux qui croise en Mer Rouge, il nous décrit « les voyageurs de l’amer »; et c’est chaque fois un ravissement. La prose de grand vent -salé, cette fois- de Rolin sonne juste, car elle est forte comme un rhum cul-sec.
Dans la même veine de ces écrivains-reporters-observateurs, capables de décrire un simple fait divers, une scène de rue a priori ordinaire et d’en faire un moment de littérature, prenez Vu sur la mer, de Jean Rolin (La Table ronde / La petite vermillon), recueil de reportages donnés à Lui, Libération, Géo… L’auteur nous embarque sur le fleuve Congo et nous pensons au Cœur des ténèbres de Conrad, bien sûr, il nous propulse à Singapour parmi des pirates, nous fait voyager à bord d’un port-conteneur depuis St-Louis-du-Rhône, Camargue, ou bien d’un autre bateau semblable, le Ville de Bordeaux qui croise en Mer Rouge, il nous décrit « les voyageurs de l’amer »; et c’est chaque fois un ravissement. La prose de grand vent -salé, cette fois- de Rolin sonne juste, car elle est forte comme un rhum cul-sec. Cela n’a rien à voir, mais le Guide de poche des oiseaux de France (Seuil / Points2) est un microscopique ouvrage d’ornithologie très précisément illustré et qui est extrêmement fiable, car fondé sur les données irréprochables contenues dans les fameux guides du naturaliste des éditions Delachaux & Niestlé. 200 espèces d’oiseaux des jardins, des forêts, des bords de mer… y sont habilement décrits. Indispensable (à glisser dans le jean d'un gamin dont vous ne voulez plus qu'il vous dise : tous les oiseaux se ressemblent)...
Cela n’a rien à voir, mais le Guide de poche des oiseaux de France (Seuil / Points2) est un microscopique ouvrage d’ornithologie très précisément illustré et qui est extrêmement fiable, car fondé sur les données irréprochables contenues dans les fameux guides du naturaliste des éditions Delachaux & Niestlé. 200 espèces d’oiseaux des jardins, des forêts, des bords de mer… y sont habilement décrits. Indispensable (à glisser dans le jean d'un gamin dont vous ne voulez plus qu'il vous dise : tous les oiseaux se ressemblent)...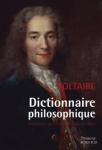
 Relire Voltaire : le Dictionnaire philosophique (Actes Sud / Thesaurus) présenté par Béatrice Didier, l’inoxydable Candide ou l'optimisme –illustré par Quentin Blake (folio, édition anniversaire) est un bonheur auquel on ne s’attend pas. Génie, virtuosité, pensée leste et fine, phrase profonde et « enlevée », notre penseur des Lumières –à l’heure où l’on fête Rousseau- demeure un homme de polémique, de réflexion et de combat philosophique inévitable, encore aujourd’hui. Il faut lire son Dictionnaire comme un manifeste de la liberté de pensée. Il n’a pas pris une ride et si, par endroits, certains faits et commentaires semblent dater quelque peu, il faut les prendre comme on lit Saint-Simon ; en déconnectant le fil historique pour projeter le fait dans l’éternel. Jouissives lectures.
Relire Voltaire : le Dictionnaire philosophique (Actes Sud / Thesaurus) présenté par Béatrice Didier, l’inoxydable Candide ou l'optimisme –illustré par Quentin Blake (folio, édition anniversaire) est un bonheur auquel on ne s’attend pas. Génie, virtuosité, pensée leste et fine, phrase profonde et « enlevée », notre penseur des Lumières –à l’heure où l’on fête Rousseau- demeure un homme de polémique, de réflexion et de combat philosophique inévitable, encore aujourd’hui. Il faut lire son Dictionnaire comme un manifeste de la liberté de pensée. Il n’a pas pris une ride et si, par endroits, certains faits et commentaires semblent dater quelque peu, il faut les prendre comme on lit Saint-Simon ; en déconnectant le fil historique pour projeter le fait dans l’éternel. Jouissives lectures.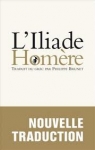 Homère ! Points nous offre l'édition en poche d'une nouvelle traduction de L’Iliade, absolument moderne. Replonger dans nos lectures (obligées) de l’enfance, avec un œil un brin vieilli, est un coup de fouet, un coup de jeune, un plongeon dans l’eau glacée de Biarritz un matin de décembre. L’immersion dans cette épopée unique de 15 500 vers en 24 chants, d’une architecture admirable, d’une immortelle poésie et d’un souffle romanesque à côté duquel même les grands auteurs Russes semblent avoir attrapé l’asthme de Proust -apparaît même nécessaire. Philippe Brunet est l’auteur de cette adaptation salutaire. Grâce lui soit rendue.
Homère ! Points nous offre l'édition en poche d'une nouvelle traduction de L’Iliade, absolument moderne. Replonger dans nos lectures (obligées) de l’enfance, avec un œil un brin vieilli, est un coup de fouet, un coup de jeune, un plongeon dans l’eau glacée de Biarritz un matin de décembre. L’immersion dans cette épopée unique de 15 500 vers en 24 chants, d’une architecture admirable, d’une immortelle poésie et d’un souffle romanesque à côté duquel même les grands auteurs Russes semblent avoir attrapé l’asthme de Proust -apparaît même nécessaire. Philippe Brunet est l’auteur de cette adaptation salutaire. Grâce lui soit rendue.
 Parmi les classiques modernes, citons les rééditions « collector » du Gatsby de F.S.Fitzgerald (dans la traduction inédite de Philippe Jaworski qui figurera dans l’édition de La Pléiade) et d’Exercices de style, de Queneau, dans une nouvelle édition enrichie d’exercices plus ou moins inédits (folio), parce qu'elles nous obligent avec tact et délicatesse à reprendre des textes enfouis dans notre mémoire. Idem pour La route, de Kerouac, sauf qu’il s’agit du « rouleau » original
Parmi les classiques modernes, citons les rééditions « collector » du Gatsby de F.S.Fitzgerald (dans la traduction inédite de Philippe Jaworski qui figurera dans l’édition de La Pléiade) et d’Exercices de style, de Queneau, dans une nouvelle édition enrichie d’exercices plus ou moins inédits (folio), parce qu'elles nous obligent avec tact et délicatesse à reprendre des textes enfouis dans notre mémoire. Idem pour La route, de Kerouac, sauf qu’il s’agit du « rouleau » original 
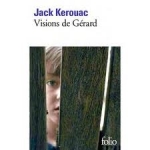 (adapté au cinéma : sortie le 23 mai), donc non censuré, que nous découvrons, histoire de se refaire un trip beat generation en essayant de retrouver des passages clés de ce gros road-novel mythique (folio) enrichi d'une floppée de textes de présentation (le roman ne débute qu'à la page 154!). A lire aussi Visions de Gérard, du même Jack Kerouac (folio), car il s’agit d’un texte très émouvant, qui évoque la mort du propre frère de l’auteur à l’âge de neuf ans. Méconnu et précieux.
(adapté au cinéma : sortie le 23 mai), donc non censuré, que nous découvrons, histoire de se refaire un trip beat generation en essayant de retrouver des passages clés de ce gros road-novel mythique (folio) enrichi d'une floppée de textes de présentation (le roman ne débute qu'à la page 154!). A lire aussi Visions de Gérard, du même Jack Kerouac (folio), car il s’agit d’un texte très émouvant, qui évoque la mort du propre frère de l’auteur à l’âge de neuf ans. Méconnu et précieux. Enfin, une note poétique avec les Chants berbères de Kabylie (édition bilingue, Points/poésie) qui fut concoctée par Jean Amrouche, poète algérien disparu en 1962. Il évoque avec justesse une parenté de cette poésie souvent anonyme, avec le chant profond (le cante jondo) andalou : l’appartenance ontologique à un peuple, une solidarité étroite de destin, et par conséquent une poésie forte. Essentielle.
Enfin, une note poétique avec les Chants berbères de Kabylie (édition bilingue, Points/poésie) qui fut concoctée par Jean Amrouche, poète algérien disparu en 1962. Il évoque avec justesse une parenté de cette poésie souvent anonyme, avec le chant profond (le cante jondo) andalou : l’appartenance ontologique à un peuple, une solidarité étroite de destin, et par conséquent une poésie forte. Essentielle. 



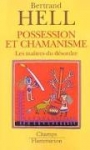
 Si l’on souhaite seulement découvrir à vélo et seuls cette forêt de 15000ha, de 100 km de circonférence (comme Paris) et de 2000 km de chemins balisés, empruntez la Voie verte (ouverte donc aux rollers, poussettes et autres roulettes), soit une piste cyclable de 50 km, qui fait une boucle et sur laquelle on pédale tranquillou au milieu d’une splendide forêt.
Si l’on souhaite seulement découvrir à vélo et seuls cette forêt de 15000ha, de 100 km de circonférence (comme Paris) et de 2000 km de chemins balisés, empruntez la Voie verte (ouverte donc aux rollers, poussettes et autres roulettes), soit une piste cyclable de 50 km, qui fait une boucle et sur laquelle on pédale tranquillou au milieu d’une splendide forêt. La côte sauvage irlandaise, du côté du Ring of Kerry, a la magie des îles du Nord, vertes et pourtant si rudes. Cette côte déchiquetée qu’on longe en voiture et qu’une mer d’Irlande qui a englouti tant de navires bat froid, possède l’attirance violente des femmes renardes. Mi-ange, mi-démon, la côte irlandaise aimante. Rien n’est plus vivifiant que se réveiller de bonne heure et de partir marcher dans la campagne irlandaise, n’importe où dans les moors (étendues de bruyère), et les tourbières (prévoir des bottes) entre deux bushes (buissons épais), emmitouflé dans une veste imperméable (la pluie irlandaise ignore les saisons). Le ring of Kerry est cependant bien ensoleillé et l’arrière printemps y est propice à toutes sortes d’activités de plein vent : équitation, golf, pêche à la mouche, observation des oiseaux… L’idée est de séjourner à Waterville et de rayonner autour de ce village calme de bord de mer où Charlie Chaplin aimait passer ses vacances en famille, au Butler Arms Hôtel. Waterville est baignée, comme chaque village irlandais, par l’odeur âcre et légèrement goudronnée de la tourbe qui flambe lentement dans chaque cheminée. Les habitants de Waterville se retrouvent le soir au Pub, notamment au Lobster’s Pub, pour savourer un hot whiskey (avec un « e ») et disputer une partie de fléchettes, ou revoir un match de rugby en buvant lentement une pinte de Guinness. La bière brune symbolise cette Irlande « rough », taiseuse et sauvage. Sa mousse si douce, couleur ventre de bécasse, à la fraîcheur idéale (la servir glacée est une hérésie) et d’une onctuosité de chantilly, résume la sérénité d’une fin de journée passée à pêcher, à monter à cheval ou simplement à se promener le long de
La côte sauvage irlandaise, du côté du Ring of Kerry, a la magie des îles du Nord, vertes et pourtant si rudes. Cette côte déchiquetée qu’on longe en voiture et qu’une mer d’Irlande qui a englouti tant de navires bat froid, possède l’attirance violente des femmes renardes. Mi-ange, mi-démon, la côte irlandaise aimante. Rien n’est plus vivifiant que se réveiller de bonne heure et de partir marcher dans la campagne irlandaise, n’importe où dans les moors (étendues de bruyère), et les tourbières (prévoir des bottes) entre deux bushes (buissons épais), emmitouflé dans une veste imperméable (la pluie irlandaise ignore les saisons). Le ring of Kerry est cependant bien ensoleillé et l’arrière printemps y est propice à toutes sortes d’activités de plein vent : équitation, golf, pêche à la mouche, observation des oiseaux… L’idée est de séjourner à Waterville et de rayonner autour de ce village calme de bord de mer où Charlie Chaplin aimait passer ses vacances en famille, au Butler Arms Hôtel. Waterville est baignée, comme chaque village irlandais, par l’odeur âcre et légèrement goudronnée de la tourbe qui flambe lentement dans chaque cheminée. Les habitants de Waterville se retrouvent le soir au Pub, notamment au Lobster’s Pub, pour savourer un hot whiskey (avec un « e ») et disputer une partie de fléchettes, ou revoir un match de rugby en buvant lentement une pinte de Guinness. La bière brune symbolise cette Irlande « rough », taiseuse et sauvage. Sa mousse si douce, couleur ventre de bécasse, à la fraîcheur idéale (la servir glacée est une hérésie) et d’une onctuosité de chantilly, résume la sérénité d’une fin de journée passée à pêcher, à monter à cheval ou simplement à se promener le long de  la côte. Les nombreux lacs et rivières avec des pools (parcours de remontée) de la région sont réputés dans toute l’Europe. La pêche ouvre mi-janvier et ferme fin septembre. Les lacs comme Lough Currane, Lough Deriana, Lough Cloonaghlin ou Lough Namona sont riches de saumons et de truites de mer. Remonter la Cummeragh river est un autre plaisir de « moucheur ». On peut aussi pêcher en mer, ou bien depuis le rivage. Une sortie jusqu’à l’île de Valentia est conseillée. Là-bas, vous aurez l’impression d’être revenu au temps des Vikings. Autour de Waterville, une virée à Killorglin –gros bourg traversé par la Luane river, riche en truites farios-, est souhaitable, au moins pour d’autres balades dans les bushes, sur les landes de tourbe infinies. Pour les amateurs de golf, c’est un paradis. Les lacs y sont nombreux et la pêche une activité courante. On peut aussi acheter son saumon fumé directement à la fumerie locale de Killorglin. A deux pas, le restaurant Nicks propose une cuisine marine et des bordeaux à prix plancher. Tralee Barrow et Killarney sont des destinations de la même eau : à fond nature et avec des pubs chaleureux pour les retours de balades « roots » et humides. Car un plaisir singulier est de s’exténuer dehors, puis de s’affaler devant un feu de tourbe, d’ôter ses bottes et de les regarder fumer tandis que nous nous repassons le film de la journée.
la côte. Les nombreux lacs et rivières avec des pools (parcours de remontée) de la région sont réputés dans toute l’Europe. La pêche ouvre mi-janvier et ferme fin septembre. Les lacs comme Lough Currane, Lough Deriana, Lough Cloonaghlin ou Lough Namona sont riches de saumons et de truites de mer. Remonter la Cummeragh river est un autre plaisir de « moucheur ». On peut aussi pêcher en mer, ou bien depuis le rivage. Une sortie jusqu’à l’île de Valentia est conseillée. Là-bas, vous aurez l’impression d’être revenu au temps des Vikings. Autour de Waterville, une virée à Killorglin –gros bourg traversé par la Luane river, riche en truites farios-, est souhaitable, au moins pour d’autres balades dans les bushes, sur les landes de tourbe infinies. Pour les amateurs de golf, c’est un paradis. Les lacs y sont nombreux et la pêche une activité courante. On peut aussi acheter son saumon fumé directement à la fumerie locale de Killorglin. A deux pas, le restaurant Nicks propose une cuisine marine et des bordeaux à prix plancher. Tralee Barrow et Killarney sont des destinations de la même eau : à fond nature et avec des pubs chaleureux pour les retours de balades « roots » et humides. Car un plaisir singulier est de s’exténuer dehors, puis de s’affaler devant un feu de tourbe, d’ôter ses bottes et de les regarder fumer tandis que nous nous repassons le film de la journée. Fallait-il panthéonniser un fasciste collabo, antisémite, xénophobe, misogyne, habité par une névrose de l'échec qui le conduisit au suicide en 1945 -doublé d'un admirable styliste dont les romans désabusés et les nouvelles désinvoltes écrites de la main d'un séducteur un brin nihiliste continuent de ravir de jeunes lecteurs?
Fallait-il panthéonniser un fasciste collabo, antisémite, xénophobe, misogyne, habité par une névrose de l'échec qui le conduisit au suicide en 1945 -doublé d'un admirable styliste dont les romans désabusés et les nouvelles désinvoltes écrites de la main d'un séducteur un brin nihiliste continuent de ravir de jeunes lecteurs? En somme, je dis (répète) juste ici qu'il convient toujours de distinguer l'homme de l'oeuvre. Sinon, qui lirait Céline ou Hamsun?
En somme, je dis (répète) juste ici qu'il convient toujours de distinguer l'homme de l'oeuvre. Sinon, qui lirait Céline ou Hamsun?
 premier mai, de 11h à 20h.
premier mai, de 11h à 20h. 









 génie disparu en 2005. Ou bien en s’allongeant en pleine forêt sur un tapis d’aiguilles de pins et de fougères, le regard planté à la cime des arbres qui dansent. Il suffit alors de fermer les yeux pour confondre, comme le faisait François Mauriac, le bruissement permanent du vent dans les branches avec celui de l’océan. Le
génie disparu en 2005. Ou bien en s’allongeant en pleine forêt sur un tapis d’aiguilles de pins et de fougères, le regard planté à la cime des arbres qui dansent. Il suffit alors de fermer les yeux pour confondre, comme le faisait François Mauriac, le bruissement permanent du vent dans les branches avec celui de l’océan. Le 
 Bordelais Mauriac n’aimait rien comme planter ses fictions dans l’âpre lande : le village d’Argelouse est à jamais marqué par « Thérèse Desqueyroux », l’un de ses plus célèbres romans(Livre de poche). Montaigne, qui voyageait à cheval, a nourri ses « Essais » (Arléa) de centaines de chevauchées à travers les Landes. Il vante même les mérites des sources thermales de Préchacq-les-Bains dans son œuvre-vie. Jean-Paul Kauffmann a donné un livre magnifique, « La maison du retour » (folio), qui raconte comment il choisit justement de s’établir de temps à autre en forêt, à Pissos. Plus bas, on peut se promener du côté d’Onesse-et-Laharie, à la recherche de la maison des sœurs de Rivoyre, échouer à la trouver et relire « Le petit matin » (Grasset), de Christine, « la Colette des Landes », au café du coin. Les Landes, c’est la place centrale de Mont-de-Marsan à l’ouverture du premier café que l’on prend en pensant aux frères Boni : Guy et André Boniface, rugbymen de légende. Un stade porte leur nom à Montfort-en-Chalosse. Denis Lalanne, qui donna comme son ami Antoine Blondin des papiers « de garde » à « L’Equipe », écrivit un livre hommage
Bordelais Mauriac n’aimait rien comme planter ses fictions dans l’âpre lande : le village d’Argelouse est à jamais marqué par « Thérèse Desqueyroux », l’un de ses plus célèbres romans(Livre de poche). Montaigne, qui voyageait à cheval, a nourri ses « Essais » (Arléa) de centaines de chevauchées à travers les Landes. Il vante même les mérites des sources thermales de Préchacq-les-Bains dans son œuvre-vie. Jean-Paul Kauffmann a donné un livre magnifique, « La maison du retour » (folio), qui raconte comment il choisit justement de s’établir de temps à autre en forêt, à Pissos. Plus bas, on peut se promener du côté d’Onesse-et-Laharie, à la recherche de la maison des sœurs de Rivoyre, échouer à la trouver et relire « Le petit matin » (Grasset), de Christine, « la Colette des Landes », au café du coin. Les Landes, c’est la place centrale de Mont-de-Marsan à l’ouverture du premier café que l’on prend en pensant aux frères Boni : Guy et André Boniface, rugbymen de légende. Un stade porte leur nom à Montfort-en-Chalosse. Denis Lalanne, qui donna comme son ami Antoine Blondin des papiers « de garde » à « L’Equipe », écrivit un livre hommage 
 aux frangins : « Le temps des Boni » (La petite vermillon). Il vit aujourd’hui paisiblement à Hossegor. Le lire, c’est retrouver le rugby rustique de village, où les déménageurs de pianos sont plus nombreux que les joueurs du même instrument. Un autre écrivain journaliste parti trop tôt (en 2004), Patrick Espagnet, de Grignols (plus haut dans les Landes girondines), possédait une plume forgée à l’ovale. Ses nouvelles : « Les Noirs », « La Gueuze », « XV histoires de rugby » (Culture Suds), sont des chefs-d’œuvre du genre. Les Landes, ce sont ces belles fermes à colombages avec leurs murs à briquettes en forme de fougère, qui se dressent
aux frangins : « Le temps des Boni » (La petite vermillon). Il vit aujourd’hui paisiblement à Hossegor. Le lire, c’est retrouver le rugby rustique de village, où les déménageurs de pianos sont plus nombreux que les joueurs du même instrument. Un autre écrivain journaliste parti trop tôt (en 2004), Patrick Espagnet, de Grignols (plus haut dans les Landes girondines), possédait une plume forgée à l’ovale. Ses nouvelles : « Les Noirs », « La Gueuze », « XV histoires de rugby » (Culture Suds), sont des chefs-d’œuvre du genre. Les Landes, ce sont ces belles fermes à colombages avec leurs murs à briquettes en forme de fougère, qui se dressent  grassement sur leur airial. La plus emblématique se trouve au sein du Parc régional de Marquèze, à Sabres, où l’ombre tutélaire de Félix Arnaudin, l’écrivain photographe un brin ethnographe, plane comme un milan royal en maraude. Les clichés d’Arnaudin sont aussi précieux que ses recueils de contes (Confluences). L’un d’eux montre un
grassement sur leur airial. La plus emblématique se trouve au sein du Parc régional de Marquèze, à Sabres, où l’ombre tutélaire de Félix Arnaudin, l’écrivain photographe un brin ethnographe, plane comme un milan royal en maraude. Les clichés d’Arnaudin sont aussi précieux que ses recueils de contes (Confluences). L’un d’eux montre un 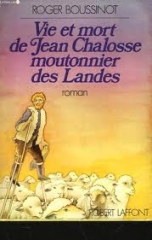
 jeune berger, Bergerot au Pradeou, dressé dans l’immensité plate comme la main. Et évoque le tendre roman de Roger Boussinot, « Vie et mort de Jean Chalosse, moutonnier des Landes » (Livre de poche).
jeune berger, Bergerot au Pradeou, dressé dans l’immensité plate comme la main. Et évoque le tendre roman de Roger Boussinot, « Vie et mort de Jean Chalosse, moutonnier des Landes » (Livre de poche).  enfin les inoubliables passages de Julien
enfin les inoubliables passages de Julien 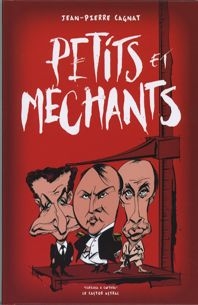 Jean-Pierre Cagnat*, talentueux croqueur, caricaturiste, dessinateur de presse reconnu (Le Monde, L'Express, VSD, etc), signe un petit livre délicieux et de circonstance (électorale) : Petits et méchants (Le Castor astral) et il vient de recevoir le Grand Prix de l'Humour Noir Grandville (qui récompense un dessinateur) au restaurant parisien Le Procope le 13 mars dernier pour ce petit bouquin caustique qui taille un short aux tyranneaux qui ont gouverné ou qui continuent de gouverner certaines parties du monde (mais jusqu'à quelle heure?). En couverture : Sarkozy, Napoléon, Poutine. Cagnat n'est pas de droite. Ca tombe bien, nous non plus. Sous la couverture, figurent, en dessins, tous les petits despotes, dont Cagnat donne srcupuleusement la taille réelle (en centimètres, donc) : Hitler, Lénine, Staline, Khrouchtchev, Kim-Il-Sung, Kim-Jong-Il, Hiro Hito, Gengis Kahn, Attila, Louis XIV, Goebbels... C'est fou ce qu'ils étaient petits, ces grand dictateurs et dictateurs-adjoints! Mais Cagnat ne s'arrête pas là, pensez! Il renifle le petit méchant du côté des stars aussi : Sade, Hitchcock (ah bon, il était méchant, lui?), Charles Manson (1,57m contre 1,62 pour Polanski : OK)... Il n'oublie pas non plus les nains libidineux de Blanche-Neige, Pépin Le Bref, les bouffons des rois de France, les couples de taille inégale (l'histoire les collectionne), les chanteurs (Little Richard, Prince : pourquoi?). Enfin, ce petit livre dessiné au vitriol noir & blanc s'attaque aux grands : De Gaulle, Raspoutine, Ben Laden, Saddam Hussein (1,88m : on aurait pas dit, hein?). Et enfin aux petits gentils : Woody Allen, Charlie Chaplin, Groucho Marx, Beethoven, Mozart, Picasso, Toulouse-Lautrec, Balzac, Gandhi... Un
Jean-Pierre Cagnat*, talentueux croqueur, caricaturiste, dessinateur de presse reconnu (Le Monde, L'Express, VSD, etc), signe un petit livre délicieux et de circonstance (électorale) : Petits et méchants (Le Castor astral) et il vient de recevoir le Grand Prix de l'Humour Noir Grandville (qui récompense un dessinateur) au restaurant parisien Le Procope le 13 mars dernier pour ce petit bouquin caustique qui taille un short aux tyranneaux qui ont gouverné ou qui continuent de gouverner certaines parties du monde (mais jusqu'à quelle heure?). En couverture : Sarkozy, Napoléon, Poutine. Cagnat n'est pas de droite. Ca tombe bien, nous non plus. Sous la couverture, figurent, en dessins, tous les petits despotes, dont Cagnat donne srcupuleusement la taille réelle (en centimètres, donc) : Hitler, Lénine, Staline, Khrouchtchev, Kim-Il-Sung, Kim-Jong-Il, Hiro Hito, Gengis Kahn, Attila, Louis XIV, Goebbels... C'est fou ce qu'ils étaient petits, ces grand dictateurs et dictateurs-adjoints! Mais Cagnat ne s'arrête pas là, pensez! Il renifle le petit méchant du côté des stars aussi : Sade, Hitchcock (ah bon, il était méchant, lui?), Charles Manson (1,57m contre 1,62 pour Polanski : OK)... Il n'oublie pas non plus les nains libidineux de Blanche-Neige, Pépin Le Bref, les bouffons des rois de France, les couples de taille inégale (l'histoire les collectionne), les chanteurs (Little Richard, Prince : pourquoi?). Enfin, ce petit livre dessiné au vitriol noir & blanc s'attaque aux grands : De Gaulle, Raspoutine, Ben Laden, Saddam Hussein (1,88m : on aurait pas dit, hein?). Et enfin aux petits gentils : Woody Allen, Charlie Chaplin, Groucho Marx, Beethoven, Mozart, Picasso, Toulouse-Lautrec, Balzac, Gandhi... Un  Pierre Schoendoerffer est
Pierre Schoendoerffer est  Les jours rallongent et les jupes raccourcissent. Les mimosas fleurissent. En ville comme à la campagne, les palombes paradent vertigineusement : les mâles montent au ciel, planent et se laissent tomber. Ils aiment sans frein. Les femelles ne regardent même pas. C’est nuptial. Tout vibre, le merle chante plus tôt, ça bourgeonne. Envie printanière d’un œuf brouillé au beurre marin, aujourd’hui. De respirer à fond en ouvrant les fenêtres sur le monde. Bonheur de sortir tôt. Dans la rue, l’air est imprégné d’odeurs chaudes de viennoiserie. Je frôle une bourgeoise tracée au Samsara. Aspergée, plutôt. Les pas sont pressants. Le pays s’éveille. Au marché proche, les primeurs débarquent des cageots verts d’asperges et rouges de fraises. Le poissonnier étale les poissons d’avril sur la glace brisée. La vita e bella…
Les jours rallongent et les jupes raccourcissent. Les mimosas fleurissent. En ville comme à la campagne, les palombes paradent vertigineusement : les mâles montent au ciel, planent et se laissent tomber. Ils aiment sans frein. Les femelles ne regardent même pas. C’est nuptial. Tout vibre, le merle chante plus tôt, ça bourgeonne. Envie printanière d’un œuf brouillé au beurre marin, aujourd’hui. De respirer à fond en ouvrant les fenêtres sur le monde. Bonheur de sortir tôt. Dans la rue, l’air est imprégné d’odeurs chaudes de viennoiserie. Je frôle une bourgeoise tracée au Samsara. Aspergée, plutôt. Les pas sont pressants. Le pays s’éveille. Au marché proche, les primeurs débarquent des cageots verts d’asperges et rouges de fraises. Le poissonnier étale les poissons d’avril sur la glace brisée. La vita e bella… veste. Il en va du canif au fond du pantalon comme de la fiasque. Si par mégarde nous l’oublions, il ou elle nous manque terriblement, alors même que nous n’en avons aucun usage. Rien à couper au couteau : ennui, saucisson, brouillard ? Le canif manque quand même au toucher. La main tâtonne désespérément l’absence. Nous nous sentons nus. Plus seul. Les affaires intimes ne sont pas à une incongruité près : c’est toujours « entre soi » que l’on aime sentir le canif dans la poche et la fiasque, là. Calée. C’est seul aussi que l’on a le plus de plaisir à ouvrir l’un et à déboucher l’autre. Oublions l’arme blanche. Chromée, chiffrée, guillochée, gainée ou non, galbée pour épouser le cœur (elle, au moins…), voilà pour le contenant de l’objet. Mettez ce que vous voulez dedans. C’est une question, capitale, de parfum. Tout alcool plongé dans une fiasque subit une pression subjective de base qui le propulse aussitôt près des Dieux. L’important, on l’aura deviné, est de dévisser l’objet et de sniffer. Boire est inutile.
veste. Il en va du canif au fond du pantalon comme de la fiasque. Si par mégarde nous l’oublions, il ou elle nous manque terriblement, alors même que nous n’en avons aucun usage. Rien à couper au couteau : ennui, saucisson, brouillard ? Le canif manque quand même au toucher. La main tâtonne désespérément l’absence. Nous nous sentons nus. Plus seul. Les affaires intimes ne sont pas à une incongruité près : c’est toujours « entre soi » que l’on aime sentir le canif dans la poche et la fiasque, là. Calée. C’est seul aussi que l’on a le plus de plaisir à ouvrir l’un et à déboucher l’autre. Oublions l’arme blanche. Chromée, chiffrée, guillochée, gainée ou non, galbée pour épouser le cœur (elle, au moins…), voilà pour le contenant de l’objet. Mettez ce que vous voulez dedans. C’est une question, capitale, de parfum. Tout alcool plongé dans une fiasque subit une pression subjective de base qui le propulse aussitôt près des Dieux. L’important, on l’aura deviné, est de dévisser l’objet et de sniffer. Boire est inutile. Il fait jour. Il fait jouir. Vos yeux embrasent, embrassent l’espace. Imaginez le plaisir de capter, à l’aurore, les parfums complexes d’une poire, au moment délicieux où le monde part bosser, et de faire alors une pause au-delà du réel, au-dessus de la mêlée qui fait la queue ou qui ahane, embouteillée et pendue à ses portables, et vous bien calé sur une motte d’illusions, un bouquet de paresse dans le dos, accoudé au comptoir du temps suspendu. Même pas dans ce rade habituel où vous avez votre ardoise. Loin! Fermez les yeux un instant –en attendant le bus, le feu vert, l’ascenseur, une augmentation, un rendez-vous gâlon, et partez ! Moi, cela m’expédie illico à 2000 mètres d’altitude, au bord d’un lac connu de quelques isards complices, et je sens une truite prendre la mouche au bout de ma soie. La poire récompense une belle prise (c’est dire si l’on est à l’abri de l’ébriété, en montagne). Le salaire de l’approche, c’est ma fiasque qui me le remet en mains propres et en liquide. Mais d’abord, par le nez, je m’octroie licence de flairer le goulot comme on respire une fleur, un cou adoré; un enfant sa mère. L’éducation du coût des choses vraies passe par là. Le bonheur est dans l'à peu près. Dans le près. Encore plus près... Approche-toi, n'aies pas peur. Comprenne qui boira. Ou bas. L.M.
Il fait jour. Il fait jouir. Vos yeux embrasent, embrassent l’espace. Imaginez le plaisir de capter, à l’aurore, les parfums complexes d’une poire, au moment délicieux où le monde part bosser, et de faire alors une pause au-delà du réel, au-dessus de la mêlée qui fait la queue ou qui ahane, embouteillée et pendue à ses portables, et vous bien calé sur une motte d’illusions, un bouquet de paresse dans le dos, accoudé au comptoir du temps suspendu. Même pas dans ce rade habituel où vous avez votre ardoise. Loin! Fermez les yeux un instant –en attendant le bus, le feu vert, l’ascenseur, une augmentation, un rendez-vous gâlon, et partez ! Moi, cela m’expédie illico à 2000 mètres d’altitude, au bord d’un lac connu de quelques isards complices, et je sens une truite prendre la mouche au bout de ma soie. La poire récompense une belle prise (c’est dire si l’on est à l’abri de l’ébriété, en montagne). Le salaire de l’approche, c’est ma fiasque qui me le remet en mains propres et en liquide. Mais d’abord, par le nez, je m’octroie licence de flairer le goulot comme on respire une fleur, un cou adoré; un enfant sa mère. L’éducation du coût des choses vraies passe par là. Le bonheur est dans l'à peu près. Dans le près. Encore plus près... Approche-toi, n'aies pas peur. Comprenne qui boira. Ou bas. L.M.

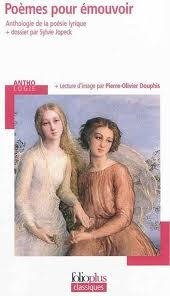 émouvoir
émouvoir
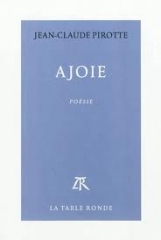
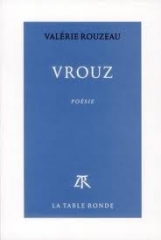
 Volga, un vin de chien. Déjà, le nom frappe. Le visuel de l’étiquette emboîte la patte. Pop, voyons-boire : il s’agit d’un vin de pays (des Corbières) sans pompons ni chichis, élaboré par Jean-Noël Bousquet, qui ne manque pas d’humour. Volga, mascotte de son domaine, le château Grand Moulin (déjà évoqué dans ses pages), se voit donc honoré. Le vin est agréable (50% syrah, 30% carignan, 20% grenache : classique), il passe un an en cuve. Nous avons goûté ce 2010 avec plaisir. Pour 4,50€, on ne peut pas lui demander d’aller chercher la lune, mais Volga a un certain chien, une belle clarté aux mirettes, des fruits rouges frais en truffe et un brin de longueur en gueule aussi. « Apporte !.. »
Volga, un vin de chien. Déjà, le nom frappe. Le visuel de l’étiquette emboîte la patte. Pop, voyons-boire : il s’agit d’un vin de pays (des Corbières) sans pompons ni chichis, élaboré par Jean-Noël Bousquet, qui ne manque pas d’humour. Volga, mascotte de son domaine, le château Grand Moulin (déjà évoqué dans ses pages), se voit donc honoré. Le vin est agréable (50% syrah, 30% carignan, 20% grenache : classique), il passe un an en cuve. Nous avons goûté ce 2010 avec plaisir. Pour 4,50€, on ne peut pas lui demander d’aller chercher la lune, mais Volga a un certain chien, une belle clarté aux mirettes, des fruits rouges frais en truffe et un brin de longueur en gueule aussi. « Apporte !.. »
 membre de leur confrérie depuis 1991 ou 92, mais je ne devrais pas le dire… Encore que l’on jure, lors de n’importe quelle intronisation, de devenir l’ambassadeur du produit qui vous accueille). Alors, après tout...
membre de leur confrérie depuis 1991 ou 92, mais je ne devrais pas le dire… Encore que l’on jure, lors de n’importe quelle intronisation, de devenir l’ambassadeur du produit qui vous accueille). Alors, après tout... distribution comme les deux autres), des Grands Cyprès 2010 de Gabriel Meffre, travaillé en agriculture raisonnée (8€), et du domaine de la Brunerie, Tradition 2010 (8,80€) -lequel a notre préférence.
distribution comme les deux autres), des Grands Cyprès 2010 de Gabriel Meffre, travaillé en agriculture raisonnée (8€), et du domaine de la Brunerie, Tradition 2010 (8,80€) -lequel a notre préférence. (grenache, syrah, mourvèdre), primé ici et là (mais étant parfois membre de jurys de dégustation, je n’attache guère d’importance aux médailles –celles-ci comme toutes les autres), est un superbe rouge à la robe profonde et au nez épicé, de fruits rouges mûrs, avec un côté cuir assez sauvage, qui en fait un vin de gibier. Il est puissant mais sait se calmer si nous l’ouvrons vingt minutes avant (10,30€).
(grenache, syrah, mourvèdre), primé ici et là (mais étant parfois membre de jurys de dégustation, je n’attache guère d’importance aux médailles –celles-ci comme toutes les autres), est un superbe rouge à la robe profonde et au nez épicé, de fruits rouges mûrs, avec un côté cuir assez sauvage, qui en fait un vin de gibier. Il est puissant mais sait se calmer si nous l’ouvrons vingt minutes avant (10,30€). Singla, cuvée La Matine. Goûté en 2009, ce vin de négoce conduit en agriculture biologique (signé Le Comptoir Familial des Vins, de Laurence et Laurent de Besombes Singla) possède une finesse remarquable qui pourrait être prise pour de la légèreté, à l’attaque en bouche, eu égard à l’appellation. Or il n’en est rien, avec ses 80% de syrah et 20% de grenache noir, sa belle longueur corpulente mais soyeuse, ce flacon est un régal sur des grillades d'agneau ou de canard (6,50€).
Singla, cuvée La Matine. Goûté en 2009, ce vin de négoce conduit en agriculture biologique (signé Le Comptoir Familial des Vins, de Laurence et Laurent de Besombes Singla) possède une finesse remarquable qui pourrait être prise pour de la légèreté, à l’attaque en bouche, eu égard à l’appellation. Or il n’en est rien, avec ses 80% de syrah et 20% de grenache noir, sa belle longueur corpulente mais soyeuse, ce flacon est un régal sur des grillades d'agneau ou de canard (6,50€).![Icone-RVB-300-DPI-JPEG[1].jpg](http://leonmazzella.hautetfort.com/media/02/02/3884124149.jpg)
 délicieusement fruité (fruits jaunes et blancs du verger), mais toujours sec. Un bel effervescent d’apéritif (à 14,50€) qui fait la nique à pas mal de champagnes bruts de base que je ne nommerai pas. Il est signé Jaillance, comme cet autre effervescent, une Clairette de Die cette fois, issue de muscat, donc un blanc pétillant et doux qui se marie avec le chocolat comme les carrés noirs de Valhrôna par exemple. Nez de tilleul, de verveine et de litchi. Bouche légèrement mentholée. Un effervescent de dessert par définition (14,50€). Les deux cuvées se nomment Icône.
délicieusement fruité (fruits jaunes et blancs du verger), mais toujours sec. Un bel effervescent d’apéritif (à 14,50€) qui fait la nique à pas mal de champagnes bruts de base que je ne nommerai pas. Il est signé Jaillance, comme cet autre effervescent, une Clairette de Die cette fois, issue de muscat, donc un blanc pétillant et doux qui se marie avec le chocolat comme les carrés noirs de Valhrôna par exemple. Nez de tilleul, de verveine et de litchi. Bouche légèrement mentholée. Un effervescent de dessert par définition (14,50€). Les deux cuvées se nomment Icône. domaine au restaurant Les Tablettes, de Jean-Louis Nomicos (Paris 16). Je confirme : la Grande Réserve rosé 2011 de La Rouillère (en magnum, je
domaine au restaurant Les Tablettes, de Jean-Louis Nomicos (Paris 16). Je confirme : la Grande Réserve rosé 2011 de La Rouillère (en magnum, je  précise), avec sa belle robe pâle, son nez de pêche et de petits fruits rouges, sa pointe à la fois mentholée et poivrée, est un rosé de caractère qui tranche avec la production locale de la Presqu’île dont il est issu. D’ailleurs, cela « fonctionna » bien avec le dessert, composé de poires confites et brioches croustillantes, sorbet citron vanille. À noter la belle tenue du Grande Réserve blanc du même domaine sur un millefeuille de foie gras et de champignons de Paris crus, ainsi que sur un œuf poché au potimarron, émulsion de parmesan et truffe noire; un ensemble d’une onctuosité confondante.
précise), avec sa belle robe pâle, son nez de pêche et de petits fruits rouges, sa pointe à la fois mentholée et poivrée, est un rosé de caractère qui tranche avec la production locale de la Presqu’île dont il est issu. D’ailleurs, cela « fonctionna » bien avec le dessert, composé de poires confites et brioches croustillantes, sorbet citron vanille. À noter la belle tenue du Grande Réserve blanc du même domaine sur un millefeuille de foie gras et de champignons de Paris crus, ainsi que sur un œuf poché au potimarron, émulsion de parmesan et truffe noire; un ensemble d’une onctuosité confondante.
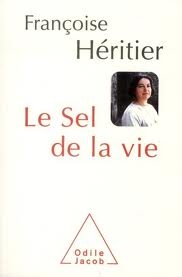 C'est un petit livre touchant, qui vous atteint au plus profond, comme le "Je me souviens" de Pérec a pu nous atteindre, ainsi que le fameux jeu de Barthes sur "j'aime - j'aime pas".
C'est un petit livre touchant, qui vous atteint au plus profond, comme le "Je me souviens" de Pérec a pu nous atteindre, ainsi que le fameux jeu de Barthes sur "j'aime - j'aime pas". 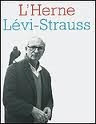 quelques jours, qui fut l'époux de Françoise Héritier,
quelques jours, qui fut l'époux de Françoise Héritier,  C'est l'année Klimt : ça ne se rate pas, si l'on aime ce peintre génial. Et l'occasion d'aller voir plus de toiles du maître Gustav Klimt qu'il n'y en a jamais eu à Vienne, est aussi celle de contempler l'oeuvre de son disciple Egon Schiele (sans Klimt, pas de Schiele). Pour cela seulement, et à condition d'admirer l'un et l'autre peintres, le voyage est indispensable en 2012 (rendez vous aux musées Leopold et Belvedere, principalement). Vienne, c'est aussi se faire plaisir en revoyant des toiles fétiches, un petit Friedrich ici, un Velasquez là. Cette ville musée, qui est aussi celle du bon café,
C'est l'année Klimt : ça ne se rate pas, si l'on aime ce peintre génial. Et l'occasion d'aller voir plus de toiles du maître Gustav Klimt qu'il n'y en a jamais eu à Vienne, est aussi celle de contempler l'oeuvre de son disciple Egon Schiele (sans Klimt, pas de Schiele). Pour cela seulement, et à condition d'admirer l'un et l'autre peintres, le voyage est indispensable en 2012 (rendez vous aux musées Leopold et Belvedere, principalement). Vienne, c'est aussi se faire plaisir en revoyant des toiles fétiches, un petit Friedrich ici, un Velasquez là. Cette ville musée, qui est aussi celle du bon café,  du bon chocolat et des bars à vins, est également le repaire d'une certaine mémoire littéraire que l'on s'efforce de chercher en flânant dans les rues, en traînant dans les cafés (certains ont conservé
du bon chocolat et des bars à vins, est également le repaire d'une certaine mémoire littéraire que l'on s'efforce de chercher en flânant dans les rues, en traînant dans les cafés (certains ont conservé 
 tombai en arrêt, littéralement, devant ma peinture préférée à cette époque et dont j'avais une copie à l'échelle 1 dans ma chambre d'adolescent -nous vivions ensemble, en quelque sorte (il s'agit des "Chasseurs dans la neige", de Bruegel) et comme j'ignorais que l'original se trouvait là, ce me fut un choc pictural énorme. Revoir ce tableau la semaine dernière fut forcément moins terrible. De même, tandis qu'on cherche dans la nuit viennoise et dans un dédale de ruelles un bon Heurige (taverne à vins), tomber
tombai en arrêt, littéralement, devant ma peinture préférée à cette époque et dont j'avais une copie à l'échelle 1 dans ma chambre d'adolescent -nous vivions ensemble, en quelque sorte (il s'agit des "Chasseurs dans la neige", de Bruegel) et comme j'ignorais que l'original se trouvait là, ce me fut un choc pictural énorme. Revoir ce tableau la semaine dernière fut forcément moins terrible. De même, tandis qu'on cherche dans la nuit viennoise et dans un dédale de ruelles un bon Heurige (taverne à vins), tomber
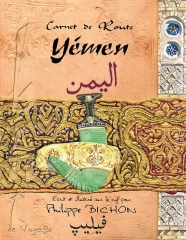 Il s'agit d'un énorme travail, d'une somme, d'une sensibilité avant tout, d'une poésie
Il s'agit d'un énorme travail, d'une somme, d'une sensibilité avant tout, d'une poésie 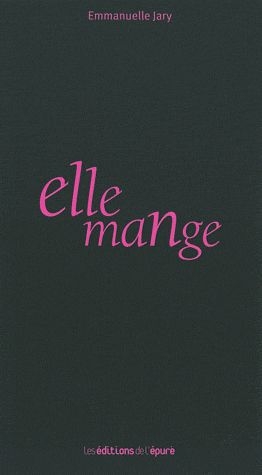
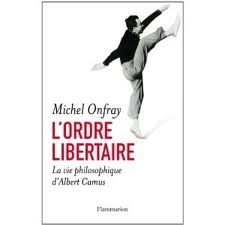
 On ne s’y attend pas. Claude Simon (disparu il y a six ans et demi), dans le texte d’une conférence qu’il donna en 1980 sur Proust, intitulée "Le poisson cathédrale", (in "Quatre conférences"
On ne s’y attend pas. Claude Simon (disparu il y a six ans et demi), dans le texte d’une conférence qu’il donna en 1980 sur Proust, intitulée "Le poisson cathédrale", (in "Quatre conférences"



 Jean-Baptiste Pontalis (dites J.-B. pour ne pas passer pour un plouc à Saint-Germain-des-Près, ou bien dans n'importe quel dîner en ville de province) poursuit la publication, en petits volumes, de son autobiographie fragmentée. Au rythme d'un livre par an en moyenne, nous avons les faits marquants, les séances d'analyse mémorables, les événements personnels, amoureux,
Jean-Baptiste Pontalis (dites J.-B. pour ne pas passer pour un plouc à Saint-Germain-des-Près, ou bien dans n'importe quel dîner en ville de province) poursuit la publication, en petits volumes, de son autobiographie fragmentée. Au rythme d'un livre par an en moyenne, nous avons les faits marquants, les séances d'analyse mémorables, les événements personnels, amoureux, 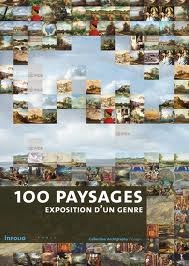 Il s'agit d'un album dont l'originalité est d'être parvenu à rassembler soixante spécialistes de la lecture du paysage dans la peinture occidentale. 100 Paysages, Exposition d'un genre (éditions infolio) nous donne à voir cent oeuvres éclairées par cent textes (sur cent doubles pages), signés de noms prestigieux comme ceux de Serge Briffaud, Michel Butor, Yves Hersant, Jean-Pierre Le Dantec
Il s'agit d'un album dont l'originalité est d'être parvenu à rassembler soixante spécialistes de la lecture du paysage dans la peinture occidentale. 100 Paysages, Exposition d'un genre (éditions infolio) nous donne à voir cent oeuvres éclairées par cent textes (sur cent doubles pages), signés de noms prestigieux comme ceux de Serge Briffaud, Michel Butor, Yves Hersant, Jean-Pierre Le Dantec  Que n'ai-je découvert plus tôt la chronique saint-simonienne et d'un sarcasme drôle, talentueux et très documenté, que Patrick Rambaud (Prix Goncourt pour La Bataille en 1997, mais aussi et entre plus de quarante ouvrages, auteur du Roland Barthes sans peine, et de Virginie Q., signé Marguerite Duraille...), distille avec succès chez Grasset : j'ai avalé cette Cinquième chronique du règne de Nicolas Ier
Que n'ai-je découvert plus tôt la chronique saint-simonienne et d'un sarcasme drôle, talentueux et très documenté, que Patrick Rambaud (Prix Goncourt pour La Bataille en 1997, mais aussi et entre plus de quarante ouvrages, auteur du Roland Barthes sans peine, et de Virginie Q., signé Marguerite Duraille...), distille avec succès chez Grasset : j'ai avalé cette Cinquième chronique du règne de Nicolas Ier 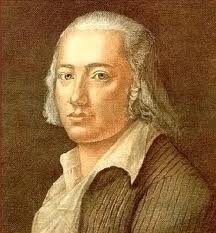 A la terrasse d'un café, je feuillette des magazines. Les pages de rédaction consacrées à la mode et les pages de publicité pour des marques de prêt-à-porter ne montrent que des personnages à la plastique parfaite, mais qui transportent avec une étrange ostentation une morgue terrifiante, au fond de leurs regards vides. L'absence totale du moindre sourire me fait froid dans le dos. Ces robocops de studio-photo semblent nés sans muscles zygomatiques. Ces visages profondément apathiques sont le reflet de notre temps, qui peine à jouir, voire à rire; à peine. Et de la météo du jour aussi -il ne fait pas froid que dans le dos. Malgré nous, le goût de vivre, et celui même d'exister s'amenuisent. Cela sèche imperceptiblement comme flaque au soleil. L'esprit d'innocence s'étiole, la fraîcheur de l'enfance fait la brasse coulée en chacun de nous, l'humour est en berne et la joie d'être au monde m'apparaît en jachère commandée par un moisi ambiant. Je reprends un quotidien que je n'ai pas eu le temps de lire. J'y trouve une phrase lumineuse, sertie dans l'adresse donnée par François Hollande à Libé, le 3 janvier, comme on tombe sur un bouquet de primevères au jaune pâle mais éclatant en cherchant des cèpes dans un sous-bois : L'espérance : je veux retrouver le rêve français. Celui qui permet à la génération qui vient de mieux vivre que la nôtre. Ces mots simples me bouleversent, sans doute parce que ma sensibilité se trouve ponctuellement (hy)perméable. Je souhaite tant que mes enfants connaissent le bonheur simple et l'insouciance solaire de leurs grands-parents. Je voudrais tant qu'ils vivent la jeunesse radieuse de mes parents, comme je l'ai seulement ressentie, gamin, plein d'une immense joie contemplative. Je repense au poème Ressouvenir, de Hölderlin (photo) -Apprendre, c'est se ressouvenir de ce que l'on avait oublié, me chuchote au passage Socrate-, car il s'achève par ces mots "en bleu adorable" :
A la terrasse d'un café, je feuillette des magazines. Les pages de rédaction consacrées à la mode et les pages de publicité pour des marques de prêt-à-porter ne montrent que des personnages à la plastique parfaite, mais qui transportent avec une étrange ostentation une morgue terrifiante, au fond de leurs regards vides. L'absence totale du moindre sourire me fait froid dans le dos. Ces robocops de studio-photo semblent nés sans muscles zygomatiques. Ces visages profondément apathiques sont le reflet de notre temps, qui peine à jouir, voire à rire; à peine. Et de la météo du jour aussi -il ne fait pas froid que dans le dos. Malgré nous, le goût de vivre, et celui même d'exister s'amenuisent. Cela sèche imperceptiblement comme flaque au soleil. L'esprit d'innocence s'étiole, la fraîcheur de l'enfance fait la brasse coulée en chacun de nous, l'humour est en berne et la joie d'être au monde m'apparaît en jachère commandée par un moisi ambiant. Je reprends un quotidien que je n'ai pas eu le temps de lire. J'y trouve une phrase lumineuse, sertie dans l'adresse donnée par François Hollande à Libé, le 3 janvier, comme on tombe sur un bouquet de primevères au jaune pâle mais éclatant en cherchant des cèpes dans un sous-bois : L'espérance : je veux retrouver le rêve français. Celui qui permet à la génération qui vient de mieux vivre que la nôtre. Ces mots simples me bouleversent, sans doute parce que ma sensibilité se trouve ponctuellement (hy)perméable. Je souhaite tant que mes enfants connaissent le bonheur simple et l'insouciance solaire de leurs grands-parents. Je voudrais tant qu'ils vivent la jeunesse radieuse de mes parents, comme je l'ai seulement ressentie, gamin, plein d'une immense joie contemplative. Je repense au poème Ressouvenir, de Hölderlin (photo) -Apprendre, c'est se ressouvenir de ce que l'on avait oublié, me chuchote au passage Socrate-, car il s'achève par ces mots "en bleu adorable" :  Fragments élaborent une perception fondamentale -au sens propre- de l'Univers : le monde est créé par le feu et, en lui, il se dissout. Le devenir est une lutte de contraires et tout s'écoule comme un fleuve. Héraclite avait une appréhension des éléments qui paraît aujourd'hui étrange, ou seulement poétique : le feu, en se consumant, se mouille, en s'épaisissant, il devient eau, quand l'eau se coagule, elle se change en terre, constate-t-il et écrit-il. Un traducteur emblématique d'Héraclite, Yves Battistini, appelle Héraclite l'homme à l'habit de lumière dans le temple de l'Ombre (Parenthèse : quel torero ne rêverait-il pas d'être ainsi désigné?..).
Fragments élaborent une perception fondamentale -au sens propre- de l'Univers : le monde est créé par le feu et, en lui, il se dissout. Le devenir est une lutte de contraires et tout s'écoule comme un fleuve. Héraclite avait une appréhension des éléments qui paraît aujourd'hui étrange, ou seulement poétique : le feu, en se consumant, se mouille, en s'épaisissant, il devient eau, quand l'eau se coagule, elle se change en terre, constate-t-il et écrit-il. Un traducteur emblématique d'Héraclite, Yves Battistini, appelle Héraclite l'homme à l'habit de lumière dans le temple de l'Ombre (Parenthèse : quel torero ne rêverait-il pas d'être ainsi désigné?..).  la mort elle aussi est une vie. Heidegger consacrera un livre à l'Obscur Ephésien et un autre au Romantique allemand devenu fou et reclus à Tübingen. Heidegger fera d'ailleurs sien le fragment fameux : Il faut aussi se souvenir de celui qui oublie le chemin (voir le livre de Heidegger intitulé Chemins qui ne mènent nulle part). Enfin, en bâtissant son oeuvre, Char aura toujours les Fragments d'Héraclite suspendus au-dessus de lui comme une étoile : La foudre pilote (ou gouverne) l'univers, dit Héraclite. Char le prolonge avec : L'éclair me dure. La traduction des Fragments par Frédéric Roussille (aux éd. Findakly) continue de faire pousser une oeuvre de base qui fait partie des fondations de la maison et qui, de surcroît, ne se détériorera pas au fil des siècles, y compris en terre volcanique...
la mort elle aussi est une vie. Heidegger consacrera un livre à l'Obscur Ephésien et un autre au Romantique allemand devenu fou et reclus à Tübingen. Heidegger fera d'ailleurs sien le fragment fameux : Il faut aussi se souvenir de celui qui oublie le chemin (voir le livre de Heidegger intitulé Chemins qui ne mènent nulle part). Enfin, en bâtissant son oeuvre, Char aura toujours les Fragments d'Héraclite suspendus au-dessus de lui comme une étoile : La foudre pilote (ou gouverne) l'univers, dit Héraclite. Char le prolonge avec : L'éclair me dure. La traduction des Fragments par Frédéric Roussille (aux éd. Findakly) continue de faire pousser une oeuvre de base qui fait partie des fondations de la maison et qui, de surcroît, ne se détériorera pas au fil des siècles, y compris en terre volcanique...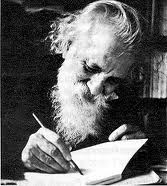 Gaston Bachelard restera le poéticien le plus sensible, le philosophe de la poésie et du rêve le plus accessible du XXème siècle. Ses célèbres travaux sur L'eau et les songes ou sur La poétique de la rêverie, chefs-d'oeuvre de limpidité, sont des invitations au voyage dans la tête du poète. Dans La flamme d'une chandelle par exemple (son oeuvre, en format de poche, est chez Corti et aux Puf), Bachelard donne à contempler le plus simplement du monde une flamme solitaire, tandis que lui s'abandonne à l'imagination sur les rêveries. Tout rêveur de flamme est un poète en puissance, écrit-il. C'est aussi un monde pour les solitaires; un monde secret et silencieux qui unit la solitude de la flamme à celle de l'homme. Grâce à la flamme, la solitude du rêveur n'est plus la solitude du vide, ajoute Bachelard.
Gaston Bachelard restera le poéticien le plus sensible, le philosophe de la poésie et du rêve le plus accessible du XXème siècle. Ses célèbres travaux sur L'eau et les songes ou sur La poétique de la rêverie, chefs-d'oeuvre de limpidité, sont des invitations au voyage dans la tête du poète. Dans La flamme d'une chandelle par exemple (son oeuvre, en format de poche, est chez Corti et aux Puf), Bachelard donne à contempler le plus simplement du monde une flamme solitaire, tandis que lui s'abandonne à l'imagination sur les rêveries. Tout rêveur de flamme est un poète en puissance, écrit-il. C'est aussi un monde pour les solitaires; un monde secret et silencieux qui unit la solitude de la flamme à celle de l'homme. Grâce à la flamme, la solitude du rêveur n'est plus la solitude du vide, ajoute Bachelard.  s'il n'y a aucun clair-obscur dans la langue de feu (doux) de Bachelard. Pour l'écrivain, et du même coup pour l'auteur en train de rédiger l'ouvrage que nous tenons entre les mains, la chandelle est
s'il n'y a aucun clair-obscur dans la langue de feu (doux) de Bachelard. Pour l'écrivain, et du même coup pour l'auteur en train de rédiger l'ouvrage que nous tenons entre les mains, la chandelle est  lampe, flamme mouillée, la lumière qui, les soirs de solitude, étend ses ailes dans la chambre (Léon-Paul Fargue) devient à la fois l'ombre et la compagne du rêveur solitaire, qu'il soit un angoissé de la page blanche ou un mégalomane éclairé. Par la lampe, un bonheur de lumière s'imprègne, dans la chambre du rêveur, écrit Bachelard. Et dans la marge, rayé, le reste de l'humanité n'est qu'une armée de moucheurs de chandelles. C'est l'ennemie du rêve qui veille... Cela fait de La flamme d'une chandelle un livre fragile qui résiste au vent de la mode.
lampe, flamme mouillée, la lumière qui, les soirs de solitude, étend ses ailes dans la chambre (Léon-Paul Fargue) devient à la fois l'ombre et la compagne du rêveur solitaire, qu'il soit un angoissé de la page blanche ou un mégalomane éclairé. Par la lampe, un bonheur de lumière s'imprègne, dans la chambre du rêveur, écrit Bachelard. Et dans la marge, rayé, le reste de l'humanité n'est qu'une armée de moucheurs de chandelles. C'est l'ennemie du rêve qui veille... Cela fait de La flamme d'une chandelle un livre fragile qui résiste au vent de la mode.




 Pas mal de poches, surtout des folio et des Poésie/Gallimard, dégustés ces jours-ci. A commencer par l'anthologie personnelle de Philippe Jaccottet, immense poète que j'adore et que je lis et relis depuis 34 ans déjà. Cela s'appelle L'encre serait de l'ombre, notes, proses et poèmes (1946-2008) choisis par l'auteur, et si vous n'avez qu'un livre à acheter du poète de Grignan, grand traducteur par ailleurs, prenez celui-ci. 560 pages de bonheur poétique absolu. Dans la même collection Poésie de Gallimard, citons Mon beau navire, ô ma
Pas mal de poches, surtout des folio et des Poésie/Gallimard, dégustés ces jours-ci. A commencer par l'anthologie personnelle de Philippe Jaccottet, immense poète que j'adore et que je lis et relis depuis 34 ans déjà. Cela s'appelle L'encre serait de l'ombre, notes, proses et poèmes (1946-2008) choisis par l'auteur, et si vous n'avez qu'un livre à acheter du poète de Grignan, grand traducteur par ailleurs, prenez celui-ci. 560 pages de bonheur poétique absolu. Dans la même collection Poésie de Gallimard, citons Mon beau navire, ô ma mémoire, sous-titré Un siècle de poésie française. C'est une anthologie plutôt bien ficelée, de belle facture : honnête et pas scolaire, avec son content de grands classiques et sa dose de modernité, mais où l'on trouve, à l'instar d'une arête dans le poisson (je chipote, je sais) un poème de Rilke, qui était né à Praque et de langue allemande (mais il est vrai qu'il écrivit en français ses dernières oeuvres, notamment
mémoire, sous-titré Un siècle de poésie française. C'est une anthologie plutôt bien ficelée, de belle facture : honnête et pas scolaire, avec son content de grands classiques et sa dose de modernité, mais où l'on trouve, à l'instar d'une arête dans le poisson (je chipote, je sais) un poème de Rilke, qui était né à Praque et de langue allemande (mais il est vrai qu'il écrivit en français ses dernières oeuvres, notamment  Vergers, dont est extrait le poème choisi dans la présente anthologie -et traduit d'ailleurs par Jaccottet). Mention spéciale (en Poésie/Gallimard, toujours) à l'oeuvre complète magnifique (1954-2004) du Nobel 2011, le grand poète suédois Tomas Tranströmer, Baltiques, car il s'agit vraiment d'une formidable découverte.
Vergers, dont est extrait le poème choisi dans la présente anthologie -et traduit d'ailleurs par Jaccottet). Mention spéciale (en Poésie/Gallimard, toujours) à l'oeuvre complète magnifique (1954-2004) du Nobel 2011, le grand poète suédois Tomas Tranströmer, Baltiques, car il s'agit vraiment d'une formidable découverte. 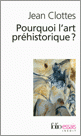
 plus, titre très derridien que Etienne Bimbenet donne à ce copieux et souvent ardu (mais passionnant de bout en bout) essai sur l'origine animale de l'homme -pour faire très court. En clair, l'homme est un animal humain. Et le rapport de l'homme à l'animal, dans cette étude philosophique, va bien au-delà de l'éthologie.
plus, titre très derridien que Etienne Bimbenet donne à ce copieux et souvent ardu (mais passionnant de bout en bout) essai sur l'origine animale de l'homme -pour faire très court. En clair, l'homme est un animal humain. Et le rapport de l'homme à l'animal, dans cette étude philosophique, va bien au-delà de l'éthologie.  Philippe Sollers continue de compiler pour notre bonheur ses articles littéraires donnés ici et là (l'Obs, Le Monde...) et cela produit à chaque fois un folio de 1000 pages et plus. Le dernier opus se nomme Discours parfait (il était paru il y a moins de deux ans en Blanche) : de l'intelligence à l'état pur, mâtinée d'une mégalomanie que l'on a fini par pardonner, ou sur laquelle nous glissons car le personnage est aussi attachant qu'irritant... tant il est brillant. Admirables pages sur Shakespeare, Montaigne, Saint-Simon, Van Gogh, Venise, Stendhal à Bordeaux... Entre autres analyses subtilement circonscrites, avec tact, érudition et talent, bien sûr.
Philippe Sollers continue de compiler pour notre bonheur ses articles littéraires donnés ici et là (l'Obs, Le Monde...) et cela produit à chaque fois un folio de 1000 pages et plus. Le dernier opus se nomme Discours parfait (il était paru il y a moins de deux ans en Blanche) : de l'intelligence à l'état pur, mâtinée d'une mégalomanie que l'on a fini par pardonner, ou sur laquelle nous glissons car le personnage est aussi attachant qu'irritant... tant il est brillant. Admirables pages sur Shakespeare, Montaigne, Saint-Simon, Van Gogh, Venise, Stendhal à Bordeaux... Entre autres analyses subtilement circonscrites, avec tact, érudition et talent, bien sûr.  De Modiano, voyez L'horizon, qui n'est pas son plus mauvais roman sur le seul et (désespérément) unique sujet de son oeuvre : l'Occupation.
De Modiano, voyez L'horizon, qui n'est pas son plus mauvais roman sur le seul et (désespérément) unique sujet de son oeuvre : l'Occupation.  originale publiée Au Diable Vauvert, signé Macha Séry. Revivre l'aventure de la jeunesse algérienne de l'auteur du Premier homme, à Alger en 1930 donc, entre matches de foot, bistrots, copains, filles, soleil et... une tuberculose qui entre sans frapper, est vivifiant. Cela remet nos idées en place sur le Camus journaliste débutant, le jeune essayiste, le séducteur, l'homme lucide surtout. Captivant (en attendant la bio de Camus que Michel Onfray publie ce mois-ci chez Flammarion...).
originale publiée Au Diable Vauvert, signé Macha Séry. Revivre l'aventure de la jeunesse algérienne de l'auteur du Premier homme, à Alger en 1930 donc, entre matches de foot, bistrots, copains, filles, soleil et... une tuberculose qui entre sans frapper, est vivifiant. Cela remet nos idées en place sur le Camus journaliste débutant, le jeune essayiste, le séducteur, l'homme lucide surtout. Captivant (en attendant la bio de Camus que Michel Onfray publie ce mois-ci chez Flammarion...). Retour à Killybegs, qui a valu le Grand Prix du roman de l'Académie française à Sorj Chalandon (Grasset) est un bon et solide roman sur la trahison, qui fera sans doute date. Sur fond de combats de l'IRA, c'est fort comme un hot whiskey au retour d'une chasse à la bécasse dans les bushes, c'est franc comme un coup de poing bien assené et sec comme le regard d'un ami frappé de déception : cela ne cille ni ne ploie. Je ne citerai que la phrase placée en exergue du roman, relevée sur un mur de Belfast : Savez-vous ce que disent les arbres lorsque la hache entre dans la forêt? Regardez! Le manche est l'un des nôtres!
Retour à Killybegs, qui a valu le Grand Prix du roman de l'Académie française à Sorj Chalandon (Grasset) est un bon et solide roman sur la trahison, qui fera sans doute date. Sur fond de combats de l'IRA, c'est fort comme un hot whiskey au retour d'une chasse à la bécasse dans les bushes, c'est franc comme un coup de poing bien assené et sec comme le regard d'un ami frappé de déception : cela ne cille ni ne ploie. Je ne citerai que la phrase placée en exergue du roman, relevée sur un mur de Belfast : Savez-vous ce que disent les arbres lorsque la hache entre dans la forêt? Regardez! Le manche est l'un des nôtres! Dire que je n'ai pas du tout aimé La Guerre sans l'aimer, de Bernard-Henri Lévy (Grasset, 648 p.), est un euphémisme. Je voulais quand même feuilleter abondamment, m'arrêter ici ou là, tenter de comprendre la pathologie de ce Journal d'un écrivain au coeur du printemps libyen. Mais les bras m'en sont tombés. J'ai repensé à une formule de Cornelius Castoriadis à propos de "l'
Dire que je n'ai pas du tout aimé La Guerre sans l'aimer, de Bernard-Henri Lévy (Grasset, 648 p.), est un euphémisme. Je voulais quand même feuilleter abondamment, m'arrêter ici ou là, tenter de comprendre la pathologie de ce Journal d'un écrivain au coeur du printemps libyen. Mais les bras m'en sont tombés. J'ai repensé à une formule de Cornelius Castoriadis à propos de "l'
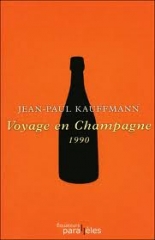 Lumineuse, l'idée d'Olivier Frébourg, patron des éditions des Equateurs, de reprendre dans sa petite collection Parallèles, deux textes splendides de Jean-Paul Kauffmann, l'un sur Bordeaux : Voyage à Bordeaux 1989 (que je suis fier de posséder dans son introuvable édition originale, celle de la Caisse des Dépôts et Consignations publiée à l'intention du notariat français, illustrée par Michel Guillard, mise en pages par le talentueux Marc Walter et préfacée par Jacques Chaban-Delmas!), l'autre sur le champagne : Voyage en Champagne 1990. Il s'agit de textes très littéraires sur les vins, les paysages, les hommes de la vigne. C'est précis et pêchu comme toujours avec Kauffmann, voire précieux dans l'écriture (comme du Veilletet, du Gracq) et surtout profond : le bordeaux est une initiation, prévient-il. Et le champagne est fils de l'air.
Lumineuse, l'idée d'Olivier Frébourg, patron des éditions des Equateurs, de reprendre dans sa petite collection Parallèles, deux textes splendides de Jean-Paul Kauffmann, l'un sur Bordeaux : Voyage à Bordeaux 1989 (que je suis fier de posséder dans son introuvable édition originale, celle de la Caisse des Dépôts et Consignations publiée à l'intention du notariat français, illustrée par Michel Guillard, mise en pages par le talentueux Marc Walter et préfacée par Jacques Chaban-Delmas!), l'autre sur le champagne : Voyage en Champagne 1990. Il s'agit de textes très littéraires sur les vins, les paysages, les hommes de la vigne. C'est précis et pêchu comme toujours avec Kauffmann, voire précieux dans l'écriture (comme du Veilletet, du Gracq) et surtout profond : le bordeaux est une initiation, prévient-il. Et le champagne est fils de l'air. 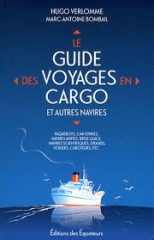 Voyages en Cargo et autres navires, de Hugo Verlomme et Marc-Antoine Bombail. Slow is beautiful lancent avec justesse les auteurs. Un livre unique pour tout savoir sur les possibilités de voyages à bord de paquebots, cargos, car-ferries, navires mixtes, brise-glace, grands voiliers, caboteurs et autres vieux grééments, baliseurs ou navires scientifiques... Sur les océans et les mers du monde entier.
Voyages en Cargo et autres navires, de Hugo Verlomme et Marc-Antoine Bombail. Slow is beautiful lancent avec justesse les auteurs. Un livre unique pour tout savoir sur les possibilités de voyages à bord de paquebots, cargos, car-ferries, navires mixtes, brise-glace, grands voiliers, caboteurs et autres vieux grééments, baliseurs ou navires scientifiques... Sur les océans et les mers du monde entier. Mon amour est le titre donné à une épatante anthologie de textes amoureux (folio, sous un coffret rouge ravissant bardé d'un ruban imprimé aux mots de je t'aime) que l'on a envie d'offrir -et c'est le premier but d'une telle démarche éditoriale! (Saint-Valentin oblige). Stendhal, Ovide, Proust, Cohen, Aragon, Duras, Shakespeare, Verlaine, Labé, Neruda, Eluard... Ils sont tous là et, curieusement, parmi ces classiques magnifiques, on trouve un seul contemporain peu connu pour ses textes amoureux : Jean-Christophe Rufin! Allez comprendre, des fois...
Mon amour est le titre donné à une épatante anthologie de textes amoureux (folio, sous un coffret rouge ravissant bardé d'un ruban imprimé aux mots de je t'aime) que l'on a envie d'offrir -et c'est le premier but d'une telle démarche éditoriale! (Saint-Valentin oblige). Stendhal, Ovide, Proust, Cohen, Aragon, Duras, Shakespeare, Verlaine, Labé, Neruda, Eluard... Ils sont tous là et, curieusement, parmi ces classiques magnifiques, on trouve un seul contemporain peu connu pour ses textes amoureux : Jean-Christophe Rufin! Allez comprendre, des fois... La revue (mauvais esprit) Ravages publie son nouveau numéro sur le thème : Slow! Comme toujours, c'est décapant, irrévérencieux, rentre-dedans, franc du collier et salutaire, et la maquette est redoutablement chic-efficace. Slow citta, slow food, slow life, slow money, slow travel, slow drive, slow industry, slow management... Tout est passé en revue, et des signatures prestigieuses comme celle d'Edgar Morin donnent dans Ravages. Bravo!
La revue (mauvais esprit) Ravages publie son nouveau numéro sur le thème : Slow! Comme toujours, c'est décapant, irrévérencieux, rentre-dedans, franc du collier et salutaire, et la maquette est redoutablement chic-efficace. Slow citta, slow food, slow life, slow money, slow travel, slow drive, slow industry, slow management... Tout est passé en revue, et des signatures prestigieuses comme celle d'Edgar Morin donnent dans Ravages. Bravo! l'originalité et la beauté de leurs publications (déjà remarquées ici même) : Les Miscellanées du jardin, de Guillaume Pellerin et Cléophée de Turckheim, sont par exemple un chef d'euvre d'édition audacieuse, tant pour l'illustration que pour le propos. Ce petit bijou nous apprend des tas de choses sur les mots du jardin, des anecdotes, des petits trucs, et c'est captivant, élégant, subtil et surtout bourré d'infos originales et sincèrement enrichissantes.
l'originalité et la beauté de leurs publications (déjà remarquées ici même) : Les Miscellanées du jardin, de Guillaume Pellerin et Cléophée de Turckheim, sont par exemple un chef d'euvre d'édition audacieuse, tant pour l'illustration que pour le propos. Ce petit bijou nous apprend des tas de choses sur les mots du jardin, des anecdotes, des petits trucs, et c'est captivant, élégant, subtil et surtout bourré d'infos originales et sincèrement enrichissantes. Toujours chez Ulmer, Les Jardins à vivre de Pierre-Alexandre Risser (20 ans de jardin à Paris et ailleurs) est un ouvrage splendide sur l'oeuvre d'un paysagiste de grand talent, un créateur de jardins et de terrasses en ville beaux toute l'année, en somme. Photos remarquables.
Toujours chez Ulmer, Les Jardins à vivre de Pierre-Alexandre Risser (20 ans de jardin à Paris et ailleurs) est un ouvrage splendide sur l'oeuvre d'un paysagiste de grand talent, un créateur de jardins et de terrasses en ville beaux toute l'année, en somme. Photos remarquables. 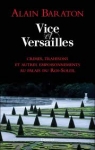 désopilant signé Alain Baraton (Grasset), jardinier en chef du parc de Versailles et du Trianon : cela regorge et dégorge d'intrigues, de meurtres, de coups fourrés sanglants. On se croirait chez les Borgia. Et c'est, de surcroît, écrit dans un style enlevé!
désopilant signé Alain Baraton (Grasset), jardinier en chef du parc de Versailles et du Trianon : cela regorge et dégorge d'intrigues, de meurtres, de coups fourrés sanglants. On se croirait chez les Borgia. Et c'est, de surcroît, écrit dans un style enlevé!
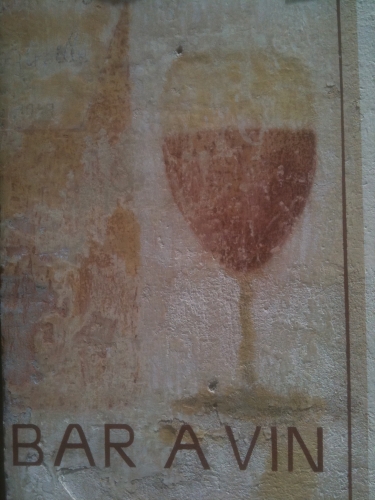 au-dessus de la plage -basque- de La Chambre d'Amour, en plein froid et à la tombée du jour. Et puis il faut préciser qu'il y avait aussi du chorizo patra negra et un jamon iberico formidables, achetés pour 3 sous à la venta Lapitxuri, à Dancharia. Alors...).
au-dessus de la plage -basque- de La Chambre d'Amour, en plein froid et à la tombée du jour. Et puis il faut préciser qu'il y avait aussi du chorizo patra negra et un jamon iberico formidables, achetés pour 3 sous à la venta Lapitxuri, à Dancharia. Alors...). Lorsque Les Vins du Sud-Ouest enivrent Paris, je me déplace. Cela se passait à La Bellevilloise (20ème). 29 vignerons étaient là. Du beau monde et de beaux flacons, pour accompagner quelques produits phares, comme le jambon, le foie gras et tout ça... Je retiens les jurançon de Camin Larredya, domaine piloté par une charmante petite équipe placée sous la houlette de Jean-Marc Grussaute : 9 ha à peine en conversion bio qui subliment avec beaucoup de talent les gros manseng, petit manseng et petit courbu. Tant en sec : La Part davan, La Virada, qu'en moelleux, notamment le remarquable Au Capceu, et l'excellent A Solhevat. Mention spéciale à la cuvée Alabets (et alors?, en Gascon) du château Plaisance, de Marc Penavayre, à Vacquiers (31). C'est un fronton 100% négrette élevé en cuves béton. Son frère élevé en barriques, Tot ço que cal (tout ce qu'il faut) est moins puissant, mais plus fin : normal. Bons souvenirs en passant : les classiques de chez Plageoles (gaillac), les vins si raffinés de Causse Marines (gaillac), Le Sid, puissant et sérieux, de Mathieu Cosse (cahors), le toujours meilleur vin de Mouthes Le Bihan (côtes-de-duras), l'excellent irouléguy de Thérèse et Michel Riouspeyrous : Arretxea, l'emblématique et indémodable gamme, encore enrichie, de Charles Hours, du Clos Uroulat, à Jurançon. La gamme "tradi" de la famille Hours nous enchantera toujours, surtout la Cuvée Marie (un formidable sec). Et sa gamme "trendy" nous renverse, notamment avec Happy Hours (prononcez api-ours bien sûr). Citons encore les cuvées Le Préphylloxérique (2007) du domaine Labranche-Laffont (madiran), les cuvées Hécate, et 666, d'un autre madiran (Laffont), et enfin la gamme toujours aussi épatante d'un de nos chouchous : Elian Da Ros, prince des côtes-du-marmandais.
Lorsque Les Vins du Sud-Ouest enivrent Paris, je me déplace. Cela se passait à La Bellevilloise (20ème). 29 vignerons étaient là. Du beau monde et de beaux flacons, pour accompagner quelques produits phares, comme le jambon, le foie gras et tout ça... Je retiens les jurançon de Camin Larredya, domaine piloté par une charmante petite équipe placée sous la houlette de Jean-Marc Grussaute : 9 ha à peine en conversion bio qui subliment avec beaucoup de talent les gros manseng, petit manseng et petit courbu. Tant en sec : La Part davan, La Virada, qu'en moelleux, notamment le remarquable Au Capceu, et l'excellent A Solhevat. Mention spéciale à la cuvée Alabets (et alors?, en Gascon) du château Plaisance, de Marc Penavayre, à Vacquiers (31). C'est un fronton 100% négrette élevé en cuves béton. Son frère élevé en barriques, Tot ço que cal (tout ce qu'il faut) est moins puissant, mais plus fin : normal. Bons souvenirs en passant : les classiques de chez Plageoles (gaillac), les vins si raffinés de Causse Marines (gaillac), Le Sid, puissant et sérieux, de Mathieu Cosse (cahors), le toujours meilleur vin de Mouthes Le Bihan (côtes-de-duras), l'excellent irouléguy de Thérèse et Michel Riouspeyrous : Arretxea, l'emblématique et indémodable gamme, encore enrichie, de Charles Hours, du Clos Uroulat, à Jurançon. La gamme "tradi" de la famille Hours nous enchantera toujours, surtout la Cuvée Marie (un formidable sec). Et sa gamme "trendy" nous renverse, notamment avec Happy Hours (prononcez api-ours bien sûr). Citons encore les cuvées Le Préphylloxérique (2007) du domaine Labranche-Laffont (madiran), les cuvées Hécate, et 666, d'un autre madiran (Laffont), et enfin la gamme toujours aussi épatante d'un de nos chouchous : Elian Da Ros, prince des côtes-du-marmandais. Pour finir cette note, j'évoquerai Brigitte Lurton, qui fit carrière dans quelques unes des propriétés bordelaises de sa famille, notamment à Climens (barsac), et qui replonge après plusieurs années de "jachère vigneronne", en sélectionnant cette fois des vins de propriétaires des terroirs français, pour leurs qualités, leur personnalité, leur sincérité, leur franchise de goût et leur profonde simplicité... Soit bien loin des canons des entêtés à oeillères du vignoble bordelais, confits dans leur suffisance depuis des temps immémoriaux comme le dindon dans sa graisse, et qui s'empêtrent désormais dans une impasse bien obscure, par faute, notamment, de clairvoyance. Le packaging des flacons est design et chic, simple et efficace (Brigitte Lurton est
Pour finir cette note, j'évoquerai Brigitte Lurton, qui fit carrière dans quelques unes des propriétés bordelaises de sa famille, notamment à Climens (barsac), et qui replonge après plusieurs années de "jachère vigneronne", en sélectionnant cette fois des vins de propriétaires des terroirs français, pour leurs qualités, leur personnalité, leur sincérité, leur franchise de goût et leur profonde simplicité... Soit bien loin des canons des entêtés à oeillères du vignoble bordelais, confits dans leur suffisance depuis des temps immémoriaux comme le dindon dans sa graisse, et qui s'empêtrent désormais dans une impasse bien obscure, par faute, notamment, de clairvoyance. Le packaging des flacons est design et chic, simple et efficace (Brigitte Lurton est 


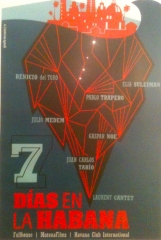




 C'est le livre le plus poignant de l’automne. Le plus personnel aussi, le plus fort et sans doute l’un des mieux écrits. Gaston et Gustave, publié au Mercure de France, vient de remporter le Prix Décembre (ex-aequo avec Jean-Christophe Bailly). Olivier Frébourg, écrivain (de Marine), journaliste, éditeur, nous a déjà donné une dizaine de très bons livres –romans, essais. Lisez son Nimier, trafiquant d'insolence (LTR, La Petite Vermillon), Maupassant, le clandestin (Folio), Souviens-toi de Lisbonne (La Petite Vermillon) -voir sur ce blog à la date du 20 octobre dernier, et aussi Port d'attache (Albin Michel) et encore La vie sera plus belle (Le Livre de Poche). Il avait déjà laché un livre personnel très émouvant : Un homme à la mer (folio). Avec Gaston et Gustave, il ouvre à nouveau son cœur, largement, et délivre sa peine d’une trop grand souffrance. L’écriture, nous le savons, est une catharsis contre les coups du destin. Elle doit permettre aussi d’alléger tout sentiment de culpabilité. En tout cas essayer…
C'est le livre le plus poignant de l’automne. Le plus personnel aussi, le plus fort et sans doute l’un des mieux écrits. Gaston et Gustave, publié au Mercure de France, vient de remporter le Prix Décembre (ex-aequo avec Jean-Christophe Bailly). Olivier Frébourg, écrivain (de Marine), journaliste, éditeur, nous a déjà donné une dizaine de très bons livres –romans, essais. Lisez son Nimier, trafiquant d'insolence (LTR, La Petite Vermillon), Maupassant, le clandestin (Folio), Souviens-toi de Lisbonne (La Petite Vermillon) -voir sur ce blog à la date du 20 octobre dernier, et aussi Port d'attache (Albin Michel) et encore La vie sera plus belle (Le Livre de Poche). Il avait déjà laché un livre personnel très émouvant : Un homme à la mer (folio). Avec Gaston et Gustave, il ouvre à nouveau son cœur, largement, et délivre sa peine d’une trop grand souffrance. L’écriture, nous le savons, est une catharsis contre les coups du destin. Elle doit permettre aussi d’alléger tout sentiment de culpabilité. En tout cas essayer…  La tentation d’appliquer le mot de Feydeau : « J’ai voulu noyer mon chagrin dans l’alcool mais il savait nager » est grande...
La tentation d’appliquer le mot de Feydeau : « J’ai voulu noyer mon chagrin dans l’alcool mais il savait nager » est grande... 
 Socrate toujours. Comment se passer d'air? De sang? D'électricité dans les veines du cerveau et de l'âme/corps? Sans Socrate, tu meurs! Laisse Platon, son exégète, son scribe. Prends Socrate, et re-sache que tu ne sais rien. Sache que tu sais nada. Et va nu. Sois. Deviens (si tu veux) celui que tu es, ou pense être. Deviens sage : sois ouverture, rigueur, courage, endurance, engagement, humilité. Ne déçois plus jamais. Apprends à comprendre ton être de tout ton être. Tu sais qu'être riche, c'est n'avoir rien à perdre. Même si ce que j'ai dit est mon maître, et ce que je n'ai pas encore dit est mon esclave, je me sens avant tout tissé de l'étoffe dont sont faits les rêves dont je ne me souviens pas.
Socrate toujours. Comment se passer d'air? De sang? D'électricité dans les veines du cerveau et de l'âme/corps? Sans Socrate, tu meurs! Laisse Platon, son exégète, son scribe. Prends Socrate, et re-sache que tu ne sais rien. Sache que tu sais nada. Et va nu. Sois. Deviens (si tu veux) celui que tu es, ou pense être. Deviens sage : sois ouverture, rigueur, courage, endurance, engagement, humilité. Ne déçois plus jamais. Apprends à comprendre ton être de tout ton être. Tu sais qu'être riche, c'est n'avoir rien à perdre. Même si ce que j'ai dit est mon maître, et ce que je n'ai pas encore dit est mon esclave, je me sens avant tout tissé de l'étoffe dont sont faits les rêves dont je ne me souviens pas. Et Diogène, ton pote par-delà les siècles, qui me tire par la manche en me rappelant que là, on lui dit qu’il était interdit de cracher par terre, et par conséquent il cracha au visage de celui qui venait de le lui interdire. Diogène ajouta : c’est le seul endroit sale que j’ai trouvé.».
Et Diogène, ton pote par-delà les siècles, qui me tire par la manche en me rappelant que là, on lui dit qu’il était interdit de cracher par terre, et par conséquent il cracha au visage de celui qui venait de le lui interdire. Diogène ajouta : c’est le seul endroit sale que j’ai trouvé.». http://www.leshistoiresduderby.fr/
http://www.leshistoiresduderby.fr/


 guides particuliers : les deux Lebey (restos et bistrots) pour les tables de Paris et alentour, le fooding pour la catégorie de restos qu'il traite, ou encore le Petit Lapaque des vins de copains et le carnet de vigne omnivore de Sylvie Augereau pour les vins naturels et bios. Donc je salue ici la nouvelle édition du Hachette des vins -indispensable et constamment à portée de main pour vérifier une adresse, un cépage, un site, un truc. Ainsi qu'un petit guide fort pratique et très sympa, car bourré de découvertes :
guides particuliers : les deux Lebey (restos et bistrots) pour les tables de Paris et alentour, le fooding pour la catégorie de restos qu'il traite, ou encore le Petit Lapaque des vins de copains et le carnet de vigne omnivore de Sylvie Augereau pour les vins naturels et bios. Donc je salue ici la nouvelle édition du Hachette des vins -indispensable et constamment à portée de main pour vérifier une adresse, un cépage, un site, un truc. Ainsi qu'un petit guide fort pratique et très sympa, car bourré de découvertes :  Côté solide, lisez
Côté solide, lisez  Lisez aussi les dernières parutions des éditions Honoré Champion : la collection Champion les dictionnaires s'enrichit du
Lisez aussi les dernières parutions des éditions Honoré Champion : la collection Champion les dictionnaires s'enrichit du 
 chocolat,
chocolat,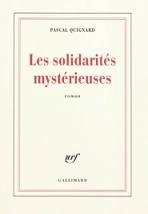 Les solidarités mystérieuses, le dernier roman de Pascal Quignard (Gallimard) est stupéfiant tant il déçoit. Disparue la magie de cet auteur précieux et fondamental -l'un des meilleurs du moment. Plus rien, dans ce livre creux, livide, insipide par endroits, de l'écriture hiératique, austère et pure, limpide et d'une beauté entre toutes remarquables. Passage à vide? Laxisme d'auteur et laisser-aller éditorial? Ce nouvel opus de l'auteur si poétique, si érudit de Vie secrète, des Petits traités, de Villa Amalia, de Tous les matins du monde et de tant d'autres bijoux, m'a ennuyé et lorsque je l'ai achevé il y a une douzaine de jours, je me suis senti désappointé, presque trahi. Reste à présent à espérer un nouveau bon bouquin -fiction ou essai, peu importe, et à relire contre toute attente le(s) Quignard que nous aimons.
Les solidarités mystérieuses, le dernier roman de Pascal Quignard (Gallimard) est stupéfiant tant il déçoit. Disparue la magie de cet auteur précieux et fondamental -l'un des meilleurs du moment. Plus rien, dans ce livre creux, livide, insipide par endroits, de l'écriture hiératique, austère et pure, limpide et d'une beauté entre toutes remarquables. Passage à vide? Laxisme d'auteur et laisser-aller éditorial? Ce nouvel opus de l'auteur si poétique, si érudit de Vie secrète, des Petits traités, de Villa Amalia, de Tous les matins du monde et de tant d'autres bijoux, m'a ennuyé et lorsque je l'ai achevé il y a une douzaine de jours, je me suis senti désappointé, presque trahi. Reste à présent à espérer un nouveau bon bouquin -fiction ou essai, peu importe, et à relire contre toute attente le(s) Quignard que nous aimons.




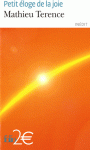
 Le Bottin des lieux proustiens
Le Bottin des lieux proustiens

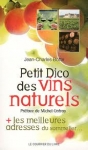





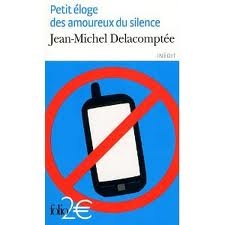 Jean-Michel Delacomptée livre un Petit éloge des amoureux du silence (folio 2€) qui serait seulement délicieux s'il n'était pas entâché d'un esprit chagrin qui vire ronchon au fil des pages et qui finit par une plainte primaire, doublée d'un catalogue des nuisances sonores qui polluent notre quotidien urbain et rural.
Jean-Michel Delacomptée livre un Petit éloge des amoureux du silence (folio 2€) qui serait seulement délicieux s'il n'était pas entâché d'un esprit chagrin qui vire ronchon au fil des pages et qui finit par une plainte primaire, doublée d'un catalogue des nuisances sonores qui polluent notre quotidien urbain et rural. 
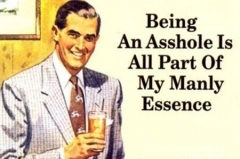


 Sévigné écrivit tant de lettres (j'ajoute que Grignan est un village associé pour moi au grand poète Philippe Jaccottet, car il y vit et que je le lis et relis sans cesse, avec une émotion égale, depuis l'été 1976), s'appelait jusqu'en 2010 Côteaux-du-Tricastin. Or, la confusion avec la centrale nucléaire éponyme commençait à nuire aux vignerons. Le nom fut changé : voilà les bons vins de Grignan-les-Adhémar. Les
Sévigné écrivit tant de lettres (j'ajoute que Grignan est un village associé pour moi au grand poète Philippe Jaccottet, car il y vit et que je le lis et relis sans cesse, avec une émotion égale, depuis l'été 1976), s'appelait jusqu'en 2010 Côteaux-du-Tricastin. Or, la confusion avec la centrale nucléaire éponyme commençait à nuire aux vignerons. Le nom fut changé : voilà les bons vins de Grignan-les-Adhémar. Les  avec septembre, cette année!-, voyez du côté du croquant et gourmand vin du Domaine de Montine, cuvée Gourmandises 2010 (70% grenache noir, 20%
avec septembre, cette année!-, voyez du côté du croquant et gourmand vin du Domaine de Montine, cuvée Gourmandises 2010 (70% grenache noir, 20%  syrah, 10% cinsault) :
syrah, 10% cinsault) : 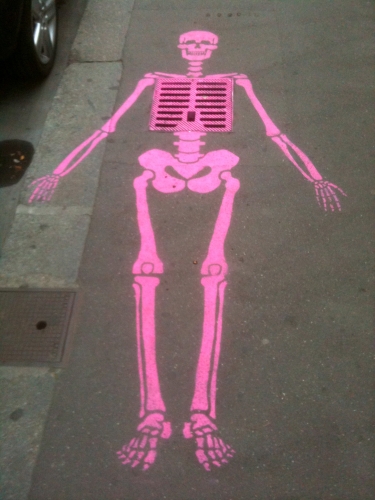
 L’avantage d’un blog, s’agissant de rendre compte de la lecture d’un livre, c’est que l’on peut y évoquer notre connaissance de l’auteur en prévenant immédiatement qu’il ne s’agit pas de copinage, mais d’éclairage supplémentaire. Je connais Saber Mansouri. C’est un ami. Il publie ces jours-ci son quatrième essai : « Tu deviendras un Français accompli », Oracle (*). Composé comme un anti-manuel à l’usage des immigrés choisis qui ne se hasarderont pas à franchir la Méditerranée clandestinement jusqu’à l’île de Lampedusa au péril de leur vie (il précise lui-même qu’il n’eut pas le choix, car il ne sait toujours pas nager…), mais qui prépareront un tant soi peu leur arrivée sur le sol français en pensant notamment aux concepts de consensus, d’intégration (« un long travail sur soi », dit l’auteur) et aussi de renoncement... Précisons d’emblée une chose : ce livre ne s’adresse pas aux Djerbiens qui ouvriront une épicerie de quartier, mais plutôt à tous les étrangers qui désirent effectuer des études supérieures en France, et aux intellectuels sans avenir dans leur pays, futurs thésards et universitaires à Paris, comme Saber Mansouri l’est devenu. Il a quitté le djebel proche de Tunis pour devenir, quelques longues années plus tard (il a aujourd'hui quarante ans) –mais au prix de combien de privations, de difficultés quotidiennes, donc au prix d’efforts qui forcent le respect, enseignant à l’Ecole des Hautes Etudes, directeur de collection, écrivain essayiste. Bref, un intellectuel arabisant et helléniste, historien de formation, disciple de feu Pierre Vidal-Naquet auquel il voue une adoration certaine...
L’avantage d’un blog, s’agissant de rendre compte de la lecture d’un livre, c’est que l’on peut y évoquer notre connaissance de l’auteur en prévenant immédiatement qu’il ne s’agit pas de copinage, mais d’éclairage supplémentaire. Je connais Saber Mansouri. C’est un ami. Il publie ces jours-ci son quatrième essai : « Tu deviendras un Français accompli », Oracle (*). Composé comme un anti-manuel à l’usage des immigrés choisis qui ne se hasarderont pas à franchir la Méditerranée clandestinement jusqu’à l’île de Lampedusa au péril de leur vie (il précise lui-même qu’il n’eut pas le choix, car il ne sait toujours pas nager…), mais qui prépareront un tant soi peu leur arrivée sur le sol français en pensant notamment aux concepts de consensus, d’intégration (« un long travail sur soi », dit l’auteur) et aussi de renoncement... Précisons d’emblée une chose : ce livre ne s’adresse pas aux Djerbiens qui ouvriront une épicerie de quartier, mais plutôt à tous les étrangers qui désirent effectuer des études supérieures en France, et aux intellectuels sans avenir dans leur pays, futurs thésards et universitaires à Paris, comme Saber Mansouri l’est devenu. Il a quitté le djebel proche de Tunis pour devenir, quelques longues années plus tard (il a aujourd'hui quarante ans) –mais au prix de combien de privations, de difficultés quotidiennes, donc au prix d’efforts qui forcent le respect, enseignant à l’Ecole des Hautes Etudes, directeur de collection, écrivain essayiste. Bref, un intellectuel arabisant et helléniste, historien de formation, disciple de feu Pierre Vidal-Naquet auquel il voue une adoration certaine...  genre est inédit depuis des siècles !) est également incisif et solidement documenté –l’auteur (photo ci-contre) demeure universitaire dans la méthode de son discours. Alors s’il existe une justice dans le monde de la rentrée littéraire de ce mois de septembre, versus essais, un grand succès attend ce petit livre rouge brûlant. Sinon, je me promets de m'infliger, en pénitence, la lecture des derniers Finkielkraut, Bruckner et BHL...
genre est inédit depuis des siècles !) est également incisif et solidement documenté –l’auteur (photo ci-contre) demeure universitaire dans la méthode de son discours. Alors s’il existe une justice dans le monde de la rentrée littéraire de ce mois de septembre, versus essais, un grand succès attend ce petit livre rouge brûlant. Sinon, je me promets de m'infliger, en pénitence, la lecture des derniers Finkielkraut, Bruckner et BHL...
 C'est la rentrée, c'est l'temps des vendanges et des dégust' d'automne...
C'est la rentrée, c'est l'temps des vendanges et des dégust' d'automne...
 Paisible échappée à Bayonne, ses abords et ses atours, ses Adours, mes amours, alentour et dedans. Flâner, saluer, chipironer, trinquer, déguster la lumière de l'aube sur la Nive, et celle du couchant sur la dune d'Ilbarritz -comme on prend un pintxo de jamon et una copita de navarra. Lire à peine, car ici le regard se lève de la page pour contempler devant et autour. La beauté empêche. Et je pêche la beauté à la ligne d'horizon de mes désirs, au-delà du fleuve et sous les arbres. Ici, on envisage, on ne dévisage pas. Je prends place dans ma querencia atlantique à la manière d'un chien qui gratte et tourne en rond avant de s'affaler comme un sac de farine épaulé-jeté. Car Paris au mois d'août me va comme un polo moulant à col roulé en rilsan® à même la peau : ça me gratte.
Paisible échappée à Bayonne, ses abords et ses atours, ses Adours, mes amours, alentour et dedans. Flâner, saluer, chipironer, trinquer, déguster la lumière de l'aube sur la Nive, et celle du couchant sur la dune d'Ilbarritz -comme on prend un pintxo de jamon et una copita de navarra. Lire à peine, car ici le regard se lève de la page pour contempler devant et autour. La beauté empêche. Et je pêche la beauté à la ligne d'horizon de mes désirs, au-delà du fleuve et sous les arbres. Ici, on envisage, on ne dévisage pas. Je prends place dans ma querencia atlantique à la manière d'un chien qui gratte et tourne en rond avant de s'affaler comme un sac de farine épaulé-jeté. Car Paris au mois d'août me va comme un polo moulant à col roulé en rilsan® à même la peau : ça me gratte. Au début, je trouvais que ce poète avait trop lu René Char au point d'en avoir la langue imprégnée, prisonnière même, à l'instar d'une Peau d'Âne. Il est vrai que Char est un poète si inspirant, qu'il aveugle nombre de ceux qui le pastichent, font du, sans le vouloir, veux-je penser. Mais voici un poème personnel, puis un autre -le recueil en comprend beaucoup, qui me permettent de reprendre la poésie de Siméon avec sérénité. Soit en oubliant ce qui ressemble à des emprunts (faits à une morale, une diction, un ton sentencieux, un vocabulaire minéral si identifiable -pour qui a commerce avec la langue originale), que nous détectons vite,
Au début, je trouvais que ce poète avait trop lu René Char au point d'en avoir la langue imprégnée, prisonnière même, à l'instar d'une Peau d'Âne. Il est vrai que Char est un poète si inspirant, qu'il aveugle nombre de ceux qui le pastichent, font du, sans le vouloir, veux-je penser. Mais voici un poème personnel, puis un autre -le recueil en comprend beaucoup, qui me permettent de reprendre la poésie de Siméon avec sérénité. Soit en oubliant ce qui ressemble à des emprunts (faits à une morale, une diction, un ton sentencieux, un vocabulaire minéral si identifiable -pour qui a commerce avec la langue originale), que nous détectons vite,  La Presqu’île rend fous les investisseurs avides de posséder un vignoble estampillé Saint-Tropez. Le groupe Bolloré a repris les domaines de La Croix et de la Bastide blanche, sur la commune de La Croix Valmer, 90 ha de vignes qui donnent un rosé classieux. Ce n’est pas le cas de tous les domaines, dont le point commun positif est de jouer volontiers la carte de l’agriculture raisonnée. À La Croix, on n’a pas lésiné sur les moyens pour remettre le vignoble en état et, surtout, confier à un architecte local de renom, François Vieillecroze, le soin d’imaginer et de réaliser un chai spectaculaire et futuriste. À Gassin, le célèbre Minuty, de réputation internationale, démontre que grande production peut rimer avec qualité. L’un de ses voisins, le domaine de La Rouillère, 40 ha plantés sur 120, appartient à un industriel de Lille, Bertrand Letartre, leader européen des produits d’hygiène et de désinfection en milieu hospitalier. « J’ai eu le coup de foudre il y a une dizaine d’années lorsque je cherchais à reprendre un domaine. J’ai racheté pour 4 millions d’euros une propriété un peu délaissée. 8 millions ont été injectés pour les travaux. Il y a eu notamment le rachat de terres à la famille de Robert Boulin. Une parcelle se nomme d’ailleurs Ministre »
La Presqu’île rend fous les investisseurs avides de posséder un vignoble estampillé Saint-Tropez. Le groupe Bolloré a repris les domaines de La Croix et de la Bastide blanche, sur la commune de La Croix Valmer, 90 ha de vignes qui donnent un rosé classieux. Ce n’est pas le cas de tous les domaines, dont le point commun positif est de jouer volontiers la carte de l’agriculture raisonnée. À La Croix, on n’a pas lésiné sur les moyens pour remettre le vignoble en état et, surtout, confier à un architecte local de renom, François Vieillecroze, le soin d’imaginer et de réaliser un chai spectaculaire et futuriste. À Gassin, le célèbre Minuty, de réputation internationale, démontre que grande production peut rimer avec qualité. L’un de ses voisins, le domaine de La Rouillère, 40 ha plantés sur 120, appartient à un industriel de Lille, Bertrand Letartre, leader européen des produits d’hygiène et de désinfection en milieu hospitalier. « J’ai eu le coup de foudre il y a une dizaine d’années lorsque je cherchais à reprendre un domaine. J’ai racheté pour 4 millions d’euros une propriété un peu délaissée. 8 millions ont été injectés pour les travaux. Il y a eu notamment le rachat de terres à la famille de Robert Boulin. Une parcelle se nomme d’ailleurs Ministre »

 ©L.M. Juillet 2011.
©L.M. Juillet 2011.
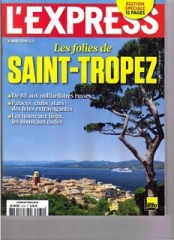 Retour de Procida...
Retour de Procida...  « Et tard dans la nuit de cet été 1965, Margot ouvrit la porte de l’hôtel familial de La Ponche à Gunther Sachs et à Brigitte Bardot. Ils voulaient une chambre, urgemment : Ma petite Brigitte… Et monsieur Gunther, mais quelle surprise !,
« Et tard dans la nuit de cet été 1965, Margot ouvrit la porte de l’hôtel familial de La Ponche à Gunther Sachs et à Brigitte Bardot. Ils voulaient une chambre, urgemment : Ma petite Brigitte… Et monsieur Gunther, mais quelle surprise !,  souvenir
souvenir jamais compter. Il a oublié que Mick Jagger s’est marié ici avec Bianca en 1971, il se souvient en revanche qu’il a une autre affaire à faire tourner à Courchevel, en relais de celle-ci sur le port, en deçà ou sur une plage de Pampelonne. Car aujourd’hui, il convient de suivre le VIP à la trace, dans les sillages uniformément blancs comme la fameuse Soirée –et de son yacht et de son avion privé. Le nouveau visage de St-Trop’ est davantage cosmopolite, plus exigeant, plus arrogant aussi. Les maîtres du monde, s’ils possèdent encore, parfois, le tact et l’intelligence effacée, exposent plus fréquemment des attitudes d’enfants gâtés qui veulent tout tout de suite. « Le risque est qu’ils fichent le camp ailleurs, puisque les côtes de la planète leur sont ouvertes », dit Kaled, inquiet militant de l’avenir des plages de Ramatuelle. En attendant les suites d’un éternel imbroglio (
jamais compter. Il a oublié que Mick Jagger s’est marié ici avec Bianca en 1971, il se souvient en revanche qu’il a une autre affaire à faire tourner à Courchevel, en relais de celle-ci sur le port, en deçà ou sur une plage de Pampelonne. Car aujourd’hui, il convient de suivre le VIP à la trace, dans les sillages uniformément blancs comme la fameuse Soirée –et de son yacht et de son avion privé. Le nouveau visage de St-Trop’ est davantage cosmopolite, plus exigeant, plus arrogant aussi. Les maîtres du monde, s’ils possèdent encore, parfois, le tact et l’intelligence effacée, exposent plus fréquemment des attitudes d’enfants gâtés qui veulent tout tout de suite. « Le risque est qu’ils fichent le camp ailleurs, puisque les côtes de la planète leur sont ouvertes », dit Kaled, inquiet militant de l’avenir des plages de Ramatuelle. En attendant les suites d’un éternel imbroglio ( Gates, mais transparent avec son tee-shirt imprimé et ses Havaïanas aux pieds, et dans une moindre mesure un Jean-Michel Jarre ou un Alexandre Jardin croisés ce 5 juillet au fil des quais et aux bras de leur dulcinée, fabriquent le Saint-Tropez d’aujourd’hui. Celui-ci tient du zoo, lorsqu’on se trouve devant ces yachts dont on ne sait pas qui sont les singes : ceux qui les occupent, là-haut, ou bien les humbles qui,
Gates, mais transparent avec son tee-shirt imprimé et ses Havaïanas aux pieds, et dans une moindre mesure un Jean-Michel Jarre ou un Alexandre Jardin croisés ce 5 juillet au fil des quais et aux bras de leur dulcinée, fabriquent le Saint-Tropez d’aujourd’hui. Celui-ci tient du zoo, lorsqu’on se trouve devant ces yachts dont on ne sait pas qui sont les singes : ceux qui les occupent, là-haut, ou bien les humbles qui, menton dressé et appareil photo prêt à tirer, guettent leurs occupants et se photographient devant des pavillons de complaisance évoquant les îles lointaines ? Il relève de la réserve d’Indiens : les Bateaux Verts proposent pour 9€ une balade en navette à la découverte des « villas de célébrités ». St-Trop’ tient encore du hameau charmant, lorsque l’on emprunte, depuis les quais et jusqu’à la Place des Lices, cette ravissante ruelle Etienne Berny chargée du parfum des figuiers qui dégringolent, et où deux piétons ne peuvent se croiser. Le village magique tient de l’inaltérable enfin, lorsque, devant soi, au cœur de la nuit, à l’heure où l’on quitte hagard les Caves du Roy, un nanti indien proche de la famille Mital (propriétaire dans les environs), évoquant en Anglais son dîner au Polo Club (la cuisine, italienne, y est remarquable), achète, pour se refaire, un panini à 5,40€, ni vu ni reconnu. Record absolu.
menton dressé et appareil photo prêt à tirer, guettent leurs occupants et se photographient devant des pavillons de complaisance évoquant les îles lointaines ? Il relève de la réserve d’Indiens : les Bateaux Verts proposent pour 9€ une balade en navette à la découverte des « villas de célébrités ». St-Trop’ tient encore du hameau charmant, lorsque l’on emprunte, depuis les quais et jusqu’à la Place des Lices, cette ravissante ruelle Etienne Berny chargée du parfum des figuiers qui dégringolent, et où deux piétons ne peuvent se croiser. Le village magique tient de l’inaltérable enfin, lorsque, devant soi, au cœur de la nuit, à l’heure où l’on quitte hagard les Caves du Roy, un nanti indien proche de la famille Mital (propriétaire dans les environs), évoquant en Anglais son dîner au Polo Club (la cuisine, italienne, y est remarquable), achète, pour se refaire, un panini à 5,40€, ni vu ni reconnu. Record absolu. Dans L'Express de cette semaine, je publie trois papiers sur le thème des grandes familles paloises : la saga des Biraben (foies gras éponymes et chevaux de course), des Escudé (sportifs de haut niveau : foot et tennis) et celle des Loustalan (presse quotidienne régionale). Il se trouve qu'en 1984, j'ai travaillé à Pau à Pyrénées Presse (La République des Pyrénées et L'Eclair des Pyrénées). Voici pourquoi je choisis de coller ci-dessous le papier qui évoque les Loustalan. Nota : ce dossier est uniquement diffusé en Béarn.
Dans L'Express de cette semaine, je publie trois papiers sur le thème des grandes familles paloises : la saga des Biraben (foies gras éponymes et chevaux de course), des Escudé (sportifs de haut niveau : foot et tennis) et celle des Loustalan (presse quotidienne régionale). Il se trouve qu'en 1984, j'ai travaillé à Pau à Pyrénées Presse (La République des Pyrénées et L'Eclair des Pyrénées). Voici pourquoi je choisis de coller ci-dessous le papier qui évoque les Loustalan. Nota : ce dossier est uniquement diffusé en Béarn.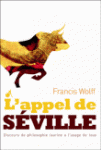




 avec
avec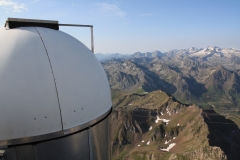
 un havane et en buvant un verre de Montus 2007, vers minuit. Je m'y trouvais pour fêter les dix ans de l'ouverture du Pic au public (gros raout gastronomique, j'y reviendrai). Là, c'est juste une impression à chaud -il faisait d'ailleurs frais là-haut, le jour était donc bien choisi... S'y lever avant l'aube, ce matin, pour voir le soleil apparaître fut un bonheur ineffable. J'y reviendrai aussi. Ainsi qu'au Pic. Un livre m'accompagnait, que je relisais avec l'impression de ne l'avoir jamais lu : L'insoutenable légèreté de l'être, de Kundera. J'eus le sentiment que Tomas, Tereza, Sabina, les personnages du roman, étaient avec moi là-haut. Cela procède
un havane et en buvant un verre de Montus 2007, vers minuit. Je m'y trouvais pour fêter les dix ans de l'ouverture du Pic au public (gros raout gastronomique, j'y reviendrai). Là, c'est juste une impression à chaud -il faisait d'ailleurs frais là-haut, le jour était donc bien choisi... S'y lever avant l'aube, ce matin, pour voir le soleil apparaître fut un bonheur ineffable. J'y reviendrai aussi. Ainsi qu'au Pic. Un livre m'accompagnait, que je relisais avec l'impression de ne l'avoir jamais lu : L'insoutenable légèreté de l'être, de Kundera. J'eus le sentiment que Tomas, Tereza, Sabina, les personnages du roman, étaient avec moi là-haut. Cela procède  (banal), va sur un rouge léger : le jus de raisin fermenté bio de Thierry Germain : Domaine des Roches Neuves, en 2010. C'est un saumur-champigny qui se croque, il est frais comme une place de village genre Uzès sous les platanes à l'heure de la belote, et gourmand comme les draps un rien rêches et raides à l'heure de la sieste d'un juin forcément érotique.
(banal), va sur un rouge léger : le jus de raisin fermenté bio de Thierry Germain : Domaine des Roches Neuves, en 2010. C'est un saumur-champigny qui se croque, il est frais comme une place de village genre Uzès sous les platanes à l'heure de la belote, et gourmand comme les draps un rien rêches et raides à l'heure de la sieste d'un juin forcément érotique. Pour finir, au salon en écoutant de la viole de gambe, un limoncello della casa mazzella di bosco, ça te dit?..
Pour finir, au salon en écoutant de la viole de gambe, un limoncello della casa mazzella di bosco, ça te dit?.. Mardi *,
Mardi *,  Nicolas Grimaldi, dont j'allais écouter les cours sur Le désir et le temps à la Fac de Lettres de Bordeaux au tout début des années 80, donne à présent dans la jalousie (l'enfer proustien), Socrate (le sorcier) et parle admirablement, en philosophe sage, de l'amour. Bien que son dernier livre, Métamorphoses de l'amour (Grasset) contienne de nombreux lieux communs et vérités plates, il pose en réalité les questions simples (en illustrant son propos de manière oroginale : non pas avec des textes philosophiques, mais avec des extraits de romans de Simenon!). Qu'aime-t-on quand on aime? L'attente et ses ambivalences. L'intolérable solitude. L'existence transfigurée, sont quelques thèmes majeurs parmi d'autres que l'auteur aborde dans ce petit livre précieux.
Nicolas Grimaldi, dont j'allais écouter les cours sur Le désir et le temps à la Fac de Lettres de Bordeaux au tout début des années 80, donne à présent dans la jalousie (l'enfer proustien), Socrate (le sorcier) et parle admirablement, en philosophe sage, de l'amour. Bien que son dernier livre, Métamorphoses de l'amour (Grasset) contienne de nombreux lieux communs et vérités plates, il pose en réalité les questions simples (en illustrant son propos de manière oroginale : non pas avec des textes philosophiques, mais avec des extraits de romans de Simenon!). Qu'aime-t-on quand on aime? L'attente et ses ambivalences. L'intolérable solitude. L'existence transfigurée, sont quelques thèmes majeurs parmi d'autres que l'auteur aborde dans ce petit livre précieux.