My Funny Ventoline
Il ne s'agit pas d'un hommage à Chet Baker (My Funny Valentine), mais d'un texte très personnel que j'ai donné en mai 2021 à un magazine en ligne que j'aime beaucoup, L'Intimiste.
C'est mon ami Didier Pourquery qui m'avait incité à le faire auprès de Sandrine Tolotti, qui pilote cette délicate lettre littéraire à laquelle je recommande de s'abonner.
Je suis retombé dessus après avoir discuté ce matin avec un ami d'asthme littéraire (voir la note précédente).
Je le re-délivre (l'heure est à la reprise). Cliquez sur le lien ci-dessous, et déroulez jusqu'à La carte blanche => My funny Ventoline Ou bien lisez ci-dessous.
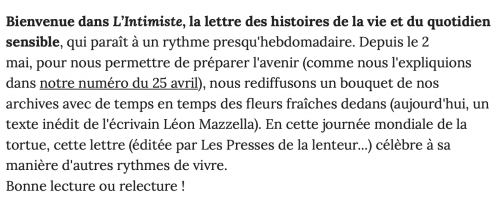
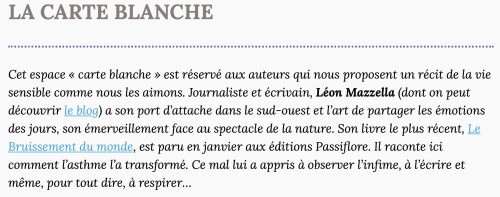
Par Léon Mazzella
Surtout, je ne parvenais pas à l’exprimer, comme s’il s’agissait d’une honte, oui, d’une honte. Pire, je crois qu’il m’était acquis que cela devait se passer ainsi. Ne pas parler de ce qui ne va pas, de ce qui fait mal, de ce qui empêche. Telle me semblait être la règle unique. Garder la bouche fermée, les dents serrées. As-tu bien dormi mon fils – Oui papa. Tiens, mange tes tartines, ne te mets pas en retard. Never complain. Et, davantage, en l’occurrence, never explain ; travail d’amont. Les années douloureuses furent nombreuses. Une vingtaine. C’est beaucoup. Vraiment. Ma seule paix, durant tant et tant de nuits, je la trouvai debout, me forçant à lutter contre le sommeil qui m’envahissait pourtant, et à marcher dans la maison, en bas, entre salon et cuisine, et dans le jardin, pieds nus l’été, chaussé l’hiver.
Puisque c’est dehors la nuit que j’ai commencé d’éprouver la nature, je remercie l’asthme de m’avoir familiarisé avec la voûte céleste, avec la voie lactée que j’ai apprise, avec le hululement de la chouette effraie, de la hulotte, de la chevêche, avec l’air chargé de vase et de marée – nous habitions au-dessus de la Nive, à Bayonne, qui charriait deux fois par jour ses remugles montagnards et campagnards à l’aller, et marins au retour. Je le remercie de m’avoir permis d’apprivoiser cette tisane froide des parfums nocturnes de l’herbe, et aussi l’odeur de la rosée, cette autre qui composait un bouquet lié d’une infusion précieuse, une liasse dans laquelle le chèvrefeuille se frottait à la menthe, la rose trémière au tilleul, le gazon tondu à la terre gorgée d’eau. J’écoutais les grenouilles, les crapauds aussi, le chuintement du vol des hiboux, le passage d’un sphinx, gros papillon de nuit, qui venait se cogner au lampadaire municipal, devant le portail de la maison, le passage furtif d’un chat de gouttière, la fuite suave d’un ragondin au poil gominé, car il en traînait, qui remontaient de la rivière, pour venir brouter à l’aise et à l’insu des chiens de garde.
Nous n’avions pas le droit d’être malade, à la vérité. Une sorte d’inhibition causée par la peur de mes parents de voir un de leurs enfants souffrant – mes deux sœurs et moi-même -, m’envahissait. Au moindre éternuement, notre père déclenchait un plan de riposte médical qui, par sa démesure, était grotesque. Mais ça, un enfant le ressent, mais il ne peut encore le dire. Aussi, ai-je toujours étouffé mes éternuements. Le moindre chatouillement de la gorge entrainant un début de toux m’effrayait : ne pouvant la retenir, j’étais aussitôt démasqué, je perdais ma paix, je ne m’appartenais plus. Repéré, objet d’une attention stupide, j’étais aussitôt diminué, réduit à une chose fragile et en danger, dépendante, qu’il fallait calfeutrer, confiner, enfermer, soigner afin d’endiguer le spectre d’un mal plus grand. Je ne sais d’où venait cette frousse de perdre leurs enfants qui animait des parents devenus tellement protecteurs que leur prudence excessive interdisait que nous puissions nous armer en fabriquant des anticorps. En conséquence, ma petite crainte m’obligeait à taire toute égratignure, toute douleur. Mon oreiller absorbait les sons de la toux et de chaque éternuement. La honte d’être malade prit ainsi le relais de la peur. Le sentiment d’être en faute, de faire mal en tombant malade m’étreignait à chaque bronchite. Ainsi passèrent la fin de mon enfance, mon adolescence, et les premières années de ma vie d’homme. L’apparition de l’asthme avait enclenché ces années clandestines.
En 1980, j’avais vingt-deux ans, la disparition de mon grand-père augmenta le rythme de mes crises nocturnes, bien que celles-ci survenaient surtout le week-end, désormais, car j’étais étudiant à Bordeaux, où mes nuits étaient plus paisibles, parfois profondes. Une question d’humidité, sans doute. Mes bronches rétrécirent de tristesse, je ne m’habituais pas à leur chuintement aigu à chaque respiration forcée. Les muscles des épaules et du torse étaient fourbus de devoir se distendre afin d’augmenter la capacité d’une cage thoracique continuellement sollicitée ; par force. Un jour, un copain de lycée, « grand » asthmatique de naissance, me tendit son flacon coudé bleu ciel recouvert d’un bouchon bleu marine. Mais, comme il m’avait déjà dit que son usage l’avait conduit à plusieurs reprises à l’hôpital car il y avait un risque cardiaque à l’utiliser, je refusai. La peur, sans doute, de me retrouver hospitalisé et de recevoir la visite de mes parents, qui transformeraient ma chambre en cellule stérile, en prison à vie, me paniqua. Même si l’étau ne prenait pas de vacances, je choisis de continuer de lutter, de ne pas dormir, d’entamer mes journées épuisé, perclus de courbatures, vermoulu, avec l’impression d’avoir été roué de coups.
Ainsi jusqu’à ce jour de 1991, en pleine brousse, au nord du Burkina Faso. Une crise m’avait soudain saisi à la tombée de la nuit, alors que l’asthme commençait à me laisser en paix depuis quelques années. Il ne s’acharnait plus, mais lorsqu’il resurgissait, il devenait intraitable, ses mâchoires ne desserraient pas. Me voyant empêtré, ayant reconnu les sifflements caractéristiques, un voyageur présent au campement me lança : « Vous semblez avez oublié votre Ventoline en France ». Je répondis que je n’en avais pas, et que je n’en avais encore jamais utilisé. En guise de réponse, il me tendit le petit spray bleu qui ne le quittait pas : « Tenez, vous allez voir, ça va passer tout de suite. Retournez-le, mettez-le dans la bouche et inspirez à fond tout en appuyant dessus. C’est comme ça que ça marche. Allez-y ! ». Je ne réfléchis pas, ôtai le capuchon et envoyai ma première bouffée dans les poumons. Ce fut un choc. La naissance d’un nouveau bonheur. Un miracle. L’apparition de la Vierge. Un orgasme. Un coup de foudre. L’expérience de la sidération. Subjugué, car instantanément débarrassé des griffes du mal, j’éclatais de rire bêtement comme un enfant qui ouvre une pochette-surprise. L’effet fulgurant du salbutamol, la molécule unique composant la Ventoline, son effet bronchodilatateur, m’apparut comme quelque chose d’absolument magique. D’un seul pschitt, d’une seule bouffée de rien du tout, je pouvais annihiler une crise sur l’instant, lors qu’il m’avait fallu jusque-là patienter douloureusement une nuit entière jusqu’à l’aube et au-delà, pour en voir diminuer chacune à mesure, ce jusqu’à l’effacement total. Seule l’anesthésie générale que je subis longtemps après – cette impression de partir inexorablement, de glisser comme du sable entre les doigts disjoints -, produisit un effet comparable mais à l’envers sur mon corps et ma conscience. Je ne conçus aucun regret d’avoir perdu tant de temps. Je n’en voulus jamais à mes parents de m’avoir d’une certaine façon empêché de leur parler du mal dont je souffrais. Je tirais au contraire une certaine fierté de m’être débrouillé par moi-même, de façon empirique certes, mais tout seul.
Depuis, comme chaque allergique, je ne puis me déplacer sans ma Ventoline. Et même si je n’en ai plus l’usage, mon asthme ayant fini par capituler, il me faut quand même (s)avoir un, voire plusieurs sprays pas loin : table de chevet, boîte à gants, sac de week-end. L’oublier pourrait provoquer une angoisse telle qu’elle déclencherait une crise. Aussi, le flacon bleu ciel à bout bleu marine fait-il constamment partie de mon viatique. Aujourd’hui, lorsque la date de péremption est dépassée, je les jette sans les avoir utilisés une seule fois. Et je m’en procure d’autres. Au cas où.
Je remercie aussi cette tentation de mettre ses enfants en couveuse, car se sentir épié en permanence – pour son bien -, génère un besoin de fuir, une soif de solitude. L’envie de s’en sortir. D’apprendre à. Engendre l’aversion pour toute aide. Entretient le devoir de ne jamais se plaindre. Voire celui d’endurer avec stoïcisme. De ne jamais passer pour une victime. D’affronter les éléments, de regarder le soleil en face sans le recours aux lunettes protectrices, d’endurcir son corps, de marcher pieds nus sur le sable brûlant, de prendre des coups et d’en donner parfois. De braver le froid comme la chaleur, la faim et la soif, les ronces comme les vagues. Je pris très tôt le contrepied. J’en conçus une urgente nécessité, un besoin vital. Il me fallut d’abord vérifier qu’un rhume n’est pas mortel et qu’une chute de vélo ne rend pas tétraplégique. Puis, que le surf ou l’escalade ne sont pas des activités si périlleuses qu’on le prétend. Plus tard, que voyager forge la jeunesse. Que courir l’encierro à Pampelune devant les toros envoie sa dose merveilleuse d’adrénaline. C’est donc peut-être grâce à cette surprotection initiale que j’ai toujours aimé braver le risque, faire l’expérience de mes limites, me mettre en danger. Aussi, n’est-ce pas un hasard si j’ai découvert la Ventoline en brousse, après une journée d’approche d’un troupeau de buffles, armé de jumelles, au cours de laquelle je fis une rencontre décisive avec le regard d’un lion.
Reste que l’asthmatique manque d’air, s’il ne manque pas de courage. La course de fond ne sera jamais une discipline dans laquelle il brillera. La course de vitesse sur courte distance (80, 100 m) oui. La nouvelle davantage que le roman. Les histoires d’amour brèves. L’aventure forte, puis classée sans suite. Faire court, ce n’est pas si mal. Que Proust, asthmatique notoire, ait pu écrire une œuvre si ample, aux phrases si longues qu’elles essoufflent leur lecteur à voix haute, laisse penser en somme que son encre était du salbutamol. Funny Ventoline… L.M.
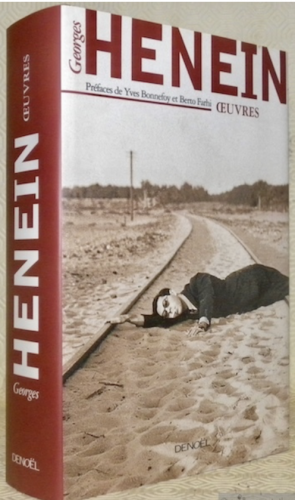

 Elle niche dans l’une des granges et sort tard, la nuit. Mais je veille encore, tire sur un cigare ou pas, contemple les étoiles, écoute les froissements, les chuintements, les cris, le silence ; le temps. Alors, depuis le faîte, elle ouvre ses ailes vers minuit, et se lance, décrit une courbe, tombe bas, rase le sol, évite joliment le mirabellier, puis remonte très vite et me frôle la tête, ou peu s’en faut. Cela fait déjà deux fois. Deux soirs de suite. Signe. Par son vol d’intimidation caractéristique, cette chouette effraie me signifie que je suis moins chez moi qu’elle n’est chez elle. Qu’elle entend bien rester ici, en posant ses conditions. C’est elle la patronne. J’obtempère mais elle ne le sait pas. J’aime. L.M.
Elle niche dans l’une des granges et sort tard, la nuit. Mais je veille encore, tire sur un cigare ou pas, contemple les étoiles, écoute les froissements, les chuintements, les cris, le silence ; le temps. Alors, depuis le faîte, elle ouvre ses ailes vers minuit, et se lance, décrit une courbe, tombe bas, rase le sol, évite joliment le mirabellier, puis remonte très vite et me frôle la tête, ou peu s’en faut. Cela fait déjà deux fois. Deux soirs de suite. Signe. Par son vol d’intimidation caractéristique, cette chouette effraie me signifie que je suis moins chez moi qu’elle n’est chez elle. Qu’elle entend bien rester ici, en posant ses conditions. C’est elle la patronne. J’obtempère mais elle ne le sait pas. J’aime. L.M. Purée! C'est dans Ovide et ça n'a pas pris une ride. C'est splendide, mais ressenti comme audacieux, 2000 ans après. Inquiétant, non...
Purée! C'est dans Ovide et ça n'a pas pris une ride. C'est splendide, mais ressenti comme audacieux, 2000 ans après. Inquiétant, non...  Le Gewurztraminer Grand Cru
Le Gewurztraminer Grand Cru 

 "A tout âge, on se découvre orphelin de père et de mère. Passée l'enfance, cette double perte ne nous est pas moins épargnée. Si elle ne s'est déjà produite, elle se tient devant nous. Nous la savions inévitable mais, comme notre propre mort, elle paraissait lointaine et, en réalité, inimaginable. Longtemps occultée de notre conscience par le flot de la vie, le refus de savoir, le désir de les croire immortels, pour toujours à nos côtés, la mort de nos parents, même annoncée par la maladie ou la sénilité, surgit toujours à l'improviste, nous laisse cois. Cet événement qu'il nous faut affronter et surmonter deux fois ne se répète pas à l'identique. Le premier parent perdu, demeure le survivant. Le coeur se serre. La douleur est là, aiguë peut-être, inconsolable, mais la disparition du second fait de nous un être sans famille. Le couple des parents s'est retrouvé dans la tombe. Nous en sommes définitivement écartés. Oedipe s'est crevé les yeux, Narcisse pleure".
"A tout âge, on se découvre orphelin de père et de mère. Passée l'enfance, cette double perte ne nous est pas moins épargnée. Si elle ne s'est déjà produite, elle se tient devant nous. Nous la savions inévitable mais, comme notre propre mort, elle paraissait lointaine et, en réalité, inimaginable. Longtemps occultée de notre conscience par le flot de la vie, le refus de savoir, le désir de les croire immortels, pour toujours à nos côtés, la mort de nos parents, même annoncée par la maladie ou la sénilité, surgit toujours à l'improviste, nous laisse cois. Cet événement qu'il nous faut affronter et surmonter deux fois ne se répète pas à l'identique. Le premier parent perdu, demeure le survivant. Le coeur se serre. La douleur est là, aiguë peut-être, inconsolable, mais la disparition du second fait de nous un être sans famille. Le couple des parents s'est retrouvé dans la tombe. Nous en sommes définitivement écartés. Oedipe s'est crevé les yeux, Narcisse pleure". Lydia Flem a poursuivi avec un talent et une émotion égales, son travail -universel- de deuil de ses parents, avec Lettres d'amour en héritage (Points/Seuil). C'est d'une pudeur extrême et d'un amour infiniment grand. Le livre retrace la vie de ses parents disparus, à travers trois cartons de leur correspondance amoureuse, depuis les débuts, que leur fille (l'auteure) découvrit, en vidant la maison, une fois orpheline... La tendresse résume ce livre précieux. Il n'est pas innocent que l'écriture soit devenue, très tôt, le terrain de jeu de l'auteure, puis que celle-ci ait fait profession de psychanalyste. Par bonheur, ces deux livres sont exempts de théorie, mais emplis, au contraire, de sensibilité à vif -mais douce, comme ces napperons brodés que nous avons tous vus dans les mains de notre mère, tandis qu'elle les rangeait avec un soin particulier, alors qu'ils sentaient encore le "chaud" du fer à repasser, sur une étagère d'une armoire, quelque part dans une pièce de la maison familiale...
Lydia Flem a poursuivi avec un talent et une émotion égales, son travail -universel- de deuil de ses parents, avec Lettres d'amour en héritage (Points/Seuil). C'est d'une pudeur extrême et d'un amour infiniment grand. Le livre retrace la vie de ses parents disparus, à travers trois cartons de leur correspondance amoureuse, depuis les débuts, que leur fille (l'auteure) découvrit, en vidant la maison, une fois orpheline... La tendresse résume ce livre précieux. Il n'est pas innocent que l'écriture soit devenue, très tôt, le terrain de jeu de l'auteure, puis que celle-ci ait fait profession de psychanalyste. Par bonheur, ces deux livres sont exempts de théorie, mais emplis, au contraire, de sensibilité à vif -mais douce, comme ces napperons brodés que nous avons tous vus dans les mains de notre mère, tandis qu'elle les rangeait avec un soin particulier, alors qu'ils sentaient encore le "chaud" du fer à repasser, sur une étagère d'une armoire, quelque part dans une pièce de la maison familiale...  Autres extraits
Autres extraits C'est fou ce que l'on peut changer quand même. Longtemps je n'ai pu supporter d’avoir un toit au-dessus de la tête, de me sentir prisonnier à l’intérieur avec des gens que cela ne gênait nullement, les fenêtres fermées, un silence confiné; voire du thé -tandis que la lumière du jour pouvait encore galvaniser tous mes sens. Question de musique et de mouvement. Peindre, selon Cézanne, c'est aussi écrire, danser, si j'en crois François Fédier et son admirable Ecouter voir
C'est fou ce que l'on peut changer quand même. Longtemps je n'ai pu supporter d’avoir un toit au-dessus de la tête, de me sentir prisonnier à l’intérieur avec des gens que cela ne gênait nullement, les fenêtres fermées, un silence confiné; voire du thé -tandis que la lumière du jour pouvait encore galvaniser tous mes sens. Question de musique et de mouvement. Peindre, selon Cézanne, c'est aussi écrire, danser, si j'en crois François Fédier et son admirable Ecouter voir Les jours rallongent et les jupes raccourcissent. Les mimosas fleurissent. En ville comme à la campagne, les palombes paradent vertigineusement : les mâles montent au ciel, planent et se laissent tomber. Ils aiment sans frein. Les femelles ne regardent même pas. C’est nuptial. Tout vibre, le merle chante plus tôt, ça bourgeonne. Envie printanière d’un œuf brouillé au beurre marin, aujourd’hui. De respirer à fond en ouvrant les fenêtres sur le monde. Bonheur de sortir tôt. Dans la rue, l’air est imprégné d’odeurs chaudes de viennoiserie. Je frôle une bourgeoise tracée au Samsara. Aspergée, plutôt. Les pas sont pressants. Le pays s’éveille. Au marché proche, les primeurs débarquent des cageots verts d’asperges et rouges de fraises. Le poissonnier étale les poissons d’avril sur la glace brisée. La vita e bella…
Les jours rallongent et les jupes raccourcissent. Les mimosas fleurissent. En ville comme à la campagne, les palombes paradent vertigineusement : les mâles montent au ciel, planent et se laissent tomber. Ils aiment sans frein. Les femelles ne regardent même pas. C’est nuptial. Tout vibre, le merle chante plus tôt, ça bourgeonne. Envie printanière d’un œuf brouillé au beurre marin, aujourd’hui. De respirer à fond en ouvrant les fenêtres sur le monde. Bonheur de sortir tôt. Dans la rue, l’air est imprégné d’odeurs chaudes de viennoiserie. Je frôle une bourgeoise tracée au Samsara. Aspergée, plutôt. Les pas sont pressants. Le pays s’éveille. Au marché proche, les primeurs débarquent des cageots verts d’asperges et rouges de fraises. Le poissonnier étale les poissons d’avril sur la glace brisée. La vita e bella… veste. Il en va du canif au fond du pantalon comme de la fiasque. Si par mégarde nous l’oublions, il ou elle nous manque terriblement, alors même que nous n’en avons aucun usage. Rien à couper au couteau : ennui, saucisson, brouillard ? Le canif manque quand même au toucher. La main tâtonne désespérément l’absence. Nous nous sentons nus. Plus seul. Les affaires intimes ne sont pas à une incongruité près : c’est toujours « entre soi » que l’on aime sentir le canif dans la poche et la fiasque, là. Calée. C’est seul aussi que l’on a le plus de plaisir à ouvrir l’un et à déboucher l’autre. Oublions l’arme blanche. Chromée, chiffrée, guillochée, gainée ou non, galbée pour épouser le cœur (elle, au moins…), voilà pour le contenant de l’objet. Mettez ce que vous voulez dedans. C’est une question, capitale, de parfum. Tout alcool plongé dans une fiasque subit une pression subjective de base qui le propulse aussitôt près des Dieux. L’important, on l’aura deviné, est de dévisser l’objet et de sniffer. Boire est inutile.
veste. Il en va du canif au fond du pantalon comme de la fiasque. Si par mégarde nous l’oublions, il ou elle nous manque terriblement, alors même que nous n’en avons aucun usage. Rien à couper au couteau : ennui, saucisson, brouillard ? Le canif manque quand même au toucher. La main tâtonne désespérément l’absence. Nous nous sentons nus. Plus seul. Les affaires intimes ne sont pas à une incongruité près : c’est toujours « entre soi » que l’on aime sentir le canif dans la poche et la fiasque, là. Calée. C’est seul aussi que l’on a le plus de plaisir à ouvrir l’un et à déboucher l’autre. Oublions l’arme blanche. Chromée, chiffrée, guillochée, gainée ou non, galbée pour épouser le cœur (elle, au moins…), voilà pour le contenant de l’objet. Mettez ce que vous voulez dedans. C’est une question, capitale, de parfum. Tout alcool plongé dans une fiasque subit une pression subjective de base qui le propulse aussitôt près des Dieux. L’important, on l’aura deviné, est de dévisser l’objet et de sniffer. Boire est inutile. Il fait jour. Il fait jouir. Vos yeux embrasent, embrassent l’espace. Imaginez le plaisir de capter, à l’aurore, les parfums complexes d’une poire, au moment délicieux où le monde part bosser, et de faire alors une pause au-delà du réel, au-dessus de la mêlée qui fait la queue ou qui ahane, embouteillée et pendue à ses portables, et vous bien calé sur une motte d’illusions, un bouquet de paresse dans le dos, accoudé au comptoir du temps suspendu. Même pas dans ce rade habituel où vous avez votre ardoise. Loin! Fermez les yeux un instant –en attendant le bus, le feu vert, l’ascenseur, une augmentation, un rendez-vous gâlon, et partez ! Moi, cela m’expédie illico à 2000 mètres d’altitude, au bord d’un lac connu de quelques isards complices, et je sens une truite prendre la mouche au bout de ma soie. La poire récompense une belle prise (c’est dire si l’on est à l’abri de l’ébriété, en montagne). Le salaire de l’approche, c’est ma fiasque qui me le remet en mains propres et en liquide. Mais d’abord, par le nez, je m’octroie licence de flairer le goulot comme on respire une fleur, un cou adoré; un enfant sa mère. L’éducation du coût des choses vraies passe par là. Le bonheur est dans l'à peu près. Dans le près. Encore plus près... Approche-toi, n'aies pas peur. Comprenne qui boira. Ou bas. L.M.
Il fait jour. Il fait jouir. Vos yeux embrasent, embrassent l’espace. Imaginez le plaisir de capter, à l’aurore, les parfums complexes d’une poire, au moment délicieux où le monde part bosser, et de faire alors une pause au-delà du réel, au-dessus de la mêlée qui fait la queue ou qui ahane, embouteillée et pendue à ses portables, et vous bien calé sur une motte d’illusions, un bouquet de paresse dans le dos, accoudé au comptoir du temps suspendu. Même pas dans ce rade habituel où vous avez votre ardoise. Loin! Fermez les yeux un instant –en attendant le bus, le feu vert, l’ascenseur, une augmentation, un rendez-vous gâlon, et partez ! Moi, cela m’expédie illico à 2000 mètres d’altitude, au bord d’un lac connu de quelques isards complices, et je sens une truite prendre la mouche au bout de ma soie. La poire récompense une belle prise (c’est dire si l’on est à l’abri de l’ébriété, en montagne). Le salaire de l’approche, c’est ma fiasque qui me le remet en mains propres et en liquide. Mais d’abord, par le nez, je m’octroie licence de flairer le goulot comme on respire une fleur, un cou adoré; un enfant sa mère. L’éducation du coût des choses vraies passe par là. Le bonheur est dans l'à peu près. Dans le près. Encore plus près... Approche-toi, n'aies pas peur. Comprenne qui boira. Ou bas. L.M. synthétique, et prévient : « Il y a une chose dont vos esprits doivent bien se pénétrer (il s'adresse à des étudiants) : l'oeuvre n'est pas autobiographique, le narrateur n'est pas Proust en tant qu'individu, et les personnages n'ont jamais existé ailleurs que dans l'esprit de l'auteur. » (...) « Proust est un prisme. Son seul objet est de réfracter, et, par réfraction, de recréer rétrospectivement un monde. « (...) « Les créatures prismatiques de Proust n'ont pas d'emploi, leur emploi est d'amuser l'auteur. » Nous entrons ainsi dans une oeuvre d'art dont l'ampleur est considérable. Nous sommes au sein d'une évocation gigantesque et aux ramifications qui semblent infinies, pas d'une description. Ni d'une autofiction, suis-je tenté d'ajouter. Ce serait trop facile! Et les Doubrovsky et autres Vilain se réjouiraient en hâte. Non. Proust est autrement plus complexe tout en restant limpide, par la force surhumaine de son style, par la grâce dont la Recherche est empreinte de la première ligne à la dernière (pour peu que l'on sache tourner les pages lorsqu'il le faut; à bon escient). « En matière de générosité verbale, dit Nabokov à propos de l'usage de la métaphore par Proust, c'est un véritable Père Noël. » Chez Proust, poursuit-il, « conversations et descriptions s'entremêlent, créant une nouvelle unité où fleur et insecte appartiennent à un seul et même arbre en fleurs. » Je pense alors à la peinture d'EkAT. Aux remarques de Christiane à ce sujet et à propos de ses propres créations graphiques. Et je retourne illico à Nabokov : celui-ci souligne avec tact une façon de déplier l'image comme un éventail, procédé caractéristiquement proustien. Prenons « le » personnage. Proust, selon Nabokov, l'appréhende comme une personnalité connue de façon comparative seulement, jamais de façon absolue. Aussi, « au lieu de le hacher menu (façon Joyce avec Ulysse), il nous montre tel personnage à travers l'idée que d'autres personnages se font de ce personnage. Et il espère, après avoir donné une série de ces prismes et de ces reflets, les combiner pour en faire une réalité artistique. » Bien sûr, Nabokov évoque –avec une infinie douceur, pas comme un chirurgien de l’Université ou un critique littéraire armé de sourds couteaux revanchards -, la madeleine, le baiser de maman, Combray, la flèche pourpre, la crème au chocolat, Méséglise, Vinteuil, Léonie, la jalousie –qui éclatera beaucoup plus loin avec Albertine, Guermantes, les cattleyas… Mais il ne brille jamais aussi intensément que lorsqu’il parle de cette notion du temps incorporé, de ce quelque chose de plus que la mémoire. « Un bouquet de sensations dans le présent et la vision d’un événement ou d’une sensation dans le passé, voilà où la sensation et la mémoire se rejoignent, où le temps perdu se retrouve. » Chef d’œuvre, vous dis-je!
synthétique, et prévient : « Il y a une chose dont vos esprits doivent bien se pénétrer (il s'adresse à des étudiants) : l'oeuvre n'est pas autobiographique, le narrateur n'est pas Proust en tant qu'individu, et les personnages n'ont jamais existé ailleurs que dans l'esprit de l'auteur. » (...) « Proust est un prisme. Son seul objet est de réfracter, et, par réfraction, de recréer rétrospectivement un monde. « (...) « Les créatures prismatiques de Proust n'ont pas d'emploi, leur emploi est d'amuser l'auteur. » Nous entrons ainsi dans une oeuvre d'art dont l'ampleur est considérable. Nous sommes au sein d'une évocation gigantesque et aux ramifications qui semblent infinies, pas d'une description. Ni d'une autofiction, suis-je tenté d'ajouter. Ce serait trop facile! Et les Doubrovsky et autres Vilain se réjouiraient en hâte. Non. Proust est autrement plus complexe tout en restant limpide, par la force surhumaine de son style, par la grâce dont la Recherche est empreinte de la première ligne à la dernière (pour peu que l'on sache tourner les pages lorsqu'il le faut; à bon escient). « En matière de générosité verbale, dit Nabokov à propos de l'usage de la métaphore par Proust, c'est un véritable Père Noël. » Chez Proust, poursuit-il, « conversations et descriptions s'entremêlent, créant une nouvelle unité où fleur et insecte appartiennent à un seul et même arbre en fleurs. » Je pense alors à la peinture d'EkAT. Aux remarques de Christiane à ce sujet et à propos de ses propres créations graphiques. Et je retourne illico à Nabokov : celui-ci souligne avec tact une façon de déplier l'image comme un éventail, procédé caractéristiquement proustien. Prenons « le » personnage. Proust, selon Nabokov, l'appréhende comme une personnalité connue de façon comparative seulement, jamais de façon absolue. Aussi, « au lieu de le hacher menu (façon Joyce avec Ulysse), il nous montre tel personnage à travers l'idée que d'autres personnages se font de ce personnage. Et il espère, après avoir donné une série de ces prismes et de ces reflets, les combiner pour en faire une réalité artistique. » Bien sûr, Nabokov évoque –avec une infinie douceur, pas comme un chirurgien de l’Université ou un critique littéraire armé de sourds couteaux revanchards -, la madeleine, le baiser de maman, Combray, la flèche pourpre, la crème au chocolat, Méséglise, Vinteuil, Léonie, la jalousie –qui éclatera beaucoup plus loin avec Albertine, Guermantes, les cattleyas… Mais il ne brille jamais aussi intensément que lorsqu’il parle de cette notion du temps incorporé, de ce quelque chose de plus que la mémoire. « Un bouquet de sensations dans le présent et la vision d’un événement ou d’une sensation dans le passé, voilà où la sensation et la mémoire se rejoignent, où le temps perdu se retrouve. » Chef d’œuvre, vous dis-je!
 Yeux bleus, cheveux mi-longs, voix grave, jeans & pieds froids sur le seuil, il sonna, menaçant sans doute, de l'index droit. J'eus la lâcheté de ne pas répondre immédiatement. Coldplay m'enivrait. Vrai. Minuit : l'heure du scream... "Ohé, on va se calmer sur la musique, sinon dans 2 minutes, j'appelle les flics". Waasssccchhh... Vérification faite de l'oeil droit, le volume hi-fique affichait 27 (genre : thermostat 8...). Chaudlesmarrons. Dakodak. Vu que la réserve de Ricard était à moins sec depuis des plombes, il aurait été impossible d'honorer convenablement la visite d'une maréchaussée réputée sans humour (dans cet arrondissement et alentour itou) et seulement solvable -ou soluble-, dans le "Jaune". Avec ou sans glace, d'ailleurs. So... Je suis passé au thermostat 3. Genre timidousse cuisine végétarienne sans sel pour endive bouillie spécialement moulée pour plateau d'hosto calibré mince. Mince alors. Et là, j'écoute quoi, à présent? Brahms? Mozart... Mieux vaut retourner à la fenêtre et mater les taxis qui ne s'arrêtent pas devant des bras levés, timides, trop timides (les bras). Trop cons (décidément) les tacots. Et finir, vautré, sous couette, A l'ombre des jeunes filles en fleur (Marcel) et Au-delà du fleuve et sous les arbres (Hem'). Genre, toujours...
Yeux bleus, cheveux mi-longs, voix grave, jeans & pieds froids sur le seuil, il sonna, menaçant sans doute, de l'index droit. J'eus la lâcheté de ne pas répondre immédiatement. Coldplay m'enivrait. Vrai. Minuit : l'heure du scream... "Ohé, on va se calmer sur la musique, sinon dans 2 minutes, j'appelle les flics". Waasssccchhh... Vérification faite de l'oeil droit, le volume hi-fique affichait 27 (genre : thermostat 8...). Chaudlesmarrons. Dakodak. Vu que la réserve de Ricard était à moins sec depuis des plombes, il aurait été impossible d'honorer convenablement la visite d'une maréchaussée réputée sans humour (dans cet arrondissement et alentour itou) et seulement solvable -ou soluble-, dans le "Jaune". Avec ou sans glace, d'ailleurs. So... Je suis passé au thermostat 3. Genre timidousse cuisine végétarienne sans sel pour endive bouillie spécialement moulée pour plateau d'hosto calibré mince. Mince alors. Et là, j'écoute quoi, à présent? Brahms? Mozart... Mieux vaut retourner à la fenêtre et mater les taxis qui ne s'arrêtent pas devant des bras levés, timides, trop timides (les bras). Trop cons (décidément) les tacots. Et finir, vautré, sous couette, A l'ombre des jeunes filles en fleur (Marcel) et Au-delà du fleuve et sous les arbres (Hem'). Genre, toujours... il faut savoir nager dans ses propres larmes comme dans une rivière (dostoïevsky)
il faut savoir nager dans ses propres larmes comme dans une rivière (dostoïevsky) Il y eut d'abord son geste faible du bras droit -l'autre était depuis plusieurs semaines saisi par la paralysie- pour retenir la vie, pour dire des mots, les derniers, avec les doigts. En avancant ce bras. La parole ne montait plus. Les lèvres restaient closes. Le regard était droit. Dur. Mais comme la volonté, l'expression, la franchise intérieure peuvent l'être. Tout son être, le concentré de son existence se trouvaient là. Au bout de ce bras, de ces cinq doigts qui tremblaient vers moi. Au bout de ces deux yeux, que quelque chose de funeste commencait de voiler légèrement. Soie.
Il y eut d'abord son geste faible du bras droit -l'autre était depuis plusieurs semaines saisi par la paralysie- pour retenir la vie, pour dire des mots, les derniers, avec les doigts. En avancant ce bras. La parole ne montait plus. Les lèvres restaient closes. Le regard était droit. Dur. Mais comme la volonté, l'expression, la franchise intérieure peuvent l'être. Tout son être, le concentré de son existence se trouvaient là. Au bout de ce bras, de ces cinq doigts qui tremblaient vers moi. Au bout de ces deux yeux, que quelque chose de funeste commencait de voiler légèrement. Soie. 2007 sera l'année René Char (il est né en 1907) : grande expo en mai à la BNF (et jusqu'en septembre), publications diverses, notamment par Poésie/Gallimard, le Printemps des poètes aura pour thème : "Lettera amorosa" -sans doute le plus beau poème d'amour en prose jamais écrit au XXè siècle (avec "Prose pour l'étrangère", de Gracq), et qui sera réédité pour l'occasion, etc.
2007 sera l'année René Char (il est né en 1907) : grande expo en mai à la BNF (et jusqu'en septembre), publications diverses, notamment par Poésie/Gallimard, le Printemps des poètes aura pour thème : "Lettera amorosa" -sans doute le plus beau poème d'amour en prose jamais écrit au XXè siècle (avec "Prose pour l'étrangère", de Gracq), et qui sera réédité pour l'occasion, etc. La sérénité rétablira peu à peu ses quartiers
La sérénité rétablira peu à peu ses quartiers Achat d'un beau citronnier, hier soir, qui porte seize citrons dodus.
Achat d'un beau citronnier, hier soir, qui porte seize citrons dodus.

 C'est l'après-midi. Un soleil magnifique et d'une douceur incroyable pour novembre inonde la chambre. Par la fenêtre grande ouverte, j'aperçois la montagne Basque. Ses yeux ne peuvent plus la voir. Nous sommes seuls tous les deux. Je caresse doucement sa main et son bras droits velus depuis de longues minutes de grand calme, tout en parcourant les titres du journal ouvert sur la couette. Soudain, il me demande si je pense qu'il en a encore pour trois ou quatre jours à vivre, ou bien un peu plus. Je luis
C'est l'après-midi. Un soleil magnifique et d'une douceur incroyable pour novembre inonde la chambre. Par la fenêtre grande ouverte, j'aperçois la montagne Basque. Ses yeux ne peuvent plus la voir. Nous sommes seuls tous les deux. Je caresse doucement sa main et son bras droits velus depuis de longues minutes de grand calme, tout en parcourant les titres du journal ouvert sur la couette. Soudain, il me demande si je pense qu'il en a encore pour trois ou quatre jours à vivre, ou bien un peu plus. Je luis fais promettre un peu bêtement, avec une voix que je me reproche d'avoir à cet instant (façon infirmière : dans la dénégation punchy -pris au dépourvu, je ne trouve rien d'autre), de fêter Noël en famille, ici même, dans sa chambre! Son regard de vérité fait écho à un terrible silence. Pour faire diversion, je lui demande s’il veut écouter de la musique, car depuis que ma fille a eu la bonne idée d’installer une chaîne hi-fi près de son lit, Verdi, Puccini et Tino Rossi l’apaisent et le font même chantonner faiblement. Tu préfères écouter quoi ? Verdi ou Tino ? Il répond : la meilleure des musiques, en faisant le geste de porter un verre à sa bouche, pouce dressé comme un autostoppeur… Je suis stupéfait. Je vérifie : Tu veux quoi ? Il me dit : Du tariquet glacé. Cela fait quelque temps qu’il accompagne sa douzaine d’huîtres quotidienne d’un verre de ce vin blanc sec du Gers. Décidé à ne rien lui refuser, je monte la bouteille et un verre. Il me demande de trinquer avec lui... Tchin-tchin. Il siffle
fais promettre un peu bêtement, avec une voix que je me reproche d'avoir à cet instant (façon infirmière : dans la dénégation punchy -pris au dépourvu, je ne trouve rien d'autre), de fêter Noël en famille, ici même, dans sa chambre! Son regard de vérité fait écho à un terrible silence. Pour faire diversion, je lui demande s’il veut écouter de la musique, car depuis que ma fille a eu la bonne idée d’installer une chaîne hi-fi près de son lit, Verdi, Puccini et Tino Rossi l’apaisent et le font même chantonner faiblement. Tu préfères écouter quoi ? Verdi ou Tino ? Il répond : la meilleure des musiques, en faisant le geste de porter un verre à sa bouche, pouce dressé comme un autostoppeur… Je suis stupéfait. Je vérifie : Tu veux quoi ? Il me dit : Du tariquet glacé. Cela fait quelque temps qu’il accompagne sa douzaine d’huîtres quotidienne d’un verre de ce vin blanc sec du Gers. Décidé à ne rien lui refuser, je monte la bouteille et un verre. Il me demande de trinquer avec lui... Tchin-tchin. Il siffle  deux verres, lui qui n'a jamais bu ni fumé. La meilleure des musiques… Désir de femme enceinte, d’aquoiboniste en partance, d’hédoniste encore et toujours du côté de la vie, jusqu’à la lie. L'hallali. La la lère...
deux verres, lui qui n'a jamais bu ni fumé. La meilleure des musiques… Désir de femme enceinte, d’aquoiboniste en partance, d’hédoniste encore et toujours du côté de la vie, jusqu’à la lie. L'hallali. La la lère... j'adore cette déclaration que fit Daniel Emilfork (qui a quitté ce monde avant-hier, non sans l'avoir marqué de son physique hiératique et inquiétant, de Nosferatu -de Murnau-, de dandy désinvolte, de sa voix si grave, de ses regards si perçants, de son jeu si fébrilement calme, dans une quantité impressionnante de seconds rôles au cinéma et au théâtre) = "Je suis acteur pour que les jeunes gens et les vieux écrivent des poèmes et aient des utopies. Je veux que les gens rêvent à un autre monde". J'ai prélevé ceci dans la belle "nécro" signée Fabienne Darge, qui a rencontré Emilfork en 2003, et publiée par "Le Monde" de ce jeudi soir. Et je suis ému. Rien à ajouter, donc. L'émotion opère. Elle fait son travail.
j'adore cette déclaration que fit Daniel Emilfork (qui a quitté ce monde avant-hier, non sans l'avoir marqué de son physique hiératique et inquiétant, de Nosferatu -de Murnau-, de dandy désinvolte, de sa voix si grave, de ses regards si perçants, de son jeu si fébrilement calme, dans une quantité impressionnante de seconds rôles au cinéma et au théâtre) = "Je suis acteur pour que les jeunes gens et les vieux écrivent des poèmes et aient des utopies. Je veux que les gens rêvent à un autre monde". J'ai prélevé ceci dans la belle "nécro" signée Fabienne Darge, qui a rencontré Emilfork en 2003, et publiée par "Le Monde" de ce jeudi soir. Et je suis ému. Rien à ajouter, donc. L'émotion opère. Elle fait son travail. Politis est aux abois et lance un appel (le polithon), pour rassembler un million d'euros avant la fin du mois.
Politis est aux abois et lance un appel (le polithon), pour rassembler un million d'euros avant la fin du mois. "Nous sommes partisans après l'incendie d'effacer les traces et de murer le labyrinthe. On ne prolonge pas un climat exceptionnel". René Char
"Nous sommes partisans après l'incendie d'effacer les traces et de murer le labyrinthe. On ne prolonge pas un climat exceptionnel". René Char souviens absolument pas : "Oui, tout ce bruit !.. quand la paix serait d'aimer, et de créer en silence. Mais il faut savoir patienter. Encore un moment, le soleil scelle les bouches".
souviens absolument pas : "Oui, tout ce bruit !.. quand la paix serait d'aimer, et de créer en silence. Mais il faut savoir patienter. Encore un moment, le soleil scelle les bouches". l'efficacité du novelliste au vocabulaire simple ("La Chute", "L'Exil et le royaume"), l'épaisseur du romancier ("La Peste")...
l'efficacité du novelliste au vocabulaire simple ("La Chute", "L'Exil et le royaume"), l'épaisseur du romancier ("La Peste")... On dit du tango que c’est un sentiment qui se danse. Le flamenco est au-delà : c’est un sentiment dansé. Le flamenco est un tesson de tragédie en travers d’une gorge éraillée qui chante la douleur du monde, et en particulier celle de l’amour. C’est un éclat noir sous lequel on devine le sang et l’eau, le cœur et la sueur, le sein et le suaire. Le cri. Le flamenco est un sentiment qui se creuse pour cambrer la parole. Et le regard. Cette concentration, ce ramassé comme on le dit d’un félin prêt à bondir sur sa proie qu’il tient déjà entre ses yeux, cette chispa (étincelle), est une façon d’être. D’habiter le monde. Etre flamenco… Comme on naît torero. Les coplas flamencas, ces haïkus andalous issus de l’âme gitane noire, incandescente, indomptable, fière, sont les paraboles de l’amour dansé : Ton visage, c’est la Sierra Morena, et tes yeux, les bandits qu’on y rencontre. Le flamenco, c’est cette Lointaine solitude sonore dont parle l’immense poète Rafael Alberti, Source sans fin d’insomnie d’où jaillit, du toreo la musique tue. Le flamenco, c’est à peine une ombre portée, un poignet cassé, un regard plus noir que la nuit, une cuisse dénudée. Le flamenco traduit avec douleur, mais les dents serrées (en parlant bouche fermée), la langue noueuse du corps à cœur : Va et que l’on te tire dessus avec la poudre de mes yeux et les balles de mes soupirs.
On dit du tango que c’est un sentiment qui se danse. Le flamenco est au-delà : c’est un sentiment dansé. Le flamenco est un tesson de tragédie en travers d’une gorge éraillée qui chante la douleur du monde, et en particulier celle de l’amour. C’est un éclat noir sous lequel on devine le sang et l’eau, le cœur et la sueur, le sein et le suaire. Le cri. Le flamenco est un sentiment qui se creuse pour cambrer la parole. Et le regard. Cette concentration, ce ramassé comme on le dit d’un félin prêt à bondir sur sa proie qu’il tient déjà entre ses yeux, cette chispa (étincelle), est une façon d’être. D’habiter le monde. Etre flamenco… Comme on naît torero. Les coplas flamencas, ces haïkus andalous issus de l’âme gitane noire, incandescente, indomptable, fière, sont les paraboles de l’amour dansé : Ton visage, c’est la Sierra Morena, et tes yeux, les bandits qu’on y rencontre. Le flamenco, c’est cette Lointaine solitude sonore dont parle l’immense poète Rafael Alberti, Source sans fin d’insomnie d’où jaillit, du toreo la musique tue. Le flamenco, c’est à peine une ombre portée, un poignet cassé, un regard plus noir que la nuit, une cuisse dénudée. Le flamenco traduit avec douleur, mais les dents serrées (en parlant bouche fermée), la langue noueuse du corps à cœur : Va et que l’on te tire dessus avec la poudre de mes yeux et les balles de mes soupirs. c'est de camus (le titre), et cela m'évoque cette ambiance consommatrice, du tout jetable, du rien réparable.
c'est de camus (le titre), et cela m'évoque cette ambiance consommatrice, du tout jetable, du rien réparable. 3h45 du matin. Le thé vert à la menthe est brûlant. Je reprends « Vie secrète », de Pascal Quignard dans la bibliothèque, comme on casse une barre de chocolat aux noisettes –en appuyant fermement sur la tablette, puis en ôtant le papier aluminium déchiré.
3h45 du matin. Le thé vert à la menthe est brûlant. Je reprends « Vie secrète », de Pascal Quignard dans la bibliothèque, comme on casse une barre de chocolat aux noisettes –en appuyant fermement sur la tablette, puis en ôtant le papier aluminium déchiré. y a sa désertion. Il y a l’ivresse, l’apnée et le vertige. Il y a l’incomplétude et la vulnérabilité. Il y a la fascination et il y a la patience. Il y a le plaisir –pulvérisateur du désir, et il y a la fulgurance : le coup de feu ; de foudre. Il y a l’anagramme troublante : sidérée, désirée. Il y a le fond de ton ventre et la périphérie, où rôdent les fauves. Il y a l’espace et il y a la tanière. Il y a la connivencia et il y a l’ineffable. Il y a les nuages et il y a deux amoureux –forcément coupés du monde. Il y a le silence sonore et il y a la solitude sonore, aussi. Il y a une haie tout au bout du pré, et des grives dedans qui jailliront à ton approche. Mais il en restera toujours une ou deux pour fuir du buis et du roncier, dans un fracas de plumes et de peur, lorsque tu seras à les toucher. Ce sont tes frères d’émotion. Tes compagnons de l’aube. Toujours recommencée. Veille sur eux.
y a sa désertion. Il y a l’ivresse, l’apnée et le vertige. Il y a l’incomplétude et la vulnérabilité. Il y a la fascination et il y a la patience. Il y a le plaisir –pulvérisateur du désir, et il y a la fulgurance : le coup de feu ; de foudre. Il y a l’anagramme troublante : sidérée, désirée. Il y a le fond de ton ventre et la périphérie, où rôdent les fauves. Il y a l’espace et il y a la tanière. Il y a la connivencia et il y a l’ineffable. Il y a les nuages et il y a deux amoureux –forcément coupés du monde. Il y a le silence sonore et il y a la solitude sonore, aussi. Il y a une haie tout au bout du pré, et des grives dedans qui jailliront à ton approche. Mais il en restera toujours une ou deux pour fuir du buis et du roncier, dans un fracas de plumes et de peur, lorsque tu seras à les toucher. Ce sont tes frères d’émotion. Tes compagnons de l’aube. Toujours recommencée. Veille sur eux.