Confirmez si vous venez, mais venez, au moins boire une coupe

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

 Dans le n°118 qui paraît, le bel article de Jean-Marc Gatteron :
Dans le n°118 qui paraît, le bel article de Jean-Marc Gatteron :
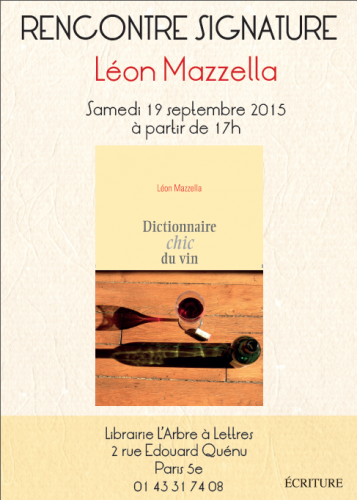
(Merci à Christian Authier pour cette belle page).
Si vous n'avez rien de mieux à écouter tout à l'heure (de 20h à 21h), allumez la radio : l'émission de Frédéric Taddei, "Europe1 Social Club", accueille Denis Tillinac, Serge Bramly, Christian Berst et votre serviteur.

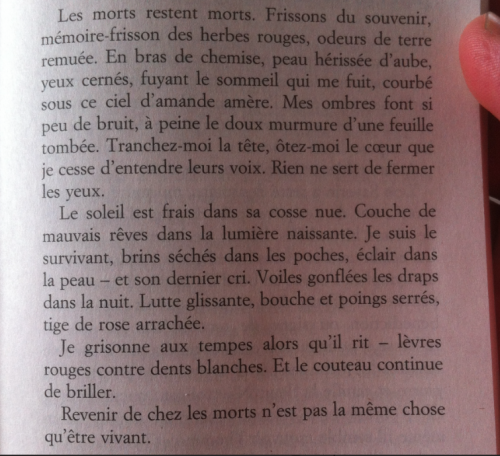 ... de pénétrer une oeuvre est souvent d'en lire la première page. L'incipit, et au-delà de lui. Voici celle des Nouveaux monstres, de Simonetta Greggio, qui reparaît en format de poche et qui fait suite à son magnifique Dolce Vita (Stock, et Poche). Ce livre, qui resserre, relate, compresse, analyse, crie, les années 1978-2014 en Italie, son pays, cette Botte tissée de relations troubles, impures, incestueuses, grotesques, picaresques, baroques, insolentes et risibles comme certaines amours - entre l'Etat, le Vatican (l'autre Etat) et la Mafia (l'Etat suprême?). Un grand livre.
... de pénétrer une oeuvre est souvent d'en lire la première page. L'incipit, et au-delà de lui. Voici celle des Nouveaux monstres, de Simonetta Greggio, qui reparaît en format de poche et qui fait suite à son magnifique Dolce Vita (Stock, et Poche). Ce livre, qui resserre, relate, compresse, analyse, crie, les années 1978-2014 en Italie, son pays, cette Botte tissée de relations troubles, impures, incestueuses, grotesques, picaresques, baroques, insolentes et risibles comme certaines amours - entre l'Etat, le Vatican (l'autre Etat) et la Mafia (l'Etat suprême?). Un grand livre.
Mon Dictionnaire chic du vin figure dans la première sélection du Prix Renaudot essai, selon le site de L'Obs : bibliobs (cliquer ci-dessous), mais pas sur les listes publiées par les sites du Figaro (lefigaro.fr) et du Monde (lemonde.fr). On se calme : Sherlock-Bacchus mène l'enquête!..

 Un papier d'Emmanuel Hecht sur mon dicOchic. Détail : je cherche l'auteur des jeux de mots cités, qui sont anonymes.
Un papier d'Emmanuel Hecht sur mon dicOchic. Détail : je cherche l'auteur des jeux de mots cités, qui sont anonymes.
Enfin : le livre paraît le 16. Réservez-le.
http://www.lexpress.fr/culture/livre/l-homme-des-tavernes-de-a-a-z_1714398.html
Précision : le livre paraît le 16.

http://www.theglamattitude.com/index.php/indispensable-dictionnaire-chic-du-vin/
 Le meilleur livre de la rentrée de septembre est paru en juin. Les Œuvres complètes de l’immense Louis-René des Forêts (1918-2000), sont le très beau cadeau de l’été, que la collection Quarto de Gallimard (une collection qui se bonifie considérablement avec le temps *, en laissant sur le carreau ses concurrentes : Bouquins/Laffont, Omnibus), a fait aux aficionados de l’auteur inoubliable du Bavard et d’Ostinato, pour ne citer que deux ouvrages majeurs que l’on se plait à relire régulièrement, pour le plaisir de la langue, celui de l’émotion forte, très forte, que des Forêts instille (« faire passer dans les mots la sève fertilisante sans laquelle ils ne sont que du bois mort »). L’édition, assurée par le talentueux Dominique Rabaté, universitaire sans les défauts inhérents à la profession, est un spécialiste de l’auteur. Le volumineux pavé (1342 pages) s’ouvre sur un précieux album de famille, où de nombreuses photos, des lettres (pas seulement à des écrivains célèbres, mais aussi à des amis très chers – comme l’entendait Montaigne, et pas facebook -, tels Jean de Frotté), une biographie précise et chaleureuse, sont agréablement dispersées, afin d’entrer dans l’œuvre – par une nouvelle inédite, de surcroît, intitulée Les Coupables -, de la manière la plus douce qui soit, la plus musicale, pourrait-on dire, puisque Louis-René des Forêts fut habité toute sa vie par la musique, au point de faire de son premier roman, Les Mendiants, une sorte de suite polyphonique, et de chacun de ses livres, l’écho au « fil conducteur » de son existence. Le volume que nous tenons en mains est par ailleurs riche de témoignages nombreux et prestigieux, qui vont de Maurice Blanchot (et son célèbre texte sur Le Bavard, intitulé La Parole vaine, qui figura dans une édition rare en 10/18), à Jean-Louis Ezine (un entretien clé à propos d’Ostinato), en passant par Philippe Jaccottet (superbe texte d’analyse droite et rigoureuse d’un écrivain que le grand poète de Grignan admire), Michel Leiris, Raymond Queneau (des Forêts participa avec Monsieur Zazie, à la création de l’Encyclopédie de La Pléiade, avant de devenir membre du comité de lecture de « la Banque de France de l’édition », laquelle publia, avec sa filiale le Mercure de France, la majeure partie de son œuvre), et encore André Frénaud, Pascal Quignard, Marcel Arland, Jean Roudaut, Pierre Klossowski, Charles du Bos, André du Bouchet… Du beau linge, et des textes enrichissants, tant sur ce que l’on apprend de l’auteur de Pas à pas jusqu’au dernier, que sur le travail, l’écriture ou tout simplement l’amitié de ces compagnons de route, de ces « alliés substantiels ». Il fut beaucoup reproché à des Forêts de cesser d’écrire, après avoir conquis un lectorat fidèle et ayant pris goût. Il se mit alors à peindre dix années durant et se tût – littérairement -, environ dix de plus (et le volume « donne à voir » ses peintures, tourmentées, imprégnées à la fois d’un surréalisme figuratif, et d’une fantasmagorie à la Jérôme Bosch). Il faut savoir que l’année 1965 fut la cassure majeure de la vie de l’écrivain. Sa fille Elisabeth mourut accidentellement à l’âge de quatorze ans, et d’une telle déchirure, nul ne se remet. Cependant, le père terrassé, désagrégé, commence alors à bâtir en silence, pierre à pierre, un travail de deuil qui ressemble à la tâche de Sisyphe, ou bien à une entreprise vaine et condamnée d’avance. Cela s’appellera, après plusieurs tentatives de renoncement, quelques publications fragmentaires en revue, Ostinato, en 1997. (Au Mercure de France d’abord, dans L’Imaginaire/Gallimard aujourd’hui, en plus de l’édition monumentale dont nous rendons compte). Un chef d’œuvre, même si cette expression est par trop usitée et par conséquent galvaudée. Un livre inclassable et incassable, bien qu’il semble fait de cristal. Et de cendre, ou plutôt de pluie d’étoiles. Ostinato, ou obstinément, le devoir d’achèvement, est l'un des plus somptueux hommages faits à la langue française de ces dernières décennies. Ce livre semble avoir été écrit comme Beethoven composa ses plus beaux quatuors, soit une fois devenu totalement sourd. Des Forêts l’entendait un peu, et sans forfanterie, de cette oreille (et il les avait grandes). Ostinato, avec Le Bavard, Les Mégères de la mer, les Poèmes de Samuel Wood aussi, sont de ces textes que l’on a plaisir à lire à voix haute à un être cher, tout en marchant, livre en main, dans la campagne ou dans un sous-bois. Livre de recueillement, long poème en prose, livre d’une vie, livre-vie, livre de la déchirure et de l’impossible reconstruction, il est l’offrande musicale d’un auteur précieux et trop méconnu, à la fois à la littérature, au questionnement sur la langue – son pouvoir, sa raison d’être pour l’auteur, et pour un hypothétique lecteur aussi -, à cette « vieille arme ébréchée du langage », et enfin à l’essence de la vie même. Nous imaginons sans peine Le Bavard et son célèbre incipit : « Je me regarde souvent dans la glace. », lu au théâtre par un Sami Frey, un Claude Rich, un Jean-François Balmer (à la manière des Braises, de Sandor Marai, ou de Novecento, d’Alessandro Baricco, ou encore de Pour un oui ou pour un non, de Nathalie Sarraute : vous voyez ?..). Car il y a dans chacun des livres de Louis-René des Forêts, à la fois la suggestion musicale et le plaisir du texte qui ne demande qu’à être partagé… musicalement, fut-ce à la voix, notre principal, primitif instrument. Des Forêts est encore de ces noms d’auteurs qui se chuchotent. Le seul fait d’apercevoir quelqu’un lire l’un de ses livres, dans un transport en commun par exemple (mais cela est rarissime), suffit à nous persuader que nous appartenons à une même confrérie, et que nous souhaitons, l’inconnu(e) comme soi-même, qu’elle ne demeure pas une société secrète. La littérature a le don subtil de générer ce type de menu plaisir; et c’est heureux. Ecoutons Dominique Rabaté, qui ouvre son texte de présentation avec ces mots : « L’éclat du rire, le sel des larmes et la toute-puissante sauvagerie : voilà en une formule ternaire magnifique ce à quoi fait encore appel Louis-René des Forêts dans le dernier de ses grands livres, Ostinato. La vivacité d’une ironie frondeuse, l’amertume vivifiante qui déchire le cœur mais le baigne de sève marine, le sursaut de révolte puisé à même la force du monde extérieur auquel il faut s’accorder, ce sont là les qualités de cette ‘’voix de l’enfant’’ dont son œuvre fait résonner toutes les harmoniques. » Des Forêts fut toute sa vie également habité par la poésie. Ses amis et compagnons de la revue L’Ephémère se nomment Paul Celan, Jacques Dupin, Yves Bonnefoy, en plus des du Bouchet et Leiris précités. Les « voies et détours de sa fiction » emprunteront ainsi les voies royales du poème (de facture volontiers classique, voire hugolienne), en plus de la peinture. Sans jamais oublier une portée musicale pour toile de fond. Ce trio d’expressions, cette recherche pugnace de la clé qui ouvrira(it) tout, empêcheront ce « vœu de silence » majuscule qui manqua priver le lecteur de certains livres importants de Louis-René des Forêts, sommes-nous tentés d’ajouter égoïstement. L’auteur vécut si douloureusement cette « interminable expiation qui se vit dans la déchéance de survivre »... Habité par une « souffrance qui frappe si haut que la voix se retire », des Forêts lâcha : « S’imposer silence par dévotion au langage, c’est aussi comme sous-entendre que les mots sont facteurs de dévoiement. » Louis-René des Forêts fut encore l’écrivain braconnier qui pratiquait le détournement. Mais la littérature ne peut-elle pas être définie par le seul mot de détour ? C’est en tout cas ce que nous croyons fermement. A cet instant, il convient de prévenir de deux choses : des Forêts a été perçu comme « un écrivain pour écrivains ». Vous savez, cette expression commode qui permet de mettre dans un tiroir les très grands comme Julien Gracq, les maîtres, les « patrons », aurait dit Nourissier, en interdisant de facto leur accès « gratuit ». Un aveu d'élitisme corportatiste, en somme… Cela est considérablement réducteur, même si c'est extrêmement flatteur pour l’auteur qui se voit ainsi « classé ». Or, des Forêts est bien plus qu’un auteur que ses pairs respectent et dont ils se défendent de s’inspirer (tout au plus s’en imprègnent-ils, et c’est déjà un baume, un onguent suffisants). Il ne fut pas non plus, un précurseur ou un apôtre, à son corps défendant, de l’autofiction, et encore moins un adepte de la confession narcissique. Ni La Chambre des enfants, encore moins Face à l’immémorable – belle réflexion sur l’acte grave d’écrire -, ou même Le Malheur au Lido, ne constituent des textes dont une impudeur à peine déguisée aurait guidé la plume de leur auteur. Dominique Rabaté évoque plutôt une « autobiographie extérieure » (à propos d’Ostinato), comme on peut parler, avec humour, de journal extime, dès lors que l’on décide de rendre public ses carnets… Suivant en cela la belle formule du critique Robert Kanters (nous citons de mémoire) : « Le roman et le journal intime sont comme le vêtement et sa doublure, et cette dernière est d’une étoffe si fine et si précieuse que l’on peut être tenté de porter un jour le vêtement retourné. » En lisant des Forêts, auteur fragile, nous relevons des « manières de traces », nous découvrons « le corps obscurci de la mémoire », « tout ce qui respire à ciel ouvert » (couleurs, odeurs, humeurs), là où « le temps reste à la neige, le cœur brûlant toujours d’anciennes fièvres ». Nous éprouvons physiquement l’épaisseur des silences en picorant ses livres, et nous écoutons « les sourdes vibrations de sa fièvre prise comme un fleuve dans le gel qui craque au premier souffle printanier. » Une phrase, magnifique entre toutes, suffit à circonscrire l’âme et la rigueur de la prose poétique de son auteur : « Que jamais la voix de l’enfant en lui ne se taise, qu’elle tombe comme un don du ciel offrant aux mots desséchés l’éclat de son rire, le sel de ses larmes, sa toute-puissante sauvagerie. » Qu’on ne se méprenne donc pas : des Forêts a toujours tenu son je à distance, en respectant cette pudeur essentielle qui distinguera toujours le vécu mis en prose du livre authentique. C’est ainsi que, depuis Lucrèce, une voix intérieure, « venue d’ailleurs », parfois, peut toucher à l’universel. Cela s’appelle encore la littérature. Faites passer. Léon Mazzella
Le meilleur livre de la rentrée de septembre est paru en juin. Les Œuvres complètes de l’immense Louis-René des Forêts (1918-2000), sont le très beau cadeau de l’été, que la collection Quarto de Gallimard (une collection qui se bonifie considérablement avec le temps *, en laissant sur le carreau ses concurrentes : Bouquins/Laffont, Omnibus), a fait aux aficionados de l’auteur inoubliable du Bavard et d’Ostinato, pour ne citer que deux ouvrages majeurs que l’on se plait à relire régulièrement, pour le plaisir de la langue, celui de l’émotion forte, très forte, que des Forêts instille (« faire passer dans les mots la sève fertilisante sans laquelle ils ne sont que du bois mort »). L’édition, assurée par le talentueux Dominique Rabaté, universitaire sans les défauts inhérents à la profession, est un spécialiste de l’auteur. Le volumineux pavé (1342 pages) s’ouvre sur un précieux album de famille, où de nombreuses photos, des lettres (pas seulement à des écrivains célèbres, mais aussi à des amis très chers – comme l’entendait Montaigne, et pas facebook -, tels Jean de Frotté), une biographie précise et chaleureuse, sont agréablement dispersées, afin d’entrer dans l’œuvre – par une nouvelle inédite, de surcroît, intitulée Les Coupables -, de la manière la plus douce qui soit, la plus musicale, pourrait-on dire, puisque Louis-René des Forêts fut habité toute sa vie par la musique, au point de faire de son premier roman, Les Mendiants, une sorte de suite polyphonique, et de chacun de ses livres, l’écho au « fil conducteur » de son existence. Le volume que nous tenons en mains est par ailleurs riche de témoignages nombreux et prestigieux, qui vont de Maurice Blanchot (et son célèbre texte sur Le Bavard, intitulé La Parole vaine, qui figura dans une édition rare en 10/18), à Jean-Louis Ezine (un entretien clé à propos d’Ostinato), en passant par Philippe Jaccottet (superbe texte d’analyse droite et rigoureuse d’un écrivain que le grand poète de Grignan admire), Michel Leiris, Raymond Queneau (des Forêts participa avec Monsieur Zazie, à la création de l’Encyclopédie de La Pléiade, avant de devenir membre du comité de lecture de « la Banque de France de l’édition », laquelle publia, avec sa filiale le Mercure de France, la majeure partie de son œuvre), et encore André Frénaud, Pascal Quignard, Marcel Arland, Jean Roudaut, Pierre Klossowski, Charles du Bos, André du Bouchet… Du beau linge, et des textes enrichissants, tant sur ce que l’on apprend de l’auteur de Pas à pas jusqu’au dernier, que sur le travail, l’écriture ou tout simplement l’amitié de ces compagnons de route, de ces « alliés substantiels ». Il fut beaucoup reproché à des Forêts de cesser d’écrire, après avoir conquis un lectorat fidèle et ayant pris goût. Il se mit alors à peindre dix années durant et se tût – littérairement -, environ dix de plus (et le volume « donne à voir » ses peintures, tourmentées, imprégnées à la fois d’un surréalisme figuratif, et d’une fantasmagorie à la Jérôme Bosch). Il faut savoir que l’année 1965 fut la cassure majeure de la vie de l’écrivain. Sa fille Elisabeth mourut accidentellement à l’âge de quatorze ans, et d’une telle déchirure, nul ne se remet. Cependant, le père terrassé, désagrégé, commence alors à bâtir en silence, pierre à pierre, un travail de deuil qui ressemble à la tâche de Sisyphe, ou bien à une entreprise vaine et condamnée d’avance. Cela s’appellera, après plusieurs tentatives de renoncement, quelques publications fragmentaires en revue, Ostinato, en 1997. (Au Mercure de France d’abord, dans L’Imaginaire/Gallimard aujourd’hui, en plus de l’édition monumentale dont nous rendons compte). Un chef d’œuvre, même si cette expression est par trop usitée et par conséquent galvaudée. Un livre inclassable et incassable, bien qu’il semble fait de cristal. Et de cendre, ou plutôt de pluie d’étoiles. Ostinato, ou obstinément, le devoir d’achèvement, est l'un des plus somptueux hommages faits à la langue française de ces dernières décennies. Ce livre semble avoir été écrit comme Beethoven composa ses plus beaux quatuors, soit une fois devenu totalement sourd. Des Forêts l’entendait un peu, et sans forfanterie, de cette oreille (et il les avait grandes). Ostinato, avec Le Bavard, Les Mégères de la mer, les Poèmes de Samuel Wood aussi, sont de ces textes que l’on a plaisir à lire à voix haute à un être cher, tout en marchant, livre en main, dans la campagne ou dans un sous-bois. Livre de recueillement, long poème en prose, livre d’une vie, livre-vie, livre de la déchirure et de l’impossible reconstruction, il est l’offrande musicale d’un auteur précieux et trop méconnu, à la fois à la littérature, au questionnement sur la langue – son pouvoir, sa raison d’être pour l’auteur, et pour un hypothétique lecteur aussi -, à cette « vieille arme ébréchée du langage », et enfin à l’essence de la vie même. Nous imaginons sans peine Le Bavard et son célèbre incipit : « Je me regarde souvent dans la glace. », lu au théâtre par un Sami Frey, un Claude Rich, un Jean-François Balmer (à la manière des Braises, de Sandor Marai, ou de Novecento, d’Alessandro Baricco, ou encore de Pour un oui ou pour un non, de Nathalie Sarraute : vous voyez ?..). Car il y a dans chacun des livres de Louis-René des Forêts, à la fois la suggestion musicale et le plaisir du texte qui ne demande qu’à être partagé… musicalement, fut-ce à la voix, notre principal, primitif instrument. Des Forêts est encore de ces noms d’auteurs qui se chuchotent. Le seul fait d’apercevoir quelqu’un lire l’un de ses livres, dans un transport en commun par exemple (mais cela est rarissime), suffit à nous persuader que nous appartenons à une même confrérie, et que nous souhaitons, l’inconnu(e) comme soi-même, qu’elle ne demeure pas une société secrète. La littérature a le don subtil de générer ce type de menu plaisir; et c’est heureux. Ecoutons Dominique Rabaté, qui ouvre son texte de présentation avec ces mots : « L’éclat du rire, le sel des larmes et la toute-puissante sauvagerie : voilà en une formule ternaire magnifique ce à quoi fait encore appel Louis-René des Forêts dans le dernier de ses grands livres, Ostinato. La vivacité d’une ironie frondeuse, l’amertume vivifiante qui déchire le cœur mais le baigne de sève marine, le sursaut de révolte puisé à même la force du monde extérieur auquel il faut s’accorder, ce sont là les qualités de cette ‘’voix de l’enfant’’ dont son œuvre fait résonner toutes les harmoniques. » Des Forêts fut toute sa vie également habité par la poésie. Ses amis et compagnons de la revue L’Ephémère se nomment Paul Celan, Jacques Dupin, Yves Bonnefoy, en plus des du Bouchet et Leiris précités. Les « voies et détours de sa fiction » emprunteront ainsi les voies royales du poème (de facture volontiers classique, voire hugolienne), en plus de la peinture. Sans jamais oublier une portée musicale pour toile de fond. Ce trio d’expressions, cette recherche pugnace de la clé qui ouvrira(it) tout, empêcheront ce « vœu de silence » majuscule qui manqua priver le lecteur de certains livres importants de Louis-René des Forêts, sommes-nous tentés d’ajouter égoïstement. L’auteur vécut si douloureusement cette « interminable expiation qui se vit dans la déchéance de survivre »... Habité par une « souffrance qui frappe si haut que la voix se retire », des Forêts lâcha : « S’imposer silence par dévotion au langage, c’est aussi comme sous-entendre que les mots sont facteurs de dévoiement. » Louis-René des Forêts fut encore l’écrivain braconnier qui pratiquait le détournement. Mais la littérature ne peut-elle pas être définie par le seul mot de détour ? C’est en tout cas ce que nous croyons fermement. A cet instant, il convient de prévenir de deux choses : des Forêts a été perçu comme « un écrivain pour écrivains ». Vous savez, cette expression commode qui permet de mettre dans un tiroir les très grands comme Julien Gracq, les maîtres, les « patrons », aurait dit Nourissier, en interdisant de facto leur accès « gratuit ». Un aveu d'élitisme corportatiste, en somme… Cela est considérablement réducteur, même si c'est extrêmement flatteur pour l’auteur qui se voit ainsi « classé ». Or, des Forêts est bien plus qu’un auteur que ses pairs respectent et dont ils se défendent de s’inspirer (tout au plus s’en imprègnent-ils, et c’est déjà un baume, un onguent suffisants). Il ne fut pas non plus, un précurseur ou un apôtre, à son corps défendant, de l’autofiction, et encore moins un adepte de la confession narcissique. Ni La Chambre des enfants, encore moins Face à l’immémorable – belle réflexion sur l’acte grave d’écrire -, ou même Le Malheur au Lido, ne constituent des textes dont une impudeur à peine déguisée aurait guidé la plume de leur auteur. Dominique Rabaté évoque plutôt une « autobiographie extérieure » (à propos d’Ostinato), comme on peut parler, avec humour, de journal extime, dès lors que l’on décide de rendre public ses carnets… Suivant en cela la belle formule du critique Robert Kanters (nous citons de mémoire) : « Le roman et le journal intime sont comme le vêtement et sa doublure, et cette dernière est d’une étoffe si fine et si précieuse que l’on peut être tenté de porter un jour le vêtement retourné. » En lisant des Forêts, auteur fragile, nous relevons des « manières de traces », nous découvrons « le corps obscurci de la mémoire », « tout ce qui respire à ciel ouvert » (couleurs, odeurs, humeurs), là où « le temps reste à la neige, le cœur brûlant toujours d’anciennes fièvres ». Nous éprouvons physiquement l’épaisseur des silences en picorant ses livres, et nous écoutons « les sourdes vibrations de sa fièvre prise comme un fleuve dans le gel qui craque au premier souffle printanier. » Une phrase, magnifique entre toutes, suffit à circonscrire l’âme et la rigueur de la prose poétique de son auteur : « Que jamais la voix de l’enfant en lui ne se taise, qu’elle tombe comme un don du ciel offrant aux mots desséchés l’éclat de son rire, le sel de ses larmes, sa toute-puissante sauvagerie. » Qu’on ne se méprenne donc pas : des Forêts a toujours tenu son je à distance, en respectant cette pudeur essentielle qui distinguera toujours le vécu mis en prose du livre authentique. C’est ainsi que, depuis Lucrèce, une voix intérieure, « venue d’ailleurs », parfois, peut toucher à l’universel. Cela s’appelle encore la littérature. Faites passer. Léon Mazzella
---
* Avec les récents volumes consacrés à Modiano, Maupassant, Montaigne, J.-B. Pontalis et très récemment Boualem Sansal, Quarto s’affirme en effet comme une collection de « semi-poche » (« de sac », plutôt) de premier plan.
Louis-René des Forêts, Œuvres complètes, Quarto/Gallimard, 28€.
 Il est paru ce matin et il est placé, comme toujours, sous la houlette de Philippe Bidalon. J'y invite à découvrir les crus communaux du muscadet (Gorges, Clisson, etc) : de grands vins blancs de garde issus de melon de Bourgogne, un cépage étonnant. Je fais part de très jolies découvertes en IGP Bouches-du-Rhône : des vins modestes, pas chers et excellents. Enfin, une troisième virée, à Gaillac cette fois, m'a permis de vérifier combien les cépages du cru brillaient, tant en blanc qu'en rouge, sur leur terroir originel. Bonne lecture.
Il est paru ce matin et il est placé, comme toujours, sous la houlette de Philippe Bidalon. J'y invite à découvrir les crus communaux du muscadet (Gorges, Clisson, etc) : de grands vins blancs de garde issus de melon de Bourgogne, un cépage étonnant. Je fais part de très jolies découvertes en IGP Bouches-du-Rhône : des vins modestes, pas chers et excellents. Enfin, une troisième virée, à Gaillac cette fois, m'a permis de vérifier combien les cépages du cru brillaient, tant en blanc qu'en rouge, sur leur terroir originel. Bonne lecture.



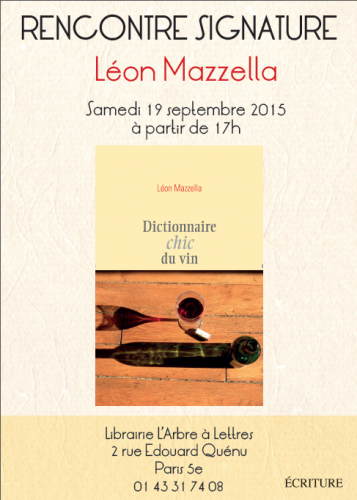
Merci à (la plume sagace d') Olivier Mony.
 Chaque fois (ces temps-ci, c'est quasiment chaque jour), cela me fait bizarre de le voir à la salle de gym (nous fréquentons la même et je ne vous donnerai pas son adresse, même sous la torture*). Un si grand écrivain** dans un corps si chétif a de quoi surprendre. Sa démarche lente, son air dubitatif devant les instruments de musculation, son short trop grand, son silence, ses regards sombres... Accepterait-il la soumission aux machines d'entretien du corps... Saisit-il ici matière à un prochain livre... Je me demande. Pour une fois, il n'enchaîne pas les cigarettes. Michel Houellebecq prend soin de lui. N'allez pas croire.
Chaque fois (ces temps-ci, c'est quasiment chaque jour), cela me fait bizarre de le voir à la salle de gym (nous fréquentons la même et je ne vous donnerai pas son adresse, même sous la torture*). Un si grand écrivain** dans un corps si chétif a de quoi surprendre. Sa démarche lente, son air dubitatif devant les instruments de musculation, son short trop grand, son silence, ses regards sombres... Accepterait-il la soumission aux machines d'entretien du corps... Saisit-il ici matière à un prochain livre... Je me demande. Pour une fois, il n'enchaîne pas les cigarettes. Michel Houellebecq prend soin de lui. N'allez pas croire.
J'en ai rencontré pas mal, des écrivains, et je continue d'en fréquenter. Ma plus belle rencontre fut Julien Gracq. Indépassable. Là, en baskets et tee-shirt trempé de sueur salutaire (pour ce qui me concerne), je ne me sens pas prêt pour une rencontre. Lui non plus, cela semble certain. Continuons par conséquent de brûler nos calories, à force de pédaler, de ramer, de courir surplace, de rêver en dedans, tandis que notre corps exsude, exulte d'une certaine façon, et que nous observons le granTécrivain en coin. Pour la soumission, nous verrons. Plus tard. Mais je ne suis plus très loin de penser, avec Alain Finkielkraut (ce qui suit est une phrase qu'il m'a dite lorsque je l'ai longuement interviewé pour L'Express, le 11 janvier dernier), que le premier parti de France est devenu celui de la soumission... Avec ou sans Houellebecq, c'est bien vu, non?
P.S. : je me fiche pour le moment de la (récente) polémique Le Monde et Ariane Chemin / Michel Houellebecq. Lisons la série de papiers que la très talentueuse journaliste consacre à l'auteur des Particules élémentaires, à paraître dès lundi dans notre quotidien préféré, et parlons-en (éventuellement) après.
Ariane Chemin / Michel Houellebecq. Lisons la série de papiers que la très talentueuse journaliste consacre à l'auteur des Particules élémentaires, à paraître dès lundi dans notre quotidien préféré, et parlons-en (éventuellement) après.
---
* Ceux qui veulent mon RIB n'ont qu'à m'écrire. Ah, mais!
** J'adore le lire, y compris sa poésie. Ses romans visionnaires, même s'ils prennent une gîte légère depuis peu sur le plan purement littéraire, ses essais déguisés en romans, donc, demeurent une lecture nécessaire, comme on parle de décryptage, pas à pas, de notre société mise à nu. Et c'est ainsi que Houellebecq est (plus) grand (qu'Allah).
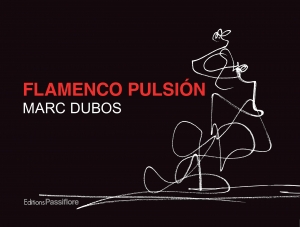 Marc Dubos, architecte de formation, vit dans les Landes et il est habité par l'Arte Flamenco (allusion au fameux festival éponyme qui se tient en juillet à Mont-de-Marsan). A l'instar de Jack Kerouac et de son célèbre rouleau, sur lequel il écrivit des mètres de Sur la route, Dubos possède son propre outil, la festigraph, qui lui permet de saisir sur le vif la danse (et la musique) flamenca au fur et à mesure qu'elle se déroulent devant lui, lors des spectacles dédiés. Il appelle cela la flamenscopie (nous préférons ajouter un co, ça sonne mieux). Comme les surréalistes pratiquaient l'écriture automatique, Dubos dessine, saisit sur le vif, croque à l'infini, et à une vitesse vertgineuse, quantité de dessins - jusqu'à cent par soirée -, et c'est une sélection de ceux-ci (noir sur blanc) que les éditions Passiflore proposent dans un recueil intitulé Flamenco pulsion (18€). Je me souviens du peintre taurin landais Jean Ducasse, qui vivait à Saubion (il a disparu en mai 2011), lorsqu'il dessinait à cent à l'heure, dans la tribune presse des arènes de Saint-Vincent de Tyrosse : un oeil et demi dans le ruedo, et un demi sur le papier, il enchaînait les dessins au trait sur des feuilles blanches de format A4, qu'il faisait tomber une à une à une cadence suffocante, et à la fin de la corrida, le sol était jonché de ces croquis saisis sur le vif. Dubos fait à peu près pareil, avec son festigraph, et sa patte est différente. Lui, choisit de saisir des instants, des gestes, des mouvements de danseurs flamenco, pas ceux des toreros. Une même chorégraphie déclinée sur des terrains distincts, pour exprimer à cru l'âme flamenca. ¡Olé! L.M.
Marc Dubos, architecte de formation, vit dans les Landes et il est habité par l'Arte Flamenco (allusion au fameux festival éponyme qui se tient en juillet à Mont-de-Marsan). A l'instar de Jack Kerouac et de son célèbre rouleau, sur lequel il écrivit des mètres de Sur la route, Dubos possède son propre outil, la festigraph, qui lui permet de saisir sur le vif la danse (et la musique) flamenca au fur et à mesure qu'elle se déroulent devant lui, lors des spectacles dédiés. Il appelle cela la flamenscopie (nous préférons ajouter un co, ça sonne mieux). Comme les surréalistes pratiquaient l'écriture automatique, Dubos dessine, saisit sur le vif, croque à l'infini, et à une vitesse vertgineuse, quantité de dessins - jusqu'à cent par soirée -, et c'est une sélection de ceux-ci (noir sur blanc) que les éditions Passiflore proposent dans un recueil intitulé Flamenco pulsion (18€). Je me souviens du peintre taurin landais Jean Ducasse, qui vivait à Saubion (il a disparu en mai 2011), lorsqu'il dessinait à cent à l'heure, dans la tribune presse des arènes de Saint-Vincent de Tyrosse : un oeil et demi dans le ruedo, et un demi sur le papier, il enchaînait les dessins au trait sur des feuilles blanches de format A4, qu'il faisait tomber une à une à une cadence suffocante, et à la fin de la corrida, le sol était jonché de ces croquis saisis sur le vif. Dubos fait à peu près pareil, avec son festigraph, et sa patte est différente. Lui, choisit de saisir des instants, des gestes, des mouvements de danseurs flamenco, pas ceux des toreros. Une même chorégraphie déclinée sur des terrains distincts, pour exprimer à cru l'âme flamenca. ¡Olé! L.M.
 Purée! C'est dans Ovide et ça n'a pas pris une ride. C'est splendide, mais ressenti comme audacieux, 2000 ans après. Inquiétant, non...
Purée! C'est dans Ovide et ça n'a pas pris une ride. C'est splendide, mais ressenti comme audacieux, 2000 ans après. Inquiétant, non...
Extrait :
Si tu veux m’en croire, lecteur, ne hâte pas le plaisir de Vénus ; sache le retarder, le faire venir peu à peu, doucement. Quand tu auras trouvé l’endroit sensible, l’organe féminin de la jouissance, pas de sotte pudeur : caresse-le, tu verras dans ses yeux brillants une tremblante lueur, flaque de soleil à la surface des eaux… Viendront alors les plaintes et un tendre murmure, de doux gémissements –et ces mots excitants qui fouaillent le désir…
Ne va pas, voguant à pleines voiles, la laisser en arrière ! Evite, aussi, qu’elle ne te précède : qu’un même élan pousse vos navires vers le port. Quand, vaincus tous deux en même temps, l‘homme et la femme retombent ensemble, c’est là le comble du plaisir !
Alliance :
 Le Gewurztraminer Grand Cru Eichberg 2011 de Martin Schaetzel, vigneron alsacien de respect, sis à Ammerschwihr. Pour le nez généreusement fruité, aux touches exotiques (lychee) de ce grand vin de garde
Le Gewurztraminer Grand Cru Eichberg 2011 de Martin Schaetzel, vigneron alsacien de respect, sis à Ammerschwihr. Pour le nez généreusement fruité, aux touches exotiques (lychee) de ce grand vin de garde
 (élevé en biodynamie, 15-20€). Pour sa bouche aux accents miellés. Et surtout pour cet équilibre prodigieux entre minéralité, fraîcheur, acidité et douceur extrême. La puissance et l'onctuosité mêlées, en somme. Une sorte de fading oenologique, car la longueur en bouche signe aussi sa prestance. Une invitation indirecte aux plaisirs divers du coeur de l'été. L.M.
(élevé en biodynamie, 15-20€). Pour sa bouche aux accents miellés. Et surtout pour cet équilibre prodigieux entre minéralité, fraîcheur, acidité et douceur extrême. La puissance et l'onctuosité mêlées, en somme. Une sorte de fading oenologique, car la longueur en bouche signe aussi sa prestance. Une invitation indirecte aux plaisirs divers du coeur de l'été. L.M.

 Détente, c'est l'heure de l'apéro. Et là, tout est dit sur la contre-étiquette (lire ci-dessous), laquelle est, pour une fois, ni niaise ni superflue ou passe-partout. Dominique Piron est un orfèvre. Un champion à Morgon (avec les Foillard et autre Lapierre).
Détente, c'est l'heure de l'apéro. Et là, tout est dit sur la contre-étiquette (lire ci-dessous), laquelle est, pour une fois, ni niaise ni superflue ou passe-partout. Dominique Piron est un orfèvre. Un champion à Morgon (avec les Foillard et autre Lapierre).
Il propose nombre de cuvées, dont ce beaujolais simple. Un gamay
d'une modestie confondante, qui n'exclut pas la complexité aromatique. C'est gourmand à souhait, frais, ça se croque comme des fruits rouges à pleines mains, lorsqu'on laisse le jus couler sur notre menton. Vous voyez?..
Les Cadoles de la Chanaise, ou l'expression conviviale d'un cépage - parfois - magicien. Nous tenons là un vin de bons copains par excellence. Un vrai vin de partage. Ce beaujolais de Piron est la red star gouleyante de l'été (6,50€).
ALLIANCE LITTÉRAIRE :
Petit éloge du temps comme il va, de Denis Grozdanovitch (folio 2€),  car l'auteur se moque des influences sur nos humeurs du temps qu'il fait : il s'accommode joyeusement. Il sait en effet se réjouir de la grisaille - sa description de la pluie qui tombe (la friture divine du grand ruissellement des pluies torrentielles) est un morceau d'anthologie -, il a le mauvais temps enthousiaste, parvient à générer du bonheur au coeur de l'ennui, et du désir sans la satiété... Grozdanovitch est un philosophe au sourire large, qui cite Ellul de surcroît. Il sait faire valoir le droit poétique à ce que d'aucuns perçoivent comme négatif. C'est un poète des nuages qu'il se plait à contempler (à l'instar de L'inconnu sur la terre de Le Clézio). Avec lui, le soleil brille dans les grandes largeurs, et la pluie chantonne, fredonne, flagelle. L'auteur a appris à saisir, comme Charles-Albert Cingria, les instants de furtive éternité. C'est un ralentisseur du temps. Et son petit livre ensoleillé, une ode à tous ceux qui prêtent une attention vétilleuse aux petits riens superflus qui sont le sel de la vie. Faites passer! L.M.
car l'auteur se moque des influences sur nos humeurs du temps qu'il fait : il s'accommode joyeusement. Il sait en effet se réjouir de la grisaille - sa description de la pluie qui tombe (la friture divine du grand ruissellement des pluies torrentielles) est un morceau d'anthologie -, il a le mauvais temps enthousiaste, parvient à générer du bonheur au coeur de l'ennui, et du désir sans la satiété... Grozdanovitch est un philosophe au sourire large, qui cite Ellul de surcroît. Il sait faire valoir le droit poétique à ce que d'aucuns perçoivent comme négatif. C'est un poète des nuages qu'il se plait à contempler (à l'instar de L'inconnu sur la terre de Le Clézio). Avec lui, le soleil brille dans les grandes largeurs, et la pluie chantonne, fredonne, flagelle. L'auteur a appris à saisir, comme Charles-Albert Cingria, les instants de furtive éternité. C'est un ralentisseur du temps. Et son petit livre ensoleillé, une ode à tous ceux qui prêtent une attention vétilleuse aux petits riens superflus qui sont le sel de la vie. Faites passer! L.M.
 La statue était depuis longtemps fissurée, notre admiration mise à mal, avec ce goût aigre de la déception historique, identique à celui que nous eûmes en apprenant pour Tonton (et Bousquet) d'une part, et pour, pêle-mêle : Cioran, Jünger, Heidegger, Hamsun et quelques autres comme Déon ou Chardonne. Là, tout s'effondre dans un Espace littéraire qui fut notre livre de chevet, avec La part du feu, Le livre à venir, L'amitié, Thomas l'obscur, Une voix venue d'ailleurs et tant d'autres essais brillantissimes. Maurice Blanchot fut un salaud. Il faut s'y résoudre. L'étude que lui consacre Michel Surya est implacable. Il ne s'agit cependant pas d'un procès à charge post-mortem comme le milieu sait en faire et comme la France en a le secret. Non. L'autre Blanchot, sous-titré L'écriture de jour, l'écriture de nuit (Tel/Gallimard) entreprend de dénoncer le plus froidement possible la contribution active de l'auteur de Faux-pas et de L'Arrêt de mort, à la presse d'extrême droite des années 1930 (*), en se gardant de dresser un réquisitoire, car on ne tire pas sur une ambulance et qu'à vaincre sans péril... Ce que Surya souligne, reproche et regrette surtout, ce sont les silences, les omissions, les non-dits, voire les mensonges de celui qui passe pour le représentant de la plus haute exigence littéraire, une profonde réflexion sur "la conséquence de la pensée", précise Surya. C'est ce même Blanchot qui dénonçait l'engagement nazi de Heidegger, que l'auteur de cet essai salutaire pointe du doigt - sans pour cela vouloir l'accabler. C'est la tâche de la pensée de s'emparer de ce qui la désempare. La première phrase de ce livre, douloureux au fond, résonne en nous. Cela ne doit cependant pas nous interdire de revenir aux essais et études littéraires de Maurice Blanchot, dont l'intelligence est d'un éternel vif-argent. Nous pouvons néanmoins réfléchir à la désinvolture de la jeunesse, aux ressorts troubles de l'engagement dans un sens ou dans un autre (la Collaboration contre la Résistance, par exemple - et à ce propos, relire le formidable livre de Pierre Bayard, Aurais-je été résistant ou bourreau? Minuit). Il y aurait eu le premier Blanchot, chien fou (il a 23 ans en 1930), journaliste pétainiste, puis le second Blanchot, après la Libération, qui commença à donner les essais que l'on sait. Surya condamne chez Blanchot tout d'abord le détournement du langage, puis le détournement de l'attention en la faisant porter sur l'affaire Heidegger (1984), ainsi que l'absence d'autocritique de la part du maître ès critique littéraire, quand bien même tout le monde savait depuis longtemps. S'être empêché jusqu'à L'Instant de ma mort (livre bouleversant), d'avouer l'inavouable, passe dès lors pour une faute capitale, et difficile à pardonner. L'essentiel n'est cependant pas qu'il ait berné l'intelligentsia (de gauche) française, mais qu'il ait collaboré. Toutefois, Blanchot demeure (à nos yeux), le philosophe qui sera passé de Maurras à Lévinas; et pas l'inverse. C'est déjà ça. L.M.
La statue était depuis longtemps fissurée, notre admiration mise à mal, avec ce goût aigre de la déception historique, identique à celui que nous eûmes en apprenant pour Tonton (et Bousquet) d'une part, et pour, pêle-mêle : Cioran, Jünger, Heidegger, Hamsun et quelques autres comme Déon ou Chardonne. Là, tout s'effondre dans un Espace littéraire qui fut notre livre de chevet, avec La part du feu, Le livre à venir, L'amitié, Thomas l'obscur, Une voix venue d'ailleurs et tant d'autres essais brillantissimes. Maurice Blanchot fut un salaud. Il faut s'y résoudre. L'étude que lui consacre Michel Surya est implacable. Il ne s'agit cependant pas d'un procès à charge post-mortem comme le milieu sait en faire et comme la France en a le secret. Non. L'autre Blanchot, sous-titré L'écriture de jour, l'écriture de nuit (Tel/Gallimard) entreprend de dénoncer le plus froidement possible la contribution active de l'auteur de Faux-pas et de L'Arrêt de mort, à la presse d'extrême droite des années 1930 (*), en se gardant de dresser un réquisitoire, car on ne tire pas sur une ambulance et qu'à vaincre sans péril... Ce que Surya souligne, reproche et regrette surtout, ce sont les silences, les omissions, les non-dits, voire les mensonges de celui qui passe pour le représentant de la plus haute exigence littéraire, une profonde réflexion sur "la conséquence de la pensée", précise Surya. C'est ce même Blanchot qui dénonçait l'engagement nazi de Heidegger, que l'auteur de cet essai salutaire pointe du doigt - sans pour cela vouloir l'accabler. C'est la tâche de la pensée de s'emparer de ce qui la désempare. La première phrase de ce livre, douloureux au fond, résonne en nous. Cela ne doit cependant pas nous interdire de revenir aux essais et études littéraires de Maurice Blanchot, dont l'intelligence est d'un éternel vif-argent. Nous pouvons néanmoins réfléchir à la désinvolture de la jeunesse, aux ressorts troubles de l'engagement dans un sens ou dans un autre (la Collaboration contre la Résistance, par exemple - et à ce propos, relire le formidable livre de Pierre Bayard, Aurais-je été résistant ou bourreau? Minuit). Il y aurait eu le premier Blanchot, chien fou (il a 23 ans en 1930), journaliste pétainiste, puis le second Blanchot, après la Libération, qui commença à donner les essais que l'on sait. Surya condamne chez Blanchot tout d'abord le détournement du langage, puis le détournement de l'attention en la faisant porter sur l'affaire Heidegger (1984), ainsi que l'absence d'autocritique de la part du maître ès critique littéraire, quand bien même tout le monde savait depuis longtemps. S'être empêché jusqu'à L'Instant de ma mort (livre bouleversant), d'avouer l'inavouable, passe dès lors pour une faute capitale, et difficile à pardonner. L'essentiel n'est cependant pas qu'il ait berné l'intelligentsia (de gauche) française, mais qu'il ait collaboré. Toutefois, Blanchot demeure (à nos yeux), le philosophe qui sera passé de Maurras à Lévinas; et pas l'inverse. C'est déjà ça. L.M.
(*) Maurice Blanchot ne publia cependant jamais dans les torchons antisémites que furent Je suis partout (de Drieu), ou L'ami du peuple, mais dans des périodiques comme le Journal des débats, notoirement maurrassien et xénophobe.
Notons enfin que Michel Surya, qui dirige la revue Lignes, a également consacré une numéro spécial à ce délicat sujet en mars 2014.
 ... Procure un bien fou. Surtout avec les traductions en Français moderne dont nous disposons, et qui jamais plus ne heurtent notre lecture. Il y avait celle de Claude Pinganaud chez Arléa, il y a aussi celle d'André Lanly chez Gallimard (coll° Quarto). Grâce à ces adaptateurs de génie, Montaigne nous devient familier dès la première ligne, il est notre contemporain, il devient tutoyant, proche; c'est un ami (de la famille) de notre bibliothèque. Prenez par exemple le petit folio sagesses (à la couverture superbe, et au papier agréable parce que pas glacé), et qui rassemble quelques extraits, dont (sur) le pédantisme, la cruauté, la fainéantise et la colère, sous le titre sobre de : Sur l'oisiveté. Ce sont 120 et quelques pages de gourmandise, d'intelligence pure, de perception suraiguë, d'analyse fine et simple, de réflexion saine, bienveillante et positive. On a envie de tout souligner, de crayonner des accolades à chaque page, de relire à voix haute certaines phrases (d'ailleurs nous ne nous en privons pas), de brandir le livre et de dire au premier être cher qui passe : écoute ça! Montaigne galvanise, et ce n'est pas nouveau. Cette magie, seuls quelques écrivains la possèdent, la partagent et la transmettent avec l'auteur des Essais, grâce à leur inaltérable talent. Montaigne est sans doute le chef de cette bande de sacrés passeurs de bonheurs : ceux des mots, de la langue, de l'intelligence brillante qui possède le claquant incomparable, l'acuité qui frappe, toute cette alchimie qui donne matière à cabrer notre esprit. Les anecdotes qui illustrent le propos de Montaigne n'ont pas pris une ride, ni sur le plan psychologique, ni sur le plan politique ou géopolitique. Les vertus, les vices, la ruse, le pouvoir, la couardise, la sagesse intérieure, la violence nécessaire, le chagrin, tout est bon pour nous aider à désapprendre le mal. Alors, oui, lire Montaigne à petites doses, chaque jour de ce mois d'août, est une gymnastique qui vaut bien le dos crawlé, ou la brasse coulée. A vos marques ! L.M.
... Procure un bien fou. Surtout avec les traductions en Français moderne dont nous disposons, et qui jamais plus ne heurtent notre lecture. Il y avait celle de Claude Pinganaud chez Arléa, il y a aussi celle d'André Lanly chez Gallimard (coll° Quarto). Grâce à ces adaptateurs de génie, Montaigne nous devient familier dès la première ligne, il est notre contemporain, il devient tutoyant, proche; c'est un ami (de la famille) de notre bibliothèque. Prenez par exemple le petit folio sagesses (à la couverture superbe, et au papier agréable parce que pas glacé), et qui rassemble quelques extraits, dont (sur) le pédantisme, la cruauté, la fainéantise et la colère, sous le titre sobre de : Sur l'oisiveté. Ce sont 120 et quelques pages de gourmandise, d'intelligence pure, de perception suraiguë, d'analyse fine et simple, de réflexion saine, bienveillante et positive. On a envie de tout souligner, de crayonner des accolades à chaque page, de relire à voix haute certaines phrases (d'ailleurs nous ne nous en privons pas), de brandir le livre et de dire au premier être cher qui passe : écoute ça! Montaigne galvanise, et ce n'est pas nouveau. Cette magie, seuls quelques écrivains la possèdent, la partagent et la transmettent avec l'auteur des Essais, grâce à leur inaltérable talent. Montaigne est sans doute le chef de cette bande de sacrés passeurs de bonheurs : ceux des mots, de la langue, de l'intelligence brillante qui possède le claquant incomparable, l'acuité qui frappe, toute cette alchimie qui donne matière à cabrer notre esprit. Les anecdotes qui illustrent le propos de Montaigne n'ont pas pris une ride, ni sur le plan psychologique, ni sur le plan politique ou géopolitique. Les vertus, les vices, la ruse, le pouvoir, la couardise, la sagesse intérieure, la violence nécessaire, le chagrin, tout est bon pour nous aider à désapprendre le mal. Alors, oui, lire Montaigne à petites doses, chaque jour de ce mois d'août, est une gymnastique qui vaut bien le dos crawlé, ou la brasse coulée. A vos marques ! L.M.
Paraissent simultanément dans la même collection folio sagesses, Aller au bout de son coeur, de Meng zi, lequel nous instruit sur l'art et la manière de ne pas perdre son coeur, ou bien de le retrouver si nous pensons l'avoir perdu. Le passionnant Instructions au cuisinier zen, de Dôgen - qui nous apprend (avec Bouddha) à regarder un simple légume comme un être de respect. Et le grand classique Tao-tö-king, de Lao-tseu, livre sacré des deux grands V : la Voie et la Vertu.
 Chacun connaît au moins le si poignant poème Les Séparés, grâce à l'adaptation (chantée), assez réussie, qu'en a donné Julien Clerc :
Chacun connaît au moins le si poignant poème Les Séparés, grâce à l'adaptation (chantée), assez réussie, qu'en a donné Julien Clerc :
N’écris pas. Je suis triste, et je voudrais m’éteindre.
Les beaux étés sans toi, c’est la nuit sans flambeau.
J’ai refermé mes bras qui ne peuvent t’atteindre,
Et frapper à mon cœur, c’est frapper au tombeau.
N’écris pas !
N’écris pas. N’apprenons qu’à mourir à nous-mêmes.
Ne demande qu’à Dieu... qu’à toi, si je t’aimais !
Au fond de ton absence écouter que tu m’aimes,
C’est entendre le ciel sans y monter jamais.
N’écris pas !
N’écris pas. Je te crains ; j’ai peur de ma mémoire ;
Elle a gardé ta voix qui m’appelle souvent.
Ne montre pas l’eau vive à qui ne peut la boire.
Une chère écriture est un portrait vivant.
N’écris pas !
N’écris pas ces doux mots que je n’ose plus lire :
Il semble que ta voix les répand sur mon cœur ;
Que je les vois brûler à travers ton sourire ;
Il semble qu’un baiser les empreint sur mon cœur.
N’écris pas !
Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859), est une poétesse romantique à laquelle nombre de ses pairs ont voué un véritable culte... ambigu. Et qui perdure, car si Lamartine lui consacre un poème en 1831, la romancière Anne Plantagenet en fait un personnage de roman, avec Seule au rendez-vous en 2005. D'abord, c'est une femme qui écrit, qui défie en quelque sorte, à l'époque encore, et qui enfonce le clou en affirmant sa conscience de femme de lettres qui dérange. L'admiration est franche, mais elle souligne chaque fois la noirceur de l'oeuvre comme un fer, une indélébile marque de fabrique. Lucien Descaves la surnomme Notre-Dame des Pleurs, Stefan Zweig l'appelle Mater Dolorosa, Franz Liszt dit d'elle : elle est la femme de ses oeuvres, un pleur vivant, causant et marchant. La vie de Marceline n'est pas un conte de fées, et ceci explique en partie cela (Lucien Descaves la surnommera aussi la prolétaire des lettres). Alors, pour mieux comprendre une oeuvre poétique dense et d'une sensibilité d'écorchée que traduit toujours le vers qui fait mouche, et qui nous touche ne serait-ce que par le bout d'un seul poème, rien ne vaut un petit folioplus classiques (Gallimard). Celui-ci (concocté par Virginie Belgazou et Valérie Lagier), est intensément lumineux, tant il est éclairant. Autant sur l'auteur (la femme), que sur l'oeuvre, ou bien sur l'époque et le mouvement romantique. Nous comprenons ainsi la méfiance teintée de misogynie des poètes mâles, puis l'admiration valmorienne générale... Posthume, comme souvent. L'anthologie des poèmes est enfin judicieuse, si nous la comparons à l'oeuvre publiée en Poésie/Gallimard. Chaque volume de cette collection propose une lecture d'image, écho pictural de l'oeuvre analysée, en l'occurrence il s'agit de L'Âme de la rose, peinture de John William Waterhouse. L'éditeur précise que l'ouvrage est recommandé pour les classes de lycée : ça fait du bien de rajeunir!.. L.M.

 Du grand Philippe Jaccottet, désormais pléiadisé, la collection Poésie/Gallimard reprend deux volumes de critiques : L'entretien des muses, chroniques de poésie (1955-1966), et Une transaction secrète, Lectures de poésie (1954-1986). C'est le bonheur de retrouver tant de poètes classiques et contemporains, à travers le prisme d'un grand lecteur à l'acuité frappante, et à l'analyse acérée. Ce sont des lectures toniques (souvent parues ne revue, notamment la nrf), d'un poète sachant garder ses distances avec chacun de ses alliés substantiels, aurait dit René Char. Friedrich Hölderlin, Rainer Maria Rilke, Giuseppe Ungaretti, lui sont des compagnons fidèles, autant que les Francis Ponge, Yves Bonnefoy et autres André du Bouchet et Jacques Dupin, car Jaccottet a traduit les premiers, et connu les seconds. L'auteur ouvre des horizons, ne pratique pas la critique pour elle-même, mais plutôt la lecture enthousiaste et néanmoins méticuleuse, pour "donner à découvrir", pour présenter, tirer la manche du lecteur. C'est un passeur de poètes. Et ses deux recueils donnent par ailleurs envie de reprendre l'oeuvre méconnue, ou en voie d'oubli, des Alain Borne, Armen Lubin, ou Gustave Roud. Et de replonger avec délice et gourmandise dans Pierre-Jean Jouve, Novalis, Saint-John Perse, Jules Supervielle, et pourquoi pas Gongora et Maurice Scève! L.M.
Du grand Philippe Jaccottet, désormais pléiadisé, la collection Poésie/Gallimard reprend deux volumes de critiques : L'entretien des muses, chroniques de poésie (1955-1966), et Une transaction secrète, Lectures de poésie (1954-1986). C'est le bonheur de retrouver tant de poètes classiques et contemporains, à travers le prisme d'un grand lecteur à l'acuité frappante, et à l'analyse acérée. Ce sont des lectures toniques (souvent parues ne revue, notamment la nrf), d'un poète sachant garder ses distances avec chacun de ses alliés substantiels, aurait dit René Char. Friedrich Hölderlin, Rainer Maria Rilke, Giuseppe Ungaretti, lui sont des compagnons fidèles, autant que les Francis Ponge, Yves Bonnefoy et autres André du Bouchet et Jacques Dupin, car Jaccottet a traduit les premiers, et connu les seconds. L'auteur ouvre des horizons, ne pratique pas la critique pour elle-même, mais plutôt la lecture enthousiaste et néanmoins méticuleuse, pour "donner à découvrir", pour présenter, tirer la manche du lecteur. C'est un passeur de poètes. Et ses deux recueils donnent par ailleurs envie de reprendre l'oeuvre méconnue, ou en voie d'oubli, des Alain Borne, Armen Lubin, ou Gustave Roud. Et de replonger avec délice et gourmandise dans Pierre-Jean Jouve, Novalis, Saint-John Perse, Jules Supervielle, et pourquoi pas Gongora et Maurice Scève! L.M.
http://www.editionsecriture.com/livre/dictionnaire-chic-du-vin/
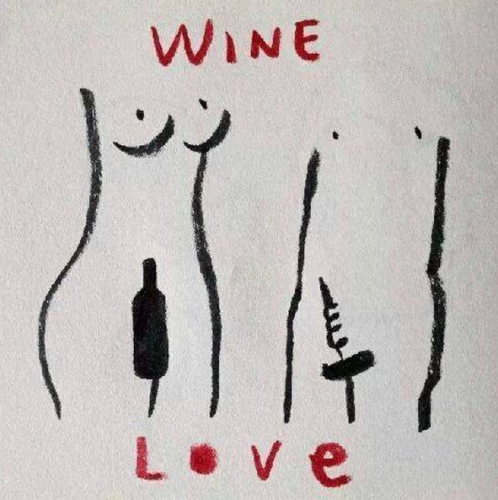
Mes lèvres ne peuvent plus s’ouvrir
que pour dire ton nom
baiser ta bouche
te devenir en te cherchant.
Tu es au bout de chacun de mes mots
tu les emplis, les brûles, les vides.
Te voici en eux
tu es ma salive et ma bouche
et mon silence même est crispé de toi.
Je me couche dans la poussière, les yeux fermés
La nuit sera totale, tant que l’aube
Et le grand jour de ta chair
Ne passeront pas au-dessus de moi
Comme un vol de soleils.
Alain Borne (1915-1962).
Jean Lacouture, 9 juin 1921- 16 juillet 2015.
Thierry Bourgeon : http://www.laradiodugout.fr/livres/2015/07/dictionnaire-chic-du-vin/

Papier paru cette semaine dans le hors-série de L'Express consacré aux faits divers qui ont marqué le monde.
Monaco /Affaire PASTOR
UN GENDRE CUPIDE
Polar sur le Rocher : la richissime héritière de l’empire immobilier monégasque aurait été assassinée sur ordre du compagnon de sa fille.
___
Le 28 avril dernier, le dossier du double assassinat de la femme d’affaires monégasque Hélène Pastor, 77 ans, et de son chauffeur et fidèle majordome égyptien Mohamed Darwich, 54 ans, devant l’hôpital niçois L’Archet, connaît un nouveau rebondissement avec l’interpellation et le placement en garde à vue à Marseille, de cinq personnes visées par l’enquête, ce qui porte à sept le nombre de personnes mises en examen dans le cadre de l’affaire qui a secoué le Rocher en mai 2014. C’est le juge d’instruction Christophe Perruaux qui a fait procéder à ces arrestations, dans le cadre d’une commission rogatoire. Ce nouveau « coup de filet » intervient quelques jours après la reconstitution de l’assassinat, le 22 avril dernier. Les personnes interpellées seraient susceptibles d’avoir fourni des moyens, notamment en armes, aux auteurs des faits. Mais les principaux protagonistes sont déjà épinglés par les autorités depuis longtemps.
Le 6 mai 2014, la richissime Hélène (lire encadré) et son chauffeur sont abattus, à coups de fusil de chasse de calibre 12 à canon scié et chargé de chevrotines, dans leur véhicule, une Lancia Voyager noire, en quittant l’hôpital L’Archet vers 19h, après une visite quotidienne rendue par Mme Pastor à son fils cadet Gildo, 48 ans, hospitalisé depuis quatre mois pour un grave accident vasculaire cérébral. Hélène succombera à ses blessures quinze jours plus tard, le 21 mai, en ayant déclaré ne pas savoir qui pouvait lui en vouloir à mort (son chauffeur rend l’âme le 10 mai, sans avoir pu être interrogé).
Quelques jours après le drame, le 23 juin, une vaste opération de police conduit à l’arrestation de vingt-trois personnes supposées liées à l’affaire, à Marseille, Nice et Rennes, en particulier le tueur et le guetteur présumés, confondus par des caméras de vidéosurveillance, et des tests ADN. Ces deux auteurs potentiels de l’assassinat – au demeurant des tueurs à gage, payés 60 000 euros en tout pour accomplir leur crime -, sont Samine Saïd Ahmed, le tireur, un délinquant et trafiquant de stupéfiants marseillais d’origine comorienne de 24 ans, et le guetteur, Alhair Hamadi, voyou marseillais de 31 ans d’origine comorienne lui aussi.
Trois autres prévenus sont particulièrement visés, qui auraient servi d’intermédiaires : un gendarme, Salim Yousouf, recruté pour être le tireur, et qui s’est désisté, non sans avoir fourni les munitions ayant été utilisées. Omer Lehoré, pour avoir recruté le tireur authentifié, et Abdelkader Belkhatir, intermédiaire entre ces deux derniers hommes.
Au-dessus de tout soupçon
Le dossier, aux allures de sinistre affaire familiale assortie de gros sous, se corse très vite en montrant ses atours crapuleux, lorsque l’enquête soupçonne Wojciech Janowski, le compagnon depuis vingt-huit ans de Sylvia Pastor, 54 ans, la fille de la richissime victime, d’avoir commandité l’assassinat, afin de mettre la main sur l’immense fortune de sa « belle-mère ». Le « gendre idéal » et en apparence au-dessus de tout soupçon, reconnaît bien vite son implication dans le double meurtre. Placée elle-même en garde à vue trois jours durant « pour les nécessités de l’enquête », Sylvia Pastor ne peut que déplorer d’avoir été trahie par son compagnon. Aucune charge n’est retenue à son encontre par la Police judiciaire de Nice. Le coach sportif du couple Sylvia Pastor et Wojciech Janowski, Pascal Dauriac, 46 ans, est en revanche suspecté d’avoir fomenté le piège. Le procureur de Marseille, Brice Robin le qualifie de « chef de la logistique, et de véritable organisateur du crime ». Il aurait perçu près de 200 000 euros en espèces de la part de Janowski pour ce faire, ainsi que divers cadeaux (voyages, voiture), d’une valeur estimée à 50 000 euros.
Wojciech, 65 ans, consul honoraire de Pologne à Monaco depuis 2007, puis consul général honoraire depuis 2012, membre de la Chambre de commerce polonaise, président d’une société monégasque de nanotechnologie, Firmus SAM, spécialisée dans le traitement de l’eau, a su s’attirer la confiance du monde politique pour de prétendues activités caritatives en faveur d’associations luttant contre l’autisme -, au point d’être promu Officier de l’Ordre national du Mérite par Nicolas Sarkozy en 2010. Ce qui n’explique pas totalement que le prévenu ait observé un silence de tombe (et avant que le masque...), lors des premiers interrogatoires. La carrière du gendre de facto de la milliardaire, s’est auparavant déroulée dans le milieu de l’hôtellerie de luxe et les casinos britanniques et monégasques, comme le Grand Metropolitan, et la Société des bains de mer. Depuis, le diplomate partageait les 500 000 euros d’argent de poche mensuels que sa compagne percevait de sa maman.
Au fil de l’instruction, il appert que le redoutable Wojciech est également soupçonné, selon des déclarations qu’aurait faites Pascal Dauriac, son ex-coach sportif, d’avoir envisagé de faire assassiner Gildo, son « beau-frère ». On le dit en effet ruiné par des affaires de rachat de sociétés en difficulté pour le compte de la Hudson Oil, une société canadienne dont il était le président exécutif, et notamment pour le non-paiement d’une raffinerie polonaise dont le prix était fixé à de 30 millions d’euros. Serait-ce un cruel besoin de tant d’argent qui aurait poussé le gendre à fomenter le funeste guet-apens ? Tandis que l’enquête se poursuit, le cupide polonais croupit, en « isolement total », à la prison des Baumettes. Léon Mazzella
LA FORTUNE FACILITÉE DU CLAN PASTOR
Ultime survivante d’une famille d’architectes italiens ayant fortement marqué le paysage urbain monégasque, en particulier Gildo Pastor (1910-1990), Hélène était la fille de Gildo et la petite-fille de Jean-Baptiste Pastor, tailleur de pierre et maçon venu de Ligurie en 1880, auquel le Rocher doit notamment d’avoir modestement participé à la construction de la cathédrale de Monaco. Propriétaire d’un patrimoine immobilier gigantesque sur la Principauté – environ 500 000 m2 d’hôtels, et de rangées d’immeubles sur les avenues les plus huppées du front de mer, là où les loyers de leurs 4 000 appartements atteignent des sommes records -, celle que l’on surnommait la « vice-princesse » en tailleur Chanel (notons que sa fille est quant à elle surnommée « Sissi »), appartenait à l’autre famille toute-puissante de Monaco, avec celle des Grimaldi. Ce fabuleux patrimoine, elle le partageait avec ses frères Victor et Michel, décédés avant elle : Victor en 2002, et Michel, qui présida aux destinées de l’A.S. Monaco, et qui est le père d’Alexandra, épouse de David Halliday, trois mois à peine avant sa sœur, en février 2014. C’est la famille princière, et surtout Rainier III, qui a permis aux Pastor de « bâtir » leur fortune, en les autorisant à construire, à partir de 1966, quantité d’immeubles ayant vue sur la grande bleue, sur le rocher le plus cher du monde. Parfois au mépris d’un plan d’occupation de sols, et en vertu de quelque ordonnance souveraine, arme suprême monégasque. Arrangements… La fortune familiale – que l’on dit supérieure à celle des Grimaldi -, pèse entre 20 et 30 milliards d’euros. Difficile de connaître avec précision les secrets que le Rocher princier sait bien garder. L.M.
 Une balle de kalachnikov a stoppé net le talent protéiforme de Bernard Maris, le 7 janvier dernier, au cours d’une réunion de rédaction dans les locaux de Charlie-Hebdo, à Paris. Je ne ferai donc pas de dessin. L’auteur avait déposé cinq jours plus tôt chez Grasset le manuscrit de Et si on aimait la France. Cette déclaration d’amour à un bouquet de valeurs en danger, va passer pour passéiste et réactionnaire, aux yeux plissés des esprits chagrins. C’est pourtant, entre le Dictionnaire amoureux de la France, de Denis Tillinac (Plon), et De chez nous, de Christian Authier (Stock) – mais beaucoup plus proche du second que du premier -, d’une ode vivifiante, et propre à déculpabiliser tous ceux qui s’arrangent tant bien que mal avec leur mauvaise conscience en entretenant leur bonne (conscience) à coups de repentance, qu’il s’agit. C’est aussi un élégant coup de poing sur la table, à l’adresse du « French bashing », ce nouveau sport pratiqué surtout par les Français eux-mêmes. Ces citoyens de plus en plus portés sur l’auto-flagellation, passionnés qu’ils sont devenus par l’expiation de fautes qu’ils finissent par s’inventer ou à amplifier, tous les accrocs au prolongement de la peine, soucieux de faire durer le purgatoire ad nauseam. L'après décolonisation a encore de beaux jours devant elle. Les idées du Alain Finkielkraut de L’identité malheureuse ne sont pas éloignées de celles de l’économiste sensible, cultivé, en un mot charmant, que fut Bernard Maris. Le dessein de son ultime livre est de tenter de redonner le sourire aux habitants de ce pays multiculturel, cette terre des Lumières et des Droits de l’homme, et dont la langue se délite, ce « pays ou Dieu est heureux », mais où l’antiracisme fait les ravages que l’on sait. Maris a écrit ce bouquin pour les désespérés drôles : les Houellebecq, Cabu, et tous les fils de Cioran et de Reiser. Le temps de cet essai libre et enchanté, il est parti tendrement en guerre contre ceux qui parlent de la France comme d’un rhumatisme, d’un mal au dos qui ne passe pas - et qui ne passera de toute façon jamais. Contre les pessimistes, les grincheux, les « aquoibonistes » et autres apôtres passifs du c'était mieux avant. Afin de redonner confiance à ceux qui n’osent même plus murmurer qu’ils aiment leur pays, il cite – c’est de saison -, les Jean Zay, Guy Môquet, Germaine Tillion, Daniel Cordier, Honoré d’Estienne d’Orves, Henry Frenay, de Lattre de Tassigny, Pierre Mendès-France, et autres membres de l’armée des ombres. Pas de Sartre, ici, « le faux résistant, le planqué de l’Occupation », mais le Camus de Combat, oui. Bernard Maris remet à l’heure ces pendules qui ont tendance à se dérégler de façon… chronique. Amoureux de la langue française comme pas deux, « Oncle Bernard » (son surnom, et son pseudo, à Charlie-Hebdo) approuve le mot de Cioran : « Mourir pour une virgule », et déplore un pays où l’on capitule facilement, et où l’on ne résiste pas longtemps. Les pages les plus sensibles du livre, sont celles rappelant que la France a inventé l’amour courtois et la galanterie. Les troubadours ont, en effet, poétiquement exacerbé le désir, en respectant toujours de façon absolue le bon vouloir de la femme et l’autorité de son corps – ce n’est pas rien, lorsque l’on songe au contrôle de soi, tel qu’il est (mal) vécu dans la religion musulmane. « La civilisation commence lorsque l’homme domine ses pulsions », écrit Maris, et « quand les mâles voient autre chose dans un femme qu’un objet sexuel ». A l’opposé de la galanterie, se situe « le respect, mot employé à tort et à travers par la racaille et les crétins », souligne l’auteur, non sans redonner ses lettres de noblesse au respect, le vrai, montrant du doigt la marée montante de l’irrespect, qui envahit notre quotidien. « La civilisation commence avec la politesse, la politesse avec la discrétion, la retenue, le silence et le sourire sur le visage. » La France n’est-elle pas le pays du culte du respect de la population féminine, et celui qui a inventé celui de l’enfant ? Avec Maris, nous flirtons alors avec la délicatesse de Proust, nous nous moquons des bobos qui sont finalement des caricatures de bourgeois assez peu bohème (lire à ce sujet Tombeau pour une touriste innocente, du regretté Philippe Murray, recommande Maris), nous réapprenons (sans aucun accent bucolique oiseux), la simplicité des paysans, cette classe sociale – le « secteur primaire » en voie de disparition, nous n’oublions pas que la lutte des classes se transforme (démographie et crise obligent) en lutte des places (le mot est de Michel Lussault, auteur de De la lutte des classes à la lutte des places, Grasset), nous savons – et il nous est personnellement cruel de devoir nous en convaincre – que la gauche que nous aimons n’existe plus, que l’actuelle, insipide et pleutre (c’est moi qui souligne), a préféré fuir les problèmes cruciaux comme celui des banlieues et autres zones dangereuses, au lieu de les affronter avec courage. Maris agite alors le spectre terrifiant d’une forme aiguë de séparatisme, ce que Finkielkraut nomme l’échec du « vivre-ensemble », corollaire de la déliquescence du savoir-vivre (évoqué plus haut à propos de galanterie et de respect vrai), et en compagnie de l’auteur, nous nous souvenons, avec le philosophe Alain, que « le plus visible de l’homme juste et de ne point vouloir gouverner les autres ». Dans un monde de brutes, de requins, d’arrivistes (en économie comme en politique), prêts à piétiner jusqu’à leur mère pour conquérir une parcelle de pouvoir, dans ce monde ou le warrior, comme disent les adolescents, est icônisé, il est par conséquent salutaire, et apaisant, de lire Bernard Maris. Essai buissonnier, Et si on aimait la France redonne par ailleurs envie de parcourir la ville à pied, et la province en vélo, ou bien en voiture, mais slowly et vitres baissées. Julien Gracq : « Habiter une ville, c’est y tisser par ses allées et venues journalières un lacis de parcours ». Car il s’agit en quelque sorte de réapprendre la France, de se la réapproprier, de la « désinquiéter ». Le message en forme de testament de Bernard Maris sonne juste. Il exprime, en toute simplicité, la sincérité d’un homme de bien, à l’intelligence suraiguë (perchée à des années lumière, et des Bisounours, et des défaitistes), la vérité d’un homme optimiste mais pas candide, lucide et ennemi du give up, un homme qui souhaitait juste retrouver le sourire sur les lèvres des autres. Juste ça. Au lieu de quoi, le 7 janvier dernier… L.M.
Une balle de kalachnikov a stoppé net le talent protéiforme de Bernard Maris, le 7 janvier dernier, au cours d’une réunion de rédaction dans les locaux de Charlie-Hebdo, à Paris. Je ne ferai donc pas de dessin. L’auteur avait déposé cinq jours plus tôt chez Grasset le manuscrit de Et si on aimait la France. Cette déclaration d’amour à un bouquet de valeurs en danger, va passer pour passéiste et réactionnaire, aux yeux plissés des esprits chagrins. C’est pourtant, entre le Dictionnaire amoureux de la France, de Denis Tillinac (Plon), et De chez nous, de Christian Authier (Stock) – mais beaucoup plus proche du second que du premier -, d’une ode vivifiante, et propre à déculpabiliser tous ceux qui s’arrangent tant bien que mal avec leur mauvaise conscience en entretenant leur bonne (conscience) à coups de repentance, qu’il s’agit. C’est aussi un élégant coup de poing sur la table, à l’adresse du « French bashing », ce nouveau sport pratiqué surtout par les Français eux-mêmes. Ces citoyens de plus en plus portés sur l’auto-flagellation, passionnés qu’ils sont devenus par l’expiation de fautes qu’ils finissent par s’inventer ou à amplifier, tous les accrocs au prolongement de la peine, soucieux de faire durer le purgatoire ad nauseam. L'après décolonisation a encore de beaux jours devant elle. Les idées du Alain Finkielkraut de L’identité malheureuse ne sont pas éloignées de celles de l’économiste sensible, cultivé, en un mot charmant, que fut Bernard Maris. Le dessein de son ultime livre est de tenter de redonner le sourire aux habitants de ce pays multiculturel, cette terre des Lumières et des Droits de l’homme, et dont la langue se délite, ce « pays ou Dieu est heureux », mais où l’antiracisme fait les ravages que l’on sait. Maris a écrit ce bouquin pour les désespérés drôles : les Houellebecq, Cabu, et tous les fils de Cioran et de Reiser. Le temps de cet essai libre et enchanté, il est parti tendrement en guerre contre ceux qui parlent de la France comme d’un rhumatisme, d’un mal au dos qui ne passe pas - et qui ne passera de toute façon jamais. Contre les pessimistes, les grincheux, les « aquoibonistes » et autres apôtres passifs du c'était mieux avant. Afin de redonner confiance à ceux qui n’osent même plus murmurer qu’ils aiment leur pays, il cite – c’est de saison -, les Jean Zay, Guy Môquet, Germaine Tillion, Daniel Cordier, Honoré d’Estienne d’Orves, Henry Frenay, de Lattre de Tassigny, Pierre Mendès-France, et autres membres de l’armée des ombres. Pas de Sartre, ici, « le faux résistant, le planqué de l’Occupation », mais le Camus de Combat, oui. Bernard Maris remet à l’heure ces pendules qui ont tendance à se dérégler de façon… chronique. Amoureux de la langue française comme pas deux, « Oncle Bernard » (son surnom, et son pseudo, à Charlie-Hebdo) approuve le mot de Cioran : « Mourir pour une virgule », et déplore un pays où l’on capitule facilement, et où l’on ne résiste pas longtemps. Les pages les plus sensibles du livre, sont celles rappelant que la France a inventé l’amour courtois et la galanterie. Les troubadours ont, en effet, poétiquement exacerbé le désir, en respectant toujours de façon absolue le bon vouloir de la femme et l’autorité de son corps – ce n’est pas rien, lorsque l’on songe au contrôle de soi, tel qu’il est (mal) vécu dans la religion musulmane. « La civilisation commence lorsque l’homme domine ses pulsions », écrit Maris, et « quand les mâles voient autre chose dans un femme qu’un objet sexuel ». A l’opposé de la galanterie, se situe « le respect, mot employé à tort et à travers par la racaille et les crétins », souligne l’auteur, non sans redonner ses lettres de noblesse au respect, le vrai, montrant du doigt la marée montante de l’irrespect, qui envahit notre quotidien. « La civilisation commence avec la politesse, la politesse avec la discrétion, la retenue, le silence et le sourire sur le visage. » La France n’est-elle pas le pays du culte du respect de la population féminine, et celui qui a inventé celui de l’enfant ? Avec Maris, nous flirtons alors avec la délicatesse de Proust, nous nous moquons des bobos qui sont finalement des caricatures de bourgeois assez peu bohème (lire à ce sujet Tombeau pour une touriste innocente, du regretté Philippe Murray, recommande Maris), nous réapprenons (sans aucun accent bucolique oiseux), la simplicité des paysans, cette classe sociale – le « secteur primaire » en voie de disparition, nous n’oublions pas que la lutte des classes se transforme (démographie et crise obligent) en lutte des places (le mot est de Michel Lussault, auteur de De la lutte des classes à la lutte des places, Grasset), nous savons – et il nous est personnellement cruel de devoir nous en convaincre – que la gauche que nous aimons n’existe plus, que l’actuelle, insipide et pleutre (c’est moi qui souligne), a préféré fuir les problèmes cruciaux comme celui des banlieues et autres zones dangereuses, au lieu de les affronter avec courage. Maris agite alors le spectre terrifiant d’une forme aiguë de séparatisme, ce que Finkielkraut nomme l’échec du « vivre-ensemble », corollaire de la déliquescence du savoir-vivre (évoqué plus haut à propos de galanterie et de respect vrai), et en compagnie de l’auteur, nous nous souvenons, avec le philosophe Alain, que « le plus visible de l’homme juste et de ne point vouloir gouverner les autres ». Dans un monde de brutes, de requins, d’arrivistes (en économie comme en politique), prêts à piétiner jusqu’à leur mère pour conquérir une parcelle de pouvoir, dans ce monde ou le warrior, comme disent les adolescents, est icônisé, il est par conséquent salutaire, et apaisant, de lire Bernard Maris. Essai buissonnier, Et si on aimait la France redonne par ailleurs envie de parcourir la ville à pied, et la province en vélo, ou bien en voiture, mais slowly et vitres baissées. Julien Gracq : « Habiter une ville, c’est y tisser par ses allées et venues journalières un lacis de parcours ». Car il s’agit en quelque sorte de réapprendre la France, de se la réapproprier, de la « désinquiéter ». Le message en forme de testament de Bernard Maris sonne juste. Il exprime, en toute simplicité, la sincérité d’un homme de bien, à l’intelligence suraiguë (perchée à des années lumière, et des Bisounours, et des défaitistes), la vérité d’un homme optimiste mais pas candide, lucide et ennemi du give up, un homme qui souhaitait juste retrouver le sourire sur les lèvres des autres. Juste ça. Au lieu de quoi, le 7 janvier dernier… L.M.
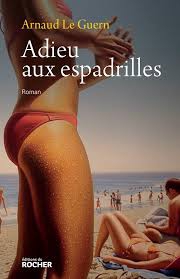 Voilà un vers de Baudelaire qui aurait pu faire le bandeau de couverture de cette longue lettre d’amour fou, si le mot adieu n’était pas déjà contenu dans un titre à rendre jaloux nombre de romanciers. Adieu aux espadrilles (*), du délicat Arnaud Le Guern, est un roman à peine fictif (même les noms des chats, Pablo et Malcolm, sont vrais), très Nouvelle Vague, très morandien – mais sans la vitesse, et avec une touche du Henry Jean-Marie Levet des Cartes Postales. Entre les pages de ce livre, nous (res) sentons ce parfum sentimental, précieux et léger comme la rosée du matin, l’été, au bord de la piscine, lorsqu’on s’est levé avant elle en prenant soin de ne pas la réveiller, pour aller fumer la première cigarette, tout en respirant les parfums tiédis du figuier à l’ombre bienfaisante; sous le soleil exactement. Arnaud Le Guern aime une femme, les actrices aussi, sa fille Louise surtout, l’insouciance, et les mots avec une gourmandise hussarde. Cette longue adresse est un joli pied-de-nez à la génération sms, qui dit avec tact et tendresse ce qu’aimer avec pureté veut dire. Le couple fait l’amour, se taquine sans jamais se griffer, les draps froissent, les jours passent, l’oisiveté chante sur la terrasse, les peaux se suffisent à elles-mêmes, les souvenirs affluent et repartent d’un revers de sa main à elle, afin d’empêcher toute nostalgie de surgir, et continuer de manger le présent à pleine bouche, comme on plante ses dents dans la peau duveteuse et craquante d’une pêche. Nous sommes dans Slogan, avec Birkin et Gainsbourg, nous feuilletons la sensualité pudique du Claire de Chardonne. Le couple est à des années lumière de Paris et son spectre de « rentrée » automnale. Les amoureux sacrifient avec délice au rite de l’apérotique : ils « apérotisent », dégustent un anjou de Mosse ou un rosé de Bandol, avant de s’entre-goûter. Ils ont le talent de savoir prendre le temps, mais avec Le Guern, le temps compte, se cueille, il frappe aux tempes du narrateur, et celui-ci a la délicatesse de ne jamais faire sentir le vertige de sa fuite. L’été est encore là, mais les saisons sont comme les coquelicots qui fanent dès qu’on les dépose sur le skai brûlant de la plage arrière du cabriolet. C’est « la vie comme à Lausanne » en plus souple, car « les espadrilles sont mes semelles de vent », écrit l’auteur. Jamais l’urgence n’ouvre ses yeux noirs, sauf peut-être sous le gouvernement du désir, et pourtant il plane comme une épée de Damoclès au-dessus de cette chambre d’hôtel. Qu’importe ! Les amants sont des aveugles. « Enlacés, nous laissons infuser une unique certitude : l’été, c’est l’amour une fin d’après-midi, au retour de la plage, nos corps fatigués de n’avoir rien fait, sinon nager, lire et bronzer ». Et c’est ainsi qu’Arnaud est grand. Léon Mazzella
Voilà un vers de Baudelaire qui aurait pu faire le bandeau de couverture de cette longue lettre d’amour fou, si le mot adieu n’était pas déjà contenu dans un titre à rendre jaloux nombre de romanciers. Adieu aux espadrilles (*), du délicat Arnaud Le Guern, est un roman à peine fictif (même les noms des chats, Pablo et Malcolm, sont vrais), très Nouvelle Vague, très morandien – mais sans la vitesse, et avec une touche du Henry Jean-Marie Levet des Cartes Postales. Entre les pages de ce livre, nous (res) sentons ce parfum sentimental, précieux et léger comme la rosée du matin, l’été, au bord de la piscine, lorsqu’on s’est levé avant elle en prenant soin de ne pas la réveiller, pour aller fumer la première cigarette, tout en respirant les parfums tiédis du figuier à l’ombre bienfaisante; sous le soleil exactement. Arnaud Le Guern aime une femme, les actrices aussi, sa fille Louise surtout, l’insouciance, et les mots avec une gourmandise hussarde. Cette longue adresse est un joli pied-de-nez à la génération sms, qui dit avec tact et tendresse ce qu’aimer avec pureté veut dire. Le couple fait l’amour, se taquine sans jamais se griffer, les draps froissent, les jours passent, l’oisiveté chante sur la terrasse, les peaux se suffisent à elles-mêmes, les souvenirs affluent et repartent d’un revers de sa main à elle, afin d’empêcher toute nostalgie de surgir, et continuer de manger le présent à pleine bouche, comme on plante ses dents dans la peau duveteuse et craquante d’une pêche. Nous sommes dans Slogan, avec Birkin et Gainsbourg, nous feuilletons la sensualité pudique du Claire de Chardonne. Le couple est à des années lumière de Paris et son spectre de « rentrée » automnale. Les amoureux sacrifient avec délice au rite de l’apérotique : ils « apérotisent », dégustent un anjou de Mosse ou un rosé de Bandol, avant de s’entre-goûter. Ils ont le talent de savoir prendre le temps, mais avec Le Guern, le temps compte, se cueille, il frappe aux tempes du narrateur, et celui-ci a la délicatesse de ne jamais faire sentir le vertige de sa fuite. L’été est encore là, mais les saisons sont comme les coquelicots qui fanent dès qu’on les dépose sur le skai brûlant de la plage arrière du cabriolet. C’est « la vie comme à Lausanne » en plus souple, car « les espadrilles sont mes semelles de vent », écrit l’auteur. Jamais l’urgence n’ouvre ses yeux noirs, sauf peut-être sous le gouvernement du désir, et pourtant il plane comme une épée de Damoclès au-dessus de cette chambre d’hôtel. Qu’importe ! Les amants sont des aveugles. « Enlacés, nous laissons infuser une unique certitude : l’été, c’est l’amour une fin d’après-midi, au retour de la plage, nos corps fatigués de n’avoir rien fait, sinon nager, lire et bronzer ». Et c’est ainsi qu’Arnaud est grand. Léon Mazzella
---
(*) Le Rocher, en librairie fin août (c'est raccord!).
Au cœur de la « mafia » bordelaise
 Loin d’être un brûlot à charge, comme celui qui irrita nombre de propriétaires bordelais, et qu'écrivit Isabelle Saporta (Vino business), l’enquête de Benoist Simmat, journaliste économique est un réel travail d’investigation au cœur de la Bordeaux Connection (*), soit au cœur de la « mafia » des grands crus girondins. L’auteur ouvre la boîte de Pandore en démontant pièce par pièce, après l’avoir pénétré et analysé dans les moindres recoins, un système fonctionnant en vase clos, véritable microcosme de propriétaires de châteaux, négociants, courtiers et autres acteurs-clés, devenus richissimes en sachant imposer avec maestria, et au monde entier, leurs règles en matière de goût, de prix, de marché, comme autant de lois émanant de leurs Ordres à caractère maçonnique, que sont les grandes confréries du « milieu », comme la Commanderie du Bontemps (Médoc, Graves, etc.), et l’Union (des grands crus). Car celles-ci fonctionnent, selon l’auteur, comme les plus belles machines à écouler les grands crus à l’exportation. Ainsi décrit-il comment les acteurs de cette caste ont par exemple vampirisé le marché chinois, aveuglé à coups d’intronisations et de fastueux dîners de gala à l’adresse de nombreux nouveaux multimillionnaires déjà hypnotisés par la culture française, et ont orchestré, de façon artificielle, l’extraordinaire valorisation des grands bordeaux en une poignée d’années. Les pages consacrées au « hold-up des primeurs » par les dégustations « avant-primeurs », et réservées aux membres – très influents sur les marchés -, de « l’Union », sont particulièrement savoureuses. Désignant ces « barons » de la Bordeaux Connection, que sont les Cruse, Castéja, Lurton, Mähler-Besse, Miailhe, de Boüard, Bernard, Pontallier, et une poignée d’autres seigneurs en leurs fiefs, sans oublier le clan des winemakers, Simmat note que, « tous, à leur corps défendant ou non, ont constitué depuis quelques décennies une nouvelle aristocratie des affaires aux codes centrés sur le commerce d’un ancien produit plaisir, les bouteilles de vin de bons Bordeaux, devenus des marques de luxe catapultées dans la compétition économique globale. » Qui l’eut (grand) cru, il y a vingt ans ? Cependant, devant le pschitt de la bulle chinoise auquel nous assistons, l’auteur s’interroge sur l’avenir de ces fantastiques débouchés pour l’élite de l’étiquette (notamment le club très fermé des « Premiers »), devenue spécialiste des magouilles complexes et opaques, sans s’inquiéter outre-mesure : les « têtes chercheuses » du lobby lorgnent déjà vers d’autres horizons, où se trouvent les puissances de demain, du Mexique au Nigeria. L’enquête, avant tout passionnante, est solide, émaillée de très nombreux faits et dires, chiffres et anecdotes révélatrices, mais son titre est racoleur. Il n’y a pas eu mort d’homme. Alors, de là parler de mafia, et donc de méthodes mafieuses… Certes, il y a des parrains. Mais Bordeaux n’est pas Naples, ni Chicago. L.M.
Loin d’être un brûlot à charge, comme celui qui irrita nombre de propriétaires bordelais, et qu'écrivit Isabelle Saporta (Vino business), l’enquête de Benoist Simmat, journaliste économique est un réel travail d’investigation au cœur de la Bordeaux Connection (*), soit au cœur de la « mafia » des grands crus girondins. L’auteur ouvre la boîte de Pandore en démontant pièce par pièce, après l’avoir pénétré et analysé dans les moindres recoins, un système fonctionnant en vase clos, véritable microcosme de propriétaires de châteaux, négociants, courtiers et autres acteurs-clés, devenus richissimes en sachant imposer avec maestria, et au monde entier, leurs règles en matière de goût, de prix, de marché, comme autant de lois émanant de leurs Ordres à caractère maçonnique, que sont les grandes confréries du « milieu », comme la Commanderie du Bontemps (Médoc, Graves, etc.), et l’Union (des grands crus). Car celles-ci fonctionnent, selon l’auteur, comme les plus belles machines à écouler les grands crus à l’exportation. Ainsi décrit-il comment les acteurs de cette caste ont par exemple vampirisé le marché chinois, aveuglé à coups d’intronisations et de fastueux dîners de gala à l’adresse de nombreux nouveaux multimillionnaires déjà hypnotisés par la culture française, et ont orchestré, de façon artificielle, l’extraordinaire valorisation des grands bordeaux en une poignée d’années. Les pages consacrées au « hold-up des primeurs » par les dégustations « avant-primeurs », et réservées aux membres – très influents sur les marchés -, de « l’Union », sont particulièrement savoureuses. Désignant ces « barons » de la Bordeaux Connection, que sont les Cruse, Castéja, Lurton, Mähler-Besse, Miailhe, de Boüard, Bernard, Pontallier, et une poignée d’autres seigneurs en leurs fiefs, sans oublier le clan des winemakers, Simmat note que, « tous, à leur corps défendant ou non, ont constitué depuis quelques décennies une nouvelle aristocratie des affaires aux codes centrés sur le commerce d’un ancien produit plaisir, les bouteilles de vin de bons Bordeaux, devenus des marques de luxe catapultées dans la compétition économique globale. » Qui l’eut (grand) cru, il y a vingt ans ? Cependant, devant le pschitt de la bulle chinoise auquel nous assistons, l’auteur s’interroge sur l’avenir de ces fantastiques débouchés pour l’élite de l’étiquette (notamment le club très fermé des « Premiers »), devenue spécialiste des magouilles complexes et opaques, sans s’inquiéter outre-mesure : les « têtes chercheuses » du lobby lorgnent déjà vers d’autres horizons, où se trouvent les puissances de demain, du Mexique au Nigeria. L’enquête, avant tout passionnante, est solide, émaillée de très nombreux faits et dires, chiffres et anecdotes révélatrices, mais son titre est racoleur. Il n’y a pas eu mort d’homme. Alors, de là parler de mafia, et donc de méthodes mafieuses… Certes, il y a des parrains. Mais Bordeaux n’est pas Naples, ni Chicago. L.M.

(*) Bordeaux connection, par Benoist Simmat (First).
Texte paru (dans une version raccourcie) dans le n° Spécial Vins de L'EXPRESS du 3 juin dernier.
Couverture avec rabats, non corrigée, du Dictionnaire chic du vin (en librairie le 9 septembre).
Photo du bandeau de couverture : © Marine Mazzella (ma fille).
 Papier paru mercredi dans le Spécial Vins et Champagnes (juin) 2015 de L'EXPRESS. (Le sujet fait d'ailleurs la couv.)
Papier paru mercredi dans le Spécial Vins et Champagnes (juin) 2015 de L'EXPRESS. (Le sujet fait d'ailleurs la couv.)
Aux kiosques, citoyens!
LE ROSÉ DE LA BELLE AURORE
Aurore Casanova est une toute jeune vigneronne qui produit un champagne rosé de caractère sur la montagne de Reims.
---
Au sein de la bannière fédératrice des “Champagnes de Vignerons” (du Syndicat général des vignerons de la Champagne), qui désigne une immense famille de plusieurs milliers de vignerons, offre tout et son contraire, le meilleur comme le pire. Cette diversité extraordinaire est à la fois une chance et un inconvénient. Saisissons-là comme l’opportunité de jouer à la loterie, ce risque douillet qui réserve de jolies surprises. Ainsi, du champagne Aurore Casanova. Le nom, déjà, invite à gober une huître dans le corsage d’une Vénitienne, à l’heure où blanchit la place Saint-Marc... Puisque c’est uniquement ainsi que le célèbre libertin lettré mangeait ses bivalves. Aurore Casanova est le patronyme d’une jeune vigneronne – elle est née en 1987 -, l’âge des chardonnays de l’hectare cinquante-deux de sa propriété. Les pinot noirs, qui représentent deux tiers de la surface, sont à peine moins jeunes, puisqu’ils ont été plantés en 1968. Après qu’elle ait suivi des études d’oenologie, ce précieux terroir lui a été confié par sa mère – son père n’étant pas intéressé par le sujet. Les premiers résultats sont enchanteurs, surtout sur la cuvée de champagne rosé (le domaine propose aussi un blanc). La robe délicatement saumonée (50% chardonnay, 35% pinot noir et 15% pinot meunier), le cordon mince de ses très fines bulles, son nez vif de fruits rouges comme la fraise fraîche et juteuse, cette touche vanillée au second nez, et puis cette bouche intense, qui possède ampleur et amplitude, et où nous devinons le travail serein du chêne, en font un rosé à boire seul, pour lui-même, d’abord. 400 bouteilles (26€) à peine sortent du domaine – autant dire que l’adjectif confidentiel n’a jamais aussi bien apposé au mot cuvée. La propriété, qui s’inscrit dans une démarche environnementale et durable – Aurore Casanova s’inspire même de certains principes de la culture en biodynamie-, est située sur le vaste et beau terroir de la Montagne de Reims. Cependant, ce flacon à l’étiquette chic, où l’on devine un masque vénitien en forme de coeur percé d’yeux, goûté sur la cuisine très (trop) élaborée du chef Akrame Benallal un soir de février dernier, sait escorter avec maestria certains mets, et il excelle sur les saveurs qui ne s’en laissent pas compter, d’ordinaire. Si le rosé d’Aurore Casanova n’aime en revanche pas se fiancer avec les champignons (on le comprend), il ne déteste pas se frotter à un poisson blanc et ferme comme la lotte,  voire sur une viande rouge très saignante ) capable de révéler sa puissance. Le rosé d’Aurore Casanova possède autant de caractère que sa jeune propriétaire, ex-danseuse classique et néovigneronne qui sait ce qu’elle veut. Léon Mazzella
voire sur une viande rouge très saignante ) capable de révéler sa puissance. Le rosé d’Aurore Casanova possède autant de caractère que sa jeune propriétaire, ex-danseuse classique et néovigneronne qui sait ce qu’elle veut. Léon Mazzella
Photo : © Dominique Bruneau
 Cliquez, puis lisez :
Cliquez, puis lisez :
https://www.youtube.com/watch?v=-aqFjWz41c0
Je te rencontre.
Je me souviens de toi.
Qui est tu ?
Tu me tues.
Tu me fais du bien.
Comment me serais je doutée que cette ville était faite à la taille de l´amour ?
Comment me serais je doutée que tu étais fait à la taille de mon corps même?
Tu me plais. Quel événement. Tu me plais.
Quelle lenteur tout à coup.
Quelle douceur.
Tu ne peux pas savoir.
Tu me tues.
Tu me fais du bien.
Tu me fais du bien.
J'ai le temps.
Je t'en prie.
Dévore-moi.
Déforme-moi jusqu'à la laideur.
Pourquoi pas toi ?
Pourquoi pas toi dans cette ville et dans cette nuit pareille aux autres au point de s'y méprendre ?
Je t'en prie…
 Cliquez à nouveau, puis lisez :
Cliquez à nouveau, puis lisez :
https://www.youtube.com/watch?v=oPONf1fu2II
Je te rencontre.
Je me souviens de toi.
Cette ville était faite à la taille de l´amour.
Tu étais fait à la taille de mon corps même.
Qui est tu ?
Tu me tues.
J´avais faim. Faim d'infidélités, d´adultères, de mensonges et de mourir.
Depuis toujours.
Je me doutais bien qu'un jour tu me tomberais dessus.
Je t'attendais dans une impatience sans borne, calme.
Dévore-moi. Déforme-moi à ton image afin qu'aucun autre, après toi, ne comprenne plus du tout le pourquoi de tant de désir.
Nous allons rester seuls, mon amour.
La nuit ne va pas finir.
Le jour ne se lèvera plus sur personne.
Jamais. Jamais plus. Enfin.
Tu me tues.
Tu me fais du bien.
Nous pleurerons le jour défunt avec conscience et bonne volonté.
Nous aurons plus rien d'autre à faire que, plus rien que pleurer le jour défunt.
Du temps passera. Du temps seulement.
Et du temps va venir.
Du temps viendra. Où nous ne saurons plus nommer ce qui nous unira. Le nom ne s'en effacera peu à peu de notre mémoire.
Puis, il disparaîtra tout à fait.
© Marguerite Duras, Alain Resnais.
Texte paru dans le hors-série La Résistance, de L'EXPRESS, actuellement en kiosque. Cours chez ton marchand de journaux, citoyen papivore, et avide de la belle Histoire de France, afin que vive la presse écrite!

QUELQUES RÉSISTANTS ILLUSTRES,
par Léon Mazzella
Quatre d’entre eux sont entrés au Panthéon le 27 mai dernier : Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette et Jean Zay. Beaucoup furent de « grand(e)s » résistant(e)s. Voici, dressés, les portraits d’une poignée de respect.
Geneviève de Gaulle-Anthonioz, « Gallia » (1920-2002)
Nièce du général (elle est la fille de Xavier, le frère aîné), Geneviève de Gaulle, entre immédiatement en Résistance en 1940, choquée par le discours de Pétain du 17 juin. Elle n’a pas vingt ans. Elle ne résiste pas longtemps de façon isolée, à Rennes où elle poursuit ses études, et rejoint rapidement le futur Réseau du musée de l’Homme. Elle entre dans la clandestinité dès août 1942. Ses nombreux actes de bravoure la conduisent à acheminer du courrier en Espagne, et surtout à agir au sein du groupe Défense de la France (elle participera au journal éponyme, en signant des articles de son pseudonyme « Gallia »), aux côtés de Philippe Viannay, son fondateur, après avoir rencontré son frère Hubert dans le maquis savoyard. Mais Geneviève de Gaulle est confondue par la Gestapo en juillet 1943, est alors emprisonnée six mois durant à Fresnes, puis déportée à Ravensbrück en février 1944, en même temps que Germaine Tillion et un millier d’autres femmes résistantes ou seulement suspectes. Elle écrira La Traversée de la nuit (Seuil, 1998), pour apporter son témoignage sur l’horreur du camp - où les femmes la surnomment « le petit de Gaulle » -. Himmler lui-même veille particulièrement, de façon tactique, à cette prisonnière qui pourrait bien constituer une monnaie d’échange… Elle parvient néanmoins à quitter Ravensbrück une année après son arrivée, lorsque l’Armée rouge le libère. A la Libération, elle épouse l’éditeur d’art Bernard Anthonioz, préside l’Association nationale des anciennes déportées et internées de la Résistance (ADIR), et prend, en 1964, la présidence de Aide à toute détresse (ATD-Quart Monde).
Germaine Tillion (1907-2008)
La grande ethnologue, célèbre pour ses travaux de terrain dans les Aurès (Algérie), et qui entre au Panthéon en ce mois de mai 2015, cherche un moyen de s’engager dans la Résistance dès son retour de mission chez les Chaouia, en juin 1940. C’est naturellement le groupe du musée de l’Homme qu’elle rejoint, et où elle tissera des liens et facilitera des contacts entre résistants. Le futur « Réseau » du musée de l’Homme, animé par Boris Vildé, Paul Hauet, Paul Rivet, Anatole Lewitsky, Charles Dutheil, et Yvonne Odon, connaît rapidement les bienfaits de l’action de l’ethnologue. Lorsque le Réseau est « décapité », suite à une délation, Germaine Tillion reprend les rênes du groupe du musée en y développant ce qu’elle sait faire le mieux : l’assistance aux prisonniers de guerre, le renseignement militaire, l’information et la multiplication des contacts entre Londres et « l’intérieur », via notamment le journal Résistance. Dénoncée à son tour, elle est arrêtée par l’Abwehr, connaît la prison de Fresnes quatorze mois durant, avant d’être déportée en octobre 1943 au camp de concentration réservé aux femmes de Ravensbrück, revêtue du sinistre statut de « NN », pour Nacht und Nebel (Nuit et Brouillard), qui désigne des personnalités gênantes pour le Reich, et que celui-ci se charge de faire disparaître. C’est à Ravensbrück qu’elle rencontre Geneviève de Gaulle, ainsi que d’autres femmes rendues célèbres par leur action durant la Résistance, comme Anise Postel-Vinay, Marie-Jo Chombart de Lauwe, Denise Jacob (Denise Jacob-Vernay, sœur de Simone Veil), ou bien pour leur activisme communiste, ainsi de l’écrivaine allemande Margarete Buber-Neumann. Elle parvient le 23 avril 1945, à échapper à l’extermination programmée du camp et l’acheminement à Mauthausen. A la Libération, Germaine Tillion laisse provisoirement de côté l’ethnologie afin de se consacrer à l’étude des crimes de guerre nazis, au sein du CNRS.
Jean Zay (1904-1944)
Avocat inscrit au barreau d’Orléans, et homme politique – il fut ministre du Front populaire, et député du Loiret -, assassiné par la Milice le 20 juin 1944, Jean Zay démissionne de ses fonctions publiques à la déclaration de guerre, en 1939, afin de servir son pays les armes à la main. Ce « rad-soc » (radical-socialiste) franc-maçon tombé très tôt dans la marmite politique, est un « Jeune Turc » actif faisant cependant figure de cavalier seul de la Résistance, au point d’avoir été seulement réhabilité en cette qualité, quatre ans après la Libération. Son nom est associé à l’affaire du Massilia. La débâcle le pousse à rejoindre ses pairs députés à Bordeaux, où gouvernement et Parlement sont provisoirement installés. Paris a été livrée aux forces d’Occupation. Proche de Pierre Mendès France, il embarque le 24 juin 1940 à bord du paquebot Massilia depuis le port médocain du Verdon, avec vingt-cinq autres parlementaires, dont Edouard Daladier et Georges Mandel, pour Casablanca, avec la ferme intention d’y installer un gouvernement français « hors-sol », et de continuer ainsi le combat. Retenus par un grève, les dissidents n’assistent pas à la prise des pleins pouvoirs de Pétain et à la fin de la IIIe République. Cet acte de « désertion en présence de l’ennemi » vaut à Jean Zay d’être aussitôt fiché comme un « juif anti-munichois » à réduire coûte que coûte au silence… Des relents d’affaire Dreyfus bis flottent dans l’air vichyssois. Tandis que Mendès et les autres écopent de peines de prison, Zay constitue la cible antisémite idéale. Le sinistre Darnand dépêchera bientôt trois miliciens déguisés en résistants, pour l’assassiner dans un bois, en simulant un transfert de la prison de Riom (où il côtoie Léon Blum), vers le maquis. Le « déserteur », réhabilité en 1945, entrera au Panthéon le 27 mai prochain comme un grand Homme.
Henri Tanguy, « Colonel Rol-Tanguy » (1908-2002)
Militant communiste depuis l’âge de 17 ans, Rol-Tanguy est surtout célèbre pour avoir ardemment participé à la libération de Paris jusqu’à l’arrivée triomphante du Général Leclerc. Il se choisit le surnom de « Rol » en mémoire de Théo Rol, combattant des Brigades internationales qui trouva la mort sur le front de l’Ebre, en Espagne. Car, jeune ouvrier chez Bréguet à Montrouge, en région parisienne, Tanguy s’engage dans les Brigades internationales au cours de la guerre civile d’Espagne. Puis, il combat en Lorraine de septembre 1939 à août 1940. Aussitôt après sa démobilisation, il embrasse la Résistance communiste armée au sein des Francs-tireurs partisans (FTP), en qualité de responsable militaire. Il agit tour à tour en Anjou, puis en région parisienne. C’est là qu’il sabotera notamment les départs au STO par son action avec ses camarades du Comité d’action contre la déportation. Il devient par la suite chef des Forces françaises de l’intérieur (FFI) de la région Île-de-France, où il est chargé de préparer la libération de la capitale. C’est à ce moment-là qu’il rencontre Jacques Chaban-Delmas, le délégué militaire national de De Gaulle, et qui représente le Comité français de libération nationale (CFLN). Une action concertée de grande envergure commence à s’organiser conjointement avec le Comité d’action militaire (COMAC) du Conseil national de la résistance. Rol-Tanguy jouera un rôle décisif dans les journées de la fin du mois d’août 1944, en particulier auprès des policiers résistants. Il est reconnu comme ayant été le « chef de l’insurrection ». Sa signature sur l’acte de reddition des Allemands, en présence du général Von Choltitz, contestée par Leclerc, ne figure pas sur l’acte officiel. Il poursuivra une carrière militaire de 1945 à 1962, mais ses convictions communistes freineront quelque peu son avancement.
Henri Frenay, « Morin », « Molin », « Charvet », « Nef » (1905-1988)
C’est l’un des hommes-clés de la Résistance, côté droite, voire extrême-droite. Il fonde fin 1941, avec Berty Albrecht rencontrée sept ans plus tôt, le mouvement Combat, qui entend confondre toutes les sensibilités politiques afin d’être uni face à l’occupant. Combat, « organe du mouvement de la Résistance française », succède à diverses tentatives, comme celles du Mouvement de libération nationale (MLN), puis du Mouvement de libération française (MLF). Démobilisé après la drôle de guerre, il entre tôt dans la clandestinité et change souvent de pseudo afin d’échapper à l’étau de la Gestapo. Il est l’un des artisans de la réunification des mouvements de la Résistance, comme Franc-Tireur, animé par Jean-Pierre Lévy, et Libération, d’Emmanuel d’Astier de La Vigerie. Il rencontre Jean Moulin dès 1941, reconnaît de Gaulle comme leur guide, depuis Londres. La réunification de ces entités porte un nom, le MUR, pour Mouvements unis de la Résistance. Lequel se fissure vite, Frenay souhaitant sans l’avouer l’indépendance de « son » Combat. Les relations se tendent avec Moulin, qu’il admire pourtant pour son courage et sa dévotion. En 1942, Frenay s’embarque depuis Gibraltar pour Londres, afin de rencontrer de Gaulle, qui l’apaise, mais se méfie de lui et lui préfère Moulin. Berty Albrecht – qui fut la première à ouvrir les yeux de Frenay sur lel danger nazi -, est retrouvée pendue dans sa cellule, à Fresnes, en mai 1943, le jour même de son emprisonnement. Frenay a de l’ambition, mais, en 1944, il échoue à se voir gratifié d’un poste à responsabilité au sein du Gouvernement provisoire de la République française (GPRF). L’homme, marqué à la droite extrême, effectue alors un virage – qui tournera court - en se rapprochant de la jeune Union démocratique et socialiste de la Résistance, et donc de François Mitterrand. Il reproche amèrement à Jean Moulin d’avoir fait main basse sur la Résistance, avec l’éphémère CNR. Ces querelles intestines et ses rancoeurs d’hommes avides de pouvoir, ternissent quelque peu son image de « grand résistant » au-dessus de la mêlée.
Gilbert Renault, « Colonel Rémy » (1904-1984)
Son nom de résistant est associé à un important réseau de la zone occupée, la Confrérie Notre-Dame, rebaptisé plus tard CND-Castille (Confrérie Notre-Dame-Castille). Très tôt en rupture lucide avec l’armistice, il est l’un des premiers à effectuer le voyage à Londres. Chargé par le colonel Passy d’animer un réseau de renseignements en France, il créé ainsi, avec Louis de La Bardonnie, dès août 1940, l’un des premiers réseaux importants du Bureau central de renseignements et d’action (BCRA), la Confrérie Notre-Dame (non sans penser placer son action sous protection divine). Le réseau clandestin qui fournira de nombreux renseignements militaires d’importance capitale, voit le jour chez La Bardonnie, alors viticulteur à Saint-Antoine-du-Breuilh (Dordogne). Pierre Brossolette aidera considérablement le colonel Rémy à rallier syndicats et partis politiques (communiste, notamment) à la cause. Claude Chabrol réalisa en 1966 un film à partir des mémoires de Gilbert Renault, signées Rémy, dans lesquelles le grand agent secret n’hésite pas à « pardonner » Pétain, ce qui lui vaut, dès la Libération, d’être lâché par de Gaulle, qui l’a néanmoins fait Compagnon de la Libération en 1942. Renault, alias Rémy, écrira par la suite de nombreux livres sur les années noires de l’Occupation.
Jacques « Chaban » -Delmas (1915-2000)
C’est à Saint-Léon-sur-Vezère, village du Périgord noir, que se trouve le château de Chaban. Il n’a jamais appartenu à l’illustre député-maire de Bordeaux durant 48 ans (surnommé « le duc d’Aquitaine »), cinq fois ministre et même Premier ministre (sous Pompidou), et enfin trois fois Président de l’Assemblé nationale. Cependant, Jacques Delmas, se promenant en 1943 dans la région, lut le nom sur un panneau et le choisit comme nom définitif de résistant, après avoir eu celui de Lakanal (du nom du lycée de Sceaux où il étudia). Il le garda par la suite, tant et si bien que l’homme politique est surtout connu par ce raccourci de son patronyme : Chaban. En juin 1940, Jacques Delmas, sorti major de Saint-Cyr, et en poste dans la région de Nice en qualité de sous-lieutenant, supporte si peu l’idée de la défaite qu’il entre en contact avec la Résistance dès le mois de décembre. Bien qu’il souhaite ardemment rejoindre la France libre, il est affecté à la Résistance intérieure, en intégrant les rangs du Comité financier de la Résistance (COFI). C’est en tant que haut-fonctionnaire (il a fait droit et Sciences po avant Saint-Cyr), qu’il travaille auprès du Ministre de la Production industrielle (du second gouvernement de Pierre Laval), et n’a de cesse d’alimenter la France libre en informations précieuses d’ordre économique, via le réseau de renseignements « Hector ». Le futur compagnon de la Libération qui jouera un rôle central au moment de la libération de Paris, devient vite, et sur recommandation appuyée auprès du général de Gaulle – dont il deviendra un fidèle et proche collaborateur -, le plus jeune général (de brigade) de l’armée française depuis le Premier empire, ce en 1944 et à l’âge de 29 ans, après avoir été nommé délégué militaire national.
Jean-Louis Crémieux « Brilhac » (1917-2015)
Mort le 8 avril dernier à l’âge de 98 ans, il fut responsable de la communication de la France libre : tour à tour secrétaire du Comité exécutif de propagande, et chef du service de diffusion clandestine de la France libre, il prendra fréquemment la parole au micro de Radio Londres, de 1941 à 1944. Mobilisé en 1939, il part combattre sur la ligne Maginot, est prisonnier durant un an et demi en Allemagne, s’évade d’un stalag de Poméranie, fuit en URSS, où il connaît encore la prison, puis il est libéré en juin 1941 lorsque la France libre et l’Union soviétique deviennent alliés. Il rallie Londres en septembre de la même année, et Jean-Louis Crémieux (neveu du critique littéraire Benjamin Crémieux), prend alors le pseudonyme de Brilhac, qu’il conservera, en s’engageant dans les Forces françaises libres, les FFL. Historien de référence de la seconde guerre mondiale, auteur (une fois prise sa retraite) de nombreux ouvrages, notamment Ici Londres. Les Voix de la liberté (La Documentation française), Les Français de l’an 40, ou encore La France libre. De l’appel du 18 juin à la Libération (Gallimard). Crémieux-Brilhac a également cofondé la Documentation française, qu’il dirigea. Grand-croix de la Légion d’honneur, fut enfin conseiller d’Etat.
Joseph Kessel, « Joseph Pascal » (1898-1979)
Son neveu se nomme Maurice Druon, et à eux deux, à la demande de Germaine Sablon, amante de Kessel et chanteuse de son état, ils composent dans un pub londonien « Le Chant des partisans » le 23 mai 1943, sur une musique composée par Anna Marly. On connaît la suite : cette mélodie chante dans nos oreilles en générant toujours autant d’émotion ; aujourd’hui. L’auteur de « L’armée des ombres » (dont Jean-Pierre Melville fera une poignante adaptation cinématographique), est Résistant dans l’âme. Allergique au fascisme comme au communisme, il devient au fil du temps le grand reporter et le romancier de talent que nous savons. Après avoir refusé de rejoindre le mouvement Libération, malgré l’insistance d’Emmanuel d’Astier de La Vigerie, il choisit de rejoindre le réseau Carte, ce peu après l’armistice, car Maurice Druon s’y trouve aussi. Ensemble, ils iront à Londres et s’engageront dans les Forces aériennes françaises libres (FAFL), l’armée de l’air de la France libre, affiliée à la Royal Air Force (RAF), et où l’on trouve Romain Gary, Pierre Clostermann, ou encore Pierre Mendès France. Juif, il se voit interdire d’exercer sa profession de journaliste, notamment à Paris-Soir. Il publiera néanmoins ses reportages à chaud, dans France, journal anglais de la communauté française. Une autre façon de résister.
Missak Manouchian (1906-1944)
Il est le plus célèbre des dix résistants communistes d’origine étrangère qui figurent sur la fameuse « Affiche rouge », que les Allemands avaient collée un peu partout sur les murs des grandes villes françaises. Le poète arménien Manouchian (rescapé du génocide organisé par l’Empire ottoman), doit apparaître avec ses camarades comme de dangereux terroristes bolcheviques, afin de jeter l’anathème sur la Résistance. Du moins, c’est ce que la propagande nazie espère. L’effet escompté est l’inverse. Militant et directeur, avant la seconde guerre, d’organisations liées au communisme, comme le Comité de secours pour l’Arménie (HOC), puis l’Union populaire franco-arménienne, ainsi que la Main d’œuvre immigrée (MOI). C’est au sein des Francs-tireurs et partisans français (FTPF), liés au PCF, que nous le retrouvons, puis aux FTP-MOI, branche étrangère (armée) des FTP. Il pilote de nombreuses opérations de sabotage et des attentats, notamment celui qui coûta la vie, en 1943, au général Julius Ritter, responsable du recrutement pour le STO. Les Brigades spéciales de la police française arrêtent Manouchian en novembre de la même année. Il est torturé. Son procès, expéditif, le condamne à mort. Avec vingt et un autres militants, Manouchian, est fusillé le 21 février 1944 au Mont-Valérien.
 René Char, « Capitaine Alexandre » (1907-1988)
René Char, « Capitaine Alexandre » (1907-1988)
Nombreux sont les écrivains et artistes qui rejoignent la Résistance. S’il ne faut retenir qu’un seul poète parmi eux, emblématique, c’est l’immense poète René Char que nous consignons dans ces pages. Responsable du maquis de la Durance, basé à Céreste (Alpes-de-Hautes-Provence), il y écrira, « dans la tension, la colère, la peur, l’émulation, le dégoût, la ruse, le recueillement furtif, l’illusion de l’avenir, l’amitié, l’amour », les Feuillets d’Hypnos, 1943-1944 (Gallimard), ses notes de maquis dédiées à son ami Albert Camus, qui est alors l’âme du journal Combat, et qui constituent un recueil de fragments en prose poétique, rédigés entre « fureur et mystère ». Un classique des temps modernes. « Ces notes marquent la résistance d’un humanisme conscient de ses devoirs, discret sur ses vertus (…) et décidé à payer le prix pour cela », déclare-t-il. En magicien de l’insécurité, Char se livrera à de multiples sabotages d’envergure, au sein des Forces françaises combattantes (FFC), ainsi qu’à la protection de tous ceux qui fuient le STO dans sa région d’influence. Rebelle et intégralement engagé dans l’action, le poète à la sérénité crispée rejoint Alger, où l’état-major interallié l’envoie en 1944. Et combat sans relâche l’occupant, dès son retour ; jusqu’à la Libération. (Photo : peinture d'EkAT, d'après photo. © Coll. part. /L.M.).
Honoré d’Estienne d’Orves, « Châteauvieux » (1901-1941)
Marin de la Royale – capitaine de corvette à vingt ans -, après avoir fait l’X, Honoré d’Estienne d’Orves possède un tempérament d’aristocrate, très « drapeau blanc », qui force le respect. Ne supportant pas le discours du 17 juin de Pétain, il s’empresse de rejoindre Londres deux mois plus tard, et rencontre de Gaulle en septembre. Affecté naturellement au sein des Forces navales françaises libres (FNFL, 2e bureau, chargé des renseignements), il regagne le sol français et participe à la création du réseau de renseignement et de liaison radio « Nemrod », avec notamment Maurice Barlier et Jan Doornick. Trahis en janvier 1941 par un jeune radio de leur propre équipe, Alfred Gressler, d’Orves est arrêté par la Gestapo le 21 à Nantes, avec vingt-cinq autres résistants. « Nemrod » est démantelé. Emprisonné à Fresnes, il est exécuté le 29 août au Mont-Valérien, après le rejet d’une demande de grâce, avec ses principaux « complices ». Au cours de son procès en Cour martiale, Honoré d’Estienne d’Orves endossa toute responsabilité, afin de tenter de sauver ses compagnons, mais en vain.
Voici ce que le regretté Jacques Lacarrière écrivait, dans le magazine Senso, à propos d'une colline familière, située derrière chez lui, en Bourgogne :
Les collines sont l'oeuvre du ciel et non celle de la terre, filles naturelles de l'érosion. Ce mot a mauvaise réputation, je sais, car il est synonyme d'effritement, délitement, délabrement, vieillissement, voire sénescence. Bien à tort. L'érosion n'est pas seulement un phénomène naturel mais un acte d'amour. Oui, un acte d'amour. N'a-t-on donc jamais remarqué que ce mot débute justement par la syllabe Eros qui signifie l'Amour? L'érosion est lotion d'amour que le ciel répand sur les hauteurs et les cimes excessives, un massage, une attention des eaux, une caresse répétée des vents, tout un savant, méticuleux, minutieux polissage des saillies inutiles, des élancements dévoyés, des entassements sauvages qu'il s'agit de domestiquer. L'érosion aplanit les aspérités, adoucit les oppositions, égalise les affrontements, en un mot apaise et abaisse en les polissant l'ardeur et l'âpreté des élans primitifs. Chaque colline eut ainsi son histoire et son aventure érosives, son long concubinage avec l'air et les eaux.
Il est paru ce matin, avec l’hebdo. 100 pages de plaisir, placées sous la houlette de Philippe Bidalon, auxquelles nous avons ardemment collaboré. Cours vite au kiosque le plus proche, citoyen papivore et amateur de bonnes bouteilles, afin que VIVE LA PRESSE ECRITE!
 A lire, notamment, des papiers sur le crowdfunding et le vin, les Bordeaux primeurs, un tour de France des vignobles (nous avons abondamment traité la Loire, l'Alsace, le Sud-Ouest, la Champagne, et pas que), les livres, l'Armagnac, les rosés de l'été (tant de flacons dégustés pour une sélection drastique et à haute valeur ajoutée garantie par nos papilles réunies), et encore bien d'autres réjouissances, dans ce numéro très spécial, très goûteux, très gouleyant, salivant, soiffard parfois, profond aussi, sincère toujours.
A lire, notamment, des papiers sur le crowdfunding et le vin, les Bordeaux primeurs, un tour de France des vignobles (nous avons abondamment traité la Loire, l'Alsace, le Sud-Ouest, la Champagne, et pas que), les livres, l'Armagnac, les rosés de l'été (tant de flacons dégustés pour une sélection drastique et à haute valeur ajoutée garantie par nos papilles réunies), et encore bien d'autres réjouissances, dans ce numéro très spécial, très goûteux, très gouleyant, salivant, soiffard parfois, profond aussi, sincère toujours.
 Quelles affiches, por dios!.. Un mano a mano Morante de la Puebla - El Juli cet après-midi (avec des Garcigrande), une mixte (!) dimanche matin, avec Pablo Hermoso de Mendoza à cheval (2 toros de Fermin Bohorquez) et Enrique Ponce à pied face à 4 autres toros (notamment un Victoriano del Rio), et l'après-midi, c'est le retour à Nîmes des Victorino Martin! Avec deux spécialistes des toros compliqués, voire durs : Rafaelillo, et Manuel Escribano (ce dernier a triomphé à Séville, il y a deux ans), et enfin Paco Urena, qui confirmera son alternative... Et qui a gracié un Victorino l'année dernière. Cela promet - et nous serons dans les gradins (pour les Victorino seulement). "Vivement dimanche!", dirait Miguel El Drouquér II.
Quelles affiches, por dios!.. Un mano a mano Morante de la Puebla - El Juli cet après-midi (avec des Garcigrande), une mixte (!) dimanche matin, avec Pablo Hermoso de Mendoza à cheval (2 toros de Fermin Bohorquez) et Enrique Ponce à pied face à 4 autres toros (notamment un Victoriano del Rio), et l'après-midi, c'est le retour à Nîmes des Victorino Martin! Avec deux spécialistes des toros compliqués, voire durs : Rafaelillo, et Manuel Escribano (ce dernier a triomphé à Séville, il y a deux ans), et enfin Paco Urena, qui confirmera son alternative... Et qui a gracié un Victorino l'année dernière. Cela promet - et nous serons dans les gradins (pour les Victorino seulement). "Vivement dimanche!", dirait Miguel El Drouquér II.
Et vive les vins des Costières de Nîmes, qui organisent ce week-end de fiesta et de feria, aux bons soins de l'agence lyonnaise Clair de Lune. A suivre, pour le compte rendu de la corrida, et surtout des dégustations.
Papier paru ce matin dans L'Express, sur Zanzibar, où je me trouvais à la fin de l'été dernier :

Il y a des noms qui propulsent dès qu’on les prononce : Samarkand, Tombouctou, Zanzibar possèdent le génie du lieu entre leurs lettres. Ces mots font rêver, et refilent illico une envie d’y aller voir. Alors nous y sommes allés – voir.

----
Si l’archipel tanzanien de Zanzibar (de l’arabe Zinj el Barr : « le pays des Noirs »), désigne trois îles : Unguja, Pemba et Mafia, c’est la première, appelée simplement Zanzibar, qui se visite en priorité, en partant de Dar es Salaam à bord d’un petit avion, ou mieux, par bateau depuis Bagamoyo – « là où meurt mon cœur », en Swahili, petite ville côtière qui fut jusqu’au XIXe siècle la base arrière de Zanzibar, alors plaque tournante du commerce des épices – et notamment du clou de girofle -, de l’ivoire et des esclaves. Stone Town, la capitale zanzibarite, est plus connue sous le nom de Zanzibar City. Cette splendide petite cité, dont l’architecture a subi tour à tour les influences portugaise, allemande, arabe et anglaise, est un lacis de ruelles très étroites, un éparpillement de palais délicieusement décatis, et de marchés aux épices et aux poissons qui enrichissent durablement notre mémoire olfactive. Quelques monuments comme The house of Wonders (la maison des Merveilles), ou le Fort arabe, et les jardins Forodhani, envahis chaque soir d’échoppes proposant des grillades de poissons, justifient une à deux journées de visite, avant de filer vers l’extrême nord de l’île, à une soixantaine de km de là (une heure en voiture, le double en « daladala », le bus local), aux seules fins d’avoir l’Océan indien pour horizon turquoise, en un lieu inouï et loin de tout tumulte, où chacun est prié de laisser ses tracas sur le perron d’un Lodge accorte.

ON THE ROCK

----
Photos : © L.M.
Lire : Tanzanie & Zanzibar (Bibliothèque du voyageur, Gallimard)
C'est le nouveau hors-série de L'EXPRESS auquel j'ai participé
(co-rédaction en chef, aux côtés de Philippe Bidalon, et rédaction).
Aux kiosques, citoyens!
Afin que vive la presse écrite!

Humeur matinale
Je pensais un peu naïvement que l’espèce la plus répandue, à Paris, était le pigeon, ce biset malade et dégénéré, lesté de plomb gazeux et nourri aux déchets et autres excrétas. Puis, je me suis vite aperçu que c’était le blaireau. Ca court les rues, et les trottoirs. Talonné, en nombre, par le requin. Lequel est suivi de près, dans mes statistiques, par le vautour. Lorsque je note la présence de vautours, j’observe une colonie de faisans dans un périmètre proche – c’est la logique de la prédation. Il faut que ça vampirise pour exister, ces bêtes-là. Dans certaines zones où le maquereau abonde, la morue n’est jamais loin, en nombre conséquent elle aussi. Il s’agit là de logique de dépendance, un peu comme la chienne alimentaire (jamais loin de son maître). La bécasse gazouille bruyamment dans les magasins de prêt-à-porter, où passent des musiques insultantes pour les tympans moyens. J’ai noté, encore, la présence de plus en plus arrogante de corneilles noires toujours plus nombreuses et adaptées comme c’est pas permis (mais ça, c’est une vraie observation ornithologique, pas une blague). Et puis non ! L’espèce la plus répandue, dans cette ville de petit Noé, c’est vraiment le mouton. Je ne vous dis pas… Je ne vous dis pas ce que je ramasse chaque jour, et aux mêmes endroits, de surcroît ! A croire que le mouton se reproduit mieux que le lapin (encore un mythe, ça, comme la bécasse – qui est en réalité un oiseau intelligent). Ici, là, puis là aussi, derrière une porte – que dis-je : derrière chaque porte. Sur les étagères, sous le machin, dans l’encoignure, et là aussi, partout, partout les moutons prospèrent. En tas, en boule, en agneaux filamenteux, en trainées, en gros tas (ah, là, c’est ma faute : je n’avais pas soulevé le lit depuis des lustres), et ça sort, et ça se pose, et ça se tient chaud, ça créée des groupes, et allez ! Groupir, groupir, on dirait qu’ils veulent à tout prix être au cœur du selfie. Et ça vient de nulle part – mais oui, d’ailleurs, ça sort d’où, tout ça, vous le savez, vous ? Y’en a, mais y’en a…. Un courant d’air et ils se carapatent, en plus. Ils détalent. Le balai, l’aspi (pratique pour les selfies spéciaux), l’huile de coude, n’en peuvent mais. Ca revient le lendemain. C’est le rythme. Quotidien. Certes, l’homme n’est que poussière. « D’où l’importance du plumeau », me souffle Alexandre Vialatte. Quand même. J’aimerais me sentir moins berger lorsque je rentre chez moi. Pas vous ? L.M.
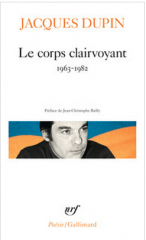 "Te gravir et, t'ayant gravie - quand la lumière ne prend plus appui sur les mots, et croule et dévale, - te gravir encore. Autre cime, autre gisement."(...)
"Te gravir et, t'ayant gravie - quand la lumière ne prend plus appui sur les mots, et croule et dévale, - te gravir encore. Autre cime, autre gisement."(...)
---
(...) "La nuit écrit. Élargissant l’espace, extravagant la page, pulvérisant le cercle de pierres. Et enrôlant la mort. On lui doit un surcroît de force, et l’aggravation du silence. On lui doit de toucher l’extrême fond de la faiblesse, et la cime de nos plissements."
---
"Nous n’appartenons qu’au sentier de montagne
Qui serpente au soleil entre la sauge et le lichen
Et s’élance à la nuit, chemin de crête,
À la rencontre des constellations."(...)
Jacques Dupin (1927-2012).
Les sites de vente en ligne annoncent déjà mon prochain livre, qui paraîtra fin août : Dictionnaire chic du vin (Ecriture), c'est 350 pages serrées d'hédonisme, de sérieux et de déconne, d'éloge du bien-vivre et du sang de la vigne - et ses inséparables connotations littéraires, musicales, sensuelles. Voici un aperçu capturé sur le site de la fnac :
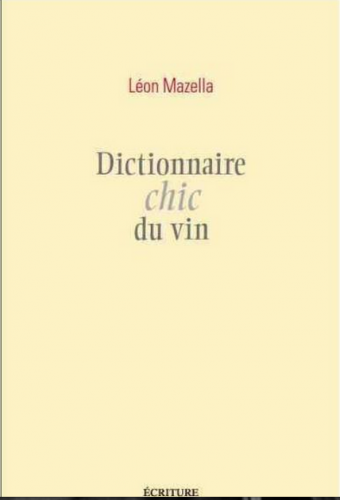 (avec une belle faute d'orthographe -ZZ- sur la couv. provisoire)
(avec une belle faute d'orthographe -ZZ- sur la couv. provisoire)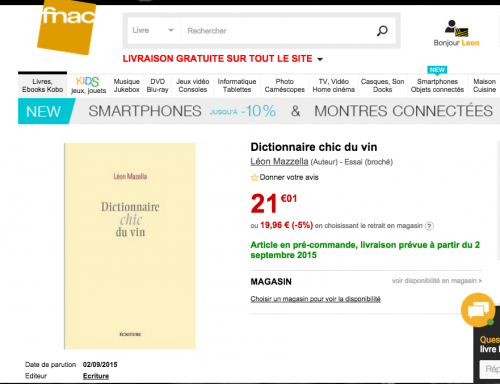
 Papier paru dans le hors-série de L'Express, C'était l'Indochine... Toujours en kiosque. Pour que Vive la presse écrite!
Papier paru dans le hors-série de L'Express, C'était l'Indochine... Toujours en kiosque. Pour que Vive la presse écrite!
NAVIGUER SUR LA SOIE VERTE
Bercée de légendes et sillonnée bar des bateaux de croisière à longueur d'année, la baie d'Along est d'abord l'une des merveilles naturelles du monde. Sa découverte frappe durablement chaque voyageur.
----
La huitième merveille du monde, disent les Vietnamiens, qui voient défiler trois millions de touristes, chaque année, dans cette partie du golfe du Tonkin où, sur une superficie d’environ 1 500 km2, 1969 pitons rocheux escarpés et karstiques, inhabités pour la plupart, et au total 3 000 îlots de toutes tailles, ont valu à ce site internationalement connu, lieu de pèlerinage obligé et d’une beauté époustouflante, d’être classé une première fois au patrimoine mondial par l’Unesco en 1994, puis en 2000, pour la richesse de sa biodiversité. L'écrivain Olivier Frébourg définit la baie comme « le lieu commun du Vietnam, son slogan publicitaire » (*).
Ha Long, « le dragon qui descend », rappelle une légende. Celle de cet animal mythologique, bienfaisant au Vietnam, qui, tiré brutalement de son sommeil, aurait plongé dans la mer et avec les battements de sa queue gigantesque, aurait taillé la montagne en pièces et en îlots, creusé des vallées profondes et des crevasses que la mer de Chine aurait ensuite comblées et sculptées. Puis, le dragon aurait trouvé l’endroit si beau qu’il choisit d’y demeurer. Les jours de brume – fréquents dans la baie, ils augmentent singulièrement son mystère et sont peut-être préférables aux jours de grand bleu -, les guides vietnamiens veulent encore voir les écailles dorsales de la créature légendaire dans la silhouette sibylline de certains pitons. A chacun son monstre du Loch Ness. La mythique tarasque d’Along est ainsi l’occasion de conduire des touristes sur des sampans dans une zone de l’immense baie, réputée propice à l’apparition du dragon.

Poésie et géologie
Des quatre villages de pêcheurs que compte la baie, Van Gia et ses habitations flottantes est le plus ancien. Aujourd’hui encore, y flottent de véritables maisons bâties sur de vastes coques plates, qui font office d’épiceries, notamment. Certains sampaniers, ou pêcheurs de ces villages racontent leurs mésaventures imaginaires, décrivant avec force détails qu’ils furent témoins du jaillissement de la queue du dragon, longue d’une trentaine de mètres, qui retomba si violemment sur l’eau que toutes les embarcations alentour faillirent chavirer. L’aura de poésie dont le site est nimbé semble infinie, en particulier lorsque une jonque glisse en silence, la nuit, ou bien à l’aube, entre ces îlots élancés comme des pains de sucre, et dont certains portent des noms d’animaux : le Chien, la Tortue, le Crapaud, la Guêpe, le Lièvre, la Libellule... D’autres ont des noms plus féériques, donnés pour la plupart par les Annamites et, à leur suite, par les officiers de Marine et les cartographes français : l’Île brûlée, le Salacco, les Pleurs, les Deux-Frères, le Colosse, le Sabot, la Vis, le Nègre… D’ailleurs, le nom même d’Along (ou Ha Long) serait dû aux Français, et il serait apparu sur les cartes maritimes au XIXe siècle, en remplacement de celui de (mer de) An Bang. Notons aussi que « Halong » désigne l’une des trois civilisations préhistoriques vietnamiennes (du post-paléolithique au post-néolithique), avec Hoa Binh et Bac Son.
Les géologues, bien moins poètes que les pêcheurs ou que les officiers de la Royale, se limitent à expliquer l’apparition de ces reliefs karstiques par l’érosion de fonds marins calcaires, vers la fin de l’ère primaire, soit il y a 500 millions d’années – une paille ! La haute mer englobait alors la baie, qui sédimenta considérablement. Puis, les mouvements intempestifs de la croûte terrestre associés au retrait consécutif de la mer, ont fait émerger ce « champ » karstique (le plus grand du monde), et l’ont exposé au grand air, donc à l’érosion, aux caprices du temps, aux effondrements et autres fractures des sols sous-marins.
Une autre légende prétend que l’empereur de Jade aurait demandé à la Princesse du
Des grottes et des calamars
Le fondateur de la dynastie Dinh, Ngo Quyen, crut mettre un frein définitif aux 
Puis, Along devient un repaire de pirates fort difficile à combattre, eu égard au labyrinthe flottant constitué par ces pitons garnis de grottes et de criques secrètes. La baie retrouve un peu de paix lorsque la Royal Navy montre ses muscles, dans les années 1810, et en chasse les pirates. En 1883, l’arrivée des premiers corps expéditionnaires français chargés de pacifier le Nord de l’Indochine, apaisent pour un temps ce paysage qui semble avoir été créé pour figurer la sérénité, et cette étendue d’eau comme une « soie verte », dit encore l’écrivain amoureux du Vietnam Olivier Frébourg ; de cette soie dont on fabrique le ao dai, la robe traditionnelle qui procède de l’élégance des femmes vietnamiennes.
Entre autres curiosités au sein de l’immense baie que l’on traverse sur l’un des nombreux bateaux consacrés aux mini-croisières, la grotte des Surprises (Sung Sot) est la plus impressionnante de toutes. Deux immenses « salles » figurent un théâtre pour la première, avec ses innombrables concrétions : stalactites et stalagmites géantes ; et un immense jardin intérieur pour la seconde, pourvu d’un lacis de roches de toute taille et de petits plans gorgés d’une eau vert émeraude, et autres vasques naturelles. La grotte, ou caverne du Palais céleste (Thien Cung) n’est pas en reste. Une légende raconte qu’un mariage y fut célébré, entre une jeune femme, May (nuage) et le prince Dragon. Sept jours et sept nuits durant, de petits dragons dansaient parmi les stalactites, des éléphants gambadaient et deux lions jouaient à se poursuivre. May eut ensuite cent enfants, pas un de moins, qu’elle éleva dans cette grotte même. La légende s’appuierait sur des scènes qui auraient été fossilisées dans la roche, mais dont on ne trouve évidemment pas trace, les grottes d’Along n’étant pas ornées.
 Aujourd’hui, si un tourisme de masse conduit chaque jour des centaines de voyageurs venus du monde entier (de plus en plus de la Chine voisine), depuis le port d’embarquement de Bai Chay, qui n’a rien de bucolique mais plutôt des allures mécaniques et industrielles, si les phoques et les dauphins se raréfient dans cette partie du golfe du Tonkin – comme partout ailleurs -, si les bateaux de croisières déguisés en jonques de bois plaqué et aux voiles factices, sont parfois à touche-touche sur la « soie verte » de ce somptueux paysage, il nous est encore permis, la nuit, lorsque la jonque est au mouillage, de pêcher avec les membres de l’équipage des calamars « à la turlutte » (à l’aide d’une ligne hérissée d’hameçons que l’on agite de bas en haut), car ils sont encore nombreux dans l’eau trouble d’Along, et délicieux, correctement saisis a la plancha. C’est l’une des joies simples et secrètes que procure la huitième merveille du monde. Léon Mazzella
Aujourd’hui, si un tourisme de masse conduit chaque jour des centaines de voyageurs venus du monde entier (de plus en plus de la Chine voisine), depuis le port d’embarquement de Bai Chay, qui n’a rien de bucolique mais plutôt des allures mécaniques et industrielles, si les phoques et les dauphins se raréfient dans cette partie du golfe du Tonkin – comme partout ailleurs -, si les bateaux de croisières déguisés en jonques de bois plaqué et aux voiles factices, sont parfois à touche-touche sur la « soie verte » de ce somptueux paysage, il nous est encore permis, la nuit, lorsque la jonque est au mouillage, de pêcher avec les membres de l’équipage des calamars « à la turlutte » (à l’aide d’une ligne hérissée d’hameçons que l’on agite de bas en haut), car ils sont encore nombreux dans l’eau trouble d’Along, et délicieux, correctement saisis a la plancha. C’est l’une des joies simples et secrètes que procure la huitième merveille du monde. Léon Mazzella
-----
(*) Vietnam, par Olivier Frébourg, photos de Nicolas Cornet (Chêne, 2004)
LA BAIE D'ALONG TERRESTRE

La baie d’Along terrestre est un havre de 1 400 km2 de zones naturelles protégées, d’une grande richesse faunistique et faunique, et riche de larges plaines irriguées de rizières et bordées de montagnes abruptes. Van Long, entrelacs paisible composé de petits villages où l’on circule encore majoritairement en char à buffles et, bien sûr, en bicyclette, de rivières, de champs plats comme la main, de grottes – notamment la célèbre Ca, couverte de stalactites et dont les eaux grouillent de tilapie (poisson-chat) -, constitue la zone la plus « bio diversifiée » du pays, avec pas moins de 3 500 hectares protégés par des digues.
Si les montagnes avoisinantes recèlent sangliers, ours et, même, quelques panthères, à leur pied, prospère un paradis des zones humides, des orchidées sauvages et des échassiers comme l’aigrette, le héron bihoreau ou le jacana, dans une atmosphère dont le calme suggère l’estampe. Cette partie de la baie d’Along terrestre est talonnée, dans le cœur des vietnamiens épris de nature préservée, par les beautés – certes moins sauvages - de Tam Coc. Cette cuvette entourée de pitons calcaires tombant à pic, et aux formes parfois étranges rappelant des visages, est aussi appelée « la baie d’Along sur rizières ». Une balade en barque à godille vers l’une des fameuses grottes du site (Tam Coc signifie « trois grottes »), propulse le voyageur dans l’atmosphère du film Indochine en trois coups de perche.
leur pied, prospère un paradis des zones humides, des orchidées sauvages et des échassiers comme l’aigrette, le héron bihoreau ou le jacana, dans une atmosphère dont le calme suggère l’estampe. Cette partie de la baie d’Along terrestre est talonnée, dans le cœur des vietnamiens épris de nature préservée, par les beautés – certes moins sauvages - de Tam Coc. Cette cuvette entourée de pitons calcaires tombant à pic, et aux formes parfois étranges rappelant des visages, est aussi appelée « la baie d’Along sur rizières ». Une balade en barque à godille vers l’une des fameuses grottes du site (Tam Coc signifie « trois grottes »), propulse le voyageur dans l’atmosphère du film Indochine en trois coups de perche.
Autre curiosité : en naviguant sur la rivière Ngo Dong, il n’est pas rare de croiser des femmes pêcheurs à bord de leur thuyen individuel, qui manient les rames avec leurs pieds nus, et gardent ainsi les mains libres pour tirer leurs lignes. Confondant. L. M.
LE CHARBON DE LA DISCORDE
La Société française des charbonnages du Tonkin, entreprise très prospère pendant l’époque coloniale, exploitait à outrance les mines de houille de la baie d’Along, en concurrence – comme toujours -, avec les Chinois depuis 1865. De sinistre mémoire, elle s’enrichit aux dépens de milliers de coolies vietnamiens qu’elle traitait comme des esclaves à peine payés et soumis à rude épreuve. Créée, en 1888, sur la concession de Hongay, la SFCT – dont les principaux actionnaires sont alors l’incontournable Banque de l’Indochine et le Crédit industriel et commercial -, commence à exploiter des mines.
Comme la richesse naturelle est à fleur de terre et la main d’œuvre locale abondante et très bon marché, le tonnage de l’exploitation augmente de façon exponentielle : de 2 000 tonnes en 1890, la production passe à 500 000 tonnes à la veille de la Grande Guerre, à 1,7 million de tonnes à la veille de la crise de 1929, pour atteindre près de trois millions de tonnes à la veille du second conflit mondial (dont 2,6 millions annuels pour la seule SFCT). De 40 000 à 85 000 travailleurs vietnamiens et chinois s’épuisent dans les mines, surnommées « l’enfer de Hongay » dans la littérature anticolonialiste des années 1930, laquelle dénonce des conditions d’exploitation (qui ne pourront aller qu’en s’améliorant) d’une pénibilité révoltante. Un coolie touchait 15 sous par jour, lorsque les bénéfices nets de la SFCT frôlaient les 30 millions de francs annuels.
Roland Dorgelès écrit, dans son livre Sur la route mandarine (Albin Michel, 1925) : « Elles sont, je crois, uniques au monde, ces mines de Hongay où l’on extrait le charbon à ciel ouvert. Campha, Haut, Monplanet, grands pans d’amphithéâtres taillés à même les mamelons. Ce sont de gigantesques escaliers noirs qui escaladent le ciel et leurs parois sont si lisses, si droites, qu’on croirait que le charbon fut découpé en tranches, ainsi qu’un monstrueux gâteau. Rien n’est à l’échelle humaine. Tout est trop haut, trop vaste, et les indigènes qui piochent les pentes ne font qu’une poussière humaine, sur ces gradins de jais. »
La houille devient rapidement le deuxième produit d’exportation indochinoise après le riz. Avec les Charbonnages de Dong Trieu, et ceux du Tonkin (SFCT), les Français se taillent une part non négligeable du lion, ou plutôt du dragon, et se dotent de leur propre infrastructure : port, chemin de fer, centrale électrique. Extrêmement rentable, l’extraction de la houille ne sera concurrencée par la culture de l’hévéa, notamment, qu’à partir de la fin des années 1930. La seule SFCT, qui produit bon an, mal an, 1,8 million de tonnes de charbon de 1939 à 1941, voit sa production chuter à moins de 200 000 tonnes en 1945… Neuf ans – de guerre – après, les accords de Genève
Un délai de grâce bien court, qui expire le 8 avril 1955, quand la république du Vietnam nationalise l’ensemble des installations. Aujourd’hui, les « gueules noires » se font rares au Vietnam, car les filons s’épuisent et le marché du charbon s’essouffle. Pourtant, le pays continue d’exploiter la houille, dans une zone discrète de cette vaste baie d’Along si paradisiaque, et dont aucun voyageur ne soupçonne l’existence à proximité des pitons rocheux. L. M.
Photos : © Léon Mazzella

Papier paru dans le hors-série de L'EXPRESS C'était l'Indochine (en kiosque pendant deux mois), sous le titre : Le "bourreau" de Banteay Srei
Jeune aventurier guidé par l'insouciance de l'amour, le génial écrivain mit son talent, en 1923, au service du pillage de ce site exceptionnel de beauté. Une équipée qui finit mal pour lui. Et pour Angkor.
Le vaste site archéologique cambodgien résonne de noms ayant marqué l’histoire. Ainsi de Banteay Srei, « la citadelle des femmes », temple situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est d’Angkor, précisément sur le site de la cité de Shiva, appelé Isvarapura. Sans doute l’un des plus beaux de tous. Un lieu doublement célèbre. D’abord, pour la beauté de ses divers monuments, qui furent taillés dans du grès rose et de la latérite, pour la subtilité de son architecture pré-angkorienne : le temple date du Xe siècle, lorsque les parties du site d’Angkor Vat les plus visitées, aux abords de la ville de Siem Reap, datent, elles, du XIIe siècle. Mais c’est aussi un nom qui fait écho au passage d’André et Clara Malraux (née Goldschmidt), en décembre 1923 (le couple est accompagné de Louis Chevasson, ami d’enfance d’André, et retrouvé à Saigon), lorsque ce temple était encore en ruines – tandis qu’il est aujourd’hui remis sur pied. Pris en flagrant délit de pillage à Phnom Penh, avec quantité de sculptures (notamment des bas-reliefs et des frontons) découpées à la scie –que l’on peut voir aujourd’hui au musée de la capitale cambodgienne, ainsi qu’au musée parisien Guimet -, l’emblématique futur ministre de la Culture de de Gaulle, a en effet la ferme intention de commettre les méfaits qui vont lui être reprochés. Jeune et amoureux fou – il est âgé d’à peine vingt-deux ans, et n’a encore rien publié -, le brillant intellectuel en devenir fomente en effet, dès avant son départ, le pillage de statues et autres ouvrages, dans le but de les vendre à de riches collectionneurs installés aux Etats-Unis – qu’il a pris soin de prévenir avant de quitter la France. Cela afin de pouvoir passer des jours tranquilles auprès de sa bien aimée. Son viatique ? Pèlerin d’Angkor, de Loti, un fort amour de la liberté, et un goût viral pour l’aventure. Investi d’une mission au Cambodge pour le compte du ministère des Colonies, il s’estime à l’abri de tout interdit et au-dessus des lois, s’il en existe dans ces contrées lointaines et placées sous protectorat. Las. C’est sans compter avec l’absence totale de romantisme des autorités cambodgiennes. Il y a un peu de naïveté dans l’esprit du futur auteur de La Condition humaine, certes déjà féru d’art khmer, voire d’inconscience, en agissant ainsi, armé d’une scie égoïne et d’une solide détermination. Bien que bardé de son ordre de mission qui se révèle être un piètre sésame, et malgré une mise en garde de l’administration coloniale sur la protection récente de l’ensemble du site d’art Khmer à ciel ouvert, l’équipée, flanquée de bœufs à la peine, traînant les chars destinés au transport des bas-reliefs et autres sculptures, connaît quelques difficultés pour évoluer dans des forêts denses jusqu’à Banteay Srei, alors perdu et pratiquement abandonné aux éléments qui le rongent. Cet isolement total est une aubaine inespérée pour Malraux et ses compagnons, qui vont casser, marteler et scier plusieurs jours durant. (Notons que le célèbre archéologue Henri Marchal contribua largement à la reconstruction, pierre par pierre, du temple, suite aux déprédations malruciennes).Trahis par un de leurs guides, les autorités assigneront donc le trio à  résidence, plusieurs mois durant, ce dès leur retour à Phnom Penh. Condamné à trois mois de prison ferme, et Chevasson à dix-huit mois, Malraux doit son salut à l’action de Clara. Relâchée, l’amoureuse remue l’intelligentsia parisienne, lorsqu’elle arrive en France. Et c’est en partie grâce à une pétition garnie de prestigieuses signatures (Gide, Breton, Aragon, Gallimard, Mauriac), que les voleurs échappent aux geôles cambodgiennes et n’écopent, en appel, que de peines de prison avec sursis, revues à la baisse de surcroît. Têtu et revanchard, Malraux en tirera, et une certaine aigreur –persuadé d’être le découvreur, et non pas le voleur, du site de Banteay Srei -, et un récit d’aventures plus abracadabrantesque que romanesque, intitulé La Voix royale (Grasset), qui marque son entrée - fracassante et un brin fracassée -, à la fois en littérature (le livre obtient le prix Interallié en 1930), et dans le paysage intellectuel national. Un moment attaqué, jamais inquiété, le grand homme se relèvera bien vite et saura emprunter d’autres voies royales. Léon Mazzella
résidence, plusieurs mois durant, ce dès leur retour à Phnom Penh. Condamné à trois mois de prison ferme, et Chevasson à dix-huit mois, Malraux doit son salut à l’action de Clara. Relâchée, l’amoureuse remue l’intelligentsia parisienne, lorsqu’elle arrive en France. Et c’est en partie grâce à une pétition garnie de prestigieuses signatures (Gide, Breton, Aragon, Gallimard, Mauriac), que les voleurs échappent aux geôles cambodgiennes et n’écopent, en appel, que de peines de prison avec sursis, revues à la baisse de surcroît. Têtu et revanchard, Malraux en tirera, et une certaine aigreur –persuadé d’être le découvreur, et non pas le voleur, du site de Banteay Srei -, et un récit d’aventures plus abracadabrantesque que romanesque, intitulé La Voix royale (Grasset), qui marque son entrée - fracassante et un brin fracassée -, à la fois en littérature (le livre obtient le prix Interallié en 1930), et dans le paysage intellectuel national. Un moment attaqué, jamais inquiété, le grand homme se relèvera bien vite et saura emprunter d’autres voies royales. Léon Mazzella
Version longue* d'un papier paru dans L'EXPRESS cette semaine (hors-série C'était l'Indochine).
---
*Faute de place, il faut parfois couper nos textes à la machette! L'avantage d'un blog est aussi d'en proposer les versions originelles.
 LE PRISME DOUBLE DU CINÉMA
LE PRISME DOUBLE DU CINÉMA
Le cinéma aide parfois à comprendre l’histoire. En dépit de la fiction, et lorsqu’il est servi par un scénario solide, le septième art a valeur de documentaire artistique. Deux films emblématiques disent l’Indochine française dans ses excès opposés.
------------
En 1992, Régis Wargnier offre « Indochine », sur un scénario co-rédigé par les écrivains Erik Orsenna et Louis Gardel (l’auteur de « Fort Saganne ») et par la scénariste Catherine Cohen. L’Indochine des années fastes : 1920-1945 y est dépeinte, décrite, dans ses splendide et cruelle vérités. Portrait d’une famille française emblématique, qui fait fortune avec la culture de l’hévéa –principale industrie coloniale indochinoise, « Indochine » souligne l’opulence du « bon temps des colonies ». Eliane Devries (interprétée par Catherine Deneuve) est une femme d’un âge mûr, née en Indochine, qui n’a jamais vu la France et qui est la riche héritière d’une immense plantation familiale, sans doute la plus importante d’Indochine (1).
Le feu sous l’insouciance
Elle incarne ces années insouciantes, jusqu’à ce qu’un ferment de révolte communiste et nationaliste se fasse jour. Le film n’est cependant pas la peinture idéalisée d’une nouvelle bourgeoisie apaisée, jadis conquérante et brillant à présent d'un humanisme relatif. La dure réalité est là, notamment avec la brutalité sans limites de l’administration coloniale –Jean Yanne incarne un chef de la Sûreté au caractère de mufle. Loin, aussi, des clichés du film anticolonialiste « basiquement » militant, le long métrage de Régis Wargnier se veut consensuel mais échoue à colmater les failles, ainsi qu’à faire entendre raison, tant aux idéologies contraires qu’aux passions schismatiques. Certes, la riche héritière adopte la petite Camille, une princesse annamite devenue orpheline. Certes, l’exotisme est présent, parfois de manière très « chromo », et la vie luxueuse mais laborieuse au sein d’une plantation conduite d’une main de fer (en raison des aléas de la culture de l’hévéa), sonne assez juste. De même, résonne avec précision la montée sourde, lente et certaine d’une révolte qui préfigure le futur Vietnam. Et comme est dépeinte avec tact l’arrivée soudaine d’un bel officier de Marine qui tourne la tête d’Eliane, puis celle de Camille devenue jeune femme. « Indochine » en devient une synthèse, à la fois de cette période riche et désinvolte comme une nouvelle de Paul Morand, ou une affiche colorisée d’Air France, et aussi la chronique des années de braise d’une colonie condamnée à être emportée par le vent de l’Histoire – le tout mêlé à une tourmente amoureuse générale, car l’histoire de l’Indochine française est bien celle d’une violente passion.
C’est là toute la portée romanesque du cinéma lorsqu’il ne se dépare pas de ses vertus ethnographiques. Car il permet, le cas échéant, de comprendre aussi la stratégie d’un parti communiste tout juste créé, d’abord dirigée contre les mandarins, ces fonctionnaires impériaux qui soutiennent les colons français, puis qui s’en prend directement à ces derniers. C’est enfin le portrait d’une jeune princesse annamite, en rupture personnelle –et par là historique, avec sa classe et sa naissance, puis qui se métamorphose en révolutionnaire rouge inflexible, symbolisant de façon éclatante un soulèvement profond mû par d’innombrables « vocations » analogues, et qui dessine le Vietnam en marche de Hô Chi Minh.
La face cachée des colonies
« L’Amant » valut le prix Goncourt en 1984 à Marguerite Duras et que Jean-Jacques Annaud adapta huit ans plus tard, souligne un interdit dans l’Indochine française : celui des relations intimes entre Français et Asiatiques (en l’occurrence, l’amant du roman est un riche Chinois). Au-delà de l’intrigue, mince, d’une jeune française en proie à sa libération sexuelle initiale, et en lutte contre une mère qui lui préfère son frère, le film oppose à « Indochine », de Wargnier, l’image de petits colons français ayant maille à partir avec le quotidien. Le mérite de l’histoire –pour ce qui nous intéresse directement ici-, est de souligner que l’Indochine française n’était pas uniquement peuplée de gros colons en costumes et robes de lin blanches et chapeaux à larges bords, ayant des domestiques à foison et des allures de Gatsby and Co. en villégiature prolongée sur les rives du Mékong. La jeune Marguerite est une fille de colons ruinés, qui passe douloureusement ses semaines en pension à Saigon. Sa mère est une institutrice qui peine à joindre les deux bouts. Duras, en écrivant « L’amant de la Chine du Nord » (Gallimard) en 1991, oppose une réponse non définitive, ou pas assez radicale, à l’adaptation que Jean-Jacques Annaud a faite de son œuvre originelle, « L’amant ». Le désaccord entre les deux artistes est abyssal (2). « L’Amant » (Minuit) n’en demeure pas moins la rare évocation esthétique d’une Indochine certaine des années trente, soit d’un Vietnam socialement endormi encore, bien que fermentant en silence comme le meilleur nuoc-mam (celui de l’île de Phu Quoc), ceci est d’ailleurs écrit avec la grâce, l’émotion, la nuance, la justesse, l’austérité forte de la phrase durassienne retrouvée (quoi qu’en disent les esprits chagrins), et puis la beauté des paysages naturels, ainsi que ceux de la ville, la vie bouillonnante des rues de Saigon (Marguerite Duras naquit en 1914 à Gia Dinh, près de Saigon, soit en pleine Cochinchine coloniale), et surtout de Sadec, dans le delta du Mékong, où sa mère s’établit. Terre inculte, car proie constante des eaux, la concession familiale se révèle être un piège, qui oblige la mère de Marguerite à renoncer, et à aller enseigner.
Le dur désir de Duras
« Un barrage contre le Pacifique » (Gallimard. Le livre manqua de peu le Goncourt en 1950), décrit déjà la terre inculte de cette concession, régulièrement inondée par la Mer de Chine, et nous dit par conséquent l’envers de l’image idéalisée des colonies, dans l’Indochine française des années trente à cinquante. La mère de Marguerite Duras, lasse d’ériger de vains barrages contre le Pacifique à la manière d’un Sisyphe résigné (osons l'oxymore), sombre dans une dépression qui devient palpable, dans l’adaptation de « L’Amant » par Jean-Jacques Annaud. La face cachée d’un colonialisme triomphal, confiant, conquérant, dominateur, richissime et insouciant, trouve avec la voix de Duras son exact contrepoint. La profonde désillusion des petits colons français qui peuplaient aussi, en nombre, l’Indochine du Tonkin à la Cochinchine en passant par l’Annam, le Cambodge et le Laos, fut retranscrite dans deux adaptations du premier roman de Duras. La première, par René Clément en 1958, avec Anthony Perkins (Jo) et Silvana Mangano (Suzanne), dans les rôles principaux, et la seconde –nettement plus fade-, par Rithy Panh, en 2009, avec une Isabelle Huppert comme absente, hors-cadre, ou déjà dans son prochain film, et un Gaspard Ulliel en « gravure de mode » sans épaisseur.
Léon Mazzella
---
(1) L’historien Pierre Brocheux, dans son « Histoire économique du Vietnam, 1850-2007, La palanche et le camion » (Les Indes savantes) souligne que la décolonisation fut lente et absolument pas radicale : « au Sud-Vietnam, les Français (grandes sociétés et planteurs, commerçants et industriels) conservaient des positions clés dans l’économie. Par exemple, en 1963, 74 000 des 86 000 hectares plantés d’hévéas appartenaient toujours aux grandes sociétés françaises, la chambre de commerce française à Saigon recensait 300 entreprises dans les secteurs pharmaceutique, des pneumatiques, alimentaire, etc. »
(2)Umberto Eco, conscient de la liberté du réalisateur lorsqu’il adaptait son succès planétaire, « Le nom de la rose », dit simplement et intelligemment ceci : « il y a mon roman, et il y aura ton film ». Marguerite Duras préfère écrire sa version vraie de l’adaptation à venir, imminente, d’un autre texte, réducteur, à ses yeux, puisqu’il ne donne à voir qu’une affaire sexuelle (initiale) entre une gamine pauvre et un riche Chinois de dix-sept ans son aîné… « L’Amant de la Chine du Nord » est une façon de synopsis que la romancière aurait utilisé pour une adaptation, si elle avait eu à en réaliser une. (Par chance, ce ne fut pas le cas : souvenez-vous des incursions désastreuses de Marguerite dans le 7ème art, comme avec Le Camion - et Depardieu dans le rôle principal, qui ont fait dire à Pierre Desproges : Marguerite Duras n'a pas écrit que des conneries. Elle en a filmé aussi...).
PRISONNIER DES KHMERS
Le dernier film de Régis Wargnier, « Le temps des aveux » (décembre 2014), signe l’adaptation du célèbre roman autobiographique « Le Portail » (La Table ronde, 2000) de l’ethnologue François Bizot. Et raconte par conséquent la captivité de l’auteur, en mission angkorienne, lorsqu’il fut prisonnier des Khmers rouges, en 1971, dans le camp S21, de sinistre mémoire, dirigé par Douch, l’un des plus grands criminels de guerre cambodgiens –tenu responsable de la mort de 40 000 détenus-, avec Pol Pot et quelques autres. François Bizot a par ailleurs publié en 2011 une sorte d’éloge de la magnanimité, avec « Le silence du bourreau » (Flammarion), livre dans lequel il bat en brèche un lieu commun, affirmant que le bourreau –en l’occurrence Douch-, n’est ni un démon ni un monstre, mais bien pire que cela encore, puisque c’est un homme comme les autres. Et qu’il s’agit de tenter de comprendre, voire d’excuser, par-delà le ressentiment… L.M.
C'était l'Indochine paraît demain.
J'ai eu le plaisir de le co-piloter avec Philippe Bidalon, et d'y écrire.
Allez! Tous au kiosque! Et vive la presse écrite...

 Papier paru dans le hors-série de L'Express consacré aux Juifs de France. Actuellement en kiosque. (Pour que) Vive la presse écrite!
Papier paru dans le hors-série de L'Express consacré aux Juifs de France. Actuellement en kiosque. (Pour que) Vive la presse écrite!
Contrairement aux colons européens, les juifs étaient présents sur le sol algérien depuis des siècles. Mais leur statut connut de multiples vicissitudes. Il n’a cependant rien à envier à la déception historique des musulmans. Par Léon Mazzella
Depuis leur arrivée, il y a près de trois mille ans avancent de nombreux historiens, sur ces terres qui deviendront l’Algérie, les fils d’Israël ont partagé un destin pour le moins chaotique. Les premières colonies se mélangèrent sans problème avec les Berbères, auprès desquels elles auraient fait preuve d’un prosélytisme fructueux (une théorie qui ne rencontre toutefois pas l’unanimité chez les historiens). Maltraités sous l’occupation romaine, puis par les Byzantins, qui transformèrent souvent leurs synagogues en églises, les juifs, dont la communauté se renforça au cours des siècles de nouvelles vagues d’émigration dues aux soubresauts de l’histoire, notamment dans la péninsule ibérique – des persécutions des Wisigoths à celles de la Reconsquita – firent également les frais de l’islamisation de l’Afrique du Nord, consécutive à la conquête arabe, au VIIe siècle. Ainsi, hormis une courte accalmie durant l’éphémère royaume vandale d’Afrique (439-533), les descendants des Hébreux ne furent jamais traités sur un pied d’égalité avec les autres habitants d’Algérie. Pendant douze siècles, la dihmma, si elle leur reconnaît la liberté de culte, les soumet à un statut juridique inférieur à celui des musulmans.
Il leur faudra attendre 1830 et le début de la colonisation française pour être libérés de cette entrave et devenir les égaux des « indigènes musulmans ». Pas le Pérou, mais déjà un progrès…
Principalement composée d’artisans et de petits commerçants, la communauté juive, alors implantée à 80 % dans les villes (5 % seulement des musulmans y vivent), se retrouve beaucoup plus au contact de l’administration coloniale. Ils envoient leurs enfants à l’école, renoncent à leurs tribunaux religieux, adoptent la langue de Molière. Autant d’efforts pousse Paris à faire de ces modèles d’assimilation (acculturation s’interroge certains) des citoyens français à part entière. Dès 1865, un décret impérial propose la naturalisation aux juifs, mais aussi aux musulmans qui le désirent, sous certaines conditions (abandon du statut religieux et service militaire). Très peu sont candidats. Les autorités religieuses juives, toutefois, consultées par le gouvernement provisoire de la toute nouvelle IIIe République, se déclare favorable à une naturalisation collective. Le 24 octobre 1870, le fameux Décret Crémieux accorde la nationalité française aux 34 000 juifs d’Algérie. Les étrangers (Espagnols, Italiens, Maltais…) devront, eux attendre 1889 pour en bénéficier. Cette accession, ressentie comme un immense soulagement par les Juifs, est en revanche très mal vécue par les musulmans, qui voient leurs rêves d’assimilation, promise par Napoléon III, s’évanouir, sans grand espoir de retournement. Seuls ceux qui renoncent à la loi coranique et se plient aux règles de l’administration française en Algérie, notamment fiscales, obtinrent leur naturalisation. On en dénombre 10 000 à peine entre 1865 et 1962, qui furent « assimilés » et considérés comme des notables louant une patrie commune. Ces caïds appartenaient pour la plupart aux grandes familles algériennes.
Violente opposition au décret
Chez de nombreux colons, aussi, le décret passe mal. Ils craignent surtout que les musulmans ne finissent par obtenir le même statut, prémisse à leurs yeux d’une décolonisation. Ils vont paradoxalement exploiter l’aigreur des arabes, dont ils font mine de soutenir la revendication. A la fin du XIXe siècle, cette opposition au décret Crémieux s’exprime dans de violentes manifestations « antijuive » et dans les urnes. Des antisémites notoires s’installe à la tête de nombreuses villes, comme Constantine, Oran et Alger, avec Max Régis. De sinistre mémoire, Édouard Drumont est élu député d’Alger, de 1898 à 1902. La Première Guerre mondiale, qui voit les sangs des juifs et des pieds-noirs se mêler dans la défense de la Nation, marque une accalmie du sentiment anti-juif en Algérie. Mais le pire est à venir.
Quotidien, rampant et opérant donc par capillarité, l’antisémitisme resurgit avec force en 1940. Une loi signée par le maréchal Pétain, datée du 7 octobre, abroge le décret Crémieux et renvoie les juifs au statut des indigènes musulmans. Heureusement tenus à l’écart des atrocités de la Shoah, les juifs d’Algérie sont mis au ban de la société et certains, même, internés dans des camps de travail au sud du pays. Malgré l’arrivée des Américains, en 1942, ils sont maintenus dans ce régime discriminatoire par le général Giraud. C’est De Gaulle qui les rétablit dans leurs droits, en 1943.
En juillet 1962, la quasi totalité des 150 000 Juifs d’Algérie quittent cette terre qui était la leur depuis près de trois mille ans pour la France.
UNE VRAIE FRATERNITÉ
D’aucuns ne sont pas loin de penser que certains colons se félicitaient de ne pas faire évoluer la population musulmane et de continuer de la maintenir sous une forme de boisseau juridique, malgré leurs bonnes intentions affichées. Paul Bert (cité par Jeannine Verdès-Leroux), visitant la Kabylie, avait en charge la « protection » des colons et « l’avenir » de l’Algérie, avec Jules Ferry et d’autres, et il glorifia le travail accompli par les colons sur des terres rendues prospères grâce à leur tâche. Ces propos furent ceux des pieds-noirs au plus fort de la guerre, à l’aube des années 1960, lorsqu’ils invoquèrent une légitimité sur un sol qu’ils considéraient comme le leur. Paul Bert invoque subtilement le Coran qui « donne la terre à qui la vivifie », afin d’asseoir la propriété des « biens de main morte, partagés entre les mains vivantes »… Reste que le mot colon, entaché d’une image péjorative, désignera tour à tour le « rebut » de la Méditerranée (Alphonse Daudet), le travailleur patriote mais égoïste (Jules Ferry), le héros laborieux et fraternel lors des cérémonies du Centenaire (1930), et enfin la brute lors des « événements » qui ne désignaient pas encore une véritable guerre. Soulignons enfin que les liens qui se sont tissés, cent trente années durant, entre la communauté pied-noir dans son ensemble, avec ses bigarrures méditerranéennes, et la communauté musulmane, furent profonds et complexes, plus souvent teintés de fraternité que de rivalité, d’entente que d’hostilité. Le « drame algérien » doit –aussi- être mesuré à cette aune fondamentale. L.M.
 Interview publiée le 5 février dernier dans le nouveau hors-série de L'Express (en vente deux mois), consacré aux Juifs de France :
Interview publiée le 5 février dernier dans le nouveau hors-série de L'Express (en vente deux mois), consacré aux Juifs de France :
Alain Finkielkraut : « Dire avec la même ferveur Je suis casher et Je suis Charlie »
Les juifs de France ont connu deux grands rêves qui ont volé en éclats. Le franco-judaïsme et la cause antiraciste. Puis, un nouvel antisémitisme, islamiste, s’est fait jour. Le philosophe Alain Finkielkraut analyse pour L’Express les ressorts d’un politiquement correct qui est un antiracisme ayant perdu la tête, selon l’auteur de « L’Identité malheureuse ».
Propos recueillis par Léon Mazzella
L’histoire des juifs de France commence-t-elle avec la Révolution ?
Non, bien sûr. Mais l’émancipation des juifs de France par la Révolution a engendré le grand rêve du franco-judaïsme. Les juifs ont choisi la voie de l’assimilation avec enthousiasme car elle ne représentait pas pour eux un sacrifice, mais quelque chose comme un accomplissement messianique. Se référant à l’épisode révolutionnaire, le rabbin Kahn de Nîmes disait : « C’est notre sortie d’Egypte … C’est notre Pâque moderne ». Ce franco-judaïsme a volé en éclats dans les années noires de l’Occupation. Après le statut des juifs et la rafle du Vel d’Hiv, les juifs ne pouvaient plus se décharger de leur être sur une autre instance. Certains, au lendemain de la guerre, ont opéré un retour « aux sources, aux livres anciens, oubliés, difficiles, dans une étude dure, laborieuse et sévère », comme écrivait Levinas. Pour la plupart, l’attachement à Israël est devenu constitutif de leur identité. Bien sûr ils demeuraient français car, rappelait aussi Levinas
« la France est un pays auquel on peut s’attacher par le cœur et par l’esprit autant que par les racines », mais il n’appartenait pas à ce pays de réaliser toutes les aspirations juives. L’inquiétude était présente, et avec Israël, naquit l’idée que, en cas de nouveau malheur, il y avait un refuge possible.
« Qu’est-ce qui se passe ? », écrivez-vous dans « L’imparfait du présent ». Que se passe-t-il avec les juifs de France aujourd’hui ?
Depuis le début des années 2000, l’antisémitisme refait surface dans le monde sous sa forme la plus violente, la plus apocalyptique. L’Europe croyait être en état de vigilance maximale, en honorant le devoir de mémoire, et elle a été prise complètement au dépourvu. Elle était prête à combattre ses vieux démons et ne pardonnait aucun dérapage au vieux chef de l’extrême droite française, mais d’autres démons ont surgi qui ne correspondaient pas à ce modèle. L’antisémitisme qui se répand aujourd’hui dans toute l’Europe n’est pas d’origine européenne : il est islamiste, et béni par certaines des plus hautes autorités religieuses de l’islam. Le très influent prédicateur Yûsuf Al-Qaradâwî a félicité Hitler d’avoir puni l’arrogance des juifs, sur la chaîne de télévision Al Jazeera. Cet antisémitisme, non seulement n’exprime pas la haine d’une partie du peuple français pour les juifs, mais il est une des variantes de la haine des islamistes pour l’Occident. Le franco-judaïsme est mort, mais un autre trait d’union apparaît : les juifs et les Français qu’on n’ose plus dire de souche sont dans le même bateau. La francophobie et l’antisémitisme sont les deux faces d’une même haine.
La menace qui pèse sur les juifs de France peut-elle encore provenir de citoyens français?
Tout peut arriver. Mais l’antisémitisme maurrassien est exsangue, moribond. Confrontés à l’émergence et à l’essor du Front national, les juifs de France ont eu l’impression que ça recommençait. Ils ont donc épousé, avec une fervente sincérité, la cause de l’antiracisme. De grandes figures juives ont parrainé l’association SOS Racisme. Manière pour eux d’affirmer la solidarité de toutes les victimes du rejet de l’Autre, de toutes les cibles de Dupont-Lajoie. Après le franco-judaïsme, cette illusion aussi s’effondre. L’idée d’une communauté de destin entre les « Beurs » et les juifs ne peut plus dissimuler la réalité du nouvel antisémitisme. Youssouf Fofana, Mohammed Merah, Mehdi Nemmouche, Amedy Coulibaly sont certes des cas isolés, mais, comme l’a dit Georges Bensoussan, le coordinateur des Territoires perdus de la République, l’antisémitisme, dans les quartiers dits populaires, est devenu un « code culturel ». Et les Juifs ne doivent pas seulement subir ces paroles et parfois ces actes désinhibés, ils doivent faire face à un antiracisme devenu fou et qui les vise parce qu’ils ne se démarquent pas de la politique « criminelle » de l’Etat d’Israël. Ils voient même toute une partie de l’élite politique, médiatique et intellectuelle retourner contre eux le fameux devoir de mémoire et leur coudre sur la poitrine, non plus une étoile jaune, mais une croix gammée. Ça donne envie de changer d’air.
L’alya (la montée vers Israël) connaît un essor considérable (lire page73). Traduit-elle encore une foi, un espoir, malgré les risques encourus sur place, ou seulement une crainte plus grande encore?
Ceux qui font leur alya préfèrent les risques encourus à l’association française de l’insécurité et du déni. Plusieurs livres sont parus récemment pour dire que l’islamophobie avait pris le relais de l’antisémitisme. C’était une manière particulièrement brutale de faire l’impasse sur ce que vivent les juifs français. Mais peut-être qu’avec la marche historique du 11 janvier 2015, la France a enfin décidé de mettre sa montre à l’heure.
Israël a-t-elle renversé la donne –à son corps défendant- en faisant de Tsahal des assassins d’enfants, à cause du cynisme du Hamas (avec l’utilisation des souterrains de Gaza, des roquettes lancées depuis les écoles, et des enfants-martyrs…) ?
Israël devrait engager des négociations immédiates avec l’autorité palestinienne et démanteler, pour preuve de bonne volonté, un certain nombre de colonies de peuplement, car la situation actuelle mène à la dissolution de l’Etat juif dans un Etat binational. Un jour ou l’autre, les juifs risquent de se retrouver minoritaires, mais nul ne peut croire qu’une telle politique aurait un effet calmant sur les musulmans antisémites. Ceux-là veulent la reconquête de Jérusalem et ce sont les mêmes qui ont salué la tuerie de l’Hyper Cacher de la Porte de Vincennes par des manifestations de liesse.
Vous dénoncez depuis longtemps un « antiracisme idéologique », qui serait autrement plus pervers que l’antisémitisme « traditionnel ». Quels sont ses ressorts?
Cet antiracisme s’est acharné toutes ces dernières années contre Charlie Hebdo : « Qu’ils crèvent, disait l’humoriste Guy Bedos des gens de Charlie en 2012, leur histoire de Mahomet, c’était nul. » Le rappeur Nekfeu promettait, dans la bande-annonce du film La Marche, « un autodafé pour ces chiens de Charlie ». Et dans un langage plus policé, des personnalités de tous bords se sont indignées de cet irrespect envers les croyances des exploités. Car, pour le politiquement correct, tout le mal vient de l’Occident sûr de lui-même et dominateur. Il y a même des experts très sérieux, en Amérique comme en France, pour penser que si Israël n’occupait pas la Palestine, il n’y aurait pas eu d’attentats du 11 septembre, ni la moindre trace d’antisémitisme dans le monde. Les antiracistes d’aujourd’hui expliquent sentencieusement aux juifs qu’ils sont coupables de la haine dont ils sont l’objet.
Quelle est la part de responsabilité des juifs de France, lorsqu’ils refusent de partager le jeu républicain, en ne se sentant pas eux-mêmes Français ?
Pour moi, les choses sont simples : les juifs de France ne peuvent pas s’installer dans une situation d’émigration intérieure. La France est leur pays, ils sont les héritiers de son histoire et ils ne souffrent d’aucune discrimination d’Etat. Ils peuvent vouloir quitter une société où l’hostilité le dispute à l’incompréhension mais je ne leur concède pas le droit de se dire, en vivant sur le sol français, étrangers à la France.
La solidarité des juifs de France envers Israël alimente-t-elle le nouveau visage de l’antisémitisme ?
Sans doute, mais ces antisémites-là, ceux qui s’en prennent à des juifs pour venger les Palestiniens, ne sont pas des partisans de la solution de deux Etats. Ils épousent les thèses extrémistes du Hezbollah ou du Hamas –Je rappelle au passage que Gaza n’est plus occupée. Ils souhaitent la disparition d’Israël, ce sont des gens qui applaudissent lorsque les roquettes font des victimes civiles et pour lesquels tout juif est un Israélien, c'est-à-dire une cible.
Le repli communautaire des juifs de France pêche-t-il par excès, en excluant l’Autre ?
Je ne crois pas que les juifs de France soient en train de se « ghettoiser » : il y a de plus en plus de mariages mixtes, ce qui au demeurant inquiète certains membres de la communauté. Si un fossé se creuse, cela vient de la difficulté grandissante pour les juifs de partager leur souci d’Israël avec les autres Français.
La recherche obstinée du « coupable élu » persiste-t-elle ?
Le véritable danger provient de l’union islamo-progressiste. Les islamistes veulent l’anéantissement d’Israël, et les progressistes expliquent depuis longtemps que l’origine de tous les problèmes, le mal originel, c’est Israël, le cancer israélo-palestinien.
L’idée républicaine du « vivre ensemble » est-elle un rêve?
Il n’y a pas de vivre ensemble en France. Si l’on prend l’exemple de Paris, les autochtones n’habitent plus au-delà du boulevard périphérique, ils habitent désormais au-delà de la banlieue. Et quand on parle de quartiers « populaires », c’est pour désigner des endroits où vit une population majoritairement musulmane. Cela veut dire que les peuples se séparent. J’aimerais y croire, mais le métissage est un mensonge. La réalité est celle de la séparation.
Que pensez-vous, en tant qu’auteur du « Juif imaginaire », de cette phrase de Bernard Frank : « Comme tous les juifs français, je suis imaginairement juif et réellement français » ?
C’était vrai pour moi. Mes parents m’ont éduqué dans le souvenir de ce qui leur était arrivé, et dans l’attachement à Israël, mais, eux-mêmes orphelins, ils n’avaient pas le cœur à perpétuer la tradition. J’ai donc été élevé dans l’obsession juive et dans l’ignorance du judaïsme. Je suis allé à l’école laïque, et je suis devenu réellement Français en assimilant ce que je pouvais de la culture française. Il n’en reste pas moins que j’ai découvert la pensée d’Emmanuel Lévinas, que j’ai rencontré et travaillé avec Benny Lévy … Peut-être ne suis-je plus tout à fait un juif imaginaire.
Alain Finkielkraut est professeur à l’Ecole polytechnique. Il anime l’émission « Répliques » sur France-Culture. Il a été élu à l’Académie française en avril 2014. Philosophe, il est l’auteur de nombreux essais, dont « Une voix vient de l’autre rive », « La défaite de la pensée », « Au nom de l’Autre. Réflexions sur l’antisémitisme qui vient » (Gallimard/folio), et plus récemment, de « L’identité malheureuse » (Stock).
C'est le nouveau hors-série de L'Express auquel j'ai collaboré (en kiosque aujourd'hui).


Passage au Père Lachaise, hier matin (pour de tristes circonstances, oeuf corse). En musardant devant le "colombarium", je souris en lisant le nom de Camille Malcuit sur une cassette (est-ce ainsi que l'on désigne le micro caveau dans lequel on place une ou plusieurs urnes contenant des cendres?), puis sur le nom d'Achille Zavatta, et à côté, je tombe sur la cassette d'Edmond Jabès (et de sa femme). Totale surprise. Je me souviens tout à coup de ma rencontre avec le grand écrivain, il y a trente ans déjà, et de l'entretien que j'avais alors réalisé pour Sud-Ouest Dimanche. Mais le plus étrange est de tomber sur quelque chose, quelqu'un, lorsque rien ne nous y prépare. Il faisait un temps idéal (pur, bleu et froid), et je me rendais pour la première fois dans ce cimetière rempli de people littéraire. (J'avoue ne pas être très cimetière -à part celui de Venise, sur l'île de Burano, je ne souhaite en (re)visiter aucun), considérant qu'un jour, je devrai effectuer une visite prolongée à celui de Bayonne (à moins qu'une âme bien inspirée songe plutôt à disperser mes cendres devant la Corricella, à Procida, depuis une barque bleue). Jabès, donc. Et Vialatte, que j'allais oublier! "Nous ne sommes que poussière. C'est dire l'importance du plumeau"...
Il y en a beaucoup. En voici deux que j'aime particulièrement.
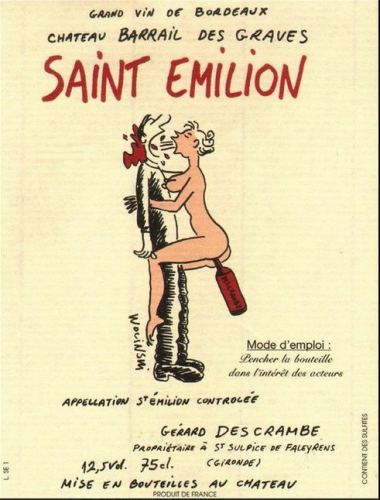
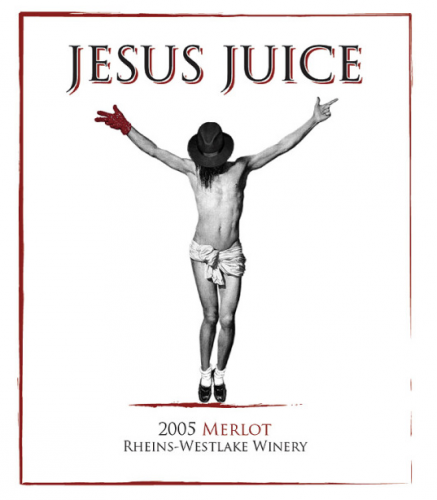

A propos du pardon selon Jacques Derrida, auteur de "Pardonner. L'impardonnable et l'imprescriptible" (Galilée) :
"Le véritable pardon ne peut être décidé par aucune institution, mais seulement par la victime, dans la singularité d'un face-à-face.
En se posant comme un dernier mot, le pardon ressemble à un verdict. Mais il ne juge pas, ne solde pas les comptes. Ce n'est pas le pardon qui peut rendre un coupable innocent, ni mettre fin à ses remords."
Leur façon de -ne pas- penser, leur manière d'agir ne s'exportent pas; surtout par la force. Une fracture culturelle certaine pourrait devenir historique.
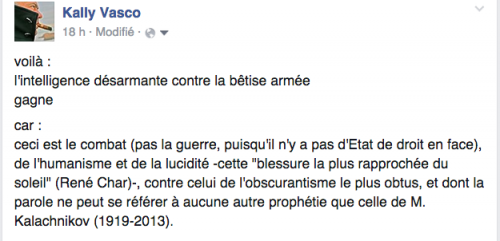 Noté ceci sur ma page facebook, hier.
Noté ceci sur ma page facebook, hier.
... c'est sur ma page facebook : https://www.facebook.com/leonmazzelladibosco
que je choisis de m'activer ces prochains jours.

Magistral.
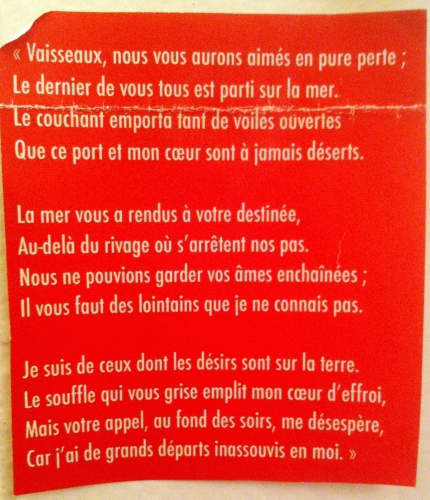

Papier qui paraît dans le dernier numéro de Pyrénées magazine :
Txotx
MOJON !
Par Léon Mazzella. Photos : Serge Bonnet
Le cidre basque n'a rien à envier à son rand cousin normand. Mieux : d'aucuns prétendent que ce dernier lui doit quelque chose… Reportage à Txopinondo, cidrerie basque du nord, avec Dominic, encyclopédiste du sagarno, lors du Txotx, la fête annuelle du cidre nouveau.
-----
Il a beau être né en 1955 à Falaise (Calvados), Dominic Lagadec est le plus Basque des Normands, malgré un nom breton. Autant dire qu’il a toujours vécu “dans les pommes”. L’apuru (patron) de la cidrerie Txopinondo ( "rassemblés autour d’un verre"), qu’il a créée à Ascain en 1998, est une encyclopédie du sagarno, le vin de pomme (Sagar : la pomme et no : qui vient de).
La définition juridique du cidre est “boisson fermentée à base de pommes”, et il est assimilé aux “vins tranquilles” blancs, rouges et rosés au regard des Douanes. Une cidrerie – le Pays basque en compte une centaine, surtout en Gipuzkoa, et en particulier autour d’Astigarraga et de Hernani –, désigne le lieu où l’on transforme les fruits cidricoles à pépins (pomme, poire, nèfle, coing…), à l’exception du raisin. Elles sont devenues au fil du temps des lieux de restauration. Certaines, comme Txopinondo, reçoivent le jus des pommes qui ont été pressées en Espagne, puis celui-ci est mis en barriques et il fermente à Ascain, jusqu’à la fête du Txotx, soit du cidre nouveau, qui a lieu autour de fin janvier - début février. Le terme, arrangé phonétiquement, dérive du basque zotz (petite branche d’arbre), et désigne le bout de bois qui obture l’orifice de la kupela (barrique de 5 000 à 15 000 litres – certaines peuvent contenir jusqu’à 30 000 litres !), par lequel jaillit un jet de cidre que l’on recueille dans son verre, à la queue leu leu et en file indienne, lorsqu’il est ôté d’un coup sec et à intervalles réguliers, au cri rassembleur de “mojon !” (ça mouille !), lors des longues soirées extrêmement conviviales et festives dans les cidreries, de l’hiver au printemps. Le succès rencontré par le rite du txotx et les cidreries en général va croissant et a vu passer la production du sagarno produit dans l’ensemble du Pays basque (nord et sud), de un million de litres en 1970 à douze millions aujourd’hui*. Cependant, 15 % seulement du cidre est consommé dans les cidreries et 85 % est mis en bouteilles. Le sagarno est largement distribué et même exporté : c’est le “French farm taste” très prisé des Américains, précise Lagadec, tout en mettant la dernière main au préparatifs de sa grande soirée : dans quelques heures, c'est l'ouverture de la fête annuelle du Txotx, à Txopinondo. 150 convives sont attendues, des personnalités comme José Mari Albero, qui dirige Sagardo Etxea à Aztigarraga, le maire-adjoint d'Ascain, Jean-Pierre Ibarboure… Les txuletas sont prêtes à être grillées, et la musique est assurée cette année par l'ensemble bayonnais Kriolinak. Le nombre de buveurs de cidre augmente donc vite, reprend notre encyclopédiste, et dépasse de beaucoup celui des pommiers!
Une histoire en dents de scie
L’histoire du cidre basque a pourtant connu des vicissitudes et fait parfois du yoyo. La présence de pommiers en terre basque est attestée dans un document daté du 17 avril 1014, signé du roi de Navarre Sanche le Majeur. Les cidreries sont nombreuses au Moyen-Âge, sur la Côte, autour de Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz, et l’apogée de la culture de la pomme basque se situe au XVIIe siècle. Un pèlerin de Compostelle écrivit alors de façon imagée que l’on pouvait aller “de Bayonne à Bilbao sans descendre d’un pommier”, raconte Dominic Lagadec, tout en vérifiant ses kupelas : "C'est mon 16è Txotx ici". Nous goûtons le cidre 2013, qu'il voit évoluer depuis mai : "moins alcoolisé que l'an passé, son goût est plus franc, plus sec", commente-t-il, "sa belle robe jaune paille et jus de citron est superbe. En bouche, le pamplemousse et la mandarine explosent doucement" . "Il fut même un temps où les marins pêcheurs basques et normands échangeaient leurs greffons de pommiers en pleine mer", poursuit Dominic. Réputé pour combattre le scorbut, le cidre était également embarqué pour l’usage de l’équipage. D’aucuns prétendent même que les marins basques auraient très tôt exporté leurs meilleurs pommiers vers la Normandie, où la culture du cidre se généralisa au XIVe siècle, puis s’étendit à la Picardie, à la Bretagne et à l’Angleterre.
Il y a un siècle encore, la Normandie achetait des pommes en Gipuzkoa, car le savoir-faire de la transformation (distillerie, mise en bouteilles) était encore inexistant en terre basque. Une variété de pomme du Pays d’Auge se nomme d’ailleurs Bisquette (de Biscaye) et une pomme basque s’appelle Normanda. L’apogée du cidre, quant à elle, date de la fin du XIXe siècle, lorsque le transport des pommes se faisait par bateau de Honfleur à Bayonne, puis par bœufs depuis Hendaye. La culture de la pomme périclite avec la fin de la pêche hauturière et l’arrivée du maïs. La consommation du cidre passe derrière celle du vin, les goûts et le commerce évoluant. La fin de la seconde Guerre mondiale met un coup d’arrêt à la culture du cidre basque, jusqu’à la fin des années soixante, où un regain d’intérêt s’amorce, qui ne fera que croître, avec la forte demande, notamment, des sociétés gastronomiques de Donostia, et la mise en bouteille du sagarno qui se généralise. La consommation du cidre s’accélère après la mort de Franco en 1975, qui voit aussi l’essor du Txakoli. Le modèle de la bouteille de cidre basque, baptisée Sagardo est déposé en 1982. Aujourd’hui, c’est un million de repas “txotx” typiques - avec omelette à la morue, txuleta (côte de bœuf), fromage de brebis, membrillo (pâte de coing), noix et cidre à volonté (pour 30 à 35€) qui sont servis chaque année. Le sagarno, qui titre 6°, est consommé dans l’année et il ignore le sulfitage, ce qui en fait un produit plutôt naturel, que l’on peut boire (avec modération) jusqu’au bout de la nuit. Ce premier février, l'ambiance conviviale augmente avec le temps, la chaleur, les chants, le cidre, les agapes et les rires se font plus clairs, plus forts et communicatifs. Les convives, venus en famille, entre potes ou en groupes, lèvent les verres et trinquent. Dominic passe entre les longues tablées, puis repart vers une kupela en lançant un long "Mojoooon!".. L.M.
---
(*) En règle générale, les variétés Basques de pommes entrent dans la composition du sagarno à 30 % minimum (et jusqu’à 50%), puis ce sont des variétés Normandes, et enfin Espagnoles, en provenance des Asturies et de Galice, qui servent à son élaboration.
-------
Relancer la culture de la pomme
La municipalité d’Ascain exprime sa volonté de relancer la culture de la pomme en replantant des pommiers. Le village offre déjà un pommier à la naissance de chaque Azkindar. Et l’élection d'une ambassadrice de charme, la Reine de la Pomme se tient le 15 août depuis 8 ans.
Cidreries du nord et du sud
À l’exception de Txopinondo à Ascain, et de quelques restaurants cidreries où l’ambiance est reconstituée, comme Ttipia à Bayonne, le Fronton à Arbonne et la Cidrerie à Biriatou, l’écrasante majorité des cidreries se situent en Guipuzkoa, notamment autour des villages d’Hernani, comme la cidrerie Zetala, et d’Astigarraga : cidreries Rezola, Bereziartua, Petritegi, Alorrenea, Zaplain ou, proche de San Sebastian, Burkaiztegi. Fini le temps des cidreries rustiques au rez-de-chaussée en terre battue des fermes aux murs tapissés de kupelas, et où l’on mangeait le repas Txotx à la bonne franquette. Les cidreries modernes sont d’immenses salles de réception un rien froides, de prime abord, mais elles ne le restent jamais longtemps…
Fêtes du cidre
Txotx, début février, marque l’arrivée du cidre nouveau et l’ouverture des cidreries de tout le Pays basque.
Autour du 21 mars, Kukuaren Kupela (la barrique du coucou), est une fête printanière qui rappelle une rite ancestral : lorsque le coucou chantait (il fallait alors avoir une pièce de monnaie dans la poche !) ceux qui n’avaient pas encore consommé tout le cidre durant l’hiver, le montraient au village. C’était un signe extérieur de richesse.
À la mi-juin, le cidre est également fêté et donne lieu à un festival de chants de marins (en langues Basque, Gasconne, Bretonne et Française), qui se tient en souvenir des marins qui partaient en Terre-Neuve et au Labrador : le sagarno embarqué servait de monnaie d’échange avec les Indiens des rives du Saint-Laurent (il était troqué contre de la graisse de baleine, qui servait à s’éclairer).
de marins (en langues Basque, Gasconne, Bretonne et Française), qui se tient en souvenir des marins qui partaient en Terre-Neuve et au Labrador : le sagarno embarqué servait de monnaie d’échange avec les Indiens des rives du Saint-Laurent (il était troqué contre de la graisse de baleine, qui servait à s’éclairer).
À la mi-septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine, le Ban du Pressage donne
lieu, à Ascain, et à l’aide des pommes des vergers du conservatoire municipal, à des démonstrations de pressage à l’ancienne (à l’attention des écoliers) dans les vieux pressoirs comme celui de Txopinondo qui date de 1875.
Pour Urtezahar (la veille de la St-Sylvestre), un réveillon sans cotillons (avec viandes nobles et boisson à volonté, 55 €) se tient à Txopinondo, afin d’enterrer “la vieille année”. L.M.
La plage de La Chambre d'Amour, à Anglet (64).
(Retrouver un lieu de notre jeunesse apaise, efface les tourments de l'existence d'un seul regard).

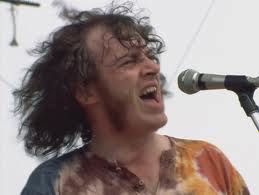 No comment : la vérité à l'état pur, l'altérité intérieure exprimée comme jamais, l'expression crue. Ciao J.C. :
No comment : la vérité à l'état pur, l'altérité intérieure exprimée comme jamais, l'expression crue. Ciao J.C. :

Papier paru simultanément dans un numéro Spécial Café de L'Express et de L'Expansion :
ALLIANCES
Par Léon Mazzella
Ecartons d’emblée les préparations qui contiennent du café - pâtisseries, glaces, sorbets, mousses et autres plats salés inventés par des chefs cuisiniers-, pour nous concentrer sur l’affaire très sérieuse des alliances du café et des mets, alcools et autres menus plaisirs.
------
La première des alliances, celle qui nous est proposée d’office dans la plupart des bars d’Europe, est celle du café avec un carré de chocolat noir, généralement fortement dosé en cacao (65, 75%), glissé entre la tasse et la sous-tasse, à côté d’un morceau de sucre. Notons en passant que le sucre est généralement l’ennemi de l’amateur de café, qui n’en ajoute jamais dans sa boisson fétiche. Mais les goûts et les couleurs du café composent une large palette et l’esprit d’ouverture minimal consiste d’abord à ne pas mépriser les amateurs de chocolat au lait, voire de barres chocolatées et caramélisées, enrichies de fruits secs, comme ont tendance à le faire les ayatollahs du cacao absolu et à l’amertume extrême.
Sfogliatella
L’Italien, de nature gourmande, a coutume de mordre un ou plusieurs morceaux de chocolat gianduja (au praliné d’une onctuosité magnifique), avec son espresso. Le Napolitain l’est davantage, qui déguste régulièrement une sfogliatella avec son « caffè » matinal. La sfogliatella est une pâtisserie aussi typique de la Campanie que peut l’être la mozzarella di buffala. Elle possède la forme d’un amphithéâtre grec, comme à Delphes ou à Epidaure. Nous pouvons deviner dans sa forme une conque sibylline davantage qu’une corne d’abondance. Ainsi que la promesse d’un ruissellement de plaisirs n’ayant rien de financiers. Sa forme figure encore un panier d’osier de vendangeur. La sfogliatella est composée d’une dentelle en pâte brisée, d’une sorte de ruban infini, une écharpe soigneusement enroulée sur elle-même, laquelle renferme une crème pâtissière à base de ricotta, où l’on trouve des écorces d’agrumes et de la pulpe de courge, de la vanille, un soupçon de cannelle, et très peu de sucre. Avec un stretto brûlant –une larme d’esprit de café, la sfogliatella se transforme en chef d’œuvre matinal. Car ce drôle de coquillage qui exige d’être dégusté chaud, ne supporte guère le temps qui passe à pas de géant et partage avec l’éphémère, moustique inoffensif, le funeste privilège de flétrir en quelques heures.
Plus universelle est l’alliance avec un macaron tout simple, sans parfum fruité additionné, comme celui que produit la maison Adam à St-Jean-de-Luz, ou bien un Muxu (macaron à la noisette) de la maison Pariès, luzienne elle aussi. Car le café, bien fait, assez serré, affectionne les saveurs régressives de la pâte d’amande et du pralin, ainsi que le couple sensitif mou-croquant de ces miracles de douceur devenus des best-sellers absolus que sont les macarons. Dans le même ordre de goûts, une madeleine, ou bien un financier escortent agréablement un café, voire un café au lait.
« Lait cafeté »
À ce propos, comme il existe des ayatollahs du chocolat pur et amer, il y a ceux qui vouent le café au lait aux gémonies. Une femme de lettres du XVIIe siècle, gourmande en diable, et qui a donné son nom à un célèbre chocolatier, s’inscrit en faux et nous donne des leçons d’ouverture d’esprit : la marquise de Sévigné adore le café au lait, qu’elle appelle délicieusement le « lait cafeté », ou bien le « café laité » et elle revendique son addiction. Dès le XVIIIe siècle, on attribue de nombreuses vertus au café au lait et l’augmentation de la consommation de lait suit naturellement celle de café, surtout au cours du siècle suivant. Aujourd’hui, ses vertus digestives sont contestées. Il demeure une boisson qui se marie agréablement avec un biscuit (bordelais) canelé, à cause du beurré et de la touche vanillée de cette gourmandise de fin de repas qui craque si bien sous la dent (avant d'entrer dans le mou, l'onctueux), lorsque sa cuisson, parfaite, ressemble à celle d'un foie frais poêlé a gusto. Osons même, avec le « lait cafeté », un Nuts ou un Mars ! Leurs saveurs mêlées ont un écho de goûter de l’enfance, qui nous éloigne de la rigueur gustative, par trop sérieuse, d’une truffe au chocolat avec un moka serré. Cela repose un instant les papilles de la nation.
Le café se marie fort bien avec un sorbet rhum-raisins, avec une glace forte en fruits rouges (cassis, framboise), voire avec un tiramisu riche ne mascarpone (ce, en dépit de ce que nous énoncions au sujet des pâtisseries au goût de café : le tiramisu figure l’exception), et le contraste chaud-froid est en général du meilleur effet sous la langue.
Le fameux « café gourmand » proposé dans nombre de restaurants français, est en général composé d’un assortiment propice à tester les alliances avec le café : canelé, sorbet, financier, macaron, mini tartelette, le composent fréquemment. Autant de mignardises allant comme un gant à notre expresso de bonne extraction.
Nous évoquons (lire p.20) l’adjonction d’une larme d’alcool dans la tasse de café : anisette, calvados, grappa. Mais s’agissant d’alliances pures, il convient plutôt d’achever de boire son café, puis de servir dans la tasse vide et chaude (ou bien à part, dans un verre), quelques centilitres – au choix - de rhum agricole ambré, d’armagnac, de cognac, de calvados ou encore d’un whisky correctement tourbé (Islay). La chimie fait le reste, le choc thermique sublime les arômes mêlés et d’étonnantes flaveurs jaillissent de la petite tasse comme de la Lampe merveilleuse d’Aladin. Cela peut par conséquent se révéler génial. Car en matière d’alliances, il convient de préférer marcher sans filet au-dessus de l’inconnu. L’empirisme conduit à des bonheurs insoupçonnés et, le cas échéant, le caractère rapidement évolutif des arômes et des saveurs développées par de telles fiançailles d’un instant que l’on aimerait prolonger, enfantent des feux qui ne sont jamais d’artifice. Pour finir, les amateurs savent qu’un café connaît un autre allié de respect comme on le dit d’un toro de combat noble : le cigare. Bien davantage qu’une cigarette, au champ organoleptique étroit comme une feuille de papier gommé, un cigare, de La Havane ou non, est un allié substantiel de l’espresso. Un module doux issu des Honduras ou de Saint-Domingue escorte à merveille et en toute simplicité un ou plusieurs cafés suaves aux notes grillées, fruitées, florales. Un habano boisé, épicé, au fumage par tiers allant crescendo, avec les cafés intenses et savamment épicés, un Grand Cru pure origine par exemple, aux saveurs fortes et assises, forment un couple propre à chasser les tourments du quotidien d’un revers de la main. Le café en devient, selon le mot de Talleyrand, « noir comme le diable, chaud comme l’enfer, pur comme un ange et doux comme l’amour. » Ainsi soit-il toujours. L.M.

Master class whiskies
CRÉER SON PROPRE BLEND
Par Léon Mazzella
Quel amateur de whisky n’a pas rêvé d’élaborer son propre « blend », un whisky d’assemblage, qui lui ressemble ? Les master class organisées par Glen Turner sont l’occasion de se livrer à cet exercice particulier.
----
Ils représentent l’écrasante majorité des whiskies consommés dans le monde. 92% des whiskies écossais sont des Blends. Ils sont issus à 40% whiskies de malt, ou Pure malt (élaborés exclusivement à partir d’orge maltée, soit germée une fois humidifiée, puis séchée) et à 60% de whiskies de grain (maïs ou blé dans des proportions variables). S’ils n’ont ni la profondeur ni la complexité des Single malt (Pure malt provenant d’une seule distillerie), les « Blended » présentent l’avantage d’être chacun le fruit d’un mélange de cinq à cinquante malts issus de plusieurs distilleries, réalisé par le « Blender », ou maître de chai, dont le savoir-faire, avec l’alambic à distillation en continu, confine à l’alchimie. Notons que c’est à la faveur de l’épidémie de phylloxéra qui détruisit le vignoble européen à la fin du XIXe siècle, dont celui de la région de Cognac, que les Blends connurent un essor considérable – qui perdure.
La première étape de la master class animée par Charles MacLean, « maître du malt » (lire notre édition du 15 octobre), consiste, pour la vingtaine de participants (dont quatre femmes, le 5 décembre dernier), tous amateurs concernés, à déguster six whiskies représentatifs de la palette écossaise, aux saveurs tantôt florales, épicées, fruitées, caramélisées, boisées (single malt, blends), tantôt fumées, salines, marines (Islay), et dont la coloration varie en fonction de l’élevage. En effet, au-delà de la pureté des matières premières, et de la bonne conduite de la distillation, MacLean souligne l’importance du vieillissement en fûts de chêne, américains ou européens (espagnols notamment), dans l’élaboration du whisky, et son principe de métamorphose : « c’est comme si l’eau-de-vie était une chenille qui entrait dans un fût et qu’elle en sortait transformée en papillon : le whisky », dit-il.
A tâtons
Les participants sont par ailleurs invités à réfléchir aux alliances gustatives avec une dizaine de snacks spécialement élaborés pour révéler les flaveurs spécifiques de chaque scotch. Qu’il s’agisse d’un sablé au parmesan et légumes confits, d’un saumon à la plancha, gingembre et citron vert, ou bien de pomme verte, de magret fumé, de tartare d’algues, de cheddar, de kumquat, d’œuf mimosa, ou encore des gambas au fenouil, l’aptitude des whiskies à soutenir des préparations audacieuses est confondante.
Chacun est enfin avide d’en découdre avec l’étape expérimentale : être soi-même le « blender » de son propre whisky en réalisant le mélange qui convient à sa personnalité, ce à partir de cinq échantillons issus de plusieurs distilleries : quatre malts en provenance du Speyside, de l’île d’Islay, des Highlands et des Lowlands, et enfin un whisky de grain. Laisser libre cours à des dosages personnels oblige au tâtonnement, puis à forcer ou à minimiser selon son goût, le côté granuleux des Lowlands, la touche caramélisée des Highlands, le fumé et la pointe médicinale du Islay, la complexité céréalière du whisky de grain. Sans oublier d’ajouter de temps en temps un peu d’eau dans son verre au cours de l’élaboration expérimentale. Incomparable révélateur des saveurs du whisky, elle est l’alliée la plus sûre du dégustateur, blender or not.
Et l'immense (et regretté) Bernard Frank nous rappelle - à propos de Mauriac, qu'il assassine- un temps "que les moins de vingt ans"... Ce temps où l'écriture d'un papier, d'une critique, d'un portrait à charge ou non, exigeaient une connaissance, une finesse d'analyse, un talent en somme, que seuls les plumes de sa trempe possédaient et distillaient à l'envi, pour le plus grand bonheur d'un régiment de hussards aficionados => cliquez donc ci-après, afin de savourer correctement : http://bit.ly/1u9LvF1
 Grand texte que celui de Modiano, prononcé lors de la réception de son prix Nobel, le 7 décembre dernier à Stockholm : lisez, relisez et faites passer, car c'est empreint d'une grande et précieuse sensibilité.
Grand texte que celui de Modiano, prononcé lors de la réception de son prix Nobel, le 7 décembre dernier à Stockholm : lisez, relisez et faites passer, car c'est empreint d'une grande et précieuse sensibilité.
 Je sais, le papier est long, mais il arrive que l'on me demande d'écrire de longs papiers... Celui-ci paraît dans le hors-série volumineux de L'Express (il s'agit d'un mook de 212 pages), en kiosque jusqu'à fin février. Il évoque une fascination ambiguë, ou l'attirance-répulsion d'un personnage hors du commun, exercée à son corps plus ou moins défendant, sur les écrivains du XIXè siècle avant tout :
Je sais, le papier est long, mais il arrive que l'on me demande d'écrire de longs papiers... Celui-ci paraît dans le hors-série volumineux de L'Express (il s'agit d'un mook de 212 pages), en kiosque jusqu'à fin février. Il évoque une fascination ambiguë, ou l'attirance-répulsion d'un personnage hors du commun, exercée à son corps plus ou moins défendant, sur les écrivains du XIXè siècle avant tout :
UN GENRE LITTÉRAIRE EN SOI
Napoléon est sans doute le personnage historique qui exerce sur l’esprit des écrivains le plus de haine et d’admiration mêlées. Personnage infiniment romanesque et à l’ambiguïté propice, sa complexité est tellement hors-norme qu’il en devient unique, et fait de « l’Aigle », notamment au XIXe siècle, davantage qu’un homme, voire qu’un démiurge, un sujet qui crispe sur lui toutes les passions.
Par Léon MAZZELLA
-------
« Il neigeait.
On était vaincu par sa conquête.
Pour la première fois l’aigle baissait la tête. »
Les premiers mots de « L’expiation », fameux poème de Victor Hugo extrait des « Châtiments », que l’on apprend sur les bancs d’école depuis des lustres, résument à eux seuls ce que l’auteur de « La Légende des siècles » doit à l’empereur : son lyrisme sans doute, la noblesse de son style, et son emphase peut-être. Le poème évoque la retraite de Russie, l’âpre hiver qui anéantit les grognards, et traduit l’admiration et la compassion pour un conquérant vaincu. L’historien Jean Tulard qualifie Napoléon de « mythe littéraire par excellence », dans la revue « Hors les murs », publiée par l’Ecole nationale d’administration (ENA). Le spécialiste de l’empereur rappelle que le Romantisme, totalement séduit par la démesure du personnage napoléonien, tire une leçon essentielle, qui sera sa marque de fabrique, celle de l’affirmation de l’individu. Chateaubriand en est la plus belle illustration : l’homme comme son œuvre majeure, les « Mémoires d’Outre-tombe », sont imprégnés de cette image de l’individu « au-dessus de la mêlée » (pour reprendre l’expression que Romain Rolland utilisa au moment de la Grande Guerre, pour titrer son célèbre manifeste pacifiste). Le romantique est une sorte de double impérial, un personnage énigmatique, ténébreux, dont le mystère croît avec le silence, la réflexion supposée, la solitude, voire la réclusion volontaire, la nécessaire retraite… La théâtralité du personnage napoléonien déteint sur celle de l’écrivain. Jean Tulard observe que les romantiques ont été pris de vertige devant la rapidité de la chute de leur modèle. Le grand homme n’a cessé depuis d’inspirer les écrivains du monde entier. Certains philosophes, et non des moindres, sont fascinés : pour Nietzsche, Napoléon est « le surhomme » par définition, l’incarnation de « la volonté de puissance » – deux thèmes fondateurs de la philosophie nietzschéenne. Pour Maurice Barrès, Napoléon incarne l’exaltation du culte du moi. Une vision qui rejoint celle des Romantiques dans leur ensemble. Avec Victor Hugo, qui voyait en Napoléon un « Prométhée des temps modernes », le mythe napoléonien atteint son paroxysme. Dans l’ « Ode à la colonne », entre cent autres exemples, l’auteur des « Contemplations » écrit sans détours : « Avec sa main romaine, il tordit et mêla, dans l’œuvre surhumaine, tout un siècle fameux… ». Tulard prend soin de souligner que le personnage mythique, sculpté par la vie même de Napoléon, renvoie au vestiaire d’autres mythes ayant pourtant la peau dure, comme ceux de Don Juan et de Tristan.
L'OGRE PEUT DEVENIR HÉROS
Il n’est qu’à observer l’abondante production romanesque pour se convaincre de l’imaginaire développé par les auteurs de fictions de tout poil, qu’ils soient eux-mêmes héritiers du mouvement romantique, stylistes, auteurs prolixes de romans historiques, ou même de romans policiers. Frédéric Dard sacrifia lui aussi au mythe, en donnant un San-Antonio forcément drolatique intitulé « Napoléon Pommier ». Le Corse nourrit tous les fantasmes, y compris politiques : « Il y a dans la fiction des Napoléon de droite et des Napoléon de gauche », écrit Jean Tulard. « Napoléon lui-même peut se classer à gauche – il est alors le rempart des conquêtes de la Révolution - ou à droite – c’est un tyran confisquant la liberté ». Le comte de Las Cases, auteur du « Mémorial de Sainte-Hélène », œuvre de propagande, pourrait-on dire, publié après la mort de Napoléon, a contribué à forger l’image du grand homme à la légende double : à la fois dorée et noire. Las Cases force cependant le trait doré du personnage de légende. Et cela eut pour effet de jeter les bases du bonapartisme. C’est donc dire qu’un ogre peut devenir un héros, qu’un sauveur peut se transformer en tyran, et qu’un démon peut revêtir les atours d’un dieu. Balzac est littéralement fasciné par le personnage, par l’homme et son action confondus : « ce qu’il a commencé par l’épée, je l’achèverai par la plume », écrit l’auteur de « La Comédie humaine ». Dans les « Contes bruns », il écrit encore : « … Un homme qu’on représente les bras croisés et qui a tout fait! (…) Singulier génie qui a promené partout la civilisation armée sans la fixer nulle part ; un homme qui pouvait tout faire, parce qu’il voulait tout ; prodigieux phénomène de volonté, domptant une maladie par une bataille, et qui cependant devait mourir d’une maladie dans un lit après avoir vécu au milieu des balles et des boulets… » Pour l’historien de l’art Elie Faure, c’est « un prophète des temps modernes ». Le caractère messianique dont on affuble Napoléon renforce le mythe, grave la légende, peaufine sa gloire. Stendhal – qui fut soldat de Napoléon -, sacrifie sans compter au mythe littéraire napoléonien dans ses deux romans emblématiques : « Le Rouge et le noir » et « La Chartreuse de Parme ». Napoléon apparaît, dans la « Chartreuse », comme un héros ayant l’image rassurante du père (rêvé, ou de substitution), notamment pour le personnage principal, Fabrice Del Dongo, lequel voue une admiration sans bornes à l’empereur. C’est aussi l’image du jeune général républicain monté sur un cheval fougueux que Stendhal dépeint, ou encore celle du héros par essence invincible, le conquérant qui ne se retourne pas et qui semble ignorer jusqu’à l’idée de la défaite – ce que l’histoire ne montra pas en ébréchant le mythe Napoléon. Et c’est justement les défaites, autant que l’ascension fulgurante suivie d’une chute vertigineuse, qui fascinent les écrivains, qu’ils soient romantiques ou qu’ils ne le soient plus. La faille, la fêlure, cette marque d’imperfection, ce talon d’Achille, loin d’écorner le mythe, le renforce singulièrement : « Il neigeait » !..
L'IMAGE DU GUIDE SUPRÊME
Avec la funeste bataille de Waterloo (« morne plaine ! »), Fabrice Del Dongo voit dans Napoléon l’incarnation de la « noble amitié des héros du Tasse et de l’Arioste ». Rien de moins. Il est à noter, ce recours fréquent aux grands auteurs classiques, aux références absolues : Jules César, Plutarque, voire aux dieux de l’Antiquité auxquels les écrivains font appel pour nourrir leurs métaphores. Julien Sorel, le héros du « Rouge et le noir », est, à un endroit du roman, littéralement fasciné par le souvenir de Napoléon, qui « s’était fait le maître du monde avec son épée ». Le roman européen, du vivant de Napoléon et peu après sa disparition, se nourrit sans retenue de valeurs qui sont autant d’ingrédients directement servis par le jeune mythe, et au nombre desquels nous comptons la gloire, la grandeur, l’ambition, la réussite, le courage, l’énergie, et puis la démesure, l’exaltation du moi, la fraternité virile, chevaleresque, l’image du guide suprême, du père des peuples -fantasmé.
La poésie dans son ensemble – celle des plus grands auteurs comme Hugo (le chantre par excellence, et le critique avisé aussi), Nerval (vigilant, au ton prudent, jamais grandiloquent), Vigny (fasciné, avec les traits d’un enfant, dans « Servitude et grandeur militaires »), Lamartine (auteur d’un célèbre « Bonaparte » quasiment hagiographique), Musset (qui fait de « l’immortel empereur » un modèle pour les jeunes, dans « La Confession d’un enfant du siècle »), comme celle des chansonniers populaires tels Béranger ou Debraux, des poètes mineurs qui ne connaîtront aucune gloire – la poésie générale française est traversée par l’écrasante figure de proue napoléonienne. L’image du héros – tout à tour épique, mythique, puis apothéotique, et enfin déchu-, imprègne des milliers de poèmes, au point que l’on parle aujourd’hui de « poésie napoléonienne » pour désigner cette époque largement dominée par le Romantisme, et de « muse la plus féconde des poètes » (Pierre Lebrun) du XIXe siècle, souligne Anne Kern-Boquel, auteur d’une thèse sur « Le mythe de Napoléon dans la poésie française des années 1815 à 1848 » (soit de Waterloo à la Révolution). Davantage que le roman, voire que du théâtre – qui n’est pas en reste en termes de culte du mythe napoléonien, la poésie est un genre qui se prête particulièrement à la magnificence du personnage carrément extra-ordinaire, du héros sur lequel le lyrisme et l’épopée peuvent couler comme du miel depuis une corne d’abondance. Car il est question de mythe, et pas de (simple) légende. Hissé à ce rang suprême, Napoléon rejoint Faust, au fil des strophes. La poésie, excessive comme elle sait l’être, glisse et flirte parfois avec l’exaltation mystique. L’exil, la mort (mystérieuse) du héros, le retour de ses cendres, sont autant de colonnes qui érigent une mythologie unique, et le portent encore plus haut, plus près des cieux. Car, de l’image de l’ogre et du despote, la poésie retient plus volontiers celle du sauveur, voire celle du prophète. Voulant ignorer jusqu’aux échecs, la poésie se dépolitise, pour se vouer à l’esthétisation pure, à la sacralisation d’une image, même si celle-ci commence à être la proie du passé. Charles Chassé, dans son étude sur « Napoléon par les écrivains » (Hachette, 1920), souligne que les écrivains sont passés tour à tour de l’admiration irréfléchie jusqu’en 1851, puis au dénigrement systématique jusqu’en 1887, et sont enfin parvenus à une admiration raisonnée jusqu’à l’aube du XXè siècle. A l ‘époque napoléonienne, en marge d’une littérature de référence, d’auteurs reconnus et célèbres, il existe une littérature populaire fort dynamique en France, faite de ballades, de chansons et autres complaintes, ainsi que de pièces de théâtre qui témoignent toutes de l’admiration populaire pour le héros, avec quantité de pièces célébrant la gloire du général victorieux Bonaparte, puis celle de Napoléon empereur. L’ensemble constitue un corpus historiographique formidable de l’époque. Ce sont des pièces naïves qui procèdent d’une propagande spontanée. Elles sont jouées sans chichis par des amateurs, souvent, et sont données dans divers théâtres, surtout à Paris. Cette littérature de la simplicité et du premier degré, qui se situe en marge de l’officielle, est loin d’être négligeable, car elle agit comme un formidable vecteur de la légende dorée d’un mythe qui prend corps auprès du peuple. La littérature « officielle » est composée d’écrivains flatteurs, d’hagiographes sans états d’âme, « de laquais », lancerait Cyrano de Bergerac, tels Lacépède : « On ne peut louer dignement Sa Majesté, sa gloire est trop haute », Laplace : « Grâce au génie de l’Empereur, l’Europe entière ne formera bientôt qu’une immense famille », Bernardin de Saint-Pierre : « Enfin le ciel nous envoya un libérateur. Ainsi, l’aigle s’élance au milieu des orages ; en vain, les autans le repoussent et font ployer ses ailes, il accroît sa force de leur furie, et, s’élevant au haut des airs, il s’avance dans l’axe de la tempête, à la faveur même des vents contraires ». Le propos paraît ridicule aujourd’hui. Il ne l’était pas, lorsque l’auteur de « Paul et Virginie » prononça cet « Eloge académique de Napoléon », sous la figure d’un « héros philosophe, foudre à la main et caducée de l’autre, planant sur l’Egypte »… Et ça marche. Les peuples d’Europe sont conquis.
SERVITUDE DORÉE OU LUTTE IMPLACABLE
La peinture et la musique symphonique emboîtent le pas de cette littérature qui ne recule devant aucun excès, allant jusqu’à friser le ridicule, à son corps défendant. De Saint-Pierre, encore : « Mais, lorsque le bruit des canons annoncera à la capitale le retour de tes phalanges invincibles, que des foules de jeunes épouses et de filles couronnées de fleurs se précipiteront dans les rangs de tes soldats couverts de lauriers, pour y embrasser des frères et des époux qu’elles croyaient perdus ; qu’élevant leurs bras et leurs couronnes de fleurs vers ton char de triomphe elles t’environneront de danses et de chants de la reconnaissance et de la joie, c’est alors que les muses françaises, s’élevant vers la postérité, chanteront la paix que tu auras donné au monde. » Ainsi la légende dorée tissait-elle ses lauriers à un empereur choyé, narcissique et satisfait (et qui n’en demandait peut-être pas tant). La noire ne sera pas moins excessive. Passons à présent « en revue » les apôtres de la légende suivante : Chateaubriand, pourtant mesuré, dans « Apostrophe à Napoléon », Charles Nodier avec « La Napoléone », Paul-Louis Courier dans « Le Plébiscite », Benjamin Constant dans « Napoléon usurpateur », ou encore le poète Marie-Joseph Chénier et Madame de Staël, n’y vont pas de plume morte lorsqu’ils dégainent leur ressentiment. Charles Chassé énonce clairement que « Napoléon eut contre lui les écrivains et républicains et légitimistes auxquels répugnait son despotisme. » Et même si certains continuent de l’admirer en secret, comme Chateaubriand et Madame de Staël, ils finissent par exprimer leur désaccord avec l’empereur. Et c’est une prise de risque, car Napoléon ne « lâche pas la bride », selon sa propre expression, ni à la presse, ni aux littérateurs qui sont en délicatesse avec sa politique. Chassé : « il fallait à ses adversaires choisir entre la servitude dorée et la lutte implacable. Parfois ils acceptaient la servitude, de guerre lasse ». A la vérité, Napoléon supportait difficilement qu’on ne l’adule pas. Victor Hugo, dans son discours de réception à l’Académie française, prononcé en 1841, décrit l’état de l’opinion en 1800 : « Tout dans le continent s’inclinait devant Napoléon, tout – excepté six poètes, messieurs, - permettez-moi de le dire et d’en être fier dans cette enceinte, - excepté six penseurs restés seuls debout dans l’univers agenouillé (…) Ducis, Delille, Mme de Staël, Benjamin Constant, Chateaubriand, Lemercier. » Certains sont « des adversaires intermittents de Napoléon », selon l’expression de Chassé. L’empereur ne les craint pas, sauf Chateaubriand, Benjamin Constant et Madame de Staël. Le premier, qui dédia à l’empereur son « Génie du christianisme » en 1802, tourne casaque avec véhémence une première fois avec un article publié dans « Le Mercure » en 1807. Celui-ci annonce la fameuse « Apostrophe à Napoléon », qui figure dans le pamphlet « De Buonaparte et des Bourbons », publié après l’abdication de Fontainebleau en 1814. Bonaparte, puis Napoléon, occupent l’essentiel des « Mémoires d’Outre-tombe », à partir de la Troisième partie et du Livre dix-neuvième. Extrait de cet Apostrophe : « Dis, qu’as-tu fait de cette France si brillante ? Où sont nos trésors, les millions de l’Italie, de l’Europe entière ? (…) Cet état de choses ne peut durer ; il nous a plongés dans un affreux despotisme. On voulait la république, et tu nous as apporté l’esclavage (…) Où n’as-tu pas répandu la désolation ? Dans quel coin du monde une famille a-t-elle échappé à tes ravages ? (…) La voix du monde te déclare le plus grand coupable qui ait jamais paru sur la terre (…) tu as voulu régner par le glaive d’Attila et les maximes de Néron (…) Nous te chassons comme tu as chassé le Directoire… ». Constant, banni comme Mme de Staël, publie malgré tout en 1813 « De l’Esprit de conquête et de l’Usurpation dans leurs rapports avec la civilisation européenne », pamphlet destiné à hâter le renversement de Napoléon (et à installer une monarchie constitutionnelle), au sein duquel le chapitre « Napoléon usurpateur » est d’une rare violence. L’empereur y est appelé « le lâche coquin ». Le livre devint un classique de toutes les luttes contre les régimes totalitaires. « Considérations sur la Révolution française », ouvrage inachevé et posthume (1818) de Mme de Staël (qui fut la compagne de Benjamin Constant), n’est pas moins tendre, même lorsque la femme de lettres y évoque Bonaparte avant son départ pour l’Egypte, mais ses attaques demeurent hésitantes. Chassé avance l’hypothèse d’un amour refoulé pour Napoléon qui aurait empêché la romancière d’exprimer sa grande déception (ou inconsciente frustration). Bien qu’interdite de séjour sur le sol français par l’empereur, qu’elle gênait, et en exil en Suisse dès 1803, Germaine de Staël nourrit ce fameux et largement partagé sentiment ambigu d’attirance-répulsion à l’égard du souverain. « Il m’intimidait toujours davantage. Je sentais confusément qu’aucune émotion du cœur ne pouvait agir sur lui. Il regarde une créature humaine comme un fait ou une chose, mais non comme un semblable. Il ne hait pas plus qu’il n’aime ; il n’y a que lui pour lui ; tout le reste des créatures sont des chiffres. La force de sa volonté consiste dans l’imperturbable calcul de son égoïsme… ». Chassé souligne qu’« il y a (là) comme une plainte personnelle qui teinte de discrétion ses remontrances ».
LES AUTEURS RUSSES LUI VOUENT UN VÉRITABLE CULTE
Napoléon exerce une fascination égale chez les écrivains étrangers. En Allemagne, les romanciers, francs-maçons pour la plupart, considèrent Napoléon comme l’empereur maçon qui devait octroyer la paix à l’Europe, précise Charles Chassé. Goethe décrit un génie, Fichte oscille entre admiration et dégoût, Kleist exprime sa haine napoléonienne à travers un personnage de « La Bataille d’Arminius ». Les Anglais Wordsworth, Walter Scott, Thomas Hardy, ou Coleridge, ne sont guère tendres. Outre-Manche, le fiel des poètes et des romanciers est en effet des plus denses à l’égard de celui qui leur inspire la terreur. Les auteurs russes vouent quant à eux un véritable culte à Napoléon, mais ils sont parfois aussi peu indulgents à l’égard de l’empereur et de la France, que le sont les écrivains espagnols. Cependant, c’est la fin du martyre de Sainte-Hélène, et la mort de l’empereur qui amoindrit le ressentiment de certains. Pouchkine tourne ainsi casaque : du vivant de l’empereur, sa poésie contre lui est véhémente et post-mortem, elle devient admirative. Même revirement assorti de trémolos dans les vers, chez les Anglais Shelley et Byron, et chez le Français Lamartine notamment dans les « Nouvelles méditations poétiques ». Quelques années après sa disparition, la légende de Napoléon est réhabilitée à grand fracas, en France comme partout ailleurs, dans le roman, le théâtre et la poésie. Le retour des cendres du grand homme produit un choc et génère une empathie posthume qui transpire de certains livres. Les admirateurs tardifs les plus éblouis, les plus épiques, sont les écrivains polonais tel Mickiewicz, ou l’Anglais Browning. Le temps du « dénigrement systématique » à l’égard de la mémoire napoléonienne, envahit l’ensemble de la littérature.
DE LA HAINE À LA COMPASSION
Cette période sera suivie d’une autre, où planera une « admiration raisonnée » pour l’empereur, ce jusqu’à l’aube des années 1920. Sauf peut-être en Russie, ou un Léon Tolstoï écrit avec mesure et justesse sur la gloire de l’empereur –mais aussi au sujet de la vanité de celui-ci-, en particulier dans « Guerre et Paix ». Le grand auteur avait été terrifié par le culte voué à Napoléon lorsqu’il visita Paris en 1858, déclare l’historienne Natalia Bassovskaïa. Tolstoï écrit d’ailleurs avec lucidité que « comme la guerre est déshumanisante, la figure de Napoléon n’est pas héroïsée ». Bassovskaïa souligne que le personnage (romanesque) napoléonien, d’abord dépeint sous les traits d’un « monstre corse », provoquera, après sa chute, une compassion qui ne sera cependant jamais univoque, tant chez Dostoïevski (qui se comparait volontiers à Bonaparte), que chez Lermontov ou Pouchkine. « Les classiques de la littérature russe n’avaient pas de tentation de se réjouir de son échec », énonce l’historienne. Qui ne manque de préciser que les femmes écrivains, à l’instar de Mme de Staël, et à l’image de la grande poétesse Marina Tsvetaïeva, sont plus volontiers passionnées, et comme irrationnellement captives, sous le charme de Napoléon. Voire secrètement amoureuses. Tsvetaïeva voue un véritable culte à l’empereur, allant jusqu’à décorer son intérieur d’images et de portraits de son héros absolu. Une vraie fan. Ailleurs, l’Allemand Nietzsche affûte son jugement dans « Le Gai savoir » en voyant dans Napoléon le modèle du « bon européen ». Les Français Maurice Barrès, Anatole France, entre autres, ou Rostand au théâtre, avec « L’Aiglon », ont la plume désormais apaisée. Une sorte de consensus se fait jour, en particulier dans le roman, qui se trouve débarrassé de parti-pris extrêmes. Il n’y aura jamais plus ni adoration ni haine péremptoires, mais des personnages romanesques à l ‘équilibre, ayant tiré peut-être les leçons de l’histoire. L’un des exemples les plus récents et des plus marquants de l’inspiration napoléonienne dans le roman, est La Bataille, de Patrick Rambaud (Grasset), qui obtint le Goncourt et le Grand prix du roman de l’Académie française, en 1997. Le livre (premier volet d'une trilogie, avec Il neigeait, et L'Absent), retrace la bataille d’Essling (21 et 22 mai 1809, près de Vienne). Balzac projetait d’écrire ce livre. Rambaud l’a fait. A n’en pas douter, l’immense succès du roman est à mettre pour partie au crédit de son inspiration napoléonienne. Le grand homme que l’on se plait à détester fascinera encore longtemps écrivains et lecteurs. L.M.
 Le Bayonnais Robert Linxe vient de s'éteindre (ce matin, chez lui, à Bayonne, à l'âge de 85 ans : lire Sud-Ouest, lien ci-dessous). Un orfève du chocolat se barre. Il avait créé La Maison du Chocolat en 1977. Hommage ganaché.
Le Bayonnais Robert Linxe vient de s'éteindre (ce matin, chez lui, à Bayonne, à l'âge de 85 ans : lire Sud-Ouest, lien ci-dessous). Un orfève du chocolat se barre. Il avait créé La Maison du Chocolat en 1977. Hommage ganaché.

De nombreux articles sur le héros absolu, l'homme-légende, l'homme-Histoire, l'homme-destin... J'y signe le papier sur la funeste campagne d'Espagne de l'empereur, qui fut si meurtrière, avec notamment la conférence de Bayonne, au château de Marracq, ainsi qu'un long article sur Napoléon pris comme un genre littéraire en soi, ou : l'attirance-répulsion, depuis Hugo, Chateaubriand, Madame de Staël et jusqu'à Patrick Rambaud, pour un personnage qui fascine étrangement écrivains et lecteurs.
212 pages. En kiosque.
Merveilleux petit livre que celui de Clémentine Mélois, Cent titres (Grasset), qui s'amuse (merci le logiciel Photoshop) à détourner avec humour les titres


Les bons papiers sont parfois ceux que l'on n'attend ni ne sollicite, ceux qui proviennent de vrais lecteurs qui font eux-mêmes la démarche d'acheter des livres qu'ils ont envie de lire, et puis d'en partager la lecture. J'ignore qui est la Hélène qui signe ces notes si sensibles, sur le site Lecturissime, mais voici deux de ses articles (je connaissais celui sur Les Bonheurs de l'aube, je suis tombé sur l'autre - consacré à Chasses furtives- par hasard en surfant, hier), et cela ajoute à la tendre humilité de son auteur : nous découvrons ces compte-rendu en passant, car nul ne nous en avertit, et cela augmente singulièrement la délicatesse du geste)... Ce genre de surprise réjouit autant qu'un papier signé d'une pointure dans un journal à grand tirage.
http://www.lecturissime.com/2014/11/chasses-furtives-de-leon-mazzella.html
http://www.lecturissime.com/article-les-bonheurs-de-l-aube-de-leon-mazzella-114626959.html

Sélection de livres sur le vin (papier paru cette semaine dans L'Express, par L.M.) :
UN CLASSEMENT A LA LOUPE
Ils sont 87 châteaux du bordelais à pouvoir inscrire la formule magique qui agit comme un sésame pour le monde entier, depuis l’Exposition universelle de 1855. « Le » classement, intemporel, souvent décrié, mais toujours en vigueur, signe les domaines les plus réputés du Médoc, des Graves et du Sauternais. C’est à une découverte de l’esprit et de l’histoire de ces crus d’exception que nous invite cet ouvrage co-signé par Jean-Charles Chapuzet (textes), et Guy Charneau (photos). Au-delà des mythiques Lafite-Rothschild, Latour, Margaux, Yquem, Haut-Brion et autre Mouton-Rotshchild, l’amateur découvre quantité d’histoires d’hommes, de terroirs, ayant forgé une certaine philosophie de la qualité et du prestige. Les Grands Crus Classés se sont d’ailleurs portés candidats, comme un seul homme, au classement au patrimoine immatériel mondial de l’Unesco. A suivre.
1855. Bordeaux. Les Grands Crus Classés, Glénat, 49,90€
ETERNELLE EXTRAVAGANCE
Fort du succès de « Culture whisky », Patrick Mahé récidive avec « Culture champagne » et nous fait pénétrer dans l’univers de l’extravagance, de l’art de vivre et du luxe accessible, en nous contant de façon didactique mais en souplesse, l’histoire pétillante d’un vin unique au monde, ainsi que les arcanes de son élaboration, sans oublier la grâce, l’élégance, et la part de mystère dont le champagne est auréolé. Nous entrons, autour de Reims, d’Epernay et d’Aÿ, jusque dans les crayères des maisons les plus prestigieuses, escorté par des photos remarquables signées Shoky Van der Horst, et l’ouvrage, qui évoque entre autres les noces fréquentes du champagne avec les arts, ne manque pas de faire la part belle aux femmes du Champagne (elles ne sont pas toutes veuves) ; ses meilleures ambassadrices.
Culture Champagne, Le Chêne/ EPA, 35€
LES CLÉS DE BORDEAUX
L’Ecole du vin de Bordeaux, émanation du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB), propose aux professionnels et aux particuliers des formations diverses, qui vont de l’initiation au perfectionnement le plus pointu. Elle est devenue une référence, y compris à l’étranger, puisqu’elle inscrit son action au sein d’un réseau de 35 écoles spécialisées. C’est la quintessence du savoir et du savoir-faire de cette prestigieuse école qui se trouve rassemblé dans un ouvrage précieux et ludique à la fois, jamais abscons et cependant sérieux. « L’Essentiel des vins de Bordeaux » fait le tour de la question à la manière d’un guide ludique, en livrant toutes les clés nécessaires à la compréhension du terroir, du vignoble, d’une filière unique en son genre (dans les relations entre les châteaux et le négoce), d’une mosaïque d’AOC, des classements des grands crus, de l’année vigneronne jour après jour, de la vinification, et jusqu’aux alliances gourmandes, en passant par la dégustation. L’ensemble, présenté de façon concise, est agrémenté d’infographies terriblement pratiques et de croquis synthétiques, dans un ouvrage d’une grande clarté qui n’oublie jamais la dimension humaine de l’univers de la vigne. Cerise sur le bouchon : 38 vidéos sont téléchargeables depuis le livre, à partir de QR codes, qui permettent de prolonger la lecture, avant de se rendre sur le terrain.
L’essentiel des vins de Bordeaux, éditions de La Martinière, 19,90€
LA MÉMOIRE DE L’OUTIL
C’est un véritable musée de la vigne et du vin en 700 photos qui se trouve dans les pages d’un superbe album à dimension historique. Le prolongement de la main du vigneron a en effet toujours été un outil, fruit de l’imagination judicieuse de l’homme. La mécanisation croissante de ce métier tend à ranger au musée cette profusion d’objets utiles, cette mine d’ingéniosité, ces inventions d’une grande beauté aussi, que sont « Les outils de la vigne et du vin ». L’ouvrage est signé par deux passionnés, Sréphane Bernoud (rédacteur du livre) et Dominique Auroy, initiateur du projet. Ce dernier a constitué son propre musée… à Tahiti (ainsi où il a également créé, ex nihilo, un vignoble singulier sur l’atoll de Rangiroa, dans l’archipel de Tuamotu). L’ouvrage rassemble donc la collection privée, riche de plus de mille outils, de Dominique Auroy. Et il a été conçu avant tout afin de transmettre l’image et la trace d’un savoir aux générations futures. Mine d’informations sur les outils ayant servi au travail du sol, à la taille, au traitement de la vigne, au pressurage, aux vendanges, la tonnellerie, sans oublier la cave et la dégustation, l’album est enrichi par ailleurs de quantité de cartes postales anciennes. Celles-ci retracent une belle histoire humaine et l’on sent par ailleurs, en regardant de près ces outils dont l’usure extrême est palpable, la trace des mains des hommes, la beauté de leurs gestes, leur force paysanne et la difficulté de leur travail, aussi. Ce qui augmente l’émotion à la lecture.
Les outils de la vigne et du vin, La Taillanderie, 75€
------------------------------------------
Et quelques autres notules (non parues) sur d'autres livres :
VIN ET NUMÉRIQUE
La collection des Précis Féret, petits manuels pratiques à l’usage des professionnels de la filière vitivinicole, étudiants compris, et des amateurs éclairés, s’enrichit d’un ouvrage consacré aux relations qu’entretiennent forcément le vin et les réseaux sociaux. Nul ne semble en effet pouvoir échapper à l’avantage qu’il y a à utiliser (intelligemment) ces nouveaux modes de communication, dans le cadre d’un développement marketing, stratégique, commercial ou simplement d’information. Ce précis est ainsi un manuel d’aide à la décision pour des acteurs du monde du vin encore perplexes devant un phénomène relativement récent et complexe dans son utilisation, surtout lorsqu’il s’agit de boissons alcoolisées...
Les Réseaux sociaux et le vin, par Patrice Malka et Vincent Pétré, Féret, 9,90€
DÉGUSTATION BIODYNAMIQUE
« Le Guide des vins en biodynamie », signé Evelyne Malnic, créatrice par ailleurs du site plusbellelavignebio, en est à sa troisième édition et c’est donc un signe (positif) du succès rencontré par les nouvelles méthodes culturales douces et prônant une certaine symbiose avec la nature, qui touche à une philosophie fondée sur l’amour et le respect quasi absolu de la terre. L’auteur n’hésite pas à parler au sujet de la biodynamie « d’avant-garde de la viticulture française, voire de la viticulture de demain », ici et partout ailleurs. 487 vins bios (français et suisses) ont été dégustés à la fin de l’année 2013 par un jury composé de 23 dégustateurs professionnels, et sont commentés dans ce véritable guide pratique singulier, qui milite de manière gourmande en faveur de vignerons engagés, passionnés et convaincus par les bienfaits de leur démarche écologique.
Le Guide des vins en biodynamie, Féret, 22,50€
sur ma page fesses de bouc :

 Papier paru dans le nouveau hors-série de L'EXPRESS, La France des collabos (rédaction en chef Philippe Bidalon, avec Léon Mazzella).
Papier paru dans le nouveau hors-série de L'EXPRESS, La France des collabos (rédaction en chef Philippe Bidalon, avec Léon Mazzella).
C’est une France apathique, d’abord abasourdie par la défaite, puis aveuglée par un Pétain dont elle ne décèle pas de double jeu, qui va tantôt collaborer activement, tantôt résister mollement durant les années noires. Par Léon MAZZELLA
-----
En 1940, après la défaite, qui représente un énorme coup de massue national, aussi violent qu’inattendu, les esprits sont dévastés, et l’horizon prend l’aspect d’ « un paysage d’après la débâcle », écrit Julien Gracq dans « Un Balcon en forêt » (Corti), le récit par excellence de la drôle de guerre et de l’attente. Une France en déroute peut en emprunter plusieurs, aurait dit Lacan. Soit l’une ou l’autre, car la France d’alors est manichéenne par la force des choses (collaborer ou résister –mais avaient-ils le choix, au début ?). Ou bien alors cette France est sourde et aveugle, donc coupable de passivité active… Davantage abasourdie, le pays éprouve, comme l’exprime Pierre Laborie dans « Les mots de 39-45 » (P.U. du Mirail) « le deuil et l’humiliation (lesquels) ne suffisent pas à la conscience que les Français doivent garder du désastre et aux leçons qu’il leur revient d’en tirer. C’est du moins le discours que Vichy martèle quotidiennement en 1940. L’espace public est écrasé par un message envahissant, répété avec insistance : la défaite est une punition méritée, elle sanctionne les relâchements fautifs du passé (…). Le royaume étriqué du Maréchal devient celui de mea culpa, de l’autoflagellation et de la mortification collective. »
C’est donc cette France-là, comme perdue en pleine mer, qui tombe dans le panneau Pétain. L’image du sauveur, de l’homme de Verdun, le grand-père rassurant et protecteur dans l’inconscient collectif, joue en faveur de celui qui se révèlera assez vite être l’homme du double jeu par excellence. Présenté comme un « bouclier » face au nazisme, la France croit en lui comme un seul homme, ou peu s’en faut, car il est toujours des esprits affûtés pour déceler l’ignoble supercherie, la couardise érigée en système nouveau. Et la France « collabore », de manière passive, en suivant aveuglément Pétain, pensant « résister » convenablement à l’occupant, auquel le maréchal dit ne pas faire trop de concessions.
Las. Les premières lois antijuives seront promulguées dès 1940 par un gouvernement français auquel les Allemands ne demandaient rien. Pour Vichy, faire le jeu nazi en anticipant avec zèle ses désirs les plus ignobles, c’était s’acheter une place de choix dans la future Europe allemande, supposée inéluctable. Et de géopolitique, l’action de Vichy deviendra vite idéologique (lire p32). Car la France collaborationniste est bien un régime structuré, souligne Pierre Laborie, dans « L’Opinion française sous Vichy » (Seuil). Fort d’une idéologie incarnée par le maréchal, et baptisée « Révolution nationale », concept qui désigne une sorte d’interprétation de la débâcle, laquelle serait le produit d’une décadence trouvant ses origines dans une « anti-France » composée de Juifs, de francs-maçons, de communistes et autres métèques… L’historien Denis Peschanski, auteur de « Vichy 1940-1944, contrôle et exclusion » (Complexe), remarque à ce propos que les Français ne semblent pas porter aujourd’hui la trace d’une culpabilité, mais manifestent davantage un intérêt pour une période « compliquée » (il n’est qu’à lire au sujet de cet adjectif chaque roman de Modiano), où chaque citoyen était partie prenante, à des niveaux très variables. Un autre historien ayant largement exploré la question, Henry Rousso, parle de « matrice du temps présent » pour évoquer cette période trouble de l’Occupation et du second conflit mondial en général.
Dans le paysage de cette France autant trouble que troublée, il y a encore les Justes qui deviennent des sauveteurs par empathie bienheureuse, et les héros, qui combattent les armes à la main. Nous trouvons également des cas d’espèce : c’est Daniel Cordier, maurrassien convaincu, qui deviendra presque subitement le bras droit de Jean Moulin…
Et puis il y a ceux que l’historien Jean-Pierre Azéma nomme les « vichysto-résistants » : d’abord pro-Pétain, puis déçus ou choqués par un fourvoiement certain, ils se tourneront vers une forme de résistance à des degrés divers : tous ne prirent pas le maquis une mitraillette Sten à la main, loin s’en faut. Mais tous condamnèrent les criminels de bureau qui se contentaient d’obéir aux ordres, en évitant soigneusement de se poser des questions d’ordre moral ou simplement personnelles.
Enfin, il y a la majorité silencieuse. Un peuple en pleine « déliaison sociale » tandis qu’elle aurait dû naturellement se serrer les coudes. Sans agir, mais de la façon la plus passive qui puisse être, il exprime une France apathique. « Sortir du cadre », et d’abord désobéir, refuser par exemple l’humiliation de trop, comme le Service de travail obligatoire (STO), exigeait une force surhumaine. Rappelons que Vichy ira jusqu’à créer en 1941 des tribunaux d’exception auprès de chaque Cour d’appel, les « Sections spéciales » (Costa-Gavras en fit un film en 1975), chargés de juger les résistants, communistes et autres anarchistes, en se livrant à une justice expéditive.
Parler encore de collaboration subie et de résistance passive, de mollesse et de courage, empêche par conséquent quiconque de juger le comportement d’un Français durant l’Occupation, et de lui reprocher d’avoir été pleutre ou « peu résistant », comme le susurra avec ironie Arletty lors de son arrestation. L.M.
"Chutes" du papier inédites, au sujet de la passion trouble de l'obéissance :
Collaborer ou bien résister. Telle est la question. L’universitaire et psychanalyste Pierre Bayard, dans son essai atypique, « Aurais-je été résistant ou bourreau » (Minuit), s’est livré à cette interrogation en toute honnêteté. Pure projection, certes, mais ô combien digne d’intérêt, ne serait-ce qu’intellectuel. Né en 1954, l’auteur ignore ce qu’il aurait fait s’il avait eu vingt ou trente ans en 1940. Il s’est donc transporté en esprit dans le passé, et il y a reconstitué sa vie, conscient de la supercherie fondamentale de son opération. Pour tenter de voir. Il a réfléchi aux choix auxquels il aurait été confronté, aux décisions qu’il aurait dû prendre, aux erreurs qu’il aurait commises. Il a pour cela inventé un « personnage-délégué », et a eu recours à la fiction pour effectuer cette expédition singulière. En faisant naître son personnage quand le propre père de l’auteur est né (en 1922). Alors Pierre Bayard explore le temps, tente de baigner dans un contexte singulier, et pénètre dans la tourmente d’une histoire écrasante et déchirante. Au sein de laquelle le principe d’engagement prend un sens capital. Par le détour de la fiction, une franchise intérieure aussi forte que possible autorise, peut-être, d’approcher une réalité enfuie, « le glissement vers les ténèbres » et, au-delà de celle-ci, de répondre à la question clé : « qu’aurais-je donc fait à la place de mon père ? ». Pierre Bayard n’oublie pas de préciser que le « devenir-résistant » est plus singulier que le « devenir-bourreau ». « Beaucoup plus mystérieux », écrit-il, « est le devenir-résistant, c’est à –dire la capacité que manifestent certains êtres à certains moments de leur histoire (…) de dire non.
Car aucun Français adulte ayant vécu l’Occupation ne saurait être jugé à la seule aune de notre présent confortable. Le regard élémentaire de l’historien (devons-nous le rappeler), nous apprend cette indispensable mise à distance du sujet, laquelle tient infiniment compte du contexte historique et social. De manière récurrente, le roman français tente d’apporter quelques éléments de réponse. Marc Lambron, né en 1957, écrit, dans « 1941 » (Grasset) : « Et nous condamnons d’autant plus fortement Vichy, qui n’a droit à aucune indulgence, que nous n’avons pas pris part à son histoire. »
« Sortir du cadre », et d’abord désobéir, refuser par exemple l’humiliation de trop, exigeait une force surhumaine qui en appelait à la « re-création de soi », selon l’expression de Pierre Bayard (op.cit.). D’aucuns pensent que notre passion (française) d’obéir transcende jusqu’à notre égoïsme et notre souci de protéger nos intérêts vitaux. Ce concept a été étudié, côté Allemand, par l’historien américain Daniel Jonah Goldhagen, dans « Les bourreaux volontaires de Hitler », sous-titré « Les Allemands ordinaires et l’holocauste » (Seuil). Thèse : il n’est pas nécessaire d’avoir été actif pour être responsable. Ou bien : nous pouvons être redoutablement actifs sans avoir à nous salir les mains (voir Sartre). Goldhagen appuie cependant sa recherche (qui fit débat) sur l’idée d’un consensus sans contrainte, correspondant à des prédispositions (antisémites, en l’occurrence), inhérentes à une structure psycho-affective, historique, culturelle en somme, et exacerbée à un moment apothéotique de l’Histoire…. Il s’agit en quelque sorte du « devenir-bourreau par passivité » évoqué par Pierre Bayard. De l’inaction pire que la réaction, etc. Un thème récurrent. L.M.

Papier paru dans le hors-série de L'Express consacré à la Collaboration. (Rédaction en chef : Philippe Bidalon, avec Léon Mazzella). En kiosque depuis ce matin et pour deux mois.
Le gouvernement de Vichy a non seulement collaboré en devançant les ordres nazis, mais elle manifesta un zèle redoutable dans ce que l’on nomma plus tard la Shoah.
Par Léon Mazzella
---
Comme souvent au sortir d’un drame national aux plaies encore purulentes, un peuple meurtri et parfois coupable comme ce fut le cas pour le peuple français sous le régime de Vichy, est plus soucieux de se reconstruire et d’oublier ou de faire oublier un passé peu glorieux, voire honteux, au lieu de se livrer immédiatement à un travail de justice. L’Epuration a tout de même eu lieu, mais force est de reconnaître que l’omerta française dura fort longtemps, sur ce motif, préférant parler de Résistance en bombant le torse et en enflant parfois le tableau, plutôt que d’évoquer tout sujet dérangeant. Le mythe d’une France résistante dans son ensemble s’effondrera d’ailleurs au milieu des années 1970.
La participation active, et souvent zélée des hommes de Vichy au régime nazi, afin de l’aider dans la recherche, la persécution et la déportation des Juifs, de 1940 à 1944, fut un sujet tabou dans les esprits et jusque dans certains livres d’histoire parus au début des années 1970, qui ne mentionnent jamais les sinistres lois antisémites d’octobre 1940. La France avançait, toute honte bue, en continuant d’occulter la part d’ombre la plus sombre de son histoire récente. Ainsi le maréchal Pétain fut-il invariablement présenté comme un véritable rempart contre l’occupant, un « bouclier » modéré, un protecteur des Français contre les rigueurs et les souffrances de l’Occupation. Cette vision angélique dissimulait une réalité toute autre. L’idée que Vichy menait par ailleurs un double jeu vis-à-vis de l’occupant fut également contestée et même battue en brèche par de solides travaux historiques.
Le livre de l’historien américain Robert O. Paxton, en 1973, La France de Vichy (Seuil) - fondé principalement sur les archives allemandes, les seules qui lui furent à l’époque accessibles – fit l’effet d’une bombe lorsqu’il parut. La brèche était béante, qui indiquait la voie à des dizaines de travaux de recherches sur des sujets plus stupéfiants et révoltants les uns que les autres. L’accès à de nouvelles archives, par de jeunes historiens moins directement concernés que leurs aînés (et à la suite de Henry Rousso et Jean-Pierre Azéma, lesquels ont œuvré à la mise en perspective de l’œuvre de Paxton), a ouvert en grand les fenêtres de salles nauséabondes où des secrets honteux pensaient pouvoir rester terrés comme des rats dans des cartons.
Les travaux fondateurs de Paxton démontrent la participation active du gouvernement français à la solution finale, la Shoah. Cette révélation mit durablement à mal toutes les lectures qui avaient été faites jusque là de l’histoire du régime de Vichy (Henri Amouroux, Robert Aron) puisque, loin de se contenter de devancer les ordres allemands Vichy –personnalisé par Pétain et Laval- et l’ensemble de l’administration française derrière eux, ont manifesté le désir supérieur de s’associer clairement à l’ « ordre nouveau » nazi, prélude ou condition sine qua non à la réalisation finale d’une (nouvelle) « Révolution nationale », en totale rupture avec la République. Sans même parler de certains hauts fonctionnaires comme Maurice Papon et de leur collaboration active en faveur de l’extermination programmée des juifs (lire p.54). Aussi, la lecture des archives allemandes par Paxton démontra donc que, loin d’avoir freiné l’occupant dans son action, Vichy a facilité le travail des nazis, en particulier au sujet de la déportation des Juifs. Pire : l’historien américain rappelle dans son ouvrage majeur que les Allemands ne demandaient pas immédiatement des lois antisémites. Tandis que la politique de Vichy analysait la défaite comme une conséquence de la décadence d’une France au coeur de laquelle les Juifs avaient une responsabilité majeure… Paxton souligne d’ailleurs que les Allemands n’auraient de toute manière pas pu réaliser tous leurs funestes projets sans le concours des administrations diverses, du gouvernement à la police en passant par des entreprises comme la SNCF. Le rôle-clé que tint le Commissariat général aux questions juives (CGQJ), instrument majeur de la politique antisémite de l’Etat français, a montré par son action que, loin de vouloir dessiner une politique antisémite « à la française », il devint rapidement l’auxiliaire, le bras armé, le chien fidèle de la Gestapo. Si le CGQJ ne comptait « que » 2 500 agents, ce sont bien davantage de personnes, la fonction publique dans son ensemble, qui participa activement aux exactions que nous savons, selon Tal Bruttmann, auteur de « Au bureau des affaires juives. L‘administration française et l’application de la législation antisémite, 1940-1944 » (La Découverte). Par ailleurs, le reportage retentissant qu’Eric Conan réalisa en 1990 sur les enfants juifs du camp de Pithiviers, et qui suit ces pages, prouve avec éloquence la participation active de la police de Vichy que dirigeait René Bousquet, sinistre organisateur de la rafle du Vel' d’Hiv' (les 16 et 17 juillet 1942). Car il n’y a eu « ni double jeu, ni passivité (ni a fortiori, demi-résistance) d’un Vichy attentiste », précise Stanley Hoffmann dans sa préface à La France de Vichy ; « il y a eu une constante et illusoire politique de collaboration, une offre maintes fois renouvelée au vainqueur nazi : en échange d’une reconnaissance par l’Allemagne de l’autonomie politique de Vichy et d’un assouplissement de l’armistice, la France s’associerait pleinement à l’ordre nouveau »et jouerait le rôle d’un brillant second », écrit-il. Enfin, il n’est qu’à rappeler les propos haineux et assumés de Pierre Darquier de Pellepoix, dans une interview que celui qui fut le Commissaire aux Questions juives donna à L’Express en 1978. Il persistait et signait en déclarant notamment « qu’à Auschwitz, on n’a(vait) gazé que des poux ». Avec un aplomb glaçant, il ne se souvenait pas « de cette histoire d’étoile jaune », faisant montre d’un effroyable déni révisionniste. Prétendant que les Juifs, « prêts à n’importe quoi pour se faire de la publicité, avaient inventé le chiffre de 6 millions de victimes ». Il lança au journaliste qui l’interrogeait, qu’il était « un agent de Tel-Aviv »… L’interview, qui eut un effet aussi choquant que retentissant, prouvait que Darquier avait été un collaborateur tellement zélé qu’il avait proposé lui-même aux Allemands, le 7 février 1943, et à l’adresse des Juifs, le port de l’étoile jaune, l’interdiction de l’exercice de fonctions publiques, ainsi que le retrait de la nationalité française à tous ceux qui l’avaient acquise depuis 1927. Au détour d’une question, il niait aussi l’existence des chambres à gaz, « une invention juive ». Quant à la solution finale, il s’agissait selon ce monstre, d’« une invention pure et simple ». C'était aussi cela, Vichy... L.M.
 L'ami Christian Authier a décroché le Renaudot essai pour son magnifique De chez nous (Stock), évoqué ici, ainsi que sur le Huff'Post : http://bit.ly/1xg1ELM et je suis vraiment très heureux pour lui. On trinquera! (par parenthèse : dans la première sélection de l'Interallié, figuraient les noms de quatre potes : Stéphane Guibourgé, dont j'ai chroniqué ici aussi : http://bit.ly/1t6YVFy (ainsi que sur le Huf'Post), l'époustouflant Les fils de rien, les princes, les humiliés (Fayard), Christian Authier pour son précédent livre, Soldat d'Allah (Grasset), Jean-Marc Parisis - mais je n'ai pas encore lu ses Inoubliables (Flammarion)-, et Simonetta Greggio pour sa suite donnée à Dolce Vita, avec Les Nouveaux monstres (Stock). Reste seulement Simo en lice, et je croise les doigts, de pied y compris, pour qu'elle décroche le prix!).
L'ami Christian Authier a décroché le Renaudot essai pour son magnifique De chez nous (Stock), évoqué ici, ainsi que sur le Huff'Post : http://bit.ly/1xg1ELM et je suis vraiment très heureux pour lui. On trinquera! (par parenthèse : dans la première sélection de l'Interallié, figuraient les noms de quatre potes : Stéphane Guibourgé, dont j'ai chroniqué ici aussi : http://bit.ly/1t6YVFy (ainsi que sur le Huf'Post), l'époustouflant Les fils de rien, les princes, les humiliés (Fayard), Christian Authier pour son précédent livre, Soldat d'Allah (Grasset), Jean-Marc Parisis - mais je n'ai pas encore lu ses Inoubliables (Flammarion)-, et Simonetta Greggio pour sa suite donnée à Dolce Vita, avec Les Nouveaux monstres (Stock). Reste seulement Simo en lice, et je croise les doigts, de pied y compris, pour qu'elle décroche le prix!).
 Sarah Bakewell, avec Comment vivre? Une vie de Montaigne en une question et vingt tentatives de réponses (Livre de Poche) redonne la fringale de relire les Essais. C'est brillant, tonique, lumineux, simple et tutoyant. Nous suivons Montaigne pas à pas au fil de sa vie et de ses réflexions permanentes. Et nous nous disons que l'auteur d'un incomparable livre-vie, est définitivement notre auteur-miroir, notre meilleur compagnon de chaque jour, notre philosophe quotidien.
Sarah Bakewell, avec Comment vivre? Une vie de Montaigne en une question et vingt tentatives de réponses (Livre de Poche) redonne la fringale de relire les Essais. C'est brillant, tonique, lumineux, simple et tutoyant. Nous suivons Montaigne pas à pas au fil de sa vie et de ses réflexions permanentes. Et nous nous disons que l'auteur d'un incomparable livre-vie, est définitivement notre auteur-miroir, notre meilleur compagnon de chaque jour, notre philosophe quotidien.
Avec Les Napolitains, de Marcelle Padovani, Henry Dougier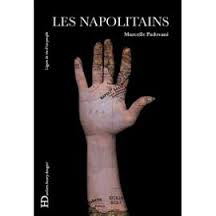 (qui créa les éditions autrement) inaugure une collection, Lignes de vie d'un peuple, aux éditions HD, qui s'attachera à raconter les peuples aujourd'hui, par trop invisibles. En mettant en scène leurs valeurs, leurs interrogations, leurs créations, leurs passions en partage, à travers des narrations fortes, des portraits, des enquêtes de terrain rédigées par des écrivains un brin ethnologues, la collection promet d'offrir des histoires marquantes issues de cultures profondes. Avec Les Napolitains, déjà, c'est gagné : leur ironie dévastatrice, leur conscience aiguë du malheur de vivre, le bonheur simple de leur puissance d'exister spinozienne, leur sens inné d'acteurs tragiques -et comiques- de la comédie humaine, en font un peuple à part qui touche néanmoins à un certain universel, que d'aucuns lui envie. Titres à venir : Les Islandais, Les Catalans, les Ecossais, les Roumains, les Suisses, les Anglais, les Canadiens francophones, les Irlandais, les Brésiliens, les Indiens, les Ukrainiens : ça promet grave...
(qui créa les éditions autrement) inaugure une collection, Lignes de vie d'un peuple, aux éditions HD, qui s'attachera à raconter les peuples aujourd'hui, par trop invisibles. En mettant en scène leurs valeurs, leurs interrogations, leurs créations, leurs passions en partage, à travers des narrations fortes, des portraits, des enquêtes de terrain rédigées par des écrivains un brin ethnologues, la collection promet d'offrir des histoires marquantes issues de cultures profondes. Avec Les Napolitains, déjà, c'est gagné : leur ironie dévastatrice, leur conscience aiguë du malheur de vivre, le bonheur simple de leur puissance d'exister spinozienne, leur sens inné d'acteurs tragiques -et comiques- de la comédie humaine, en font un peuple à part qui touche néanmoins à un certain universel, que d'aucuns lui envie. Titres à venir : Les Islandais, Les Catalans, les Ecossais, les Roumains, les Suisses, les Anglais, les Canadiens francophones, les Irlandais, les Brésiliens, les Indiens, les Ukrainiens : ça promet grave...
 Le Dictionnaire chic de philosophie, de Frédéric Schiffter (Ecriture) est un abécédaire amoureux et désinvolte qui donne un salutaire coup de fouet à la philo. telle qu'on l'édite. Le prof-de-philo-surfeur-biarrot - à qui l'on doit également une délicieuse Petite philosophie du surf (Atlantica), est un dilettante de génie qui aime flirter dans tous les sens du terme : avec Montaigne, Cioran, Nietzsche
Le Dictionnaire chic de philosophie, de Frédéric Schiffter (Ecriture) est un abécédaire amoureux et désinvolte qui donne un salutaire coup de fouet à la philo. telle qu'on l'édite. Le prof-de-philo-surfeur-biarrot - à qui l'on doit également une délicieuse Petite philosophie du surf (Atlantica), est un dilettante de génie qui aime flirter dans tous les sens du terme : avec Montaigne, Cioran, Nietzsche 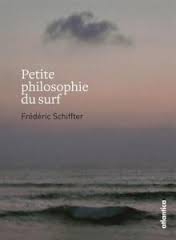 et les jolies filles, forcément. Nihilisme, bikinisme, mélancolie, dandysme, ivrognerie, onanisme, libertinage, naufrage amoureux, égoïsme, flemme et filles de la plage sont des entrées qui se côtoient et se frottent avec joie, dans ce gros bouquin à déguster comme Montaigne recommandait de lire : en picorant à la manière des poules.
et les jolies filles, forcément. Nihilisme, bikinisme, mélancolie, dandysme, ivrognerie, onanisme, libertinage, naufrage amoureux, égoïsme, flemme et filles de la plage sont des entrées qui se côtoient et se frottent avec joie, dans ce gros bouquin à déguster comme Montaigne recommandait de lire : en picorant à la manière des poules.
Les mots de l'époque (autrement), est le recueil des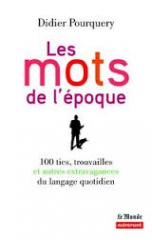 précieuses, savoureuses, toujours très attendues chroniques intitulées Juste un mot, que l'ami Didier Pourquery a donné au Monde, et qu'il donne à présent au Huff'Post. Réunies (il y en a 100), elles dessinent un bonheur : celui de relire la pensée incisive de Pourquery, son écoute suraiguë, et tendre aussi, du monde contemporain (des mots) tel qu'il gesticule, évolue, se métisse, se fond, se confond et enrichit nos parlers contemporains. Il y est question de tics, de trouvailles, d'extravagances du langage quotidien. De Waouh! à Bâtard, de "J'lui fais" à Genre!, de Réenchanter à Melon (avoir le), en passant par Célib', Deadline, P'tit mail, Souci (pas d'), et de Boucle (tu me mets dans la), à Revisité, Improbable, Dispo, Boulet, ou encore Impacter, et Au final, les billets de Didier sont la peinture en mots de notre temps : c'est précieux, précis, drôle, fin, subtil, et c'est de surcroît un bonheur d'écriture et donc de lecture.
précieuses, savoureuses, toujours très attendues chroniques intitulées Juste un mot, que l'ami Didier Pourquery a donné au Monde, et qu'il donne à présent au Huff'Post. Réunies (il y en a 100), elles dessinent un bonheur : celui de relire la pensée incisive de Pourquery, son écoute suraiguë, et tendre aussi, du monde contemporain (des mots) tel qu'il gesticule, évolue, se métisse, se fond, se confond et enrichit nos parlers contemporains. Il y est question de tics, de trouvailles, d'extravagances du langage quotidien. De Waouh! à Bâtard, de "J'lui fais" à Genre!, de Réenchanter à Melon (avoir le), en passant par Célib', Deadline, P'tit mail, Souci (pas d'), et de Boucle (tu me mets dans la), à Revisité, Improbable, Dispo, Boulet, ou encore Impacter, et Au final, les billets de Didier sont la peinture en mots de notre temps : c'est précieux, précis, drôle, fin, subtil, et c'est de surcroît un bonheur d'écriture et donc de lecture.
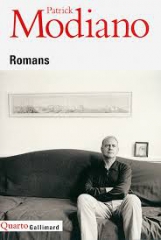 Romans, de Patrick Modiano est le Quarto (Gallimard) qu'il faut avoir chez soi, car il rassemble le meilleur de notre nouveau Nobel : Villa triste, Livret de famille, Rue des boutiques obscures (son Goncourt), Remise de peine, Chien de printemps, Dora Bruder (inoubliable livre!), Accident nocturne, Un pedigree (à nos yeux le plus touchant, car peut-être le plus vrai de ses livres), Dans le café de la jeunesse perdue (sans doute le plus abouti des Modiano), et L'horizon. Avec ça, je vous mets L'herbe des nuits, ainsi que Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier (le petit dernier, d'une tendresse extrême, qui fait forcément un carton en librairie), et je vous sers aussi Une jeunesse -Allez! Vous
Romans, de Patrick Modiano est le Quarto (Gallimard) qu'il faut avoir chez soi, car il rassemble le meilleur de notre nouveau Nobel : Villa triste, Livret de famille, Rue des boutiques obscures (son Goncourt), Remise de peine, Chien de printemps, Dora Bruder (inoubliable livre!), Accident nocturne, Un pedigree (à nos yeux le plus touchant, car peut-être le plus vrai de ses livres), Dans le café de la jeunesse perdue (sans doute le plus abouti des Modiano), et L'horizon. Avec ça, je vous mets L'herbe des nuits, ainsi que Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier (le petit dernier, d'une tendresse extrême, qui fait forcément un carton en librairie), et je vous sers aussi Une jeunesse -Allez! Vous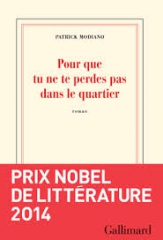 tenez là l'oeuvre d'un homme humble, qui s'exprime aussi mal à l'oral qu'il excelle, à l'écrit, à nous (re)dire le Paris des années noires de l'Occupation - et pas seulement. Le Quarto, Romans est par ailleurs enrichi d'un cahier de photos tirées des archives personnelles de l'auteur, qui en disent plus long qu'une biographie. Intime et pudique à la fois, comme Modiano lui-même.
tenez là l'oeuvre d'un homme humble, qui s'exprime aussi mal à l'oral qu'il excelle, à l'écrit, à nous (re)dire le Paris des années noires de l'Occupation - et pas seulement. Le Quarto, Romans est par ailleurs enrichi d'un cahier de photos tirées des archives personnelles de l'auteur, qui en disent plus long qu'une biographie. Intime et pudique à la fois, comme Modiano lui-même.
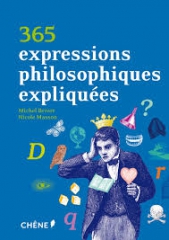 Je me suis régalé à feuilleter, à m'arrêter ici ou là selon l'humeur, au fil des pages, de 365 expressions philosophiques expliquées, de Michel Brivot et Nicole Masson (Chêne), car c'est un rappel salutaire et ludique qui nous est fait, à partir de citations célèbres, assorties de leur explication simple, de leur contexte et de quelques mots sur leur auteur. C'est donc pédagogique, à glisser dans le sac à dos des ados, tiens! Afin qu'ils lâchent un instant leur outils 2.0 pour se pencher sur des pistes de réflexions bien connues, comme On ne naît pas femme, on le devient (Beauvoir), L'enfer, c'est les autres (Sartre), Rien n'est beau que le vrai : le vrai seul est aimable (Boileau), Ce qui est animal devient humain, ce qui est humain devient animal (Marx), etc. Ca ne peut pas faire de mal.
Je me suis régalé à feuilleter, à m'arrêter ici ou là selon l'humeur, au fil des pages, de 365 expressions philosophiques expliquées, de Michel Brivot et Nicole Masson (Chêne), car c'est un rappel salutaire et ludique qui nous est fait, à partir de citations célèbres, assorties de leur explication simple, de leur contexte et de quelques mots sur leur auteur. C'est donc pédagogique, à glisser dans le sac à dos des ados, tiens! Afin qu'ils lâchent un instant leur outils 2.0 pour se pencher sur des pistes de réflexions bien connues, comme On ne naît pas femme, on le devient (Beauvoir), L'enfer, c'est les autres (Sartre), Rien n'est beau que le vrai : le vrai seul est aimable (Boileau), Ce qui est animal devient humain, ce qui est humain devient animal (Marx), etc. Ca ne peut pas faire de mal.
Chez le même éditeur (Chêne), paraît un petit monument éditorial que tout amateur de plantes doit posséder, car c'est une somme, signée d'un grand spécialiste, Jean-Marie Pelt, que c'est admirablement bien illustré de planches botaniques et de chromo anciens. Cela s'appelle Les Plantes qui guérissent, qui nourrissent, qui décorent (les trois parties de ce gros ouvrage). Un album de longue garde, comme on le dit de certains grands crus.
de plantes doit posséder, car c'est une somme, signée d'un grand spécialiste, Jean-Marie Pelt, que c'est admirablement bien illustré de planches botaniques et de chromo anciens. Cela s'appelle Les Plantes qui guérissent, qui nourrissent, qui décorent (les trois parties de ce gros ouvrage). Un album de longue garde, comme on le dit de certains grands crus.
Un mot, enfin, pour évoquer Encore des nouilles, recueil des  chroniques culinaires loufoques que le très regretté Pierre Desproges donna à Cuisine & Vins de France, de septembre 1984 à novembre 1985 (on s'en souvient bien!). C'est publié par Les Echappés, et c'est hilarant de la première à la dernière ligne On en pleure de bonheur en lisant, c'est du grand Desproges. Un grand régal. A table!
chroniques culinaires loufoques que le très regretté Pierre Desproges donna à Cuisine & Vins de France, de septembre 1984 à novembre 1985 (on s'en souvient bien!). C'est publié par Les Echappés, et c'est hilarant de la première à la dernière ligne On en pleure de bonheur en lisant, c'est du grand Desproges. Un grand régal. A table!
Ecouter : Cat Power : The Greatest
C'est un livre de photos signées Cyrille Vidal, avec des textes d'Alain Dubos et de ma pomme, publié aux éditions Passiflore (*). Commandez-le si vous aimez la poésie des matins de partage en forêt landaise, lorsque le beau souci qui anime les amoureux des oiseaux (les palombes, en l'occurrence), est juste de les jouer, de les convaincre de se poser -d'abord sur les arbres, puis de descendre au sol- en les séduisant à la voix (en roucoulant) et en jouant des appeaux (ah, les traîtres!), puis de les prendre au filet, et après de les relâcher, et de ne jamais leur tirer dessus, comme dans certaines palombières qui tiennent aussi du restaurant de campagne et du havre de l'amitié...
(*) Cliquez sur le C
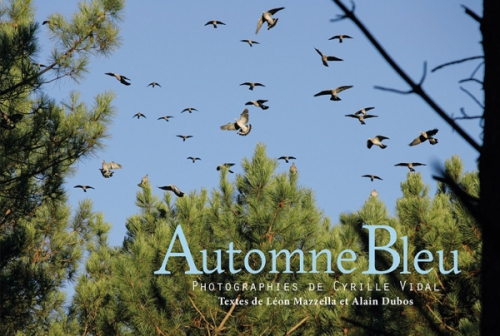
Papier paru dans un numéro spécial de L'EXPANSION et L'EXPRESS les 1er et 15 octobre :
 Qu’y a-t-il de commun entre un Américain sirotant son café très allongé dans un mug en carton au volant de sa voiture et un Italien dégustant son espresso stretto à la terrasse d’un café célèbre ? Pas grand chose, sinon que l’un comme l’autre obéissent à leur culture en dégustant chacun à sa manière sa boisson favorite.
Qu’y a-t-il de commun entre un Américain sirotant son café très allongé dans un mug en carton au volant de sa voiture et un Italien dégustant son espresso stretto à la terrasse d’un café célèbre ? Pas grand chose, sinon que l’un comme l’autre obéissent à leur culture en dégustant chacun à sa manière sa boisson favorite.
Par Léon Mazzella
------
Les modes de consommation de la « cerise » torréfiée varient considérablement d‘une culture à l’autre. Ainsi, du souci extrême apporté à la qualité d’un café serré (stretto), généralement désigné par le mot espresso, dans le moindre bar d’Italie, car chaque habitant de la Botte a le souci de la larme de café concentré qui emplit chacune des tasses qu’il déguste. Le café qui est servi dans le saint de saints, au Gran Caffè Gambrinus, Via Chiaia à Naples, est une institution. Littéraire, il était assidûment fréquenté par Gabriele d’Annunzio, puis par Benedetto Croce, et quantité d’intellectuels, journalistes et hommes politiques de Campanie et au-delà. Le café espresso qui y est servi est tout simplement divin, comme l’apprécierait le producteur italien du film en train de se faire (scène culte), dans « Mulholland Drive », de David Lynch, et qui ne trouve jamais un café digne de ce nom à sa convenance, lorsqu’il se rend à des réunions de travail à Hollywood. On ne plaisante jamais avec la qualité d’un espresso, du Trentin-Haut-Adige à la Calabre.
Cafés italiens mythiques
Et au Gambrinus, même si l’on est pas gourmand, il convient d’accompagner son caffè (de toute façon stretto) d’une sfogliatella, cette pâtisserie napolitaine en forme de coquillage équivoque (lire page 28). Boire un café en Italie est souvent associé à un lieu public. Parmi les cafés célèbres où cette boisson possède toutes les qualités requises pour satisfaire les palais amateurs de nectar un rien amer avec ce je –ne-sais-quoi de délicat contenu dans la mousse qui recouvre un liquide puissant et rond à la fois, le mythique Florian, à Venise, est de ces hauts-lieux-là. À l’instar du Gilli à Florence, du Camparino à Milan, du Fiorio à Turin, du Mangini à Gênes, du Greco à Rome, ou encore du Tasso à Bergame, tous célèbrent et subliment la simple tasse de « caffé » en accordant un soin constant à sa préparation ainsi qu’à son service, et transforment depuis quatre siècles le café en œuvre d’art gourmet. N’oublions pas que c’est à Venise que le café apparaît en Europe, en 1604. Henry James en parle dans « Venice », ainsi que dans « Les Papiers d’Aspern », non sans rappeler que la Sérénissime fut une plate-forme du commerce international du café dès le XVIIe siècle. Le Florian était alors une des nombreuses boutiques de café de la cité. Mais il acquiert sa réputation grâce, encore, aux nombreux écrivains et artistes de tous horizons qui y tiennent salon, s’y prélassent et sacrifient à l’addiction mesurée de la boisson venue d’Orient. C’est Floriano Francesconi qui ouvrit le Florian en 1720. Goethe, Byron, Stendhal, Constant, Sand, Mme de Staël, Musset, Gautier, Pound… De Casanova à Philippe Sollers, la littérature mondiale est passée, passe et passera encore par le Florian pour y déguster un café en terrasse ou dans l’un de ses salons alcôves.
Chez lui, l’Italien affectionne particulièrement l’élaboration de son nectar favori avec une cafetière moka express, à pression, dite « napolitaine », de type Bialetti – du nom de son inventeur (bien que ce soit un Français nommé Bernard Rahaud qui soit à l’origine du principe, en 1822). Cette petite machine en aluminium, appelée justement la macchinetta, ou bien la caffettiera, est devenue le symbole du café italien, concentré, puissant, servi très chaud, toujours fait à l’instant et jamais réchauffé.
La grolla valdôtaine
Certes, il existe des particularismes, dans la Botte comme partout ailleurs. Ainsi du Val d’Aoste, dans le nord de l’Italie, où une coutume veut que l’on boive le café de manière communautaire, conviviale, dans la « grolla » (l’équivalent de la grolle savoyarde), qui est une sorte de « coupe de l’amitié » en terre cuite, percée de plusieurs trous (on parle de grolla à quatre, six, huit, voire dix becs) afin de permettre à plusieurs convives de boire, en partage, au même récipient. Le café qui y est introduit est généralement fort (cela va sans dire en Italie) et très sucré. On peut y ajouter de la grappa, l’alcool blanc italien par excellence, ainsi que des écorces d’agrumes (oranges, citrons) : cela devient le café « à la valdôtaine » (du Val d’Aoste), et ce rituel, soulignent les observateurs, n’est pas sans rappeler celui du Saint-Graal.
L’Italie a son propre café au lait (chauffé à la vapeur, celui-ci devient mousseux) : le cappuccino, que l’on saupoudre de chocolat amer. Il ne faut pas confondre le cappuccino avec le café con nata (à la crème), ou avec le macchiato (tacheté), qui est un espresso à la mousse de lait chaud fouetté. Additionné de chantilly, le café devient viennois.
En Vénétie, le café est parfois servi additionné d’une goutte d’amaretto (liqueur d’amande). Cette façon de l’enrichir –les puristes disent de le dénaturer - , se retrouve en Espagne, où il est d’usage d’ajouter une goutte d’anisette dans son café. Cela s’appelle le « carajillo » (prononcez la « jota »). C’est l’équivalent, en quelque sorte, de notre café-calva, appelé aussi « café normal » dans certains bars de Normandie ayant érigé la défense de leur alcool régional, le Calvados, en militantisme provocateur…
Mugs pour light allongés
L’Américain ordinaire (Hemingway, par exemple, buvait surtout des litres de Bloody Mary à Venise), préfère le café allongé, extrêmement léger et servi dans des mugs en plastique ou bien cartonnés, refermés afin de garder la chaleur de la boisson, aux stretto et autres espressos italiens. Les Américains sont les premiers consommateurs de café au monde. Ils n’apprécient guère les cafés parfumés et encore moins les cafés fortement torréfiés. Ainsi font-ils leur choix judicieusement chez les deux géants de l’industrie du café que sont Starbucks et Peet’s, nés sur la côte ouest et qui ont conquis le monde. Starbucks propose aujourd’hui quantités de cafés pour tous les goûts, du « jus de chaussette » vilipendé par l’Italien au serré propre à écoeurer le Texan. L’Américain ordinaire apprécie par conséquent le café peu torréfié, faible en goût, auquel il ajoute volontiers un nuage de crème. Ce sont ses habitudes de consommation qui l’obligent à doser faiblement son café. En effet, lorsqu’on boit à toute heure du jour, au travail, en se déplaçant ou bien devant sa télévision, un soda ou un café, il vaut mieux que ce dernier soit allongé. Notons que certaines sectes, comme celle des Mormons, interdisent la consommation du café, au nom de principes religieux fondés sur la santé totale du corps, considéré comme un don précieux de Dieu.
Cardamome ou cannelle
Au Yémen, berceau de la culture du café, il est d’usage d’accomplir un petit cérémonial appelé « gawha » dans la préparation du breuvage. Celui-ci est appelé « qisr » et il est réalisé à partir des cerises (avec leur péricarpe) séchées ou grillées. Celui qui prépare le café pour le groupe doit tout réaliser seul, de la torréfaction au service en passant par le pilage au mortier. Additionné d’eau, la boisson est chauffée sur des braises dans une sorte de pot long et étroit faisant office de cafetière, en cuivre, parfois en bronze, à long manche, appelé « ibrik » en Turquie, et volontiers additionné de sucre, mais surtout de quelques graines de cardamome écrasées entre deux doigts –une graine par tasse suffit -, ou bien d’un morceau de cannelle, ou encore d’un peu de gingembre. Les Yéménites consomment également le thé en y ajoutant des épices. Lorsqu’ils ne le dégustent pas dans un café, les hommes le préparent ainsi n’importe où, au bord d’un chemin, dans les champs, dans la rue. De même qu’ils sacrifient quotidiennement – en général après le déjeuner – au rite du qât, cette plante légèrement hallucinogène qui les transporte, les hommes accordent une importance particulière au rituel du café – qui est, rappelons-le, un psychotrope -; soulignant ainsi leur fierté quant à la paternité de la culture de la petite graine.
« A la turque »
Le café « à la sultane » ou « à la turque » correspond à une façon de préparer le café, originelle et brute : la coque de la graine est plongée dans l’eau seule ou bien avec la « bunn » (la baie) brûlée et réduite en poudre, nous dit Annie Perrier-Robert (« Le café », Solar), puis le mélange est porté à ébullition. L’eau se charge ainsi d’un marc qui n’est pas du goût de chacun. En effet, le café à la turque n’est pas filtré, et les Européens répugnent à boire et manger en même temps leur café. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le café viennois connut un succès fulgurant, dès lors que son inventeur, le Polonais Franz Georg Kolschitzky, eut l’idée (dans les années 1683) de filtrer sa préparation « à la sultane » et d’y ajouter du sucre (puis de la crème fouettée), ce à partir du café récupéré dans des sacs abandonnés par les Turcs ayant assiégé la capitale autrichienne (lire page 6). Si l’on emploie que la coque, le café (turc) se nomme « qichariya » (qichra signifie écorce), et si l’on fait usage du grain avec la coque, on le nomme « bunniya ». L’amertume doit être de toute façon bien présente pour que le café soit digne d’être servi. Les Turcs ajoutent traditionnellement à leur café des clous de girofle, ou de la cardamome comme au Yémen, parfois de l’essence d’ambre ou de l’anis des Indes. Notons que l’Orient possède les secrets de l’hospitalité : le cérémonial du café revêt aujourd’hui encore des atours précieux et sérieux. L’art de recevoir et de contenter son hôte sont des valeurs extrêmes dans l’ensemble du Moyen-Orient. Le moment du café a même valeur de « grand examen », précise Anne Perrier-Robert, pour la jeune fille à marier. Ses « bonnes manières » sont alors jugées, ainsi que son savoir-faire : par exemple, le café turc (dûment sucré) doit impérativement être porté à ébullition à deux reprises avant d’être prêt, ceci après un repos de une à deux minutes. Au moment de le servir, il convient de déposer un peu de la mousse qui surnage, dans chaque tasse, puis de servir le café, et enfin de jeter quelques gouttes d’eau froide afin de précipiter le marc au fond des tasses. Après quoi, la jeune fille sera jugée bonne à marier. Ou non. L’affaire est on ne peut plus sérieuse, dans les contrées maternelles d’une boisson devenue universelle et qui est consommée par un être humain sur trois. Un proverbe éthiopien énonce clairement : « Buna dabo naw » : le café est notre pain.
Cafés Viennois
Sait-on que l’Allemagne est le deuxième importateur et le deuxième consommateur mondial de café ? D’aucuns jureraient que l’Italie, ou la France, tiennent cette position. Or, la consommation de café a explosé ces quarante dernières années outre-Rhin, les cafés à tendance acide s’y taillent la part du lion, loin devant les cafés solubles, qui connaissent un succès ailleurs, mais que l’Allemand juge dépourvus de qualités organoleptiques suffisantes.
L’Autriche est indissociable du café viennois, à la crème fouettée (voire à la chantilly) et des légendaires cafés de la capitale, que l’on dit littéraires car nombre d’écrivains les fréquentent assidûment depuis l’époque splendide de l’empire austro-hongrois. À l’aube du XXe siècle, Stefan Zweig est de ces auteurs cultes qui écrivent dans les cafés de la ville de Freud, son ami. Il se rend fréquemment aux cafés Beethoven, Reyl et Rathaus pour y déguster son breuvage favori, avec ou sans crème d’ailleurs. L’une de ses nombreuses nouvelles, figurant dans le recueil intitulé « La Peur », met en scène un café viennois, le café Gluck, et un érudit singulier, « Le Bouquiniste Mendel » Atmosphère : « À Vienne, un café vous attend à chaque coin de rue. (…) Dans mon oisiveté, je commençais déjà à m’abandonner à la molle passivité qui émane subrepticement de chaque véritable café viennois. (…) J’observais la demoiselle de la caisse, qui distribuait mécaniquement aux garçons le sucre et les cuillères pour chaque tasse de café… ».
Irish coffee
Si le Lapon a pour coutume d’additionner de la graisse de renne à son café et de ne jamais le sucrer, le Russe, lui, y ajoute volontiers une rondelle de citron comme nous le faisons dans l’eau pétillante. Le Grec le boit frappé, et il a largement contribué au succès d’une boisson estivale, le café glacé (avec ou sans lait). L’Irlandais préfère adjoindre à son café du whiskey (avec un « e » pour le distinguer du Scotch whisky). C’est dans son roman irlandais, « Un Taxi mauve », que Michel Déon décrit la préparation minutieuse, par « une tenancière et avec un soin jaloux » de l’Irish coffee : « …Verres à pied chaud, sucre bien fondu dans le whiskey brûlant, café d’encre et faux col de crème glacée. Une jeune fille aux joues rosies, fraîche comme Mollie Malone, nous les apporta avec des grâces d’équilibriste, sans qu’une goutte de crème troublât le café. » Les Anglais, enfin, grands buveurs de thé devant l’éternel, négligent le café authentique, au point de lui préférer le café soluble, jugé indigne par tout amateur qui se respecte. Le chansonnier à l’humour caustique Pierre-Jean Vaillard dit : « Je sais maintenant pourquoi les Anglais préfèrent le thé : je viens de goûter leur café ». Ce qui n’empêche évidemment pas de nombreux aficionados de l’espresso et citoyens de Sa Majesté, de fréquenter les bars londoniens dédiés au culte de cette boisson incomparable ; lorsqu’elle est élaborée « à l’italienne ». L.M.
--------
ORIENTALISMES
Gérard de Nerval, dans son « Voyage en Orient », effectué en 1843, est saisi par l’atmosphère des cafés du Caire, où il découvre la danse du ventre et surtout la « liqueur ambrée » - ainsi nomme-t-il poétiquement le café -, dont il se délecte. « Le kahwedji {qui a la charge de préparer le café} sait bien qu’il faut sucrer la tasse, et la compagnie sourit de cette bizarre préparation. (…) Le foyer est toujours garni d’une multitude de petites cafetières de cuivre rouge, car il faut faire bouillir une cafetière pour chacune de ces fines-janes {pour « findjân » : petite tasse à café} grandes comme des coquetiers. »
Le poète Constantin Cavafy hante les cafés populaires d’Alexandrie, sa ville, au début du XXe siècle, et il puise l’inspiration dans ces lieux mal famés, peuplés de petites gens qui boivent des cafés jusqu’au bout de la nuit.
C’est à Istanbul (où un café porte son nom : « Le Piyer Loti », dans le quartier d’Eyoub), que Pierre Loti goûte aux charmes lascifs de l’amour. « Aziyadé », son roman oriental, évoque ces cafés où des conteurs se livrent à des récits captivants, tandis que les clients fument le narguilé et consomment force cafés : « … S’arrêter à tous les cafedjis. (…) Boire le café de Turquie dans les microscopiques tasses bleues à pied de cuivre. (…) On m’apporte mon narguilé et ma tasse de café turc, qu’un enfant est chargé de renouveler tous les quarts d’heure… » L.M.
Papier paru dans le hors-série de L'EXPRESS, actuellement en kiosque, consacré aux Pieds-Noirs (rédaction en chef : Philippe Bidalon et Léon Mazzella) :

La littérature pied-noire naît avec Camus, mais le maître a engendré et continue d'engendrer pléthore de bons auteurs pieds-noirs.
Par Léon Mazzella
La littérature pied-noire – de qualité- naît au milieu des années trente avec les premiers textes d’Albert Camus, comme « L’Envers et l’endroit », et « Noces », publiés par Edmond Charlot. Cet éditeur libraire algérois fit beaucoup pour cette littérature naissante, avec son confrère Baconnier (auquel on associe le nom de Charles Brouty, illustrateur célèbre), et qui publia notamment « Jeunes saisons » d’Emmanuel Roblès, ainsi que des textes algériens capitaux, comme « Jours de Kabylie », de Mouloud Feraoun. Les auteurs phares de cette pépinière furent regroupés autour de « L’Ecole d’Alger » avec Charlot pour éditeur, et comptait, aux côtés d’Albert Camus, Emmanuel Roblès, Jules Roy, le philosophe Jean Grenier, le romancier René-Jean Clot ou encore le poète Max-Pol Fouchet. Ainsi que Gabriel Audisio et Jean Sénac.
Donc, Camus. Avec « Noces », « L’Eté », « La Peste », « L’Etranger », « Le Premier homme »… L’ombre tutélaire du Nobel 1957 plane sur la littérature pied-noire comme celle d'un mancenillier. Sa génération connut de grandes plumes. Il n'est qu'à citer Jules Roy (1907-2000), dont la précieuse saga « Les Chevaux du soleil » (Omnibus), ainsi qu’un livre devenu un classique, « La Guerre d’Algérie» (Bourgois), demeurent des ouvrages majeurs, sans concession le second, et inaltérables. Emmanuel Roblès (1914-1995), qui fit tant pour les écrivains pieds-noirs et algériens aussi en qualité d’éditeur au Seuil, dépeint, entre autres dans « Les Hauteurs de la ville » et dans « Jeunes saisons » (Seuil), le petit peuple d’Oran avec une immense tendresse que l’on retrouvera plus tard dans les romans de Louis Gardel. Algérois comme Camus, habité par Jules Roy, vivant à Paris, ce romancier puissant et délicat, éditeur au Seuil lui aussi, auteur du célèbre « Fort Saganne », traverse son œuvre au fil de l’Algérie. Et ce, depuis « L’Eté fracassé » jusqu’à « La Baie d’Alger » et « Le Scénariste », en passant par « Couteau de chaleur », « Notre homme », ou encore « Dar Baroud » (Seuil). Tous disent l’Algérie heureuse avec justesse, et aucun des personnages ne gémit jamais sur le paradis perdu ; ce qui est salutaire. Une autre voix précieuse est celle de Frédéric Musso, romancier de talent, poète concis et biographe avisé de Camus, dont il faut tout lire, notamment « Martin est aux Afriques » et « L’Algérie des souvenirs » (La Table ronde).
Romanciers sans pathos
Et puis, il y a tant d'auteurs. Pêle-mêle : Jean Pélégri, et « Les Oliviers de la justice », « Le Maboul » (Gallimard), et un livre-testament bouleversant : « Ma Mère, l’Algérie » (Actes Sud). Jean-Pierre Millecam, auteur du sensible « Et je vis un cheval pâle » (Gallimard). Annie Cohen et le si tendre « Marabout de Blida » (Actes Sud), Assia Djebar pour la violence salutaire de « Oran, langue morte » (Actes Sud). Il y a de la « nostalgérie » soft chez Marie Elbe, et « A l’heure de notre mort » (Albin Michel), chez Janine Montupet, « La Fontaine rouge » (R.Laffont), et chez Marie Cardinal, « Les Pieds-Noirs » (Place Furstemberg). Ainsi qu'avec Norbert Régina, qui fut secrétaire général de la rédaction de L’Express jusqu’en 1987, et l’auteur d’une trilogie romanesque : « Ils croyaient à l’éternité », « La Femme immobile », « Les crépuscules d’Alger » (Flammarion). Dans « L’homme à la mer » (Orban) de Jacques Fieschi aussi. Citons encore Roland Bacri, disparu en mai dernier, qui fut « Le Petit Poète » du « Canard enchaîné » et l’auteur du « Roro », un dictionnaire pataouète qui ne prétendait pas donner le change au (Petit) Robert, car Paul Robert, l’auteur du dictionnaire éponyme, était lui aussi Pied-Noir ! Mention spéciale pour l’absence totale de pathos à deux livres parus récemment : « Trois jours à Oran », formidable roman d'un retour au lieu d'origine signé Anne Plantagenet (Stock), et au vibrant « Le Glacis », de Monique Rivet (Métailié). Sans oublier les Morgan Sportès, romancier né à Alger, Hélène Cixous, Oranaise et grande féministe, auteurs qualifié abusivement de pied-noir, car leur oeuvre n'évoque pas l'Algérie. Il y a par ailleurs le délicat Alain Vircondelet, Algérois et "durassien", l'éditeur né à Mascara Jean-Paul Enthoven, et même le grand Robert Merle! Enfin, last but not least, l'Algérois et "camusien" Jacques Ferrandez dans le domaine de la BD littéraire imprégnée par l'histoire de la présence française en Algérie.
Philosophes de grand renom
La philosophie n’est pas non plus en reste, avec des noms aussi prestigieux que celui de Jacques Derrida (1930-2004), d’abord. Le théoricien de la déconstruction naît à El Biar en 1930 dans une famille juive, et il restera en Algérie jusqu’en 1949, puis il y retourne pour effectuer son service militaire de 1957 à 1959, soit en pleine guerre. Il y retournera encore dans les années 70 pour y donner des conférences. Sa postface à « Les Français d’Algérie », de l’historien Pierre Nora (Bourgois), inédite jusqu'en 2012, est un bijou de 50 pages à l’adresse de son ami, auquel il reproche fermement d’être injuste à l’égard des Pieds-Noirs. Collègue de Derrida à Normale Sup’, le philosophe marxiste Louis Althusser (1918-1990) est également d’origine pied-noire, puisque issu d’une famille alsacienne installée au sud d’Alger, à Birmandreis. Le très médiatique Bernard-Henry Lévy, est né en 1948 à Béni-Saf. Son arrière grand-père maternel fut le rabbin de Tlemcen. BHL a quitté l’Algérie avec sa famille pour Neuilly-sur-Seine en 1954. Notons que Derrida et Althusser furent ses professeurs, rue d’Ulm. « Le plus beau décolleté de Paris » (Angelo Rinaldi dans L'Expres) a déclaré en 2012 que l’Algérie n’était « ni un pays arabe ni un pays islamique, mais un pays juif et français, sur un plan culturel »… Parmi les écrivains journalistes célèbres, citons rapidement Jean Daniel (Le Nouvel Observateur, qui fit ses armes à L'Express, où il couvrit la guerre d'Algérie). Et Jean-Claude Guillebaud, essayiste et grand reporter, né en Algérie d’un père charentais et d’une mère pied-noire. Il a grandi dans le Sud-Ouest dès l’âge de trois ans. Journaliste, il refusa obstinément d’y retourner pour ne pas raviver ce qu’il nomme « une dislocation originelle ». Jusqu’en décembre 2011, parce que « l’heure était venue » de retrouver l’autre partie de lui-même devant la Baie d’Alger... L.M.
-----------
GRANDES VOIX ALGÉRIENNES
Il est impossible de dissocier les grandes voix de la littérature algérienne des années Camus à nos jours, de la littérature dite pied-noire. Parmi celles-ci et dès avant Yasmina Khadra dont l’œuvre rencontre un succès revigorant, nous trouvons Mouloud Feraoun, ses « Jours de Kabylie », et « Le Fils du pauvre » (Seuil). Feraoun n’a pas cinquante ans lorsqu’il est assassiné le 15 mars 1962 à Alger par l’OAS .
Il y a Jean Amrouche et « L’éternelle Jugurtha » (L’Arche), qui eut ce mot : « L’Algérie est l’esprit de mon âme. La France l’âme de mon esprit ». Mouloud Mammeri pour « La Colline oubliée » (Seuil). Mohamed Dib le tlemcénien, qui collabora au quotidien progressiste « Alger Républicain » avec Kateb Yacine, auteur de l’inoubliable « Nedjma » (Seuil). Dib signa notamment « Un été africain » (Seuil), dans les pages duquel il nomme toujours les « événement » que l’on appellera officiellement « Guerre » qu’en 1999, par le lapidaire vocable : « ça ». Mohammed Dib est aussi l’auteur d’une trilogie, « Algérie » : « La Grande maison », « L’Incendie », et « Le Métier à tisser » (Seui) qui paraissent au moment des années de braise d’une guerre sans nom et décrivent une terre rurale, pauvre, simple, quotidienne, aux dimensions ethnographiques précieuses. Il y a également Rachid Mimouni et son « Fleuve détourné » (Stock), Tahar Djaout, assassiné en 1993 (« Les Vigiles », Seuil), et plus tard Rachid Boudjedra et son puissant roman « La Répudiation » (Denoël). Citons enfin Leïla Sebbar, romancière et pilote, notamment, d’une admirable anthologie intitulée « Une enfance algérienne » (Gallimard), et Malika Mokeddem, pour son touchant roman « L’Interdite » (Grasset). L.M.

C'est un papier qui paraît dans un n° spécial de L'EXPRESS et de L'EXPANSION, consacré à la petite graine.
LE CARBURANT DES CRÉATEURS
Par Léon Mazzella
Les écrivains en font parfois une consommation effrénée, car le café, « torréfiant intérieur », selon Balzac, maintient éveillé et stimule la création.
----
Balzac est un cas. L’auteur de La Comédie humaine, gigantesque « peinture de la société » en plus de 90 ouvrages, qualifie le café de « torréfiant intérieur », dans son « Traité des excitants modernes ». Il note que le café ouvre l’esprit, en donne à ceux qui en manquent mais rend encore plus ennuyeux ceux qui nous ennuient… Citant le prince des gastronomes, Brillat-Savarin, l’auteur du « Père Goriot » confirme que « le café met en mouvement le sang, en fait jaillir les esprits moteurs ; excitation qui précipite la digestion, chasse le sommeil, et permet d’entretenir pendant un peu plus longtemps les facultés cérébrales ». Balzac lui-même sait gré au café de lui permettre d’écrire, de produire tant et plus. L’auteur pantagruélique alterne les ripailles les plus rabelaisiennes avec l’abstinence la plus monacale, mais sacrifie quotidiennement à l’absorption de son carburant préféré. Il possède plusieurs cafetières fétiches, dont une en argent, dite à la Chaptal. Mais c’est celle en porcelaine de Limoges, avec ses initiales sur la couronne qui lui permet de maintenir son breuvage au chaud, et que l’on peut encore voir à la Maison de Balzac, musée sis rue Raynouard à Paris, qui ne quitte jamais sa table de travail. Il prépare lui-même sa drogue douce. Il s’agit d’un mélange de Moka auquel il ajoute du café de la Martinique et du café Bourbon. Le romancier prolifique les achète de préférence chez l’épicier Bonnemains, place Saint-Michel. Il y sacrifie une part non négligeable de ses dépenses, au moins dix fois plus que pour l’achat du pain. Son petit secret réside dans l’ajout d’une pincée de sel afin de développer les arômes d’un élixir qu’il prend soin de faire couler très lentement. Comme il ne fume pas – il déteste même le tabac-, ne boit guère (sauf lors de gueuletons), il abuse de son unique péché mignon, mais comme le café a partie liée avec l’encre, l’abus l’excuse. Les deux liquides noirs sont les mamelles de sa création.
« Dès lors, tout s’agite »
« Le café tombe dans votre estomac (…) Dès lors, tout s’agite : les idées s’ébranlent comme les bataillons de la Grande Armée sur le terrain d’une bataille », écrit-il, « et la bataille a lieu. Les souvenirs arrivent au pas de charge, enseignes déployées : la cavalerie légère des comparaisons se développe par un magnifique galop ; l’artillerie de la logique arrive avec son train et ses gargousses ; les traits d’esprit arrivent en tirailleurs ; les figures se dressent, le papier se couvre d’encre, car la veille commence et finit par des torrents d’eau noire, comme la bataille par sa poudre noire. » Et c’est ainsi, grâce à quantité de tasses dégustées, à des litres de café avalées jour et nuit – Balzac écrit beaucoup du crépuscule à l’aube-, que ses romans avancent, à l’instar d’une armée en ordre de marche et qui ne peut, dès lors, connaître la déroute. « L’état où vous met le café pris à jeun », écrit-il encore, « dans les conditions magistrales, produit une sorte de vivacité nerveuse qui ressemble à celle de la colère. Le verbe s’élève, les gestes expriment une impatience maladive ; on veut que tout aille comme trottent les idées ; on est braque, rageur pour des riens ; on arrive à ce variable caractère du poète tant accusé par les épiciers ; on prête à autrui la lucidité dont on jouit. » Balzac déteste l’idée même d’ajouter du lait dans le café, comme d’autres n’imaginent même pas l’adjonction d’une goutte d’eau dans leur vin – au propre comme au figuré. Il a même des mots peu caressants à l’adresse des amateurs : « Offrir du café au lait, ce n’est pas une faute, c’est un ridicule. Il n’y a plus que les portières qui prennent cette mixture populacière, laquelle attriste la fibre, charge l’estomac de saburres pernicieuses et débilite le système nerveux ». Balzac est un puriste. Il lui faut du solide, du pur, du dur, du coup de fouet. Il pense que « le fluide nerveux est le conducteur de l’électricité que dégage cette substance {le café} », que son pouvoir n’est ni constant ni absolu. Conforté en cela par Rossini : « Le café, m’a-t-il dit, est une affaire de quinze ou vingt jours ; le temps fort heureusement de faire un opéra. Le fait est vrai. Mais le temps pendant lequel on jouit des bienfaits du café peut s’étendre… » L’œuvre de Balzac le prouve avec superbe, laquelle a donné au roman français ses volumes parmi les plus riches. Comme par hasard ou par un effet de balancier (on aime les chiens ou les chats, rarement les deux à la fois), Balzac n’aime pas du tout le thé. La boisson comme son univers, qu’il ne manque pas de vilipender : « Il donnerait la morale anglaise, les miss au teint blafard, les hypocrisies et les médisances anglaises ; ce qui est certain, c’est qu’il ne gâte pas moins la femme au moral qu’au physique. Là où les femmes boivent du thé, l’amour est vicié dans son principe ; elles sont pâles, maladives, parleuses, ennuyeuses, prêcheuses. » Des propos forts de café… Un café que notre puriste prolifique et expert en « Etudes de mœurs » ne répugnait pas à consommer, à l’occasion, additionné d’un soupçon de crème. Dans « La Femme auteur », nous lisons ceci : « La tasse de café que je prends est exquise, la crème est de la crème envoyée de la ferme que mon oncle Hannequin possède à Bobigny, le café, c’est du vrai moka… ». Une entorse en forme de confession, assortie de précisions de taille : il ne s’agit pas de lait, et la provenance de la crème est un gage de qualité.
Les premiers cafés littéraires
Un autre grand buveur de café est Voltaire, qui passe des heures et des heures au Procope, rue de l’Ancienne-Comédie, dans le quartier de l’Odéon (et où se trouvait jadis la Comédie française). Le Procope, « Café-Glacier depuis 1686 », fut créé par un Sicilien nommé Francesco Procopio Dei Coltelli, qui en fit un débiteur de café et de spiritueux. Pour l’auteur de « Candide », le café est une plante cultivée dans le sud et consommée dans le nord », ce qui n’ est plus vrai aujourd’hui. Voltaire boit du café dans les cafés, et lance sans le vouloir, avec ses amis Encyclopédistes, la mode des bars que l’on appelle dès lors cafés. Confondre ainsi le lieu et l’une des boissons qu’on y propose assure le succès du « petit noir ». Dès avant Sartre et Beauvoir, qui usèrent leur séant sur les banquettes du Flore et les chaises des Deux Magots voisin, boulevard Saint-Germain, les cafés deviennent littéraires au temps de Voltaire. Ce dernier n’était-il pas membre de la confrérie des buveurs de café ? Buveur impénitent – il en boit plusieurs dizaines chaque jour, mais légers ! -, il ne pense pas avec Fontenelle que c’est « un poison lent », mais au contraire un stimulant de l’esprit. Dans « Les Confessions », Rousseau témoigne de cette incroyable appétence de l’auteur de « Zadig » : Il avait la réputation de boire quarante tasses de café chaque jour pour l’aider à rester éveillé pour penser, penser, penser à la manière de lutter contre les tyrans et les imbéciles. »
Flaubert évoque le café dans « Madame Bovary » en des termes qui dénotent le soin particulier apporté à l’élaboration du breuvage : « Mm Homais réapparut, portant une de ces vacillantes machines que l’on chauffe avec de l’esprit-de-vin ; car Homais tenait à faire son café sur la table, l’ayant, d’ailleurs, torréfié lui-même, porphyrisé lui-même, mixtionné lui-même. » Brillat-Savarin souligne l’art de la torréfaction ainsi : « La décoction de café cru est une boisson insignifiante ; mais la carbonisation y développe un arôme, et y forme une huile qui caractérisent le café, tel que nous le prenons, et qui resteraient éternellement inconnus sans l’intervention de la chaleur. »
Boisson à connotation intellectuelle, puisqu’elle développe les capacités créatrices, le café se voit parfois opposer ses vertus à celles du thé. Proust boit quant à lui des quantités impressionnantes d’ « essence de café » – uniquement du Corcellet, acheté dans le XVIIe arrondissement de Paris, élaboré avec une précision maniaque et servi dans une cafetière en argent, cela pour tenir, et continuer de pouvoir écrire sa monumentale « Recherche du temps perdu ». Et aussi afin de calmer ses incessantes crises d’asthme. À Lisbonne, l’immense poète Fernando Pessoa passe des journées au café « A Brasileira », dans le quartier du Chiado, où il possède aujourd’hui sa statue en bronze, et c’est de là qu’il « contemple la vie en frémissant », tout en sirotant « uma bica », terme qui désigne un espresso.
Pénétrer les cerveaux
Cité dans l’anthologie « Le goût du café » (Mercure de France), Paul Morand déclare, non sans ironie : « Par le thé, l’Orient pénètre dans les salons bourgeois, par le café, il pénètre dans les cerveaux. » C’est dans « La Route des Indes » que l’écrivain diplomate retrace avec brio l’histoire de l’arrivée du café à la cour du Roi Soleil, puis sa conquête de l’Europe d’une boisson qui devint vite à la mode, à la cour comme dans la rue. Morand : « Le moka brûlant fait son chemin dans l’estomac et dans les méninges de ces Nordiques lents à penser et les réveille ; les Irlandais cessent d’avoir le monopole de l’esprit ; des idées non suivies d’actes, mais qu’on aime pour leur jeu rapide et gratuit, dansent dans les têtes. » Morand se plaît à souligner l’apport spirituel du café, lequel semble secouer la vieille Europe comme une drogue douce et bienfaisante. « Stupéfiants et excitants sont les deux faces de la déesse », écrit-il encore, « les deux visages par où l’Orient sourit à l’Europe, ou grimace. Le café énerva le classicisme ; le romantisme découvrira bientôt l’autre noir abîme du désespoir humain : en 1797, Coleridge avale, à Malte, des boulettes d’opium. »
C’est dans son « Dictionnaire de cuisine » qu’Alexandre Dumas évoque les bienfaits du café et donne de nombreux conseils comme celui de « ne le moudre qu’au fur et à mesure des besoins, afin qu’il ne puisse perdre son arôme ». Il prétend que « Voltaire et Delisle ont fait abus du café, qui, loin d’être un poison, comme on l’a dit d’abord, est un antidote pour tous les poisons stupéfiants ; il opère rapidement sur l’opium, sur la belladone, etc. Il faut alors le prendre très fort et une cuillerée à café toutes les cinq minutes ». Le père des « Trois Mousquetaires » donne même des recettes, comme celle du café à la crème frappé de glace, à partir d’une infusion de café Moka ou de café Bourbon : « Vous la mettez dans un bol en porcelaine, vous la sucrez convenablement, et vous y ajoutez une égale quantité de lait bouilli ou le tiers d’une crème onctueuse. Vous entourez ensuite le bol de glace pilée. »
Enfin, Karen Blixen, dans son inoubliable « Ferme africaine », raconte son quotidien d’exploitante d’une plantation de café arabica située à près de 2000 mètres d’altitude, au Kenya, mais en revanche, elle n’abuse pas de sa consommation comme la plupart de ses frères et sœurs de plume. L.M.
-------
Musiciens et peintres
Les musiciens ne sont pas en reste. Jean-Sébastien Bach dédie au café une cantate profane, la « Cantate du café » BWV 211, pour flûte traversière, violons, timbales et voix (ténor, basse, soprano), tant il aimait ce breuvage. Il s’agit d’une sorte de mini opéra comique ayant l’addiction au café pour sujet, qui était un réel problème dans le Liepzig du XVIIIè siècle. Le dramaturge italien Carlo Goldoni consacre à sa boisson favorite une comédie de moeurs, « La Bottega del caffé ». Les artistes, compositeurs et peintres, ont eux aussi vite compris que la caféine chassait la somnolence et favorisait la création. Ludwig Van Beethoven en boit plusieurs tasses chaque matin, à raison de 60 grains scrupuleusement comptés un à un pour chaque tasse. Plus près de nous, et entre autres compositeurs et interprètes, Gustav Mahler et Glenn Gould sont célèbres pour en faire leur combustible mental fétiche.
Quant aux peintres, s’ils en consomment depuis toujours, ils peignent à l’occasion la boisson et son service. Ainsi, de Cézanne et sa célèbre « Femme à la cafetière », ou de Manet et du non moins célèbre « Déjeuner dans l’atelier », ou encore le « Café arabe » d’Eugène Girardet, entre autres tableaux qui font du café un sujet qui n’est pas de nature morte. Mais vive. L.M.
Papier paru hier dans L'EXPRESS de cette semaine :

Charles MacLean, maître du malt
Par Léon Mazzella
Le droit mène à tout… Même au whisky. Charles MacLean, pantalon écossais, moustache blonde soignée, regard vif, en est la preuve vivante : cet éphémère avocat, né en 1951 à Glasgow et vivant à Edimburg, a troqué sa robe pour les habits de globe-trotter au service sa majesté le malt. Depuis, il parcourt le monde animer des Master Class pour le compte de diverses marques de whisky. Une passion née dans l’adolescence. A 16 ans, Charles se lie d’amitié Charly Grant, le fils du propriétaire de la distillerie The Glenlivet. Par atavisme et en plein cœur de la région du Speyside, Charly initie naturellement son pote Charles à la dégustation d’une eau de feu que ce dernier juge d’abord imbuvable, puis agréable, intéressante, complexe, intrigante. « Le whisky n’est pas franchement un easy drink », confie-t-il encore aujourd’hui. Désormais piqué au malt, il écrit des textes sur sa boisson favorite pour des agences de communication. Vite repéré pour la sincérité de ses articles sur l’élaboration, l’art de la dégustation et l’histoire du whisky, il travaille pour quantité de marques. En 1988, Charles rédige son premier livre, The Pocket guide of Scotch Whisky. Sa voie est tracée, on s’arrache désormais ses commentaires. Il entame alors une carrière de conseiller, anime des ateliers de dégustation en Ecosse, puis au-delà du Mur d’Hadrien. Consécration, il participe à la réalisation du film La Part des anges, de Ken Loach. « Ce fut un sacré booster, avoue-t-il. Mais surtout une belle aventure. D’abord sollicité comme expert, Ken m’a demandé un matin d’interpréter mon propre rôle. ‘’Be yourself !’’ me lança-t-il. »
Voilà comment Charles MacLean est devenu l’un des connaisseurs les plus respectés de la planète maltée. Celui que The Times a sacré, en 2010, meilleur expert du whisky d’Ecosse, confesse avoir également une attirance pour les flacons japonais, indiens et taiwanais, en humant avec gourmandise un pur écossais Glen Turner Heritage, lors des premières master class* organisées dans l’Hexagone par la distillerie créée, en 1981, à Bathgate (Ecosse) mais en activité depuis 2004 seulement, et qu’il animait fin septembre à Paris.
L’occasion, pour notre expert, de rappeler combien il apprécie l’amateur français (rappelons que, avec 1,26 million d’hectolitre achetés en 2011, la France est le premier pays consommateur de whisky), car « votre culture du vin, des eaux de vie ambrées et de la gastronomie en général, vous donne un incomparable whisky-appeal. Chaque Français est un whisky-addict avec lequel j’ai plaisir à parler des grands whiskies comme des crus classés. »
Autour de son cou, une sorte de coquille saint-jacques se balance au gré de ses gestes amples. C’est son pedigree absolu : MacLean n’est pas peu fier d’être Master of the Quaich (en gaélique, quaich désigne le verre à whisky idéal). Ce club vénérable l’a non seulement adoubé comme Keeper (gardien du temple), en 1992, mais promu Master, il y a cinq ans, soit le titre suprême, partagé par une petite cinquantaine d’heureux élus de par le monde. Un sésame.
* Six whiskies furent proposés au cours de cette dégustation exceptionnelle : deux single malt des Highlands, Old Pulteney 12 ans d’âge (floral, aromatique, marin) et Clynelish 14 ans (suave, profond) ; un single Highlands malt, Glen Turner 12 ans (boisé, tourbé, miellé, réglissé) ; un whisky d’assemblage de malts de 15 ans d’âge, Glen Turner Heritage (boisé, vanillé, fruité, caramélisé) ; deux Islay single malt, Bowmore 12 ans (fumé, salin) et Kilchoman Machir Bay (fumé, boisé, marin).
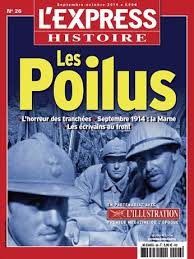 Papier paru dans le hors-série Les POILUS, de L'EXPRESS, actuellement en kiosque (rédaction en chef : Philippe Bidalon, avec Léon Mazzella).
Papier paru dans le hors-série Les POILUS, de L'EXPRESS, actuellement en kiosque (rédaction en chef : Philippe Bidalon, avec Léon Mazzella).
La Grande Guerre de position et ses longues plages d’ennui a développé les sports collectifs, véritables moteurs pour aider à monter à l’assaut. Et l’immédiat après-guerre a vu se développer naturellement le sport féminin et le handisport.
Par Léon Mazzella
----
Ils jouaient au ballon pour tromper l’ennui. La guerre de position a favorisé la pratique du sport, car, contrairement à une idée reçue, si les combats furent tous d’une grande intensité meurtrière, ils furent rares et parfois brefs. Aussi, le poilu découvrit-il l’ennui dans les tranchées (lire par ailleurs dans ce numéro), immobile, à attendre tout le jour l’ennemi comme Piero Aldobrandi dans Le Rivage des Syrtes, roman de Julien Gracq ou Giovanni Drogo dans Le désert des Tartares, de Dino Buzzati. Ainsi le sport distrayait-il les troupes tout en les galvanisant et en leur infusant cette alchimie que seul l’esprit du rugby engendre, par exemple, en faisant « jouer le collectif » avec courage et détermination. Signalons que nombre de rugbymen de légende, notamment anglo-saxons, mais également de l’Aviron Bayonnais ou du Stade Toulousain, périrent au front. L’un d’entre eux, selon Michel Merckel, nommé Manguez, frappé d’une balle de mitrailleuse, déclara avant de mourir : « Allez dire que je n’ai pas encore reculé devant la mêlée ! », relate Michel Merckel, auteur d’un livre-clé sur le sujet (1).
Les jambes coupées
Encouragé par les officiers, la pratique du sport, notamment des sports collectifs :le rugby le fut sous l’impulsion des soldats anglais, les Tommies, le football (orthographié foot-ball à l’époque) connaîtra un essor formidable qui ne se démentira plus jamais, et l’athlétisme se développent sur tous les fronts dès 1915, lorsque les « pantalons rouges » deviennent les « poilus ». Car il fallait de sacrées doses de courage pour monter à l’assaut, baïonnette au clair. À ce propos, soulignons un paradoxe : si d’aucuns chauffaient leurs muscles en faisant du sport afin d’entretenir -par surcroît-, une forme physique indispensable pour combattre au corps à corps, il semble qu’avec l’usure du temps et la déprime qui s’installa au cœur des tranchées, les Poilus préférèrent au foot, boire le litre de pinard quotidien et la dose de gnole qui leur étaient distribuées, afin de se donner de la « gniaque », voire une forme d’inconscience provoquée par l’ivresse ; et il y a fort à parier que le saut hors de la tranchée s’effectua souvent les « jambes coupées » par l’alcool…
Une presse des tranchées dynamique
La presse des tranchées, d’un étonnant dynamisme, entretient cependant le moral des troupes qui choisissent de pratiquer certains sports pour tuer le temps. Au début, ils jouent en effet au ballon, puis ils s’organisent, forment des équipes, disputent des matches et même des compétitions ! Les journaux de soldats comme « Face aux Boches », « On les aura », « Boum voilà », « La Guerre Joviale », « Le Poilu », « La Fourragère », « La Revue Poilusienne », « Le Cri du Poilu », « L’Echo de la Mitraille et du Canon », « La voix du 75 » (en référence au canon emblématique de l’armée française), « L’Echo des Guitounes », « Le Périscope », « Le Canard du Boyau », « La Musette », « Brise d’entonnoirs », en relatant ces rencontres sportives improvisées, prennent leur part dans l’entretien du moral de troupes désoeuvrées. Les grands magazines : « Sporting », « Le Miroir des Sports », « La Vie au grand air », leur emboîtent le pas. « L’Illustration » du 26 août 1916, avec sa voix patriotique habituelle, énonce que la boxe développe l’amour-propre et le désir de triompher. La course, le football augmentent l’agilité des membres qui s’étaient un peu figés dans la boue des tranchées… Propagandiste, le discours évoque avec fierté les Jeux interalliés qui se mettent également en place. Les Poilus pratiquent l’escrime ou la boxe et nombre d’entre eux sont d’ailleurs de grands sportifs : Roland-Garros, Jean Bouin, Gaston Alibert, Bernard Bessan, René Fenouillère, Gustave Lapize… Figurent parmi les 424 champions nationaux et internationaux qui mourront au combat, et dont Michel Merckel dresse la liste précise. La fin du conflit connaîtra l’esssordu sport féminin et du handisport.
Des sportives émancipées
L’émancipation du sport féminin se fera à la malheureuse faveur du nombre de victimes au front. Ajoutons à cela une politique nataliste, comme le précise Michel Merckel, qui, « pour compenser les pertes en vies humaines, encourage les femmes à pratiquer des sports afin de concevoir de beaux enfants ! » Le premier match de football féminin disputé en France se tient dès le 30 septembre 1917, le premier cross-country féminin en avril 1918 dans le bois de Chaville et le 10 août 1922, sont organisés les premiers Jeux olympiques féminins au stade Pershing du Bois de Boulogne-Billancourt. Entre temps, la Fédération sportive féminine internationale a ouvert ses portes à l’Autriche et à l’Allemagne en 1921, faisant montre d’un remarquable esprit d’équité et de réconciliation.
La naissance du handisport
C’est également à la « faveur » de la Grande Guerre que les compétitions sportives d’envergure et réservées aux handicapés verront le jour. L’Ecole (normale militaire de gymnastique) de Joinville est en cela exemplaire qui, dès sa réouverture le 7 mai 1916, n’aura de cesse de vouloir remettre sur pieds nombre de soldats éclopés qui lui étaient présentés en masse. Mais sans attendre des organisations officielles dédiées, le nombre de gueules cassées et de blessés de guerre qui se sont illustrés est impressionnant, rappelle Michel Merckel, « de Jospeh Guillemot, sans poumon droit à cause des gaz mais qui sera champion olympique du 5000 m en 1920, au boxeur Eugène Criqui, qui eût la mâchoire fracassée, se fit poser une plaque d’acier, remonta sur le ring et devint champion du monde poids plumes. Ou encore Jean Vermeulen, agonisant et criblé d’obus, qui faillit perdre ses deux jambes et qui remporta le marathon aux Jeux interalliés de 1919. Sans évoquer ce match de rugby France-Ecosse du 1er janvier 1920 qui comptait cinq borgnes (énucléés au combat) sur trente joueurs ! ». Comme quoi, conclut Michel Merckel, « la Grande Guerre fut aussi un moyen de diffusion du sport dans les tranchées et elle servit même de tremplin au sport moderne français. »
----
(1) « 14-18, le sport sort des tranchées » (éd. Le Pas d’oiseau, 2013).
CHIQUITO DE CAMBO : Le grenadier au chistera
Prononcez son nom n’importe où au Pays basque et vous verrez les regards s’allumer. Dans la mémoire collective d’un pays attaché à ses traditions et à ses champions, Chiquito de Cambo, de son vrai nom Joseph Apestéguy est une légende. Il naît le 20 mai 1881 à Cambo-les-Bains. Athlétique : 1,95 m pour 90 kg, il ne peut éviter, puisqu’il naît en terre basque, pêle-mêle : le sens de la fête, le rugby, la chasse à la palombe et la pelote. Cette balle en peau dure qu’on lance à main nue et à temps perdu sur un mur de fortune (ajoutons le surf, aujourd’hui à cette panoplie). C’est surtout la pelote qui captive très tôt le jeune Joseph. Le gamin costaud se révèle être un joueur surdoué qui brûle les étapes. Il devient champion du monde de pelote basque à l’âge de 18 ans en défiant et en battant largement le champion en titre Arrué, de Bidart, au cours d’une partie restée célèbre disputée le 23 septembre 1899. Il demeurera champion du monde de pelote basque sans discontinuer de1899 à 1914 et de 1919 à 1923. Un record absolu. Dans son livre sur la guerre de 14-18 comprise comme un formidable tremplin à l’essor du sport français : « 14-18, le sport sort des tranchées (éd. Le Pas d’oiseau), Michel Merckel rappelle un épisode insolite de la carrière de Chiquito de Cambo lorsque celui-ci fut mobilisé. Sur le front, le champion avait emporté avec lui un grand gant de chistera et il aurait eu l’ingénieuse idée de s’en servir pour lancer les grenades à une distance record depuis les tranchées françaises sur les lignes allemandes, tandis que le lancer de grenade, effectué par le poilu moyen, demeurait alors un geste approximatif et parfois malencontreux, voire foireux. « La légende raconte que les Allemands ne comprirent jamais quel surhomme pouvait lancer les grenades aussi loin », précise Michel Merckel. Mieux :  « Chiquito a réglé à sa façon l’un des points faibles de la grenade. En effet, sa distance de destruction est parfois trop près du lanceur. Pour lancer loin, la grenade à fusil fut inventée et cet engin va se perfectionner pendant toute la durée du conflit », ajoute l’auteur. Aucun document ne prouve cependant l’exploit réitéré du champion, mais la légende, tenace, en fait un grenadier hors pair qui fut d’ailleurs cité à plusieurs reprises à l’ordre de l’armée. Eric Mailharrancin, qui rend hommage dans son roman « Les Oubliés du Chemin des Dames » (Elkar) aux soldats basques, notamment ceux du 49ème régiment d’infanterie de Bayonne, s’interroge encore. Il a relancé le débat en mettant la main sur des photos montrant Chiquito en soldat avec son fameux gant de chistera à la main. Hypothèses… Mais qu’importe. Chiquito de Cambo finira paisiblement sa vie rue Augustin-Chaho à St-Jean-de-Luz. Il meurt le 30 mai 1950 à Guéthary et chaque année, en septembre, Cambo, où il repose, célèbre les Journées Chiquito. Un trinquet parisien, situé 8, quai St-Exupéry, porte même le nom du grenadier au chistera. L.M.
« Chiquito a réglé à sa façon l’un des points faibles de la grenade. En effet, sa distance de destruction est parfois trop près du lanceur. Pour lancer loin, la grenade à fusil fut inventée et cet engin va se perfectionner pendant toute la durée du conflit », ajoute l’auteur. Aucun document ne prouve cependant l’exploit réitéré du champion, mais la légende, tenace, en fait un grenadier hors pair qui fut d’ailleurs cité à plusieurs reprises à l’ordre de l’armée. Eric Mailharrancin, qui rend hommage dans son roman « Les Oubliés du Chemin des Dames » (Elkar) aux soldats basques, notamment ceux du 49ème régiment d’infanterie de Bayonne, s’interroge encore. Il a relancé le débat en mettant la main sur des photos montrant Chiquito en soldat avec son fameux gant de chistera à la main. Hypothèses… Mais qu’importe. Chiquito de Cambo finira paisiblement sa vie rue Augustin-Chaho à St-Jean-de-Luz. Il meurt le 30 mai 1950 à Guéthary et chaque année, en septembre, Cambo, où il repose, célèbre les Journées Chiquito. Un trinquet parisien, situé 8, quai St-Exupéry, porte même le nom du grenadier au chistera. L.M.
Photo ci-dessus : LA GRANDE GUERRE, l'indispensable mook de L'EXPRESS paru précédemment.
 Papier publié dans le hors-série Pieds-Noirs de L'EXPRESS paru il y a quelques jours et en vente encore plusieurs semaines (rédaction en chef : Philippe Bidalon et Léon Mazzella) => Tous au kiosque!
Papier publié dans le hors-série Pieds-Noirs de L'EXPRESS paru il y a quelques jours et en vente encore plusieurs semaines (rédaction en chef : Philippe Bidalon et Léon Mazzella) => Tous au kiosque!
7 ans et 8 mois d’une guerre qui prôna la pacification, l’autodétermination, puis l’abandon d’un pays, des Pieds-Noirs et des harkis.
Par Léon Mazzella
Le feu couve depuis les impitoyables massacres de Sétif du 8 mai 1945 : 104 européens, puis 1500 arabes en représailles (lire p15) sonnent le glas de la paix. L’armée de libération nationale (ALN), bras armé du Front de libération national (FLN) apparaît le 1er novembre 1954. Cette Toussaint-là, une série d’attentats sont perpétrés en divers points du pays. Les 7 premières victimes, dont l’instituteur Guy Monnerot et sa femme, ainsi que le caïd Hadj Sadok, assassinés dans un bus sur une route des Aurès, signent le véritable début de la guerre. L’armée française riposte aussitôt. Des renforts arrivent. Le gouvernement d’Edgar Faure remplace celui de Mendès-France. Le mot d’ordre est « l’intégration », après le rétablissement de l’ordre. Mais l’armée capture beaucoup de suspects, faute de trouver des coupables… La « question » de la torture est gravement posée. Le FLN compte à peine 500 hommes. L’embrasement va vite grossir ses rangs. L’intimidation est sa règle : « tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous ». « Sujets » français, les Arabes, qui ont si souvent souhaité devenir citoyens comme les juifs et les Européens, passent du côté de la lutte, coûte que coûte, pour leur indépendance.
Guérilla urbaine
Jacques Soustelle, gouverneur général d’Algérie, sait que la haine naît de l’injustice et de l’humiliation. L’inexorable engrenage génère des excès des deux camps. Le 20 août 1955, 70 Pieds-Noirs sont massacrés à Philippeville (région de Constantine). S’ensuit de nouvelles représailles massives, menées par un Soustelle humaniste, mais contraint. Le peuple algérien est désormais acquis à la cause du FLN. Le fossé entre deux communautés qui auraient pu envisager une alliance d’un troisième type, selon les vœux réitérés d’Albert Camus (lire p.46), devient abyssal. Le gouvernement de Guy Mollet, peu apprécié des Pieds-Noirs, échoue à imposer le général Catroux pour ministre-résident en Algérie. Les « ultras le rejettent. Il est remplacé par Robert Lacoste. L’ALN en a fini avec les embuscades sauvages. Mieux organisée, elle attaque frontalement l’armée française. La guérilla urbaine devient intense, les attentats se multiplient aux terrasses des cafés, le terrorisme frappe aveuglément. La peur est dans tous les ventres. Elle appelle la vengeance. Ne cède pas au désespoir. Avec une représentation contestée à l’ONU, notamment par Antoine Pinay qui crie à l’ingérence, le FLN connaît une aura internationale. La crise de Suez, le soutien de Nasser au FLN, provoquent l’arrivée du général Massu et de ses paras sur le sol algérien. « La Bataille d’Alger » de 1957 est dure et très meurtrière, mais les « paras » de Massu et de Bigeard la gagnent. Ils neutralisent le FLN dans ses bastions névralgiques. Etape suivante : « nettoyer les douars et le djebel ». L’armée « gouverne ». Stratège, elle appelle à ses côtés des musulmans afin de constituer des « unités supplétives » : ce sont les harkis, dont le sort après la guerre sera monstrueux. Injustement abandonnés par la France, ils seront torturés et massacrés par dizaines de milliers par un FLN vainqueur. La « bataille des frontières » (avec la Tunisie) fait rage. Le gouvernement de Félix Gaillard est renversé. Celui de Pierre Pflimlin, symbole de l’abandon de l’Algérie, est redouté des « pro » Algérie française (l’armée et les Pieds-Noirs), qui créent un comité de « salut public » avec à sa tête le député Pierre Lagaillarde (futur cofondateur de l’OAS avec Jean-Jacques Susini). Le 13 mai 1958 voit l’attaque le Gouvernement général à Alger, symbole du pouvoir parisien, qui frémit.
De Gaulle aux affaires
Les gaullistes fomentent le retour du général. En arbitre, le général Salan déclare « prendre provisoirement les destinées de l’Algérie française »… et achève son discours par un timide mais retentissant « Vive de Gaulle ! », qui signe le retour du grand Charles aux affaires, comme président du Conseil dès le 1er juin. Ils se rend immédiatement à Alger. Un rêve de fraternisation entre « tous les Français à part entière » bat de l’aile, et survit avec peine, « de Dunkerque à Tamanrasset », dans les discours vibrants du général. Le fameux « Je vous ai compris » (prononcé à Alger) deviendra vite un je vous ai trahis dans la conscience pied-noire. La constitution (sur mesure) de la Ve république est approuvée le 4 octobre.
La stratégie de l’abandon
Le FLN, en exil à Tunis, créé le Gouvernement provisoire de la république algérienne (GPRA). Ferhat Abbas, son chef, décide de porter la guerre également sur le sol français. À Paris, le « réseau Jeanson », les « porteurs de valises » (augurant « le manifeste des 121 ») aident le FLN. De Gaulle en appelle à « la paix des braves » afin de désarmer les maquisards hésitants de l’ALN. Peine perdue. Paul Delouvrier remplace Salan au poste de délégué général du gouvernement. Le général Challe est commandant en chef. Mission : écraser l’ALN. Les paras continuent de faire « le sale boulot », notamment en Kabylie et dans les Aurès. Lorsque de Gaulle propose un référendum sur l’autodétermination le 16 septembre 1959, le peuple pied-noir s’insurge avec force et dresse à nouveau des barricades. Pierre Lagaillarde et Jo Ortiz résistent. De sauveur, de Gaulle devient l’homme à abattre. En face, Houari Boumédienne tient son armée. Les Pieds-Noirs se découvrent de nouveaux ennemis : l’armée, les gardes-mobiles et les CRS. Le 22 avril 1961, « un quarteron de généraux en retraite » (Zeller, Challe, Jouhaud et Salan) font un putsch qui sera un flop au bout de 4 jours. Le « pronunciamento militaire » est peu suivi par les gradés. Même Hélie de Saint-Marc se rend : il ne veut pas de la guerre. L’état d’urgence est décrété. Des grèves générales monstrueuses sont très suivies. L’OAS est créée (lire page 50). Salan la dirige. Des plasticages à répétition ont lieu jusqu’à Orly. La terreur répond à celle qui continue d’être semée par le FLN. Avec les mêmes armes honteuses. Discours y compris : « Tout ce qui n’est pas Algérie française est ennemi ». La manifestation du FLN à Paris, le 17 octobre 1961, tourne au massacre : la police tue plus de 50 personnes. Les accords d’Evian du 18 mars 1962 sur « l’avenir d’une Algérie souveraine et indépendante » sont signés. Krim Belkacem, l’homme du 1er novembre 1954, a le sourire. De Gaulle renonce au pétrole du Sahara et aux essais nucléaires. Avec la fin des combats, le cessez-le-feu est déclaré sur tout le territoire. Il n’est pas respecté. L’OAS poursuit sa politique désespérée et aveugle de la terre brûlée. Appelle les civils à la révolte. Joue son va-tout. Le 26 mars 1962, l’armée française tire sur la foule pied-noire, rue d’Isly à Alger (lire p.51). Un accord est signé entre le FLN et l’OAS le 17 juin. Baroud « d’horreur » : l’OAS incendie le port d’Oran et disparaît. Les Pieds-Noirs continuent de fuir massivement « leur » pays. Le 1er juillet, l’indépendance est proclamée.
 Un papier donné au Huffington Post, et qui est paru hier :
Un papier donné au Huffington Post, et qui est paru hier :
 GRACQ INÉDIT
GRACQ INÉDIT
J'y reviendrai forcément très vite, ici même :
http://www.jose-corti.fr/titresfrancais/Terres_du_couchant.html
Extrait, pour redire brièvement l'intemporalité, la permanence, la perfection du style, l'oubli de tout repère, excepté celui du méridien de Greenwich littéraire que l'auteur figure ou dessine à lui seul, extrait donc, de l'événement littéraire 2014/2015 absolu, et propre à balayer tout le reste comme un amical tsunami - d'un revers distrait de la manche.
« En ces jours-là, le monde nous faisait cortège, chaud comme une bête, touffu comme un bois noir, plein de peurs et de merveilles – nous étions conduits – de grands signes se levaient pour nous sur la route, comme à celui qui s’est mis en chemin derrière une étoile – et tout autour de nous était calme, majesté, silence – un monde tendu à nous comme sur une paume, tout rafraîchi de palmes sauvages, fouetté de grands vents qui brassaient à pleins bras son écume verte, incliné, tout entier comme une voile qui prend l’alizé vers sa destination cachée, dans un roulis de long-courrier, un balancement d’équinoxe. »
Papier paru dans le hors-série Pieds-Noirs, histoire d'une déchirure, de L'EXPRESS. (Rédaction en chef : Philippe Bidalon et Léon Mazzella). En vente en kiosque pendant trois mois => Courez-y!
 Un travail de mémoire et d’entretien de celle-ci s’opère depuis cinquante ans, par le biais notamment d’associations et de revues. Capital, cette quête des origines qui anime certains « descendants » de pieds-noirs, est ravivée par la disparition annoncée d’une communauté –au sens strict -, à l’horizon 2062, centenaire du grand départ. Par Léon Mazzella
Un travail de mémoire et d’entretien de celle-ci s’opère depuis cinquante ans, par le biais notamment d’associations et de revues. Capital, cette quête des origines qui anime certains « descendants » de pieds-noirs, est ravivée par la disparition annoncée d’une communauté –au sens strict -, à l’horizon 2062, centenaire du grand départ. Par Léon Mazzella
---
L’acteur Daniel Auteuil naquit « par hasard » à Alger en 1950, lorsque ses parents, chanteurs, y résidaient provisoirement. De là à le considérer comme pied-noir, il n’y a qu’un pas audacieux que la « diaspora » aime bien franchir afin de grossir artificiellement ses rangs, histoire de s’enorgueillir de compter des stars, des people, des gens biens, des pieds-noirs recommandables. Analysons ce réflexe. Il exagère chouia (le pied-noir exagère tout, de toute façon). Exprime une sorte de revanche sociale, un déficit à combler, une conduite à racheter, au nom d’une culpabilité induite, d’une honte bue mais jamais éliminée, d’un complexe d’être, aux yeux des « Français de France », ces (« sales ») pieds-noirs, un million d’hommes et de femmes qui furent parfois maltraités dans un hexagone qui les accueillit globalement à contrecoeur. Dire qu’il s’agit d’un juste retour des choses pour une communauté ayant maintenu la population algérienne sous le boisseau serait par ailleurs aussi hâtif qu’hasardeux.
INTRANQUILLES LOCATAIRES
Ainsi, les pieds-noirs se sont-ils toujours faits tout petits, afin de se faire accepter, de se faire « aimer » par l’autre. La peur d’être à nouveau rejetés ailleurs, exilés une nouvelle fois, et repoussés au quotidien, appartient à leur inconscient. Cette crainte sociologique a été en effet largement partagée, dès leur arrivée sur le sol métropolitain en 1962. Rappelons que leur histoire est celle d’un peuple bigarré qui investit un sol qui ne sera jamais vraiment le sien, une terre qu’ils s’approprient certes, mais dont ils savent qu’ils sont les locataires seulement, et que leur bail a une durée déterminée, dont la date n’est pas fixée. Les pieds-noirs ont par conséquent toujours vécu dans une sorte de qui vive, comme les Napolitains qui gardent constamment au fond de leur conscience la possibilité d’une nouvelle éruption du Vésuve. Carpe diem (et memento mori). L’histoire les expulse en 1962. Ils arrivent ailleurs, en « terre mère » soi-disant, dans leur patrie, et celle-ci s’avère étrangement étrangère, voire hostile. Jean-Jacques Gonzales, auteur d’un tendre « Oran » (Séguier), ville qu’il quitte à l’âge de 11 ans, a des mots d’une grande justesse pour résumer l’absurdité de cette situation historique, dans le superbe ouvrage collectif « Algérie 1954-1962 », placé sous la direction de Benjamin Stora et Tramor Quemeneur (Les Arènes) : « Et puis il y a l’école, où l’on ne nous apprend rien de l’Algérie, mais tout de cette France que nous ne connaissons pas. Un truc dingue, schizophrénique. Ensuite la guerre, atroce, horrible. Mais je me disais qu’elle devait m’amener au paradis, dans cette France des livres, du savoir. Une fois arrivés, on nous a dit que nous n’étions pas chez nous. En fait, chez nous, maintenant, c’était nulle part. »
LA « NOSTALGÉRIE »
Néanmoins, les pieds-noirs ne se laissent pas abattre et font montre d’une belle énergie. Ils se refont la clémentine, tant bien que mal, en gardant les stigmates d’un passé qui ne passe pas, en ayant l’esprit du guetteur chevillé au corps. Sans cesse en alerte, ils ne connaissent jamais la paix, sinon dans le souvenir de là-bas. Ce syndrome génère vite une maladie qui semble incurable, communément appelée « nostalgérie ». Certains entretiennent le virus, car ce peut être un mal délicieux qui procure un bien étrange... L’entretien du souvenir d’un paradis perdu connaît un essor formidable avec la multiplication de rencontres, colloques, rassemblements parfois monstres, qui se tiennent dans des centres à forte densité de pieds-noirs comme Narbonne, Nice, Montpellier et Nîmes. Les voyages organisés pour retourner « là-bas » connaissent eux aussi un beau succès, bien que tous ces événements aient aujourd’hui tendance à se raréfier, par manque croissant de participants... Ils sont par ailleurs l’occasion de retrouver les « pieds-verts », cette population très minoritaire (environ quelques dizaines de milliers après 1963, quelques centaines aujourd’hui) de pieds-noirs ayant choisi de rester en Algérie et auxquels Assiya Hamza consacre un livre de témoignages émouvant, « Mémoires d’enracinés » (Michalon). La littérature pied-noire, ou plutôt les livres sur le sujet, sont légion. Nombre d’entre eux sont autoédités et n’ont aucune prétention littéraire. Leur dessein est d’entretenir, encore et toujours, le souvenir. Maurice Calmein et Christiane Lacoste-Adrover, dans leur ouvrage « Dis, c’était comment l’Algérie française ? » (Atlantis) ont dénombré 800 associations de pieds-noirs et de Français musulmans « repliés » d’Algérie. Les premières ont eu pour but de veiller aux intérêts matériels des rapatriés, les fameuses « indemnisations » des biens laissés en Algérie, que l’Etat français mettra de nombreuses années à rembourser, au compte-goutte et de façon souvent symbolique, voire indigne, augmentant ainsi la rancœur de pieds-noirs régulièrement enclins à exprimer leur colère par le vote sanction pur –celui qui est dénué d’idéologie ou de conviction politique précise mais qui constitue l’expression solidaire d’un poids électoral certain. Ces associations se nomment ANFANOMA (Association nationale des Français d’Afrique du Nord), RANFRAN (Rassemblement national des Français d’Afrique du Nord), rivales, puis rassemblée sous le label FNR (Front national des rapatriés) créé en 1969 par le général Edmond Jouhaud. Puis ce sera le RECOURS en 1974 (Rassemblement et coordination unitaire des rapatriés et spoliés), toujours à l’appel de Jouhaud, et que présidera Jacques Roseau, ex-OAS assassiné en 1993 par… l’OAS (lire page 53).
Les associations de défense des Français musulmans ne sont pas en reste, notamment celles qui prennent la défense des malheureux harkis (ils sont 60 000 à toucher le sol français en 1962), comme Collectif Justice. Ou encore la dynamique association ANEH (Association nationale des enfants de harkis). Mais la plupart des associations sont apolitiques et parlent davantage kémia, soleil et du bon temps « quand on était là-bas » lors de leurs assemblées générales. Ce sont des amicales. Très nombreuses, certaines d’entre elles éditent leur propre bulletin de liaison (lire encadré). En parallèle, il faut saluer l’initiative d’envergure d’un Joseph Perez, qui, avec son association CDHA (Centre de documentation historique sur l’Algérie, installé avec sa propre bibliothèque à Aix-en-Provence) effectue depuis quarante ans un travail mémoriel prodigieux, de collection de documents de toutes sortes. Ses fils Gilles et Cyrille Perez, sont notamment les auteurs d’un long documentaire sur les pieds-noirs qui fait date (lire page 58), preuve que certains membres de la génération des quadras-quinquas d’aujourd’hui s’intéresse activement au sujet. Prochaine étape, capitale pour le président du CDHA : achever et inaugurer (en 2015, à Aix) un site mémoriel, placé sous l’égide de la Fondation de France, le Conservatoire national de la mémoire des Français d’Afrique du Nord, qui devrait devenir le centre de documentation le plus riche sur le sujet.
UNE QUÊTE IDENTITAIRE
Paradoxalement, les pieds-noirs se font donc tout petits d’un côté, et d’un autre, leur façon d’être exubérante, « forte en gueule », témoigne d’une véritable affirmation identitaire. La culture pied-noire, à travers le cinéma, la chanson, le café-théâtre, l’oralité –un accent reconnaissable entre tous, a véhiculé et progressivement imposé leur présence solaire sur le sol français. Les rapatriés se sont fait leur place loin du soleil de là-bas, dont chacun affirme qu’« il ne brillait pas de la même façon qu’ici ». Et leur belle énergie a dopé plusieurs secteurs de l’économie et certaines régions, comme la filière viticole (Languedoc-Roussillon), la culture des agrumes (Corse), l’immobilier ici, le petit commerce là... Les pieds-noirs se sont révélés doués pour créer et piloter des PME, et leur efficacité dans les professions libérales (médecine, droit) n’a jamais été démentie. Certes, la France des Trente Glorieuses renouait avec la prospérité, mais elle n’avait nullement besoin d’un million de pieds-noirs. Ces derniers participèrent néanmoins d’une croissance qui dépassa 6%. La galerie de portraits, dans des domaines divers, qui suit ces pages le démontre de façon sélective mais éloquente.
La génération des enfants et aujourd’hui des petits-enfants, voire des arrière petits-enfants des pieds-noirs arrivés sur le sol métropolitain en 1962 s’interroge. Notons d’ailleurs que les descendants de harkis sont animés de la même quête identitaire. Dépassionnée, sereine, légitimement curieuse, elles sont avides de savoir. Certes, seule une minorité effectue des recherches ou bien accomplit la démarche du retour sur la terre de naissance de leur famille, si possible en compagnie d’un parent qui consent à effectuer un voyage de toute façon douloureux, « avant qu’il ne soit trop tard » (lire à ce propos le roman d’Anne Plantagenet, voir page 73). Plus étonnant encore, certains jeunes « descendants » de pieds-noirs, âgés d’une vingtaine d’années à peine, agitent le spectre de l’oubli, expriment une demande de « transmission », de réappropriation identitaire, que celle-ci passe par la cuisine ou par l’histoire. Ce ne sont pas des cas isolés. Ils manifestent ce désir ardent de connaître la terre de leurs proches ancêtres –d’où ils proviennent, donc leur propre histoire, et envisagent eux aussi, peut-être sans parent, de faire le voyage (initiatique) du retour, afin de vérifier que là-bas ce n’est pas nulle part et que la notion de racines peut revêtir bien des aspects. L.M.
--------
Le rôle social des bulletins de liaison
Le plus connu est « L’Echo de l’Oranie », qui atteignit des pics de vente de 50 000 exemplaires, uniquement sur abonnement, réalisée à Nice depuis 1963. Il traite d’histoire, d’archéologie, de cuisine, de littérature, de pataouète –et il publie surtout un carnet. Celui-ci est précieux, car il permet à la « diaspora pied-noir » de savoir qui meurt et qui naît ! Il est aussi précieux que ces mêmes pages dans n’importe quel quotidien régional. Ce rôle est singulièrement accru à une période où la génération active en 1962 disparaît peu à peu. Le rôle social de ces journaux, primordial, est aussi de permettre aussi aux uns et aux autres de se retrouver, de reprendre contact, au moins de savoir « ce qu’ils sont devenus »... Aujourd’hui, la course contre la montre a commencé : afin d’éviter que la mémoire sombre dans l’oubli en partant dans la tombe, ces journaux constituent une précieuse source d’informations sur la vie d’une communauté qui s’éteint. Au sens strict, les pieds-noirs sont devenus une « espèce » en voie de disparition. Si l’on considère en effet qu’un pied-noir est une personne née sur le sol algérien avant le mois de juillet 1962, et que l’espérance de vie raisonnable de l’être humain est d’environ un siècle, les derniers pieds-noirs disparaîtront dans cinquante ans et des poussières. Parmi les revues plus culturelles, outre « Mémoire vive », revue du CDHA (lire plus haut), « L’Algérianiste », revue du Cercle algérianiste se distingue en tenant le haut du pavé. Créé en 1973, cette revue-livre donne chaque trimestre son lot d’articles de fond sur l’Algérie, traitée sous tous ses aspects. Fort d’une quarantaine de cercles locaux répartis dans toute la France, le Cercle algérianiste, basé à Narbonne, organise nombre de colloques, conférences, rencontres théâtrales, cinématographiques, et décerne même un prix littéraire. Citons encore « Pieds-Noirs d’hier et d’aujourd’hui », et « Jeune Pied-Noir » qui demeurent des associations actives et qui ont édité des magazines éponymes. L.M.
 Papier paru dans le hors-série Pieds-Noirs de L'Express. (Rédaction en chef : Philippe Bidalon et Léon Mazzella). En kiosque pour 3 mois depuis avant-hier :
Papier paru dans le hors-série Pieds-Noirs de L'Express. (Rédaction en chef : Philippe Bidalon et Léon Mazzella). En kiosque pour 3 mois depuis avant-hier :
L’EXIL ET LA HAINE
Par Léon Mazzella
L’exode de l’été 1962 rapatrie 800 000 Pieds-Noirs valise à la main sur les côtes métropolitaines. Ils sont loin d’être les bienvenus.
----
Les Pieds-Noirs, bien avant qu’on les désigne ainsi, ne possédaient rien lorsqu’ils sont arrivés sur le sol algérien. « On a tout construit, petit à petit, on s’est créé quelque chose à nous, et puis un jour, 130 ans plus tard, on nous a dit de partir en laissant tout sur place. On a du tout abandonner », déclare une rapatriée dans « Les Pieds-Noirs. Histoire d’une blessure », un film signé Gilles Perez. Ils ont tout perdu, et ils se sont retrouvés « une main devant, une main derrière », « avec juste les yeux pour pleurer », selon les formules bien connues. Alors, après 1962, ils se sont murés dans le silence, ils se sont fondus tant bien que mal dans un pays qui ne les accueillait pas avec enthousiasme. La plupart se sont tus pendant plus de 40 ans ; ils se réunissaient entre eux pour se tenir chaud au cœur.
À l’école, en Algérie, on leur apprenait les départements de métropole, mais rien sur l’Algérie, leur pays de résidence. Ils n’ont pas appris un mot d’Arabe non plus, et ce fut sans doute l’une des plus graves erreurs de la colonisation : ne pas apprendre la langue de l’Autre, qui est chez lui et chez lequel on s’invite...
La valise ou le cercueil
À partir du 13 mai 1958 et du fameux « Je vous ai compris » prononcé par de Gaulle, qui fut suivi de tant de trahison et d’abandon, ils ont compris à leur tour. Les accords d’Evian du 19 mars 1962 sont venus précipiter les choses. Un faux cessez-le-feu suivi d’attentats, d’enlèvements sauvages, le massacre de la rue d’Isly à Alger, l’OAS qui donne le change au FLN en utilisant les mêmes armes atroces, le massacre du 5 juillet 1962 à Oran enfin – juste après l’indépendance, précipitent un départ définitif aux accents de délivrance.
Ils eurent droit à une valise, car le mot d’ordre était « la valise ou le cercueil ». Et que met-on dans une seule valise, se demande l’un d’eux ? Un disque des Chaussettes noires ? Un ourson en peluche ? Des vêtements chauds parce qu’en France métropolitaine il fait froid ? Le train électrique du petit, qui voyagera dans un couffin ? Des photos encadrées des parents défunts? Trois fois rien. Si ! Les clés de la maison, quand on ne l’a pas brûlée, avec la quatre-chevaux, pour ne pas « leur » laisser... Rien, c’est-à-dire un siècle dans une valise.
Dans « Le Onzième commandement » (Gallimard), André Rossfelder résume une certaine haine d’un côté de la Méditerranée : « Une vieille dame d’Oran se présente sur le quai du départ avec son chien et sa valise (limitée à 10 kg). ‘’C’est le chien ou la valise’’, dit le gendarme rouge. Elle jette rageusement la valise à la mer. Il abat le chien. ‘’Trop lourd !’’ » La tension est à son paroxysme, chaque jour de cet été 62, sur les quais des ports algériens. La peur au ventre d’être enlevé et de « disparaître » depuis des mois, avant ou après l’heure du couvre-feu, un peuple étourdi, abasourdi, ne comprend pas tout, sauf qu’il sait qu’il doit tout laisser derrière lui précipitamment, sauf son cœur, son enfance, sa jeunesse – ça ils sentent tous que c’est impossible autrement. Peu nombreux sont les Pieds-Noirs qui pensent revenir bientôt ici, chez eux. Ce n’est plus chez eux. Est-ce que cela l’a été un jour, telle est la vraie question. Ils se la poseront plus tard. Pour l’heure, il faut sauver sa peau, rien de moins, rien de plus.
90% des Pieds-Noirs prennent le bateau, le Ville-d’Oran, le El-Djezaïr, le Jean-Laborde... Ou plutôt s’entassent par milliers (jusqu’à 2630 dans les flancs et sur les ponts du Kairouan et ses 1172 places autorisées, le 26 juin), offrant de funestes allures d’ « Exodus » à ce grand départ inassouvi. « Les gens montaient la passerelle en courant, en criant, en pleurant », écrit Daniel Saint-Hamont dans « Le coup de sirroco » (Fayard), qui deviendra un film emblématique pour la diaspora pied-noire.
La plupart des navires font route vers Marseille, car les quais de la Joliette sont historiquement le passage obligé des hommes et des biens depuis des siècles et que la cité Phocéenne a été désignée ville de transit des rapatriés d’Algérie par le gouvernement. Les Pieds-Noirs les plus riches (à peine 10% d’entre eux) quittent l’Algérie en avion, ils prennent place à bord d’une Caravelle ou d’un Constellation à l’aéroport de La Sénia (Oran) ou celui de Maison-Blanche (Alger). Mais quel que soit le mode de transport, ce qui attend 1,230 million de Pieds-Noirs aux quatre coins de la France ne ressemble en rien à un accueil à la Tahitienne.
« Il faut jeter les Pieds-Noirs à la mer »
Sur place, il n’y a presque aucune assistance, psychologique ou autre, comme il en existe désormais au moindre accrochage automobile, excepté celle de la Croix Rouge, qui fut d’une grande efficacité. Personne n’attend les Français d’Algérie, citoyens de trois départements, au même titre que les Bouches-du-Rhône, en cette période estivale, de vacances. Ils sont parfois « accueillis avec des cris de haine », pour paraphraser les derniers mots de « L’Etranger », de Camus.
Ils arrivent, précédés de mots terribles prononcés à leur encontre, comme celui de Jean-Paul Sartre, en pleine guerre d’Algérie, qui restera dans les mémoires : « Un Français mort, c’est un Arabe libre ». Le maire de Marseille, Gaston Defferre, aura des mots très durs à l’encontre de ses compatriotes : « Que les Pieds-Noirs quittent Marseille en vitesse, qu’ils essaient de se réadapter ailleurs et tout ira pour le mieux », pouvait-on lire à la Une de « Paris-Presse » du 27 juillet 1962. Une autre phrase, de sinistre mémoire, est attribuée à Defferre : « Il faut jeter les Pieds-Noirs à la mer »… Des plaques d’égout sont posées contre les portes d’appartements marseillais occupés par des rapatriés. Par milliers, ils débarquent chaque jour, épuisés, hébétés, traumatisés, sur les quais des ports français, et Marseille fait figure d’une étrange Ellis Island (*). « La plupart des gens semblaient ignorer que nous étions Français comme eux. D’autres s’étonnaient que nous ne soyons pas Arabes, d’autres encore nous imaginaient avec la peau noire », déclare une femme dans le documentaire de Gilles Perez. L’historien Jean-Jacques Jordi, auteur de « 1962 : l’arrivée des Pieds-Noirs » (autrement), précise dans le film que certains conteneurs étaient volontairement trempés dans l’eau du port avant d’être posés à quai, ou bien étaient jetés de haut… Les dockers déclenchèrent de surcroît plusieurs grèves. « Il fallait désengorger Marseille, puis les départements voisins », dit-il. Certains sont immédiatement envoyés d’autorité à Nevers, Laval, Auch, ou dans un village du Jura… Le mot d’ordre est « dispersion » davantage que bienveillance. Sur place, des dortoirs sont improvisés, notamment dans les hangars (dont le célèbre J4) des môles de La Joliette, et séparent de façon injustifiée les femmes et les enfants des hommes, ajoutant à la douleur une humiliation violente et gratuite. Une parmi d’autres. Cet exil touche alors à l’absurde, puisque les Pieds-Noirs sont des Français chassés d’un bout de France et qui arrivent en métropole ! Ils sont cependant perçus comme des étrangers et eux-mêmes se sentent tout de suite étrangers en terre métropolitaine. La métaphore de l’arbre que l’on transplante, soulignée par un Oranais dans le film précité, est juste : « il ne repart pas avec la même vigueur, ou alors il meurt ». Car si l’accueil qui leur fut réservé fut excellent en Corse – rappelons que l’île de Beauté contribua beaucoup à peupler l’Algérie coloniale-, et très bon à Toulouse et à Strasbourg, il fut désastreux dans de nombreux endroits, outre Marseille.
« Moi, je ne loue pas aux Pieds-Noirs »
D’autres témoignages du film de Perez, comme celui de Gérard Bengio, 13 ans en 1962, montrent la violence d’un racisme qui ne dit pas son nom : avec son frère aîné, ils furent interdits de cours d’histoire-géo, au lycée d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques) au motif que le professeur, membre du parti communiste, « ne souhaitait pas avoir des colonialistes tueurs d’Arabes dans son cours ». De même, il fut refusé à sa famille la location d’un pavillon : « Je ne loue pas à des Pieds-Noirs », avait déclaré le propriétaire. Ces exemples sont légion, et s’ajoutent à la rigueur historique de l’hiver 1963. Jean-Jacques Jordi : « la société française reporte à cette époque-là tous les maux aux Pieds-Noirs », sauf peut-être la neige qui tombe en abondance. « L’augmentation du prix du panier de la ménagère ? – C’est la faute aux Pieds-Noirs. Celle de l’immobilier, idem. » Ajoutons avec perfidie l’augmentation marseillaise –avérée - des tarifs hôteliers et des courses en taxi… Le rejet du rapatrié confine au racisme. « Sales Pieds-Noirs » devient une insulte courante, que l’on retrouve aussi sur certains murs. Le coup est particulièrement dur pour ceux qui connaissent déjà Marseille pour l’avoir libérée 18 ans plus tôt. Il s’agissait d’un autre débarquement. Aux six coins de l’hexagone, de nombreux gamins connaîtront l’humiliation d’être déchaussé de force à l’heure de la récré afin de montrer la couleur de leurs pieds… Le racisme se double parfois d’une aberrante bêtise. Ces humiliations firent naître la honte d’être Pied-Noir. Raciste, fasciste, « gros-colon-qui-a-fait-suer-le-burnous », OAS… Sont autant d’insultes qui conduisent les Pieds-Noirs « à se faire le plus petit possible, à tenter de passer inaperçus », déclare un rapatrié dans le film de Gilles Perez. A cacher ce qu’ils sont. « Le plus extraordinaire », poursuit cet Algérois anonyme, « est que l’on soit parvenu à culpabiliser la victime. Car nous avions tous, à force, le sentiment profond d’être coupable de quelque chose. »
Jeannine Verdès-Leroux, auteur des « Français d’Algérie » (Fayard) déclare que d’aucuns « souhaitaient que les Pieds-Noirs aillent en Amérique du Sud, puisque c’était tous des fascistes, tous des membres de l’OAS !.. » Selon un autre historien, Alain-Gérard Slama, auteur de « La Guerre d’Algérie. Histoire d’une déchirure » (Gallimard), « les Pieds-Noirs anéantis partent pour la plupart vers l’inconnu ». Seuls Raymond Aron et Alain Peyrefitte ont prédit leur retour massif, qui inquiète les politiques. Slama : « Au cours du conseil des ministres du 18 juillet 1962, de Gaulle souhaite leur retour en Algérie. Louis Joxe, méfiant à l’égard de cette ‘’mauvaise graine’’, estime qu’il vaudrait mieux ‘’qu’ils s’installent en Argentine, ou au Brésil, ou en Australie ‘’. ‘’Mais non ! rétorque de Gaulle. Plutôt en Nouvelle-Calédonie. Ou en Guyane !’’ »
« Qu’on les écrase ! »
L’amalgame est sévère, en 1962, et une presse à front bas s’en fait l’écho. François Billoux, député communiste des Bouches-du-Rhône et directeur politique de « La Marseillaise », écrit : « Ne laissons pas les ‘’repliés’’ d’Algérie devenir une réserve de fascisme ». Le quotidien L’Humanité est aussi virulent, qui n’hésite pas à publier des caricatures montrant les premiers « rapatriés » débarquant en France, ornés d’une croix gammée (dessin paru le 6 janvier 1962 –déjà !). Libération titre quant à lui : « Qu’on les écrase !»…
Arrivés en France contre vents et marées, violence et sarcasmes, mépris et refus, les Pieds-Noirs sont donc repartis à zéro. La plupart connurent de grandes difficultés à trouver l’essentiel : un logement et un travail. Se refaire la cerise, ou plutôt la clémentine, représenta un exploit pour beaucoup, car aucun n’était au bout de sa peine…
---
(*) l’île par laquelle tout émigrant entrant aux USA doit passer pour obtenir son viatique.
POUR ALLER OÙ?
Voici ce que l’écrivain Jules Roy, auteur de nombreux ouvrages sur l’Algérie, notamment la saga « Les Chevaux du soleil » (Grasset), alors reporter à L’Express, écrivit dans nos pages le 1er juillet 1962 depuis Marseille : « Voilà, ils sont partis parce qu’ils ont peur. Jusqu’au 1er juillet, cette peur va grandir et prendre des allures de panique. La raison ne les atteint pas plus qu’autrefois, et ils osent à peine voir cette ville que beaucoup d’entre eux ne connaissent pas, cette cathédrale en stuc gris, ces docks giflés par le mistral. Ce qui les rattache encore à l’Algérie, c’est l’eau du port et le bateau dont ils ont à présent tant de mal à s’arracher. Pour aller où ? Chargés de leurs maigres biens, de matelas, tirant derrière eux des chiens ou soutenant des infirmes, ils avancent en cahotant, ivres de douleur. Vous pourriez supporter ce spectacle, vous ? Moi pas, parce que ce sont les miens, que je leur ai annoncé tout ça s’ils ne partageaient pas ce qu’ils avaient avec les Arabes, et qu’à présent leur malheur m’accable avec eux. »
C'est le nouveau hors-série de L'Express (rédaction en chef : Philippe Bidalon et Léon Mazzella). Achetez-le, pour que vive la presse écrite, lisez-le attentivement, et on en reparle.

Dégustation gersoise de la gamme de Plaimont producteurs, hier sur une péniche amarrée quai de Montebello (Paris 5), devant une ribambelle de stands dédiés aux produits gourmands du Sud-Ouest. Autant dire qu'il y a pire, comme fin de journée, surtout avec cet été indien, la Seine en bas, Notre-Dame au bout du bras, un pont rutilant de cadenas amoureux au-dessus des yeux - qui prenaient, l'une et l'autre et à mesure, les rayons orangés d'un soleil qui rechignait à aller se coucher, et enfin une charmante dégustatrice passionnée et blogueuse de talent pour croiser le verre à mes côtés. J'ai pu ainsi goûter, tout en discutant avec l'équipe à bérets (notamment Joël Boueilh et Olivier Bourdet-Pees), la fameuse cuvée confidentielle de tannat (clonés à tout va) pré-phylloxériques, ainsi que la non moins confidentielle cuvée de vignes issues de tannat immédiatement plantées après le funeste passage, fin XIXè, du satané phyllo (Madeleine) - il paraît que ces ceps sont larges comme des troncs : il va falloir aller voir cela. Mention spéciale au splendide Monastère de Saint-Mont. Plaimont, ce sont en somme des vins de synthèse et d'équilibre, car ils sont à la fois tendus, profonds, structurés, puissants et élégants, voire raffinés comme peuvent l'être certains gentlemen-farmers hemingwayens sur les bords (bourrus comme des ours et fins comme des papillons) : c'est ça que l'on aime, non? Cette égale distance entre force et finesse que l'on recherche systématiquement dans ces régions, se trouve dans un verre d'Empreinte, dans un autre du Faîte, totalement dans un de Monastère, avec beaucoup de classe dans un verre de Madeleine, et avec plus de légèreté dans Sabazan, et de subtilité facile dans Nature secrète...
Photos ci-dessous : 1- la (fameuse) vigne préphylloxérique, 2- La Madeleine de Saint-Mont (magnifique), 3- Nature secrète (bio), 4 -Le Monastère (respect), Empreinte (en blanc et en rouge), château Sabazan, 5- Les vignes retrouvées (blanc), Le Faîte, et enfin 6- Rosé d'enfer (superbe!), Hat-Trick (bof, pour les anglo-saxons) et Béret noir (j'adore).
C'est donc l'occasion de publier, ici, le papier qui est paru dans le hors-série Vins de L'Express en juin dernier :
La cave de référence : PLAIMONT
Avec Tain-L’hermitage (Drôme), la cave de Saint-Mont, dans le Gers, fait partie des caves coopératives qui comptent. Pl pour Plaisance, Ai pour Aignan, Mont pour Saint-Mont sont les segments qui résument la réunion de trois caves en 1979. Plaimont Producteurs, alors sous l’égide d’André Dubosc, est aujourd’hui présidée par Joël Boueilh et dirigée par Olivier Bourdet-Pees. La cave s’est enrichie en 1999 de celles de Crouseilles (Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Béarn) et de Condom (Côtes de Gascogne). Et c’est 1000 producteurs, 5300 ha, 40 millions de bouteilles et 200 salariés. Singulière cave qui possède aussi des  châteaux prestigieux comme Saint-Go, Sabazan, ou encore Cassaigne. La force de Plaimont est écrasante : 98% de l’AOC Saint-Mont, 55% de celle de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, 50% de l’IGP Côtes de Gascogne. Avec des fleurons dans le giron : le célébrissime Colombelle (blanc nouveau, léger et légèrement perlant), l’excellente Madeleine de Saint-Mont (rouge puissant), issu d’une parcelle de la renaissance du vignoble, car plantée en 1880, immédiatement après le passage du phylloxéra. Le Passé authentique (St-Mont blanc sec).
châteaux prestigieux comme Saint-Go, Sabazan, ou encore Cassaigne. La force de Plaimont est écrasante : 98% de l’AOC Saint-Mont, 55% de celle de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, 50% de l’IGP Côtes de Gascogne. Avec des fleurons dans le giron : le célébrissime Colombelle (blanc nouveau, léger et légèrement perlant), l’excellente Madeleine de Saint-Mont (rouge puissant), issu d’une parcelle de la renaissance du vignoble, car plantée en 1880, immédiatement après le passage du phylloxéra. Le Passé authentique (St-Mont blanc sec). Océanide (un St-Mont rosé de caractère). Et le fameux Pacherenc (blanc moelleux) vendangé à Viella dans la nuit de la St-Sylvestre – les premières vendanges de l’année ! Car Plaimont est la cave des coups médiatiques – elle propose depuis peu la confidentielle cuvée Les vignes préphylloxériques, issue de Tannat et de Pinenc « francs de pied » datant de 1871. Ainsi que des partenariats qui décoiffent, comme Jazz in Marciac. Léon Mazzella
Océanide (un St-Mont rosé de caractère). Et le fameux Pacherenc (blanc moelleux) vendangé à Viella dans la nuit de la St-Sylvestre – les premières vendanges de l’année ! Car Plaimont est la cave des coups médiatiques – elle propose depuis peu la confidentielle cuvée Les vignes préphylloxériques, issue de Tannat et de Pinenc « francs de pied » datant de 1871. Ainsi que des partenariats qui décoiffent, comme Jazz in Marciac. Léon Mazzella
Plaimont, 32400 Saint-Mont.
J'ajoute ce portrait express d'un jeune vigneron en AOC Fronton qui fait des vins formidables (paru sur la même page, dans L'Express) :
Le vigneron à suivre : CÉDRIC L'ENCHANTEUR
Lorsqu’il reprend les rênes de la propriété familiale, Cédric Faure, 5è génération au château LaViguerie de Beulaygue, situé au nord de l’AOC Fronton, a 21 ans, un BTS de viticulture-œnologie en poche et des projets plein la tête. Le domaine vendait en vrac au négoce jusqu’en 1995. Cédric révolutionne tout ça avec ses parents, et crée rapidement une gamme de vins qu’il signe de son empreinte. Sublimer la négrette (et la syrah) est l’impératif. Le vignoble de 18 ha jouit d’un sol de rougets, de graviers et de boulbènes qui donnent à « l’enchanteur », la cuvée haut de gamme, sa complexité aromatique. « C’est le fruit d’un travail de fond sur le vignoble, en réduisant les rendements à 25 hl/ha, sur la taille de la vigne afin de faire respirer la négrette, cépage fragile, et d’une sélection parcellaire selon les sols. J’obtiens ainsi des vins où dominent la réglisse, les fruits noirs confiturés. En bouche, l’enchanteur n’a pas de tanins exubérants, mais une souplesse, de l’ampleur et une belle longueur », dit-il. L.M.
La Viguerie de Beulaygue, 1650 chemin de Bonneval, 82370 Labastide Saint-Pierre.
... Au mois d'août, sur l'île propice.

Ci-dessus : boire une bière Kilimanjaro sur la plage de Nungwi, à l'extrême nord de l'île, tandis qu'un dhow (boutre) hisse et part pêcher.
Ci-dessous : The Rock, un restaurant singulier que l'on atteint à pied sec à marée basse et en pirogue à marée haute. Michanwi Pingwe, au sud-est de l'île.
©L.M.
Allez! Tous au kiosque, pour que vive la presse!
(rédaction en chef : Philippe Bidalon, avec Léon Mazzella).
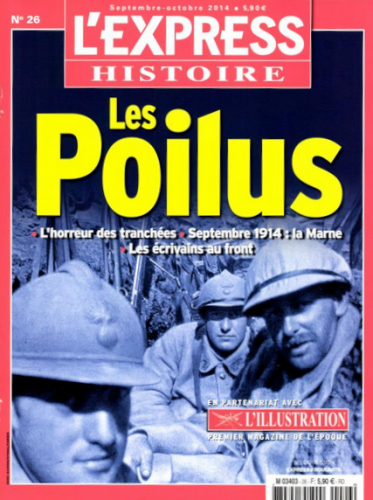


 Papier paru cette semaine dans le spécial vins de L'EXPRESS, conçu et réalisé par Philippe Bidalon (photo : © Jean Brana) :
Papier paru cette semaine dans le spécial vins de L'EXPRESS, conçu et réalisé par Philippe Bidalon (photo : © Jean Brana) :
 Stéphane Guibourgé a écrit Les fils de rien, les princes, les humiliés avec une mitraillette Sig. C’est percutant, uppercutant même, ça claque, c’est sec, les phrases sont ultra courtes, dépouillées, elles crissent, cognent, frappent, trouent, cassent, craquent comme des os. Ca flingue du regard, des pieds chaussés de rangers, ça use du couteau et de l’arme de poing à dix coups. C’est épuré jusqu’au sang. Dans ce magma de violence urbaine inouïe, il y a une infinie tendresse, une humanité dans les silences de Falco, le narrateur. 1982, ambiance de grèves dures en France. Nous suivons une bande de skins, de desperados tatoués aux insignes nazis et qui commencent par voler des Mercos et des Béhèmes dans les quartiers chics pour rouler le plus vite possible en hurlant leur néant du bon côté du périphérique, puis à cogner, et enfin à tuer. Seule la haine les fait bander. Ces princes sont issus de pères humiliés, ouvriers, chômeurs, dignes jusqu’à l’épure, mais qui ont échoué à vouloir contenir leurs fils en blousons noirs. Des fils qui marquent les filles à vie, violent dur, cassent indifféremment du bicot et du youpin, du SDF à l’occasion, pour rien, parce qu’ils sont les enfants d’une vie absurde dressée comme un mur d’au-delà de la honte – le mur d’une fierté nihiliste, violente jusqu’à la folie. Falco (son nom au sein de la Meute) se souvient, vingt-cinq ans après, de ses années destroy, lorsqu'il bascula, tandis que cet homme blessé qui habite sa fêlure, désormais retiré du monde, en pleine montagne, ne songe plus qu’à construire une maison pour son propre fils, en tentant de se reconstruire aussi, de chasser hors de lui une estime de suie. Ils se souvient des loups, de la Meute, de cette horde sauvage qui était sa vie. La fraternité de la Meute est alors la plus solide soudure du monde. Ils sont frères du sang des autres. Le cœur sec, les mains gonflées par la douleur des coups trop donnés sur la gueule de bâtards, le corps entier tuméfié par les coups trop tirés dans le ventre de petites salopes. De nombreux flash-back ponctuent ce roman admirablement construit, et qui décrit un Falco - redevenu homme - écorché vif, infiniment sensible aux premières lueurs de l’aube, au galop de son chien Sands, à l’envol d’un oiseau ; au regard de son fils. Car, si la fraternité et la violence sourde, ourdie, enfouie, mais qui éclate parfois comme le pire des volcans, parsèment l’œuvre romanesque de Stéphane Guibourgé, c’est la filiation qui habite le cœur de ses romans. La quête du père ; l’obsession de la transmission. L’amour du père aussi, par delà le bien et le mal, la difficile définition du fils, la tension du fil, la construction de l'homme. Falco se souvient des coups du père, ouvrier de l'usine Citroën de Poissy. Il le cognait chaque soir, sans raison, sous les yeux du frère qui se taisait, et il serrait les dents à se faire péter les mâchoires. Au sein de la Meute de skinheads qui l’adoube, avec Lev, le chef qui devient une sorte de nouveau père, un être enfin admirable, un prophète, il apprend le mépris, la justice ou l’injustice, c’est pareil. L’instinct fauve, la barbarie. Il guette l’acédie du monde, l’indifférence glacée, incendie sa vie, tue un homme à dix-huit ans, comme ça, fait de la taule, en sort davantage durci, hanté, poisseux ; sa vie est infectée. Demain est une illusion d'alliance, lit-on dans cette confession (de la rédemption) d'un homme de quarante-sept ans, revenu de cet autre monde. Mais cela reste un roman. De 200 pages à 200 à l'heure. D’une beauté redoutable, immense, crue. A la fois lisse et dure comme une balafre.
Stéphane Guibourgé a écrit Les fils de rien, les princes, les humiliés avec une mitraillette Sig. C’est percutant, uppercutant même, ça claque, c’est sec, les phrases sont ultra courtes, dépouillées, elles crissent, cognent, frappent, trouent, cassent, craquent comme des os. Ca flingue du regard, des pieds chaussés de rangers, ça use du couteau et de l’arme de poing à dix coups. C’est épuré jusqu’au sang. Dans ce magma de violence urbaine inouïe, il y a une infinie tendresse, une humanité dans les silences de Falco, le narrateur. 1982, ambiance de grèves dures en France. Nous suivons une bande de skins, de desperados tatoués aux insignes nazis et qui commencent par voler des Mercos et des Béhèmes dans les quartiers chics pour rouler le plus vite possible en hurlant leur néant du bon côté du périphérique, puis à cogner, et enfin à tuer. Seule la haine les fait bander. Ces princes sont issus de pères humiliés, ouvriers, chômeurs, dignes jusqu’à l’épure, mais qui ont échoué à vouloir contenir leurs fils en blousons noirs. Des fils qui marquent les filles à vie, violent dur, cassent indifféremment du bicot et du youpin, du SDF à l’occasion, pour rien, parce qu’ils sont les enfants d’une vie absurde dressée comme un mur d’au-delà de la honte – le mur d’une fierté nihiliste, violente jusqu’à la folie. Falco (son nom au sein de la Meute) se souvient, vingt-cinq ans après, de ses années destroy, lorsqu'il bascula, tandis que cet homme blessé qui habite sa fêlure, désormais retiré du monde, en pleine montagne, ne songe plus qu’à construire une maison pour son propre fils, en tentant de se reconstruire aussi, de chasser hors de lui une estime de suie. Ils se souvient des loups, de la Meute, de cette horde sauvage qui était sa vie. La fraternité de la Meute est alors la plus solide soudure du monde. Ils sont frères du sang des autres. Le cœur sec, les mains gonflées par la douleur des coups trop donnés sur la gueule de bâtards, le corps entier tuméfié par les coups trop tirés dans le ventre de petites salopes. De nombreux flash-back ponctuent ce roman admirablement construit, et qui décrit un Falco - redevenu homme - écorché vif, infiniment sensible aux premières lueurs de l’aube, au galop de son chien Sands, à l’envol d’un oiseau ; au regard de son fils. Car, si la fraternité et la violence sourde, ourdie, enfouie, mais qui éclate parfois comme le pire des volcans, parsèment l’œuvre romanesque de Stéphane Guibourgé, c’est la filiation qui habite le cœur de ses romans. La quête du père ; l’obsession de la transmission. L’amour du père aussi, par delà le bien et le mal, la difficile définition du fils, la tension du fil, la construction de l'homme. Falco se souvient des coups du père, ouvrier de l'usine Citroën de Poissy. Il le cognait chaque soir, sans raison, sous les yeux du frère qui se taisait, et il serrait les dents à se faire péter les mâchoires. Au sein de la Meute de skinheads qui l’adoube, avec Lev, le chef qui devient une sorte de nouveau père, un être enfin admirable, un prophète, il apprend le mépris, la justice ou l’injustice, c’est pareil. L’instinct fauve, la barbarie. Il guette l’acédie du monde, l’indifférence glacée, incendie sa vie, tue un homme à dix-huit ans, comme ça, fait de la taule, en sort davantage durci, hanté, poisseux ; sa vie est infectée. Demain est une illusion d'alliance, lit-on dans cette confession (de la rédemption) d'un homme de quarante-sept ans, revenu de cet autre monde. Mais cela reste un roman. De 200 pages à 200 à l'heure. D’une beauté redoutable, immense, crue. A la fois lisse et dure comme une balafre.
-------
Fayard, 12€, en librairie le 20 août.
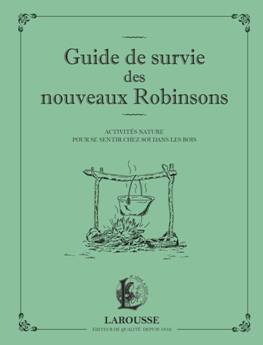 C'est le genre de petit bouquin qu'on adore : le Guide de survie des nouveaux Robinsons, de l'ethnobotaniste François Couplan (Larousse, 4,99€) est un cahier plein d'astuces pour nous aider à nous débrouiller seul en pleine nature, et à glisser entre toutes les mains et surtout dans les petits sacs à dos des enfants - qui adorent ce genre de livre, eux aussi. On y apprend à distinguer les plantes sauvages comestibles entre elles (impossible de ne pas penser à la fin tragique du film Into the wild), à se construire un abri sûr à partir de branchages, à fabriquer une ficelle costaud, un matelas végétal, à éviter les insectes importuns, à s'orienter sans boussole, à se chauffer sans briquet, à savoir quoi faire sans paniquer lorsqu'on s'est perdu en forêt... De quoi donner, justement, envie de se perdre vraiment.
C'est le genre de petit bouquin qu'on adore : le Guide de survie des nouveaux Robinsons, de l'ethnobotaniste François Couplan (Larousse, 4,99€) est un cahier plein d'astuces pour nous aider à nous débrouiller seul en pleine nature, et à glisser entre toutes les mains et surtout dans les petits sacs à dos des enfants - qui adorent ce genre de livre, eux aussi. On y apprend à distinguer les plantes sauvages comestibles entre elles (impossible de ne pas penser à la fin tragique du film Into the wild), à se construire un abri sûr à partir de branchages, à fabriquer une ficelle costaud, un matelas végétal, à éviter les insectes importuns, à s'orienter sans boussole, à se chauffer sans briquet, à savoir quoi faire sans paniquer lorsqu'on s'est perdu en forêt... De quoi donner, justement, envie de se perdre vraiment.