La napolitude
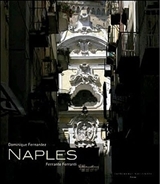 Connnaissez-vous la napolitude ? Ce terme désigne l’univers cosmopolite et chatoyant, multiculturel –à la fois espagnol, grec, africain de Naples, qui est sûrement la ville la plus séduisante et la plus ensorcelante d’Europe (du Sud). Démesurée, débordante, exagérée, toujours dans cet excès à deux doigts du troppo, cette ville d’art, de vitalités énormes et disparates, offre un charme capital qui touche. Et fort. Dominique Fernandez, Napolitain de cœur depuis toujours, signe un livre de plus –mais quel magnifique album ! avec Ferrante Ferranti, photographe (Imprimerie Nationale, 59€, parution le 20 avril) qui nous montre une Naples splendide et arrogante, sensuelle et infiniment artistique, scandaleuse et talentueuse. Naples semble se foutre du tourisme lisse et mondialisé. Elle laisse cela aux cités du Nord de la Botte. Dire du mal d’elle (ville de voleurs, de poubelles non ramassées, de mafieux et de misère) équivaut à redire de Venise qu’elle est romantique, que les chats sont sournois et la mer… humide. C'est s'arrêter à l'écume, au fard, au cliché. Pour le passager au regard vrai, l’usage de Naples est celui de l’art de voyager, celui qui ne craint jamais le venin. (A dire vrai, je n’aime guère ceux qui font la grimace à l’évocation de cette ville merveilleuse et j’aime ceux dont le regard s’illumine en entendant les six lettres qui forment son nom). Vivre et savourer Naples, c’est marcher jusqu’à se perdre dans Spaccanapoli, c’est errer sur les quais du port, au-delà de la Mergellina, c’est manger une pizza chez Vesi, aller revoir les fresques de Pompéi au Musée, avant de boire un blanc issu de Falanghina en contemplant l’une des plus belles baies du monde. Fernandez est un compagnon formidable, qui aime viscéralement une ville qu’il connaît à fond et cet album sobrement intitulé Naples, est un beau-livre étincelant, dans lequel Fernandez a raison de préciser qu’un amour partagé pour cette ville scelle le voyageur à ses habitants. Il ne suffit pas de prendre un café au Gambrinus, Piazza del Plebiscito (le meilleur du monde), même si ce café littéraire est un bonheur esthétique dans ses salons intérieurs, et qu’il porte la marque d’Oscar Wilde (qui porta à terme sa « Ballade de la geôle de Reading » lors d’un séjour ici : « chacun tue ce qu’il aime »…), si Malaparte en voisin, D’Annunzio en « étranger », Domenico Rea en « local », s’y sont arrêtés souvent, car il faut avant tout se mêler, parler, marcher via Toledo (la plus belle rue du monde, selon Stendhal), via dei Tribunali en se frottant, car il faut affronter, ne jamais ignorer ni avoir l’air de se méfier. Alexandre Dumas, avait déjà compris cela. Que l’on ait la foi ou pas, écoutons ce trait de Cocteau : « Le pape est à Rome, mais Dieu est à Naples ». Fernandez, à propos de Spaccanapoli : « La rue qui ose « fendre » (spaccare) la ville, comme le couteau sépare les deux moitiés de la pastèque, comme l’homme déchire l’intimité de la femme. Une rue-blessure, obscène comme un viol, purulente comme une plaie, joyeuse comme une victoire, rectiligne et secrète, drôle et sévère, populaire et docte. » Je me trouvais à Naples il y a huit jours à peine. Et voilà ! J’ai déjà envie d’y retourner… Au moins pour manger un babà et une sfogliatella chez Scaturchio -la meilleure pâtisserie de Naples, selon Dominique Fernandez, minuscule, planquée près la place San Domenico Maggiore, dans Spaccanapoli. Avant de retourner encore et toujours à Procida. Fernandez achève son texte -superbement illustré par Ferranti, sur l'île de Graziella, et surtout d'Arturo. Il rappelle la dernière phrase du roman d'Elsa Morante (Arturo quitte son île en bateau et se retourne une dernière fois sur le paradis perdu de son enfance -et cette image, que l'on ne retrouve cependant pas tout à fait dans le film -revu hier- qu'en a tiré Damiano Damiani, résonne comme un épisode de l'Odyssée). L'isola non si vedeva piu. On ne voyait plus l'île. Ou, mieux : L'île ne se voyait plus...
Connnaissez-vous la napolitude ? Ce terme désigne l’univers cosmopolite et chatoyant, multiculturel –à la fois espagnol, grec, africain de Naples, qui est sûrement la ville la plus séduisante et la plus ensorcelante d’Europe (du Sud). Démesurée, débordante, exagérée, toujours dans cet excès à deux doigts du troppo, cette ville d’art, de vitalités énormes et disparates, offre un charme capital qui touche. Et fort. Dominique Fernandez, Napolitain de cœur depuis toujours, signe un livre de plus –mais quel magnifique album ! avec Ferrante Ferranti, photographe (Imprimerie Nationale, 59€, parution le 20 avril) qui nous montre une Naples splendide et arrogante, sensuelle et infiniment artistique, scandaleuse et talentueuse. Naples semble se foutre du tourisme lisse et mondialisé. Elle laisse cela aux cités du Nord de la Botte. Dire du mal d’elle (ville de voleurs, de poubelles non ramassées, de mafieux et de misère) équivaut à redire de Venise qu’elle est romantique, que les chats sont sournois et la mer… humide. C'est s'arrêter à l'écume, au fard, au cliché. Pour le passager au regard vrai, l’usage de Naples est celui de l’art de voyager, celui qui ne craint jamais le venin. (A dire vrai, je n’aime guère ceux qui font la grimace à l’évocation de cette ville merveilleuse et j’aime ceux dont le regard s’illumine en entendant les six lettres qui forment son nom). Vivre et savourer Naples, c’est marcher jusqu’à se perdre dans Spaccanapoli, c’est errer sur les quais du port, au-delà de la Mergellina, c’est manger une pizza chez Vesi, aller revoir les fresques de Pompéi au Musée, avant de boire un blanc issu de Falanghina en contemplant l’une des plus belles baies du monde. Fernandez est un compagnon formidable, qui aime viscéralement une ville qu’il connaît à fond et cet album sobrement intitulé Naples, est un beau-livre étincelant, dans lequel Fernandez a raison de préciser qu’un amour partagé pour cette ville scelle le voyageur à ses habitants. Il ne suffit pas de prendre un café au Gambrinus, Piazza del Plebiscito (le meilleur du monde), même si ce café littéraire est un bonheur esthétique dans ses salons intérieurs, et qu’il porte la marque d’Oscar Wilde (qui porta à terme sa « Ballade de la geôle de Reading » lors d’un séjour ici : « chacun tue ce qu’il aime »…), si Malaparte en voisin, D’Annunzio en « étranger », Domenico Rea en « local », s’y sont arrêtés souvent, car il faut avant tout se mêler, parler, marcher via Toledo (la plus belle rue du monde, selon Stendhal), via dei Tribunali en se frottant, car il faut affronter, ne jamais ignorer ni avoir l’air de se méfier. Alexandre Dumas, avait déjà compris cela. Que l’on ait la foi ou pas, écoutons ce trait de Cocteau : « Le pape est à Rome, mais Dieu est à Naples ». Fernandez, à propos de Spaccanapoli : « La rue qui ose « fendre » (spaccare) la ville, comme le couteau sépare les deux moitiés de la pastèque, comme l’homme déchire l’intimité de la femme. Une rue-blessure, obscène comme un viol, purulente comme une plaie, joyeuse comme une victoire, rectiligne et secrète, drôle et sévère, populaire et docte. » Je me trouvais à Naples il y a huit jours à peine. Et voilà ! J’ai déjà envie d’y retourner… Au moins pour manger un babà et une sfogliatella chez Scaturchio -la meilleure pâtisserie de Naples, selon Dominique Fernandez, minuscule, planquée près la place San Domenico Maggiore, dans Spaccanapoli. Avant de retourner encore et toujours à Procida. Fernandez achève son texte -superbement illustré par Ferranti, sur l'île de Graziella, et surtout d'Arturo. Il rappelle la dernière phrase du roman d'Elsa Morante (Arturo quitte son île en bateau et se retourne une dernière fois sur le paradis perdu de son enfance -et cette image, que l'on ne retrouve cependant pas tout à fait dans le film -revu hier- qu'en a tiré Damiano Damiani, résonne comme un épisode de l'Odyssée). L'isola non si vedeva piu. On ne voyait plus l'île. Ou, mieux : L'île ne se voyait plus...
Et dans la seule traduction disponible en Français (de Michel Arnaud, 1963, pour Gallimard), cela donne : On ne voyait plus mon île. J'aime assez cette appropriation par Arturo d'une île aux dimensions modestes, car cela renvoie une fois encore -dans la langue de Morante- à un réflexe d'enfant).
Commentaires
Vivre et savourer Naples..
Encore et encore