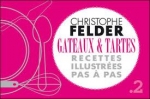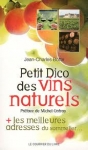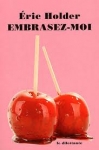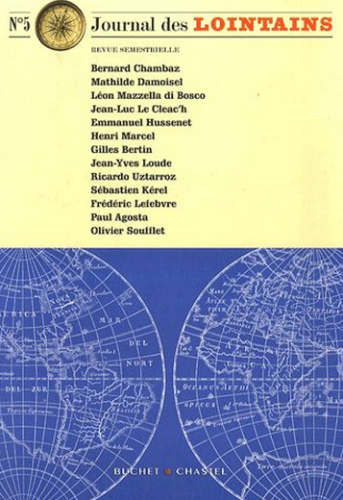 L'une des magies d'Internet est de retomber sur un texte ancien, de le relire et de se dire : ça tient encore la piste (ayant davantage emprunté des chemins de traverse qui ont toujours engendré mes chemins d'écriture -que des routes droites et balisées), et de se dire donc : tiens, et si je le mettais en ligne, celui-ci... En voici donc un, dans les archives, qui fut publié par feu Le Journal des Lointains, que l'écrivain Marc Trillard dirigeait chez Buchet-Chastel. Une revue-livre littéraire dédiée au grand reportage; un ancêtre des mooks d'aujourd'hui, abondamment illustrés -à l'instar de l'emblématique revue XXI (Les Arènes), ou bien du jeune Long Cours (L'Express). Cela se passait au Kazakhstan en 1997. Et fut publié dix ans après (en général, je publie dix ans après).
L'une des magies d'Internet est de retomber sur un texte ancien, de le relire et de se dire : ça tient encore la piste (ayant davantage emprunté des chemins de traverse qui ont toujours engendré mes chemins d'écriture -que des routes droites et balisées), et de se dire donc : tiens, et si je le mettais en ligne, celui-ci... En voici donc un, dans les archives, qui fut publié par feu Le Journal des Lointains, que l'écrivain Marc Trillard dirigeait chez Buchet-Chastel. Une revue-livre littéraire dédiée au grand reportage; un ancêtre des mooks d'aujourd'hui, abondamment illustrés -à l'instar de l'emblématique revue XXI (Les Arènes), ou bien du jeune Long Cours (L'Express). Cela se passait au Kazakhstan en 1997. Et fut publié dix ans après (en général, je publie dix ans après).
Nota Bene : c’était à la période où Lady Di mourût. Je l’appris avec une semaine de retard. Dans la steppe où je me trouvais –à huit mille cinq cents kilomètres de Paris, trois mille cinq cents de Pékin, à cinq heures de piste d’un premier village et à dix-huit du premier centre de soins hospitaliers, le monde pouvait tourner en vrille sans que je le sache. Et c’était bien ainsi… Surtout de réaliser qu'avec mes compagnons de fortune, nous faisions partie des rares humains qui apprenaient cette nouvelle planétaire avec tant de retard, en tombant sur ses portraits qui inondaient le kiosque à journaux de l'aéroport d'Istanbul, au retour de notre longue virée.
AU CUL DES COQS DANS LA BRUYERE KAZAKH
29 août. Vol Paris-Istanbul. Escale dans la capitale turque. Eternelle magie du voyage. Jusque dans les façons de faire pour reconnaître individuellement ses bagages sur la piste, avant de remonter dans l’avion... Ce qui me ravit délicieusement énerve toujours quelques grincheux qui ont vite recours à l’adjectif sauvage pour désigner les us d’une civilisation étrangère. C’est affligeant. Les veneurs qui sont du voyage et qui tenteront de prendre un cerf maral –le plus gros du monde- avec leur meute de quarante-deux chiens solognots et les petits chevaux kazakhs, sont moins cul pincé que je ne le craignais. Ils sont même assez chauds : chaque femme qui passe est déshabillée du regard et abordée sans ambages. Ils aiment aussi l’alcool et les cigares et semblent peu habitués à voyager. C’est de bon augure. Touffeur. Attente. Retard (prévisible) de l’avion pour Alma-Ata (j’ai du mal à dire ou à écrire Almaty car Alma-Ata, c’est comme Samarkand et Zanzibar, comme la route de la soie ou celle des épices : du rêve brut). Vendeurs de loukoums. La photo de Carole Bouquet au duty-free. Bu une bière tiède. 21 heures (locales). L’avion est plein. Beaucoup de chinois et de mongols, j’avoue ne pas les distinguer avec certitude.
Vol Istanbul - Alma-Ata. 4 h 45 dans les airs. Il sera environ cinq heures du matin à l’arrivée (heure kazakh), soit environ deux heures du matin ce samedi 30 août en France. Là, nous avons le choix entre une visite de la capitale du Kazakhstan (aux allures de cité russe formée de gros cubes de béton triste), puis prendre un avion réputé improbable, voire périlleux (2 h 30 de vol) ou bien se taper, avec les chiens, environ trente heures de bus sur les « routes » …
Autrement écrit, mon choix est fait. Je testerai le talent des pilotes de la Kazakhstan Airlines.
Almaty signifie « le village des pommiers ». Kazakh, selon la même source –une brochure égarée-, signifie brigand, rebelle, guerrier nomade en lutte contre l’Etat, et ses compatriotes. De tels éclairages laissent à penser qu’un tel pays ne peut pas avoir de mauvais fond.
Alma-Ata est appelée Almaty depuis le printemps 1993. Je reprends mes deux vieux Hemingway dans l’édition de La Pléiade. Les exemplaires sont fatigués, usés par les voyages que nous avons faits ensemble. Mais là, c’est différent, je les sors de la routine africaine, puisque je les ai emmenés en Asie.
31 août. Après le vol Almaty – Ust-Kamenogorsk (vite surnommé : Ouste ! Calmez les gosses), à bord d’un avion d’une vétusté de cheval fourbu et de camion retraité -il n’y avait même pas de ceinture de sécurité à mon siège- , nous avons pris la route. Huit heures de bus prévues. Il y en aura dix-huit.
Nous sommes déjà dimanche matin, il est 7 h 30, et nous avons dormi dans le bus, habillés, sur des sièges durs comme du bois ; au bord d’un lac immense, en attendant le bac qui doit nous faire passer. Malgré nos fusées éclairantes et notre klaxon qui déchirait un silence de nuit dans le désert, il n’est pas arrivé à l’heure, hier soir. L’explication est simple, et courante : l’équipage était fin saoul, à bord. Nous entendions leurs chants d’ivresse. Le bac a passé la nuit en face… Aube. Un vol de canards passe au ras de l’eau. Il y a des mouettes et, curieusement, des pigeons bisets surgis de nulle part, et une longue file de camions et de voitures derrière nous. Les Russes qui nous accompagnent sont toujours souriants et aimables. Depuis hier, nous mangeons un pain dur et gris, du saucisson de cheval, une sorte de gros fromage de vache à pâte molle, des petits-beurre et de l’eau gazeuse légèrement salée dans des bouteilles de plastique trop mou. Ce matin, ils ont trouvé le moyen de faire du thé : un bonheur ! Hier soir, l’atterrissage de notre petit Tupolev sur la piste d’Ust-Kamenogorsk fut splendide. Il était environ 19 heures, la lumière était douce et le paysage infiniment serein, vert amande. Rivière argentée, montagnes au loin, longue, longue plaine à donner envie de chevaucher sans fin. Un paysage de film russe. Nuit dans le bus qui cahotait, puis, à l’arrêt, dans le même bus, à la recherche du sommeil, entassé comme les autres sur les sacs et les sièges, la tête contre mon barda, dur, avec la mallette à cartouches pour oreiller, ma veste de chasse pour couverture et mes pataugas aux pieds depuis maintenant plus de 48 heures. Nous sommes précisément à Buhtarma. Cette première nuit kazakh fut si étoilée que j’ai trouvé –pour la première fois -, qu’il y en avait trop ! Et toujours ce temps superbe, bleu dur.
Traversée en bus de la steppe. Je me serais cru dans « Urga » et dans « Soleil trompeur », les films magnifiques de Nikita Mikhalkov, surtout lorsque nous avons perdu notre route (l’épisode fameux du camion qui cherche à retrouver son chemin, dans « Soleil trompeur », et qui traverse tout le film, ne quittera pas mon esprit pendant tout le voyage).
Arrivée après 5 h 30 de chaleur, de poussière fine et pénétrante, de chaos qui faisaient ruer le camion-bus, au campement de yourtes. Le paysage immédiat est montagneux. Nous sommes à 1500 mètres d’altitude. Tout autour du campement,une large plaine sauvage d’herbes sèches qui alterne curieusement avec des champs de blé, car on a de la peine à imaginer que l’homme puisse travailler le sol ou autre chose, ici, si loin de tout.
J’ai vu une énorme crotte d’ours fraîche, en partant pour la première chasse. Charmant, lorsque l’on s’en va chercher des petits coqs de bruyère. Les ours viennent dans les champs, la nuit. Il y en a beaucoup, paraît il. C’est un brun assez semblable au notre. Les loups aussi sont nombreux par ici. Les tétras-lyre sont en revanche assez rares. Le paysage m’évoque les plateaux de Castille. Je retrouve aussi la Russie des grands tétras. Mais foin des comparaisons, je découvre surtout le Kazakhstan dans toute sa beauté sauvage. Pas un avion ne passe, pas une trace blanche, donc, pour rayer le ciel bleu, ni l’écho d’un bruit. Cela devient rare. Au cours du premier dîner sous la yourte-restaurant, un chasseur de maral cita cette phrase fameuse de Charles X, dans une lettre à sa femme : « Madame, il fait grand vent et j’ai pris trois loups »…
1 septembre. Aujourd’hui, je n’ai tiré que deux cartouches avec mon petit calibre vingt : deux tétras au tableau (pourvu que ça dure). Les paysages sont splendides. Les couleurs d’automne : mordoré, jaune, rouge, habillent les arbres dont les tons changent vite. La montagne est sèche, l’herbe et les bois cassants. Le vent est tiède et très desséchant aussi. Nos lèvres gercent et se fendent. Le guide de chasse kazakh fut un peu benêt : il semblait découvrir les territoires en même temps que nous, mais la journée fut belle. Nous avons trouvé un piège à ours artisanal : un braconnier avait installé une carcasse de cheval (et une autre de chien, ou bien c’était la victime du piège devenue appât). L’entrée du piège était barrée d’un fil de pêche tendu à hauteur d’un ours marchant à quatre pattes. Une grosse branche avait été disposée pour forcer l’animal à entrer ainsi car, au bout du fil, la détente d’un vieux fusil à un coup du type Simplex ou Baïkal, solidement attaché et dissimulé, devait porter un coup de feu à la tête et à bout portant. C’était la seule entrée du piège : les trois autres côtés étaient barrés par d’épais branchages. Les braconniers font cela pour la peau de l’ours.
Au retour, je me suis baigné dans l’eau glacée d’un torrent, sous l’œil d’un aigle (et de Samia, l’unique femme de l’équipée. Elle a dix-neuf ans, son bac en poche, et s’offre un grand voyage dépaysant parce qu’elle adore la chasse. Elle est très belle. Très blonde. D’origine Germanique. Vierge, sans doute). Vivifiant à crier ; le bain.
La soirée fut longue et arrosée, placée sous les signes entrelacés de la vodka et des chansons ; nous avons ri sous les étoiles très tard dans la nuit, avec nos compagnons kazakhs, jusqu’à ce qu’un chasseur se mette à hurler depuis sa yourte, « vos gueules ! ».
Bonne nuit.
Mardi 2 septembre. Ce matin, réveil vers 9 h 30, calmement. Nous allons monter les chevaux kazakhs. Aucune chasse n’est prévue, sauf que j’ai envie, avec mes deux compagnons de chambrée (ou de yourte) d’aller faire un tour à cheval, carabine en bandoulière, là où passent parfois les loups, selon les guides ; puis de vérifier si la bécassine solitaria, qu’un veneur m’affirme avoir levé, se trouve encore autour du petit marigot, au-delà du campement. L’équipe de TF1 est arrivée dans la nuit. Ils dorment, sauf Christophe, qui prépare le tournage en lisant sa documentation. Il fait grand vent (doux) et je n’ai pas vu, pas pris, de loup…
J’ai bu l’eau de la rivière et ne fut pas dérangé. Il est recommandé, avant cela, de vérifier si une carcasse de cheval ne traîne pas dans l’eau, en amont ; les kazakhs ayant la fâcheuse manie d’abandonner dans le courant et pas sur l’herbe. Nous sommes au cœur de la civilisation du cheval : le peuple kazakh, nomade, le monte (ils semblent nés sur une selle) et le mange.
Merveille de pouvoir ainsi boire l’eau pure d’un pays sauvage, préservé (je serai sourd, tout au long du séjour, aux dires concernant les essais nucléaires répétés –mais où ?- et sur la radioactivité élevée du pays)… Après-midi douce. Lumière extraordinaire, à rendre fou un photographe. Les bouleaux prennent un peu plus d’automne chaque jour. Monter à cheval dans un tel paysage n’a pas d’équivalent. Nous avons tourné ensemble, avec TF1, notre recherche de la bécassine solitaire. Nous n’en avons vu (et pris) qu’une ordinaire. Et examiné de belles crottes d’ours pleines de baies à peine digérées. Certains ont aperçu des loups. Demain, les veneurs chasseront. Les chasseurs à tir comme moi pourront les suivre à cheval ou bien marcher derrière les coqs de bruyère, ailleurs. Je ne partirai pas avec les veneurs à cause des plaies que la selle kazakh, a déjà infligé à mes fesses. Il est question de faire une battue au loup, après-demain. Puis de partir vers un camp volant dans les parages duquel vivraient quelques chevreuils de Sibérie et de nombreux tétras. Chouette programme en perspective. L’impression de dépaysement que je ressens est telle que le mot dépaysement me paraît désuet. J’ai la flemme de chercher le mot ad hoc.
De là, nous passerons à nouveau par Ust-Kamenogorsk.
Bonheur de se laver dans la rivière ou de prendre un banhia, cette sorte de sauna russe improvisé sous une yourte hermétique, qui garde la chaleur d’un poêle. De laver mes vêtements dans le courant du ruisseau, d’observer ces ciels incroyablement étoilés. Samia, dans la yourte qui abrite le banhia, m’a appelé pour que je vienne lui frotter le dos. Je l’ai fait avec reconnaissance.
Isolement et bonheur simple. Ce soir, les veneurs et leurs 42 chiens sont partis bivouaquer loin d’ici, pour chasser de bonne heure demain. Sans les aboiements incessants de la meute, parquée dans un chenil de fortune, la nuit sera plus calme.
Mercredi 3 septembre. Ce matin tôt, quatre loups sont passés en trottant sur la crête au-dessus du campement, à une centaine de mètres, tandis que j’achevais mon thé. Un cheval découpé hier, et dont les restes ont été laissés sur place, à proximité des yourtes, les aura attirés. Ils se sont arrêtés, m’ont regardé, et disparu dans la coupure du jour, à l’embrasement de l’aube. Le camp est vide, nous partons chasser le coq. Il fait froid la nuit, et chaud durant la journée. A huit heures, le pull-over devient incommodant. Journée dure (physiquement) mais saine, beaucoup d’oiseaux défendant chèrement leur peau, crapahut sur des crêtes et des pentes escarpées, échappée belle et montagnarde. Comme j’aime. Nous avons appris à boire l’eau des ruisseaux, à plat ventre, à l’aide d’une paille que l’on confectionne en coupant une branche de sureau. Bain, presque nus, dans la rivière. Le bonheur inouï procuré par la première gorgée de cette bière locale, même tiède, appelée « Faxe », lorsqu’on ne l’attend pas, ou plus…
Et cette soif immense, ce bonheur de boire à une source qu’il faut imaginer pure, ou bien à laquelle il vaut mieux ne pas penser. Volodia, le chauffeur, m’a tendu depuis son camion un verre de vodka kazakh, au moment où le soleil disparaissait à l’horizon et où des tétras-lyre quittaient les vallées fraîches pour se rendre au gagnage dans les champs de blé, sur les plateaux. Plaine rase et paysage infini de montagnes mauves. Au cours du dîner, les veneurs ont raconté comment ils avaient « attaqué » un cerf maral ce matin, puis leur déconvenue, la perte de plusieurs chiens. Le banhia fut salutaire, après cette journée écrasante de chaleur. Je me serais cru à nouveau sur les plateaux de Castille en août, lorsque l’on y chasse la caille ; ou en Corse –le grésillement perpétuel des insectes en moins. Avant de dîner, j’ai pris un cheval sellé et, carabine dans le dos, suis parti au-delà des collines qui entourent le campement, avec l’espoir d’apercevoir encore quelque loup…
Je repense aux quatre silhouettes de l’aube. Longtemps, je les verrai repasser dans ma tête, sur cette crête découpée comme une mâchoire.
Jeudi 4 septembre. Affût à l’ours, très tôt. Nous sommes partis chevaucher vers 5 heures 30 et nous nous sommes postés loin de nos chevaux, éloignés de plus de quatre cents mètres les uns des autres, derrière des rochers. J’étais flanqué de l’équipe de TF1, qui a l’habitude de rester immobile et silencieuse. À midi, nous avions pour invités quelques apparatchiks locaux, sans doute attirés par un possible bakchich. Les organisateurs français de ces chasses doivent savoir les flatter de temps à autre… Ce soir, je reprendrai un cheval sellé et je repartirai en balade jusqu’au couchant, ma carabine dans le dos et les jumelles battant mon ventre, « dans la nature, heureux comme avec une femme » (Rimbaud) à moins que Samia ne veuille m’accompagner.
Vendredi cinq septembre. Temps couvert. Je n’ai pas eu le courage de me lever à 5 heures pour aller à la rencontre des loups avec mes compagnons de yourte, et je m’en veux. Une grande battue collective est organisée aujourd’hui. Ours, loups, marals, chevreuils de Sibérie et autres lynx peuvent être aperçus. Nous ne verrons rien. Sauf un paysage grandiose et des lumières d’une beauté rare. Le meilleur, ce fut de retourner à cheval jusqu’au campement (l’aller avait été effectué en camion) : deux heures trente de galop et de trot, à cinq cavaliers, dont un kazakh facétieux qui veillait sur nous et s’amusait à tenter d’attraper nos chevaux au lasso, et à essayer de dénouer nos selles pendant le galop. Nous avons fait la course sur les chemins avec eux, et j’étais comme un cosaque de sous-préfecture.
Samedi six septembre. Il a plu toute la nuit et il ne fait plus chaud mais assez frais. Il paraît que la neige peut arriver très vite et qu’en quelques jours nous passions d’un climat estival à l’hiver, le vrai, avec une épaisse couche de neige. Les kazakhs commencent d’ailleurs à démonter quelques yourtes. Le campement sera bientôt déplacé vers une zone plus clémente. Chasse au tétras. Le peu d’oiseaux que nous réussissons à capturer améliorent l’ordinaire, fait de cheval à midi et de cheval le soir… Nous avons dormi sur les chaumes, à l’abri du camion, après le casse-croûte de midi. Passée aux coqs, le soir. Les voir planer, ailes arquées, comme des bolides d’un autre temps, est un ravissement. Je ne peux me résoudre à les tirer, ce soir. Les copains s’en chargent. Nous en plumerons pour le dîner.
Dimanche sept septembre. Nous quittons le campement. Le long trajet de retour commence. Journée passée dans le bus, depuis les yourtes que nous avons longtemps regardées derrière nous et à travers le nuage de poussière du camion, jusqu’à Ust-Kamenogorsk, via le bac qu’il fallut bakchicher de plus de 200 dollars afin qu’il parte plus vite, ceci pour ne pas rater l’avion. Nous l’avons eu (nouveaux bakchichs et palabres interminables avec les autorités pour les armes et l’excédent de poids, qui grève nos réserves en liquidités).
Délices et affres du voyage dans un bus fatigué de rouler comme un vieux canasson fourbu. Les arrêts, les pauses, les petites pannes et ça repart, les sautes d’humeur du moteur, la côte qui essouffle le vieux cheval de métal jusqu’à l’inquiétude, l’inconfort auquel personne ne fait plus attention ; la beauté salutaire, salvatrice, des paysages immenses et ces lumières splendides du Kazakhstan effacent tous les déboires ordinaires –lesquels, de toute façon, font le piment de tout voyage. « Sérénité crispée », préciserait René Char.
Au bac, devant le lac, des gamins qui ne semblent rien posséder nous ont offert des poissons séchés, un homme nous a servi de la vodka maison qui tenait de l’éther et du désinfectant domestique, et une femme est venue ajouter une pastèque à ces dons du fond du cœur. Vive émotion parmi nous (si j’excepte les propos déplacés, mais vite matés, sur la nourriture pleine de microbes qu’il ne faut pas toucher…). Dîner rapide à Ust-K., dans un restaurant sinistre, dans cette ville sinistre elle aussi. Le Tupolev, aussi usé que le bus, a péniblement décollé pour Alma-Ata. Une hôtesse est venue me demander si je possédais un revolver. Ma voisine de gauche sera habitée par le soupçon jusqu’à l’arrêt complet de l’appareil à l’arrivée. Au restaurant, quelques heures auparavant, nous fûmes comme des enfants, plantés devant une grande glace : après tant de jours sans nouvelles du monde ni de nous-même, certains se sont trouvés amaigris et bronzés.
Sur le trajet du retour, lors de haltes dans des hameaux, j’ai offert quelques couteaux de poche et des dizaines de stylos. Les couteaux pour les hommes, les stylos pour les enfants (et des regards pour les femmes) parce que la culture se transmet par le trait (par l’écrit ou par le dessin). Et que donner un stylo (là où on n’en trouve aucun) me semble être un geste symbolique fort, davantage que l’illustration caricaturale du colonisateur qui jette les bics aux gamins africains, du haut de son 4x4 filant à vive allure…
Lundi 8 septembre. Départ d’Alma-Ata après une courte nuit à l’hôtel. Blattes, robinetterie défectueuse, eau brune, personnel froid, lit passable, interminables formalités administratives avant d’obtenir la clé de la chambre ne m’ont jamais exaspéré. Ailleurs comme ici. Surtout ici où, dès lors que l’on est immergé dans les difficultés locales, notre patience se renforce et le chasseur voyageur acquiert une certaine sérénité devant toute difficulté.
Vol pour Paris via Istanbul. Survol magnifique de la Géorgie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie. Ciel bleu dense et montagnes enneigées. Nous sommes passés juste au-dessus de Tbilissi. Transit en Turquie. Certains d’entre nous en ont marre : c’est ce fameux empressement de retrouver son chez soi aussitôt que nous sommes sur le chemin du retour… Plusieurs d’entre nous toussent ; moi, j’ai mal à la gorge et ne parviens pas à faire cesser un saignement de nez intermittent depuis plusieurs jours. D’autres ont de sérieux problèmes intestinaux, c’est la « tourista » de règle (transit double). Dans la salle d’embarquement, bigarrée comme j’aime, le contraste saisissant d’une jeune fille en gandoura noire et tchador jusqu’aux yeux, chaussée de baskets vert cru très tendance, aux semelles compensées et walkman sur les oreilles. Je mange des loukoums. Des bébés braillent dans tous les coins. Et il y a toujours un imbécile (blanc) pour se plaindre des étranges manières des étrangers, chez eux... Nous apercevons la ville d’Istanbul au-delà des avions. Elle est très proche. Il est toujours un peu frustrant de ne pouvoir visiter une telle ville lorsque l’on se trouve ainsi entre deux vols ; assignés à résidence. Les yeux verts et les yeux bleus, si clairs, des visages turcs. Leur beauté paysanne rugueuse et forte. Visages d’hommes rudes, durs, comme dans les films de Ylmaz Güney, notamment « Yol ». À côté d’eux, les canons de la beauté dominante, internationale, blonde et pâle, me semblent anémiés, privés de force et de caractère. L’avion est plein d’enfants. Les passagers sont presque tous Turcs. Vont-ils tenter une autre vie en France ? Couleurs, voiles, yeux clairs, regards droits. Paris est raide, devant. Et possède encore le goût rogue de la fadeur jalouse. Partir, vite. Repartir…
©LM
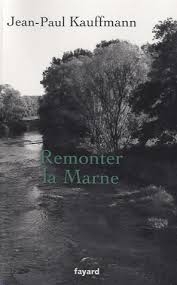 Le livre majeur paru ces derniers mois est Remonter la Marne, de Jean-Paul Kauffmann (Fayard). J'ai lu deux fois ce livre : en l'achevant, je l'ai aussitôt recommencé afin de rester dans la musique, dans la phrase, dans la subtilité des descriptions, l'analyse aiguë des personnages croisés, le choix du mot juste et parfois rare ou oublié, la remarque qui touche, l'extrême sensibilité de l'auteur et puis bien sûr la démarche générale : une pérégrination à la manière des travel-writers comme Jacques Lacarrière (Kauffmann avait d'ailleurs promis à l'auteur de Chemin faisant d'effectuer
Le livre majeur paru ces derniers mois est Remonter la Marne, de Jean-Paul Kauffmann (Fayard). J'ai lu deux fois ce livre : en l'achevant, je l'ai aussitôt recommencé afin de rester dans la musique, dans la phrase, dans la subtilité des descriptions, l'analyse aiguë des personnages croisés, le choix du mot juste et parfois rare ou oublié, la remarque qui touche, l'extrême sensibilité de l'auteur et puis bien sûr la démarche générale : une pérégrination à la manière des travel-writers comme Jacques Lacarrière (Kauffmann avait d'ailleurs promis à l'auteur de Chemin faisant d'effectuer 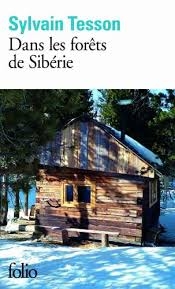 un périple semblable -c'est chose faite), à la recherche de soi-même au détour d'un chemin, dans la fumée d'un havane, à la tombée du soir lorsque la lumière touche à la grâce. Dans la foulée, j'ai lu Dans les forêts de Sibérie, de Sylvain Tesson (folio), que je rapproche du premier. Une longue marche d'un côté, une retraite statique de l'autre, mais un même élan vers la vérité intérieure, la quête des limites, la communion avec le simple, le rugueux, la nature, l'essentiel. L'épure à la fin. Des livres comme ces deux-là sont rares. L'un et l'autre
un périple semblable -c'est chose faite), à la recherche de soi-même au détour d'un chemin, dans la fumée d'un havane, à la tombée du soir lorsque la lumière touche à la grâce. Dans la foulée, j'ai lu Dans les forêts de Sibérie, de Sylvain Tesson (folio), que je rapproche du premier. Une longue marche d'un côté, une retraite statique de l'autre, mais un même élan vers la vérité intérieure, la quête des limites, la communion avec le simple, le rugueux, la nature, l'essentiel. L'épure à la fin. Des livres comme ces deux-là sont rares. L'un et l'autre 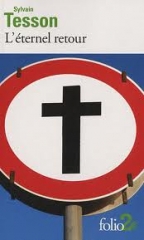 possèdent une écriture somptueuse de surcroît. Je les ai rangés côte à côte à présent, pas trop loin de (presque) tous les autres livres de ces deux auteurs précieux. A noter un folio 2€ de Tesson, extrait de Une vie à coucher dehors (folio) et qui s'intitule L'éternel retour -cinq nouvelles coups de poing. Un petit régal.
possèdent une écriture somptueuse de surcroît. Je les ai rangés côte à côte à présent, pas trop loin de (presque) tous les autres livres de ces deux auteurs précieux. A noter un folio 2€ de Tesson, extrait de Une vie à coucher dehors (folio) et qui s'intitule L'éternel retour -cinq nouvelles coups de poing. Un petit régal. 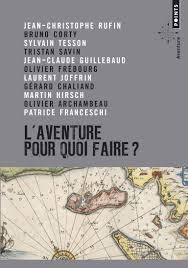 des bourlingueurs nommés Patrice Franceschi (il pilote la collection), Jean-Claude Guillebaud (beau texte intitulé Vers l'autre et vers soi-même), Olivier Frébourg (superbe texte intitulé Fuir seul, vers le seul -le mot est emprunté à Plotin), Sylvain
des bourlingueurs nommés Patrice Franceschi (il pilote la collection), Jean-Claude Guillebaud (beau texte intitulé Vers l'autre et vers soi-même), Olivier Frébourg (superbe texte intitulé Fuir seul, vers le seul -le mot est emprunté à Plotin), Sylvain 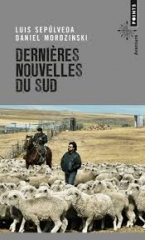
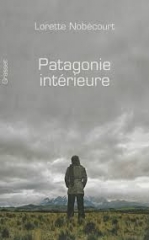 Tesson, Tristan Savin (qui pilote le "mook" Long Cours, auteur ici de la nouvelle forte Le lion de Belfort), Gérard Chaliand, Bruno Corty, Jean-Christophe Rufin, Martin Hirsch, Laurent Joffrin et Olivier Archambeau. L'aventure peut elle encore avoir un sens dans un siècle exploré jusqu'à l'os, où la technologie interdit à l'homme de se perdre, où le principe de précaution et la recherche de sécurité sont des diktats ordinaires digérés ?.. L'altérité, la rencontre vraie, l'esprit de liberté demeurent. "L'aventure ou l'antidote au suicide collectif", écrit l'ami
Tesson, Tristan Savin (qui pilote le "mook" Long Cours, auteur ici de la nouvelle forte Le lion de Belfort), Gérard Chaliand, Bruno Corty, Jean-Christophe Rufin, Martin Hirsch, Laurent Joffrin et Olivier Archambeau. L'aventure peut elle encore avoir un sens dans un siècle exploré jusqu'à l'os, où la technologie interdit à l'homme de se perdre, où le principe de précaution et la recherche de sécurité sont des diktats ordinaires digérés ?.. L'altérité, la rencontre vraie, l'esprit de liberté demeurent. "L'aventure ou l'antidote au suicide collectif", écrit l'ami 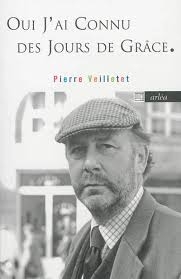 Frébourg, qui pense aussi que "la liberté, ça ne se négocie pas : c'est la part des anges". Parmi les premiers titres de cette collection, outre ce manifeste inédit, citons le très beau livre de Luis Sepùlveda et du photographe Daniel Mordzinski, Dernières nouvelles du Sud -un long voyage en Patagonie, à rapprocher du touchant journal de voyage, Patagonie intérieure, que Lorette Nobécourt publie chez Grasset en plus de son roman sur Hildegarde de Bingen, La clôture des merveilles.
Frébourg, qui pense aussi que "la liberté, ça ne se négocie pas : c'est la part des anges". Parmi les premiers titres de cette collection, outre ce manifeste inédit, citons le très beau livre de Luis Sepùlveda et du photographe Daniel Mordzinski, Dernières nouvelles du Sud -un long voyage en Patagonie, à rapprocher du touchant journal de voyage, Patagonie intérieure, que Lorette Nobécourt publie chez Grasset en plus de son roman sur Hildegarde de Bingen, La clôture des merveilles. genèse, la création, la composition de l'emblématique recueil avec un flip-book qui montre des photos (datant de 1914) d'Apollinaire et de son ami André Rouveyre en train de rire. Il y a aussi des textes admirables de Paul Léautaud, Blaise Cendrars, Pierre Reverdy, Max Jacob, René Guy Cadou, Maurice Fombeure, Louis Aragon, Allan Ginsberg et, plus près de nous, de Jacques Réda, André Velter, Guy Goffette, et Adonis, qui rendent hommage à la beauté d'Alcools. A noter également la publication d'un folioplus sur le recueil, doté d'un solide dossier analytique signé Sophie-Aude Picon.
genèse, la création, la composition de l'emblématique recueil avec un flip-book qui montre des photos (datant de 1914) d'Apollinaire et de son ami André Rouveyre en train de rire. Il y a aussi des textes admirables de Paul Léautaud, Blaise Cendrars, Pierre Reverdy, Max Jacob, René Guy Cadou, Maurice Fombeure, Louis Aragon, Allan Ginsberg et, plus près de nous, de Jacques Réda, André Velter, Guy Goffette, et Adonis, qui rendent hommage à la beauté d'Alcools. A noter également la publication d'un folioplus sur le recueil, doté d'un solide dossier analytique signé Sophie-Aude Picon.  Soixante-dix poèmes écrits au cours des deux dernières années de la vie de Celan, 1967-68, fortement teintés d'un érotisme discret.
Soixante-dix poèmes écrits au cours des deux dernières années de la vie de Celan, 1967-68, fortement teintés d'un érotisme discret.  est précieuse car elle comprend le fac-similé du manuscrit original. Et il est toujours touchant de "lire l'écriture" des écrivains que l'on aime. Ici, les pages sont limpides, sans ratures (l'inverse d'un manuscrit tempétueux, foisonnant, d'un Flaubert ou d'un Proust), et pourtant Verlaine écrivit cela en prison, à Bruxelles,
est précieuse car elle comprend le fac-similé du manuscrit original. Et il est toujours touchant de "lire l'écriture" des écrivains que l'on aime. Ici, les pages sont limpides, sans ratures (l'inverse d'un manuscrit tempétueux, foisonnant, d'un Flaubert ou d'un Proust), et pourtant Verlaine écrivit cela en prison, à Bruxelles,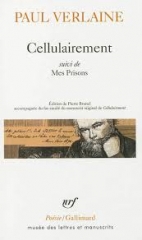 puis à Mons entre 1873 et 1875. La Chanson de Gaspard Hauser et L'Art poétique, entre autres poèmes célèbres, figurent dans ce livre.
puis à Mons entre 1873 et 1875. La Chanson de Gaspard Hauser et L'Art poétique, entre autres poèmes célèbres, figurent dans ce livre.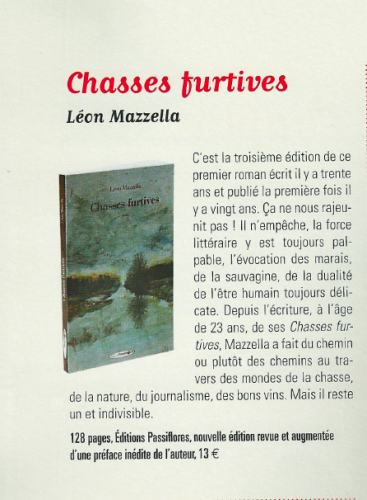
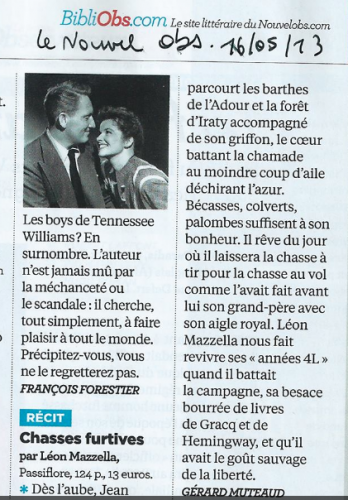

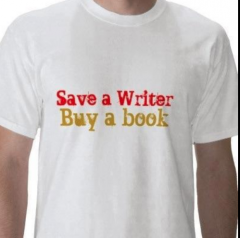
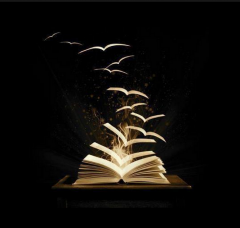
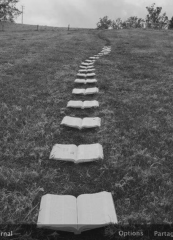
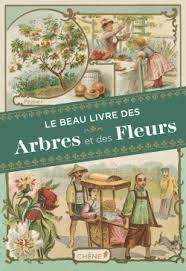 Le beau livre des arbres et des fleurs que signe Dominique Pen Du -journaliste et auteur spécialisée (Chêne, 25€) faisait l'objet de deux ouvrages distincts parus l'an dernier. Réunis en un joli beau volume illustré de chromos anciennes : une page de texte sur un arbre ou une fleur et un chromo en face -telle est la maquette, d'une efficace simplicité, de ce dictionnaire compact de 350 pages. L'ouvrage offre plus de 160 entrées sous formes de fiches où l'anecdote est partout, et l'histoire, les termes vernaculaires, les rappels de certaines croyances dont la botanique est truffée sautent à chaque paragraphe. Le livre va d'Abies Pinsapo (le sapin d'Espagne) à Zinnia (une fleur de la famille des Astéracées), en passant par l'ancolie, la digitale, le mancenillier, le phlox, la reine-des-prés, le sycomore et encore la verveine... Une lecture vivifiante.
Le beau livre des arbres et des fleurs que signe Dominique Pen Du -journaliste et auteur spécialisée (Chêne, 25€) faisait l'objet de deux ouvrages distincts parus l'an dernier. Réunis en un joli beau volume illustré de chromos anciennes : une page de texte sur un arbre ou une fleur et un chromo en face -telle est la maquette, d'une efficace simplicité, de ce dictionnaire compact de 350 pages. L'ouvrage offre plus de 160 entrées sous formes de fiches où l'anecdote est partout, et l'histoire, les termes vernaculaires, les rappels de certaines croyances dont la botanique est truffée sautent à chaque paragraphe. Le livre va d'Abies Pinsapo (le sapin d'Espagne) à Zinnia (une fleur de la famille des Astéracées), en passant par l'ancolie, la digitale, le mancenillier, le phlox, la reine-des-prés, le sycomore et encore la verveine... Une lecture vivifiante.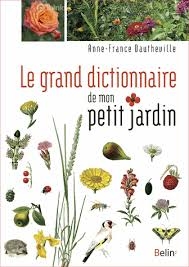 Dans le même esprit, le somptueux Grand dictionnaire de mon petit jardin, d'Anne-France Dautheville (Belin, 28€), paru précédemment chez Minerva, est riche de 400 entrées où l'on passe en revue fleurs, arbres, insectes, oiseaux, maladies, haies, sol et autres serpents ou termes comme la floraison et concepts comme la ruse -car les herbes, mauvaises ou non, savent inventer des tours de passe-passe. Chaque note sur une plante, une fleur, un arbre, un fruit... délivre son bouquet d'informations insolites, d'enseignements historiques, anecdotiques ici aussi ou encore étymologiques. On ressort plus riche de chaque lecture faite au gré. Ce gros livre est de surcroît admirablement illustré de planches en couleurs et il comporte -cerise sur le gâteau-, des petits encadrés systématiques sur la culture (quand et comment planter) et les astuces (pour que ça pousse bien). C'est précieux. Il faut dire que son auteur est une spécialiste très cultivée, une voyageuse qui a sillonné le monde, discuté avec les jardiniers de tous les continents et qu'elle possède une plume alerte.
Dans le même esprit, le somptueux Grand dictionnaire de mon petit jardin, d'Anne-France Dautheville (Belin, 28€), paru précédemment chez Minerva, est riche de 400 entrées où l'on passe en revue fleurs, arbres, insectes, oiseaux, maladies, haies, sol et autres serpents ou termes comme la floraison et concepts comme la ruse -car les herbes, mauvaises ou non, savent inventer des tours de passe-passe. Chaque note sur une plante, une fleur, un arbre, un fruit... délivre son bouquet d'informations insolites, d'enseignements historiques, anecdotiques ici aussi ou encore étymologiques. On ressort plus riche de chaque lecture faite au gré. Ce gros livre est de surcroît admirablement illustré de planches en couleurs et il comporte -cerise sur le gâteau-, des petits encadrés systématiques sur la culture (quand et comment planter) et les astuces (pour que ça pousse bien). C'est précieux. Il faut dire que son auteur est une spécialiste très cultivée, une voyageuse qui a sillonné le monde, discuté avec les jardiniers de tous les continents et qu'elle possède une plume alerte.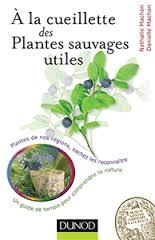 A la cueillette des plantes sauvages utiles. Plantes médicinales, tinctoriales, aromatiques, dépollueuses, fourragères... Ou comment savoir les reconnaître et minimiser le risque si l'on tente une aventure into the wild, ou bien si l'on souhaite par exemple fabriquer une eau de toilette personnalisée, ou vouloir bien identifier, tout simplement, les plantes sauvages entre elles. Tels sont les objets de ce livre très utile signé Nathalie Machon et Danielle Machon (Dunod, 15,90€). Ce guide "nouvelle génération", réalisé en collaboration avec le Muséum national d'Histoire naturelle, est extrêmement fiable et pratique. Il appartient à la collection L'amateur de Nature, qui rassemble des guides de terrain comme celui-ci, richement illustrés (par Delphine Zigoni, en l'occurrence), bourrés d'infos et d'astuces. A glisser dans le sac à dos.
A la cueillette des plantes sauvages utiles. Plantes médicinales, tinctoriales, aromatiques, dépollueuses, fourragères... Ou comment savoir les reconnaître et minimiser le risque si l'on tente une aventure into the wild, ou bien si l'on souhaite par exemple fabriquer une eau de toilette personnalisée, ou vouloir bien identifier, tout simplement, les plantes sauvages entre elles. Tels sont les objets de ce livre très utile signé Nathalie Machon et Danielle Machon (Dunod, 15,90€). Ce guide "nouvelle génération", réalisé en collaboration avec le Muséum national d'Histoire naturelle, est extrêmement fiable et pratique. Il appartient à la collection L'amateur de Nature, qui rassemble des guides de terrain comme celui-ci, richement illustrés (par Delphine Zigoni, en l'occurrence), bourrés d'infos et d'astuces. A glisser dans le sac à dos. Pour un nouvel exotisme au jardin, de Jean-Michel Groult (Actes Sud, 22€), fait le point sur la quête de l'exotisme devenue omniprésente dans nos jardins et ce depuis des lustres. L'auteur, à qui nous devons nombre d'ouvrages sur le sujet botanique (notamment, et parmi les plus récents, Une histoire des plantes politiquement incorrectes, évoquée sur ce blog), parle d'invitation au voyage immobile. Groult pense et démontre que cet exotisme va loin : fruit d'un tourment complexe fait de songes et de passions, il n'exprime pas qu'un aimable dépaysement, mais une façon bien occidentale, d'appréhender une relation au monde. Un essai brillant (admirable troisième chapitre, intitulé tropical pour être honnête).
Pour un nouvel exotisme au jardin, de Jean-Michel Groult (Actes Sud, 22€), fait le point sur la quête de l'exotisme devenue omniprésente dans nos jardins et ce depuis des lustres. L'auteur, à qui nous devons nombre d'ouvrages sur le sujet botanique (notamment, et parmi les plus récents, Une histoire des plantes politiquement incorrectes, évoquée sur ce blog), parle d'invitation au voyage immobile. Groult pense et démontre que cet exotisme va loin : fruit d'un tourment complexe fait de songes et de passions, il n'exprime pas qu'un aimable dépaysement, mais une façon bien occidentale, d'appréhender une relation au monde. Un essai brillant (admirable troisième chapitre, intitulé tropical pour être honnête). 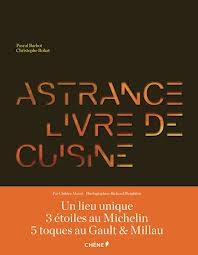 Il est rare que je garde des "beaux-livres" de cuisine, de ces albums à la gloire de, avec des photos léchées abusivement, prises en gros plan avec des floutés et des bougés devenus ringards aujourd'hui, de pleines pages qui sont comme des peintures sur assiette -et on voudrait nous faire croire qu'on feuillette un catalogue d'art contemporain et puis des textes hagiographiques, des dithyrambes, des recettes maquettées comme des poèmes inédits de Rimbaud. Bref, en général, je m'en sépare vite en les offrant à des amies aimant cuisiner et qui se fichent de cette mise en scène et qui les chargent vite en projections de graisse tout en tambouillant, un oeil sur eux, un autre sur le motif; le sujet. Là, je pense aux rares bouquins que j'ai gardés, comme celui de Michel Bras (Rouergue). Il en reste peu. Le pontifiant Une journée à elBulli (Ferran Adria, Phaidon), m'a gonflé -le pape de la moléculaire eut la suffisance de le présenter à la presse à... Beaubourg! Le grand livre d'Hélène Darroze aussi (offert vite). Enfin, bon, là, j'en tiens un vrai, un qui n'est pas prêt de quitter mes lieux : Astrance Livre de cuisine (Le Chêne, 70€). Parce que le bouquin est vraiment somptueux, sous emboîtage, avec son second livre, un cahier de recettes pas-à-pas, qui frappent par leur modestie : Pascal Barbot (le chef) y livre ses secrets pour tenter de réalsier les grands classiques de sa table comme l'aubergine au miso, le millefeuille de foie gras (une tarte avec des champignons de Paris d'un incroyable croquant), le dashi, et aussi la façon de cuire avec précision un poisson à la poêle ou à la vapeur... Les textes -du gros livre principal-, sont de Chihiro Masui, une Japonaise infusée, perfusée à la haute gastronomie française. Les photos sont signées Richard Haughton, un Irlandais familier des grandes cuisines françaises. Astrance nous dit surtout la fusion, l'alchimie de la rencontre entre un chef cuisinier réellement exceptionnel, Pascal Barbot, formé chez Passard (L'Arpège) notamment, et un chef d'orchestre en salle, Christophe Rohat donc, maître de cérémonie plutôt, directeur de la machine ainsi que leur brigade décontractée et tellement talentueuse qu'on est tenté de se dire, en entrant à l'Astrance (mon restaurant préféré et de loin dans sa catégorie),
Il est rare que je garde des "beaux-livres" de cuisine, de ces albums à la gloire de, avec des photos léchées abusivement, prises en gros plan avec des floutés et des bougés devenus ringards aujourd'hui, de pleines pages qui sont comme des peintures sur assiette -et on voudrait nous faire croire qu'on feuillette un catalogue d'art contemporain et puis des textes hagiographiques, des dithyrambes, des recettes maquettées comme des poèmes inédits de Rimbaud. Bref, en général, je m'en sépare vite en les offrant à des amies aimant cuisiner et qui se fichent de cette mise en scène et qui les chargent vite en projections de graisse tout en tambouillant, un oeil sur eux, un autre sur le motif; le sujet. Là, je pense aux rares bouquins que j'ai gardés, comme celui de Michel Bras (Rouergue). Il en reste peu. Le pontifiant Une journée à elBulli (Ferran Adria, Phaidon), m'a gonflé -le pape de la moléculaire eut la suffisance de le présenter à la presse à... Beaubourg! Le grand livre d'Hélène Darroze aussi (offert vite). Enfin, bon, là, j'en tiens un vrai, un qui n'est pas prêt de quitter mes lieux : Astrance Livre de cuisine (Le Chêne, 70€). Parce que le bouquin est vraiment somptueux, sous emboîtage, avec son second livre, un cahier de recettes pas-à-pas, qui frappent par leur modestie : Pascal Barbot (le chef) y livre ses secrets pour tenter de réalsier les grands classiques de sa table comme l'aubergine au miso, le millefeuille de foie gras (une tarte avec des champignons de Paris d'un incroyable croquant), le dashi, et aussi la façon de cuire avec précision un poisson à la poêle ou à la vapeur... Les textes -du gros livre principal-, sont de Chihiro Masui, une Japonaise infusée, perfusée à la haute gastronomie française. Les photos sont signées Richard Haughton, un Irlandais familier des grandes cuisines françaises. Astrance nous dit surtout la fusion, l'alchimie de la rencontre entre un chef cuisinier réellement exceptionnel, Pascal Barbot, formé chez Passard (L'Arpège) notamment, et un chef d'orchestre en salle, Christophe Rohat donc, maître de cérémonie plutôt, directeur de la machine ainsi que leur brigade décontractée et tellement talentueuse qu'on est tenté de se dire, en entrant à l'Astrance (mon restaurant préféré et de loin dans sa catégorie),  L'Astrance est
L'Astrance est 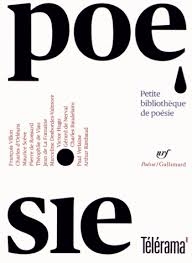 Le coffret est arrivé par coursier et quand je l'ai ouvert, je me suis exclamé de bonheur. Il y a des jours comme ça où vous pensez que c'est votre fête, mais non -ou bien oui.
Le coffret est arrivé par coursier et quand je l'ai ouvert, je me suis exclamé de bonheur. Il y a des jours comme ça où vous pensez que c'est votre fête, mais non -ou bien oui. 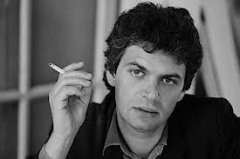
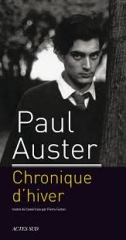
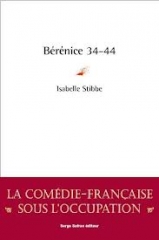
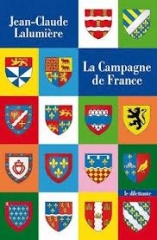

 Spécial autopromo... Je suis invité à signer Chasses furtives sur le stand des éditions Passiflore
Spécial autopromo... Je suis invité à signer Chasses furtives sur le stand des éditions Passiflore 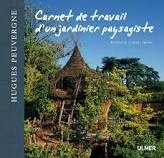 Le paysagiste est un poète des jardins et cet ouvrage magnifique est pour lui et tous ceux qui poursuivent
Le paysagiste est un poète des jardins et cet ouvrage magnifique est pour lui et tous ceux qui poursuivent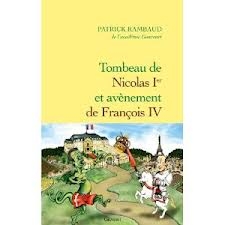 C'est le sixième et dernier volume de la chronique rédigée à la manière d'un Duc de Saint-Simon des temps modernes, du règne de Nicolas Ier, Notre Culotté Potentat qui présida
C'est le sixième et dernier volume de la chronique rédigée à la manière d'un Duc de Saint-Simon des temps modernes, du règne de Nicolas Ier, Notre Culotté Potentat qui présida Le marché est encombré mais les éditeurs y vont encore : folio 2€ lance sa sous-collection, baptisée Sagesses, avec une
Le marché est encombré mais les éditeurs y vont encore : folio 2€ lance sa sous-collection, baptisée Sagesses, avec une dizaine de titres minces et essentiels : Cioran, Pensées étranglées (extraits du Mauvais démiurge), Ellul, Je suis sincère avec moi-même (déjà évoqué ici il y a quelques jours : "Presse Papier". Extraits de Exégèse des nouveaux lieux communs), Sénèque, De la providence (extraits de Lettres à Lucilius et de Stoïciens), Tchouang-tseu, Joie suprême, Maître Eckhart, L'amour est fort comme la mort, Saâdi, Le Jardin des Fruits, et encore Liu An, Du monde des hommes (de l'art de vivre pami ses semblables), un ouvrage
dizaine de titres minces et essentiels : Cioran, Pensées étranglées (extraits du Mauvais démiurge), Ellul, Je suis sincère avec moi-même (déjà évoqué ici il y a quelques jours : "Presse Papier". Extraits de Exégèse des nouveaux lieux communs), Sénèque, De la providence (extraits de Lettres à Lucilius et de Stoïciens), Tchouang-tseu, Joie suprême, Maître Eckhart, L'amour est fort comme la mort, Saâdi, Le Jardin des Fruits, et encore Liu An, Du monde des hommes (de l'art de vivre pami ses semblables), un ouvrage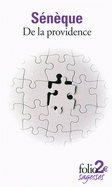 sur la voie du zen de Dôgen, Corps et esprit, et un extrait de La Légende dorée (vie des saintes
sur la voie du zen de Dôgen, Corps et esprit, et un extrait de La Légende dorée (vie des saintes  illustres) de Voragine... Avec une collection à ce prix, ces petits livres que l'on a envie d'offrir comme on achète des chocolatines sont voués au succès. C'est le miracle du (mini) poche que de faire tenir tant d'esprit, de sagesse, de réflexions intemporelles pour la plupart, dans un bouquin aussi épais
illustres) de Voragine... Avec une collection à ce prix, ces petits livres que l'on a envie d'offrir comme on achète des chocolatines sont voués au succès. C'est le miracle du (mini) poche que de faire tenir tant d'esprit, de sagesse, de réflexions intemporelles pour la plupart, dans un bouquin aussi épais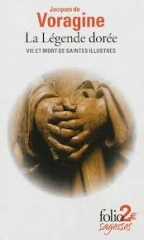 qu'une tranche de pain de mie et à peine davantage qu'une tranche de jambon coupée comme avant. La
qu'une tranche de pain de mie et à peine davantage qu'une tranche de jambon coupée comme avant. La  forme est séduisante et les textes sont des compagnons pour le jardin, l'attente, les
forme est séduisante et les textes sont des compagnons pour le jardin, l'attente, les 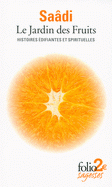 transports en commun. Quoi de plus stimulant en effet, tandis que l'on attend un ami quelque part, surtout pas temps de neige comme aujourd'hui, que de lire des aphorismes de Cioran, une pensée de Sénèque, des réflexions sur le bonheur d'un sage chinois, des sentences et des historiettes persanes ou encore des méditations sur la vie contemplative, le détachement, la honte, la jalousie, le pardon, le discernement... qui nous sont chuchotées par les maîtres -anciens et modernes- de la sérénité (re)trouvée? On en redemande.
transports en commun. Quoi de plus stimulant en effet, tandis que l'on attend un ami quelque part, surtout pas temps de neige comme aujourd'hui, que de lire des aphorismes de Cioran, une pensée de Sénèque, des réflexions sur le bonheur d'un sage chinois, des sentences et des historiettes persanes ou encore des méditations sur la vie contemplative, le détachement, la honte, la jalousie, le pardon, le discernement... qui nous sont chuchotées par les maîtres -anciens et modernes- de la sérénité (re)trouvée? On en redemande.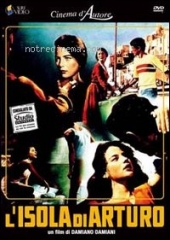
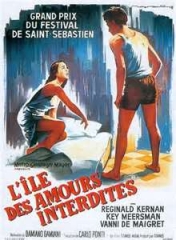 interdites, adapté de l'Isola di Arturo, L'Île d'Arturo, d'Elsa Morante, le grand roman (Prix Strega 1957 -le Goncourt italien), de "la" Morante et qui a Procida pour cadre? Le film valut à Damiani le Grand Prix du Festival de Saint-Sebastien en 1961. Damiani était le cinéaste des problèmes sociaux et il se rapproche en cela du néoréalisme italien. L'Île des amours interdites, tourné en noir et blanc, montre une Procida encore sauvage, une prison, Terra Murata, en activité (elle ne fermera qu'en 1988) et des personnages d'une sensibilité à fleur de peau. De ce film, fidèle au roman, il se dégage une poésie simple, un dépouillement; une vérité pure comme l'enfance lorsqu'elle rencontre la mélancolie et qu'elle cesse de jouer avec un chien sur la plage.
interdites, adapté de l'Isola di Arturo, L'Île d'Arturo, d'Elsa Morante, le grand roman (Prix Strega 1957 -le Goncourt italien), de "la" Morante et qui a Procida pour cadre? Le film valut à Damiani le Grand Prix du Festival de Saint-Sebastien en 1961. Damiani était le cinéaste des problèmes sociaux et il se rapproche en cela du néoréalisme italien. L'Île des amours interdites, tourné en noir et blanc, montre une Procida encore sauvage, une prison, Terra Murata, en activité (elle ne fermera qu'en 1988) et des personnages d'une sensibilité à fleur de peau. De ce film, fidèle au roman, il se dégage une poésie simple, un dépouillement; une vérité pure comme l'enfance lorsqu'elle rencontre la mélancolie et qu'elle cesse de jouer avec un chien sur la plage.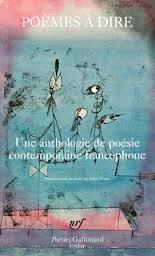 A noter, la parution d'une précieuse petite anthologie concoctée par Zéno Bianu, orfèvre en la matière : Poèmes à dire, une anthologie de poésie contemporaine francophone, publiée par Poésie/Gallimard (6,90€) à l'occasion du
A noter, la parution d'une précieuse petite anthologie concoctée par Zéno Bianu, orfèvre en la matière : Poèmes à dire, une anthologie de poésie contemporaine francophone, publiée par Poésie/Gallimard (6,90€) à l'occasion du  Je suis tombé là-dessus il y a quelques minutes en (je confesse) "googlisant" les mots chasses furtives :
Je suis tombé là-dessus il y a quelques minutes en (je confesse) "googlisant" les mots chasses furtives :  Ignacio Ramonet (Le Monde diplomatique) livre une histoire synthétique de la presse écrite française et surtout des crises qu'elle traverse, dans son précieux essai intitulé
Ignacio Ramonet (Le Monde diplomatique) livre une histoire synthétique de la presse écrite française et surtout des crises qu'elle traverse, dans son précieux essai intitulé 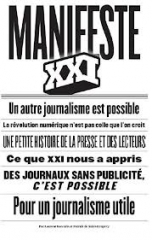 de la valeur du travail correctement fait ; car il en reste, de ces lecteurs. Ramonet dresse par ailleurs un tableau complet de l'univers de l'information reloaded : le Web, les sites d'info gratuits, les payants (aucun n'ayant encore trouvé un modèle économique qui pourrait être suivi), les pure players, le pari fait par certains groupes de presse sur la tablette comme outil miraculeux et garant de l'avenir de la presse "écrite", etc.
de la valeur du travail correctement fait ; car il en reste, de ces lecteurs. Ramonet dresse par ailleurs un tableau complet de l'univers de l'information reloaded : le Web, les sites d'info gratuits, les payants (aucun n'ayant encore trouvé un modèle économique qui pourrait être suivi), les pure players, le pari fait par certains groupes de presse sur la tablette comme outil miraculeux et garant de l'avenir de la presse "écrite", etc.  philosophe dans la cité. C'est à lui que revient le rôle d'éveilleur des esprits lorsque ceux-ci sont atteints des syndrômes du laisser-faire, de la banalité du mal (cher à Hannah Arendt); bref lorsqu'ils sont sous anesthésie sociale. L'aiguillon, la mouche du coche, l'empêcheur de penser en rond, c'est autant ce grain de sable qui dérange (le journaliste selon Edwy Plenel), que le philosophe. Socrate n'a-t-il pas un peu inventé une certaine forme de journalisme de qualité, avec la fameuse ironie qui
philosophe dans la cité. C'est à lui que revient le rôle d'éveilleur des esprits lorsque ceux-ci sont atteints des syndrômes du laisser-faire, de la banalité du mal (cher à Hannah Arendt); bref lorsqu'ils sont sous anesthésie sociale. L'aiguillon, la mouche du coche, l'empêcheur de penser en rond, c'est autant ce grain de sable qui dérange (le journaliste selon Edwy Plenel), que le philosophe. Socrate n'a-t-il pas un peu inventé une certaine forme de journalisme de qualité, avec la fameuse ironie qui 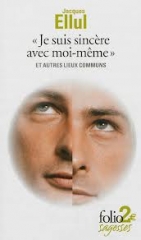 caractérise sa réthorique (lorsqu'il s'adressait aux Sophistes ou aux simples citoyens d'Athènes et qui séduisit tant le Camus journaliste*), et même l'art de conduire un reportage, avec la maïeutique, ou l'art d'accoucher les esprits?
caractérise sa réthorique (lorsqu'il s'adressait aux Sophistes ou aux simples citoyens d'Athènes et qui séduisit tant le Camus journaliste*), et même l'art de conduire un reportage, avec la maïeutique, ou l'art d'accoucher les esprits? 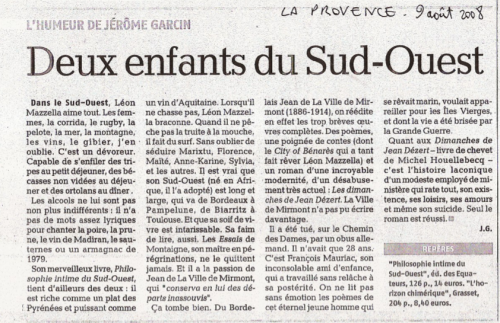
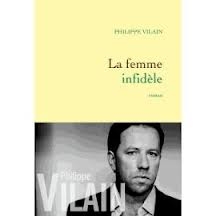 La femme infidèle, de Philippe Vilain
La femme infidèle, de Philippe Vilain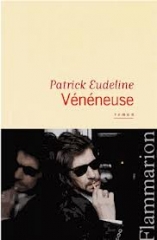 Vénéneuse, de Patrick Eudeline
Vénéneuse, de Patrick Eudeline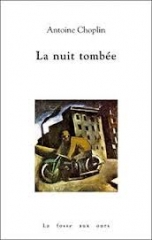
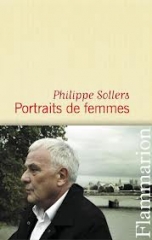
 Le Peterson (le Guide Peterson des oiseaux de France et d'Europe, de P. Peterson, G. Mountfort, P.A.D. Hollom et P. Géroudet; Delachaux & Niestlé, 29€) n'a pas relooké que sa couverture. The guide indispensable, qui escorte inlassablement des dizaines de milliers d'aficionados a los oiseaux depuis 1954 et qui en fait de bons ornithos de base, est indétrônable. On aura beau faire, il reste le meilleur. Entièrement revu, corrigé, augmenté, actualisé, il est encore plus riche de 1500 illustrations nécessaires à l'identification sûre de plus de 700 espèces d'oiseaux. 366 cartes de distribution géographique éclairent un propos concis, précis, juste, fiable et passionnant. Une mine, un compagnon, un objet inséparable de la boîte à gants, de la poche de la veste en toile brune, de la table de chevet et de la mémoire; à la fin. Bref, Le Peterson, quoi.
Le Peterson (le Guide Peterson des oiseaux de France et d'Europe, de P. Peterson, G. Mountfort, P.A.D. Hollom et P. Géroudet; Delachaux & Niestlé, 29€) n'a pas relooké que sa couverture. The guide indispensable, qui escorte inlassablement des dizaines de milliers d'aficionados a los oiseaux depuis 1954 et qui en fait de bons ornithos de base, est indétrônable. On aura beau faire, il reste le meilleur. Entièrement revu, corrigé, augmenté, actualisé, il est encore plus riche de 1500 illustrations nécessaires à l'identification sûre de plus de 700 espèces d'oiseaux. 366 cartes de distribution géographique éclairent un propos concis, précis, juste, fiable et passionnant. Une mine, un compagnon, un objet inséparable de la boîte à gants, de la poche de la veste en toile brune, de la table de chevet et de la mémoire; à la fin. Bref, Le Peterson, quoi.
 Gascogne légèrement moelleux (75% gros manseng, 25% sauvignon blanc) au nez d'agrumes, d'ananas et de vanille. Il escorte bien le foie gras, la tarte tatin et la fourme d'Ambert. (Vignobles Lionel Osmin. 7,50€ le flacon).
Gascogne légèrement moelleux (75% gros manseng, 25% sauvignon blanc) au nez d'agrumes, d'ananas et de vanille. Il escorte bien le foie gras, la tarte tatin et la fourme d'Ambert. (Vignobles Lionel Osmin. 7,50€ le flacon).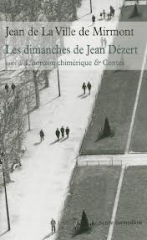 L'idéal est de le déguster à la plage de La Chambre d'Amour (Anglet), assis sur le parapet et face à un océan qui était légèrement déchaîné dimanche dernier... En reprenant au hasard les poèmes de L'Horizon chimérique (extrait ci-dessous), de Jean de La Ville de Mirmont, dans la nouvelle édition de ses oeuvres complètes que propose La Petite Vermillon (La Table ronde, 8,70€) sous le titre (de l'unique roman de l'auteur), Les dimanches de Jean Dézert. Le recueil contient donc également
L'idéal est de le déguster à la plage de La Chambre d'Amour (Anglet), assis sur le parapet et face à un océan qui était légèrement déchaîné dimanche dernier... En reprenant au hasard les poèmes de L'Horizon chimérique (extrait ci-dessous), de Jean de La Ville de Mirmont, dans la nouvelle édition de ses oeuvres complètes que propose La Petite Vermillon (La Table ronde, 8,70€) sous le titre (de l'unique roman de l'auteur), Les dimanches de Jean Dézert. Le recueil contient donc également 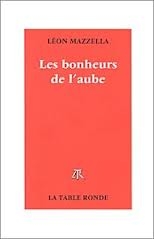 Surprise du soir : je viens de trouver ce papier anonyme sur un site que je ne connaissais pas :
Surprise du soir : je viens de trouver ce papier anonyme sur un site que je ne connaissais pas : 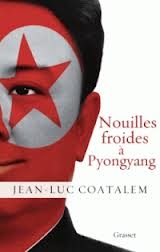 Ce récit de voyage est terrifiant. Déguisé en professionnel du tourisme en quête de nouveaux marchés,
Ce récit de voyage est terrifiant. Déguisé en professionnel du tourisme en quête de nouveaux marchés,  une violence dont on ne peut que deviner l'ampleur. Ce récit se double d'une excellente histoire résumée du pays, de ses chefs fous (Kim Jong-il et Kim Jong-un notamment), non sans dériver avec bonheur en compagnie de Melville (l'archipel de papier de
une violence dont on ne peut que deviner l'ampleur. Ce récit se double d'une excellente histoire résumée du pays, de ses chefs fous (Kim Jong-il et Kim Jong-un notamment), non sans dériver avec bonheur en compagnie de Melville (l'archipel de papier de  compenser la faim au sens propre. A noter aussi la reprise en poche du
compenser la faim au sens propre. A noter aussi la reprise en poche du 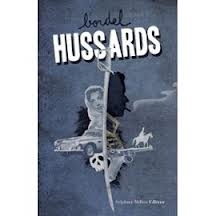 tristes
tristes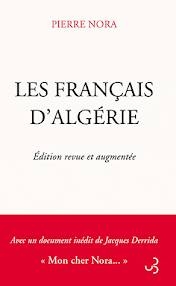 Décevant. Nous avions tant attendu (des années!) la réédition de ce livre épuisé depuis des lustres... Pierre Nora, brillant historien et essayiste que nous savons, académicien, manitou de la non fiction chez Gallimard, pilote emblématique de la somme éditoriale intitulée Les lieux de mémoire... Donnait son premier livre en 1961 avec ces Français d'Algérie. Il était alors enseignant à Oran. Le livre parut juste avant le putsch d'un quarteron de généraux à la retraite. Son analyse de la société pied-noir est à ce point méprisante (cette société-là semble lui inspirer le dégoût caractéristique de cette gauche bourgeoise qui affecte de ne pas prendre le métro, qui vit dans le 7ème à Paris tout en affichant des amitiés avec le peuple socialiste), qu'on se demande en tournant les pages pourquoi il se livra à une telle étude. Les Français d'Algérie reparaît donc, augmenté d'une préface (Cinquante ans après) et surtout d'une lumineuse longue lettre inédite (trente pages) de Jacques Derrida adressée à son ami Nora (Bourgois, 17€). Le propos s'éloigne d'emblée, à nos yeux, de la notion ethnographique de terrain, car l'historien semble se pincer le nez devant son sujet -il eut mieux fait d'aller exercer son jeune talent sur les rives plus lisses (quoique) du Lac Léman. Oui, le petit peuple d'Algérie que décrivit si admirablement Albert Camus (que Nora déglingue comme il déglingue -curieusement- Germaine Tillion) avait sa structure sociologique propre, extrêmement humble dans son écrasante majorité, qui n'était pas franchement celle des CSP++ d'aujourd'hui, sinon ils n'aurait pas quitté l'Europe des années 1830 et suivantes pour aller retrouver fortune, tenter sa chance, se refaire la cerise, manger à sa faim, fuir des persécutions politiques, dans ce qui figurait un nouvel Eldorado, un Far-West transméditerranéen. Cela, Nora semble l'occulter et c'est dommage. Car, à l'évidence, ce peuple (contexte de l'époque) était populiste comme on fut plus tard poujadiste en métropole, certes il fut antisémite à la marge, lorsqu'à Paris on dénonçait à tout va et on collaborait copieusement, certes il n'avait pas la culture des étudiants de la rue d'Ulm, certes il eut parfois des comportements comparables à ceux qui furent constatés à des époques semblables en Indochine, en Inde, au Sénégal et dans toutes les colonies. Oui, certains pieds-noirs furent un brin militaristes, anti-parisiens, anti jacobins, un peu Corses dirons-nous, voire autonomistes mais avec ambiguité : en acceptant les subsides de la maison mère, ce qui peut à la limite se traduire par du cynisme mais qui fut je crois de l'opportunisme basique. En historien contemporain qui travaille sur le vivant, Nora se confronte en filtrant, semble-t-il. Parfois, il donne l'impression d'avoir bossé à l'hygiaphone plutôt qu'au microphone et au carnet de notes. La presse qui fit écho du livre (admirable papier de Jean Lacourure dans Le Monde du 29 avril 1961) n'épargnât pas davantage Nora que Derrida ne le fit, mais ce dernier avec une condescendance amicale, dans sa longue lettre qui égratigne profondément, mais avec respect, le propos. Nora semble mettre dans le même panier (le préjugé et la tentation à généraliser sont pourtant des écueils faciles à éviter, car spectraux), les colons, les militaires, les gouverneurs et tous les autres. Le "tous colons", tous pourris affleure à certaines pages et c'est le plus surprenant, venant de la plume d'un grand esprit de ce temps; déjà. La vulgarité populaire dégoûte l'historien qui devrait a minima garder la distance nécessaire, indispensable avec son sujet. Certes l'analyse est fine, construite, nourrie, souvent brillante, même si elle comprend de grosses lacunes (pas un mot sur le FLN par exemple). La démonstration de l'intégration comme mythe de compensation, celle de l'existence tenace et farouche d'un certain paternalisme autoritaire représentant un idéal de justice, qui dédouanait cette communauté de son racisme ordinaire, sont admirables d'intelligence, autant que sont captivantes, ébouissantes, les analyses de la distance raciale et sociale des Français d'Algérie avec les Arabes. L'historien (trop sérieux?) est cependant mal à l'aise, voire affligé lorsqu'il cite l'humour simpliste et désespéré d'un peuple qui répond par une boutade à des propositions (déjà décidées), de De Gaulle : Autodétermination?.. Et pourquoi pas bicyclette-détermination! Nora condamne par ailleurs de la même manière le moralisme de Camus et celui des libéraux (une auberge espagnole, à vrai dire), comme il décrit de façon hâtive ce peuple de petits blancs humiliés et méprisants, leur hospitalité agressive, leur culte de l'individu, leur bonne conscience, l'affinité profonde, en leur sein, entre le soldat et le colon... Une phrase importante ouvre le livre : les Français d'Algérie ne veulent pas être défendus par la métropole. Ils veulent en être aimés. Elle est malheureusement laissée sur le bas-côté de l'analyse. L'objectivité glacée de Nora, comme le souligne Lacouture, manque de cette chaleur propre à la rue de là-bas. Et par voie de conséquence à une analyse talentueuse qui aurait été exemplaire si elle n'avait pas été -pour résumer; antipathique.
Décevant. Nous avions tant attendu (des années!) la réédition de ce livre épuisé depuis des lustres... Pierre Nora, brillant historien et essayiste que nous savons, académicien, manitou de la non fiction chez Gallimard, pilote emblématique de la somme éditoriale intitulée Les lieux de mémoire... Donnait son premier livre en 1961 avec ces Français d'Algérie. Il était alors enseignant à Oran. Le livre parut juste avant le putsch d'un quarteron de généraux à la retraite. Son analyse de la société pied-noir est à ce point méprisante (cette société-là semble lui inspirer le dégoût caractéristique de cette gauche bourgeoise qui affecte de ne pas prendre le métro, qui vit dans le 7ème à Paris tout en affichant des amitiés avec le peuple socialiste), qu'on se demande en tournant les pages pourquoi il se livra à une telle étude. Les Français d'Algérie reparaît donc, augmenté d'une préface (Cinquante ans après) et surtout d'une lumineuse longue lettre inédite (trente pages) de Jacques Derrida adressée à son ami Nora (Bourgois, 17€). Le propos s'éloigne d'emblée, à nos yeux, de la notion ethnographique de terrain, car l'historien semble se pincer le nez devant son sujet -il eut mieux fait d'aller exercer son jeune talent sur les rives plus lisses (quoique) du Lac Léman. Oui, le petit peuple d'Algérie que décrivit si admirablement Albert Camus (que Nora déglingue comme il déglingue -curieusement- Germaine Tillion) avait sa structure sociologique propre, extrêmement humble dans son écrasante majorité, qui n'était pas franchement celle des CSP++ d'aujourd'hui, sinon ils n'aurait pas quitté l'Europe des années 1830 et suivantes pour aller retrouver fortune, tenter sa chance, se refaire la cerise, manger à sa faim, fuir des persécutions politiques, dans ce qui figurait un nouvel Eldorado, un Far-West transméditerranéen. Cela, Nora semble l'occulter et c'est dommage. Car, à l'évidence, ce peuple (contexte de l'époque) était populiste comme on fut plus tard poujadiste en métropole, certes il fut antisémite à la marge, lorsqu'à Paris on dénonçait à tout va et on collaborait copieusement, certes il n'avait pas la culture des étudiants de la rue d'Ulm, certes il eut parfois des comportements comparables à ceux qui furent constatés à des époques semblables en Indochine, en Inde, au Sénégal et dans toutes les colonies. Oui, certains pieds-noirs furent un brin militaristes, anti-parisiens, anti jacobins, un peu Corses dirons-nous, voire autonomistes mais avec ambiguité : en acceptant les subsides de la maison mère, ce qui peut à la limite se traduire par du cynisme mais qui fut je crois de l'opportunisme basique. En historien contemporain qui travaille sur le vivant, Nora se confronte en filtrant, semble-t-il. Parfois, il donne l'impression d'avoir bossé à l'hygiaphone plutôt qu'au microphone et au carnet de notes. La presse qui fit écho du livre (admirable papier de Jean Lacourure dans Le Monde du 29 avril 1961) n'épargnât pas davantage Nora que Derrida ne le fit, mais ce dernier avec une condescendance amicale, dans sa longue lettre qui égratigne profondément, mais avec respect, le propos. Nora semble mettre dans le même panier (le préjugé et la tentation à généraliser sont pourtant des écueils faciles à éviter, car spectraux), les colons, les militaires, les gouverneurs et tous les autres. Le "tous colons", tous pourris affleure à certaines pages et c'est le plus surprenant, venant de la plume d'un grand esprit de ce temps; déjà. La vulgarité populaire dégoûte l'historien qui devrait a minima garder la distance nécessaire, indispensable avec son sujet. Certes l'analyse est fine, construite, nourrie, souvent brillante, même si elle comprend de grosses lacunes (pas un mot sur le FLN par exemple). La démonstration de l'intégration comme mythe de compensation, celle de l'existence tenace et farouche d'un certain paternalisme autoritaire représentant un idéal de justice, qui dédouanait cette communauté de son racisme ordinaire, sont admirables d'intelligence, autant que sont captivantes, ébouissantes, les analyses de la distance raciale et sociale des Français d'Algérie avec les Arabes. L'historien (trop sérieux?) est cependant mal à l'aise, voire affligé lorsqu'il cite l'humour simpliste et désespéré d'un peuple qui répond par une boutade à des propositions (déjà décidées), de De Gaulle : Autodétermination?.. Et pourquoi pas bicyclette-détermination! Nora condamne par ailleurs de la même manière le moralisme de Camus et celui des libéraux (une auberge espagnole, à vrai dire), comme il décrit de façon hâtive ce peuple de petits blancs humiliés et méprisants, leur hospitalité agressive, leur culte de l'individu, leur bonne conscience, l'affinité profonde, en leur sein, entre le soldat et le colon... Une phrase importante ouvre le livre : les Français d'Algérie ne veulent pas être défendus par la métropole. Ils veulent en être aimés. Elle est malheureusement laissée sur le bas-côté de l'analyse. L'objectivité glacée de Nora, comme le souligne Lacouture, manque de cette chaleur propre à la rue de là-bas. Et par voie de conséquence à une analyse talentueuse qui aurait été exemplaire si elle n'avait pas été -pour résumer; antipathique. 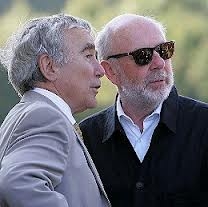 C'est un grand journaliste doublé d'un écrivain précieux, précis qui vient de quitter ce monde à l'âge de 69 ans, le 8 janvier dernier. A Bordeaux. Sa ville. Né à Momuy dans les Landes et d'origine flamande par ailleurs, Pierre Veilletet aura effectué une brillante carrière au journal Sud-Ouest, qu'il pilota, jusqu'à son éviction brutale en 2000 -qu'il ne digéra pas. Prix Albert-Londres 1976 pour ses reportages sur l'agonie de Franco, il préféra rester le premier à Bordeaux au lieu d'être un numéro à Paris. C'était un maître à l'écriture rigoureuse, au ton singulier, hiératique et profond. Un styliste. Un observateur d'une finesse désarçonnante. Un taiseux au sourire rare aussi. Un personnage un rien intimidant mais toujours prompt à lancer un trait d'esprit pour détendre une atmosphère qu'il savait avoir rendue pesante, dans son bureau au journal ou ailleurs par hasard dans les rues de la ville. Veilletet avait le tact inscrit en lui. Et une délicatesse parfois gauche mais jamais empruntée. Il n'était pas d'accès libre. Ce n'est qu'à l'âge de 43 ans qu'il publia son premier livre, le court et dense roman La pension des nonnes, chez Arléa, maison cofondée avec ses amis Jean-Claude et Catherine Guillebaud et à laquelle il restera aussi fidèle que Julien Gracq le demeura à José Corti. L'allusion vaut rapprochement : le choix scrupuleux de l'adjectif, l'usage de l'italique pour appuyer comme on adresse un clin d'oeil entendu, rendent l'écriture de Veilletet voisine, sinon cousine de celle du grand écrivain de Saint-Florent-le-Vieil. Si Querencia et autres lieux sûrs peut faire penser à La première gorgée de bière de Philippe Delerm pour sa thématique, mais avec une autre tenue, une exigence altière,
C'est un grand journaliste doublé d'un écrivain précieux, précis qui vient de quitter ce monde à l'âge de 69 ans, le 8 janvier dernier. A Bordeaux. Sa ville. Né à Momuy dans les Landes et d'origine flamande par ailleurs, Pierre Veilletet aura effectué une brillante carrière au journal Sud-Ouest, qu'il pilota, jusqu'à son éviction brutale en 2000 -qu'il ne digéra pas. Prix Albert-Londres 1976 pour ses reportages sur l'agonie de Franco, il préféra rester le premier à Bordeaux au lieu d'être un numéro à Paris. C'était un maître à l'écriture rigoureuse, au ton singulier, hiératique et profond. Un styliste. Un observateur d'une finesse désarçonnante. Un taiseux au sourire rare aussi. Un personnage un rien intimidant mais toujours prompt à lancer un trait d'esprit pour détendre une atmosphère qu'il savait avoir rendue pesante, dans son bureau au journal ou ailleurs par hasard dans les rues de la ville. Veilletet avait le tact inscrit en lui. Et une délicatesse parfois gauche mais jamais empruntée. Il n'était pas d'accès libre. Ce n'est qu'à l'âge de 43 ans qu'il publia son premier livre, le court et dense roman La pension des nonnes, chez Arléa, maison cofondée avec ses amis Jean-Claude et Catherine Guillebaud et à laquelle il restera aussi fidèle que Julien Gracq le demeura à José Corti. L'allusion vaut rapprochement : le choix scrupuleux de l'adjectif, l'usage de l'italique pour appuyer comme on adresse un clin d'oeil entendu, rendent l'écriture de Veilletet voisine, sinon cousine de celle du grand écrivain de Saint-Florent-le-Vieil. Si Querencia et autres lieux sûrs peut faire penser à La première gorgée de bière de Philippe Delerm pour sa thématique, mais avec une autre tenue, une exigence altière, 



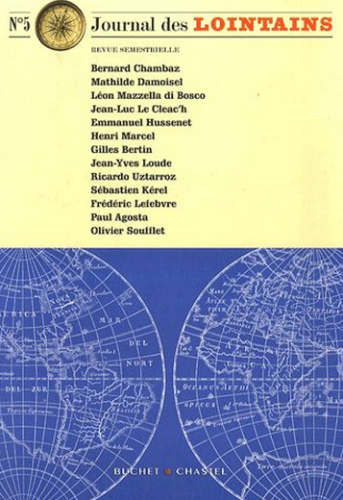 L'une des magies d'Internet est de retomber sur un texte ancien, de le relire et de se dire : ça tient encore la piste (ayant davantage emprunté des chemins de traverse qui ont toujours engendré mes chemins d'écriture -que des routes droites et balisées), et de se dire donc : tiens, et si je le mettais en ligne, celui-ci... En voici donc un, dans les archives, qui fut publié par feu Le Journal des Lointains, que l'écrivain Marc Trillard dirigeait chez Buchet-Chastel. Une revue-livre littéraire dédiée au grand reportage; un ancêtre des mooks d'aujourd'hui, abondamment illustrés -à l'instar de l'emblématique revue XXI (Les Arènes), ou bien du jeune Long Cours (L'Express). Cela se passait au Kazakhstan en 1997. Et fut publié dix ans après (en général, je publie dix ans après).
L'une des magies d'Internet est de retomber sur un texte ancien, de le relire et de se dire : ça tient encore la piste (ayant davantage emprunté des chemins de traverse qui ont toujours engendré mes chemins d'écriture -que des routes droites et balisées), et de se dire donc : tiens, et si je le mettais en ligne, celui-ci... En voici donc un, dans les archives, qui fut publié par feu Le Journal des Lointains, que l'écrivain Marc Trillard dirigeait chez Buchet-Chastel. Une revue-livre littéraire dédiée au grand reportage; un ancêtre des mooks d'aujourd'hui, abondamment illustrés -à l'instar de l'emblématique revue XXI (Les Arènes), ou bien du jeune Long Cours (L'Express). Cela se passait au Kazakhstan en 1997. Et fut publié dix ans après (en général, je publie dix ans après).

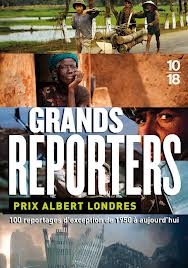
 Les single malt de Bowmore 12 ans, 15 ans ou 18 ans d'âge possèdent un subtil arôme tourbé que la distillerie prend à sa source, dans l'eau d'une pureté confondante du fleuve Laggan. Bowmore est l'une des huit distilleries de la toute petite île d'Islay et elle fut fondée en 1779 par un marin nommé David Simson. C'est aussi l'une des très rares distilleries à produire sa propre orge maltée sur aire, retournée comme il se doit par les malteurs à l'aide de pelles à malt en bois. Le maltage est l'une des sept étapes de l'élaboration d'un whisky. Il est suivi du séchage au four, du broyage, du brassage, de la fermentation, de la distillation et enfin de la maturation. La présence d'un parfum de sel marin signe les grands Islay comme le 12 ans d'âge à la robe ambrée et chaude, au nez fumé et miellé avec une pointe d'agrume et à la persistance, en bouche, où perce une note cacaotée et finement tourbée. Le 15 ans, Darkest, porte bien son nom. Plus boisé, plus puissant aussi, il dégage des flaveurs de cèdre et de Xérès qui rappelle l'origine des fûts dans lesquels il vieillit. Le 18 ans, plus doux mais si fin, légèrement caramélisé au nez, exprime un fruité exotique en bouche et possède une finale qui répugne à mourir et dans laquelle nous retrouvons l'iode, la tourbe et le parfum de l'herbe coupée que les si nombreux cerfs d'Islay broutent la nuit (32€ le 12 ans).
Les single malt de Bowmore 12 ans, 15 ans ou 18 ans d'âge possèdent un subtil arôme tourbé que la distillerie prend à sa source, dans l'eau d'une pureté confondante du fleuve Laggan. Bowmore est l'une des huit distilleries de la toute petite île d'Islay et elle fut fondée en 1779 par un marin nommé David Simson. C'est aussi l'une des très rares distilleries à produire sa propre orge maltée sur aire, retournée comme il se doit par les malteurs à l'aide de pelles à malt en bois. Le maltage est l'une des sept étapes de l'élaboration d'un whisky. Il est suivi du séchage au four, du broyage, du brassage, de la fermentation, de la distillation et enfin de la maturation. La présence d'un parfum de sel marin signe les grands Islay comme le 12 ans d'âge à la robe ambrée et chaude, au nez fumé et miellé avec une pointe d'agrume et à la persistance, en bouche, où perce une note cacaotée et finement tourbée. Le 15 ans, Darkest, porte bien son nom. Plus boisé, plus puissant aussi, il dégage des flaveurs de cèdre et de Xérès qui rappelle l'origine des fûts dans lesquels il vieillit. Le 18 ans, plus doux mais si fin, légèrement caramélisé au nez, exprime un fruité exotique en bouche et possède une finale qui répugne à mourir et dans laquelle nous retrouvons l'iode, la tourbe et le parfum de l'herbe coupée que les si nombreux cerfs d'Islay broutent la nuit (32€ le 12 ans).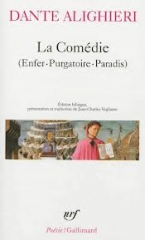 Alliances
Alliances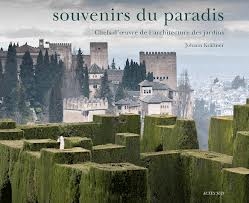
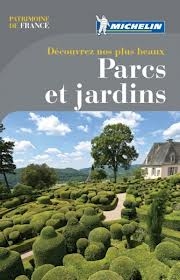
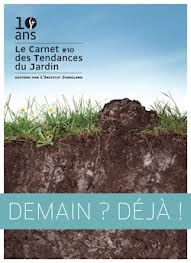
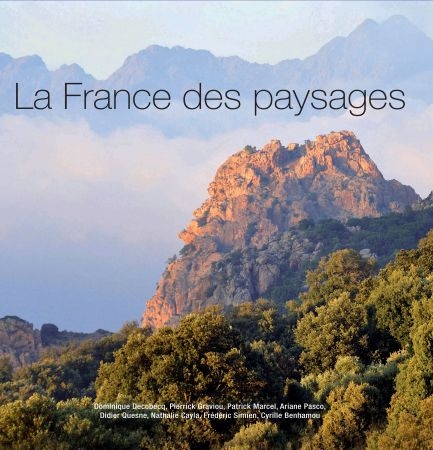
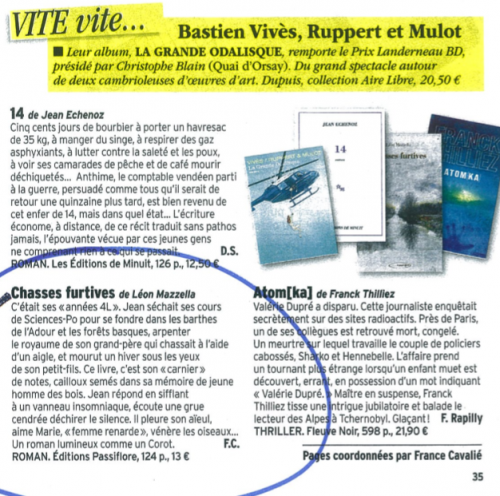

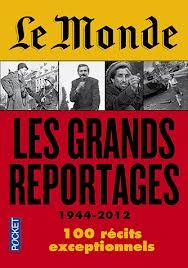 Notre façon d'être journaliste, friand de récits de mémoire du boulot, compte quelques opus précieux, soigneusement rangés dans un rayon particulier. Il y avait eu Grands reportages, 43 prix Albert-Londres, 1946-1989, reparu en Points Actuels en 1989 (l'édition que je possède) et parus initialement chez Arléa en 1986. Un délice qui dure 660 pages, un tour du monde et des mots, de la teneur et du désir urgent, nécessaire, salutaire de plonger la plume dans la plaie (Albert Londres). Puis il y eut Siècle (Phaidon, 2002) -parce que l'écriture photographique est aussi du (très) grand reportage-, que mon fils m'offrit alors qu'il n'avait que onze ans : le XXème siècle en photo-reportage. Du dur, du vrai, du fort. Un monument émouvant et inaltérable. Et là, Pocket, à la suite des éditions des Arènes, nous propose en format de poche élargi (un format formidable, au passage), Les grands reportages du journal Le Monde. Une sélection de 100 récits exceptionnels parus entre 1944 et 2012. Des textes où le processus narratif s'exprime à plein talent. Bon, la chose est entendue : Le Monde est l'un des dix meilleurs quotidiens de la planète et si l'on excepte El Pais, en cruelle difficulté actuellement, c'est sans doute le meilleur quotidien européen. Et je ne dis pas cela parce qu'il m'arrive d'y donner un papier de temps à autre. Voilà, sur 900 pages, de la Libération et de la prise de Shanghai par les troupes de Mao jusqu'au tsunami japonais de 2011, un bouquet qui constitue, en choeur et individuellement, un roman de l'histoire immédiate d'un demi-siècle. Une énorme tranche de notre temps passé sur le terrain, à aller voir ce qui se passe dans le monde entier -d'en bas de ma rue jusqu'à l'extrémité des pôles, pour le re-porter à ceux qui ne sont pas in situ. Le boulot de base du journaliste, fait d'observation et d'humilité, d'empathie avec distance, de respect et de retrait, de ressenti avec affect mais pas trop -est là, de Cuba à l'Algérie, du Vietnam à la Roumanie, de Berlin à Barcelone, de Bokassa à Allende, de Nasser à Aldo Moro, de Sabra et Chatila à la cache de Massoud, des Tchétchènes aux Rebeus de la Courneuve, sous l'oeil et avec la plume de tant de "d'historiens de l'instant" (la formule est de Camus pour désigner le journaliste) : Pierre Georges, Jean Lacouture, Jean-Claude Guillebaud, Jacques Almaric, Marcel Niedergang, Bernard Guetta, Jean-Jacques Bozonnet, Patrice Claude, Ariane Chemin, Francis Deron, Eric Fottorino, Alain Frachon, Bruno Frappat, Sylvie Kauffmann, Robert Guillain, Jean de la Guérivière, Jean-Pierre Langellier, Jean-Yves Lhomeau, Rémy Ourdan, Jean-Claude Pomonti, Marc Roche, Robert Solé, Jean-Pierre Tuquoi... Autant de noms familiers pour tout aficionado du quotidien du Boulevard Blanqui et dont on retrouvait/retrouve le style, le ton, la patte à la page idoine -celle à laquelle on se rend sans pouce férir, pour entendre le Nicaragua, Berlin, Sangatte, Ceausescu, un SDF, Maria Callas, le massacre des Tutsis, le portrait d'un rugbyman déchu, un trafic de cocaïne, des tournantes en Seine St-Denis, une brèche dans le rideau de fer, des gosses palestiniens électrisés...). Cette très précieuse compilation (que je brandirai dès lundi matin et durant toute la semaine à mes étudiants en journalisme auxquels j'enseigne une matière de dinosaure : la presse écrite), s'accompagne chez Pocket également, d'un autre opus aussi passionnant, du Monde, consacré aux
Notre façon d'être journaliste, friand de récits de mémoire du boulot, compte quelques opus précieux, soigneusement rangés dans un rayon particulier. Il y avait eu Grands reportages, 43 prix Albert-Londres, 1946-1989, reparu en Points Actuels en 1989 (l'édition que je possède) et parus initialement chez Arléa en 1986. Un délice qui dure 660 pages, un tour du monde et des mots, de la teneur et du désir urgent, nécessaire, salutaire de plonger la plume dans la plaie (Albert Londres). Puis il y eut Siècle (Phaidon, 2002) -parce que l'écriture photographique est aussi du (très) grand reportage-, que mon fils m'offrit alors qu'il n'avait que onze ans : le XXème siècle en photo-reportage. Du dur, du vrai, du fort. Un monument émouvant et inaltérable. Et là, Pocket, à la suite des éditions des Arènes, nous propose en format de poche élargi (un format formidable, au passage), Les grands reportages du journal Le Monde. Une sélection de 100 récits exceptionnels parus entre 1944 et 2012. Des textes où le processus narratif s'exprime à plein talent. Bon, la chose est entendue : Le Monde est l'un des dix meilleurs quotidiens de la planète et si l'on excepte El Pais, en cruelle difficulté actuellement, c'est sans doute le meilleur quotidien européen. Et je ne dis pas cela parce qu'il m'arrive d'y donner un papier de temps à autre. Voilà, sur 900 pages, de la Libération et de la prise de Shanghai par les troupes de Mao jusqu'au tsunami japonais de 2011, un bouquet qui constitue, en choeur et individuellement, un roman de l'histoire immédiate d'un demi-siècle. Une énorme tranche de notre temps passé sur le terrain, à aller voir ce qui se passe dans le monde entier -d'en bas de ma rue jusqu'à l'extrémité des pôles, pour le re-porter à ceux qui ne sont pas in situ. Le boulot de base du journaliste, fait d'observation et d'humilité, d'empathie avec distance, de respect et de retrait, de ressenti avec affect mais pas trop -est là, de Cuba à l'Algérie, du Vietnam à la Roumanie, de Berlin à Barcelone, de Bokassa à Allende, de Nasser à Aldo Moro, de Sabra et Chatila à la cache de Massoud, des Tchétchènes aux Rebeus de la Courneuve, sous l'oeil et avec la plume de tant de "d'historiens de l'instant" (la formule est de Camus pour désigner le journaliste) : Pierre Georges, Jean Lacouture, Jean-Claude Guillebaud, Jacques Almaric, Marcel Niedergang, Bernard Guetta, Jean-Jacques Bozonnet, Patrice Claude, Ariane Chemin, Francis Deron, Eric Fottorino, Alain Frachon, Bruno Frappat, Sylvie Kauffmann, Robert Guillain, Jean de la Guérivière, Jean-Pierre Langellier, Jean-Yves Lhomeau, Rémy Ourdan, Jean-Claude Pomonti, Marc Roche, Robert Solé, Jean-Pierre Tuquoi... Autant de noms familiers pour tout aficionado du quotidien du Boulevard Blanqui et dont on retrouvait/retrouve le style, le ton, la patte à la page idoine -celle à laquelle on se rend sans pouce férir, pour entendre le Nicaragua, Berlin, Sangatte, Ceausescu, un SDF, Maria Callas, le massacre des Tutsis, le portrait d'un rugbyman déchu, un trafic de cocaïne, des tournantes en Seine St-Denis, une brèche dans le rideau de fer, des gosses palestiniens électrisés...). Cette très précieuse compilation (que je brandirai dès lundi matin et durant toute la semaine à mes étudiants en journalisme auxquels j'enseigne une matière de dinosaure : la presse écrite), s'accompagne chez Pocket également, d'un autre opus aussi passionnant, du Monde, consacré aux 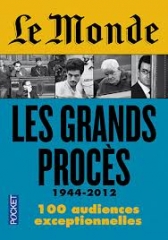 Grands procès (1944-2012, 100 audiences exceptionnelles) qui nous font revivre tant d'affaires historisques sous la plume de feu l'un des princes des chroniqueurs du quotidien du soir, Jean-Marc Théolleyre (surnommé "Théo" le juste), mais aussi avec le regard perfide de Bertrand Poirot-Delpech, qui fut chroniqueur judiciaire avant d'être chroniqueur littéraire. Et tant d'autres (Jean-Michel Dumay, Pascale Robert-Diard...), ayant relaté avec maestria, du procès de Pétain à celui de Dutroux en passant par Laval, les porteurs de valises, Omar Raddad, Goldman, Mesrine, la légitime défense, Rouillan, Papon, Yann Piat, Virenque, François Besse, les caricatures de Mahomet, les écoutes élyséennes -un demi-siècle de moments forts. Ces deux petits pavés de près de 1000 pages et d'à peine 14,50€ chacun, je les conseille à tous. Ce sont, servi avec un talent incontesté, un pan de notre mémoire, historique, sociale, économique, politique, judiciaire; humaine. D'ici et d'ailleurs. Faites passer et lisez. Ce sont des "romans" polyphoniques, des odes sérieuses -au plus près du fait-, au temps qui passe, que ces petites pierres marqueront durablement grâce à l'expression d'un grand professionnalisme, du sens absolu d'un métier qui exprime la volonté de ne connaître qu'une seule ligne : celle du chemin de fer (Albert Londres, again).
Grands procès (1944-2012, 100 audiences exceptionnelles) qui nous font revivre tant d'affaires historisques sous la plume de feu l'un des princes des chroniqueurs du quotidien du soir, Jean-Marc Théolleyre (surnommé "Théo" le juste), mais aussi avec le regard perfide de Bertrand Poirot-Delpech, qui fut chroniqueur judiciaire avant d'être chroniqueur littéraire. Et tant d'autres (Jean-Michel Dumay, Pascale Robert-Diard...), ayant relaté avec maestria, du procès de Pétain à celui de Dutroux en passant par Laval, les porteurs de valises, Omar Raddad, Goldman, Mesrine, la légitime défense, Rouillan, Papon, Yann Piat, Virenque, François Besse, les caricatures de Mahomet, les écoutes élyséennes -un demi-siècle de moments forts. Ces deux petits pavés de près de 1000 pages et d'à peine 14,50€ chacun, je les conseille à tous. Ce sont, servi avec un talent incontesté, un pan de notre mémoire, historique, sociale, économique, politique, judiciaire; humaine. D'ici et d'ailleurs. Faites passer et lisez. Ce sont des "romans" polyphoniques, des odes sérieuses -au plus près du fait-, au temps qui passe, que ces petites pierres marqueront durablement grâce à l'expression d'un grand professionnalisme, du sens absolu d'un métier qui exprime la volonté de ne connaître qu'une seule ligne : celle du chemin de fer (Albert Londres, again).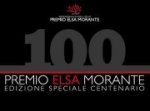 Pour l'édition du centenaire de la naissance de l'auteur de L'île d'Arturo, de Aracoeli, de La Storia et autres chefs-d'oeuvre, le Prix Elsa Morante -présidé par Tjuna Notarbartolo, une amie follement amoureuse de Procida, écrivain (son dernier livre A volo d'angelo, Felici editore, connaît
Pour l'édition du centenaire de la naissance de l'auteur de L'île d'Arturo, de Aracoeli, de La Storia et autres chefs-d'oeuvre, le Prix Elsa Morante -présidé par Tjuna Notarbartolo, une amie follement amoureuse de Procida, écrivain (son dernier livre A volo d'angelo, Felici editore, connaît  leurs paroles. Extrait du Corriere della sera de ce jour : Nel centenario della nascita di Elsa Morante, il Premio intitolato alla grande scrittrice si arricchisce di una nuova sezione, 'Parole in musica', dedicata ai grandi cantautori italiani, e la giuria presieduta da Dacia Maraini premia Gianna Nannini ''per la narrativita' luminosa delle sue canzoni, veicolo di emozioni nel senso piu' 'morantiano' del termine'. Voici le site de Gianna Nannini, italianissime comme on aime, la voix éraillée à mort, qui semble gravée à la grappa et à la clope, à l'insomnie et au sexe; bref d'un certain glamour... :
leurs paroles. Extrait du Corriere della sera de ce jour : Nel centenario della nascita di Elsa Morante, il Premio intitolato alla grande scrittrice si arricchisce di una nuova sezione, 'Parole in musica', dedicata ai grandi cantautori italiani, e la giuria presieduta da Dacia Maraini premia Gianna Nannini ''per la narrativita' luminosa delle sue canzoni, veicolo di emozioni nel senso piu' 'morantiano' del termine'. Voici le site de Gianna Nannini, italianissime comme on aime, la voix éraillée à mort, qui semble gravée à la grappa et à la clope, à l'insomnie et au sexe; bref d'un certain glamour... : 
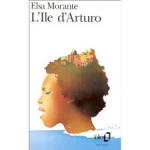 rappelle -en la modernisant considérablement, cela va de soi-, la prose langoureuse, enveloppante, envoûtante, impregnée de tant de sortilèges de "la" Morante, dont on ne se lasse pas de relire L'Île d'Arturo, entre autres romans marquants de la littérature italienne du XXème siècle. Lire par ailleurs ses Récits oubliés publiés par Verdier, l'heureux et méritant éditeur de Lagrasse qui vient de remporter ce matin le Prix Décembre avec Mathieu Riboulet et ses Oeuvres de miséricorde.
rappelle -en la modernisant considérablement, cela va de soi-, la prose langoureuse, enveloppante, envoûtante, impregnée de tant de sortilèges de "la" Morante, dont on ne se lasse pas de relire L'Île d'Arturo, entre autres romans marquants de la littérature italienne du XXème siècle. Lire par ailleurs ses Récits oubliés publiés par Verdier, l'heureux et méritant éditeur de Lagrasse qui vient de remporter ce matin le Prix Décembre avec Mathieu Riboulet et ses Oeuvres de miséricorde.  Notre-Dame du Nil (Gallimard, éditeur de Le Clézio... et qui n'avait pour l'heure rien raflé dans la course aux Prix) et son auteure rwandaise méconnue, Scholastique Mukasonga, alors qu'il ne figurait pas sur la short list et que peu de jurés avaient même eu connaissance du livre (Jérôme Garcin, de L'Obs, l'avait, lui, lu et en avait rendu compte dans ses pages). L'auteure, aussitôt prévenue, aurait même cru à une blague par téléphone. C'est dire! Comment comprendre une telle surprise dont le Renaudot est d'ailleurs coutumier (Némirovsky et Pennac, déjà, pour des raisons différentes...). Le non-respect des règles, passe. Ce détournement au service de rattrapages, non. Mais on va encore penser que je suis mauvaise langue.
Notre-Dame du Nil (Gallimard, éditeur de Le Clézio... et qui n'avait pour l'heure rien raflé dans la course aux Prix) et son auteure rwandaise méconnue, Scholastique Mukasonga, alors qu'il ne figurait pas sur la short list et que peu de jurés avaient même eu connaissance du livre (Jérôme Garcin, de L'Obs, l'avait, lui, lu et en avait rendu compte dans ses pages). L'auteure, aussitôt prévenue, aurait même cru à une blague par téléphone. C'est dire! Comment comprendre une telle surprise dont le Renaudot est d'ailleurs coutumier (Némirovsky et Pennac, déjà, pour des raisons différentes...). Le non-respect des règles, passe. Ce détournement au service de rattrapages, non. Mais on va encore penser que je suis mauvaise langue.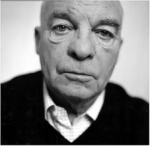
 exceptionnelle restent en surnuméraire : Philippe Jaccottet et Yves Bonnefoy -des classiques vivants. De Jacques Dupin, je ne me lasse jamais de rouvrir ses principaux livres (publiés chez Gallimard, Fata Morgana et POL pour la plupart). Trois, en format de poche (
exceptionnelle restent en surnuméraire : Philippe Jaccottet et Yves Bonnefoy -des classiques vivants. De Jacques Dupin, je ne me lasse jamais de rouvrir ses principaux livres (publiés chez Gallimard, Fata Morgana et POL pour la plupart). Trois, en format de poche (

 d'une fraîcheur confondante, une bouche pleine et ronde), pour escorter de toutes petites crevettes (qui deviennent grises) jetées vivantes, transparentes et en bouquet dans une poêle chaude avec un fond accueillant d'huile d'olive, d'ail finement coupé et de persil plat. Saupoudrez généreusement de sel et poivrez. C'est si rare d'en trouver chez le poissonnier! En lisant quoi? -Les Haïkus saisonniers de Kerouac (La petite vermillon de LTR) qui n'égalent pas les maîtres du genre
d'une fraîcheur confondante, une bouche pleine et ronde), pour escorter de toutes petites crevettes (qui deviennent grises) jetées vivantes, transparentes et en bouquet dans une poêle chaude avec un fond accueillant d'huile d'olive, d'ail finement coupé et de persil plat. Saupoudrez généreusement de sel et poivrez. C'est si rare d'en trouver chez le poissonnier! En lisant quoi? -Les Haïkus saisonniers de Kerouac (La petite vermillon de LTR) qui n'égalent pas les maîtres du genre  Japonais, mais qui possèdent la légèreté apparente du beatnik de Sur la route. Ou bien une nouvelle (courte) de Conrad, Jeunesse par exemple, car dans une nouvelle de Conrad, il y a tout Conrad ramassé (éd. autrement) et que tout Conrad ramassé en une poignée de pages, c'est l'océan avec des hommes de bonne volonté dessus.
Japonais, mais qui possèdent la légèreté apparente du beatnik de Sur la route. Ou bien une nouvelle (courte) de Conrad, Jeunesse par exemple, car dans une nouvelle de Conrad, il y a tout Conrad ramassé (éd. autrement) et que tout Conrad ramassé en une poignée de pages, c'est l'océan avec des hommes de bonne volonté dessus. Passons à table avec une cassolette de pibales, ces alevins d’anguilles qui nous reviennent en hiver depuis la lointaine mer des Sargasses et qui, longs comme des petits doigts, fins comme des spaghettis à deux yeux (les Japonais sont d’ailleurs parvenus à en faire un surimi plus vrai que nature), translucides avant que d’être « passés
Passons à table avec une cassolette de pibales, ces alevins d’anguilles qui nous reviennent en hiver depuis la lointaine mer des Sargasses et qui, longs comme des petits doigts, fins comme des spaghettis à deux yeux (les Japonais sont d’ailleurs parvenus à en faire un surimi plus vrai que nature), translucides avant que d’être « passés  atteindre des sommes astronomiques, jusqu’à 1000€ le kilo payé au pêcheur, et cela se traduit par 50€ la mini cassolette de 100g, dans les restaurants basco-landais et espagnols qui en servent (
atteindre des sommes astronomiques, jusqu’à 1000€ le kilo payé au pêcheur, et cela se traduit par 50€ la mini cassolette de 100g, dans les restaurants basco-landais et espagnols qui en servent ( hypothermie) vers la Chine et Hong-Kong pour l’élevage de l’anguille que l’alevin deviendra (l’anguille ne se reproduit pas en aquaculture, il faut donc l’élever à partir de son alevin. En 18 mois, un kilo d’alevins donne 800 kg d’anguilles). Cette exportation a cependant été interdite la saison dernière, mettant en danger des centaines de « civeliers » charentais notamment (on pêche l’alevin, appelé aussi civelle dans les estuaires de la Charente, de la Gironde et de l’Adour). Mais il y a pire : la réglementation européenne de la pêche des alevins durcit le ton car les pibales se raréfient. Certes la pêche française, forte de 690 unités maritimes de 7 à 12 m et de 225 pêcheurs fluviaux (à pied) recensés en 2007, touche à 66% de la population de l’alevin de l’anguille. Mais les causes principales de sa raréfaction sont la dégradation des habitats, les centrales hydroélectriques, véritables hachoirs à poissons de remontée, les pompages dérivations de cours d’eau, le rejet de 22 pesticides organochlorés et toxiques, les métaux lourds, utilisés en agriculture, notamment pour le maïs, et autres joyeusetés. Buon appetito.
hypothermie) vers la Chine et Hong-Kong pour l’élevage de l’anguille que l’alevin deviendra (l’anguille ne se reproduit pas en aquaculture, il faut donc l’élever à partir de son alevin. En 18 mois, un kilo d’alevins donne 800 kg d’anguilles). Cette exportation a cependant été interdite la saison dernière, mettant en danger des centaines de « civeliers » charentais notamment (on pêche l’alevin, appelé aussi civelle dans les estuaires de la Charente, de la Gironde et de l’Adour). Mais il y a pire : la réglementation européenne de la pêche des alevins durcit le ton car les pibales se raréfient. Certes la pêche française, forte de 690 unités maritimes de 7 à 12 m et de 225 pêcheurs fluviaux (à pied) recensés en 2007, touche à 66% de la population de l’alevin de l’anguille. Mais les causes principales de sa raréfaction sont la dégradation des habitats, les centrales hydroélectriques, véritables hachoirs à poissons de remontée, les pompages dérivations de cours d’eau, le rejet de 22 pesticides organochlorés et toxiques, les métaux lourds, utilisés en agriculture, notamment pour le maïs, et autres joyeusetés. Buon appetito. 
 comme celles de mon pote Joël Dupuch (les Viviers de l'Impératrice) ou bien celles de Gillardeau, ils peuvent faire des étincelles si on a juste l'idée de les décantonner. Sinon, un rouge tout simple -n'allez pas chercher midi à quatorze heures parce
comme celles de mon pote Joël Dupuch (les Viviers de l'Impératrice) ou bien celles de Gillardeau, ils peuvent faire des étincelles si on a juste l'idée de les décantonner. Sinon, un rouge tout simple -n'allez pas chercher midi à quatorze heures parce  qu'il s'agit d'un mets rarissime et cher : un côtes-du-roussillon de hasard et d'humble extraction, mais correctement élevé fera l'affaire (là, aucun ne me vient spontanément),
qu'il s'agit d'un mets rarissime et cher : un côtes-du-roussillon de hasard et d'humble extraction, mais correctement élevé fera l'affaire (là, aucun ne me vient spontanément), 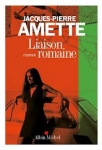
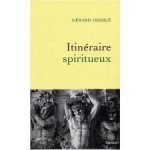 d'un homme fou amoureux et que ça, c'est toujours poignant et qu'en plus Amette écrit par touches d'une sensibilité d'antenne d'escargot -ça compte lorsqu'on tourne les pages!..
d'un homme fou amoureux et que ça, c'est toujours poignant et qu'en plus Amette écrit par touches d'une sensibilité d'antenne d'escargot -ça compte lorsqu'on tourne les pages!.. 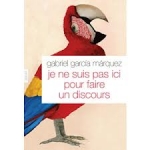 Harrison. Ou encore les discours de "Gabo",
Harrison. Ou encore les discours de "Gabo",  macérer. C’est elle qui est accusée de sublimer la créativité et parfois de rendre « fou »… Au bout de 95 années d’interdiction, la loi de 1915 qui, en interdisant l’absinthe, ouvrit un boulevard à toutes les boissons anisées (*), pourrait bien être abrogée, car le Sénat a déjà voté son abrogation en décembre 2010, faisant enfin suite à un décret de 1988 qui a mis fin à la prohibition de l’absinthe par un dispositif technique. La proposition d’abrogation effectue actuellement la « navette parlementaire ». À suivre, donc. L’absinthe serait ainsi réhabilitée. Bue additionnée d’eau selon un rituel précis : on verse notamment l’eau glacée lentement sur un sucre posé sur la cuillère à absinthe… Verte, blanche, ou bien déclinée en cocktails, l’Absinthe sulfureuse au goût anisé et légèrement amer de la fin du XIXème siècle, pourrait bien devenir branchée. Les « markéteux » y pensent fort.
macérer. C’est elle qui est accusée de sublimer la créativité et parfois de rendre « fou »… Au bout de 95 années d’interdiction, la loi de 1915 qui, en interdisant l’absinthe, ouvrit un boulevard à toutes les boissons anisées (*), pourrait bien être abrogée, car le Sénat a déjà voté son abrogation en décembre 2010, faisant enfin suite à un décret de 1988 qui a mis fin à la prohibition de l’absinthe par un dispositif technique. La proposition d’abrogation effectue actuellement la « navette parlementaire ». À suivre, donc. L’absinthe serait ainsi réhabilitée. Bue additionnée d’eau selon un rituel précis : on verse notamment l’eau glacée lentement sur un sucre posé sur la cuillère à absinthe… Verte, blanche, ou bien déclinée en cocktails, l’Absinthe sulfureuse au goût anisé et légèrement amer de la fin du XIXème siècle, pourrait bien devenir branchée. Les « markéteux » y pensent fort. Baudelaire et autres addicts. Je préfère suggérer le dernier Echenoz, 14 (Minuit) pour sa prose d'une pureté, d'une épure, d'un dégraissage, d'une essence d'extrait rarement lues ailleurs, même chez lui. Ses phrases, voire ses chapitres, courts certes, retombent sur leurs pattes (surtout le 7) comme un chat jeté du troisième étage : ça fonctionne à la perfection, à la manière d'une suite, d'un menuet, d'une pièce; d'un oeuf. Echenoz a d'ailleurs quelques lignes pour les soldats (de 14-18) que seul l'alcool fort pouvait projeter au devant du front de feu et d'acier avec une relative inconscience -nécessaire et bienvenue,
Baudelaire et autres addicts. Je préfère suggérer le dernier Echenoz, 14 (Minuit) pour sa prose d'une pureté, d'une épure, d'un dégraissage, d'une essence d'extrait rarement lues ailleurs, même chez lui. Ses phrases, voire ses chapitres, courts certes, retombent sur leurs pattes (surtout le 7) comme un chat jeté du troisième étage : ça fonctionne à la perfection, à la manière d'une suite, d'un menuet, d'une pièce; d'un oeuf. Echenoz a d'ailleurs quelques lignes pour les soldats (de 14-18) que seul l'alcool fort pouvait projeter au devant du front de feu et d'acier avec une relative inconscience -nécessaire et bienvenue, 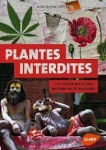 (*) lire : Plantes interdites,
(*) lire : Plantes interdites, 
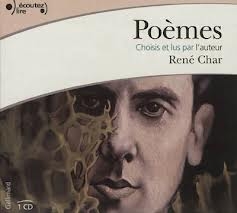


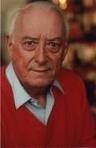 Extraits d'une lettre que m'a adressé
Extraits d'une lettre que m'a adressé 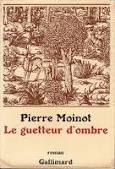 dégage du récit entier une mélancolie profonde, loin du temps, un sentiment rare d'harmonie qui d'ailleurs joue sans doute dans l'effacement du temps, le seul repère étant cette boule chaude d'un bonheur passé, du grand-père, d'une esquisse de famille au soleil - L'ensemble fait que ce récit échappe au corset réducteur des "récits de chasse" et rejoint une littérature de plus large visée. (...) Votre livre m'a touché parce que je le trouve d'une qualité littéraire très au-dessus de tout ce que je lis, parce que je découvre en vous lisant un vrai écrivain, sûr de son outil, riche de ce qu'il a à exprimer, et qui ne me touche pas seulement parce qu'il est de ma "famille d'esprit", mais parce qu'il a une sensibilité rare..."
dégage du récit entier une mélancolie profonde, loin du temps, un sentiment rare d'harmonie qui d'ailleurs joue sans doute dans l'effacement du temps, le seul repère étant cette boule chaude d'un bonheur passé, du grand-père, d'une esquisse de famille au soleil - L'ensemble fait que ce récit échappe au corset réducteur des "récits de chasse" et rejoint une littérature de plus large visée. (...) Votre livre m'a touché parce que je le trouve d'une qualité littéraire très au-dessus de tout ce que je lis, parce que je découvre en vous lisant un vrai écrivain, sûr de son outil, riche de ce qu'il a à exprimer, et qui ne me touche pas seulement parce qu'il est de ma "famille d'esprit", mais parce qu'il a une sensibilité rare..." 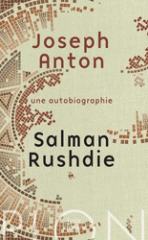 Je n'ai pas encore lu Joseph Anton, Une autobiographie, de Salman Rushdie qui paraît ces jours-ci chez Plon, mais j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les trois pages du Monde des Livres daté d'hier consacrées à son auteur, rencontré le 12 septembre dernier à Londres. L'entretien avec Jean Birnbaum (par ailleurs responsable du meilleur supplément littéraire de la presse quotidienne nationale française), est complété d'éclairages, notamment celui de l'historienne Lucette Valensi.
Je n'ai pas encore lu Joseph Anton, Une autobiographie, de Salman Rushdie qui paraît ces jours-ci chez Plon, mais j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les trois pages du Monde des Livres daté d'hier consacrées à son auteur, rencontré le 12 septembre dernier à Londres. L'entretien avec Jean Birnbaum (par ailleurs responsable du meilleur supplément littéraire de la presse quotidienne nationale française), est complété d'éclairages, notamment celui de l'historienne Lucette Valensi. 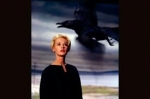 l'affaire des caricatures de Mahomet et de l'incendie des locaux de Charlie-Hebdo) : Tout cela fait partie de la même histoire, du même récit fondamental, affirme Rushdie. Mais, en 1989, il était trop tôt pour comprendre de quoi il s'agissait. Personne n'a vu la fatwa comme le début d'un conflit plus large, on y percevait une anomalie farfelue. C'est comme dans Les Oiseaux, d'Hitchcock. Il y a d'abord un oiseau qui apparaît, et vous vous dites : "C'est juste un oiseau!" C'est seulement plus tard, quand le ciel est rempli d'oiseaux furieux, que vous pensez : "Ah, oui, cet oiseau annonçait quelque chose, il n'était que le premier..." Cette comparaison est omniprésente sous la plume de Rushdie, dont le livre bâtit une "onithologie de la terreur".
l'affaire des caricatures de Mahomet et de l'incendie des locaux de Charlie-Hebdo) : Tout cela fait partie de la même histoire, du même récit fondamental, affirme Rushdie. Mais, en 1989, il était trop tôt pour comprendre de quoi il s'agissait. Personne n'a vu la fatwa comme le début d'un conflit plus large, on y percevait une anomalie farfelue. C'est comme dans Les Oiseaux, d'Hitchcock. Il y a d'abord un oiseau qui apparaît, et vous vous dites : "C'est juste un oiseau!" C'est seulement plus tard, quand le ciel est rempli d'oiseaux furieux, que vous pensez : "Ah, oui, cet oiseau annonçait quelque chose, il n'était que le premier..." Cette comparaison est omniprésente sous la plume de Rushdie, dont le livre bâtit une "onithologie de la terreur".  (...) Vers le milieu de Joseph Anton, Rushdie évoque en particulier une "mouette aux ailes mazoutées qui ne pouvait plus voler". Le mazout, ici, représente la visqueuse tolérance à l'égard de l'intolérance, l'idéologie sirupeuse du compromis et l'accusation paralysante d'"islamophobie".
(...) Vers le milieu de Joseph Anton, Rushdie évoque en particulier une "mouette aux ailes mazoutées qui ne pouvait plus voler". Le mazout, ici, représente la visqueuse tolérance à l'égard de l'intolérance, l'idéologie sirupeuse du compromis et l'accusation paralysante d'"islamophobie".  C'est un Crozes-Hermitage (rouge 2011) de la Cave de Tain (sise à Tain L'Hermitage, dans la Drôme et dont je ne me lasserai pas de dire du bien). Syrah à 100%. Cuvaison courte et mise rapide afin de préserver le fruit dans sa pureté : bon point. Robe profonde, sombre comme la nuit tombante. Nez de fruits des sous-bois et des haies dont on fait des confitures ce mois-ci, suivi d'arômes plus durs de cuir et de tabac à pipe blond légèrement poivré. Bouche ravissante de fraîcheur, belle structure, longueur plus que correcte. Finale doucement épicée. J'ai accompagné ce vin issu de raisins biologiques (10€ le flacon et ça les vaut bien) et qui s'inscrit sans forfanterie mais avec une réelle conviction dans la démarche de la Cave de Tain en faveur du Développement durable, avec -ne riez pas-, d'un côté une simple pizza margharita de belle facture, rehaussée d'huile pimentée et de l'autre l'âpreté des Croquis de la Nouvelle-Orléans brossés par William Faulkner (in Coucher de soleil, folio 2€). Et bien la syrah s'en est sortie la tête haute.
C'est un Crozes-Hermitage (rouge 2011) de la Cave de Tain (sise à Tain L'Hermitage, dans la Drôme et dont je ne me lasserai pas de dire du bien). Syrah à 100%. Cuvaison courte et mise rapide afin de préserver le fruit dans sa pureté : bon point. Robe profonde, sombre comme la nuit tombante. Nez de fruits des sous-bois et des haies dont on fait des confitures ce mois-ci, suivi d'arômes plus durs de cuir et de tabac à pipe blond légèrement poivré. Bouche ravissante de fraîcheur, belle structure, longueur plus que correcte. Finale doucement épicée. J'ai accompagné ce vin issu de raisins biologiques (10€ le flacon et ça les vaut bien) et qui s'inscrit sans forfanterie mais avec une réelle conviction dans la démarche de la Cave de Tain en faveur du Développement durable, avec -ne riez pas-, d'un côté une simple pizza margharita de belle facture, rehaussée d'huile pimentée et de l'autre l'âpreté des Croquis de la Nouvelle-Orléans brossés par William Faulkner (in Coucher de soleil, folio 2€). Et bien la syrah s'en est sortie la tête haute.  Les croquis du Deep South circonscrivent en trois ou quatre phrases à peine un personnage saisi sur le vif aussi efficacement qu'un portrait exécuté par un peintre leste et sur lequel nous portons un coup d'oeil puis un regard appuyé. Tout est là, dit ou (dé)peint. Cela s'appelle le talent et Faulkner n'en manquait pas. Ses sujets d'écriture sont les humbles. Mendiants, cabossés de la vie, simples d'esprit, alcooliques, tous sont avides de reconnaissance et lancent des appels à l'autre comme on jette une bouteille à la mer. Ce crozes-hermitage n'a pas besoin de cela, car c'est lui qui envoie des signes où l'on reconnaît l'évidence de la syrah lorsqu'elle s'épanouit dans les côtes-du-rhône septentrionales, rive gauche bien sûr et qu'un travail à main d'homme a fait consciencieusement le reste; soit l'essentiel. A la manière de l'écrivain ou du peintre devant le motif. Et comme j'étais en appétit, j'ai enquillé en feuilletant les poèmes hiératiques d'Erri De Luca tout en picorant des baies de raisin noir (lire Solo andata, juste dessous). En lisant, en croquant, en prenant une gorgée par-ci, par-là, ce rouge d'une distinction franche m'a soufflé une idée : désormais, je me livrerai au jeu charmant des alliances vins-mets-livres. Parce que ça marche.
Les croquis du Deep South circonscrivent en trois ou quatre phrases à peine un personnage saisi sur le vif aussi efficacement qu'un portrait exécuté par un peintre leste et sur lequel nous portons un coup d'oeil puis un regard appuyé. Tout est là, dit ou (dé)peint. Cela s'appelle le talent et Faulkner n'en manquait pas. Ses sujets d'écriture sont les humbles. Mendiants, cabossés de la vie, simples d'esprit, alcooliques, tous sont avides de reconnaissance et lancent des appels à l'autre comme on jette une bouteille à la mer. Ce crozes-hermitage n'a pas besoin de cela, car c'est lui qui envoie des signes où l'on reconnaît l'évidence de la syrah lorsqu'elle s'épanouit dans les côtes-du-rhône septentrionales, rive gauche bien sûr et qu'un travail à main d'homme a fait consciencieusement le reste; soit l'essentiel. A la manière de l'écrivain ou du peintre devant le motif. Et comme j'étais en appétit, j'ai enquillé en feuilletant les poèmes hiératiques d'Erri De Luca tout en picorant des baies de raisin noir (lire Solo andata, juste dessous). En lisant, en croquant, en prenant une gorgée par-ci, par-là, ce rouge d'une distinction franche m'a soufflé une idée : désormais, je me livrerai au jeu charmant des alliances vins-mets-livres. Parce que ça marche. 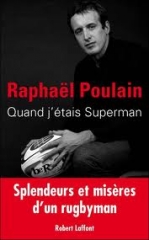 Raphaël Poulain, ex rugbyman pro du Stade Français surnommé un temps le Lomu frenchie, se confesse à fond dans Quand j'étais Superman (Robert Laffont) et c'est infiniment attendrissant. Le beau bébé de 100 kg de muscles, issu du terroir Picard (around Beauvais) aura connu (de manière par trop fulgurante) les ors, la gloire, l'argent facile, le champagne, les filles en veux-tu en voilà autant que des bagnoles décapotables et de la dope et tout ce que tu voudras. Résultat : une jolie dépression en cours de fausse-route, une décheption (déchoir, se décevoir peut-être, remettre les compteurs à Z surtout -et c'est ça qui compte aujourd'hui) : au présent et à l'avenir, Raph s'est engagé dans le métier dur, âpre, pas gagné de comédien comme on s'engouffre dans la Légion. Histoire d'oublier, de se refaire surtout -le gamin a la trentaine tout juste dépassée et un talent à revendre comme Matthias Schoenaerts
Raphaël Poulain, ex rugbyman pro du Stade Français surnommé un temps le Lomu frenchie, se confesse à fond dans Quand j'étais Superman (Robert Laffont) et c'est infiniment attendrissant. Le beau bébé de 100 kg de muscles, issu du terroir Picard (around Beauvais) aura connu (de manière par trop fulgurante) les ors, la gloire, l'argent facile, le champagne, les filles en veux-tu en voilà autant que des bagnoles décapotables et de la dope et tout ce que tu voudras. Résultat : une jolie dépression en cours de fausse-route, une décheption (déchoir, se décevoir peut-être, remettre les compteurs à Z surtout -et c'est ça qui compte aujourd'hui) : au présent et à l'avenir, Raph s'est engagé dans le métier dur, âpre, pas gagné de comédien comme on s'engouffre dans la Légion. Histoire d'oublier, de se refaire surtout -le gamin a la trentaine tout juste dépassée et un talent à revendre comme Matthias Schoenaerts 
 perception par une certaine gauche, le danger islamiste (admirablement décrit aussi par Sansal -tant en Algérie que dans nos "cités"), l'assimilation dangereuse entre Israël et le régime nazi et beaucoup d'autres sujets qui devraient faire davantage débat (les menaces réitérées de l'Iran d'effacer Israël de la carte du monde, par exemple) et qui, curieusement, n'émeuvent pas outre mesure les opinions française et internationale... M'est avis que ce livre fera date.
perception par une certaine gauche, le danger islamiste (admirablement décrit aussi par Sansal -tant en Algérie que dans nos "cités"), l'assimilation dangereuse entre Israël et le régime nazi et beaucoup d'autres sujets qui devraient faire davantage débat (les menaces réitérées de l'Iran d'effacer Israël de la carte du monde, par exemple) et qui, curieusement, n'émeuvent pas outre mesure les opinions française et internationale... M'est avis que ce livre fera date. 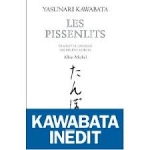 Kawabata (Albin Michel), roman inachevé et d'une grande poésie où percent l'ellipse, la cécité, la folie heureuse ou bien naïve, les beautés de la nature, l'approche sereine de la mort.
Kawabata (Albin Michel), roman inachevé et d'une grande poésie où percent l'ellipse, la cécité, la folie heureuse ou bien naïve, les beautés de la nature, l'approche sereine de la mort.  plonge! -Quel plaisir, nom d'un p'tit bonhomme... On circule dans ses pages (et dans un Marseille dont on tombe forcément amoureux) comme dans un grand Fred Vargas : L'homme à l'envers par exemple, relu avant l'été just for pleasure). Je suis d'ailleurs en immersion dans Chourmo, le second volet de la trilogie qui s'achève avec Solea, du regretté Izzo.
plonge! -Quel plaisir, nom d'un p'tit bonhomme... On circule dans ses pages (et dans un Marseille dont on tombe forcément amoureux) comme dans un grand Fred Vargas : L'homme à l'envers par exemple, relu avant l'été just for pleasure). Je suis d'ailleurs en immersion dans Chourmo, le second volet de la trilogie qui s'achève avec Solea, du regretté Izzo.  britannique) après la guerre, et qui commence une seconde vie déjà, au moment de bâtir Israël. L'adolescent ne trouve l'apaisement que dans le sommeil. Il semble vouloir oublier, tandis qu'il cultive inconsciemment les souvenirs. En réalité, la fuite inexorable et prégnante dans le sommeil lui permet de retrouver ses parents morts dans les profondeurs de la nuit, lui qui doit aussi désapprendre sa langue maternelle pour apprendre l'hébreu. C'est puissant et tendre à la fois, prodigieusement onirique et tendu, et à la fois accroché au réel. Un livre aussi bouleversant que l'inoubliable Histoire d'une vie, du même Appelfeld (Points).
britannique) après la guerre, et qui commence une seconde vie déjà, au moment de bâtir Israël. L'adolescent ne trouve l'apaisement que dans le sommeil. Il semble vouloir oublier, tandis qu'il cultive inconsciemment les souvenirs. En réalité, la fuite inexorable et prégnante dans le sommeil lui permet de retrouver ses parents morts dans les profondeurs de la nuit, lui qui doit aussi désapprendre sa langue maternelle pour apprendre l'hébreu. C'est puissant et tendre à la fois, prodigieusement onirique et tendu, et à la fois accroché au réel. Un livre aussi bouleversant que l'inoubliable Histoire d'une vie, du même Appelfeld (Points).


 français moderne par André Lanly. Débat :
français moderne par André Lanly. Débat :  cette adaptation (très récente, des Essais dans la collection Quarto/Gallimard -et il s'agit avec Sur l'oisiveté d'un extrait) est-elle supérieure à celle, admirable, de Claude Pinganaud (pour Arléa)? Il nous faudra comparer les deux textes (à suivre, donc). Ce petit
cette adaptation (très récente, des Essais dans la collection Quarto/Gallimard -et il s'agit avec Sur l'oisiveté d'un extrait) est-elle supérieure à celle, admirable, de Claude Pinganaud (pour Arléa)? Il nous faudra comparer les deux textes (à suivre, donc). Ce petit  recueil reprend les chapîtres sur l'oisiveté, le pédantisme, la cruauté, la fénéantise et la colère.
recueil reprend les chapîtres sur l'oisiveté, le pédantisme, la cruauté, la fénéantise et la colère. 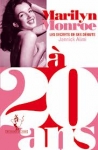 Il y a également des petites choses intéressantes à parcourir :
Il y a également des petites choses intéressantes à parcourir : 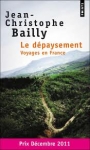

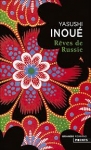

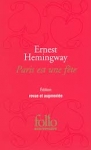 Papa Hemingway dans une jolie édition collector (folio)
Papa Hemingway dans une jolie édition collector (folio)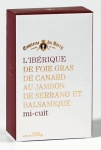

 château Campuget tradition 2010, un Costières-de-Nîmes à 3,60€ qui ne s’en laisse pas compter : il est puissant et rond, vif et long, épicé (poivre) et soyeux. L’autre est château Vaugelas, Cuvée Prestige 2010, un Corbières magnifique, modeste et richissime (fruits rouges et noirs, vanille, poivre, soyeux lui aussi et même velouté) qui coûte 4,5€ ! Deux vraies affaires en ces temps de Foires aux vins où les gens font du yoyo avec leur calculette entre les rayons, jusqu'à en oublier l'usage du tire-bouchon... Lisez et buvez.
château Campuget tradition 2010, un Costières-de-Nîmes à 3,60€ qui ne s’en laisse pas compter : il est puissant et rond, vif et long, épicé (poivre) et soyeux. L’autre est château Vaugelas, Cuvée Prestige 2010, un Corbières magnifique, modeste et richissime (fruits rouges et noirs, vanille, poivre, soyeux lui aussi et même velouté) qui coûte 4,5€ ! Deux vraies affaires en ces temps de Foires aux vins où les gens font du yoyo avec leur calculette entre les rayons, jusqu'à en oublier l'usage du tire-bouchon... Lisez et buvez.
 Puisque l'atmosphère est à l'échappée en bord de mer, glissez dans votre plus petite poche le Guide nature des Balades en bord de mer (Points2). Extrait des fameux et irréprochables guides publiés par Delachaux et Niestlé, c'est un compagnon malin et idéal pour identifier la faune (oiseaux, poissons, crustacés) et la flore de nos côtes plus ou moins sauvages. Personnellement, je déteste hésiter entre une sterne arctique et une sterne pierregarin lorsque l'une passe et que je nomme l'autre intérieurement. Si je doute, je peux souffrir de n'avoir pas avec moi un guide vérificateur comme celui-ci. Les illustrations sont très fidèles et les fiches signalétiques concises, précises; précieuses. Et puis savoir distinguer le réséda blanc (si bien décrit par Proust qu'il devient impossible de le confondre) du gaillet des sables, ou encore l'actéon, de la nasse réticulée (deux coquillages) enrichit et transforme une promenade sur la dune en exploration douce. Bon à prendre.
Puisque l'atmosphère est à l'échappée en bord de mer, glissez dans votre plus petite poche le Guide nature des Balades en bord de mer (Points2). Extrait des fameux et irréprochables guides publiés par Delachaux et Niestlé, c'est un compagnon malin et idéal pour identifier la faune (oiseaux, poissons, crustacés) et la flore de nos côtes plus ou moins sauvages. Personnellement, je déteste hésiter entre une sterne arctique et une sterne pierregarin lorsque l'une passe et que je nomme l'autre intérieurement. Si je doute, je peux souffrir de n'avoir pas avec moi un guide vérificateur comme celui-ci. Les illustrations sont très fidèles et les fiches signalétiques concises, précises; précieuses. Et puis savoir distinguer le réséda blanc (si bien décrit par Proust qu'il devient impossible de le confondre) du gaillet des sables, ou encore l'actéon, de la nasse réticulée (deux coquillages) enrichit et transforme une promenade sur la dune en exploration douce. Bon à prendre.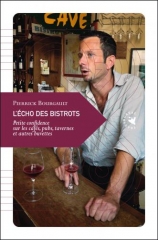 Nous avons tous nos bars d'élection, nos repaires, nos petites adresses, nos querencias, nos annexes où nous nous sentons bien, accoudés au zinc ou bien assis en terrasse; seul ou avec un ou plusieurs amis. Un café peut devenir le centre du monde et, selon sa clientèle et donc l'endroit où il se trouve, son style aussi, une photographie de la société. J'adore les bars pour cela. Pour observer l'autre, prendre le temps, l'air et aussi déguster un bon vin. Pierrick Bourgault est un bourlingueur. Il va de bar en bar, partout et il sait parler de ces microcosmes qui en disent si long sur les rapports humains, sur les caractères, les
Nous avons tous nos bars d'élection, nos repaires, nos petites adresses, nos querencias, nos annexes où nous nous sentons bien, accoudés au zinc ou bien assis en terrasse; seul ou avec un ou plusieurs amis. Un café peut devenir le centre du monde et, selon sa clientèle et donc l'endroit où il se trouve, son style aussi, une photographie de la société. J'adore les bars pour cela. Pour observer l'autre, prendre le temps, l'air et aussi déguster un bon vin. Pierrick Bourgault est un bourlingueur. Il va de bar en bar, partout et il sait parler de ces microcosmes qui en disent si long sur les rapports humains, sur les caractères, les 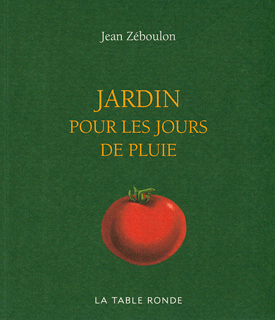
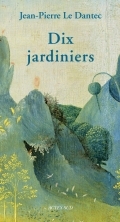 Dans un registre plus sérieux, Jean-Pierre Le Dantec, dont on avait évoqué ici la Poétique des jardins, publie Dix jardiniers (les deux chez Actes Sud), ou l'éloge, en dix mini-biographies très libres, de dix jardiniers exceptionnels, passionnés, flamboyants, géniaux en somme. L'historien de l'architecture, de la ville et du paysagisme raconte des vies et il aime ça. Il invente sans doute un peu, mais il envoûte avant tout. Le substrat informatif est solide et la littérature nappe l'ensemble, avec sa part nécessaire de fiction : la recette prend, que l'auteur narre l'existence et l'oeuvre de Pirro Ligorio (à qui l'on doit les jardins de la Villa d'Este), celles de Frederick Law Olmsted et Calvert Vaux (Central Park à New York), ou encore la vie singulière de Charles Pecqueur, cet ancien mineur du Nord qui concentra sa vision du monde dans son minuscule jardin d'art brut.
Dans un registre plus sérieux, Jean-Pierre Le Dantec, dont on avait évoqué ici la Poétique des jardins, publie Dix jardiniers (les deux chez Actes Sud), ou l'éloge, en dix mini-biographies très libres, de dix jardiniers exceptionnels, passionnés, flamboyants, géniaux en somme. L'historien de l'architecture, de la ville et du paysagisme raconte des vies et il aime ça. Il invente sans doute un peu, mais il envoûte avant tout. Le substrat informatif est solide et la littérature nappe l'ensemble, avec sa part nécessaire de fiction : la recette prend, que l'auteur narre l'existence et l'oeuvre de Pirro Ligorio (à qui l'on doit les jardins de la Villa d'Este), celles de Frederick Law Olmsted et Calvert Vaux (Central Park à New York), ou encore la vie singulière de Charles Pecqueur, cet ancien mineur du Nord qui concentra sa vision du monde dans son minuscule jardin d'art brut. 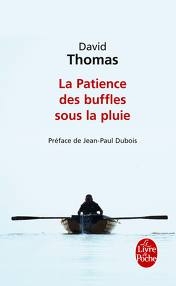

 Il serait commode de dire qu'il s'agit d'un roman à tiroirs. La grande maison, second roman traduit de Nicole Krauss (folio) est pourtant une prodigieuse construction qui présente, entrelace, mêle, démêle quatre histoires gravitant autour d'un bureau ayant appartenu à Federico Garcia Lorca et qui possèderait une âme capable de lier quatre destins éparpillés : à Londres, celui d'Athur Bender qui découvre que sa femme lui a caché une partie de sa vie. A Jérusalem, celui d'un père qui adresse une lettre émouvante à son fils Dov dont il n'a jamais su être proche. A Oxford où une Américaine, Isabelle, venue étudier outre-Atlantique, tombe éperdument amoureuse du fils d'une étrange antiquaire dont l'existence est dédiée à la restitution des biens juifs confisqués par les nazis. Et le destin du poète Daniel Varsky enfin, qui confie à une certaine Nadia le bureau si particulier. L'écriture envoûtante de Krauss, son sens prodigieux de la construction d'un roman (elle retombe toujours sur ses pattes et ne nous cause aucune peine à suivre l'écheveau de ces histoires) ainsi que sa capacité à ouvrir des tiroirs, à les refermer discrètement, à en laisser d'autres entrouverts, donne à ce roman une dimension mystérieuse singulière. Comme avec son précédent livre L'Histoire de l'amour (déjà évoqué ici l'an passé), on ne lâche pas les pages de cette grande maison.
Il serait commode de dire qu'il s'agit d'un roman à tiroirs. La grande maison, second roman traduit de Nicole Krauss (folio) est pourtant une prodigieuse construction qui présente, entrelace, mêle, démêle quatre histoires gravitant autour d'un bureau ayant appartenu à Federico Garcia Lorca et qui possèderait une âme capable de lier quatre destins éparpillés : à Londres, celui d'Athur Bender qui découvre que sa femme lui a caché une partie de sa vie. A Jérusalem, celui d'un père qui adresse une lettre émouvante à son fils Dov dont il n'a jamais su être proche. A Oxford où une Américaine, Isabelle, venue étudier outre-Atlantique, tombe éperdument amoureuse du fils d'une étrange antiquaire dont l'existence est dédiée à la restitution des biens juifs confisqués par les nazis. Et le destin du poète Daniel Varsky enfin, qui confie à une certaine Nadia le bureau si particulier. L'écriture envoûtante de Krauss, son sens prodigieux de la construction d'un roman (elle retombe toujours sur ses pattes et ne nous cause aucune peine à suivre l'écheveau de ces histoires) ainsi que sa capacité à ouvrir des tiroirs, à les refermer discrètement, à en laisser d'autres entrouverts, donne à ce roman une dimension mystérieuse singulière. Comme avec son précédent livre L'Histoire de l'amour (déjà évoqué ici l'an passé), on ne lâche pas les pages de cette grande maison.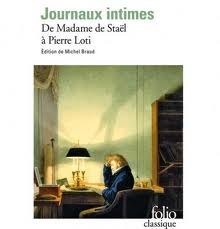 L'été se prête à la lecture des Journaux intimes d'écrivains. Voici une solide anthologie qui balaye le genre -car c'en est un, concoctée par Michel Braud, spécialiste de la question : Journaux intimes, de Madame de Staël à Pierre Loti (folio). Il permet de se souvenir que le Journal est un incomparable baromètre de l'âme qui donne ce que le roman ne donne pas encore. Arrière-boutique du work in progress, il en est aussi le laboratoire, le brouillon magnifique, la chambre des débats intérieurs, y compris lorsqu'il consigne le quotidien et son cortège de faits et gestes d'une banalité qui serait affligeante si elle n'était pas écrite. Produite par un écrivain. Et je pense à ce mot de Robert Kanters (je cite de mémoire) : le roman (en cours) et le Journal sont comme le vêtement et sa doublure et cette dernière est d'une étoffe si fine que l'on peut être tenté
L'été se prête à la lecture des Journaux intimes d'écrivains. Voici une solide anthologie qui balaye le genre -car c'en est un, concoctée par Michel Braud, spécialiste de la question : Journaux intimes, de Madame de Staël à Pierre Loti (folio). Il permet de se souvenir que le Journal est un incomparable baromètre de l'âme qui donne ce que le roman ne donne pas encore. Arrière-boutique du work in progress, il en est aussi le laboratoire, le brouillon magnifique, la chambre des débats intérieurs, y compris lorsqu'il consigne le quotidien et son cortège de faits et gestes d'une banalité qui serait affligeante si elle n'était pas écrite. Produite par un écrivain. Et je pense à ce mot de Robert Kanters (je cite de mémoire) : le roman (en cours) et le Journal sont comme le vêtement et sa doublure et cette dernière est d'une étoffe si fine que l'on peut être tenté 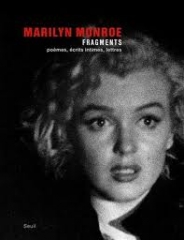 C'est l'année Marilyn. Le cinquantenaire de sa disparition (le 5 août prochain) est l'occasion d'une profusion d'hommages et de la publication de nombreux livres. Parmi ceux-ci, voici la réédition dans un agréable format semi-poche de ces Fragments (Points) qui nous firent découvrir l'année dernière une Marilyn Monroe intime et intello. Histoire de clouer le bec à tous les mysogynes et autres esprits réducteurs enclins à penser hâtivement qu'une blonde pulpeuse ne pouvait posséder le moindre neurone. Les cons. La sensibilité extrême d'une femme fragile et grande lectrice, amie de nombreux écrivains, apparaît au fil de ces pages précieuses qui permettent également de lire ses poèmes (de nombreux manuscrits sont reproduits), ses lettres, son Journal, ses états d'âme et l'ensemble produit un bouquet si délicat qu'on en oublierait le sex symbol; l'inoxydable icône. Une réussite.
C'est l'année Marilyn. Le cinquantenaire de sa disparition (le 5 août prochain) est l'occasion d'une profusion d'hommages et de la publication de nombreux livres. Parmi ceux-ci, voici la réédition dans un agréable format semi-poche de ces Fragments (Points) qui nous firent découvrir l'année dernière une Marilyn Monroe intime et intello. Histoire de clouer le bec à tous les mysogynes et autres esprits réducteurs enclins à penser hâtivement qu'une blonde pulpeuse ne pouvait posséder le moindre neurone. Les cons. La sensibilité extrême d'une femme fragile et grande lectrice, amie de nombreux écrivains, apparaît au fil de ces pages précieuses qui permettent également de lire ses poèmes (de nombreux manuscrits sont reproduits), ses lettres, son Journal, ses états d'âme et l'ensemble produit un bouquet si délicat qu'on en oublierait le sex symbol; l'inoxydable icône. Une réussite. 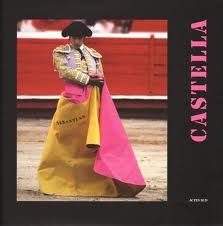 Sebastien Castella, l'immense torero français (il est Bitterois), l'équivalent de José Tomas en Espagne -les deux figuras les plus importantes du moment- ont en commun le partage du mystère. Austères, fermés, ils ne semblent pouvoir s'exprimer que devant un toro de combat. A coups de quarts d'heure d'une émotion parfois insoutenable de justesse, de lenteur (de temple) et de beauté. Le chroniqueur taurin Jacques Durand dit de l'un qu'il laisse son corps à l'hôtel lorsqu'il va toréer. Il y a de cela lorsqu'on voit l'un et/ou l'autre au centre d'une arène. Un livre magnifique vient de paraître sur Castella, signé Olga Holguin (Actes Sud). Cette photographe a suivi le torero pendant plusieurs années. Son livre tire la quintessence visuelle de l'art toreo du maestro. Des textes de grande teneur accompagne ces photos d'une sensibilité de chair de poule, signés Arevalo, Durand, Diusaba. Et des huiles de Robert Ryan enveloppent l'ensemble. Un beau livre; vraiment.
Sebastien Castella, l'immense torero français (il est Bitterois), l'équivalent de José Tomas en Espagne -les deux figuras les plus importantes du moment- ont en commun le partage du mystère. Austères, fermés, ils ne semblent pouvoir s'exprimer que devant un toro de combat. A coups de quarts d'heure d'une émotion parfois insoutenable de justesse, de lenteur (de temple) et de beauté. Le chroniqueur taurin Jacques Durand dit de l'un qu'il laisse son corps à l'hôtel lorsqu'il va toréer. Il y a de cela lorsqu'on voit l'un et/ou l'autre au centre d'une arène. Un livre magnifique vient de paraître sur Castella, signé Olga Holguin (Actes Sud). Cette photographe a suivi le torero pendant plusieurs années. Son livre tire la quintessence visuelle de l'art toreo du maestro. Des textes de grande teneur accompagne ces photos d'une sensibilité de chair de poule, signés Arevalo, Durand, Diusaba. Et des huiles de Robert Ryan enveloppent l'ensemble. Un beau livre; vraiment. 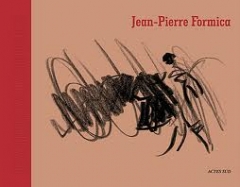 Le peintre Gardois Jean-Pierre Formica livre quant à lui ses Carnets taurins (Actes Sud, préface d'Alain Montcouquiol), réalisés à main levée pendant les corridas de Nîmes et d'ailleurs. Une sélection drastique de ses dix mille dessins à la craie et au fusain nous est proposée, qui choisit de traduire le mouvement, la durée, la retenue, l'instant où le temps semble se taire au détour d'une passe et au coeur de la chorégraphie particulière que livrent sous nos yeux un homme et un fauve. Il est question de geste dans ces dessins et du fameux silence sonore du toreo dont parlait le grand José Bergamin.
Le peintre Gardois Jean-Pierre Formica livre quant à lui ses Carnets taurins (Actes Sud, préface d'Alain Montcouquiol), réalisés à main levée pendant les corridas de Nîmes et d'ailleurs. Une sélection drastique de ses dix mille dessins à la craie et au fusain nous est proposée, qui choisit de traduire le mouvement, la durée, la retenue, l'instant où le temps semble se taire au détour d'une passe et au coeur de la chorégraphie particulière que livrent sous nos yeux un homme et un fauve. Il est question de geste dans ces dessins et du fameux silence sonore du toreo dont parlait le grand José Bergamin.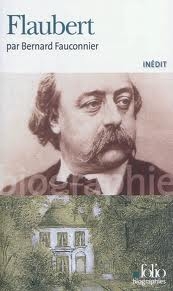 Voici une biographie, une vraie, signée Bernard Fauconnier, inédite et qui paraît directement en poche (folio) sur l'immense Flaubert. L'auteur avait déjà donné un Cézanne qui fut remarqué. Voici l'homme-livre décrit par le menu de l'oeuvre, chronologiquement, avec force documents, masse d'informations et dans un style captivant. On ne lâche pas ce petit bouquin une minute. Et l'envie de reprendre la Bovary, l'Education, les Trois contes, Salammbô et surtout la Correspondance est forte. Car Fauconnier nous prend par la main et nous fait cheminer à côté de Flaubert. Nous ressentons les atermoiements de Gustave, ses joies et ses peines, ses amitiés, ses déconvenues en amour et jusqu'à ses chaudepisses! Nous voyageons en Orient, nous allons par les champs et par les grèves en Normandie et ailleurs, nous compatissons pour lui lorsqu'il souffre de réécrire La tentation de Saint-Antoine, son obsession, lorsqu'il est couvert de lauriers ou bien de dettes, louangé ou bien laminé par une presse vengeresse ou encore vilipendé sournoisement par les précieux ridicules frères Goncourt. La maison de Croisset nous devient aussi familière que Louise Colet, George Sand,
Voici une biographie, une vraie, signée Bernard Fauconnier, inédite et qui paraît directement en poche (folio) sur l'immense Flaubert. L'auteur avait déjà donné un Cézanne qui fut remarqué. Voici l'homme-livre décrit par le menu de l'oeuvre, chronologiquement, avec force documents, masse d'informations et dans un style captivant. On ne lâche pas ce petit bouquin une minute. Et l'envie de reprendre la Bovary, l'Education, les Trois contes, Salammbô et surtout la Correspondance est forte. Car Fauconnier nous prend par la main et nous fait cheminer à côté de Flaubert. Nous ressentons les atermoiements de Gustave, ses joies et ses peines, ses amitiés, ses déconvenues en amour et jusqu'à ses chaudepisses! Nous voyageons en Orient, nous allons par les champs et par les grèves en Normandie et ailleurs, nous compatissons pour lui lorsqu'il souffre de réécrire La tentation de Saint-Antoine, son obsession, lorsqu'il est couvert de lauriers ou bien de dettes, louangé ou bien laminé par une presse vengeresse ou encore vilipendé sournoisement par les précieux ridicules frères Goncourt. La maison de Croisset nous devient aussi familière que Louise Colet, George Sand, 
 Martinez, et un bienvenu florilège de l'auteur de Bel-Ami, Contes au fil de l'eau (folio 2€) dans lequel un bonheur intact nous fait retrouver les pages denses de textes courts et forts comme Amour (in Le Horla) , Sur l'eau (extrait de Une partie de campagne), ou encore En mer (dans
Martinez, et un bienvenu florilège de l'auteur de Bel-Ami, Contes au fil de l'eau (folio 2€) dans lequel un bonheur intact nous fait retrouver les pages denses de textes courts et forts comme Amour (in Le Horla) , Sur l'eau (extrait de Une partie de campagne), ou encore En mer (dans 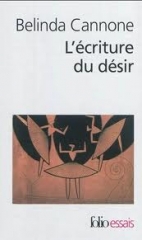 une peau m'incite à essayer d'écrire le goût de cette peau, la forme de mon désir, et le plaisir est grand de chercher, de trouver les mots pour décrire la chose minuscule et immense, l'élan de l'être. La narration du désir, y compris érotique, occupe cet essai sensuel dans les grandes largeurs. Comment édifier le bonheur à partir de notre connaissance du désastre? demande Cannone. Je crois la richesse de la langue miraculeuse, dit-elle. Grâce à elle, le mouvement d'écrire est une étreinte et une célébration. Même lorque les mots disent l'ombre, l'effroi et la souffrance.
une peau m'incite à essayer d'écrire le goût de cette peau, la forme de mon désir, et le plaisir est grand de chercher, de trouver les mots pour décrire la chose minuscule et immense, l'élan de l'être. La narration du désir, y compris érotique, occupe cet essai sensuel dans les grandes largeurs. Comment édifier le bonheur à partir de notre connaissance du désastre? demande Cannone. Je crois la richesse de la langue miraculeuse, dit-elle. Grâce à elle, le mouvement d'écrire est une étreinte et une célébration. Même lorque les mots disent l'ombre, l'effroi et la souffrance.  qui revigore l'esprit, notre mémoire des oeuvres, des dates, des pseudos d'écrivains, des Prix, des lieux, des personnages de romans, des incipit, du subjonctif imparfait... Tester ainsi ses connaissances littéraires est littéralement jouissif. On y joue comme avec un quizz ou avec un psycho-test sur la plage. Et l'on se casse parfois les dents avec un certain délice, si-si!
qui revigore l'esprit, notre mémoire des oeuvres, des dates, des pseudos d'écrivains, des Prix, des lieux, des personnages de romans, des incipit, du subjonctif imparfait... Tester ainsi ses connaissances littéraires est littéralement jouissif. On y joue comme avec un quizz ou avec un psycho-test sur la plage. Et l'on se casse parfois les dents avec un certain délice, si-si! 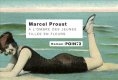 C'est fou ce que l'on peut changer quand même. Longtemps je n'ai pu supporter d’avoir un toit au-dessus de la tête, de me sentir prisonnier à l’intérieur avec des gens que cela ne gênait nullement, les fenêtres fermées, un silence confiné; voire du thé -tandis que la lumière du jour pouvait encore galvaniser tous mes sens. Question de musique et de mouvement. Peindre, selon Cézanne, c'est aussi écrire, danser, si j'en crois François Fédier et son admirable Ecouter voir
C'est fou ce que l'on peut changer quand même. Longtemps je n'ai pu supporter d’avoir un toit au-dessus de la tête, de me sentir prisonnier à l’intérieur avec des gens que cela ne gênait nullement, les fenêtres fermées, un silence confiné; voire du thé -tandis que la lumière du jour pouvait encore galvaniser tous mes sens. Question de musique et de mouvement. Peindre, selon Cézanne, c'est aussi écrire, danser, si j'en crois François Fédier et son admirable Ecouter voir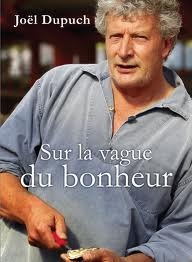 Oubliez un instant Jean-Louis-le-gars-des-huîtres-des-Petits-Mouchoirs, la marionnette un brin moralisatrice des Guignols, et penchez vous sur la belle leçon de vie, de courage, de bonheur, que donne cet homme, Joël Dupuch, ostréiculteur archi passionné par son métier et par le Bassin d’Arcachon –son jardin, et en particulier par sa cabane qui ouvre sur le Paradis selon lui-, en lisant, ou plutôt en avalant comme je viens de le faire cul-sec, son livre intitulé Sur la vague du bonheur (Michel Lafon). Je ne tairai pas (ce serait mentir et je sais pas faire), que Joël est un ami depuis plus de vingt-cinq ans, que j’habitais (dans les années 87-92) à deux pas de son bistrot de l’huître, Joël D., qui trônait rue des Piliers-de-Tutelle dans le Vieux Bordeaux tandis que je créchais rue des Faussets, que ses Quiberon n°3 sont depuis lors et pour toujours mes huîtres préférées (il me faudra goûter un jour ses Perles), qu’il a eu l’extrême gentillesse de me donner la parole à la page 45 de son livre, en reproduisant ce que j’ai écrit sur le mot Gascon dans mon bouquin Le Sud-Ouest vu par Léon Mazzella (Hugo & Cie) ; et que voilà.
Oubliez un instant Jean-Louis-le-gars-des-huîtres-des-Petits-Mouchoirs, la marionnette un brin moralisatrice des Guignols, et penchez vous sur la belle leçon de vie, de courage, de bonheur, que donne cet homme, Joël Dupuch, ostréiculteur archi passionné par son métier et par le Bassin d’Arcachon –son jardin, et en particulier par sa cabane qui ouvre sur le Paradis selon lui-, en lisant, ou plutôt en avalant comme je viens de le faire cul-sec, son livre intitulé Sur la vague du bonheur (Michel Lafon). Je ne tairai pas (ce serait mentir et je sais pas faire), que Joël est un ami depuis plus de vingt-cinq ans, que j’habitais (dans les années 87-92) à deux pas de son bistrot de l’huître, Joël D., qui trônait rue des Piliers-de-Tutelle dans le Vieux Bordeaux tandis que je créchais rue des Faussets, que ses Quiberon n°3 sont depuis lors et pour toujours mes huîtres préférées (il me faudra goûter un jour ses Perles), qu’il a eu l’extrême gentillesse de me donner la parole à la page 45 de son livre, en reproduisant ce que j’ai écrit sur le mot Gascon dans mon bouquin Le Sud-Ouest vu par Léon Mazzella (Hugo & Cie) ; et que voilà. 



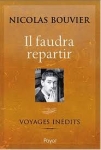 De Nicolas Bouvier, L’Usage du monde (PBP) est devenue la bible, le bréviaire du voyageur et du travel-writer. Voici que Payot nous donne des voyages inédits, avec un titre magnifique : Il faudra repartir, dont Cendrars aurait pu être jaloux. J’y ai retenu les pages admirables sur l’Algérie, que Bouvier traverse en 1958. Sa perception fine du petit peuple d’Oran, très Espagnol, très Juif aussi, constamment mêlé aux Arabes, laisse à penser que d’aucuns, dans ces années-là, auraient été bien inspirés d’écouter un observateur comme l’auteur du Journal d’Aran, dire qu’ici, les choses peuvent s’arranger, à cause des sangs mêlés justement. Mais il s’agit de melting-pot davantage que de métissage. En cela, Jules Roy avait raison de dire que là-bas, on était tous frères, mais rarement beaux-frères… Très belles pages également sur la Chine, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l’Indonésie.
De Nicolas Bouvier, L’Usage du monde (PBP) est devenue la bible, le bréviaire du voyageur et du travel-writer. Voici que Payot nous donne des voyages inédits, avec un titre magnifique : Il faudra repartir, dont Cendrars aurait pu être jaloux. J’y ai retenu les pages admirables sur l’Algérie, que Bouvier traverse en 1958. Sa perception fine du petit peuple d’Oran, très Espagnol, très Juif aussi, constamment mêlé aux Arabes, laisse à penser que d’aucuns, dans ces années-là, auraient été bien inspirés d’écouter un observateur comme l’auteur du Journal d’Aran, dire qu’ici, les choses peuvent s’arranger, à cause des sangs mêlés justement. Mais il s’agit de melting-pot davantage que de métissage. En cela, Jules Roy avait raison de dire que là-bas, on était tous frères, mais rarement beaux-frères… Très belles pages également sur la Chine, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l’Indonésie.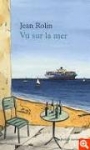 Dans la même veine de ces écrivains-reporters-observateurs, capables de décrire un simple fait divers, une scène de rue a priori ordinaire et d’en faire un moment de littérature, prenez Vu sur la mer, de Jean Rolin (La Table ronde / La petite vermillon), recueil de reportages donnés à Lui, Libération, Géo… L’auteur nous embarque sur le fleuve Congo et nous pensons au Cœur des ténèbres de Conrad, bien sûr, il nous propulse à Singapour parmi des pirates, nous fait voyager à bord d’un port-conteneur depuis St-Louis-du-Rhône, Camargue, ou bien d’un autre bateau semblable, le Ville de Bordeaux qui croise en Mer Rouge, il nous décrit « les voyageurs de l’amer »; et c’est chaque fois un ravissement. La prose de grand vent -salé, cette fois- de Rolin sonne juste, car elle est forte comme un rhum cul-sec.
Dans la même veine de ces écrivains-reporters-observateurs, capables de décrire un simple fait divers, une scène de rue a priori ordinaire et d’en faire un moment de littérature, prenez Vu sur la mer, de Jean Rolin (La Table ronde / La petite vermillon), recueil de reportages donnés à Lui, Libération, Géo… L’auteur nous embarque sur le fleuve Congo et nous pensons au Cœur des ténèbres de Conrad, bien sûr, il nous propulse à Singapour parmi des pirates, nous fait voyager à bord d’un port-conteneur depuis St-Louis-du-Rhône, Camargue, ou bien d’un autre bateau semblable, le Ville de Bordeaux qui croise en Mer Rouge, il nous décrit « les voyageurs de l’amer »; et c’est chaque fois un ravissement. La prose de grand vent -salé, cette fois- de Rolin sonne juste, car elle est forte comme un rhum cul-sec.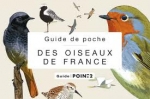 Cela n’a rien à voir, mais le Guide de poche des oiseaux de France (Seuil / Points2) est un microscopique ouvrage d’ornithologie très précisément illustré et qui est extrêmement fiable, car fondé sur les données irréprochables contenues dans les fameux guides du naturaliste des éditions Delachaux & Niestlé. 200 espèces d’oiseaux des jardins, des forêts, des bords de mer… y sont habilement décrits. Indispensable (à glisser dans le jean d'un gamin dont vous ne voulez plus qu'il vous dise : tous les oiseaux se ressemblent)...
Cela n’a rien à voir, mais le Guide de poche des oiseaux de France (Seuil / Points2) est un microscopique ouvrage d’ornithologie très précisément illustré et qui est extrêmement fiable, car fondé sur les données irréprochables contenues dans les fameux guides du naturaliste des éditions Delachaux & Niestlé. 200 espèces d’oiseaux des jardins, des forêts, des bords de mer… y sont habilement décrits. Indispensable (à glisser dans le jean d'un gamin dont vous ne voulez plus qu'il vous dise : tous les oiseaux se ressemblent)...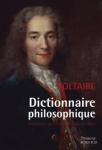
 Relire Voltaire : le Dictionnaire philosophique (Actes Sud / Thesaurus) présenté par Béatrice Didier, l’inoxydable Candide ou l'optimisme –illustré par Quentin Blake (folio, édition anniversaire) est un bonheur auquel on ne s’attend pas. Génie, virtuosité, pensée leste et fine, phrase profonde et « enlevée », notre penseur des Lumières –à l’heure où l’on fête Rousseau- demeure un homme de polémique, de réflexion et de combat philosophique inévitable, encore aujourd’hui. Il faut lire son Dictionnaire comme un manifeste de la liberté de pensée. Il n’a pas pris une ride et si, par endroits, certains faits et commentaires semblent dater quelque peu, il faut les prendre comme on lit Saint-Simon ; en déconnectant le fil historique pour projeter le fait dans l’éternel. Jouissives lectures.
Relire Voltaire : le Dictionnaire philosophique (Actes Sud / Thesaurus) présenté par Béatrice Didier, l’inoxydable Candide ou l'optimisme –illustré par Quentin Blake (folio, édition anniversaire) est un bonheur auquel on ne s’attend pas. Génie, virtuosité, pensée leste et fine, phrase profonde et « enlevée », notre penseur des Lumières –à l’heure où l’on fête Rousseau- demeure un homme de polémique, de réflexion et de combat philosophique inévitable, encore aujourd’hui. Il faut lire son Dictionnaire comme un manifeste de la liberté de pensée. Il n’a pas pris une ride et si, par endroits, certains faits et commentaires semblent dater quelque peu, il faut les prendre comme on lit Saint-Simon ; en déconnectant le fil historique pour projeter le fait dans l’éternel. Jouissives lectures.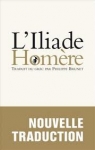 Homère ! Points nous offre l'édition en poche d'une nouvelle traduction de L’Iliade, absolument moderne. Replonger dans nos lectures (obligées) de l’enfance, avec un œil un brin vieilli, est un coup de fouet, un coup de jeune, un plongeon dans l’eau glacée de Biarritz un matin de décembre. L’immersion dans cette épopée unique de 15 500 vers en 24 chants, d’une architecture admirable, d’une immortelle poésie et d’un souffle romanesque à côté duquel même les grands auteurs Russes semblent avoir attrapé l’asthme de Proust -apparaît même nécessaire. Philippe Brunet est l’auteur de cette adaptation salutaire. Grâce lui soit rendue.
Homère ! Points nous offre l'édition en poche d'une nouvelle traduction de L’Iliade, absolument moderne. Replonger dans nos lectures (obligées) de l’enfance, avec un œil un brin vieilli, est un coup de fouet, un coup de jeune, un plongeon dans l’eau glacée de Biarritz un matin de décembre. L’immersion dans cette épopée unique de 15 500 vers en 24 chants, d’une architecture admirable, d’une immortelle poésie et d’un souffle romanesque à côté duquel même les grands auteurs Russes semblent avoir attrapé l’asthme de Proust -apparaît même nécessaire. Philippe Brunet est l’auteur de cette adaptation salutaire. Grâce lui soit rendue.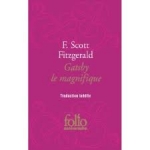
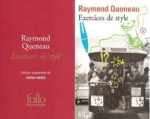 Parmi les classiques modernes, citons les rééditions « collector » du Gatsby de F.S.Fitzgerald (dans la traduction inédite de Philippe Jaworski qui figurera dans l’édition de La Pléiade) et d’Exercices de style, de Queneau, dans une nouvelle édition enrichie d’exercices plus ou moins inédits (folio), parce qu'elles nous obligent avec tact et délicatesse à reprendre des textes enfouis dans notre mémoire. Idem pour La route, de Kerouac, sauf qu’il s’agit du « rouleau » original
Parmi les classiques modernes, citons les rééditions « collector » du Gatsby de F.S.Fitzgerald (dans la traduction inédite de Philippe Jaworski qui figurera dans l’édition de La Pléiade) et d’Exercices de style, de Queneau, dans une nouvelle édition enrichie d’exercices plus ou moins inédits (folio), parce qu'elles nous obligent avec tact et délicatesse à reprendre des textes enfouis dans notre mémoire. Idem pour La route, de Kerouac, sauf qu’il s’agit du « rouleau » original 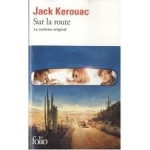
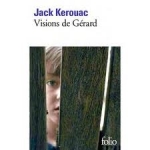 (adapté au cinéma : sortie le 23 mai), donc non censuré, que nous découvrons, histoire de se refaire un trip beat generation en essayant de retrouver des passages clés de ce gros road-novel mythique (folio) enrichi d'une floppée de textes de présentation (le roman ne débute qu'à la page 154!). A lire aussi Visions de Gérard, du même Jack Kerouac (folio), car il s’agit d’un texte très émouvant, qui évoque la mort du propre frère de l’auteur à l’âge de neuf ans. Méconnu et précieux.
(adapté au cinéma : sortie le 23 mai), donc non censuré, que nous découvrons, histoire de se refaire un trip beat generation en essayant de retrouver des passages clés de ce gros road-novel mythique (folio) enrichi d'une floppée de textes de présentation (le roman ne débute qu'à la page 154!). A lire aussi Visions de Gérard, du même Jack Kerouac (folio), car il s’agit d’un texte très émouvant, qui évoque la mort du propre frère de l’auteur à l’âge de neuf ans. Méconnu et précieux. Enfin, une note poétique avec les Chants berbères de Kabylie (édition bilingue, Points/poésie) qui fut concoctée par Jean Amrouche, poète algérien disparu en 1962. Il évoque avec justesse une parenté de cette poésie souvent anonyme, avec le chant profond (le cante jondo) andalou : l’appartenance ontologique à un peuple, une solidarité étroite de destin, et par conséquent une poésie forte. Essentielle.
Enfin, une note poétique avec les Chants berbères de Kabylie (édition bilingue, Points/poésie) qui fut concoctée par Jean Amrouche, poète algérien disparu en 1962. Il évoque avec justesse une parenté de cette poésie souvent anonyme, avec le chant profond (le cante jondo) andalou : l’appartenance ontologique à un peuple, une solidarité étroite de destin, et par conséquent une poésie forte. Essentielle. 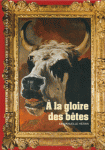
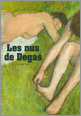


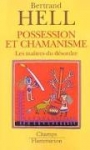
 Fallait-il panthéonniser un fasciste collabo, antisémite, xénophobe, misogyne, habité par une névrose de l'échec qui le conduisit au suicide en 1945 -doublé d'un admirable styliste dont les romans désabusés et les nouvelles désinvoltes écrites de la main d'un séducteur un brin nihiliste continuent de ravir de jeunes lecteurs?
Fallait-il panthéonniser un fasciste collabo, antisémite, xénophobe, misogyne, habité par une névrose de l'échec qui le conduisit au suicide en 1945 -doublé d'un admirable styliste dont les romans désabusés et les nouvelles désinvoltes écrites de la main d'un séducteur un brin nihiliste continuent de ravir de jeunes lecteurs? En somme, je dis (répète) juste ici qu'il convient toujours de distinguer l'homme de l'oeuvre. Sinon, qui lirait Céline ou Hamsun?
En somme, je dis (répète) juste ici qu'il convient toujours de distinguer l'homme de l'oeuvre. Sinon, qui lirait Céline ou Hamsun?

 génie disparu en 2005. Ou bien en s’allongeant en pleine forêt sur un tapis d’aiguilles de pins et de fougères, le regard planté à la cime des arbres qui dansent. Il suffit alors de fermer les yeux pour confondre, comme le faisait François Mauriac, le bruissement permanent du vent dans les branches avec celui de l’océan. Le
génie disparu en 2005. Ou bien en s’allongeant en pleine forêt sur un tapis d’aiguilles de pins et de fougères, le regard planté à la cime des arbres qui dansent. Il suffit alors de fermer les yeux pour confondre, comme le faisait François Mauriac, le bruissement permanent du vent dans les branches avec celui de l’océan. Le 
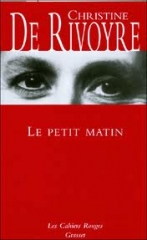 Bordelais Mauriac n’aimait rien comme planter ses fictions dans l’âpre lande : le village d’Argelouse est à jamais marqué par « Thérèse Desqueyroux », l’un de ses plus célèbres romans(Livre de poche). Montaigne, qui voyageait à cheval, a nourri ses « Essais » (Arléa) de centaines de chevauchées à travers les Landes. Il vante même les mérites des sources thermales de Préchacq-les-Bains dans son œuvre-vie. Jean-Paul Kauffmann a donné un livre magnifique, « La maison du retour » (folio), qui raconte comment il choisit justement de s’établir de temps à autre en forêt, à Pissos. Plus bas, on peut se promener du côté d’Onesse-et-Laharie, à la recherche de la maison des sœurs de Rivoyre, échouer à la trouver et relire « Le petit matin » (Grasset), de Christine, « la Colette des Landes », au café du coin. Les Landes, c’est la place centrale de Mont-de-Marsan à l’ouverture du premier café que l’on prend en pensant aux frères Boni : Guy et André Boniface, rugbymen de légende. Un stade porte leur nom à Montfort-en-Chalosse. Denis Lalanne, qui donna comme son ami Antoine Blondin des papiers « de garde » à « L’Equipe », écrivit un livre hommage
Bordelais Mauriac n’aimait rien comme planter ses fictions dans l’âpre lande : le village d’Argelouse est à jamais marqué par « Thérèse Desqueyroux », l’un de ses plus célèbres romans(Livre de poche). Montaigne, qui voyageait à cheval, a nourri ses « Essais » (Arléa) de centaines de chevauchées à travers les Landes. Il vante même les mérites des sources thermales de Préchacq-les-Bains dans son œuvre-vie. Jean-Paul Kauffmann a donné un livre magnifique, « La maison du retour » (folio), qui raconte comment il choisit justement de s’établir de temps à autre en forêt, à Pissos. Plus bas, on peut se promener du côté d’Onesse-et-Laharie, à la recherche de la maison des sœurs de Rivoyre, échouer à la trouver et relire « Le petit matin » (Grasset), de Christine, « la Colette des Landes », au café du coin. Les Landes, c’est la place centrale de Mont-de-Marsan à l’ouverture du premier café que l’on prend en pensant aux frères Boni : Guy et André Boniface, rugbymen de légende. Un stade porte leur nom à Montfort-en-Chalosse. Denis Lalanne, qui donna comme son ami Antoine Blondin des papiers « de garde » à « L’Equipe », écrivit un livre hommage 
 aux frangins : « Le temps des Boni » (La petite vermillon). Il vit aujourd’hui paisiblement à Hossegor. Le lire, c’est retrouver le rugby rustique de village, où les déménageurs de pianos sont plus nombreux que les joueurs du même instrument. Un autre écrivain journaliste parti trop tôt (en 2004), Patrick Espagnet, de Grignols (plus haut dans les Landes girondines), possédait une plume forgée à l’ovale. Ses nouvelles : « Les Noirs », « La Gueuze », « XV histoires de rugby » (Culture Suds), sont des chefs-d’œuvre du genre. Les Landes, ce sont ces belles fermes à colombages avec leurs murs à briquettes en forme de fougère, qui se dressent
aux frangins : « Le temps des Boni » (La petite vermillon). Il vit aujourd’hui paisiblement à Hossegor. Le lire, c’est retrouver le rugby rustique de village, où les déménageurs de pianos sont plus nombreux que les joueurs du même instrument. Un autre écrivain journaliste parti trop tôt (en 2004), Patrick Espagnet, de Grignols (plus haut dans les Landes girondines), possédait une plume forgée à l’ovale. Ses nouvelles : « Les Noirs », « La Gueuze », « XV histoires de rugby » (Culture Suds), sont des chefs-d’œuvre du genre. Les Landes, ce sont ces belles fermes à colombages avec leurs murs à briquettes en forme de fougère, qui se dressent  grassement sur leur airial. La plus emblématique se trouve au sein du Parc régional de Marquèze, à Sabres, où l’ombre tutélaire de Félix Arnaudin, l’écrivain photographe un brin ethnographe, plane comme un milan royal en maraude. Les clichés d’Arnaudin sont aussi précieux que ses recueils de contes (Confluences). L’un d’eux montre un
grassement sur leur airial. La plus emblématique se trouve au sein du Parc régional de Marquèze, à Sabres, où l’ombre tutélaire de Félix Arnaudin, l’écrivain photographe un brin ethnographe, plane comme un milan royal en maraude. Les clichés d’Arnaudin sont aussi précieux que ses recueils de contes (Confluences). L’un d’eux montre un 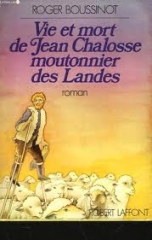
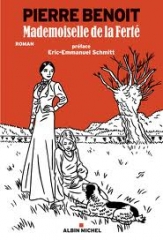 jeune berger, Bergerot au Pradeou, dressé dans l’immensité plate comme la main. Et évoque le tendre roman de Roger Boussinot, « Vie et mort de Jean Chalosse, moutonnier des Landes » (Livre de poche).
jeune berger, Bergerot au Pradeou, dressé dans l’immensité plate comme la main. Et évoque le tendre roman de Roger Boussinot, « Vie et mort de Jean Chalosse, moutonnier des Landes » (Livre de poche). 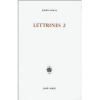 enfin les inoubliables passages de Julien
enfin les inoubliables passages de Julien 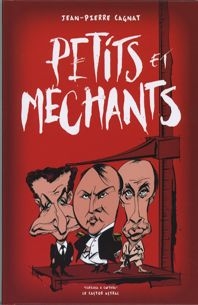 Jean-Pierre Cagnat*, talentueux croqueur, caricaturiste, dessinateur de presse reconnu (Le Monde, L'Express, VSD, etc), signe un petit livre délicieux et de circonstance (électorale) : Petits et méchants (Le Castor astral) et il vient de recevoir le Grand Prix de l'Humour Noir Grandville (qui récompense un dessinateur) au restaurant parisien Le Procope le 13 mars dernier pour ce petit bouquin caustique qui taille un short aux tyranneaux qui ont gouverné ou qui continuent de gouverner certaines parties du monde (mais jusqu'à quelle heure?). En couverture : Sarkozy, Napoléon, Poutine. Cagnat n'est pas de droite. Ca tombe bien, nous non plus. Sous la couverture, figurent, en dessins, tous les petits despotes, dont Cagnat donne srcupuleusement la taille réelle (en centimètres, donc) : Hitler, Lénine, Staline, Khrouchtchev, Kim-Il-Sung, Kim-Jong-Il, Hiro Hito, Gengis Kahn, Attila, Louis XIV, Goebbels... C'est fou ce qu'ils étaient petits, ces grand dictateurs et dictateurs-adjoints! Mais Cagnat ne s'arrête pas là, pensez! Il renifle le petit méchant du côté des stars aussi : Sade, Hitchcock (ah bon, il était méchant, lui?), Charles Manson (1,57m contre 1,62 pour Polanski : OK)... Il n'oublie pas non plus les nains libidineux de Blanche-Neige, Pépin Le Bref, les bouffons des rois de France, les couples de taille inégale (l'histoire les collectionne), les chanteurs (Little Richard, Prince : pourquoi?). Enfin, ce petit livre dessiné au vitriol noir & blanc s'attaque aux grands : De Gaulle, Raspoutine, Ben Laden, Saddam Hussein (1,88m : on aurait pas dit, hein?). Et enfin aux petits gentils : Woody Allen, Charlie Chaplin, Groucho Marx, Beethoven, Mozart, Picasso, Toulouse-Lautrec, Balzac, Gandhi... Un
Jean-Pierre Cagnat*, talentueux croqueur, caricaturiste, dessinateur de presse reconnu (Le Monde, L'Express, VSD, etc), signe un petit livre délicieux et de circonstance (électorale) : Petits et méchants (Le Castor astral) et il vient de recevoir le Grand Prix de l'Humour Noir Grandville (qui récompense un dessinateur) au restaurant parisien Le Procope le 13 mars dernier pour ce petit bouquin caustique qui taille un short aux tyranneaux qui ont gouverné ou qui continuent de gouverner certaines parties du monde (mais jusqu'à quelle heure?). En couverture : Sarkozy, Napoléon, Poutine. Cagnat n'est pas de droite. Ca tombe bien, nous non plus. Sous la couverture, figurent, en dessins, tous les petits despotes, dont Cagnat donne srcupuleusement la taille réelle (en centimètres, donc) : Hitler, Lénine, Staline, Khrouchtchev, Kim-Il-Sung, Kim-Jong-Il, Hiro Hito, Gengis Kahn, Attila, Louis XIV, Goebbels... C'est fou ce qu'ils étaient petits, ces grand dictateurs et dictateurs-adjoints! Mais Cagnat ne s'arrête pas là, pensez! Il renifle le petit méchant du côté des stars aussi : Sade, Hitchcock (ah bon, il était méchant, lui?), Charles Manson (1,57m contre 1,62 pour Polanski : OK)... Il n'oublie pas non plus les nains libidineux de Blanche-Neige, Pépin Le Bref, les bouffons des rois de France, les couples de taille inégale (l'histoire les collectionne), les chanteurs (Little Richard, Prince : pourquoi?). Enfin, ce petit livre dessiné au vitriol noir & blanc s'attaque aux grands : De Gaulle, Raspoutine, Ben Laden, Saddam Hussein (1,88m : on aurait pas dit, hein?). Et enfin aux petits gentils : Woody Allen, Charlie Chaplin, Groucho Marx, Beethoven, Mozart, Picasso, Toulouse-Lautrec, Balzac, Gandhi... Un 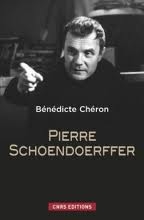 Pierre Schoendoerffer est
Pierre Schoendoerffer est 

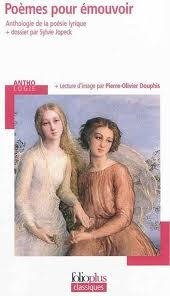 émouvoir
émouvoir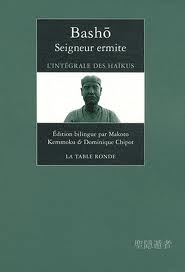
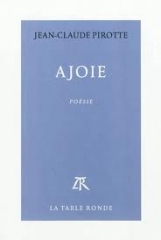
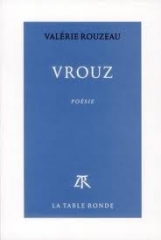

 C'est l'année Klimt : ça ne se rate pas, si l'on aime ce peintre génial. Et l'occasion d'aller voir plus de toiles du maître Gustav Klimt qu'il n'y en a jamais eu à Vienne, est aussi celle de contempler l'oeuvre de son disciple Egon Schiele (sans Klimt, pas de Schiele). Pour cela seulement, et à condition d'admirer l'un et l'autre peintres, le voyage est indispensable en 2012 (rendez vous aux musées Leopold et Belvedere, principalement). Vienne, c'est aussi se faire plaisir en revoyant des toiles fétiches, un petit Friedrich ici, un Velasquez là. Cette ville musée, qui est aussi celle du bon café,
C'est l'année Klimt : ça ne se rate pas, si l'on aime ce peintre génial. Et l'occasion d'aller voir plus de toiles du maître Gustav Klimt qu'il n'y en a jamais eu à Vienne, est aussi celle de contempler l'oeuvre de son disciple Egon Schiele (sans Klimt, pas de Schiele). Pour cela seulement, et à condition d'admirer l'un et l'autre peintres, le voyage est indispensable en 2012 (rendez vous aux musées Leopold et Belvedere, principalement). Vienne, c'est aussi se faire plaisir en revoyant des toiles fétiches, un petit Friedrich ici, un Velasquez là. Cette ville musée, qui est aussi celle du bon café, 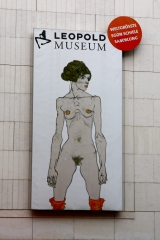 du bon chocolat et des bars à vins, est également le repaire d'une certaine mémoire littéraire que l'on s'efforce de chercher en flânant dans les rues, en traînant dans les cafés (certains ont conservé
du bon chocolat et des bars à vins, est également le repaire d'une certaine mémoire littéraire que l'on s'efforce de chercher en flânant dans les rues, en traînant dans les cafés (certains ont conservé 
 tombai en arrêt, littéralement, devant ma peinture préférée à cette époque et dont j'avais une copie à l'échelle 1 dans ma chambre d'adolescent -nous vivions ensemble, en quelque sorte (il s'agit des "Chasseurs dans la neige", de Bruegel) et comme j'ignorais que l'original se trouvait là, ce me fut un choc pictural énorme. Revoir ce tableau la semaine dernière fut forcément moins terrible. De même, tandis qu'on cherche dans la nuit viennoise et dans un dédale de ruelles un bon Heurige (taverne à vins), tomber
tombai en arrêt, littéralement, devant ma peinture préférée à cette époque et dont j'avais une copie à l'échelle 1 dans ma chambre d'adolescent -nous vivions ensemble, en quelque sorte (il s'agit des "Chasseurs dans la neige", de Bruegel) et comme j'ignorais que l'original se trouvait là, ce me fut un choc pictural énorme. Revoir ce tableau la semaine dernière fut forcément moins terrible. De même, tandis qu'on cherche dans la nuit viennoise et dans un dédale de ruelles un bon Heurige (taverne à vins), tomber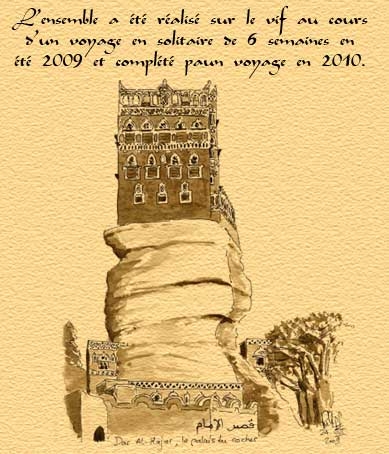
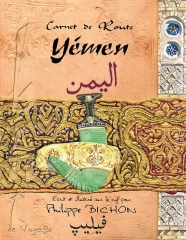 Il s'agit d'un énorme travail, d'une somme, d'une sensibilité avant tout, d'une poésie
Il s'agit d'un énorme travail, d'une somme, d'une sensibilité avant tout, d'une poésie 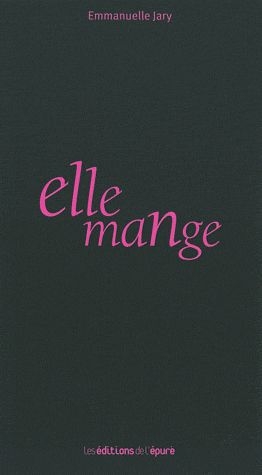
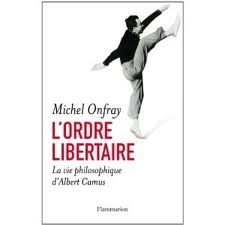
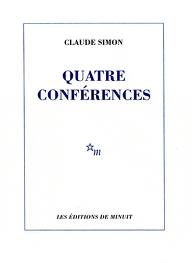 On ne s’y attend pas. Claude Simon (disparu il y a six ans et demi), dans le texte d’une conférence qu’il donna en 1980 sur Proust, intitulée "Le poisson cathédrale", (in "Quatre conférences"
On ne s’y attend pas. Claude Simon (disparu il y a six ans et demi), dans le texte d’une conférence qu’il donna en 1980 sur Proust, intitulée "Le poisson cathédrale", (in "Quatre conférences"
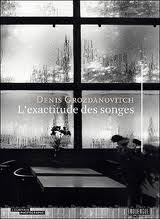
 Jean-Baptiste Pontalis (dites J.-B. pour ne pas passer pour un plouc à Saint-Germain-des-Près, ou bien dans n'importe quel dîner en ville de province) poursuit la publication, en petits volumes, de son autobiographie fragmentée. Au rythme d'un livre par an en moyenne, nous avons les faits marquants, les séances d'analyse mémorables, les événements personnels, amoureux,
Jean-Baptiste Pontalis (dites J.-B. pour ne pas passer pour un plouc à Saint-Germain-des-Près, ou bien dans n'importe quel dîner en ville de province) poursuit la publication, en petits volumes, de son autobiographie fragmentée. Au rythme d'un livre par an en moyenne, nous avons les faits marquants, les séances d'analyse mémorables, les événements personnels, amoureux, 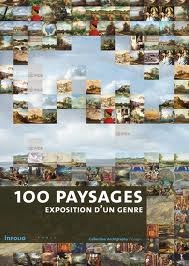 Il s'agit d'un album dont l'originalité est d'être parvenu à rassembler soixante spécialistes de la lecture du paysage dans la peinture occidentale. 100 Paysages, Exposition d'un genre (éditions infolio) nous donne à voir cent oeuvres éclairées par cent textes (sur cent doubles pages), signés de noms prestigieux comme ceux de Serge Briffaud, Michel Butor, Yves Hersant, Jean-Pierre Le Dantec
Il s'agit d'un album dont l'originalité est d'être parvenu à rassembler soixante spécialistes de la lecture du paysage dans la peinture occidentale. 100 Paysages, Exposition d'un genre (éditions infolio) nous donne à voir cent oeuvres éclairées par cent textes (sur cent doubles pages), signés de noms prestigieux comme ceux de Serge Briffaud, Michel Butor, Yves Hersant, Jean-Pierre Le Dantec  Que n'ai-je découvert plus tôt la chronique saint-simonienne et d'un sarcasme drôle, talentueux et très documenté, que Patrick Rambaud (Prix Goncourt pour La Bataille en 1997, mais aussi et entre plus de quarante ouvrages, auteur du Roland Barthes sans peine, et de Virginie Q., signé Marguerite Duraille...), distille avec succès chez Grasset : j'ai avalé cette Cinquième chronique du règne de Nicolas Ier
Que n'ai-je découvert plus tôt la chronique saint-simonienne et d'un sarcasme drôle, talentueux et très documenté, que Patrick Rambaud (Prix Goncourt pour La Bataille en 1997, mais aussi et entre plus de quarante ouvrages, auteur du Roland Barthes sans peine, et de Virginie Q., signé Marguerite Duraille...), distille avec succès chez Grasset : j'ai avalé cette Cinquième chronique du règne de Nicolas Ier 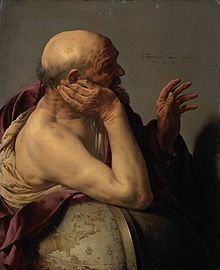 Fragments élaborent une perception fondamentale -au sens propre- de l'Univers : le monde est créé par le feu et, en lui, il se dissout. Le devenir est une lutte de contraires et tout s'écoule comme un fleuve. Héraclite avait une appréhension des éléments qui paraît aujourd'hui étrange, ou seulement poétique : le feu, en se consumant, se mouille, en s'épaisissant, il devient eau, quand l'eau se coagule, elle se change en terre, constate-t-il et écrit-il. Un traducteur emblématique d'Héraclite, Yves Battistini, appelle Héraclite l'homme à l'habit de lumière dans le temple de l'Ombre (Parenthèse : quel torero ne rêverait-il pas d'être ainsi désigné?..).
Fragments élaborent une perception fondamentale -au sens propre- de l'Univers : le monde est créé par le feu et, en lui, il se dissout. Le devenir est une lutte de contraires et tout s'écoule comme un fleuve. Héraclite avait une appréhension des éléments qui paraît aujourd'hui étrange, ou seulement poétique : le feu, en se consumant, se mouille, en s'épaisissant, il devient eau, quand l'eau se coagule, elle se change en terre, constate-t-il et écrit-il. Un traducteur emblématique d'Héraclite, Yves Battistini, appelle Héraclite l'homme à l'habit de lumière dans le temple de l'Ombre (Parenthèse : quel torero ne rêverait-il pas d'être ainsi désigné?..).  la mort elle aussi est une vie. Heidegger consacrera un livre à l'Obscur Ephésien et un autre au Romantique allemand devenu fou et reclus à Tübingen. Heidegger fera d'ailleurs sien le fragment fameux : Il faut aussi se souvenir de celui qui oublie le chemin (voir le livre de Heidegger intitulé Chemins qui ne mènent nulle part). Enfin, en bâtissant son oeuvre, Char aura toujours les Fragments d'Héraclite suspendus au-dessus de lui comme une étoile : La foudre pilote (ou gouverne) l'univers, dit Héraclite. Char le prolonge avec : L'éclair me dure. La traduction des Fragments par Frédéric Roussille (aux éd. Findakly) continue de faire pousser une oeuvre de base qui fait partie des fondations de la maison et qui, de surcroît, ne se détériorera pas au fil des siècles, y compris en terre volcanique...
la mort elle aussi est une vie. Heidegger consacrera un livre à l'Obscur Ephésien et un autre au Romantique allemand devenu fou et reclus à Tübingen. Heidegger fera d'ailleurs sien le fragment fameux : Il faut aussi se souvenir de celui qui oublie le chemin (voir le livre de Heidegger intitulé Chemins qui ne mènent nulle part). Enfin, en bâtissant son oeuvre, Char aura toujours les Fragments d'Héraclite suspendus au-dessus de lui comme une étoile : La foudre pilote (ou gouverne) l'univers, dit Héraclite. Char le prolonge avec : L'éclair me dure. La traduction des Fragments par Frédéric Roussille (aux éd. Findakly) continue de faire pousser une oeuvre de base qui fait partie des fondations de la maison et qui, de surcroît, ne se détériorera pas au fil des siècles, y compris en terre volcanique...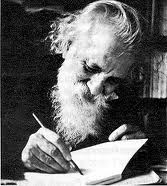 Gaston Bachelard restera le poéticien le plus sensible, le philosophe de la poésie et du rêve le plus accessible du XXème siècle. Ses célèbres travaux sur L'eau et les songes ou sur La poétique de la rêverie, chefs-d'oeuvre de limpidité, sont des invitations au voyage dans la tête du poète. Dans La flamme d'une chandelle par exemple (son oeuvre, en format de poche, est chez Corti et aux Puf), Bachelard donne à contempler le plus simplement du monde une flamme solitaire, tandis que lui s'abandonne à l'imagination sur les rêveries. Tout rêveur de flamme est un poète en puissance, écrit-il. C'est aussi un monde pour les solitaires; un monde secret et silencieux qui unit la solitude de la flamme à celle de l'homme. Grâce à la flamme, la solitude du rêveur n'est plus la solitude du vide, ajoute Bachelard.
Gaston Bachelard restera le poéticien le plus sensible, le philosophe de la poésie et du rêve le plus accessible du XXème siècle. Ses célèbres travaux sur L'eau et les songes ou sur La poétique de la rêverie, chefs-d'oeuvre de limpidité, sont des invitations au voyage dans la tête du poète. Dans La flamme d'une chandelle par exemple (son oeuvre, en format de poche, est chez Corti et aux Puf), Bachelard donne à contempler le plus simplement du monde une flamme solitaire, tandis que lui s'abandonne à l'imagination sur les rêveries. Tout rêveur de flamme est un poète en puissance, écrit-il. C'est aussi un monde pour les solitaires; un monde secret et silencieux qui unit la solitude de la flamme à celle de l'homme. Grâce à la flamme, la solitude du rêveur n'est plus la solitude du vide, ajoute Bachelard.  s'il n'y a aucun clair-obscur dans la langue de feu (doux) de Bachelard. Pour l'écrivain, et du même coup pour l'auteur en train de rédiger l'ouvrage que nous tenons entre les mains, la chandelle est
s'il n'y a aucun clair-obscur dans la langue de feu (doux) de Bachelard. Pour l'écrivain, et du même coup pour l'auteur en train de rédiger l'ouvrage que nous tenons entre les mains, la chandelle est  lampe, flamme mouillée, la lumière qui, les soirs de solitude, étend ses ailes dans la chambre (Léon-Paul Fargue) devient à la fois l'ombre et la compagne du rêveur solitaire, qu'il soit un angoissé de la page blanche ou un mégalomane éclairé. Par la lampe, un bonheur de lumière s'imprègne, dans la chambre du rêveur, écrit Bachelard. Et dans la marge, rayé, le reste de l'humanité n'est qu'une armée de moucheurs de chandelles. C'est l'ennemie du rêve qui veille... Cela fait de La flamme d'une chandelle un livre fragile qui résiste au vent de la mode.
lampe, flamme mouillée, la lumière qui, les soirs de solitude, étend ses ailes dans la chambre (Léon-Paul Fargue) devient à la fois l'ombre et la compagne du rêveur solitaire, qu'il soit un angoissé de la page blanche ou un mégalomane éclairé. Par la lampe, un bonheur de lumière s'imprègne, dans la chambre du rêveur, écrit Bachelard. Et dans la marge, rayé, le reste de l'humanité n'est qu'une armée de moucheurs de chandelles. C'est l'ennemie du rêve qui veille... Cela fait de La flamme d'une chandelle un livre fragile qui résiste au vent de la mode.
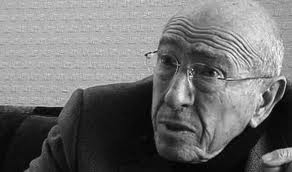

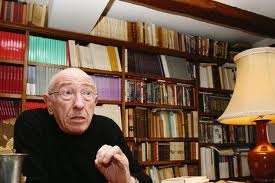

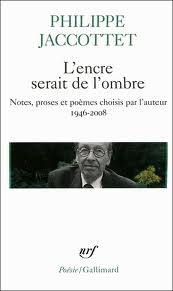 Pas mal de poches, surtout des folio et des Poésie/Gallimard, dégustés ces jours-ci. A commencer par l'anthologie personnelle de Philippe Jaccottet, immense poète que j'adore et que je lis et relis depuis 34 ans déjà. Cela s'appelle L'encre serait de l'ombre, notes, proses et poèmes (1946-2008) choisis par l'auteur, et si vous n'avez qu'un livre à acheter du poète de Grignan, grand traducteur par ailleurs, prenez celui-ci. 560 pages de bonheur poétique absolu. Dans la même collection Poésie de Gallimard, citons Mon beau navire, ô ma
Pas mal de poches, surtout des folio et des Poésie/Gallimard, dégustés ces jours-ci. A commencer par l'anthologie personnelle de Philippe Jaccottet, immense poète que j'adore et que je lis et relis depuis 34 ans déjà. Cela s'appelle L'encre serait de l'ombre, notes, proses et poèmes (1946-2008) choisis par l'auteur, et si vous n'avez qu'un livre à acheter du poète de Grignan, grand traducteur par ailleurs, prenez celui-ci. 560 pages de bonheur poétique absolu. Dans la même collection Poésie de Gallimard, citons Mon beau navire, ô ma mémoire, sous-titré Un siècle de poésie française. C'est une anthologie plutôt bien ficelée, de belle facture : honnête et pas scolaire, avec son content de grands classiques et sa dose de modernité, mais où l'on trouve, à l'instar d'une arête dans le poisson (je chipote, je sais) un poème de Rilke, qui était né à Praque et de langue allemande (mais il est vrai qu'il écrivit en français ses dernières oeuvres, notamment
mémoire, sous-titré Un siècle de poésie française. C'est une anthologie plutôt bien ficelée, de belle facture : honnête et pas scolaire, avec son content de grands classiques et sa dose de modernité, mais où l'on trouve, à l'instar d'une arête dans le poisson (je chipote, je sais) un poème de Rilke, qui était né à Praque et de langue allemande (mais il est vrai qu'il écrivit en français ses dernières oeuvres, notamment  Vergers, dont est extrait le poème choisi dans la présente anthologie -et traduit d'ailleurs par Jaccottet). Mention spéciale (en Poésie/Gallimard, toujours) à l'oeuvre complète magnifique (1954-2004) du Nobel 2011, le grand poète suédois Tomas Tranströmer, Baltiques, car il s'agit vraiment d'une formidable découverte.
Vergers, dont est extrait le poème choisi dans la présente anthologie -et traduit d'ailleurs par Jaccottet). Mention spéciale (en Poésie/Gallimard, toujours) à l'oeuvre complète magnifique (1954-2004) du Nobel 2011, le grand poète suédois Tomas Tranströmer, Baltiques, car il s'agit vraiment d'une formidable découverte. 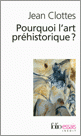
 plus, titre très derridien que Etienne Bimbenet donne à ce copieux et souvent ardu (mais passionnant de bout en bout) essai sur l'origine animale de l'homme -pour faire très court. En clair, l'homme est un animal humain. Et le rapport de l'homme à l'animal, dans cette étude philosophique, va bien au-delà de l'éthologie.
plus, titre très derridien que Etienne Bimbenet donne à ce copieux et souvent ardu (mais passionnant de bout en bout) essai sur l'origine animale de l'homme -pour faire très court. En clair, l'homme est un animal humain. Et le rapport de l'homme à l'animal, dans cette étude philosophique, va bien au-delà de l'éthologie.  Philippe Sollers continue de compiler pour notre bonheur ses articles littéraires donnés ici et là (l'Obs, Le Monde...) et cela produit à chaque fois un folio de 1000 pages et plus. Le dernier opus se nomme Discours parfait (il était paru il y a moins de deux ans en Blanche) : de l'intelligence à l'état pur, mâtinée d'une mégalomanie que l'on a fini par pardonner, ou sur laquelle nous glissons car le personnage est aussi attachant qu'irritant... tant il est brillant. Admirables pages sur Shakespeare, Montaigne, Saint-Simon, Van Gogh, Venise, Stendhal à Bordeaux... Entre autres analyses subtilement circonscrites, avec tact, érudition et talent, bien sûr.
Philippe Sollers continue de compiler pour notre bonheur ses articles littéraires donnés ici et là (l'Obs, Le Monde...) et cela produit à chaque fois un folio de 1000 pages et plus. Le dernier opus se nomme Discours parfait (il était paru il y a moins de deux ans en Blanche) : de l'intelligence à l'état pur, mâtinée d'une mégalomanie que l'on a fini par pardonner, ou sur laquelle nous glissons car le personnage est aussi attachant qu'irritant... tant il est brillant. Admirables pages sur Shakespeare, Montaigne, Saint-Simon, Van Gogh, Venise, Stendhal à Bordeaux... Entre autres analyses subtilement circonscrites, avec tact, érudition et talent, bien sûr.  De Modiano, voyez L'horizon, qui n'est pas son plus mauvais roman sur le seul et (désespérément) unique sujet de son oeuvre : l'Occupation.
De Modiano, voyez L'horizon, qui n'est pas son plus mauvais roman sur le seul et (désespérément) unique sujet de son oeuvre : l'Occupation.  originale publiée Au Diable Vauvert, signé Macha Séry. Revivre l'aventure de la jeunesse algérienne de l'auteur du Premier homme, à Alger en 1930 donc, entre matches de foot, bistrots, copains, filles, soleil et... une tuberculose qui entre sans frapper, est vivifiant. Cela remet nos idées en place sur le Camus journaliste débutant, le jeune essayiste, le séducteur, l'homme lucide surtout. Captivant (en attendant la bio de Camus que Michel Onfray publie ce mois-ci chez Flammarion...).
originale publiée Au Diable Vauvert, signé Macha Séry. Revivre l'aventure de la jeunesse algérienne de l'auteur du Premier homme, à Alger en 1930 donc, entre matches de foot, bistrots, copains, filles, soleil et... une tuberculose qui entre sans frapper, est vivifiant. Cela remet nos idées en place sur le Camus journaliste débutant, le jeune essayiste, le séducteur, l'homme lucide surtout. Captivant (en attendant la bio de Camus que Michel Onfray publie ce mois-ci chez Flammarion...). Retour à Killybegs, qui a valu le Grand Prix du roman de l'Académie française à Sorj Chalandon (Grasset) est un bon et solide roman sur la trahison, qui fera sans doute date. Sur fond de combats de l'IRA, c'est fort comme un hot whiskey au retour d'une chasse à la bécasse dans les bushes, c'est franc comme un coup de poing bien assené et sec comme le regard d'un ami frappé de déception : cela ne cille ni ne ploie. Je ne citerai que la phrase placée en exergue du roman, relevée sur un mur de Belfast : Savez-vous ce que disent les arbres lorsque la hache entre dans la forêt? Regardez! Le manche est l'un des nôtres!
Retour à Killybegs, qui a valu le Grand Prix du roman de l'Académie française à Sorj Chalandon (Grasset) est un bon et solide roman sur la trahison, qui fera sans doute date. Sur fond de combats de l'IRA, c'est fort comme un hot whiskey au retour d'une chasse à la bécasse dans les bushes, c'est franc comme un coup de poing bien assené et sec comme le regard d'un ami frappé de déception : cela ne cille ni ne ploie. Je ne citerai que la phrase placée en exergue du roman, relevée sur un mur de Belfast : Savez-vous ce que disent les arbres lorsque la hache entre dans la forêt? Regardez! Le manche est l'un des nôtres! Dire que je n'ai pas du tout aimé La Guerre sans l'aimer, de Bernard-Henri Lévy (Grasset, 648 p.), est un euphémisme. Je voulais quand même feuilleter abondamment, m'arrêter ici ou là, tenter de comprendre la pathologie de ce Journal d'un écrivain au coeur du printemps libyen. Mais les bras m'en sont tombés. J'ai repensé à une formule de Cornelius Castoriadis à propos de "l'
Dire que je n'ai pas du tout aimé La Guerre sans l'aimer, de Bernard-Henri Lévy (Grasset, 648 p.), est un euphémisme. Je voulais quand même feuilleter abondamment, m'arrêter ici ou là, tenter de comprendre la pathologie de ce Journal d'un écrivain au coeur du printemps libyen. Mais les bras m'en sont tombés. J'ai repensé à une formule de Cornelius Castoriadis à propos de "l'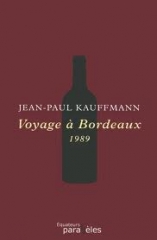
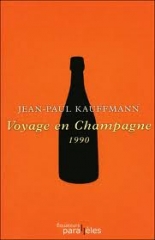 Lumineuse, l'idée d'Olivier Frébourg, patron des éditions des Equateurs, de reprendre dans sa petite collection Parallèles, deux textes splendides de Jean-Paul Kauffmann, l'un sur Bordeaux : Voyage à Bordeaux 1989 (que je suis fier de posséder dans son introuvable édition originale, celle de la Caisse des Dépôts et Consignations publiée à l'intention du notariat français, illustrée par Michel Guillard, mise en pages par le talentueux Marc Walter et préfacée par Jacques Chaban-Delmas!), l'autre sur le champagne : Voyage en Champagne 1990. Il s'agit de textes très littéraires sur les vins, les paysages, les hommes de la vigne. C'est précis et pêchu comme toujours avec Kauffmann, voire précieux dans l'écriture (comme du Veilletet, du Gracq) et surtout profond : le bordeaux est une initiation, prévient-il. Et le champagne est fils de l'air.
Lumineuse, l'idée d'Olivier Frébourg, patron des éditions des Equateurs, de reprendre dans sa petite collection Parallèles, deux textes splendides de Jean-Paul Kauffmann, l'un sur Bordeaux : Voyage à Bordeaux 1989 (que je suis fier de posséder dans son introuvable édition originale, celle de la Caisse des Dépôts et Consignations publiée à l'intention du notariat français, illustrée par Michel Guillard, mise en pages par le talentueux Marc Walter et préfacée par Jacques Chaban-Delmas!), l'autre sur le champagne : Voyage en Champagne 1990. Il s'agit de textes très littéraires sur les vins, les paysages, les hommes de la vigne. C'est précis et pêchu comme toujours avec Kauffmann, voire précieux dans l'écriture (comme du Veilletet, du Gracq) et surtout profond : le bordeaux est une initiation, prévient-il. Et le champagne est fils de l'air. 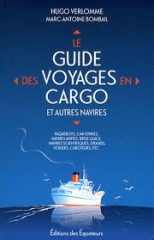 Voyages en Cargo et autres navires, de Hugo Verlomme et Marc-Antoine Bombail. Slow is beautiful lancent avec justesse les auteurs. Un livre unique pour tout savoir sur les possibilités de voyages à bord de paquebots, cargos, car-ferries, navires mixtes, brise-glace, grands voiliers, caboteurs et autres vieux grééments, baliseurs ou navires scientifiques... Sur les océans et les mers du monde entier.
Voyages en Cargo et autres navires, de Hugo Verlomme et Marc-Antoine Bombail. Slow is beautiful lancent avec justesse les auteurs. Un livre unique pour tout savoir sur les possibilités de voyages à bord de paquebots, cargos, car-ferries, navires mixtes, brise-glace, grands voiliers, caboteurs et autres vieux grééments, baliseurs ou navires scientifiques... Sur les océans et les mers du monde entier.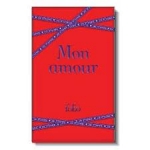 Mon amour est le titre donné à une épatante anthologie de textes amoureux (folio, sous un coffret rouge ravissant bardé d'un ruban imprimé aux mots de je t'aime) que l'on a envie d'offrir -et c'est le premier but d'une telle démarche éditoriale! (Saint-Valentin oblige). Stendhal, Ovide, Proust, Cohen, Aragon, Duras, Shakespeare, Verlaine, Labé, Neruda, Eluard... Ils sont tous là et, curieusement, parmi ces classiques magnifiques, on trouve un seul contemporain peu connu pour ses textes amoureux : Jean-Christophe Rufin! Allez comprendre, des fois...
Mon amour est le titre donné à une épatante anthologie de textes amoureux (folio, sous un coffret rouge ravissant bardé d'un ruban imprimé aux mots de je t'aime) que l'on a envie d'offrir -et c'est le premier but d'une telle démarche éditoriale! (Saint-Valentin oblige). Stendhal, Ovide, Proust, Cohen, Aragon, Duras, Shakespeare, Verlaine, Labé, Neruda, Eluard... Ils sont tous là et, curieusement, parmi ces classiques magnifiques, on trouve un seul contemporain peu connu pour ses textes amoureux : Jean-Christophe Rufin! Allez comprendre, des fois... La revue (mauvais esprit) Ravages publie son nouveau numéro sur le thème : Slow! Comme toujours, c'est décapant, irrévérencieux, rentre-dedans, franc du collier et salutaire, et la maquette est redoutablement chic-efficace. Slow citta, slow food, slow life, slow money, slow travel, slow drive, slow industry, slow management... Tout est passé en revue, et des signatures prestigieuses comme celle d'Edgar Morin donnent dans Ravages. Bravo!
La revue (mauvais esprit) Ravages publie son nouveau numéro sur le thème : Slow! Comme toujours, c'est décapant, irrévérencieux, rentre-dedans, franc du collier et salutaire, et la maquette est redoutablement chic-efficace. Slow citta, slow food, slow life, slow money, slow travel, slow drive, slow industry, slow management... Tout est passé en revue, et des signatures prestigieuses comme celle d'Edgar Morin donnent dans Ravages. Bravo!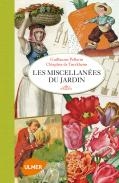 l'originalité et la beauté de leurs publications (déjà remarquées ici même) : Les Miscellanées du jardin, de Guillaume Pellerin et Cléophée de Turckheim, sont par exemple un chef d'euvre d'édition audacieuse, tant pour l'illustration que pour le propos. Ce petit bijou nous apprend des tas de choses sur les mots du jardin, des anecdotes, des petits trucs, et c'est captivant, élégant, subtil et surtout bourré d'infos originales et sincèrement enrichissantes.
l'originalité et la beauté de leurs publications (déjà remarquées ici même) : Les Miscellanées du jardin, de Guillaume Pellerin et Cléophée de Turckheim, sont par exemple un chef d'euvre d'édition audacieuse, tant pour l'illustration que pour le propos. Ce petit bijou nous apprend des tas de choses sur les mots du jardin, des anecdotes, des petits trucs, et c'est captivant, élégant, subtil et surtout bourré d'infos originales et sincèrement enrichissantes.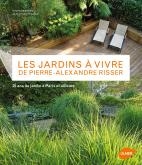 Toujours chez Ulmer, Les Jardins à vivre de Pierre-Alexandre Risser (20 ans de jardin à Paris et ailleurs) est un ouvrage splendide sur l'oeuvre d'un paysagiste de grand talent, un créateur de jardins et de terrasses en ville beaux toute l'année, en somme. Photos remarquables.
Toujours chez Ulmer, Les Jardins à vivre de Pierre-Alexandre Risser (20 ans de jardin à Paris et ailleurs) est un ouvrage splendide sur l'oeuvre d'un paysagiste de grand talent, un créateur de jardins et de terrasses en ville beaux toute l'année, en somme. Photos remarquables. 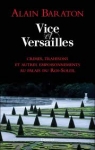 désopilant signé Alain Baraton (Grasset), jardinier en chef du parc de Versailles et du Trianon : cela regorge et dégorge d'intrigues, de meurtres, de coups fourrés sanglants. On se croirait chez les Borgia. Et c'est, de surcroît, écrit dans un style enlevé!
désopilant signé Alain Baraton (Grasset), jardinier en chef du parc de Versailles et du Trianon : cela regorge et dégorge d'intrigues, de meurtres, de coups fourrés sanglants. On se croirait chez les Borgia. Et c'est, de surcroît, écrit dans un style enlevé!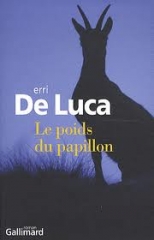
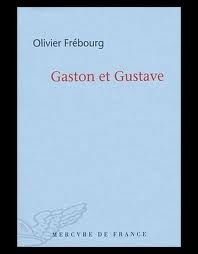 C'est le livre le plus poignant de l’automne. Le plus personnel aussi, le plus fort et sans doute l’un des mieux écrits. Gaston et Gustave, publié au Mercure de France, vient de remporter le Prix Décembre (ex-aequo avec Jean-Christophe Bailly). Olivier Frébourg, écrivain (de Marine), journaliste, éditeur, nous a déjà donné une dizaine de très bons livres –romans, essais. Lisez son Nimier, trafiquant d'insolence (LTR, La Petite Vermillon), Maupassant, le clandestin (Folio), Souviens-toi de Lisbonne (La Petite Vermillon) -voir sur ce blog à la date du 20 octobre dernier, et aussi Port d'attache (Albin Michel) et encore La vie sera plus belle (Le Livre de Poche). Il avait déjà laché un livre personnel très émouvant : Un homme à la mer (folio). Avec Gaston et Gustave, il ouvre à nouveau son cœur, largement, et délivre sa peine d’une trop grand souffrance. L’écriture, nous le savons, est une catharsis contre les coups du destin. Elle doit permettre aussi d’alléger tout sentiment de culpabilité. En tout cas essayer…
C'est le livre le plus poignant de l’automne. Le plus personnel aussi, le plus fort et sans doute l’un des mieux écrits. Gaston et Gustave, publié au Mercure de France, vient de remporter le Prix Décembre (ex-aequo avec Jean-Christophe Bailly). Olivier Frébourg, écrivain (de Marine), journaliste, éditeur, nous a déjà donné une dizaine de très bons livres –romans, essais. Lisez son Nimier, trafiquant d'insolence (LTR, La Petite Vermillon), Maupassant, le clandestin (Folio), Souviens-toi de Lisbonne (La Petite Vermillon) -voir sur ce blog à la date du 20 octobre dernier, et aussi Port d'attache (Albin Michel) et encore La vie sera plus belle (Le Livre de Poche). Il avait déjà laché un livre personnel très émouvant : Un homme à la mer (folio). Avec Gaston et Gustave, il ouvre à nouveau son cœur, largement, et délivre sa peine d’une trop grand souffrance. L’écriture, nous le savons, est une catharsis contre les coups du destin. Elle doit permettre aussi d’alléger tout sentiment de culpabilité. En tout cas essayer…  La tentation d’appliquer le mot de Feydeau : « J’ai voulu noyer mon chagrin dans l’alcool mais il savait nager » est grande...
La tentation d’appliquer le mot de Feydeau : « J’ai voulu noyer mon chagrin dans l’alcool mais il savait nager » est grande... 
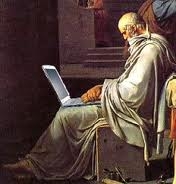 Socrate toujours. Comment se passer d'air? De sang? D'électricité dans les veines du cerveau et de l'âme/corps? Sans Socrate, tu meurs! Laisse Platon, son exégète, son scribe. Prends Socrate, et re-sache que tu ne sais rien. Sache que tu sais nada. Et va nu. Sois. Deviens (si tu veux) celui que tu es, ou pense être. Deviens sage : sois ouverture, rigueur, courage, endurance, engagement, humilité. Ne déçois plus jamais. Apprends à comprendre ton être de tout ton être. Tu sais qu'être riche, c'est n'avoir rien à perdre. Même si ce que j'ai dit est mon maître, et ce que je n'ai pas encore dit est mon esclave, je me sens avant tout tissé de l'étoffe dont sont faits les rêves dont je ne me souviens pas.
Socrate toujours. Comment se passer d'air? De sang? D'électricité dans les veines du cerveau et de l'âme/corps? Sans Socrate, tu meurs! Laisse Platon, son exégète, son scribe. Prends Socrate, et re-sache que tu ne sais rien. Sache que tu sais nada. Et va nu. Sois. Deviens (si tu veux) celui que tu es, ou pense être. Deviens sage : sois ouverture, rigueur, courage, endurance, engagement, humilité. Ne déçois plus jamais. Apprends à comprendre ton être de tout ton être. Tu sais qu'être riche, c'est n'avoir rien à perdre. Même si ce que j'ai dit est mon maître, et ce que je n'ai pas encore dit est mon esclave, je me sens avant tout tissé de l'étoffe dont sont faits les rêves dont je ne me souviens pas. Et Diogène, ton pote par-delà les siècles, qui me tire par la manche en me rappelant que là, on lui dit qu’il était interdit de cracher par terre, et par conséquent il cracha au visage de celui qui venait de le lui interdire. Diogène ajouta : c’est le seul endroit sale que j’ai trouvé.».
Et Diogène, ton pote par-delà les siècles, qui me tire par la manche en me rappelant que là, on lui dit qu’il était interdit de cracher par terre, et par conséquent il cracha au visage de celui qui venait de le lui interdire. Diogène ajouta : c’est le seul endroit sale que j’ai trouvé.».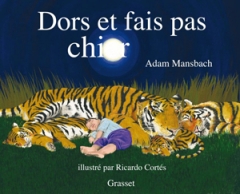

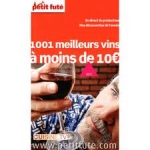 guides particuliers : les deux Lebey (restos et bistrots) pour les tables de Paris et alentour, le fooding pour la catégorie de restos qu'il traite, ou encore le Petit Lapaque des vins de copains et le carnet de vigne omnivore de Sylvie Augereau pour les vins naturels et bios. Donc je salue ici la nouvelle édition du Hachette des vins -indispensable et constamment à portée de main pour vérifier une adresse, un cépage, un site, un truc. Ainsi qu'un petit guide fort pratique et très sympa, car bourré de découvertes :
guides particuliers : les deux Lebey (restos et bistrots) pour les tables de Paris et alentour, le fooding pour la catégorie de restos qu'il traite, ou encore le Petit Lapaque des vins de copains et le carnet de vigne omnivore de Sylvie Augereau pour les vins naturels et bios. Donc je salue ici la nouvelle édition du Hachette des vins -indispensable et constamment à portée de main pour vérifier une adresse, un cépage, un site, un truc. Ainsi qu'un petit guide fort pratique et très sympa, car bourré de découvertes : 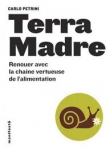 Côté solide, lisez
Côté solide, lisez  Lisez aussi les dernières parutions des éditions Honoré Champion : la collection Champion les dictionnaires s'enrichit du
Lisez aussi les dernières parutions des éditions Honoré Champion : la collection Champion les dictionnaires s'enrichit du 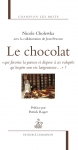
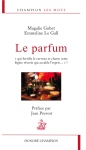 chocolat,
chocolat,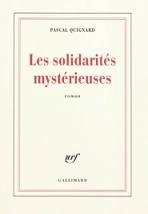 Les solidarités mystérieuses, le dernier roman de Pascal Quignard (Gallimard) est stupéfiant tant il déçoit. Disparue la magie de cet auteur précieux et fondamental -l'un des meilleurs du moment. Plus rien, dans ce livre creux, livide, insipide par endroits, de l'écriture hiératique, austère et pure, limpide et d'une beauté entre toutes remarquables. Passage à vide? Laxisme d'auteur et laisser-aller éditorial? Ce nouvel opus de l'auteur si poétique, si érudit de Vie secrète, des Petits traités, de Villa Amalia, de Tous les matins du monde et de tant d'autres bijoux, m'a ennuyé et lorsque je l'ai achevé il y a une douzaine de jours, je me suis senti désappointé, presque trahi. Reste à présent à espérer un nouveau bon bouquin -fiction ou essai, peu importe, et à relire contre toute attente le(s) Quignard que nous aimons.
Les solidarités mystérieuses, le dernier roman de Pascal Quignard (Gallimard) est stupéfiant tant il déçoit. Disparue la magie de cet auteur précieux et fondamental -l'un des meilleurs du moment. Plus rien, dans ce livre creux, livide, insipide par endroits, de l'écriture hiératique, austère et pure, limpide et d'une beauté entre toutes remarquables. Passage à vide? Laxisme d'auteur et laisser-aller éditorial? Ce nouvel opus de l'auteur si poétique, si érudit de Vie secrète, des Petits traités, de Villa Amalia, de Tous les matins du monde et de tant d'autres bijoux, m'a ennuyé et lorsque je l'ai achevé il y a une douzaine de jours, je me suis senti désappointé, presque trahi. Reste à présent à espérer un nouveau bon bouquin -fiction ou essai, peu importe, et à relire contre toute attente le(s) Quignard que nous aimons.


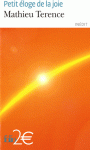
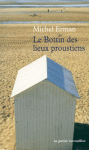 Le Bottin des lieux proustiens
Le Bottin des lieux proustiens