...En cas de besoin
Voici les notes (composées essentiellement d'extraits) que j'ai publiées ici même les 9 et 11 décembre 2006, le 18 janvier et le 24 mai 2007 et enfin le 1er mars 2009 à propos de deux livres merveilleux de Lydia Flem qui reparaissent en format de poche (Points/Seuil); et d'un troisième aussi.
C'est donc à la faveur de ces rééditions que je me permets de les rajeunir.
Orage émotionnel
 "A tout âge, on se découvre orphelin de père et de mère. Passée l'enfance, cette double perte ne nous est pas moins épargnée. Si elle ne s'est déjà produite, elle se tient devant nous. Nous la savions inévitable mais, comme notre propre mort, elle paraissait lointaine et, en réalité, inimaginable. Longtemps occultée de notre conscience par le flot de la vie, le refus de savoir, le désir de les croire immortels, pour toujours à nos côtés, la mort de nos parents, même annoncée par la maladie ou la sénilité, surgit toujours à l'improviste, nous laisse cois. Cet événement qu'il nous faut affronter et surmonter deux fois ne se répète pas à l'identique. Le premier parent perdu, demeure le survivant. Le coeur se serre. La douleur est là, aiguë peut-être, inconsolable, mais la disparition du second fait de nous un être sans famille. Le couple des parents s'est retrouvé dans la tombe. Nous en sommes définitivement écartés. Oedipe s'est crevé les yeux, Narcisse pleure".
"A tout âge, on se découvre orphelin de père et de mère. Passée l'enfance, cette double perte ne nous est pas moins épargnée. Si elle ne s'est déjà produite, elle se tient devant nous. Nous la savions inévitable mais, comme notre propre mort, elle paraissait lointaine et, en réalité, inimaginable. Longtemps occultée de notre conscience par le flot de la vie, le refus de savoir, le désir de les croire immortels, pour toujours à nos côtés, la mort de nos parents, même annoncée par la maladie ou la sénilité, surgit toujours à l'improviste, nous laisse cois. Cet événement qu'il nous faut affronter et surmonter deux fois ne se répète pas à l'identique. Le premier parent perdu, demeure le survivant. Le coeur se serre. La douleur est là, aiguë peut-être, inconsolable, mais la disparition du second fait de nous un être sans famille. Le couple des parents s'est retrouvé dans la tombe. Nous en sommes définitivement écartés. Oedipe s'est crevé les yeux, Narcisse pleure".
Ainsi commence Comment j'ai vidé la maison de mes parents, de Lydia Flem (Points/Seuil), un livre très émouvant et recommandable entre tous. En de telles circonstances ou pas, d'ailleurs. Que philosopher c'est apprendre à mourir…
Extraits : Cette étrange et envahissante liberté...
"D'abord, l'impudeur. L'obligation de bafouer toutes les règles de la discrétion : fouiller dans les papiers personnels, ouvrir les sacs à main, décacheter et lire du courrier qui ne m'était pas adressé. Transgresser les règles élémentaires de la politesse à l'encontre de ceux qui me les avaient enseignées me blessait. L'indiscrétion m'était étrangère..."
" En disparaissant, nos parents emportent avec eux une part de nous-mêmes. Les premiers chapitres de notre vie sont désormais écrits."
"En les couchant dans la tombe, c'est aussi notre enfance que nous enterrons."
"Est-ce bien normal d'éprouver successivement ou simultanément une impression effroyable d'abandon, de vide, de déchirure, et une volonté de vivre plus puissante que la tristesse, la joie sourde et triomphante d'avoir survécu, l'étrange coexistence de la vie et de la mort?"
"C'est dans la solitude que chacun se retrouve (...) Chacun fait ce qu'il peut pour surmonter l'épreuve, bricole à sa manière, toujours bancale, malheureuse, conflictuelle, et se tait."
"Même après leur mort, ne cessons-nous jamais de vivre pour eux, à travers eux, en fonction d'eux ou contre eux? Est-ce une dette qui nous poursuit toujours?"
"Se séparer de nos propres souvenirs, ce n'est pas jeter, c'est s'amputer."
"Donner est un grand bonheur. Ce que j'offrais, ce n'était pas un objet."
"L'écriture naissait du deuil et lui offrait un refuge. Un lieu où se mettre à l'abri avant d'affronter de nouvelles vagues malaisées à contenir."
"Devenir orphelin, même tard dans la vie, exige une nouvelle manière de penser. On parle du travail du deuil, on pourrait dire aussi rite de passage, métamorphose."
"Les arêtes vives des premières douleurs s'émoussent, hébétude et protestations font place à une lente acceptation de la réalité. Le chagrin se creuse. Avec des moments de vide, d'absence, de tumulte. Plus tard se répand une tristesse empreinte de douceur? Une tendre peine enveloppe l'image de l'absent en soi. Le mort s'est lové en nous. Ce cheminement ne connaît pas de raccourcis. On n'y échappe pas. La mort appartient à la vie, la vie englobe la mort."
"Mail il est un temps pour le chagrin, et un temps pour la joie."
© Lydia Flem, Comment j'ai vidé la maison de mes parents, Seuil.
 Lydia Flem a poursuivi avec un talent et une émotion égales, son travail -universel- de deuil de ses parents, avec Lettres d'amour en héritage (Points/Seuil). C'est d'une pudeur extrême et d'un amour infiniment grand. Le livre retrace la vie de ses parents disparus, à travers trois cartons de leur correspondance amoureuse, depuis les débuts, que leur fille (l'auteure) découvrit, en vidant la maison, une fois orpheline... La tendresse résume ce livre précieux. Il n'est pas innocent que l'écriture soit devenue, très tôt, le terrain de jeu de l'auteure, puis que celle-ci ait fait profession de psychanalyste. Par bonheur, ces deux livres sont exempts de théorie, mais emplis, au contraire, de sensibilité à vif -mais douce, comme ces napperons brodés que nous avons tous vus dans les mains de notre mère, tandis qu'elle les rangeait avec un soin particulier, alors qu'ils sentaient encore le "chaud" du fer à repasser, sur une étagère d'une armoire, quelque part dans une pièce de la maison familiale...
Lydia Flem a poursuivi avec un talent et une émotion égales, son travail -universel- de deuil de ses parents, avec Lettres d'amour en héritage (Points/Seuil). C'est d'une pudeur extrême et d'un amour infiniment grand. Le livre retrace la vie de ses parents disparus, à travers trois cartons de leur correspondance amoureuse, depuis les débuts, que leur fille (l'auteure) découvrit, en vidant la maison, une fois orpheline... La tendresse résume ce livre précieux. Il n'est pas innocent que l'écriture soit devenue, très tôt, le terrain de jeu de l'auteure, puis que celle-ci ait fait profession de psychanalyste. Par bonheur, ces deux livres sont exempts de théorie, mais emplis, au contraire, de sensibilité à vif -mais douce, comme ces napperons brodés que nous avons tous vus dans les mains de notre mère, tandis qu'elle les rangeait avec un soin particulier, alors qu'ils sentaient encore le "chaud" du fer à repasser, sur une étagère d'une armoire, quelque part dans une pièce de la maison familiale...
Une perle parmi cent : le corps de la mère, c'est la première géographie, le pays d'où l'on vient.
 Autres extraits
Autres extraits
"Largués par nos parents qui disparaissent et par nos enfants qui quittent la maison, c'est le plus souvent au même moment de la vie que nous sommes confrontés à ces séparations : nos parents meurent, nos enfants grandissent. Coincés entre deux générations, ceux à qui nous devons l'existence, ceux à qui nous l'avons donnée, qui sommes-nous désormais? Les repères vacillent, les rôles changent. Comment faire de cette double perte une métamorphose intérieure?
Longtemps j'ai été la "fille" de mes parents, puis je suis devenue une "maman". Cette double expérience, je l'ai vécue avec ses tensions, ses lassitudes, ses émerveillements. Mais qui suis-je désormais? Quel est mon nom?
Fille, j'ai fini de l'être. Mais cesse-t-on jamais d'être l'enfant de ses parents? Notre enfance s'inscrit dans nos souvenirs, nos rêves, nos choix, nos silences; elle survit en coulisses. Ne devenons-nous des adultes que lorsqu'il n'y a plus d'ancêtres pour nous précéder, nous protéger? Suis-je encore maman alors que mes enfants ne sont plus des enfants? La langue manque de mots pour désigner toutes les nuances de notre identité.
Comment me situer aujourd'hui dans ma généalogie? Ne faudrait-il pas un mot particulier pour nommer les parents dont les enfants ont quitté la maison? Suis-je une "maman de loin"? Une maman à qui l'on pense, à qui l'on téléphone pour un conseil, une recette, de l'argent, un encouragement, dont on a parfois la nostalgie, mais une maman avec qui on ne sera plus jamais dans le corps à corps premier." ©Lydia Flem et Le Seuil, pour "Comment je me suis séparée de ma fille et de mon quasi-fils".
Pour finir, ce mot de Primo Lévi, prélevé sur le blog de l'auteur : http://lyflol.blog.lemonde.fr
“J’écris ce que je ne pourrais dire à personne.”




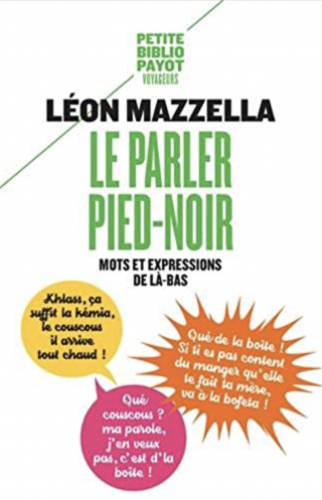


 Le vin sans additif rend addictif et c'est heureux. Antonin Iommi-Amunategui part en guerre contre les intrants, ces ajouts peu amènes qui dopent la vigne en la dévoyant, la chimie aidant. Avec son Manifeste pour le vin naturel (éd. de l'épure), mince (24 pages, 7€) comme une tranche de serrano, mais précieux comme un flacon de The Picrate, ce blogueur (allez surfer sur no wine is innocent), engagé mais calme, fixe correctement les points sur les "i", afin de (tenter de) clouer le bec aux apôtres aveugles du vin chimiquement trafiqué, cela en vissant quelques vérités neuves, ou en cours de développement. Autrement dit, sa plaquette sent le soufre, mais elle n'en contient pas, et son discours est à peine filtré. Camus aurait appelé cela la radicalité de la nuance. Le vin dit naturel, ou vivant, résumé "bio" par commodité, car nous nous perdons encore souvent dans le maquis des dénominations, entre certificat Ecocert, TerraVitis, conversion en trois ans, label AB, et j'en passe, sans oublier l'étage supérieur de la biodynamie, qui n'a rien à boire... Mais ce n'est pas le sujet de ce papier. Le vin naturel, donc, n'est plus un vin à la mode bobo, élaboré à la va comme je te pousse, consommé uniquement dans les bistros parisiens branchés par des gosiers qui ne connaissent que l'épate et capables d'avaler du vinaigre en disant c'est super!, un vin qui, il faut l'avouer, a réservé et réserve encore son lot de mauvaises surprises organoleptiques (l'intervention humaine, au moins a minima, ne remplacera jamais complètement le laisser-faire total de la nature). L'effet prend racine, s'étend, se propage façon puzzle sur l'ensemble du territoire, car les vignerons (pas) réunis se posent question, échangent timidement et agissent ici et là. Le consommateur suit, porté par le souci élémentaire de cesser d'engloutir des saloperies. Aujourd'hui, la consommation de vins plus ou moins purs ne cesse de croître. Le marché du vin bio hexagonal, lisais-je cette semaine, c'est plus de 64 000 ha de vignes (et ça continue d'augmenter, surtout en Espagne et en Italie). Cela représente, en France, en 2015, 11% du marché des produits issus de l'agriculture biologique. Et ce vin-là commence à bien s'exporter vers des marchés dits traditionnels (Allemagne, Royaume-Uni). Un signe. Le phénomène est par conséquent désormais pris au sérieux. Et nous espérons qu'il gardera encore longtemps tout ce qui bâtit sa bienheureuse singularité, à savoir ses côtés artisanal (small is always beautiful), sain, traçable, durable, et non plus seulement rousseauiste, version simpliste, baba, bobo : Ca, c'était avant, soit hier à peine. Antonin l'exprime d'emblée : J'ai pris trop mon pied avec des vins naturels pour ne pas les défendre en tant que catégorie : celle, bancale, polémique, du vin idéal. Un brin utopiste, l'auteur pourrait convaincre son lecteur qu'un vin idéal peut cohabiter dans un monde meilleur, ou bien qu'un monde idéal pourrait voir le jour, où l'on ne boirait que des vins naturels, donc meilleurs (car il est surtout question de goût, avec les vins naturels). Le paradoxe de ce type d'entreprise - que nous partageons à 100% -, est qu'il pourrait à terme noyer (je n'ai pas dit broyer) le vin naturel dans les rouages de la grande distribution actuelle, au lieu de quoi, vécu encore comme une rareté (sa quête procure des plaisirs de copains en vadrouille sur le chemin des zincs), il se recherche et se trouve chez les passeurs que sont les cavistes avisés, et dans les bistrots malins, au coeur desquels le taulier comme le client aiment donner du temps au temps, et de rire et d'aimer le simple, le beau, le bon. Puis, vient le plaisir du partage, en faisant passer. La dissémination agit bien ainsi, façon missi dominici soft. Car, méfions-nous : lorsque la parole est, ne serait-ce qu'un rien imposée, elle sent le diktat et cela n'est historiquement jamais bon, voire contreproductif, à l'instar de certaines révolutions. Brandir des dieux comme Jules Chauvet sent parfois la secte, donc l'exclusion. Condamner sans appel celui qui soufre (son vin) est stupide (et pis, en plus, ne pas soufrer a minima et à la "mise", c'est la garantie de produire de la piquette! CQFD). Ces manières de faire, non seulement divisent, mais font fuir le curieux volontaire. En revanche, militer, répandre la parole, faire goûter, informer en somme, tout bonnement, creuse le sillon, certes à la vitesse de l'escargot (slowly), ou de la tortue de la fable, mais sûrement. Je réfuterai, pour qualifier ce petit livre salutaire, l'emploi du mot combat, trop guerrier, ou bien pas assez pacifique, et donc oxymorique. Le vin nu, selon la belle expression donnée par Alice Feiring, citée par l'auteur, a toujours été là, précise Antonin. Ce n'est donc pas une mode, enchérit-il. Et d'affirmer aussitôt que son avénement est un retour qui est aussi une avancée. Lumineux! Le livre passe également en revue l'oeuvre de personnages emblématiques, de Jacques Néauport (théoricien fondamental à la parole pleine de bon sens : le vin naturel, c'est tout bête, c'est un vin sans intrants, c'est tout) à Eric Callcut (et son vin Graal), en passant par Thierry Puzelat, Pierre Overnoy ou encore Olivier Cousin (vignerons de respect). Enfin, la question qui se pose à tout produit qui prend ainsi de l'envergure, est sa nécessaire réglementation. Certains rebelles la refusent au nom d'une indépendance anti normative. Discours vain, statique, obtus, voire réactionnaire, à nos yeux. Force est d'admettre qu'une reconnaissance légale claire hisserait, distinguerait, identifierait le produit. Et le protègerait des sournoiseries industrielles. Débat en cours. Chacun semble au moins s'accorder sur la nécessité de nommer tous les ingrédients contenus dans une bouteille de vin, puisque le jus de la treille fermenté demeure l'un des derniers produits alimentaires emballés à pouvoir se passer de ces informations capitales, et réputées obligatoires depuis belle lurette. Par bonheur, les gardiens du temple comme Antonin Iommi-Amunategui veilleront toujours au raisin. Prenons-en de la graine. L.M.
Le vin sans additif rend addictif et c'est heureux. Antonin Iommi-Amunategui part en guerre contre les intrants, ces ajouts peu amènes qui dopent la vigne en la dévoyant, la chimie aidant. Avec son Manifeste pour le vin naturel (éd. de l'épure), mince (24 pages, 7€) comme une tranche de serrano, mais précieux comme un flacon de The Picrate, ce blogueur (allez surfer sur no wine is innocent), engagé mais calme, fixe correctement les points sur les "i", afin de (tenter de) clouer le bec aux apôtres aveugles du vin chimiquement trafiqué, cela en vissant quelques vérités neuves, ou en cours de développement. Autrement dit, sa plaquette sent le soufre, mais elle n'en contient pas, et son discours est à peine filtré. Camus aurait appelé cela la radicalité de la nuance. Le vin dit naturel, ou vivant, résumé "bio" par commodité, car nous nous perdons encore souvent dans le maquis des dénominations, entre certificat Ecocert, TerraVitis, conversion en trois ans, label AB, et j'en passe, sans oublier l'étage supérieur de la biodynamie, qui n'a rien à boire... Mais ce n'est pas le sujet de ce papier. Le vin naturel, donc, n'est plus un vin à la mode bobo, élaboré à la va comme je te pousse, consommé uniquement dans les bistros parisiens branchés par des gosiers qui ne connaissent que l'épate et capables d'avaler du vinaigre en disant c'est super!, un vin qui, il faut l'avouer, a réservé et réserve encore son lot de mauvaises surprises organoleptiques (l'intervention humaine, au moins a minima, ne remplacera jamais complètement le laisser-faire total de la nature). L'effet prend racine, s'étend, se propage façon puzzle sur l'ensemble du territoire, car les vignerons (pas) réunis se posent question, échangent timidement et agissent ici et là. Le consommateur suit, porté par le souci élémentaire de cesser d'engloutir des saloperies. Aujourd'hui, la consommation de vins plus ou moins purs ne cesse de croître. Le marché du vin bio hexagonal, lisais-je cette semaine, c'est plus de 64 000 ha de vignes (et ça continue d'augmenter, surtout en Espagne et en Italie). Cela représente, en France, en 2015, 11% du marché des produits issus de l'agriculture biologique. Et ce vin-là commence à bien s'exporter vers des marchés dits traditionnels (Allemagne, Royaume-Uni). Un signe. Le phénomène est par conséquent désormais pris au sérieux. Et nous espérons qu'il gardera encore longtemps tout ce qui bâtit sa bienheureuse singularité, à savoir ses côtés artisanal (small is always beautiful), sain, traçable, durable, et non plus seulement rousseauiste, version simpliste, baba, bobo : Ca, c'était avant, soit hier à peine. Antonin l'exprime d'emblée : J'ai pris trop mon pied avec des vins naturels pour ne pas les défendre en tant que catégorie : celle, bancale, polémique, du vin idéal. Un brin utopiste, l'auteur pourrait convaincre son lecteur qu'un vin idéal peut cohabiter dans un monde meilleur, ou bien qu'un monde idéal pourrait voir le jour, où l'on ne boirait que des vins naturels, donc meilleurs (car il est surtout question de goût, avec les vins naturels). Le paradoxe de ce type d'entreprise - que nous partageons à 100% -, est qu'il pourrait à terme noyer (je n'ai pas dit broyer) le vin naturel dans les rouages de la grande distribution actuelle, au lieu de quoi, vécu encore comme une rareté (sa quête procure des plaisirs de copains en vadrouille sur le chemin des zincs), il se recherche et se trouve chez les passeurs que sont les cavistes avisés, et dans les bistrots malins, au coeur desquels le taulier comme le client aiment donner du temps au temps, et de rire et d'aimer le simple, le beau, le bon. Puis, vient le plaisir du partage, en faisant passer. La dissémination agit bien ainsi, façon missi dominici soft. Car, méfions-nous : lorsque la parole est, ne serait-ce qu'un rien imposée, elle sent le diktat et cela n'est historiquement jamais bon, voire contreproductif, à l'instar de certaines révolutions. Brandir des dieux comme Jules Chauvet sent parfois la secte, donc l'exclusion. Condamner sans appel celui qui soufre (son vin) est stupide (et pis, en plus, ne pas soufrer a minima et à la "mise", c'est la garantie de produire de la piquette! CQFD). Ces manières de faire, non seulement divisent, mais font fuir le curieux volontaire. En revanche, militer, répandre la parole, faire goûter, informer en somme, tout bonnement, creuse le sillon, certes à la vitesse de l'escargot (slowly), ou de la tortue de la fable, mais sûrement. Je réfuterai, pour qualifier ce petit livre salutaire, l'emploi du mot combat, trop guerrier, ou bien pas assez pacifique, et donc oxymorique. Le vin nu, selon la belle expression donnée par Alice Feiring, citée par l'auteur, a toujours été là, précise Antonin. Ce n'est donc pas une mode, enchérit-il. Et d'affirmer aussitôt que son avénement est un retour qui est aussi une avancée. Lumineux! Le livre passe également en revue l'oeuvre de personnages emblématiques, de Jacques Néauport (théoricien fondamental à la parole pleine de bon sens : le vin naturel, c'est tout bête, c'est un vin sans intrants, c'est tout) à Eric Callcut (et son vin Graal), en passant par Thierry Puzelat, Pierre Overnoy ou encore Olivier Cousin (vignerons de respect). Enfin, la question qui se pose à tout produit qui prend ainsi de l'envergure, est sa nécessaire réglementation. Certains rebelles la refusent au nom d'une indépendance anti normative. Discours vain, statique, obtus, voire réactionnaire, à nos yeux. Force est d'admettre qu'une reconnaissance légale claire hisserait, distinguerait, identifierait le produit. Et le protègerait des sournoiseries industrielles. Débat en cours. Chacun semble au moins s'accorder sur la nécessité de nommer tous les ingrédients contenus dans une bouteille de vin, puisque le jus de la treille fermenté demeure l'un des derniers produits alimentaires emballés à pouvoir se passer de ces informations capitales, et réputées obligatoires depuis belle lurette. Par bonheur, les gardiens du temple comme Antonin Iommi-Amunategui veilleront toujours au raisin. Prenons-en de la graine. L.M. "A tout âge, on se découvre orphelin de père et de mère. Passée l'enfance, cette double perte ne nous est pas moins épargnée. Si elle ne s'est déjà produite, elle se tient devant nous. Nous la savions inévitable mais, comme notre propre mort, elle paraissait lointaine et, en réalité, inimaginable. Longtemps occultée de notre conscience par le flot de la vie, le refus de savoir, le désir de les croire immortels, pour toujours à nos côtés, la mort de nos parents, même annoncée par la maladie ou la sénilité, surgit toujours à l'improviste, nous laisse cois. Cet événement qu'il nous faut affronter et surmonter deux fois ne se répète pas à l'identique. Le premier parent perdu, demeure le survivant. Le coeur se serre. La douleur est là, aiguë peut-être, inconsolable, mais la disparition du second fait de nous un être sans famille. Le couple des parents s'est retrouvé dans la tombe. Nous en sommes définitivement écartés. Oedipe s'est crevé les yeux, Narcisse pleure".
"A tout âge, on se découvre orphelin de père et de mère. Passée l'enfance, cette double perte ne nous est pas moins épargnée. Si elle ne s'est déjà produite, elle se tient devant nous. Nous la savions inévitable mais, comme notre propre mort, elle paraissait lointaine et, en réalité, inimaginable. Longtemps occultée de notre conscience par le flot de la vie, le refus de savoir, le désir de les croire immortels, pour toujours à nos côtés, la mort de nos parents, même annoncée par la maladie ou la sénilité, surgit toujours à l'improviste, nous laisse cois. Cet événement qu'il nous faut affronter et surmonter deux fois ne se répète pas à l'identique. Le premier parent perdu, demeure le survivant. Le coeur se serre. La douleur est là, aiguë peut-être, inconsolable, mais la disparition du second fait de nous un être sans famille. Le couple des parents s'est retrouvé dans la tombe. Nous en sommes définitivement écartés. Oedipe s'est crevé les yeux, Narcisse pleure". Lydia Flem a poursuivi avec un talent et une émotion égales, son travail -universel- de deuil de ses parents, avec Lettres d'amour en héritage (Points/Seuil). C'est d'une pudeur extrême et d'un amour infiniment grand. Le livre retrace la vie de ses parents disparus, à travers trois cartons de leur correspondance amoureuse, depuis les débuts, que leur fille (l'auteure) découvrit, en vidant la maison, une fois orpheline... La tendresse résume ce livre précieux. Il n'est pas innocent que l'écriture soit devenue, très tôt, le terrain de jeu de l'auteure, puis que celle-ci ait fait profession de psychanalyste. Par bonheur, ces deux livres sont exempts de théorie, mais emplis, au contraire, de sensibilité à vif -mais douce, comme ces napperons brodés que nous avons tous vus dans les mains de notre mère, tandis qu'elle les rangeait avec un soin particulier, alors qu'ils sentaient encore le "chaud" du fer à repasser, sur une étagère d'une armoire, quelque part dans une pièce de la maison familiale...
Lydia Flem a poursuivi avec un talent et une émotion égales, son travail -universel- de deuil de ses parents, avec Lettres d'amour en héritage (Points/Seuil). C'est d'une pudeur extrême et d'un amour infiniment grand. Le livre retrace la vie de ses parents disparus, à travers trois cartons de leur correspondance amoureuse, depuis les débuts, que leur fille (l'auteure) découvrit, en vidant la maison, une fois orpheline... La tendresse résume ce livre précieux. Il n'est pas innocent que l'écriture soit devenue, très tôt, le terrain de jeu de l'auteure, puis que celle-ci ait fait profession de psychanalyste. Par bonheur, ces deux livres sont exempts de théorie, mais emplis, au contraire, de sensibilité à vif -mais douce, comme ces napperons brodés que nous avons tous vus dans les mains de notre mère, tandis qu'elle les rangeait avec un soin particulier, alors qu'ils sentaient encore le "chaud" du fer à repasser, sur une étagère d'une armoire, quelque part dans une pièce de la maison familiale...  Autres extraits
Autres extraits


