Flair n°3, "j'aime", suite
Voici d'autres extraits de ma rubrique J'aime, publiée par le magazine FLAIR Play, le magazine rugby qui fait bouger les lignes.
Le n°3 est en kiosque.
Vive la presse écrite papier!
Premiers extraits ici : Flair n°3

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Voici d'autres extraits de ma rubrique J'aime, publiée par le magazine FLAIR Play, le magazine rugby qui fait bouger les lignes.
Le n°3 est en kiosque.
Vive la presse écrite papier!
Premiers extraits ici : Flair n°3

Un peu de tendresse dans cette campagne électorale de brutes : le roman le plus gai, le plus détendant, le plus sympa paru en janvier 2016 chez Finitude, reparaît en folio : lisez ou relisez En attendant Bojangles, d'Olivier Bourdeaut l'espiègle au coeur doux et à la plume enchantée. LM
Voici ce que j'en disais à sa sortie : L'amour loufoque
Et le lien pour écouter la chanson : Mr Bojangles par Nina Simone

Cliquez =>

Quelques uns de mes J'aime, chronique publiée dans FLAIR Play magazine, parce que le rugby, c'est beaucoup plus que le rugby (extraits) :

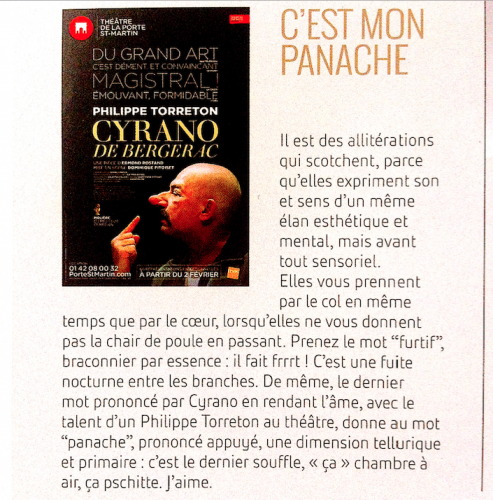


Cliquer là => Je n'ai pas connu Dominique de Roux
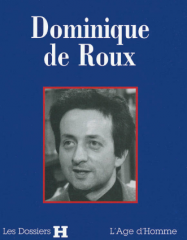
 Voici ma contribution à un hommage collectif rendu à L'Age d'homme il y a vingt ans. Mon texte, lui, a trente-deux ans. Putain, vingt, trente-deux, quarante... LM
Voici ma contribution à un hommage collectif rendu à L'Age d'homme il y a vingt ans. Mon texte, lui, a trente-deux ans. Putain, vingt, trente-deux, quarante... LM
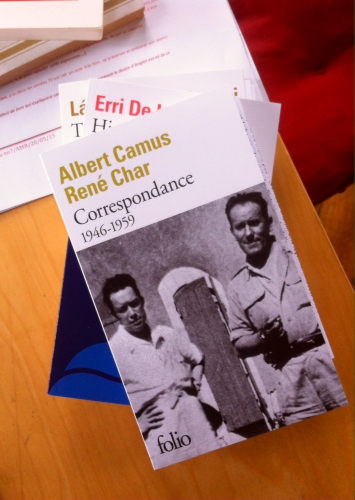
Il s'agit de la conversation bienveillante, précieuse, de deux immenses plumes qui portent un regard sur l'homme, sur un siècle qui expose sa monstruosité, sur leur oeuvre en cours, la poésie simple du matin, les lectures, les amours sûres... Cet échange entre deux authentiques compagnons exprime aussi l'appui sur l'ami, quand il sait et comprend, et qu'il marche lui-même, du même pas (Camus à Char). C'est à lire piano, piano. C'est un recueil de pépites à déguster comme un grand bas armagnac. Mieux : un mouchoir dont on dénoue les quatre oreilles avant de plonger une main avide et gourmande dans un grouillement de binagates enfouies (billes d'agathe, en pataouète pied-noir)... Où l'on découvre que Char ne cessa jamais d'être poète, où l'amitié, leur rivière souterraine, se construit lettre après lettre et mûrit comme le miel durcit, où Camus s'expose comme il fut : d'une désarmante sincérité et d'une émouvante générosité d'âme. Un livre essentiel, en marge de nos relectures régulières, soit du commerce comme disait Montaigne, avec l'oeuvre de ces deux grands bonhommes qui vécurent aussi (peu de temps), en voisins dans le Luberon, jusqu'à ce qu'un matin, Camus quitte Lourmarin et prenne la route à bord d'une funeste Facel-Véga FV3B ... L.M.
Lire aussi cette note publiée ici même le 29 novembre 2009 à propos de : La postérité du soleil
 Dimanche dernier au Mans, je signais les trois dicos que j'ai commis, puisque ce salon, Dico-Plaisir, est dédié aux dictionnaires en tout genre. J'ai surtout signé des Parler pied-noir à des nostalgériques (il en reste, et puis il y a désormais ceux qui ont envie de lire et donc de réentendre les mots de leurs parents disparus, avec l'accent que j'y ai mis, volontairement, phonétiquement), pas mal de Dictionnaire chic du vin, aussi, mais parce que j'y cause de Jasnières, et des coteaux du Loir!... Mais aucun Sud-Ouest vu par ma pomme. Les rillettes ne frayent guère avec le foie gras.
Dimanche dernier au Mans, je signais les trois dicos que j'ai commis, puisque ce salon, Dico-Plaisir, est dédié aux dictionnaires en tout genre. J'ai surtout signé des Parler pied-noir à des nostalgériques (il en reste, et puis il y a désormais ceux qui ont envie de lire et donc de réentendre les mots de leurs parents disparus, avec l'accent que j'y ai mis, volontairement, phonétiquement), pas mal de Dictionnaire chic du vin, aussi, mais parce que j'y cause de Jasnières, et des coteaux du Loir!... Mais aucun Sud-Ouest vu par ma pomme. Les rillettes ne frayent guère avec le foie gras.
La seconde édition du salon des amateurs et des auteurs de dictionnaires se tient demain au Mans.
J'y signerai Le parler pied-noir (Payot), le Dictionnaire chic du vin (Ecriture) et Le Sud-Ouest vu par Léon Mazzella (Hugo & Cie).
Cliquer ci-dessous :
https://www.dicoplaisir.fr/auteurs

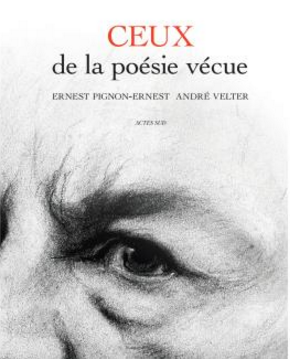


 Tenir parole, transmettre, conjuguer visible et invisible. La poésie endosse bien des rôles. Deux poètes à leur façon, André Velter, auteur et directeur de la fameuse collection de poche Poésie/Gallimard, et Ernest Pignon-Ernest, artiste plasticien imbibé par l’âme et le regard des poètes, ont déjà signé plusieurs ouvrages ensemble. Ceux consacrés à « Zingaro, suite équestre », sont dans nos mémoires vives. Le nouveau, qui paraît, « CEUX de la poésie vécue » (Actes Sud) est un magnifique album qui rend hommage, en dessins et en mots, à une vingtaine de poètes majeurs, et dont la parole est éternelle : Nerval, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, Cendrars, Maïakovsky, Éluard, Artaud, Aragon, Garcia Lorca, Michaux, Desnos, Hikmet, Neruda, Char, Genet, Pasolini, Darwich. Nous connaissons l’ardeur de Pignon-Ernest à poétiser les murs, comme ceux de Naples avec ces fameux grands dessins de Pasolini représenté en Pietà, ceux des docks de Brest avec Genet, ou encore de Darwich à Ramallah, à Jérusalem. Car la parole en lutte est aussi de mise dans ce riche album. C’est des poètes irréductibles, capteurs de signes et porteurs de paroles de révolte qu’il s’agit. « La poésie a la vie dure, même si on l’annonce régulièrement à l’article de la mort », précise Velter en introduction. « La poésie refuse d’être un ornement », poursuit-il, car « ceux de la poésie vécue ne sont en aucun cas des adeptes d’on ne sait quelle tour d’ivoire ». La poésie comme arme de combat « dit le réel, mais en le révélant plus vaste, et d’une prodigieuse intensité ». C’est cette tension, cet escalier vers la pureté qui jaillit de chaque page, et les splendides portraits au trait de poètes, les photos des grands dessins en pied de Pignon, prises sur les murs de tant de villes, y compris françaises : Desnos, Rimbaud à Paris et Charleville-Mézières, Artaud à l’hôpital d’Ivry-sur-Seine… donnent à ce livre précieux sa dimension de liberté chérie. L.M.
Tenir parole, transmettre, conjuguer visible et invisible. La poésie endosse bien des rôles. Deux poètes à leur façon, André Velter, auteur et directeur de la fameuse collection de poche Poésie/Gallimard, et Ernest Pignon-Ernest, artiste plasticien imbibé par l’âme et le regard des poètes, ont déjà signé plusieurs ouvrages ensemble. Ceux consacrés à « Zingaro, suite équestre », sont dans nos mémoires vives. Le nouveau, qui paraît, « CEUX de la poésie vécue » (Actes Sud) est un magnifique album qui rend hommage, en dessins et en mots, à une vingtaine de poètes majeurs, et dont la parole est éternelle : Nerval, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, Cendrars, Maïakovsky, Éluard, Artaud, Aragon, Garcia Lorca, Michaux, Desnos, Hikmet, Neruda, Char, Genet, Pasolini, Darwich. Nous connaissons l’ardeur de Pignon-Ernest à poétiser les murs, comme ceux de Naples avec ces fameux grands dessins de Pasolini représenté en Pietà, ceux des docks de Brest avec Genet, ou encore de Darwich à Ramallah, à Jérusalem. Car la parole en lutte est aussi de mise dans ce riche album. C’est des poètes irréductibles, capteurs de signes et porteurs de paroles de révolte qu’il s’agit. « La poésie a la vie dure, même si on l’annonce régulièrement à l’article de la mort », précise Velter en introduction. « La poésie refuse d’être un ornement », poursuit-il, car « ceux de la poésie vécue ne sont en aucun cas des adeptes d’on ne sait quelle tour d’ivoire ». La poésie comme arme de combat « dit le réel, mais en le révélant plus vaste, et d’une prodigieuse intensité ». C’est cette tension, cet escalier vers la pureté qui jaillit de chaque page, et les splendides portraits au trait de poètes, les photos des grands dessins en pied de Pignon, prises sur les murs de tant de villes, y compris françaises : Desnos, Rimbaud à Paris et Charleville-Mézières, Artaud à l’hôpital d’Ivry-sur-Seine… donnent à ce livre précieux sa dimension de liberté chérie. L.M.
... Avec L'Express Styles, sous la plume de Marianne Payot, et avec Sud-Ouest, sous la plume de Benoît Lasserre, pour évoquer la parution en format de poche de mon Parler pied-noir :
Cliquez => Le Parler pied-noir Sud-Ouest
L'EXPRESS
Avec l’auteur des Bleus à l’âme pour prétexte, je risque une confession intime sur l’apprentissage et l'impulsion littéraires. Je parlerai de son œuvre lorsque je la connaîtrai davantage.
 Nous le savons, mais nous ne pouvons nous en empêcher : Écrire à chaud est néfaste, car peu clairvoyant. J’ai pourtant envie de dire combien « je suis Françoise Sagan », ce lundi soir, et combien « je suis » aussi (quelle prétention !) « Catherine Deneuve » au sommet de sa beauté dans « La Chamade », d’après le roman éponyme du « charmant petit monstre ». Merci à Arte, qui nous a offert un doublé, ce 30 janvier, avec le film d’Alain Cavalier (1968), et le documentaire « Françoise Sagan, l’élégance de vivre », réalisé par Marie Brunet-Debaines, enrichi de la voix et des témoignages infiniment touchants de Denis Westhoff, le fils de Sagan. Cela a permis d'oublier Brigitte Bardot (pourtant si présente, par palimpseste), devant la plastique inouïe de Deneuve. Et de découvrir en profondeur le personnage iconique de Françoise Sagan. Merci Arte pour cette soirée tout en tact, en légèreté, en vol de libellule au-dessus du torrent : Bien davantage qu'un James Dean féminin, Sagan est une hussarde, une femme pétrie de vie, cette chose qu’elle s’employa à brûler (avec élégance) chaque jour, chaque nuit par les deux bouts.
Nous le savons, mais nous ne pouvons nous en empêcher : Écrire à chaud est néfaste, car peu clairvoyant. J’ai pourtant envie de dire combien « je suis Françoise Sagan », ce lundi soir, et combien « je suis » aussi (quelle prétention !) « Catherine Deneuve » au sommet de sa beauté dans « La Chamade », d’après le roman éponyme du « charmant petit monstre ». Merci à Arte, qui nous a offert un doublé, ce 30 janvier, avec le film d’Alain Cavalier (1968), et le documentaire « Françoise Sagan, l’élégance de vivre », réalisé par Marie Brunet-Debaines, enrichi de la voix et des témoignages infiniment touchants de Denis Westhoff, le fils de Sagan. Cela a permis d'oublier Brigitte Bardot (pourtant si présente, par palimpseste), devant la plastique inouïe de Deneuve. Et de découvrir en profondeur le personnage iconique de Françoise Sagan. Merci Arte pour cette soirée tout en tact, en légèreté, en vol de libellule au-dessus du torrent : Bien davantage qu'un James Dean féminin, Sagan est une hussarde, une femme pétrie de vie, cette chose qu’elle s’employa à brûler (avec élégance) chaque jour, chaque nuit par les deux bouts.
 Négligence
Négligence
Je confesse – et beaucoup se reconnaîtront dans ce qui suit -, avoir bêtement négligé de la lire durant de nombreuses années, la jugeant trop légère, allant alors jusqu’à me moquer de ceux qui la lisaient, à commencer par ma mère, à laquelle j’opposais Yourcenar, voire Duras, les jours d’égarement ou de colère capricieuse. L’époque n’était pas avare en marguerites, et le socle de la pensée était plombé d’un revêtement sartrien à toute épreuve, bien qu'assez peu résistant. Il fallait « faire genre », lire Barthes qui nous barbait, mentir en affirmant avoir aimé le dernier Sarraute, se jeter sur le nouveau Kundera comme un ovin dévot, faire semblant d’aimer l’engagement et même, déjà, conchier le poétique jugé ringard par de nouveaux tribunaux, de certaines proses somptueuses (le Rostand de Cyrano, le Morand nouvelliste, le Toulet de Mon amie Nane). Jusqu’à ce que Stendhal nous tire par la manche, un soir de lecture clandestine car tardive et sous les draps, d’un Dumas de fortune ou d’un Pergaud de contrebande, en nous chuchotant que « La politique dans un roman, c’est un coup de pistolet dans un concert ». Tout devint lumineux. Nous étions jeunes.
Lumière
Le déclic avait eu lieu timidement en classe de première, avec des extraits de Vents et d’Amers, de Saint-John Perse, et la bombe Alcools, d'Apollinaire, éveillé par un prof de Français iconoclaste (Lycée de Bayonne, 1975 - je resitue).
Puis vint la vraie lumière, l’effet détonateur, cette lumière qu'alluma un ami, en me faisant découvrir pêle-mêle Blondin, Nimier, Drieu, Chardonne, mais aussi Huysmans, Barbey d'Aurevilly, Frank, Cioran, des écrivains éloignés d’une littérature de gauche engoncée et triste dans laquelle je me complaisais. Nous dévorions tous deux les livres plus vite que les termites les poutres et mon chien de chasse sa gamelle. Mon appétit accrût singulièrement au contact de cet ami littéraire capital. Nous poursuivions des études à Sciences-Po Bordeaux (ou bien c'était l’inverse : des études nous poursuivaient et nous nous planquions chez Mollat), car on se fichait pas mal de la politique (nous n’aurions cependant raté un cours de Jacques Ellul sous aucun prétexte). Mais nous préférâmes, une fois nos études achevées, oser invectiver Philippe Sollers dans un restaurant, d'une table l'autre, et mon ami aller chiper le courrier coquin de Gabriel Matzneff directement dans sa boîte aux lettres, rue des Ursulines, ce à la faveur d'une virée parisienne placée sous le signe de Léon Bloy et de Dominique de Roux. Nous étions de vrais sales gosses...
Merci par conséquent à Benoît Lasserre, qui fit office de déclencheur décisif et d'accélérateur incisif. J'avais peu lu, jusque là. Un peu de Kipling et de London, Hamsun et Hölderlin avec passion, les Romantiques allemands, je dévorais la poésie française du XIXè, et puis Vesaas, Ramuz ; mais Lucky Luke surtout. J'avais cependant déjà placé Char et Gracq (découverts le 7.7.77) au-dessus de tous de façon péremptoire.
Serait-ce grâce à M. Louis, le prof de Français et à mon ami que j’ai commencé d’écrire des livres... Si j’étais présomptueux, je risquerais la comparaison suivante : Mr Louis et Benoît figurent ce qu'ont pu représenter ensemble l'instituteur Louis Germain, Pascal Pia et Jean Grenier pour Camus.
Stupéfaction
Sa culture, déjà grande (nous avions vingt ans et des poussières), il la partageait avec moi comme le pain, en me tendant la plus belle part à chaque occasion, et elles étaient quotidiennes. Je découvrais une autre littérature, un pan complémentaire, en somme. Je mis un temps mon obsession de la Nature entre parenthèses (Rousseau, Giono, Genevoix, Moinot, Stevenson) ainsi qu'une attitude bornée qui boutait hors de ma jeune bibliothèque tout livre se déroulant peu ou prou en milieu urbain, car cela m’asphyxiait dès les premières lignes. Ainsi n'ai-je pu lire Proust que fort tard.
Aussi, Sagan. Jamais lue jusqu'à il y a peu. Sauf « Bonjour tristesse », mais en le rangeant par la suite dans un coin reculé des rayonnages. Qu’est-ce qu’on peut être bête, snob et bête, quand même… Ce côté petit-intello-de-gauche, sans réel fondement, a longtemps collé à la peau de nombre d’entre nous. Je fus même offusqué, un jour que je rendais visite à Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil, de voir en arrivant, posé sur la grosse télévision, reposant sur Télé 7 jours, le dernier Sagan. Je crois que c’était « …Et toute ma sympathie », à moins que ce fut « Derrière l’épaule », c’est possible aussi. Je n’en suis pas certain… C’était comme si mes yeux étaient tombés sur un Marc Lévy en visitant Flaubert à Croisset ! Allez comprendre. Allez comprendre comment, avec le temps, nous revenons – ou plutôt nous allons enfin – vers des Sagan, après les avoir négligés, méprisés au nom d’une barre placée haut, au nom d’une certaine idée prétentieuse, pédante, hautaine au fond, de la littérature.
Ou alors, ou alors. Ou alors… notre époque décline (c'est un fait), au point que l’inculture, la déculturation ambiante, une certaine ignorance assumée, nous font mettre désormais la barre plus bas, là où ça nivelle, nous pousse à délaisser ce qui provoqua nos décharges d’adrénaline littéraires les plus fortes, et qui se trouve à présent relégué au rayon du trop littéraire, du compliqué, étiqueté prise de tête, donc superflu... De la même manière que nous jugions faible ce vers quoi je me rends ce soir avec délice : « la petite musique Sagan », ce style dépouillé et cheminant, ce côté romancière du couple comme le fut Moravia, ce timbre que les films de Claude Sautet possèdent, ces chansons d’Aznavour qui touchent les quadras adultères…
Perspicacité
Je trimbale avec moi depuis plusieurs jours un livre formidable de Sagan : « Chroniques, 1954-2003 » (Le Livre de Poche, dans une édition reliée, comme les « poche » ont pris l’habitude d’en produire à l’approche des fêtes, et qui hisse le format au rang d’ouvrage de collection). Ce sont ses articles (les chroniques sont des articles endormis, écrit Denis Westhoff dans l'avant-propos) sur tout et rien, parus dans L’Express, ELLE, Femme, Egoïste, Vogue, La Parisienne… Les textes sur Verlaine, Depardieu, sur Capri, Naples, sur la mode, le rugby, la lecture ou encore Orson Welles… sont des petits joyaux. C'est stylé, diraient les jeunes, espiègle (une marque de fabrique) et perspicace. L’auteur de tant de romans délivre aussi une écriture journalistique de talent.
« Chroniques, 1954-2003 » (Le Livre de Poche, dans une édition reliée, comme les « poche » ont pris l’habitude d’en produire à l’approche des fêtes, et qui hisse le format au rang d’ouvrage de collection). Ce sont ses articles (les chroniques sont des articles endormis, écrit Denis Westhoff dans l'avant-propos) sur tout et rien, parus dans L’Express, ELLE, Femme, Egoïste, Vogue, La Parisienne… Les textes sur Verlaine, Depardieu, sur Capri, Naples, sur la mode, le rugby, la lecture ou encore Orson Welles… sont des petits joyaux. C'est stylé, diraient les jeunes, espiègle (une marque de fabrique) et perspicace. L’auteur de tant de romans délivre aussi une écriture journalistique de talent.
Car, sous ses airs distillés et shootés, sous ses paupières tellement lourdes qu’elles donnent envie de tomber avec elles - à l’instar des seins de Billie Holiday, et derrière une légendaire frange blonde bien commode, Françoise Sagan porte véritablement, passé le masque de la pudeur et de la distinction, un regard percutant et précis sur les êtres, les sentiments et sur les choses, comme une flèche décochée trouve le mille sans aucun bégaiement. Alors oui, ce plaisir tardif de retrouver quelque livre racorni publié par Julliard ou Flammarion et au titre singulier emprunté parfois à Éluard –un titre saganien (ça se dit ?), faire provision de quelque Pocket à la couverture douce et claquante, puis lire peinard, désinhibé, procure un plaisir simple incroyablement bienfaisant. Merci par avance, Françoise Quoirez, de Cajarc (Lot), car nous n’avons pas fini de découvrir vos sortilèges. L.M.
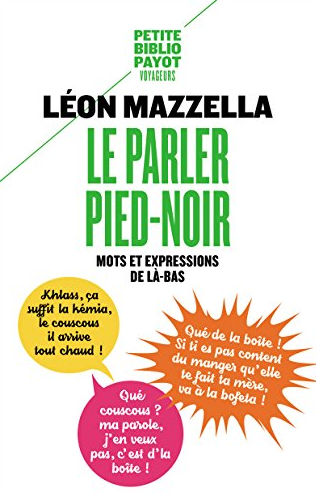
Il est paru ce matin. A vot' bon coeur!
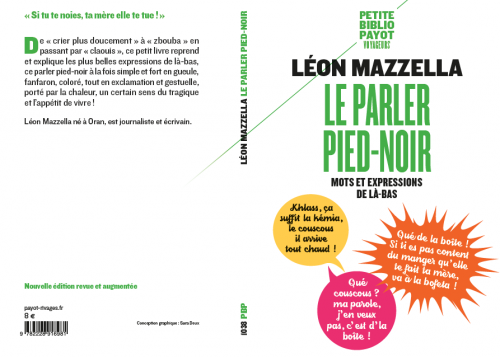
Cliquez là => René Char lu par Laurent Terzieff
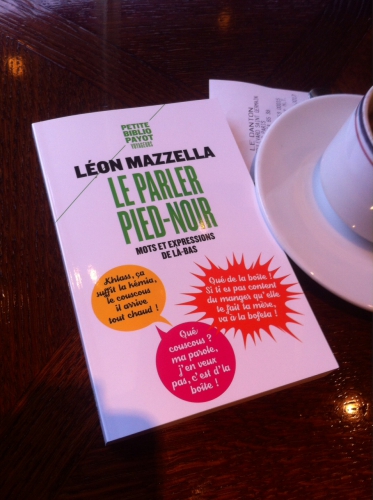
Mon Parler pied-noir arrivera donc en librairie le 18 janvier. Il s'agit de la réédition en format de poche de mon long-seller, paru en 1989 chez Rivages et constamment réimprimé depuis. Purée!..
J'ajoute qu'il s'agit d'une nouvelle édition revue et - considérablement - augmentée (192p. 8€)

LA VIE N'ATTEND JAMAIS
« Mes arches de Noé », deuxième : Pour cette rentrée, Michel Déon nous offre une nouvelle galerie de portraits souvenirs avec « Bagages pour Vancouver ». Précipitez-vous !
----------
En marge de cette rentrée aux allures d’un lâcher de chiens affamés (lesquels auront un os ?), pas même annoncée sur les listes des parutions officielles, la sortie du nouveau livre de Michel Déon, « Bagages pour Vancouver » (La Table ronde), est aussi discrète que les couleurs de sa jaquette sont douces. Bouffée d’air pur ! « Bagages pour Vancouver » est le second volume de « Mes arches de Noé », recueil de récits entrecoupés d’une vie, celle de Déon. Le premier volume racontait la découverte de Spetsai, en Grèce, le Portugal de Chardonne, l’amitié de Kléber Haedens (les plus belles pages du livre), celle de Morand, de Cocteau et de tant d’autres îles…

« Les gens de la nuit » écrivent le jour
Fonceur, bringueur, Déon traverse en gourmand raffiné le Paris des années de béton (les années Sartre), avec des copains capables de désarmer toutes les tyrannies intellectuelles. Qu’ils s’appellent Laurent, Blondin, Nimier, Fraigneau, Laudenbach ou Hecquet (que La Table ronde ferait bien de rééditer) (*) tous ces gens préféraient les gueules de bois aux langues de plomb.
C’est l’époque des reportages pour « Match », des lectures pour Charles Orengo, à la fois César, Machiavel et Chateaubriand des éditions Plon ; l’aventure bénie de « La Parisienne », jusqu’à ce que le Nouveau Roman pose sa cafetière sur la table et la nouvelle critique ses scalpels sur le billard. Ce sont les nuits alcoolisées, « rechargées » aux Halles et achevées entre les seins de jolies filles sans bas bleus… N’importe ! Ces jeunes dilettantes à l’ambition bien vertébrée savaient être jansénistes le jour. Ce sont encore les virées à « La Bourdette », chez Haedens, les blagues caustiques de Nimier, qui firent de lui un mythe plus qu’un écrivain… La découverte de la petite musique Sagan, l’amitié irlandaise avec Christine de Rivoyre, l’hommage au grand Fraigneau, qui répétait à ses cadets (dont Déon), que la vie est aussi une fête, que les moralistes sont des raseurs et l’amour un plaisir de civilisé. Bref, ce sont les années folles des hussards, vécues à 200 à l’heure dans la « Gaston-Martin » (un surnom attrapé devant chez Gallimard) de Nimier. Cette galerie de portraits-souvenirs, parfois émouvants (sur la tombe de Paul-Jean Toulet à Guéthary, chez une ancienne conquête à Saint-Jean-de-Luz), sont autant d’hommages aigres-doux rendus à une époque perdue, lost, et que Déon semble regretter : sans doute a-t-il à présent le sentiment d’être devenu un de ces aînés dont il croque admirablement le profil…
D’entre tous, c’est celui de Coco Chanel qui reste au fond du verre. Magnifiée, telle qu’on la devinait, la grande dame ouvre le livre en nous apparaissant dans toute sa noblesse, vêtue d’un tailleur de tweed blanc et d’un immuable canotier, un soir de Noël, dans sa chambre au Ritz. Cette nuit-là, Déon l’acheva calé dans un fauteuil, dans son appartement de la rue Férou, en compagnie d’Angelo Pardi et de Pauline Théus, les personnages principaux du « Hussard sur le toit », de Giono (autre émotion vive). Ce fut une nuit inoubliable, gravée à jamais dans la belle mémoire du plus stendhalien de nos écrivains. « Remettez-nous ça ! », dira Blondin.
Léon Mazzella
Sud-Ouest Dimanche, 8 septembre 1985.
---
(*) C’est fait, depuis.

Je reprends la seconde édition de mon premier roman Chasses furtives, augmentée d'une préface de Michel Déon avec une certaine émotion, depuis que l'auteur des Poneys sauvages a disparu. Je lui dois d'ailleurs le Prix Jacques-Lacroix de l'Académie française que ce petit roman reçut à sa parution deux années avant cette réédition, laquelle date de 1995, comme je dois à un autre grand académicien disparu, Pierre Moinot, le second prix que le livre reçut (le même jour, d'ailleurs), le prix François Sommer. Il y a eu une troisième édition depuis (*), et - imbécilement - j'ai cru bon de ne pas y inclure cette préface. C'est con. Et je m'en veux, ce matin. J'ai relu également toutes les lettres que Déon m'a adressées depuis Old Rectory, Tynagh, Co. Galway (Irlande), au fil des années, ainsi que les quelques articles que j'ai pu écrire sur ses livres, en particulier Bagages pour Vancouver (pour Sud-Ouest Dimanche). Aussi, une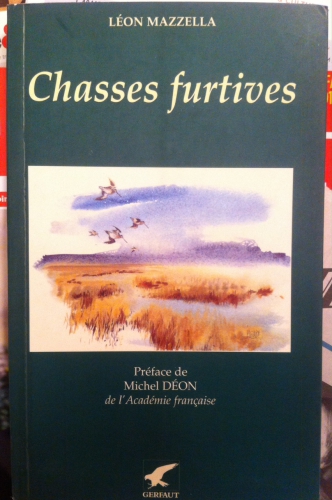
Le clébard fit une fête de tous les diables à Déon, lorsque celui-ci se glissa dans un habitacle enrichi de parfums capiteux à faire fuir toute femme, et tandis que je m'excusais pour l'enthousiasme débordant de mon sauvage à poil dur, Michel caressait le chien à qui mieux mieux tout en m'engueulant copieusement pour ne l'avoir pas amené au restaurant (nous nous étions retrouvés au Chapon fin et je le raccompagnais à son hôtel). Là-dessus, il ajouta que son invitation à venir chasser la bécassine sur ses terres irlandaises ne pourrait cependant pas se réaliser en compagnie d'Athos, pour des raisons de quarantaine dissuasives. Et il le regrettait pour lui, pas pour moi! Un souvenir parmi d'autres... L.M.
(*) Editions Passiflore, 2012.
Qu’on ne se méprenne pas, il s’agit là d’un plaisir de physionomiste, pas de fan. D’un plaisir d’ornithologue, aussi. Reconnaître un oiseau en vol par grand vent debout, ou un écrivain qui s’engouffre dans une voiture, est un plaisir égal, qui trouve sa source dans la re-connaissance. Le salaire de la mémoire est un juste plaisir.

Musarder à Paris présente l’avantage d’y croiser « des gens ». Il y a quelques mois, par exemple, j’ai vu Anouk Aimée boulevard Raspail, et je fus frappé par la classe intacte d’une femme splendide. Je garderai toujours l’image de son regard qui croisa le mien, devant la librairie Gallimard, où j’espérais qu’elle fasse une halte. J’aurais alors poussé la porte sans effort afin de prolonger l’observation. Un après-midi, tandis que je trafiquais parmi les « collection Blanche » dans cette belle librairie, c’est François Mitterrand, alors locataire de l’Élysée, qui s’y arrêta, et y acheta quelques ouvrages. Sa présence envahît absolument le lieu comme un chant de silence. Aujourd’hui –cet après-midi, lundi 19 décembre, c’est Emmanuelle Béart que j’ai vue rue Gracieuse, mais comme elle était emmitouflée à la manière d’un bébé Inuit calé dans sa poussette, il a fallu qu’elle me frôle pour que je la reconnaisse. Je ne sais qui, du succès ou des frimas, l’oblige à se dissimuler sous la silhouette de Bibendum. Il m’arrivait, il y a quelques années, de prendre le bus n°83 en même temps que Laetitia Casta, et mon cœur cognait tellement que je regardais ma chemise, car je pensais naïvement qu’elle pouvait la voir trembler. Un peu comme lorsque, dans une autre vie, j’approchais à plat ventre un cerf ou un vol de vanneaux. Quand François Cheng monte dans le n°27 en même temps que moi, cela me procure une émotion poétique, davantage empreinte de sagesse. Mon cœur demeure au ralenti. Croiser régulièrement « ceux du quartier », les familiers, ou ceux qui y frayent fréquemment : Jean-Pierre Léaud, Daniel Pennac, Jacques-Pierre Amette, Monica Bellucci et ses filles, Tahar Ben Jelloun, Nancy Huston, les époux Tiberi, Hervé Vilard, Mathilde Saignier, n’émeut guère plus. C’est s’ils viennent à manquer au paysage que l’on s’interroge, puisqu’ils en dessinent pour partie les contours. Et je cite ces noms comme j’énumèrerais chevalier gambette, courlis corlieu, pluvier doré, bécassine sourde, sarcelle d’hiver et râle des genêts – pour me limiter à un biotope de zones humides, lequel a ma préférence… Tu as pris quoi aujourd’hui ? (tu as vu qui, tantôt). Je plumerai plus tard (je te raconterai les rues) – envie d’un hot whiskey et d’un disque de Savall, avant, je déchausse, décompresse, puis je m’occupe de tout, chérie… En revanche, ce qui émoustille, c’est de voir une espèce égarée, comme on le dit d’un oiseau migrateur repéré hors de ses couloirs et territoires habituels. Soit, un germanopratin à Belleville, ou un people du 7ème en plein 13ème. Pour un peu, nous serions tenté de lui demander visa et carnet de vaccination. Car, rien n’est plus simple que de vouloir observer une concentration d’écrivains du côté de l’Odéon, puisque c’est leur réserve, leur lieu de gagnage. La trophéite y est fastoche. Il n’y a qu’à zyeuter dans le tas… Non, plus excitants sont la billebaude et l’approche, surtout. Lorsque je vivais encore à Bordeaux, et que je correspondais seulement par lettres avec Julien Gracq, il m’arriva de venir à Paris (juste) pour y jouer le paparazzi-ornitho rue de Grenelle, afin de guetter sa sortie de chez lui; il vivait au n°61. J’eus un foudroiement incandescent dans le ventre lorsqu’il apparut, vêtu d’un manteau gris à chevrons et la tête recouverte d’une toque en Astrakan. Lorsqu’il disparut, happé par l’escalier, à l’entrée du métro Bac, je fus saisi d’un vertige douloureux, comme si je m’étais trouvé au bord d’une falaise de la côte normande, par vent arrière… Aujourd’hui, je me souviens aussi de grands disparus, croisés au hasard des rues : Emil Cioran, Albert Cossery, Antoine Blondin… Et aussi de moments : Patrick Modiano, le bien vivant, photocopiant Un pedigree, rue de Vaugirard, tandis que je photocopiais aussi un truc à côté de lui. Là, j’étais sans planque, sans jumelles, et l’oiseau (pas) rare – il habite à un jet de galet de là -, s’était posé devant mes bottes, bécassine se laissant tomber comme une pierre, au mépris de toute méfiance, entre chienne et louve, dans un marais accorte et avec force « ffrrrrrt » produit par les plumes de sa queue. Ce qui pour moi, encore aujourd'hui, symbolise la confiance aveugle absolue… Mais la faune que je préfère, c’est celle à laquelle je rends fréquemment visite, quand je le souhaite : les animaux du zoo du Jardin des Plantes sont mes potes. Une faune emprisonnée. Je leur fais donc des coucous de courtoisie, non sans une certaine tristesse, que je tache de dissimuler de mon mieux. Il m’arrive de parler à un oryx, à une chouette harfang, à un orang-outan, à un ara, une panthère des neiges. J’agis discrètement, afin de ne pas éveiller le regard de mes congénères, qui serait torve. J’ai de l’amitié pour les nombreuses corneilles qui prospèrent là - pourtant, elles sont invasives et de plus en plus arrogantes -, pour les palombes si grasses qu’elles répugnent à voleter jusqu’aux jardins du Luxembourg voisins, et pour les faucons crécerelle au vol furtif et rasant, qui ne cessent de chasser au-dessus de nos têtes. Et c’est ainsi que Paris est grand. L.M.
Photo de bécassine des marais : © J.-P. Siblet
 « L’Aigle et l’enfant », film de Gerardo Olivares et Otmar Penker, avec Jean Reno, Manuel Camacho et Tobias Moretti (sorti en juillet 2016).
« L’Aigle et l’enfant », film de Gerardo Olivares et Otmar Penker, avec Jean Reno, Manuel Camacho et Tobias Moretti (sorti en juillet 2016).
Abel et Caïn. Le parent défunt, l’autre devenu impuissant, et ici il est violent. Lukas, l’enfant, Keller le père. Le chasseur impitoyable. La mère a péri dans l’incendie de la maison. Le fils unique et inconsolable est devenu sauvage. Il parcourt la montagne. Trouve un aiglon tombé du nid, poussé par son frère aîné, le plus fort de l’aire, qui voulut le tuer. Il le nomme donc Abel. L’affaite clandestinement, dans la ruine de la maison brûlée, à l’insu de son père, qui traque aussi les aigles avec son fusil. Lukas rencontre Danzer, le garde forestier, qui comprend tout, et prend peu à peu l’enfant sous son aile. Il lui apprend à dresser Abel, et le protège du père, des loups, et des pièges à mâchoires… C’est un film un peu too much, mal fagoté certes, avec un discours off récité par Jean Reno/Danzer, mièvre comme peut l'être une page de Paolo Coelho. Cependant, les paysages et les scènes de vol, de chasse de l’aigle surtout, sont inouïs.
J’ai vu ce film ce samedi soir, et je l'ai aimé, car - c'est personnel -, je me suis retrouvé enfant, adolescent, jeune adulte, dans la peau et dans l’esprit de ce gamin. Autant dire que je me suis vautré dans la pellicule comme un sanglier dans sa souille. Ma passion de la fauconnerie, ma rencontre capitale avec un aiglier exceptionnel (Jean-Jacques Planas), ma volonté profonde d’atteindre coûte que coûte une communion maximale avec la nature, m’y fondre afin de tenter de me faire accepter par le monde sauvage, en (re)devenant moi-même animal, débarrassé de ma (peau de) nature humaine…
jeune adulte, dans la peau et dans l’esprit de ce gamin. Autant dire que je me suis vautré dans la pellicule comme un sanglier dans sa souille. Ma passion de la fauconnerie, ma rencontre capitale avec un aiglier exceptionnel (Jean-Jacques Planas), ma volonté profonde d’atteindre coûte que coûte une communion maximale avec la nature, m’y fondre afin de tenter de me faire accepter par le monde sauvage, en (re)devenant moi-même animal, débarrassé de ma (peau de) nature humaine…
Pour tout cela, chacun peut s'approprier des pans du film à sa mesure, et s'identifier comme on dit. Il s'agit d'une oeuvre qui « parlera » davantage à certains qu'à d'autres, car il s'agit d'un film empathique. C'est une vraie grande émotion, malgré sa friche, et son chablis d’imperfections. L'indulgence gouverne par conséquent, et s'incline devant un film animalier de haut-vol (avec jeu de mots), puis face à un film sensible sur l'enfance fragile, poétique, et avec une histoire d'hommes, de transmission, et de blessure maladroitement perçue, mal pansée, sinon par l'étranger à l'affaire... Grosses ficelles, diront les esprits chagrins et citadins. Et même si la faille de l'histoire est un grand sujet maltraité, ici, il faut le voir, au moins si l'on aime la montagne et les oiseaux de proie.
 « L’Aigle et l’enfant » est par ailleurs à rapprocher du splendide « Kes », de Ken Loach (1969), d’après le livre (captivant) de Barry Hines, dans lequel un enfant, Billy, issu d’une ville minière du nord de l’Angleterre, déniche et dresse, à l’insu de sa famille, un niais – un jeune faucon (crécerelle) -, qui illumine sa vie...
« L’Aigle et l’enfant » est par ailleurs à rapprocher du splendide « Kes », de Ken Loach (1969), d’après le livre (captivant) de Barry Hines, dans lequel un enfant, Billy, issu d’une ville minière du nord de l’Angleterre, déniche et dresse, à l’insu de sa famille, un niais – un jeune faucon (crécerelle) -, qui illumine sa vie...
Et, dans un genre voisin, le film d'Olivares est à rapprocher également du sublime « Les Saints innocents », de Mario Camus (1984), d’après « Los Santos innocentes », roman fort, essentiel, de l’immense Miguel Delibes, et où le personnage infiniment touchant d’Azarias, vieux paysan ingénu, parle aux oiseaux, notamment à une corneille nommée Milan. Et c'est bouleversant… L.M.
également du sublime « Les Saints innocents », de Mario Camus (1984), d’après « Los Santos innocentes », roman fort, essentiel, de l’immense Miguel Delibes, et où le personnage infiniment touchant d’Azarias, vieux paysan ingénu, parle aux oiseaux, notamment à une corneille nommée Milan. Et c'est bouleversant… L.M.
 Il se nomme Riquewihr, comme la ville. Le château éponyme, donc, de la maison Dopff & Irion, à Pfaffenheim, où crèche la Cave éponyme elle aussi, produit des vins d'une grande franchise intérieure, et d'une sècheresse qui flirte avec le chic sans l'austérité, la pureté sans artifice aucun, fut-il (sans jeu de mot reposant sur une allitération) juste défini en termes de sucrosité. Le Riesling Les Murailles 2010 est une bombe d'essence originelle d'un cépage trop souvent noyé dans un sirupeux modeux qui le travestit. Et, comme le vin, surtout lorsqu'il est issu d'un seul cépage, ne dit mot (mais ne consent pas pour autant), à l'instar du poisson pris à la ligne, son
Il se nomme Riquewihr, comme la ville. Le château éponyme, donc, de la maison Dopff & Irion, à Pfaffenheim, où crèche la Cave éponyme elle aussi, produit des vins d'une grande franchise intérieure, et d'une sècheresse qui flirte avec le chic sans l'austérité, la pureté sans artifice aucun, fut-il (sans jeu de mot reposant sur une allitération) juste défini en termes de sucrosité. Le Riesling Les Murailles 2010 est une bombe d'essence originelle d'un cépage trop souvent noyé dans un sirupeux modeux qui le travestit. Et, comme le vin, surtout lorsqu'il est issu d'un seul cépage, ne dit mot (mais ne consent pas pour autant), à l'instar du poisson pris à la ligne, son silence couvre tous les excès réitérés ad nauseam. (Si les poissons hurlaient au bout de l'hameçon, et si le riesling sucré à souhait gueulait lorsqu'on le verse, il en irait autrement dans les cours d'eau, les océans, les mers, et les coteaux pentus d'Alsace, et d'ailleurs...). Soit, ce riesling : une pure merveille, droite, minérale un peu, acide - non, douce : le strict nécessaire, ce minimum syndical sans lequel nous serions dans un manque culturel, voisin de l'habitus bourdélien (et ça, ça en jette gratos, je le sais). Soit un truc incontrôlable, ne cherchez pas. Et puis alors, je vais vous dire, je ne me suis pas renseigné sur le millésime, ni sur l'élaboration du résultat offert dans ce flacon. Parfois, il est juste et bon de se limiter stricto sensu au verre, là, devant. Face à nos yeux, puis à nos narines, et enfin un peu à nos papilles de la nation. Il convient d'agir ainsi, en essayant de nous débarrasser de toute culture, de tout référent. Bien sûr, c'est difficile. L'effet de surprise joue en faveur. Ce riesling-là, mes amis, en escorte d'une épaisse sole meunière maison, juste beurrée et citronnée (avec du poivre blanc et sans sel), est aussi singulier que le gewurztraminer, Les Sorcières (2011) de la même maison avec une grappe de muscat, oui, et puis un Nuts. Na. Pureté et sincérité sont encore au garde à vous décontracté, l'air de ne pas y toucher. Comme si c'était comme ça et pas autrement qu'il fallait toujours faire. Et c'est précisément ce dont on rêve, s'agissant de vins alsaciens : notez que D&I est une maison d'envergure, que la cave de Pfaffenheim dépasse insolemment les dimensions de la votre, qu'il ne s'agit pas d'un vigneron indépendant et paysan qui répugne à décrocher lorsque le Crédit Agricole lui téléphone. Et que, malgré tout, ça fonctionne plutôt bien. Le riesling possède ce fruité idéal, délicat, qui n'inonde pas le palais mais vous laisse à l'aise avec votre propre liberté. Et le gewurztraminer a le tact, l'intelligence de ne pas vous la jouer tsunami de flaveurs convenues et reconnaissables à cent kilomètres. Les Sorcières est en référence à l'emplacement, planté en vignes aujourd'hui, où l'on brûlait ces innocentes, au Moyen-Âge. De là à prétendre que faire un bon vin n'est pas sorcier... L.M.
silence couvre tous les excès réitérés ad nauseam. (Si les poissons hurlaient au bout de l'hameçon, et si le riesling sucré à souhait gueulait lorsqu'on le verse, il en irait autrement dans les cours d'eau, les océans, les mers, et les coteaux pentus d'Alsace, et d'ailleurs...). Soit, ce riesling : une pure merveille, droite, minérale un peu, acide - non, douce : le strict nécessaire, ce minimum syndical sans lequel nous serions dans un manque culturel, voisin de l'habitus bourdélien (et ça, ça en jette gratos, je le sais). Soit un truc incontrôlable, ne cherchez pas. Et puis alors, je vais vous dire, je ne me suis pas renseigné sur le millésime, ni sur l'élaboration du résultat offert dans ce flacon. Parfois, il est juste et bon de se limiter stricto sensu au verre, là, devant. Face à nos yeux, puis à nos narines, et enfin un peu à nos papilles de la nation. Il convient d'agir ainsi, en essayant de nous débarrasser de toute culture, de tout référent. Bien sûr, c'est difficile. L'effet de surprise joue en faveur. Ce riesling-là, mes amis, en escorte d'une épaisse sole meunière maison, juste beurrée et citronnée (avec du poivre blanc et sans sel), est aussi singulier que le gewurztraminer, Les Sorcières (2011) de la même maison avec une grappe de muscat, oui, et puis un Nuts. Na. Pureté et sincérité sont encore au garde à vous décontracté, l'air de ne pas y toucher. Comme si c'était comme ça et pas autrement qu'il fallait toujours faire. Et c'est précisément ce dont on rêve, s'agissant de vins alsaciens : notez que D&I est une maison d'envergure, que la cave de Pfaffenheim dépasse insolemment les dimensions de la votre, qu'il ne s'agit pas d'un vigneron indépendant et paysan qui répugne à décrocher lorsque le Crédit Agricole lui téléphone. Et que, malgré tout, ça fonctionne plutôt bien. Le riesling possède ce fruité idéal, délicat, qui n'inonde pas le palais mais vous laisse à l'aise avec votre propre liberté. Et le gewurztraminer a le tact, l'intelligence de ne pas vous la jouer tsunami de flaveurs convenues et reconnaissables à cent kilomètres. Les Sorcières est en référence à l'emplacement, planté en vignes aujourd'hui, où l'on brûlait ces innocentes, au Moyen-Âge. De là à prétendre que faire un bon vin n'est pas sorcier... L.M.
Alliances :
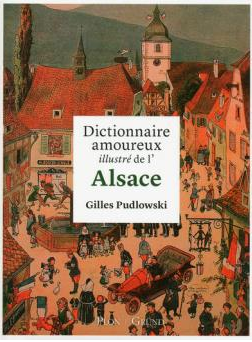 Lire, cela s'impose, la version illustrée du Dictionnaire amoureux de l'Alsace, de Gilles Pudlowski, qui parait chez Gründ (en coédition avec Plon, éditeur originel). L'auteur, Lorrain de naissance et Alsacien de coeur, est un spécialiste réputé, chantre dévot de la Pudloland. Aussi gourmand que littéraire (les deux mamelles de Pudlo), abondamment illustré, c'est un livre intime, intimiste, délicat, cultivé, subtil, et riche d'anecdotes.
Lire, cela s'impose, la version illustrée du Dictionnaire amoureux de l'Alsace, de Gilles Pudlowski, qui parait chez Gründ (en coédition avec Plon, éditeur originel). L'auteur, Lorrain de naissance et Alsacien de coeur, est un spécialiste réputé, chantre dévot de la Pudloland. Aussi gourmand que littéraire (les deux mamelles de Pudlo), abondamment illustré, c'est un livre intime, intimiste, délicat, cultivé, subtil, et riche d'anecdotes.
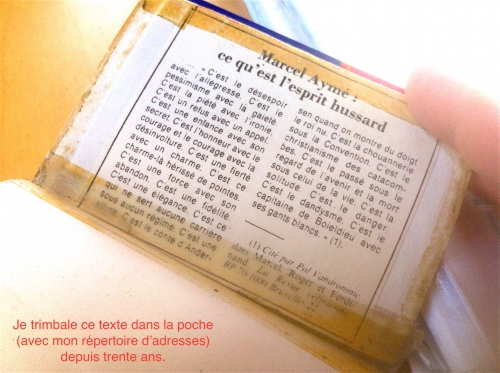 « C’est le désespoir avec l’allégresse. C’est le pessimisme avec la gaité. C’est la piété avec l’ironie. C’est un refus avec un appel. C’est une enfance avec son secret. C’est l’honneur avec le courage et le courage avec la désinvolture. C’est une fierté avec un charme. C’est ce charme-là hérissé de pointes. C’est une force avec son abandon. C’est une fidélité. C’est une élégance. C’est ce qui ne sert aucune carrière sous aucun régime. C’est une allure. C’est le conte d’Andersen quand on montre du doigt le roi nu. C’est la chouannerie sous la Convention. C’est le christianisme des catacombes. C’est le passé sous le regard de l’avenir et la mort sous celui de la vie. C’est la solitude. C’est le danger. C’est le dandysme. C’est le capitaine de Boieldieu avec ses gants blancs. » Marcel Aymé
« C’est le désespoir avec l’allégresse. C’est le pessimisme avec la gaité. C’est la piété avec l’ironie. C’est un refus avec un appel. C’est une enfance avec son secret. C’est l’honneur avec le courage et le courage avec la désinvolture. C’est une fierté avec un charme. C’est ce charme-là hérissé de pointes. C’est une force avec son abandon. C’est une fidélité. C’est une élégance. C’est ce qui ne sert aucune carrière sous aucun régime. C’est une allure. C’est le conte d’Andersen quand on montre du doigt le roi nu. C’est la chouannerie sous la Convention. C’est le christianisme des catacombes. C’est le passé sous le regard de l’avenir et la mort sous celui de la vie. C’est la solitude. C’est le danger. C’est le dandysme. C’est le capitaine de Boieldieu avec ses gants blancs. » Marcel Aymé
 On se croit curieux, et nous passons à côté de choses, comme ça, qui sont de petits cadeaux mieux dissimulés que des oeufs de Pâques dans le jardin de notre enfance. Je viens de découvrir (à la faveur d'un message amical et bienveillant), un écho écrit à une émission de radio (cliquez ci-dessous), et je remercie au passage Philippe Vallet, fort tard certes, mais vieux motard que j'aimais, n'est-ce pas. Il s'agit de mon premier roman, écrit à l'âge de 23 ans, soit il y a (putain!..) 35 ans... Purée... Outch, la gifle. Envie donc de partager, car c'est de saison : l'arrière-automne, le givre, les parfums capiteux de sous-bois, la migration qui strie le ciel bellement, l'écharpe diaphane du brouillard de l'aube, tout ça qui fait le sel de l'existence, pour peu que nous la voulions, ou voudrions toujours là, parmi ces plaisirs simples, et surtout naturels, sans aucun artifice. Jamais...
On se croit curieux, et nous passons à côté de choses, comme ça, qui sont de petits cadeaux mieux dissimulés que des oeufs de Pâques dans le jardin de notre enfance. Je viens de découvrir (à la faveur d'un message amical et bienveillant), un écho écrit à une émission de radio (cliquez ci-dessous), et je remercie au passage Philippe Vallet, fort tard certes, mais vieux motard que j'aimais, n'est-ce pas. Il s'agit de mon premier roman, écrit à l'âge de 23 ans, soit il y a (putain!..) 35 ans... Purée... Outch, la gifle. Envie donc de partager, car c'est de saison : l'arrière-automne, le givre, les parfums capiteux de sous-bois, la migration qui strie le ciel bellement, l'écharpe diaphane du brouillard de l'aube, tout ça qui fait le sel de l'existence, pour peu que nous la voulions, ou voudrions toujours là, parmi ces plaisirs simples, et surtout naturels, sans aucun artifice. Jamais...
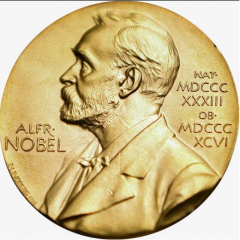 J'aime écouter Bob Dylan depuis toujours, et je suis contre tous les amalgames. Aussi...
J'aime écouter Bob Dylan depuis toujours, et je suis contre tous les amalgames. Aussi...
L’académie Nobel a beau être la mesure étalon - supposée - de l’excellence planétaire, je n’ai jamais accordé trop de crédit à ses choix pour la littérature, car d'abord qui sont ces jurés? Et pourquoi leur vote dans le plus grand huis-clos, leur sanction, seraient-ils le reflet du goût mondial, au même titre qu'un Traité devrait toujours avoir, de facto, une autorité supranationale (soit sur toute Loi), ou qu'un 99/100 attribué il y a peu encore par Robert Parker (surnommé Bob, d'ailleurs), le gourou effrayant de la planète vins, devrait de façon dictatoriale élire le meilleur... La première question est : je me fie ou je me méfie. La seconde : chacun mes goûts n'est-il qu'un indigent jeu de mots?
Les académiciens scandinaves ont, de surcroît, toujours oscillé entre une valeur sûre et convenue, archi reconnue et traduite partout, et une sombre poétesse inconnue, sauf de ses voisins, à peine publiée et timidement traduite. Là, il semblerait qu’ils souhaitent s’offrir une cure de jouvence, se la jouer djeun’s, au point d'en oublier l'objet livre : et allez, tiens, on explose les cadres… Sauf que ça redéfinit, eu égard à leur incontestable aura, de façon indirecte, induite, inexorable, les définitions de l’écrivain, de l’œuvre, de l’exigence, du travail considérable - et même de la littérature. Gide, Kipling, Camus, Kawabata, Beckett, Garcia Marquez, Simon, Naipaul, Mann, Mauriac, Grass, Faulkner, Hemingway, Bergson... n’ont rien à voir avec un chanteur, poète certes, mais dont les vers (je les ai relus avant-hier), n’ont pas - me dis-je -, la teneur de ceux d’un Saint John Perse, ni la profondeur de ceux d’un Milosz, ou la portée des poèmes d’un Pasternak, la sensibilité inouïe des textes d’un Paz, la puissance de l'oeuvre d’un Séféris, l’émotion amoureuse des chants d’un Neruda, la tendresse forte des élégies d’un Elytis, la rigueur et la rugosité des poèmes essentiels d’un Heaney, la fragilité infinie des paquets de peau crue d’un Yeats, ni même la légèreté écorchée vive d’un Maeterlinck…
Ou bien alors, signe des temps, le nivellement par le bas enfante une médiocratisation généralisée qui fait norme ; nouvelle norme. Pour rire, je me disais alors que Francis Lalanne pourrait figurer sur la liste des Goncourt (un autre Francis - Cabrel, en ferait une jaunisse), que Keith Richards pourrait prétendre au Nobel de médecine (la blague circule sur la Toile depuis un jour), que Nadine Morano pouvait être propulsée ministre de la culture, puisque les Américains risquent d’avoir Trump pour président, et que nous avons la France de Cyril Hanouna en guise de punition à nos laxismes cathodiques.
Alors, je ne crains pas de paraître ringard, « old school », antimoderne, ce que l’on voudra, car je me sens juste viscéralement attaché à une qualité d’écriture, à la « distinction », à l’exigence, à la magie du mot, du verbe, de la phrase, à ce qui fait sens, œuvre, voire intemporalité. A une certaine idée de la littérature. Que tout cela a un... prix, mais pas forcément étalonné, et aux contours de récompense. Que ça doit vraiment avoir de la gueule, de l'épaisseur, de la teneur, du fond et de la forme réunis. Et parce que j'aime démesurément la littérature, le plaisir du texte, l'objet livre, l'oeuvre en cours, l'obsession du work in progress, je m'interroge sur une certaine dissolution qui m'apparaît périlleuse. A force de mélanger les genres (ni art majeur, ni art mineur, entends-je), de dissoudre et donc de prêter à confusion, on ne reconnaît plus grand chose, et le magma sans cadre ni repères ne me dit rien qui vaille, durablement, car si je ne peux plus nommer, singulariser, désuniformiser... j'amalgame tout et mon jugement se brouille.
Je ne pense donc pas que Bob Dylan soit dans cette zone d'exigence-là. J'aime l'écouter depuis toujours, avec son timbre, sa verve, sa hargne des débuts, depuis Blowin'... le recours à l'harmonica, le Vietnam, Joan Baez, tout, mais je n'aime donc guère confondre les choses, je le répète volontairement, considérant que cela n'est jamais salutaire. En tous cas, Dylan m'apparaît moins essentiel qu'un Leonard Cohen; par exemple. Et si les Suédois du Nobel entendaient envoyer un signal (politique) fort – car ils savent faire, à l’occasion -, à l’Amérique des « trumpistes », ils se sont trompé de champion… Le donner à titre posthume - tant qu'à innover! -, à Jim Harrison, eut été un vrai geste. Ou bien l'attribuer, logiquement et sans surprise, au grand Philip Roth bien sûr. Mais il en a été décidé autrement.
Dès lors, les prochains Nobel de littérature pèseront moins qu'une plume sur mon sentiment. La dévalorisation de ce nom m'est vertigineuse, depuis jeudi. Et je pense tout à trac, tendrement à Bob Lobo Antunes, à Bob Adonis, et aussi à Bob Kundera...
Léon Mazzella.
P.S. : une ambiance délétère, opérant par capillarité, est résolument culturophobe. Et oublieuse. Volontairement partisane de l'amnésie. Dans le déni de ce terreau, comme le nommait Julien Gracq, sans lequel toute littérature du présent ne saurait pousser. Autrement dit, privé de quoi, l'éphémère n'est qu'inconsistance; condamné à faner.
 Son blog, Di(s)vin! est subtil, délicat, connaisseur, c'est le blog d'un amateur - au sens dix-huitiémiste du terme. Jean-Noël Rieffel m'a interviewé au sujet des vins et des livres. Voici la première partie de ses produits d'entretien :
Son blog, Di(s)vin! est subtil, délicat, connaisseur, c'est le blog d'un amateur - au sens dix-huitiémiste du terme. Jean-Noël Rieffel m'a interviewé au sujet des vins et des livres. Voici la première partie de ses produits d'entretien :
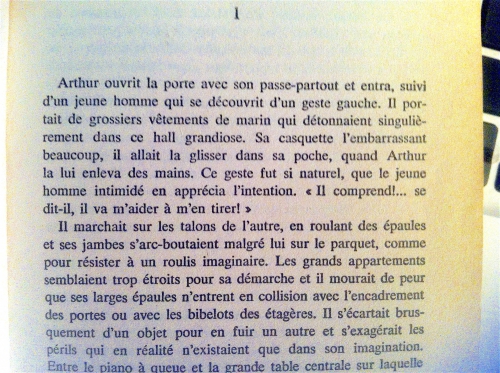
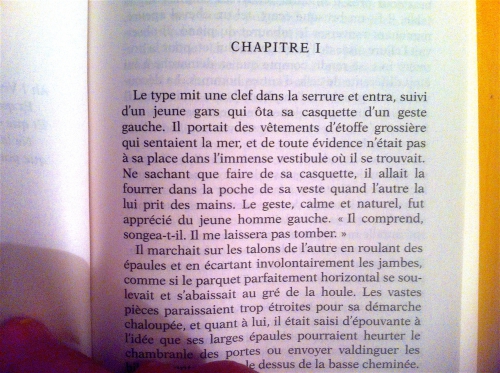
Les anniversaires et les commémorations sont une aubaine pour les traducteurs, car de nouvelles versions fleurissent alors, qui sont présentées comme révolutionnaires par leurs éditeurs - ces nouveaux artistes du marketing qui en oublient parfois que la littérature est d'abord affaire de sensibilité. Ainsi, au hasard, de Jack London, dont on fête le centenaire de la mort (22 novembre 1916). Je tiens là, la nouvelle traduction de son chef d'oeuvre, à mes yeux : Martin Eden, l'autobiographie qui permet de comprendre tout son oeuvre. Elle est signée (et préfacée) de et par Philippe Jaworski, et elle est disponible en folio. J'ai comparé, comme chaque fois que ce genre d'occasion se présente, avec la traduction de Claude Cendrée (10/18, qui a plus de quarante ans, et qui est ornée d'une superbe préface de Francis Lacassin). Les deux premières photos jointes sont celles de l'incipit et des phrases suivantes. Celle qui commence par Arthur est de Cendrée. Je vous laisse juger. Personnellement, je trouve l'ancienne plus littéraire, elle m'emporte davantage et m'engage illico dans le livre du grand London. L'autre me semble opportuniste, comme si elle voulait faire djeuns. Vous avez le choix. L'essentiel est de relire J.L. Construire un feu, et - pour les gamins, de les faire rêver à bloc en leur lisant le soir, et du mieux que l'on peut, L'Appel de la forêt, Croc-Blanc et autres bijoux empreints de nature sauvage...
vous laisse juger. Personnellement, je trouve l'ancienne plus littéraire, elle m'emporte davantage et m'engage illico dans le livre du grand London. L'autre me semble opportuniste, comme si elle voulait faire djeuns. Vous avez le choix. L'essentiel est de relire J.L. Construire un feu, et - pour les gamins, de les faire rêver à bloc en leur lisant le soir, et du mieux que l'on peut, L'Appel de la forêt, Croc-Blanc et autres bijoux empreints de nature sauvage...
Alors, est-il bien nécessaire de re-traduire? Parfois, c'est indispensable, parfois on pourrait s'en passer. C'est selon. Pour Dostoïevsky (reloaded par Actes Sud), on pouvait s'en passer. Pour Conrad (décapé par Autrement), c'était salutaire. Pour Le vieil homme et la mer, on brûle d'impatience de voir cette foutue traduction de Jean Dutourd, la seule autorisée en Français, naze à pleurer, passer à la trappe lorsque Papa Hem' entrera dans le Domaine public!.. Oui, c'est selon, et même au cas par cas. L.M.
Alliances :
 Que boire avec ça? Chemin de Moscou, du domaine Gayda, (Pays d'Oc, 2013, en magnum), d'une grande finesse, sous ses allures bourrues. Ca va bien avec le bourguignon de joue que je viens d'éteindre et qui mijotait depuis trois ou quatre heures... ¡Me alegro!
Que boire avec ça? Chemin de Moscou, du domaine Gayda, (Pays d'Oc, 2013, en magnum), d'une grande finesse, sous ses allures bourrues. Ca va bien avec le bourguignon de joue que je viens d'éteindre et qui mijotait depuis trois ou quatre heures... ¡Me alegro!
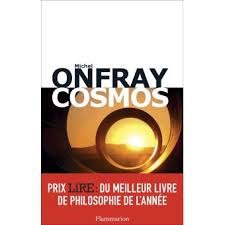 ... Cela devient jouissif. Je rentrais du marché de Bayonne, cet après-midi, il était 15h environ, et j'avais déjeuné d'un pied de cochon anthologique avec des frites a gusto au bord de la Nive, malgré le soleil qui, en terrasse, me cramait le crâne, et tout en lisant Faites les Fêtes, de Francis Marmande (éd. Lignes). Je me dirigeais vers la plage de La Chambre d'Amour, afin d'aller me fracasser le corps tout entier comme j'aime le faire, les pieds plantés dans le gravier, jambes écartées, ou bien (mieux) en plongeant à la dernière seconde à ras le ras du ras, dans les vagues de la marée presque haute (ici, on appelle ça le shore-break, et ça se prononce d'un seul coup comme ça : chorbrek. Rien à voir avec la chorba), lorsque France Culture, dans la voiture, m'interpella. C'était Michel Onfray qui parlait du vin de champagne - et autres vins de saint-émilion, sauternes, pomerol, ou de modestes languedocs... Avec un savoir bachelardien, une sensibilité cosmique, une tendresse filiale, une connaissance réelle et fine, le philosophe spinozien, nietzschéen, camusien (tout ce que nous détestons, en somme, n'est-ce pas), égrenait des expériences de dégustations, et de rencontres avec des vignerons, qui me subjugua. Aussi, l'émission m'obligea-t-elle plaisamment à me garer au bord de l'Adour, juste avant La Barre, afin de la savourer yeux mi-clos, oreilles grand large. Elle dure 1h30, cette émission, et j'en ai rattrapé pour vous le podcast. Mais c'est passionnant à partir de la 18ème minute (pour les pressés), et jusqu'à la fin. Car, même l'épilogue est délicieux comme une mignardise, ou bien comme un tout petit verre de liquoreux sorti de nulle part, façon botte secrète. Je vous en livre par conséquent le lien, afin qu'il vous lie, à votre tour, à cette parole souple et solaire, assemblée et rassemblante, enivrante et juste, je crois. C'est du grand art verbal, soutenu par une culture immense et sans faille apparente (*). Soit, pour qui aime les vins, un pur moment de dégustation philosophique précieux comme un millésime de grande garde à boire ce soir même. Cliquez, amis hédonistes : Onfray et le vin Première ligne : Les formes liquides du temps
... Cela devient jouissif. Je rentrais du marché de Bayonne, cet après-midi, il était 15h environ, et j'avais déjeuné d'un pied de cochon anthologique avec des frites a gusto au bord de la Nive, malgré le soleil qui, en terrasse, me cramait le crâne, et tout en lisant Faites les Fêtes, de Francis Marmande (éd. Lignes). Je me dirigeais vers la plage de La Chambre d'Amour, afin d'aller me fracasser le corps tout entier comme j'aime le faire, les pieds plantés dans le gravier, jambes écartées, ou bien (mieux) en plongeant à la dernière seconde à ras le ras du ras, dans les vagues de la marée presque haute (ici, on appelle ça le shore-break, et ça se prononce d'un seul coup comme ça : chorbrek. Rien à voir avec la chorba), lorsque France Culture, dans la voiture, m'interpella. C'était Michel Onfray qui parlait du vin de champagne - et autres vins de saint-émilion, sauternes, pomerol, ou de modestes languedocs... Avec un savoir bachelardien, une sensibilité cosmique, une tendresse filiale, une connaissance réelle et fine, le philosophe spinozien, nietzschéen, camusien (tout ce que nous détestons, en somme, n'est-ce pas), égrenait des expériences de dégustations, et de rencontres avec des vignerons, qui me subjugua. Aussi, l'émission m'obligea-t-elle plaisamment à me garer au bord de l'Adour, juste avant La Barre, afin de la savourer yeux mi-clos, oreilles grand large. Elle dure 1h30, cette émission, et j'en ai rattrapé pour vous le podcast. Mais c'est passionnant à partir de la 18ème minute (pour les pressés), et jusqu'à la fin. Car, même l'épilogue est délicieux comme une mignardise, ou bien comme un tout petit verre de liquoreux sorti de nulle part, façon botte secrète. Je vous en livre par conséquent le lien, afin qu'il vous lie, à votre tour, à cette parole souple et solaire, assemblée et rassemblante, enivrante et juste, je crois. C'est du grand art verbal, soutenu par une culture immense et sans faille apparente (*). Soit, pour qui aime les vins, un pur moment de dégustation philosophique précieux comme un millésime de grande garde à boire ce soir même. Cliquez, amis hédonistes : Onfray et le vin Première ligne : Les formes liquides du temps
---
(*) Juste un truc, oh, un détail, il confond l'Etna et le Vésuve à propos du Lachrima Christi, c'est vraiment pas grave!..
Que je remercie pour ce cadeau surprise :

Gabriela Manzoni signe chez Séguier Comics retournés (lire, ici, à la date du 21 juin dernier).
 Chaque été, je relis L'Eté, d'Albert Camus (folio 2€). C'est mécanique. C'est un besoin, mental autant que physique. Comme celui d'Afrique, de brousse, à chaque mois de mars, durant nombre d'années... Le Minotaure ou la halte d'Oran, Les amandiers, Prométhée aux Enfers, Petit guide pour des villes sans passé, L'exil d'Hélène, L'énigme, Retour à Tipasa, La mer au plus près (Journal de bord)... Chacun de ces petits bijoux, des récits solaires au lyrisme sec, brefs, essentiels, et hors du temps, sensuels et poétiques, me font aimer Camus encore davantage. Chaque été je relis L'Eté, et je l'offre, aussi. Il est arrivé que l'on me dise : Mais, Léon... Tu me l'as déjà offert! Tu ne t'en souviens pas?.. C'est une partie du magnifique recueil intitulé Noces (suivi de L'Eté). J'y retourne comme on ouvre les volets d'une maison de vacances avec un pincement de honte pour l'avoir négligée plusieurs mois. J'y reconnais chaque texte, que j'ai l'impression de saluer en arrivant, vêtu de ce plaisir singulier de taper l'oreiller avant d'y caler la tête pour la première partie de la nuit... Relire Camus, c'est - aussi - physique. Allez... Les deux premières phrases, et puis la dernière :
Chaque été, je relis L'Eté, d'Albert Camus (folio 2€). C'est mécanique. C'est un besoin, mental autant que physique. Comme celui d'Afrique, de brousse, à chaque mois de mars, durant nombre d'années... Le Minotaure ou la halte d'Oran, Les amandiers, Prométhée aux Enfers, Petit guide pour des villes sans passé, L'exil d'Hélène, L'énigme, Retour à Tipasa, La mer au plus près (Journal de bord)... Chacun de ces petits bijoux, des récits solaires au lyrisme sec, brefs, essentiels, et hors du temps, sensuels et poétiques, me font aimer Camus encore davantage. Chaque été je relis L'Eté, et je l'offre, aussi. Il est arrivé que l'on me dise : Mais, Léon... Tu me l'as déjà offert! Tu ne t'en souviens pas?.. C'est une partie du magnifique recueil intitulé Noces (suivi de L'Eté). J'y retourne comme on ouvre les volets d'une maison de vacances avec un pincement de honte pour l'avoir négligée plusieurs mois. J'y reconnais chaque texte, que j'ai l'impression de saluer en arrivant, vêtu de ce plaisir singulier de taper l'oreiller avant d'y caler la tête pour la première partie de la nuit... Relire Camus, c'est - aussi - physique. Allez... Les deux premières phrases, et puis la dernière :
Il n'y a plus de déserts. Il n'y a plus d'îles.
J'ai toujours eu l'impression de vivre en haute mer, menacé, au coeur d'un bonheur royal.
Je ne suis pas peu fier de savoir (depuis longtemps déjà), que Elsa Morante a écrit L'Isola di Arturo, le roman de Procida (Prix Strega 1957), à Eldorado, la maison familiale de mes ancêtres armateurs. Ce lieu splendide, sur mon île chérie, fait naturellement partie du parcours littéraire qui chemine le long des lieux phares évoqués dans le livre, et que chacun peut effectuer sans attendre la période de l'attribution du Premio Procida Isola di Arturo Elsa Morante, dont c'est le trentième anniversaire cette année.
Traductions :
1) L'Eldorado, la villa Mazzella di Bosco dove Elsa scrivera
1) L'Eldorado, la villa Mazzella di Bosco où Elsa écrira

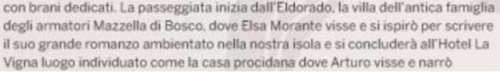
La passeggiata inizia dall'Eldorado, la villa dell'antica famiglia degli armatori Mazzella di Bosco dove Elsa Morante visse et si ispiro per scrivere il suo grande romanzo ambientato della nostra isola...
La promenade commence par Eldorado, la villa de l'ancienne famille d'armateurs Mazzella di Bosco où Elsa Morante vécut et où elle trouva son inspiration pour écrire son grand roman...

Vu de Il Giardino di Elsa, un verger de citronniers qui s'achève sur une splendide terrasse en balcon au-dessus de la plage de Chiaia, avec la Corricella à gauche, la Punta Pizzaco à droite, et Capri au loin...
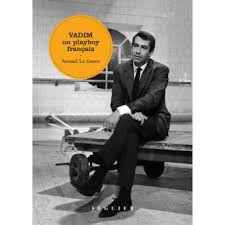 Une autre époque. L'insouciance, les fiestas chaque soir, les épaules bronzées et salées - ce liseré blanc qu'on aime baiser, une main empaumant un sein, l'autre tenant un verre. Les - très - jolies filles, le cinéma perpétuel, un cinoche à trente-six dimensions, king size comme les lits de bonne fortune où tombaient les nombreuses maîtresses, toutes plus sexy les unes que les autres, et qu'occupait un playboy nommé Vadim. Roger Vadim. Arnaud Le Guern, qui signa un Paul Gégauff mémorable, a l'âme damnée par ces années de plume et d'alcools, qui précédèrent d'autres, de plomb et de vinaigre. On le comprend. Et nous partageons son amour hussard des plages, des films, des chemises de lin blanc, de la délicieuse superficialité de certaines poupées en bikini. Nous suivons l'auteur page à page - il n'a pas besoin de nous prendre par la manche, et nous plongeons dans une sacrée époque, imbibée de plaisir comme un baba de rhum. Une époque où la désinvolture le disputait à la nonchalance, mais au sein de laquelle des talents légers et délicats comme des papillons, et doués pour le culte de la beauté et rien qu'elle, surnageaient, à l'instar d'un glaçon pris par le Spritz. Vadim en fut. Un tombeur, ce doué-là. Un mec à rendre jaloux la moitié de la planète. Ce qu'il parvint à faire sans lever le petit doigt. Et un sacré oeil qui savait déceler l'actrice sous la peau de la femme, ou bien la fabriquait le temps d'un film. Qu'est-ce alors que le temps, le succès, sinon des sorbets au soleil. L'évanescence est une danse, la vie de la soie, l'émotion une fumée. La biographie buissonnière d'Arnaud Le Guern zigzague, pétille. Plop! le champagne glougloute ici et là, elle bifurque aussi, car elle s'est nourrie d'anecdotes et de citations. Un vrai bonheur est celui de tourner les pages de Vadim, un
Une autre époque. L'insouciance, les fiestas chaque soir, les épaules bronzées et salées - ce liseré blanc qu'on aime baiser, une main empaumant un sein, l'autre tenant un verre. Les - très - jolies filles, le cinéma perpétuel, un cinoche à trente-six dimensions, king size comme les lits de bonne fortune où tombaient les nombreuses maîtresses, toutes plus sexy les unes que les autres, et qu'occupait un playboy nommé Vadim. Roger Vadim. Arnaud Le Guern, qui signa un Paul Gégauff mémorable, a l'âme damnée par ces années de plume et d'alcools, qui précédèrent d'autres, de plomb et de vinaigre. On le comprend. Et nous partageons son amour hussard des plages, des films, des chemises de lin blanc, de la délicieuse superficialité de certaines poupées en bikini. Nous suivons l'auteur page à page - il n'a pas besoin de nous prendre par la manche, et nous plongeons dans une sacrée époque, imbibée de plaisir comme un baba de rhum. Une époque où la désinvolture le disputait à la nonchalance, mais au sein de laquelle des talents légers et délicats comme des papillons, et doués pour le culte de la beauté et rien qu'elle, surnageaient, à l'instar d'un glaçon pris par le Spritz. Vadim en fut. Un tombeur, ce doué-là. Un mec à rendre jaloux la moitié de la planète. Ce qu'il parvint à faire sans lever le petit doigt. Et un sacré oeil qui savait déceler l'actrice sous la peau de la femme, ou bien la fabriquait le temps d'un film. Qu'est-ce alors que le temps, le succès, sinon des sorbets au soleil. L'évanescence est une danse, la vie de la soie, l'émotion une fumée. La biographie buissonnière d'Arnaud Le Guern zigzague, pétille. Plop! le champagne glougloute ici et là, elle bifurque aussi, car elle s'est nourrie d'anecdotes et de citations. Un vrai bonheur est celui de tourner les pages de Vadim, un payboy français (Séguier), de suivre cet ange affamé (titre de son autobiographie), de film en film, et de femme en femme (B.B., Jane Fonda, Catherine Deneuve, Maria et Catherine Schneider, Sylvia Kristel, Marie-Christine Barrault in fine, parmi tant d'autres créatures de Dieu. Mille e tre!). Les seventies furent placées sous le signe de la séduction comme les quatre-vingt dix le furent sous celui de la réussite aux dents longues. Elles avaient une autre classe. La bande à Vadim comptait de sacrés fêtards au génie singulier : Maurice Ronet, Paul Gégauff, les frères Marquand, Daniel Gélin, entre autres artistes. Et qu'importe si Vadim a signé des films que le 7ème art ne retiendra sans doute pas, même si Tarantino et d'autres s'en sont inspirés. L'homme couvert de femmes aura vécu comme un prince de la légèreté dense. Cela s'appelle le style. Ce n'est pas rien, par les temps mornes qui courent. L.M.
payboy français (Séguier), de suivre cet ange affamé (titre de son autobiographie), de film en film, et de femme en femme (B.B., Jane Fonda, Catherine Deneuve, Maria et Catherine Schneider, Sylvia Kristel, Marie-Christine Barrault in fine, parmi tant d'autres créatures de Dieu. Mille e tre!). Les seventies furent placées sous le signe de la séduction comme les quatre-vingt dix le furent sous celui de la réussite aux dents longues. Elles avaient une autre classe. La bande à Vadim comptait de sacrés fêtards au génie singulier : Maurice Ronet, Paul Gégauff, les frères Marquand, Daniel Gélin, entre autres artistes. Et qu'importe si Vadim a signé des films que le 7ème art ne retiendra sans doute pas, même si Tarantino et d'autres s'en sont inspirés. L'homme couvert de femmes aura vécu comme un prince de la légèreté dense. Cela s'appelle le style. Ce n'est pas rien, par les temps mornes qui courent. L.M.

Le Dictionnaire chic du vin (éd. Ecriture), qui était provisoirement "épuisé", a été réimprimé : il est à nouveau disponible en librairie depuis lundi dernier. Qu'on se le dise au fond des bois-boit!
 Philippe Vilain, romancier (ses livres sont évoqués sur ce blog), et essayiste qui réfléchit à la littérature contemporaine, publie une étude appelée à faire date : La littérature sans idéal (Grasset). L'auteur dresse un constat pessimiste sur la littérature - qu'il a à l'estomac -, la vraie, celle qui a le souci du style (et Vilain est un vrai styliste), qui se moque des désirs mercantiles des éditeurs, lesquels se fondent sur les supposés désirs des lecteurs, ces nouveaux tyrans dénués de réelle culture (littéraire). L’auteur est désenchanté, mais son désenchantement n’est pas le reflet de l’esprit chagrin, ni celui du pessimisme antimoderne, c’est celui qui constate avec amertume une indéniable paupérisation de la production littéraire, la marée montante d’une inculture à l’aise avec son ignorance, l’incapacité à admirer des modèles comme à concevoir un idéal poétique, sinon un idéal d’écriture. Vilain déplore la déliquescence du style, et celle du culte de la beauté de la phrase. Ainsi la littérature déchante-t-elle aussi, et laisse-t-elle place à une production « oralisante », bavarde, sans nécessité, pas écrite du tout, voire « désécrite », précise l’auteur, castrée à force de se conformer à une production commerciale convenue et assimilable par le plus grand nombre, par-delà les continents, mais sans réelle saveur, sans teneur, inconsistante, sans avenir historique. Vilain parle de « soumission » (un terme très utilisé, depuis la parution du roman éponyme de Houellebecq), de cet écrivain-là à la marchandisation de son travail. Nous sommes loin d’une exigence à la Julien Gracq et de la nécessité viscérale d’écrire. Loin, également, de la peinture sociale, de l’étude magistrale des comportements humains par un Balzac, via son œuvre immense. Cette littérature décomplexée, mais somme toute sans qualités, souhaite de surcroît se débarrasser des pères fondateurs : « brûler » Voltaire, « en finir avec » Proust. Pourquoi ? –On se le demande. Seul Céline trouve encore grâce, avec sa novlangue (il n’écrit pas, il « déparle », précise Vilain), aux yeux de ceux qui savent à peine lire. En effet, pourquoi vouloir dissoudre l’exemplarité, l’excellence?.. Serait-ce pour mieux cacher l’indigence ? Ou bien l’excellence fait-elle peur au point que son ombre de mancenillier encombre constamment. « Il n’est pas impossible que la récusation des modèles classiques trahisse une inhibition certaine de l’écrivain contemporain envers son monumental héritage, un sentiment d’écrasement face à ses figures tutélaires, un complexe d’infériorité… », souligne Philippe Vilain (*). Le capital littéraire, la connaissance ne semblent plus indispensables à la fabrique des produits de ce temps maigre, en rupture par ignorance : c'est là le côté révolutionnaire, tendance anarchique, mais teinté d'un nihilisme asthmatique et par défaut, d'une forme de « présentisme ». Le tout assorti du syndrome du « pourquoi pas moi », qui oublie qu’écrire est un métier, comme hôtelier, taxi, ou journaliste (l'uberisation de la société gagne de nouveaux terrains). Spécialiste de l’autofiction, l’auteur décrit en outre, et par le menu, cet investissement subjectif du réel qui réécrit sa mythologie personnelle (l’autofiction) et ses cousines : la biofiction, le docufiction – et leurs travers : l’épuisement sémantique, la défaite du langage, l’éprouvante simplification qui confine au simplisme, le triomphe de l’image, de la scénarisation du roman (la cinécriture), la « selfication des esprits », lance l’auteur, « les dérives d’une époque narcissique, egocentrée, et soucieuse de reconnaissance », ajoute-t-il, avec juste une « ambition récréative », et non plus littéraire, à haute valeur ajoutée. Sans idéal, donc. Ce nivellement par le bas d’un art pris dans le tourbillon d’un marketing planétarisé, a engendré une espèce de « fast writing » sans rigueur, sans substrat, et - pire -, sans fondations. Consolation (restons optimiste et continuons de parier sur la qualité, à l'instar d'une réflexion que nous pouvons mener en parallèle sur la presse écrite imprimée, face à sa jeune dauphine, la presse Web) : il s'agit bien là d'une sous littérature condamnée à la noyade. L.M.
Philippe Vilain, romancier (ses livres sont évoqués sur ce blog), et essayiste qui réfléchit à la littérature contemporaine, publie une étude appelée à faire date : La littérature sans idéal (Grasset). L'auteur dresse un constat pessimiste sur la littérature - qu'il a à l'estomac -, la vraie, celle qui a le souci du style (et Vilain est un vrai styliste), qui se moque des désirs mercantiles des éditeurs, lesquels se fondent sur les supposés désirs des lecteurs, ces nouveaux tyrans dénués de réelle culture (littéraire). L’auteur est désenchanté, mais son désenchantement n’est pas le reflet de l’esprit chagrin, ni celui du pessimisme antimoderne, c’est celui qui constate avec amertume une indéniable paupérisation de la production littéraire, la marée montante d’une inculture à l’aise avec son ignorance, l’incapacité à admirer des modèles comme à concevoir un idéal poétique, sinon un idéal d’écriture. Vilain déplore la déliquescence du style, et celle du culte de la beauté de la phrase. Ainsi la littérature déchante-t-elle aussi, et laisse-t-elle place à une production « oralisante », bavarde, sans nécessité, pas écrite du tout, voire « désécrite », précise l’auteur, castrée à force de se conformer à une production commerciale convenue et assimilable par le plus grand nombre, par-delà les continents, mais sans réelle saveur, sans teneur, inconsistante, sans avenir historique. Vilain parle de « soumission » (un terme très utilisé, depuis la parution du roman éponyme de Houellebecq), de cet écrivain-là à la marchandisation de son travail. Nous sommes loin d’une exigence à la Julien Gracq et de la nécessité viscérale d’écrire. Loin, également, de la peinture sociale, de l’étude magistrale des comportements humains par un Balzac, via son œuvre immense. Cette littérature décomplexée, mais somme toute sans qualités, souhaite de surcroît se débarrasser des pères fondateurs : « brûler » Voltaire, « en finir avec » Proust. Pourquoi ? –On se le demande. Seul Céline trouve encore grâce, avec sa novlangue (il n’écrit pas, il « déparle », précise Vilain), aux yeux de ceux qui savent à peine lire. En effet, pourquoi vouloir dissoudre l’exemplarité, l’excellence?.. Serait-ce pour mieux cacher l’indigence ? Ou bien l’excellence fait-elle peur au point que son ombre de mancenillier encombre constamment. « Il n’est pas impossible que la récusation des modèles classiques trahisse une inhibition certaine de l’écrivain contemporain envers son monumental héritage, un sentiment d’écrasement face à ses figures tutélaires, un complexe d’infériorité… », souligne Philippe Vilain (*). Le capital littéraire, la connaissance ne semblent plus indispensables à la fabrique des produits de ce temps maigre, en rupture par ignorance : c'est là le côté révolutionnaire, tendance anarchique, mais teinté d'un nihilisme asthmatique et par défaut, d'une forme de « présentisme ». Le tout assorti du syndrome du « pourquoi pas moi », qui oublie qu’écrire est un métier, comme hôtelier, taxi, ou journaliste (l'uberisation de la société gagne de nouveaux terrains). Spécialiste de l’autofiction, l’auteur décrit en outre, et par le menu, cet investissement subjectif du réel qui réécrit sa mythologie personnelle (l’autofiction) et ses cousines : la biofiction, le docufiction – et leurs travers : l’épuisement sémantique, la défaite du langage, l’éprouvante simplification qui confine au simplisme, le triomphe de l’image, de la scénarisation du roman (la cinécriture), la « selfication des esprits », lance l’auteur, « les dérives d’une époque narcissique, egocentrée, et soucieuse de reconnaissance », ajoute-t-il, avec juste une « ambition récréative », et non plus littéraire, à haute valeur ajoutée. Sans idéal, donc. Ce nivellement par le bas d’un art pris dans le tourbillon d’un marketing planétarisé, a engendré une espèce de « fast writing » sans rigueur, sans substrat, et - pire -, sans fondations. Consolation (restons optimiste et continuons de parier sur la qualité, à l'instar d'une réflexion que nous pouvons mener en parallèle sur la presse écrite imprimée, face à sa jeune dauphine, la presse Web) : il s'agit bien là d'une sous littérature condamnée à la noyade. L.M.
(*) Et l'on pense alors au fameux vers de Patrice de La Tour du Pin : Tous les pays qui n'ont plus de légendes sont condamnés à mourir de froid.
 Voici un petit livre dont nous suggérons la lecture à tous ceux qui aiment la gastronomie au-delà de l’assiette, qui aiment faire la cuisine, qui font profession de cuisinier, qui affectionnent le discours littéraire sur cette grande passion française, et à tous ceux qui auraient envie de suivre, en tournant les pages, l’itinéraire d’un jeune gourmand passionné. Ca commence à faire du monde... C’est un peu « L’enfance d’un chef cuisinier », ce court texte (une centaine de pages), signé Maylis de Kerangal, à qui nous devons le très émouvant, très beau, très fort « Réparer les vivants » (folio). Un chemin de tables (Seuil, collection « raconter sa vie », ou le roman vrai de la société française), nous conte l’histoire du jeune Mauro, qui n’aimait rien comme cuisiner pour ses potes de collège, puis chez lui. Il se lance très vite dans le métier, connaît mille misères, ne renâcle jamais. Animé d'une réelle passion, tendrement convaincu de posséder un brin de talent, il poursuit son apprentissage dans des brasseries parisiennes, et à Montreuil, puis chez des chefs, et des plus grands, passant des pizzas au fooding, via le classicisme façon tournedos Rossini. Il devient l’icône d’une cuisine fondée sur les deux piliers de l’inventivité et du partage. Ce que nous aimons, c’est d’abord l’écriture juste, précise, imagée et forte de l’auteur. Nous sentons tellement bien le personnage de Mauro, que son portrait, (page 59 et suivantes), devrait être lu, et cité en exemple dans les écoles de journalisme – c’est d’ailleurs ce que je ferai à la rentrée… Il y a aussi un personnage attachant qui grandit au fil des pages : il y a du reportage en immersion dans ce texte, et à travers ce récit, la photographie de notre gastronomie contemporaine se révèle avec, en prime, la description pointue des arcanes d’un milieu. L.M.
Voici un petit livre dont nous suggérons la lecture à tous ceux qui aiment la gastronomie au-delà de l’assiette, qui aiment faire la cuisine, qui font profession de cuisinier, qui affectionnent le discours littéraire sur cette grande passion française, et à tous ceux qui auraient envie de suivre, en tournant les pages, l’itinéraire d’un jeune gourmand passionné. Ca commence à faire du monde... C’est un peu « L’enfance d’un chef cuisinier », ce court texte (une centaine de pages), signé Maylis de Kerangal, à qui nous devons le très émouvant, très beau, très fort « Réparer les vivants » (folio). Un chemin de tables (Seuil, collection « raconter sa vie », ou le roman vrai de la société française), nous conte l’histoire du jeune Mauro, qui n’aimait rien comme cuisiner pour ses potes de collège, puis chez lui. Il se lance très vite dans le métier, connaît mille misères, ne renâcle jamais. Animé d'une réelle passion, tendrement convaincu de posséder un brin de talent, il poursuit son apprentissage dans des brasseries parisiennes, et à Montreuil, puis chez des chefs, et des plus grands, passant des pizzas au fooding, via le classicisme façon tournedos Rossini. Il devient l’icône d’une cuisine fondée sur les deux piliers de l’inventivité et du partage. Ce que nous aimons, c’est d’abord l’écriture juste, précise, imagée et forte de l’auteur. Nous sentons tellement bien le personnage de Mauro, que son portrait, (page 59 et suivantes), devrait être lu, et cité en exemple dans les écoles de journalisme – c’est d’ailleurs ce que je ferai à la rentrée… Il y a aussi un personnage attachant qui grandit au fil des pages : il y a du reportage en immersion dans ce texte, et à travers ce récit, la photographie de notre gastronomie contemporaine se révèle avec, en prime, la description pointue des arcanes d’un milieu. L.M.

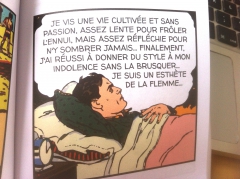



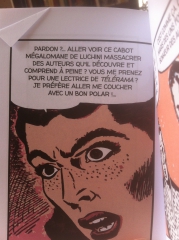 Gabriela Manzoni est habillée d’espièglerie aux tons pastels, ce qui warholise quelque peu les pensées caustiques d’un Cioran, comme : « Le réel me donne de l’asthme », ou celles d’un moraliste à la La Rochefoucauld, qu’elle adjoint à des dessins d’un humour redoutable. Ses Comics retournés, 200 pages de mauvais esprit, et du bon !, qui paraissent chez Séguier, sont un régal d’ironie, de subtilité et de cet esprit français parfois dévastateur. La bien-pensance bobo, le couple et ses méandres marécageux, le mâle et ses certitudes, la femme et son claquant ou ses fadaises, l’air du temps et les lieux communs… Tout est prétexte à l’auteur pour ciseler une formule lapidaire qui donne dans « la radicalité de la nuance », comme on prend de la crème de marrons : à deux doigts sans se retenir. Certaines icônes d’une culture sûre d’elle sont lapidées gentiment, d’autres sont griffées à ongle droit.
Gabriela Manzoni est habillée d’espièglerie aux tons pastels, ce qui warholise quelque peu les pensées caustiques d’un Cioran, comme : « Le réel me donne de l’asthme », ou celles d’un moraliste à la La Rochefoucauld, qu’elle adjoint à des dessins d’un humour redoutable. Ses Comics retournés, 200 pages de mauvais esprit, et du bon !, qui paraissent chez Séguier, sont un régal d’ironie, de subtilité et de cet esprit français parfois dévastateur. La bien-pensance bobo, le couple et ses méandres marécageux, le mâle et ses certitudes, la femme et son claquant ou ses fadaises, l’air du temps et les lieux communs… Tout est prétexte à l’auteur pour ciseler une formule lapidaire qui donne dans « la radicalité de la nuance », comme on prend de la crème de marrons : à deux doigts sans se retenir. Certaines icônes d’une culture sûre d’elle sont lapidées gentiment, d’autres sont griffées à ongle droit.
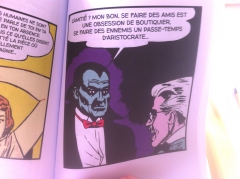 Désinvolte, nonchalante, mutine, libertine, « la » Manzoni y va franco sous le velours – façon panthère noire du trait bien tempéré. Sa lecture du monde contemporain ne manque ni de classe, ni de mélancolie. Au détour d’une page, nous laissons l’idée d’un philosophe désenchanté pour chevaucher en pensée l’esprit d’une sorte de
Désinvolte, nonchalante, mutine, libertine, « la » Manzoni y va franco sous le velours – façon panthère noire du trait bien tempéré. Sa lecture du monde contemporain ne manque ni de classe, ni de mélancolie. Au détour d’une page, nous laissons l’idée d’un philosophe désenchanté pour chevaucher en pensée l’esprit d’une sorte de 
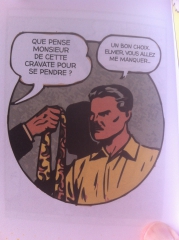

 Montherlant ou celui d’un Drieu. Et ce petit livre de bon goût, à offrir sans modération, est de surcroît très drôle. Gabriela, s’il vous plaît ... Remettez-nous ça... L.M.
Montherlant ou celui d’un Drieu. Et ce petit livre de bon goût, à offrir sans modération, est de surcroît très drôle. Gabriela, s’il vous plaît ... Remettez-nous ça... L.M.
 Une cage allait à la recherche d'un oiseau. Kafka (Journal).
Une cage allait à la recherche d'un oiseau. Kafka (Journal).
Cette phrase me hante depuis sa découverte il y a quarante ans.
De même, la métaphore du fruit appelé physalis (d'un mot grec signifiant vessie), surnommé amour en cage (photo), laisse rêveur.
De là à prendre ce qui fait battre mon coeur pour une lanterne...
Kafka, ce drôle d'oiseau, craignait peut-être la liberté. L.M.
 Michel Onfray : « On devient vraiment majeur en donnant à ceux qui ont lâché les chiens contre nous sans savoir ce qu'ils faisaient le geste de paix nécessaire à une vie par-delà le ressentiment - trop coûteux en énergie gaspillée. La magnanimité est une vertu d'adulte. (...) Serein, sans haine, ignorant le mépris, loin de tout désir de vengeance, indemne de toute rancune, informé sur la formidable puissance des passions tristes, je ne veux que la culture et l'expansion de cette puissance d'exister -selon l'heureuse formule de Spinoza enchâssée comme un diamant dans son Ethique. Seul l'art codifié de cette puissance d'exister guérit des douleurs passées, présentes et à venir. » (La puissance d'exister, Grasset et Livre de Poche).
Michel Onfray : « On devient vraiment majeur en donnant à ceux qui ont lâché les chiens contre nous sans savoir ce qu'ils faisaient le geste de paix nécessaire à une vie par-delà le ressentiment - trop coûteux en énergie gaspillée. La magnanimité est une vertu d'adulte. (...) Serein, sans haine, ignorant le mépris, loin de tout désir de vengeance, indemne de toute rancune, informé sur la formidable puissance des passions tristes, je ne veux que la culture et l'expansion de cette puissance d'exister -selon l'heureuse formule de Spinoza enchâssée comme un diamant dans son Ethique. Seul l'art codifié de cette puissance d'exister guérit des douleurs passées, présentes et à venir. » (La puissance d'exister, Grasset et Livre de Poche).
L'aube. Au Moyen-Âge, cela désigne aussi un genre, ou plutôt une forme littéraire assez singulière : c'est une poésie lyrique qui a pour thème la séparation de deux êtres qui s'aiment au point du jour . Accompagnée d'une mélodie savante, elle comporte trois grands thèmes : séparation des amants à l'aube; chant des oiseaux et lever du soleil, intervention du guetteur qui interdit à tout importun de s'approcher et prévient les amants qu'avec l'aube vient la séparation.
Karl Gottlob Schelle : La bienveillance, la cordialité, la franchise, s'installent dans le coeur qui s'ouvre à la nature; le genre humain, qui cesse de s'agiter dans l'arène des grandes passions telles que l'envie, l'avidité, l'égoïsme, apparaît, dans le miroir de la nature, dans une lumière plus pure. Un homme qui n'est pas dégénéré se sentira oppressé dès qu'il sera resté quelque temps sans voir la nature. (L'Art de se promener).
Proust : Quand on aime, l'amour est trop grand pour pouvoir être contenu tout entier en nous; il irradie vers la personne aimée, rencontre en elle une surface qui l'arrête, le force à revenir vers son point de départ, et c'est ce choc en retour de notre propre tendresse que nous appelons les sentiments de l'autre et qui nous charme plus qu'à l'aller, parce que nous ne reconnaissons pas qu'elle vient de nous. (A l'ombre des jeunes filles en fleur).
Gracq : Tant de mains pour transformer le monde et si peu de regards pour le contempler.

Photo : Maurice Ronet, dans Le Feu follet, de Louis Malle, d'après l'oeuvre de Drieu La Rochelle.
 Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant... D'un monde gouverné par la poésie, d'un système dans lequel le mot politique serait toujours remplacé par le mot poétique, où la poésie serait la règle douce et désirée. Je me répète souvent (ici encore, il y a quelques semaines, et ce depuis qu'un jour de juillet 1977, je découvris sa parole), le mot de Hölderlin (photo) : A quoi bon des poètes en un temps de manque? (Wozu dichter in dürftiger zeit?), persuadé qu'ils ne sont jamais aussi nécessaires qu'en temps de crise, de guerre, de marasme social, de doute sociétal. Quand les mythologies s'effondrent, c'est dans la poésie que trouve refuge le divin, écrivait Saint-John Perse. Baudelaire : Il n'y a de grand parmi les hommes que le poète. Hölderlin, encore, répétait que c'est poétiquement que l'homme habite - ou doit habiter -, le monde. Voilà la parole vraie. S'efforcer naturellement (osons l'oxymore) de voir la beauté sous la peau des choses, de même que nous dev(ri)ons toujours frotter et limer notre cervelle à celle d'autrui, disait Montaigne à propos des voyages (en précurseur de l'ethnologie débarrassée de tout ethnocentrisme). Faire de la poésie un mode de vie, un état d'être au monde de chaque instant. Regarder, ressentir, penser, respirer, aimer, rire, parler poésie. Perse, à nouveau (*) : La poésie est action, elle est passion, elle est puissance (...) L'amour est son foyer, l'insoumission sa loi, et son lieu est partout, dans l'anticipation. A chacun sa foi. Croire en cela ne procure aucune espérance en un quelconque au-delà, mais forge et renforce notre pas sur la terre ferme, pensant, avec Eugenio de Andrade, que la démarche crée le chemin. L.M.
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant... D'un monde gouverné par la poésie, d'un système dans lequel le mot politique serait toujours remplacé par le mot poétique, où la poésie serait la règle douce et désirée. Je me répète souvent (ici encore, il y a quelques semaines, et ce depuis qu'un jour de juillet 1977, je découvris sa parole), le mot de Hölderlin (photo) : A quoi bon des poètes en un temps de manque? (Wozu dichter in dürftiger zeit?), persuadé qu'ils ne sont jamais aussi nécessaires qu'en temps de crise, de guerre, de marasme social, de doute sociétal. Quand les mythologies s'effondrent, c'est dans la poésie que trouve refuge le divin, écrivait Saint-John Perse. Baudelaire : Il n'y a de grand parmi les hommes que le poète. Hölderlin, encore, répétait que c'est poétiquement que l'homme habite - ou doit habiter -, le monde. Voilà la parole vraie. S'efforcer naturellement (osons l'oxymore) de voir la beauté sous la peau des choses, de même que nous dev(ri)ons toujours frotter et limer notre cervelle à celle d'autrui, disait Montaigne à propos des voyages (en précurseur de l'ethnologie débarrassée de tout ethnocentrisme). Faire de la poésie un mode de vie, un état d'être au monde de chaque instant. Regarder, ressentir, penser, respirer, aimer, rire, parler poésie. Perse, à nouveau (*) : La poésie est action, elle est passion, elle est puissance (...) L'amour est son foyer, l'insoumission sa loi, et son lieu est partout, dans l'anticipation. A chacun sa foi. Croire en cela ne procure aucune espérance en un quelconque au-delà, mais forge et renforce notre pas sur la terre ferme, pensant, avec Eugenio de Andrade, que la démarche crée le chemin. L.M.
(*) cité dans Habiter poétiquement le monde, anthologie manifeste présentée par Frédéric Brun, éd. Poesis - un livre pas encore vu/lu, évoqué par Le Figaro littéraire d'hier, et d'où je tire ces deux citations de Perse.
ALLIANCES :
 Ecouter : Cigarettes after sex / Affection (cliquez).
Ecouter : Cigarettes after sex / Affection (cliquez).
 Boire : le champagne de Barfontarc, un brut blanc de noirs de la Côte des Bar 100% pinot noir, donc. C'est miellé, abricoté, framboisé, crémeux, pulpeux, délicatement vivifié par une acidité gentiment surprenante en bouche. Finale exotique (15€ le prix du plaisir, à fiancer -manger!- avec un dos de cabillaud très épais, juteux, à peine pris au four par le haut).
Boire : le champagne de Barfontarc, un brut blanc de noirs de la Côte des Bar 100% pinot noir, donc. C'est miellé, abricoté, framboisé, crémeux, pulpeux, délicatement vivifié par une acidité gentiment surprenante en bouche. Finale exotique (15€ le prix du plaisir, à fiancer -manger!- avec un dos de cabillaud très épais, juteux, à peine pris au four par le haut).
 C'est une petite merveille, ce Brut Premier Cru-là...
C'est une petite merveille, ce Brut Premier Cru-là...
Champagne Dauby (« Mère & Fille »), Blanc de noirs (issu des plus beaux pinot noirs du terroir magnifique de Mutigny, classé Premier Cru) :
Bulle fine, cordon régulier et enjoué, sous une robe jaune, vive, sans reflets clinquants : franche.
Joli nez d’une grande fraîcheur, et « viennois », de pain brioché, quasi « cremoso », avec une touche de pêche blanche, une pointe de myrtille, et puis de mûre, et enfin un zeste caressant de pomelo rose.
Bouche ronde et ample, pleine, avec un léger crayeux (le sol parle !), et juste ce qu’il faut d’agrumes mûrs, soit un citronné presque confit. On y retrouve la viennoiserie délicate, et une finale de framboise encore croquante.
Un champagne gourmand, d’apéritif attentif, et surtout pour accompagner dignement un poisson de rivière en sauce (beurre blanc, crème), ou une volaille justement cuite, encore juteuse.
La famille Dauby, sise à Aÿ, jouit de terroirs exceptionnels et élabore une gamme de champagnes de respect depuis soixante ans. La marque au coquelicot – emblème qui souligne le respect absolu de la nature et de la biodiversité, possède le sens de la recherche d’une certaine authenticité qui laisse parler la terre. C’est « juste » bien fait... (18€!). L.M.
Alliances :
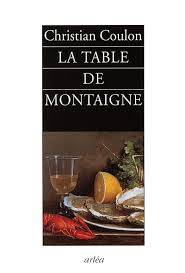 La table de Montaigne, de Christian Coulon (Arléa), car l'auteur (prof émérite à Sciences-Po Bordeaux - nos universités!), révèle un auteur des Essais qui se fiche de la gastronomie comme d'une guigne ou de sa première culotte pour aller chevaucher bride abattue, et plutôt un philosophe gourmand, voire bafreur. Et ce bouquin passionnant se double d'une vraie histoire des moeurs gastronomiques du Sud-Ouest de l'époque... Un régal, pour qui aime la région, Montaigne, et manger généreusement.
La table de Montaigne, de Christian Coulon (Arléa), car l'auteur (prof émérite à Sciences-Po Bordeaux - nos universités!), révèle un auteur des Essais qui se fiche de la gastronomie comme d'une guigne ou de sa première culotte pour aller chevaucher bride abattue, et plutôt un philosophe gourmand, voire bafreur. Et ce bouquin passionnant se double d'une vraie histoire des moeurs gastronomiques du Sud-Ouest de l'époque... Un régal, pour qui aime la région, Montaigne, et manger généreusement.
Ecouter, avec ce duo :
Une compil de bons vieux standards des Pink Floyd.
Et aussi des succès de Peter Gabriel (post Genesis)
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
 Le Dictionnaire chic du vin (éd. Ecriture), paru vers la fin du mois de septembre dernier, est en rupture de stock depuis une belle poignée de semaines (ce qui ne m'a pas empêché de signer un reliquat d'exemplaires glanés ici et là, aux salons du livre de Saumur, du Mans, et de Rue89). Sa réimpression prend du temps, mais elle devient imminente. J'en profite pour remercier ses 3 000 premiers acquéreurs, ainsi que les auteurs des nombreux articles et autres émissions de radio qui en ont fait écho dans leurs colonnes et sur les ondes. Le livre sera donc à nouveau disponible sous peu en librairie, sur simple demande/commande.
Le Dictionnaire chic du vin (éd. Ecriture), paru vers la fin du mois de septembre dernier, est en rupture de stock depuis une belle poignée de semaines (ce qui ne m'a pas empêché de signer un reliquat d'exemplaires glanés ici et là, aux salons du livre de Saumur, du Mans, et de Rue89). Sa réimpression prend du temps, mais elle devient imminente. J'en profite pour remercier ses 3 000 premiers acquéreurs, ainsi que les auteurs des nombreux articles et autres émissions de radio qui en ont fait écho dans leurs colonnes et sur les ondes. Le livre sera donc à nouveau disponible sous peu en librairie, sur simple demande/commande.
 Prestige du Président est un rosé corse de coopérative (l'Union des vignerons de l’île de Beauté, à Aléria), issu de sciaccarellu et d’un peu de syrah. Sa robe est claire, mais dense et brillante. Son nez exprime les fruits rouges vifs et croquants : framboise, fraise des bois, et un léger citronné dépourvu de cette agressivité qui semble être à la mode (et la mode semble être, tous secteurs confondus, à l'agressivité, à l'arrogance, à l'irrespect de... Je m'égare, là). Jolie bouche ample, pleine, fruitée et tendrement épicée, en finale. Très agréable sur un poulpe a la Gallega, servi tiède, avec du pimenton (ou du paprika), et des légumes verts croquants cuits brièvement à la vapeur (pois gourmands, petits pois, brocolis), finis à froid d’un filet d’huile d’olive vierge généreux. C’est, de surcroît, une bouteille belle, lourde, dont la teinte du verre cache la couleur du vin (7,50€). Très Corse, cette façon de dissimuler, d'ourdir, de comploter jusqu'à la couleur du... contenant. J'aime.
Prestige du Président est un rosé corse de coopérative (l'Union des vignerons de l’île de Beauté, à Aléria), issu de sciaccarellu et d’un peu de syrah. Sa robe est claire, mais dense et brillante. Son nez exprime les fruits rouges vifs et croquants : framboise, fraise des bois, et un léger citronné dépourvu de cette agressivité qui semble être à la mode (et la mode semble être, tous secteurs confondus, à l'agressivité, à l'arrogance, à l'irrespect de... Je m'égare, là). Jolie bouche ample, pleine, fruitée et tendrement épicée, en finale. Très agréable sur un poulpe a la Gallega, servi tiède, avec du pimenton (ou du paprika), et des légumes verts croquants cuits brièvement à la vapeur (pois gourmands, petits pois, brocolis), finis à froid d’un filet d’huile d’olive vierge généreux. C’est, de surcroît, une bouteille belle, lourde, dont la teinte du verre cache la couleur du vin (7,50€). Très Corse, cette façon de dissimuler, d'ourdir, de comploter jusqu'à la couleur du... contenant. J'aime.
Lire, avec : Le vin & le sacré, d'Evelyne Malnic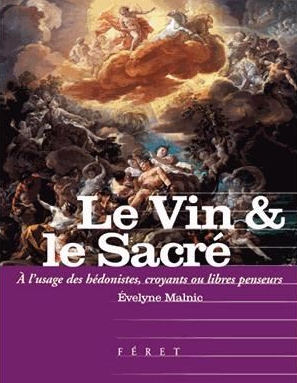 (Féret), un superbe album richement illustré, à l'usage des hédonistes, croyants et libres-penseurs : c'est le sous-titre. Une ferveur commune a toujours associé vin et divin, depuis plus de six mille ans. Le vin est en effet au coeur de la civilisation méditerranéenne. Il est dans la Bible, il imprègne, voire imbibe les textes fondateurs en Mésopotamie, en Egypte, en Grèce bien sûr. La Pâque juive, le paradis d'Allah... Nul n'est épargné, du moins du côté des monothéismes. La trop fameuse métaphore du sang versé (le Graal), l'image classique du sang de la vigne du poète persan (païen et jouisseur, pour le coup, donc hors-sujet!) Omar Khayyâm, le vin est aussi et surtout redevable du cep de vigne que Noé garda serré dans sa main, en montant dans l'Arche. C'est là le cep fondateur! Celui dont les Légions romaines ont semé les fils, partout où elles passaient. Mon Dictionnaire chic du vin (éd. Ecriture) évoque abondamment ces sources fondamentales, ainsi que les figures de Dionysos et de Bacchus, ainsi que le passage du divin au païen. Alors, lisez ce très bel album, dans lequel Evelyne Malnic a tout donné, et sur lequel nous reviendrons ici, prochainement. Rappel : religion signifie ce qui relie (les hommes entre eux). Et quoi de plus reliant que le vin?
(Féret), un superbe album richement illustré, à l'usage des hédonistes, croyants et libres-penseurs : c'est le sous-titre. Une ferveur commune a toujours associé vin et divin, depuis plus de six mille ans. Le vin est en effet au coeur de la civilisation méditerranéenne. Il est dans la Bible, il imprègne, voire imbibe les textes fondateurs en Mésopotamie, en Egypte, en Grèce bien sûr. La Pâque juive, le paradis d'Allah... Nul n'est épargné, du moins du côté des monothéismes. La trop fameuse métaphore du sang versé (le Graal), l'image classique du sang de la vigne du poète persan (païen et jouisseur, pour le coup, donc hors-sujet!) Omar Khayyâm, le vin est aussi et surtout redevable du cep de vigne que Noé garda serré dans sa main, en montant dans l'Arche. C'est là le cep fondateur! Celui dont les Légions romaines ont semé les fils, partout où elles passaient. Mon Dictionnaire chic du vin (éd. Ecriture) évoque abondamment ces sources fondamentales, ainsi que les figures de Dionysos et de Bacchus, ainsi que le passage du divin au païen. Alors, lisez ce très bel album, dans lequel Evelyne Malnic a tout donné, et sur lequel nous reviendrons ici, prochainement. Rappel : religion signifie ce qui relie (les hommes entre eux). Et quoi de plus reliant que le vin?
 Et si Bacchus était une femme. Parenthèse dans ce feuilleton des vins frais de l’été, amorcé ici le 18 avril (lire en faisant défiler les notes), une fois n'est pas coutume, car le vin que j'évoque ci-dessous s'adresse à ceux qui passent à Paris ou bien y vivent, en raison de l'unique adresse où nous pouvons le trouver. Collector, mes amis, collector! Et vintage, tant qu'on y est! Ce vin rare est incontestablement le rosé de l’été parisien. Gourmand, fruité, délicat, ce Provençal étiqueté spécialement par le célèbre domaine Gavoty, dans le Var, pour la cave parisienne « Et si Bacchus était une femme », est un rosé qui ne manque ni de claquant, ni de classe. Issu de cinsault et de grenache, il est idéal pour un déjeuner sur l’herbe dans un jardin parisien, qu’il soit des Plantes, de Vincennes, ou d’Acclimatation, avec des fromages de chèvre, du jambon de Parme, des grissini et une tapenade maison.
Et si Bacchus était une femme. Parenthèse dans ce feuilleton des vins frais de l’été, amorcé ici le 18 avril (lire en faisant défiler les notes), une fois n'est pas coutume, car le vin que j'évoque ci-dessous s'adresse à ceux qui passent à Paris ou bien y vivent, en raison de l'unique adresse où nous pouvons le trouver. Collector, mes amis, collector! Et vintage, tant qu'on y est! Ce vin rare est incontestablement le rosé de l’été parisien. Gourmand, fruité, délicat, ce Provençal étiqueté spécialement par le célèbre domaine Gavoty, dans le Var, pour la cave parisienne « Et si Bacchus était une femme », est un rosé qui ne manque ni de claquant, ni de classe. Issu de cinsault et de grenache, il est idéal pour un déjeuner sur l’herbe dans un jardin parisien, qu’il soit des Plantes, de Vincennes, ou d’Acclimatation, avec des fromages de chèvre, du jambon de Parme, des grissini et une tapenade maison.
Robe pâle et élégante. Nez fruité de groseille, de fraise mûre et de framboise croquante. Bouche ample, généreuse, avec des hanches, et pourvue d’une jolie longueur, à la fois tendre et fraîche. Le vin idoine pour un apéro sur les bords de Seine ou de Marne, depuis les quais se trouvant à l’aplomb de la Très grande bibliothèque, jusqu’à Joinville-le-Pont et au-delà. Ou bien pour un dîner amoureux sur le petit balcon, collés-serrés par la force des choses foncières... Et encore pour une soirée entre copains et copines, à l’appart’, en écoutant le dernier album collectif Autour de Chet (Baker). Le rosé « Et si Bacchus était une femme », c’est la griffe discrète d’un grand de Provence dans un gant de velours. L’alliance de la fête et de la finesse (10€). Et vendu, donc, uniquement à la boutique (coordonnées ci-dessus). Cette cave cosy est à la gloire du vin de vigneronne, et volontiers bio. A noter que la gamme Et si Bacchus était une femme se décline en blanc, en rouge, ainsi qu'en champagne (de vigneronnes, évidemment). L.M.
groseille, de fraise mûre et de framboise croquante. Bouche ample, généreuse, avec des hanches, et pourvue d’une jolie longueur, à la fois tendre et fraîche. Le vin idoine pour un apéro sur les bords de Seine ou de Marne, depuis les quais se trouvant à l’aplomb de la Très grande bibliothèque, jusqu’à Joinville-le-Pont et au-delà. Ou bien pour un dîner amoureux sur le petit balcon, collés-serrés par la force des choses foncières... Et encore pour une soirée entre copains et copines, à l’appart’, en écoutant le dernier album collectif Autour de Chet (Baker). Le rosé « Et si Bacchus était une femme », c’est la griffe discrète d’un grand de Provence dans un gant de velours. L’alliance de la fête et de la finesse (10€). Et vendu, donc, uniquement à la boutique (coordonnées ci-dessus). Cette cave cosy est à la gloire du vin de vigneronne, et volontiers bio. A noter que la gamme Et si Bacchus était une femme se décline en blanc, en rouge, ainsi qu'en champagne (de vigneronnes, évidemment). L.M.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
 Roque Star, côtes de Provence du Moulin de la Roque, au Castellet (Var), est un rosé de caractère. Finesse, élégance, ce vin est pulpeux, authentique, sans aspérité. Grenache, cinsault, mourvèdre sont le trio gagnant : zéro risque. Robe « saumon de l’Adour » soutenue, donc. Nez de fraise mûre, mais encore croquante en son coeur, bouche d’une élégance rare, façon pub parfumée jouée par Charlize Theron – vous saisissez ?.. 5,50€ le flacon, c’est donné. Et ça ira bien sur une pizza della casa à la pancetta, augmentée de pecorino au poivre sicilien, histoire de mettre à l’épreuve le roc de cette star-là.
Roque Star, côtes de Provence du Moulin de la Roque, au Castellet (Var), est un rosé de caractère. Finesse, élégance, ce vin est pulpeux, authentique, sans aspérité. Grenache, cinsault, mourvèdre sont le trio gagnant : zéro risque. Robe « saumon de l’Adour » soutenue, donc. Nez de fraise mûre, mais encore croquante en son coeur, bouche d’une élégance rare, façon pub parfumée jouée par Charlize Theron – vous saisissez ?.. 5,50€ le flacon, c’est donné. Et ça ira bien sur une pizza della casa à la pancetta, augmentée de pecorino au poivre sicilien, histoire de mettre à l’épreuve le roc de cette star-là.
Petit Bourgeois est un sauvignon blanc de Henri Bourgeois, à Chavignol, maison célèbre notamment pour sa gamme de vins de Sancerre. Ce blanc, classé en vin de pays du val de Loire (IGP), possède une grande fraîcheur et une vraie franchise. Le floral et le fruité, typiques du sauvignon, sont bien présents au nez comme en bouche – on sent notamment la fleur de vigne, et une jolie minéralité s’exprime avec tact, en finale. Idéal à l’apéritif pour lui même, puis sur des crustacés (10€ env.).
Chavignol, maison célèbre notamment pour sa gamme de vins de Sancerre. Ce blanc, classé en vin de pays du val de Loire (IGP), possède une grande fraîcheur et une vraie franchise. Le floral et le fruité, typiques du sauvignon, sont bien présents au nez comme en bouche – on sent notamment la fleur de vigne, et une jolie minéralité s’exprime avec tact, en finale. Idéal à l’apéritif pour lui même, puis sur des crustacés (10€ env.).
Gris d’Ardèche. Ce premier « jus de goutte » de  grenache noir du sud du département, classé en Ardèche IGP, et produit par les talentueux Vignerons Ardéchois – une cave de respect -, naît sur des sols rocailleux. Sa robe « melon », détonne tant elle est sombre, pour un gris. Joli nez équilibré d’agrumes et de pêche. C’est vif, et même tonique, en fin de bouche, et cela escorte élégamment une grillade d’agneau au thym, ou des boulettes de boeuf mêlées de coriandre. Chapeau pour l'habillage, très classe -Vous ne trouvez pas? (5,50€).
grenache noir du sud du département, classé en Ardèche IGP, et produit par les talentueux Vignerons Ardéchois – une cave de respect -, naît sur des sols rocailleux. Sa robe « melon », détonne tant elle est sombre, pour un gris. Joli nez équilibré d’agrumes et de pêche. C’est vif, et même tonique, en fin de bouche, et cela escorte élégamment une grillade d’agneau au thym, ou des boulettes de boeuf mêlées de coriandre. Chapeau pour l'habillage, très classe -Vous ne trouvez pas? (5,50€).
Le château Tour de Mirambeau (famille Despagne), bordeaux rosé réserve, est aussi vif que floral, et son fruité léger en fait un vin idéal pour l’apéritif sous la tonnelle, en grignotant des olives huilées et aux herbes, et des grissini entourés d’une chiffonnade de jambon de Parme. « Vin produit dans le respect de l’environnement pour une viticulture durable », lit-on sur l'étiquette. C’est de bon augure, à Bordeaux… (9€).
rosé réserve, est aussi vif que floral, et son fruité léger en fait un vin idéal pour l’apéritif sous la tonnelle, en grignotant des olives huilées et aux herbes, et des grissini entourés d’une chiffonnade de jambon de Parme. « Vin produit dans le respect de l’environnement pour une viticulture durable », lit-on sur l'étiquette. C’est de bon augure, à Bordeaux… (9€).
 Alliances : les livres de Simonetta Greggio, et prenez donc les derniers parus : Femmes de rêve, bananes et framboises (Flammarion), un recueil de nouvelles qui disent l'amour avec l'acuité redoutable du regard de Simo, doublée comme d'hab' d'un sens incroyablement profond pour dire les sentiments, soit avec une précision chirurgicale, toujours mâtinée de poésie - l'écriture féminine vous a un tact pour écraser d'un coup de talon ce qu'elle veut!.. Car, avec Simonetta, c'est toujours faussement léger, et finalement vertigineux.
Alliances : les livres de Simonetta Greggio, et prenez donc les derniers parus : Femmes de rêve, bananes et framboises (Flammarion), un recueil de nouvelles qui disent l'amour avec l'acuité redoutable du regard de Simo, doublée comme d'hab' d'un sens incroyablement profond pour dire les sentiments, soit avec une précision chirurgicale, toujours mâtinée de poésie - l'écriture féminine vous a un tact pour écraser d'un coup de talon ce qu'elle veut!.. Car, avec Simonetta, c'est toujours faussement léger, et finalement vertigineux.
Et aussi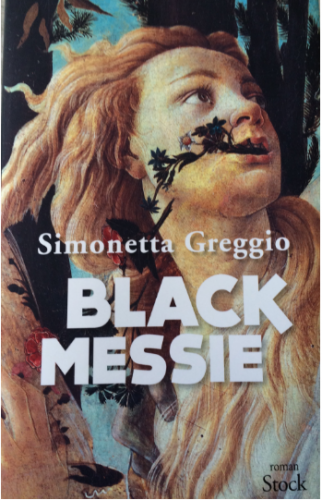 Black Messie, son dernier roman (Stock), qui paraît la semaine prochaine, car c'est une sorte de polar (elle ne nous avait pas encore habitué à cela), ou plutôt un vrai roman noir, qui nous invite à suivre un serial-killer, le Monstre de Florence, qui dézingua nombre de couples lorsqu'ils faisaient l'amour, entre 1968 et 1985, et ça n'est pas piqué des hannetons... Un flic de légende, façon Adamsberg (pour les lecteurs de Vargas), Jacopo d'Orto, mène l'enquête, et le lecteur est embarqué illico presto pour six (pieds sous) terre! J'en parlerai plus tard -ici- davantage, lorsque je l'aurai achevé (je n'en suis qu'au début).
Black Messie, son dernier roman (Stock), qui paraît la semaine prochaine, car c'est une sorte de polar (elle ne nous avait pas encore habitué à cela), ou plutôt un vrai roman noir, qui nous invite à suivre un serial-killer, le Monstre de Florence, qui dézingua nombre de couples lorsqu'ils faisaient l'amour, entre 1968 et 1985, et ça n'est pas piqué des hannetons... Un flic de légende, façon Adamsberg (pour les lecteurs de Vargas), Jacopo d'Orto, mène l'enquête, et le lecteur est embarqué illico presto pour six (pieds sous) terre! J'en parlerai plus tard -ici- davantage, lorsque je l'aurai achevé (je n'en suis qu'au début).
Et en écoutant quoi? Du light, histoire de faire contrepoint à cette trame romanesque, glaçante par endroits : Izzy Bizy, Elodie Frege, les Brigitte, Ariana Grande Feat & Lil Wayne (dans Let me love you, notamment)... Des voix fluettes de femmes dotées d'un sacré caractère. Et d'un sourire dévastateur. Et allez!
Cliquez :
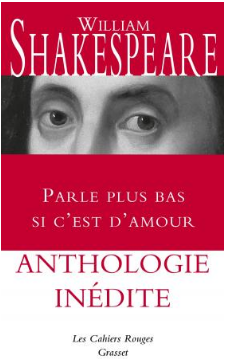 Il y a des parfums shakespeariens dans l'atmosphère. Qui s'en plaindrait! Hier soir, Arte redonnait Beaucoup de bruit pour rien, du fougueux (et egocentrique) Kenneth Branagh - avec la superbe Emma Thompson, entre autres (le casting est de rêve) : la joie, la jeunesse, la beauté, l'audace, l'honneur, la frivolité et la turbulence des sentiments, la jalousie, la vengeance, l'amour, la délicatesse, la force... C'est d'ailleurs de cette pièce que la phrase reprise en titre de cette note est extraite. Et c'est le titre que Grasset (Les Cahiers Rouges) propose pour une petite anthologie délicieuse, en forme de dictionnaire d'à peine 130 pages, des citations du grand Will, dispersées dans ses quarante pièces et ses cent quarante-quatre sonnets. D'Ambition à Vieillesse, nous musardons et retrouvons avec un air satisfait Nous sommes de l'étoffe dont sont faits les rêves (Prospero, dans La Tempête), Un cheval! Un cheval! Mon royaume pour un cheval! (Richard III), et sans aller jusqu'à chercher To be..., nous tombons sur des perles, comme L'oiseau de l'aube chante toute la nuit (Hamlet), ou Les paroles qui les accompagnaient étaient faites d'un souffle si embaumé qu'ils en étaient plus riches. Puisqu'ils ont perdu leur parfum, reprenez-les; car, pour un noble coeur, le plus riche don devient pauvre, quand celui qui donne n'aime plus (Ophélie, dans Hamlet). Le même éditeur propose également un "vrai" Hamlet, présenté par Gérard Mordillat, qui en connaît un rayon. Il s'agirait là de la version antérieure à celle que le monde entier joue à l'envi sur toutes les scènes. Et qui aurait été écrite à quatre mains, avec le concours de Thomas Kyd donné à Shakespeare. C'est ce qu'affirmait un universitaire britannique, Gerald Mortimer-Smith, shakespearien érudit
Il y a des parfums shakespeariens dans l'atmosphère. Qui s'en plaindrait! Hier soir, Arte redonnait Beaucoup de bruit pour rien, du fougueux (et egocentrique) Kenneth Branagh - avec la superbe Emma Thompson, entre autres (le casting est de rêve) : la joie, la jeunesse, la beauté, l'audace, l'honneur, la frivolité et la turbulence des sentiments, la jalousie, la vengeance, l'amour, la délicatesse, la force... C'est d'ailleurs de cette pièce que la phrase reprise en titre de cette note est extraite. Et c'est le titre que Grasset (Les Cahiers Rouges) propose pour une petite anthologie délicieuse, en forme de dictionnaire d'à peine 130 pages, des citations du grand Will, dispersées dans ses quarante pièces et ses cent quarante-quatre sonnets. D'Ambition à Vieillesse, nous musardons et retrouvons avec un air satisfait Nous sommes de l'étoffe dont sont faits les rêves (Prospero, dans La Tempête), Un cheval! Un cheval! Mon royaume pour un cheval! (Richard III), et sans aller jusqu'à chercher To be..., nous tombons sur des perles, comme L'oiseau de l'aube chante toute la nuit (Hamlet), ou Les paroles qui les accompagnaient étaient faites d'un souffle si embaumé qu'ils en étaient plus riches. Puisqu'ils ont perdu leur parfum, reprenez-les; car, pour un noble coeur, le plus riche don devient pauvre, quand celui qui donne n'aime plus (Ophélie, dans Hamlet). Le même éditeur propose également un "vrai" Hamlet, présenté par Gérard Mordillat, qui en connaît un rayon. Il s'agirait là de la version antérieure à celle que le monde entier joue à l'envi sur toutes les scènes. Et qui aurait été écrite à quatre mains, avec le concours de Thomas Kyd donné à Shakespeare. C'est ce qu'affirmait un universitaire britannique, Gerald Mortimer-Smith, shakespearien érudit jusqu'au bout des ongles et des cheveux (disparu il y a tout juste sept ans), et avec lequel Mordillat a travaillé. Nous tenons donc là, en traduction, le fameux proto-Hamlet. Soit un petit événement dans le mundillo. Quoiqu'il en soit, c'est une belle occasion de relire une pièce qui nous offre d'emblée des bouquets de fleurs printanières. En voici deux. L.M.
jusqu'au bout des ongles et des cheveux (disparu il y a tout juste sept ans), et avec lequel Mordillat a travaillé. Nous tenons donc là, en traduction, le fameux proto-Hamlet. Soit un petit événement dans le mundillo. Quoiqu'il en soit, c'est une belle occasion de relire une pièce qui nous offre d'emblée des bouquets de fleurs printanières. En voici deux. L.M.
Horatio :
Mais moi je veux mourir sur tes lèvres, maîtresse
C'est ma gloire, mon heur, mon trésor, ma richesse
Car j'ai logé ma vie en ta bouche, mon coeur.
Hamlet :
Doute que les astres soient des flammes
Soute que le soleil tourne
Doute de la vérité même
Mais ne doute pas que je t'aime.
 Alliances :
Alliances :
Le Beaujolais rosé de Dominique Piron, parce qu'il est à la fois délicat et profond. Nous tenons là un gamay (2015, bien sûr), floral et rafraîchissant comme on l'aime en cette saison.
Pour 7€, c'est une affaire.
Avec une pièce de luth de John Dowland, of corse! Le compositeur qui illustra les pièces de Shakespeare de son vivant.
Il s'agit en l'occurrence d'une Lachrimae, interprétée par mon ami talentueux Raymond Cousté.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Mais l'abus de poésie, de verbe, de musique élizabethaine et de beauté, eux, ne le sont pas...
 En attendant Bojangles, premier roman successfull d'Olivier Bourdeaut, publié par l'excellent (ex-)petit éditeur bordelais Finitude, mérite l'engouement qu'il suscite. Gai, tendre, foutraque, sans queue ni tête, cet ode à l'amour conjugal raconté par le fils unique (au fil des jours dont il prélève l'écume), la présence séduisante d'une grue de Numidie apprivoisée nommée Mademoiselle Superfétatoire, quelques personnages satellitaires figurant une équipe de cirque, possèdent la légèreté d'une bise matinale sur la côte normande, avec ce rien de perfide qui chatouille l'oreille. Bien sûr il y a une histoire, et même de tragiques événements, mais la langue de Bourdeaut a ceci de magique, qu'à l'instar de certains joggers plus marcheurs que coureurs, il semble pouvoir aller sans jamais faire de mouvement vertical : ça roule. Et donc ça marche. Cela prend les contours d'une certaine forme de réalisme magique. Oh, très éloigné de l'imaginaire baroque d'un
En attendant Bojangles, premier roman successfull d'Olivier Bourdeaut, publié par l'excellent (ex-)petit éditeur bordelais Finitude, mérite l'engouement qu'il suscite. Gai, tendre, foutraque, sans queue ni tête, cet ode à l'amour conjugal raconté par le fils unique (au fil des jours dont il prélève l'écume), la présence séduisante d'une grue de Numidie apprivoisée nommée Mademoiselle Superfétatoire, quelques personnages satellitaires figurant une équipe de cirque, possèdent la légèreté d'une bise matinale sur la côte normande, avec ce rien de perfide qui chatouille l'oreille. Bien sûr il y a une histoire, et même de tragiques événements, mais la langue de Bourdeaut a ceci de magique, qu'à l'instar de certains joggers plus marcheurs que coureurs, il semble pouvoir aller sans jamais faire de mouvement vertical : ça roule. Et donc ça marche. Cela prend les contours d'une certaine forme de réalisme magique. Oh, très éloigné de l'imaginaire baroque d'un Garcia Marquez, bien sûr, mais pourvu de ce petit côté plus loufoque que surréaliste, qui rend la folie amusante, la mort supportable, la peine gaie, et les larmes indistinctes. C'est un court roman fantasque, et de lin, oui, un livre comme le costume blanc que porte Marcello Mastroianni dans Les Yeux noirs (le film magnifique de Nikita Mikhalkof). Elégant, aérien, délicat. Un livre cousu de grâce. L.M.
Garcia Marquez, bien sûr, mais pourvu de ce petit côté plus loufoque que surréaliste, qui rend la folie amusante, la mort supportable, la peine gaie, et les larmes indistinctes. C'est un court roman fantasque, et de lin, oui, un livre comme le costume blanc que porte Marcello Mastroianni dans Les Yeux noirs (le film magnifique de Nikita Mikhalkof). Elégant, aérien, délicat. Un livre cousu de grâce. L.M.
 Ils aiment les cochonneries. En faire, en manger, en dire. Et en écrire. Pour notre bonheur, Blandine Vié & Patrick de Mari adorent raconter des histoires cochonnes et gourmandes. Ils en ont commis un paquet en prenant sans doute leur pied (et sans bêler pour autant), rassemblé sous le titre Cochonneries en tous genres (Les Itinéraires). Et on y fait son marché : au total, vingt-huit nouvelles charcutières, tantôt tendres, drôles, voire désopilantes, douce-amères, souvent cocasses, émouvantes, burlesques, ou coquines. Toujours littéraires, c'est-à-dire écrites dans le souci primordial de la langue : ce n'est jamais du mauvais gras qui est servi. Il y a du boudin ici, du jambon là, de l'andouillette ou encore des rillettes là-bas, un air de polar ici, un faux-air de bluette là, une idylle romantico-grassouillette par là-bas, des histoires de rugby, des anecdotes de mecs, des trucs de
Ils aiment les cochonneries. En faire, en manger, en dire. Et en écrire. Pour notre bonheur, Blandine Vié & Patrick de Mari adorent raconter des histoires cochonnes et gourmandes. Ils en ont commis un paquet en prenant sans doute leur pied (et sans bêler pour autant), rassemblé sous le titre Cochonneries en tous genres (Les Itinéraires). Et on y fait son marché : au total, vingt-huit nouvelles charcutières, tantôt tendres, drôles, voire désopilantes, douce-amères, souvent cocasses, émouvantes, burlesques, ou coquines. Toujours littéraires, c'est-à-dire écrites dans le souci primordial de la langue : ce n'est jamais du mauvais gras qui est servi. Il y a du boudin ici, du jambon là, de l'andouillette ou encore des rillettes là-bas, un air de polar ici, un faux-air de bluette là, une idylle romantico-grassouillette par là-bas, des histoires de rugby, des anecdotes de mecs, des trucs de filles (prénommées Rosette ou Mariette), des fantasmes (ah, le boucher!..), des histoires d'ogres ne pouvant plus avaler le moindre gosse, à cause de la malbouffe dont il sont gavés! Ca devient dangereux, ces choses-là... Il y a de la poésie aussi, au détour d'un bouquet de paragraphes. Nous tombons même sur des rimes (voir la nouvelle intitulée Goret est un cochon!). Nous y croisons par ailleurs deux teckels baptisés Francfort et Strasbourg, et une baronne de Chambon-Parme. Et l'ensemble, loin de couper l'appétit, aiguise celui-ci. Assez peu Vegan, le livre des créateurs du site gourmand Greta Garbure résonne, de surcroît, comme une jolie provocation, en ces temps light et comme ourdis par une peur panique de s'avouer amateur de cochon... Alors, vive ces cochonneries en tous genres! Et leurs deux jolies plumes gourmandes à la commande. L.M.
filles (prénommées Rosette ou Mariette), des fantasmes (ah, le boucher!..), des histoires d'ogres ne pouvant plus avaler le moindre gosse, à cause de la malbouffe dont il sont gavés! Ca devient dangereux, ces choses-là... Il y a de la poésie aussi, au détour d'un bouquet de paragraphes. Nous tombons même sur des rimes (voir la nouvelle intitulée Goret est un cochon!). Nous y croisons par ailleurs deux teckels baptisés Francfort et Strasbourg, et une baronne de Chambon-Parme. Et l'ensemble, loin de couper l'appétit, aiguise celui-ci. Assez peu Vegan, le livre des créateurs du site gourmand Greta Garbure résonne, de surcroît, comme une jolie provocation, en ces temps light et comme ourdis par une peur panique de s'avouer amateur de cochon... Alors, vive ces cochonneries en tous genres! Et leurs deux jolies plumes gourmandes à la commande. L.M.
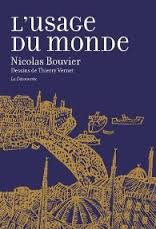 Relu attentivement L'Usage du monde (La Découverte), de Nicolas Bouvier, dans sa nouvelle et splendide édition. C'est le bréviaire, que dis-je : le mot de passe des écrivains voyageurs, des voyageurs, des écrivains aimant davantage décrire que crier, mais doucement, en observant d'un oeil faussement distrait les petits faits, les grands horizons, les regards larges, les senteurs, les saveurs, les odeurs, les rires francs, les sentiments ourdis, les petites choses que peu savent prélever, capter, et puis noter à la fraîche, ou bien tard dans la nuit, à la lueur d'une lune accorte ou d'une lampe vacillante, sur un cahier ami. Nicolas Bouvier (déjà évoqué ici, notamment pour son superbe texte posthume, Il faudra repartir, Payot - cherchez l'archive dans le blog), est un maître. Disparu en 1998, il nous a laissé un chef-d'oeuvre, avec L'Usage du monde. Peu importe où il va, vagabonde, avec son acolyte peintre Thierry Vernet, entre juin 1953 et décembre 1954 (de Genève à là-bas, d'Anatolie et partout en zig-zag, jusqu'en Afghanistan), car il aiguise chaque jour son talent d'écrivain du réel, de l'humain, et c'est cela qui compte : il est celui qui dit, qui décrit, par touches d'une subtilité cristlalline, et la langue, le choix des mots, le goût de l'adjectif idoine, de la métaphore juste, semblent lui être un impératif vital, une quête obsessionnelle et charmante, une source de plaisir qu'il n'a de cesse de partager avec son lecteur. Son voyage devient ainsi celui de chacun d'entre nous. Bouvier passe la main à chaque page, et nous tutoyons aussitôt ceux qu'il côtoie, ainsi que les paysages, les sensations, les déboires, la douleur, la soif, la chaleur, la rage de se faire voler, comme le petit bonheur chipé au quotidien (voyager n'est pas toujours de tout repos), les rencontres minuscules, le don du nada, une esquisse de potlatch parfois, le repos réparateur du corps meurtri par la route, la jouissance du presque-rien : un thé, un sourire, une voix d'enfant, un chant d'oiseau. C'est la magie de l'écriture de Bouvier... Si je commencais à reproduire ici des extraits de ce livre exceptionnel, cette note deviendrait un fleuve anthologique. J'avais lu L'Usage du monde, distraitement, car trop jeune sans doute, il y a des lustres. Je l'ai repris, et d'un trait ou presque, j'ai bu ses 375 pages. C'est un long drink pimenté, aigu et très doux, percutant et lascif, intraitable, poétique toujours. Avec, en bandoulière, cette permanente leçon de vie : nous ne sommes que des passagers, des errants, des observateurs éphémères, des hôtes; tout ça... Le respect nous anime et doit gouverner chacun de nos gestes, chacun de nos mots, et puis nous devons l'enseigner, ce respect de toute chose; il le faut. Une leçon de vie. LM
Relu attentivement L'Usage du monde (La Découverte), de Nicolas Bouvier, dans sa nouvelle et splendide édition. C'est le bréviaire, que dis-je : le mot de passe des écrivains voyageurs, des voyageurs, des écrivains aimant davantage décrire que crier, mais doucement, en observant d'un oeil faussement distrait les petits faits, les grands horizons, les regards larges, les senteurs, les saveurs, les odeurs, les rires francs, les sentiments ourdis, les petites choses que peu savent prélever, capter, et puis noter à la fraîche, ou bien tard dans la nuit, à la lueur d'une lune accorte ou d'une lampe vacillante, sur un cahier ami. Nicolas Bouvier (déjà évoqué ici, notamment pour son superbe texte posthume, Il faudra repartir, Payot - cherchez l'archive dans le blog), est un maître. Disparu en 1998, il nous a laissé un chef-d'oeuvre, avec L'Usage du monde. Peu importe où il va, vagabonde, avec son acolyte peintre Thierry Vernet, entre juin 1953 et décembre 1954 (de Genève à là-bas, d'Anatolie et partout en zig-zag, jusqu'en Afghanistan), car il aiguise chaque jour son talent d'écrivain du réel, de l'humain, et c'est cela qui compte : il est celui qui dit, qui décrit, par touches d'une subtilité cristlalline, et la langue, le choix des mots, le goût de l'adjectif idoine, de la métaphore juste, semblent lui être un impératif vital, une quête obsessionnelle et charmante, une source de plaisir qu'il n'a de cesse de partager avec son lecteur. Son voyage devient ainsi celui de chacun d'entre nous. Bouvier passe la main à chaque page, et nous tutoyons aussitôt ceux qu'il côtoie, ainsi que les paysages, les sensations, les déboires, la douleur, la soif, la chaleur, la rage de se faire voler, comme le petit bonheur chipé au quotidien (voyager n'est pas toujours de tout repos), les rencontres minuscules, le don du nada, une esquisse de potlatch parfois, le repos réparateur du corps meurtri par la route, la jouissance du presque-rien : un thé, un sourire, une voix d'enfant, un chant d'oiseau. C'est la magie de l'écriture de Bouvier... Si je commencais à reproduire ici des extraits de ce livre exceptionnel, cette note deviendrait un fleuve anthologique. J'avais lu L'Usage du monde, distraitement, car trop jeune sans doute, il y a des lustres. Je l'ai repris, et d'un trait ou presque, j'ai bu ses 375 pages. C'est un long drink pimenté, aigu et très doux, percutant et lascif, intraitable, poétique toujours. Avec, en bandoulière, cette permanente leçon de vie : nous ne sommes que des passagers, des errants, des observateurs éphémères, des hôtes; tout ça... Le respect nous anime et doit gouverner chacun de nos gestes, chacun de nos mots, et puis nous devons l'enseigner, ce respect de toute chose; il le faut. Une leçon de vie. LM
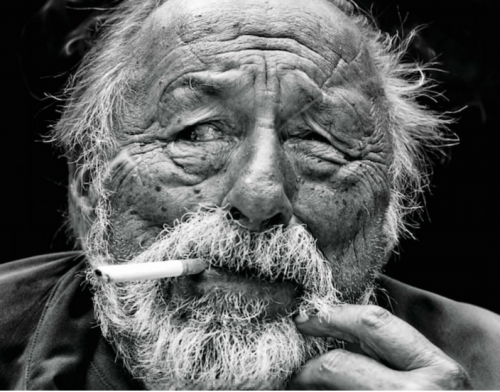
Je reproduis ci-dessous les deux pages que je consacre à Jim Harrison (lequel a quitté ce monde hier), dans mon Dictionnaire chic du vin (Ecriture, sept. 2015, pp.177-178), à la lettre H. So long, Jim. Notre rencontre sur tes terres n'aura donc pas lieu...
HARRISON, Jim
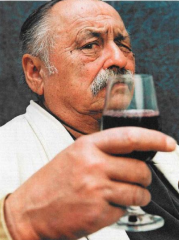 Autant faire une note sur Gargantua, tant « Big Jim », son surnom, aime bouffer, picoler (du bon – toujours lucide, le garçon !), lâcher prise, vivre en somme, dans son jardin des délices partagées en amitié. Je le sais amateur de Cos d’Estournel, saint-estèphe de très haut vol, et de tant de flacons français, de Loire, de Bourgogne et de Bordeaux. Avec Gérard Oberlé, son double du Morvan, son « jumeau astral », dirait Pierre Veilletet, Oberlé l’écrivain rabelaisien et subtil, Big Jim aime à en découdre avec les flacons purs, droits, riches, profonds, capiteux, débordant d’énergie substantielle des Côtes-du-Rhône.
Autant faire une note sur Gargantua, tant « Big Jim », son surnom, aime bouffer, picoler (du bon – toujours lucide, le garçon !), lâcher prise, vivre en somme, dans son jardin des délices partagées en amitié. Je le sais amateur de Cos d’Estournel, saint-estèphe de très haut vol, et de tant de flacons français, de Loire, de Bourgogne et de Bordeaux. Avec Gérard Oberlé, son double du Morvan, son « jumeau astral », dirait Pierre Veilletet, Oberlé l’écrivain rabelaisien et subtil, Big Jim aime à en découdre avec les flacons purs, droits, riches, profonds, capiteux, débordant d’énergie substantielle des Côtes-du-Rhône.
Un soir que je dînais chez Manuel Carcassonne (patron des éditions Stock, et de Grasset alors), avec Laure Gasparotto et Emmanuelle Jary, et que Pascal Quignard (l’un de mes écrivains français vivants favoris, avec Pierre Michon, Jean Échenoz, Pierre Bergounioux, Sylvie Germain et peu d’autres : Olivier Frébourg, Christian Authier, Stéphane Guibourgé...), devait être de la partie, ce fut Oberlé qui surgît, Gérard Oberlé de toute sa masse, de toute sa voix, de tout son crâne, de toute l’amplitude de sa verve et de tous ses gestes larges, nous parlâmes donc forcément de Big Jim. Je racontais que rendez-vous avait été pris, quelques années auparavant, avec lui afin de l’interviewer dans sa retraite du Montana, lorsque j’étais rédacteur en chef d’un magazine de chasse, et que je dus renoncer à ce voyage parce qu’un cancer méchant et dévastateur venait de se déclarer dans le corps de ma mère. Nous avons bu les flacons sélectionnés par la délicate Laure, ce soir-là. Et Emmanuelle, fine connaisseuse (elle débutait dans le métier de journaliste gastronomique et nous avions déjà asséché son meuble Eurocave, qui contenait de très grands crus), commentait les bouteilles tandis que Jim revenait sur la nappe de nos paroles. Manuel arbitrait, l’œil avisé – il connaissait l’animal borgne et auteur de Légendes d’automne, et il avait même déjà donné, je crois me souvenir, un vibrant entretien avec l’inoubliable auteur de Dalva au Magazine littéraire, mais il observait un demi silence de sage Sioux campé sur sa réserve. Comme quoi. Oberlé, lui, la voie si libre, en rajoutait, pantagruélique, ogre – oui ogre ! Et la soirée se plaçait naturellement sous le double signe des vins de France et de Jim Harrison, écrivain adulé par les Français. Je me jurais d’offrir un Cos d’Estournel à Jim H. lors de sa prochaine tournée « promotionnelle » en France. Las. Je ratai les suivantes. Aujourd’hui que son dos est vermoulu, et qu’il ne se sépare pas d’une canne pour aller jusqu’à un tire-bouchon, je me demande si je ne vais pas reprendre un billet d’avion pour le Montana et rouler un Cos d’Estournel dans les chemises. Vu que le vin est tiré et que ma mère est morte. L.M.

 Depuis Corps de jeune fille, publié en 1986 (Gallimard), la ravissante Elisabeth Barillé construit une oeuvre intime, délicate, sensuelle. Elle livre, avec L'Oreille d'or (Grasset), un récit singulier sur son propre handicap : la perte de l'ouïe de l'oreille gauche, accidentellement, à l'âge de six ans. Et sur sa vie avec. Pour qui connaît cela (j'en suis, depuis l'âge de onze ans, mais de la droite), ce petit livre est précieux, car il décrit avec une subtilité infinie les sensations que l'on éprouve, que l'on réprouve parfois, qui nous désolent et peuvent nous faire sombrer dans une mélancolie fulgurante. Ou bien qui nous grandissent en nous éloignant, voire en nous coupant de tout (sauf de la Nature), à notre corps défendant. Ainsi d'une atmosphère bruyante qui nous empêche de capter les échanges humains (le calvaire des vernissages, des brasseries à haut plafond), et que, las de devoir faire répéter l'autre, sur les lèvres duquel nous avons appris à lire depuis longtemps, nous prenons le parti de reculer d'un pas, puis de la salle, et enfin du monde. Et il arrive parfois que, une fois dehors, en respirant profondément, en soupirant, ce ne soit pas le froid qui humecte soudain nos yeux. Mais cette réclusion solitaire et forcée, Elisabeth Barillé la transforme en chance unique. L'absence conduit à la rêverie, à un monde intérieur - elle peut même mener à la création : cette demi-surdité et ses conséquences ont mené l'auteur à l'écriture. Rien de moins. La confession sans concession d'Elisabeth Barillé (celles de Rousseau ont bercé son adolescence) lui donne l'occasion de passer en revue les handicapés de l'ouïe célèbres, et pas seulement Beethoven - il est par exemple question du sonotone de François Truffaut. Et de remonter à l'enfance, aux étés en famille dans le Maine-et-Loire, aux premiers émois amoureux, à la crainte que l'homme ne découvre cette surdité au cours du repas si le restaurant est bruyant, l'embarras lorsqu'elle accomplit son travail de journaliste (surtout en interview) - on connaît : un vrai supplice! Entendre pour moi, c'est m'extirper du labyrinthe, écrit-elle. Puissance du retranchement. Puissance et dépendance. Car ce handicap invisible, s'il engendre un complexe, peut devenir un trésor. Certes, il met mal à l'aise, et celui qui entend mal, et celui qui doit faire un effort afin de se faire comprendre : Merci mon oreille morte. En me poussant à fuir tout ce qui fait groupe, la surdité m'a condamnée à l'aventure de la profondeur. En
Depuis Corps de jeune fille, publié en 1986 (Gallimard), la ravissante Elisabeth Barillé construit une oeuvre intime, délicate, sensuelle. Elle livre, avec L'Oreille d'or (Grasset), un récit singulier sur son propre handicap : la perte de l'ouïe de l'oreille gauche, accidentellement, à l'âge de six ans. Et sur sa vie avec. Pour qui connaît cela (j'en suis, depuis l'âge de onze ans, mais de la droite), ce petit livre est précieux, car il décrit avec une subtilité infinie les sensations que l'on éprouve, que l'on réprouve parfois, qui nous désolent et peuvent nous faire sombrer dans une mélancolie fulgurante. Ou bien qui nous grandissent en nous éloignant, voire en nous coupant de tout (sauf de la Nature), à notre corps défendant. Ainsi d'une atmosphère bruyante qui nous empêche de capter les échanges humains (le calvaire des vernissages, des brasseries à haut plafond), et que, las de devoir faire répéter l'autre, sur les lèvres duquel nous avons appris à lire depuis longtemps, nous prenons le parti de reculer d'un pas, puis de la salle, et enfin du monde. Et il arrive parfois que, une fois dehors, en respirant profondément, en soupirant, ce ne soit pas le froid qui humecte soudain nos yeux. Mais cette réclusion solitaire et forcée, Elisabeth Barillé la transforme en chance unique. L'absence conduit à la rêverie, à un monde intérieur - elle peut même mener à la création : cette demi-surdité et ses conséquences ont mené l'auteur à l'écriture. Rien de moins. La confession sans concession d'Elisabeth Barillé (celles de Rousseau ont bercé son adolescence) lui donne l'occasion de passer en revue les handicapés de l'ouïe célèbres, et pas seulement Beethoven - il est par exemple question du sonotone de François Truffaut. Et de remonter à l'enfance, aux étés en famille dans le Maine-et-Loire, aux premiers émois amoureux, à la crainte que l'homme ne découvre cette surdité au cours du repas si le restaurant est bruyant, l'embarras lorsqu'elle accomplit son travail de journaliste (surtout en interview) - on connaît : un vrai supplice! Entendre pour moi, c'est m'extirper du labyrinthe, écrit-elle. Puissance du retranchement. Puissance et dépendance. Car ce handicap invisible, s'il engendre un complexe, peut devenir un trésor. Certes, il met mal à l'aise, et celui qui entend mal, et celui qui doit faire un effort afin de se faire comprendre : Merci mon oreille morte. En me poussant à fuir tout ce qui fait groupe, la surdité m'a condamnée à l'aventure de la profondeur. En métamorphosant ainsi un manque, Elisabeth Barillé est capable de faire d'un sonotone un bijou. Elle dédouane, désinhibe. Son petit livre nous chuchote une sorte de "deaf pride". Et souligne aussi une chance paradoxale. La surdité est une fidélité définitive, une fidélité à soi-même imposée du dedans, contre les aventures dictatoriales du dehors, souligne-t-elle. Le demi-sourd, le malentendant, le mûr pour se faire appareiller est capable d'entendre un coeur amoureux cogner en face de lui. Elisabeth Barillé : Je n'entends pas la voiture qui pourrait me faucher, mais quand Glenn Gould joue Bach, j'entends qu'il jouit. L.M.
métamorphosant ainsi un manque, Elisabeth Barillé est capable de faire d'un sonotone un bijou. Elle dédouane, désinhibe. Son petit livre nous chuchote une sorte de "deaf pride". Et souligne aussi une chance paradoxale. La surdité est une fidélité définitive, une fidélité à soi-même imposée du dedans, contre les aventures dictatoriales du dehors, souligne-t-elle. Le demi-sourd, le malentendant, le mûr pour se faire appareiller est capable d'entendre un coeur amoureux cogner en face de lui. Elisabeth Barillé : Je n'entends pas la voiture qui pourrait me faucher, mais quand Glenn Gould joue Bach, j'entends qu'il jouit. L.M.
Coup de promo et de projo sur l'association que lance ma soeur Muriel : inscrivez-vous! Cliquez sur le lien ci-après (flyer de la première série de conférences) : Le Cycle.docx

On doit penser en homme d'action et agir en homme de pensée, disait Bergson. Cela m'évoque Ellul : penser globalement, agir localement...
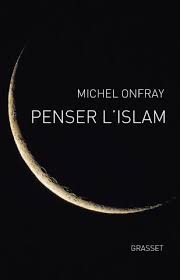 Lu le dernier Onfray, hier après-midi (je l'ai reçu avant-hier), Penser l'islam (Grasset). En son centre, un très long entretien avec une journaliste algérienne, Asma Kouar (du journal Al Jadid), dont les questions sont tournées, chantournées, insidieuses, orientées comme on dit encore parfois, bref : celle-ci tente de faire abonder Michel Onfray dans le sens de sa propre doxa, qui caresse le Prophète dans le sens du poil en en faisant un ange aux mots de miel et aux actes de bonté exclusive. Mais ça ne marche pas, même si l'on sent par endroits quelques faiblesses de la part du philosophe à la lucidité solaire, car l'auteur connaît son sujet, y compris la Sîra, le texte qui rapporte les faits et gestes du Prophète... L'introduction est répétitive, la conclusion salutaire, qui a trait aux drames du 13 novembre 2015 à Paris (l'essentiel du livre fait référence aux drames de la semaine du 5 janvier. Fucking year...). Onfray se répète, mais il n'a pas souvent tort, lorsqu'il renvoie dos à dos les islamophiles (dont une certaine gauche extrême, aveugle et antisioniste), et les islamophobes (non sans préciser le sens, détourné, galvaudé, de ce terme), qui, des deux bords, sont légion. Le philosophe prolifique a lu les textes et leur exégèse (j'adore le lire, notamment à propos de Spinoza, de Camus, de Nietzsche, de l'érotique solaire, de la gourmandise, du vin de Sauternes... et j'emmerde les onfrayphobes qui, je le constate souvent, le lynchent, hurlent avec les loups, sans même avoir lu ses livres!..). C'est un pro. : il sait de quoi il en retourne, et de quoi il parle, et il connaît ce qu'il analyse et commente. Il est plus qu'autorisé à tenter de comprendre au lieu de juger, ou bien de vociférer sans savoir, sans même avoir lu le Coran, ce que d'aucuns font sans honte (il cite nombre de personnalités politiques de premier rang). Onfray décrypte la défiguration d'un certain islam, la confusion hâtive entre un islam de paix et un islam de sang, un islam pacifique et un islam belliqueux, haineux et conquérant. Entre un islam d'écoute de l'autre, et un islam d'intolérance totale. Car les deux coexistent dans le Coran. C'est une question de prélèvement à la source (soit à la lecture - orientée, sans jeu de mots -, des sourates), une question d'usage, voire, souvent hélas, d'interprétation. Il y a ainsi deux façons - contradictoires -, d'être musulman. Onfray vilipende au passage les actes de guerre de la France, à coups de Rafale, de porte-avion, dans les pays arabes même (l'oumma, en réalité, soit la communauté musulmane planétaire, celle que nous bombardons, et qui riposte à nos terrasses, via Internet, avec des kalachnikovs), lors qu'il s'agirait d'accroître une contre-offensive au combat de rue; sur notre sol. Onfray pratique avec maestria un raisonnement dans l'esprit de Spinoza : Ni rire, ni pleurer, mais comprendre, et dans celui, voisin, des Lumières : hors passion, sans haine et sans vénération, sans mépris et sans aveuglement, sans condamnation préalable et sans amour a priori, juste pour comprendre. Son coup de gueule, à propos du désenchantement de la jeunesse française, est salutaire : Que des jeunes gens la quittent (la France) pour une vie d'aventure, d'idéal, d'action, d'engagement, je peux le comprendre puisque la République n'est plus capable de proposer l'aventure, l'idéal, l'action, l'engagement et qu'elle érige en modèles des comédiens de série B, des animateurs télé, des footballeurs décérébrés, des acteurs de cinéma, des chanteurs de radio-crochets télévisés... Il déplore qu'aujourd'hui, le grand formateur des consciences ne soit plus l'école, mais l'écran (télé, Net, tweet). Se rend à plusieurs évidences concomitantes : l'islam est une religion qui monte en puissance en Europe. Et, en France, à titre d'exemple, l'islam de France est encore financé par des pays qui n'ont aucune raison d'aimer ce pays... L'Occident est par ailleurs en bout de course. L'Europe est moribonde, elle ne survivra pas, et comme toutes les civilisations en phase d'effondrement, elle montre des signes de décadence : l'argent roi, la perte de tous les repères éthiques et moraux, l'impunité des puissants, l'impuissance des politiciens, le sexe dépourvu de sens, le marché qui fait partout la loi, l'analphabétisme de masse, l'illettrisme de ceux qui nous gouvernent, la disparition des communautés familiales ou nationales au profit des tribus égotistes et locales, la superficialité devenue règle générale, la passion pour les jeux du cirque, la déréalisation et le triomphe de la dénégation, le règne du sarcasme, le chacun pour soi... Dès lors le soufisme pacifiste (d'origine irakienne), ne peut rien contre le salafisme (et le djihadisme, sa mortifère sécrétion). Pas davantage, l'espoir (voeu pieux) d'un islam républicain ne pourrait quoi que ce soit. Ose penser par toi-même!, était la devise des Lumières, rappelle Onfray. Et d'ajouter : Cesse de penser, obéis, soumets-toi!, voilà na nouvelle devise de la gauche islamophile. L'auteur de La puissance d'exister rejoint ainsi la pensée d'un Houellebecq, d'un Finkielkraut, d'un Sansal. D'ailleurs, Onfray déborde du cadre philosophique pour entrer de plain-pied dans l'espace politique, lorsqu'il voue aux gémonies les actes pleutres d'un gouvernement de "gauche", se limitant à des messages compassionnels (tellement narcissiques, dédouanants, égoïstes, exhibitionnistes), avouant par là même son impuissance à lutter efficacement contre un islam de guerre totale, lequel, selon l'auteur, ne voit plus tellement l'intérêt de changer de direction en allant vers un islam de paix, lorsque la conquête par la guerre lui paraît soudain si aisée. La Soumission, encore, comme un terrible refrain... La dernière charge d'Onfray est une adresse désabusée, presque contrite, qui exprime le regret de ne pas se tromper, hélas, au regard de l'Histoire, lorsqu'il pense qu'il est peut-être trop tard, car la politique étrangère de la France depuis vingt-cinq ans, écrit-il, expose les Français sans pouvoir les protéger quand ripostent ceux qu'ils agressent... Car tous les assoiffés de pouvoir préfèrent se servir de la France plutôt que de la servir. (...) La carte de la paix aurait valu la peine d'être jouée, conclut-il avec une certaine mélancolie. Certes, il y faut moins de testostérone et plus de matière grise... L.M.
Lu le dernier Onfray, hier après-midi (je l'ai reçu avant-hier), Penser l'islam (Grasset). En son centre, un très long entretien avec une journaliste algérienne, Asma Kouar (du journal Al Jadid), dont les questions sont tournées, chantournées, insidieuses, orientées comme on dit encore parfois, bref : celle-ci tente de faire abonder Michel Onfray dans le sens de sa propre doxa, qui caresse le Prophète dans le sens du poil en en faisant un ange aux mots de miel et aux actes de bonté exclusive. Mais ça ne marche pas, même si l'on sent par endroits quelques faiblesses de la part du philosophe à la lucidité solaire, car l'auteur connaît son sujet, y compris la Sîra, le texte qui rapporte les faits et gestes du Prophète... L'introduction est répétitive, la conclusion salutaire, qui a trait aux drames du 13 novembre 2015 à Paris (l'essentiel du livre fait référence aux drames de la semaine du 5 janvier. Fucking year...). Onfray se répète, mais il n'a pas souvent tort, lorsqu'il renvoie dos à dos les islamophiles (dont une certaine gauche extrême, aveugle et antisioniste), et les islamophobes (non sans préciser le sens, détourné, galvaudé, de ce terme), qui, des deux bords, sont légion. Le philosophe prolifique a lu les textes et leur exégèse (j'adore le lire, notamment à propos de Spinoza, de Camus, de Nietzsche, de l'érotique solaire, de la gourmandise, du vin de Sauternes... et j'emmerde les onfrayphobes qui, je le constate souvent, le lynchent, hurlent avec les loups, sans même avoir lu ses livres!..). C'est un pro. : il sait de quoi il en retourne, et de quoi il parle, et il connaît ce qu'il analyse et commente. Il est plus qu'autorisé à tenter de comprendre au lieu de juger, ou bien de vociférer sans savoir, sans même avoir lu le Coran, ce que d'aucuns font sans honte (il cite nombre de personnalités politiques de premier rang). Onfray décrypte la défiguration d'un certain islam, la confusion hâtive entre un islam de paix et un islam de sang, un islam pacifique et un islam belliqueux, haineux et conquérant. Entre un islam d'écoute de l'autre, et un islam d'intolérance totale. Car les deux coexistent dans le Coran. C'est une question de prélèvement à la source (soit à la lecture - orientée, sans jeu de mots -, des sourates), une question d'usage, voire, souvent hélas, d'interprétation. Il y a ainsi deux façons - contradictoires -, d'être musulman. Onfray vilipende au passage les actes de guerre de la France, à coups de Rafale, de porte-avion, dans les pays arabes même (l'oumma, en réalité, soit la communauté musulmane planétaire, celle que nous bombardons, et qui riposte à nos terrasses, via Internet, avec des kalachnikovs), lors qu'il s'agirait d'accroître une contre-offensive au combat de rue; sur notre sol. Onfray pratique avec maestria un raisonnement dans l'esprit de Spinoza : Ni rire, ni pleurer, mais comprendre, et dans celui, voisin, des Lumières : hors passion, sans haine et sans vénération, sans mépris et sans aveuglement, sans condamnation préalable et sans amour a priori, juste pour comprendre. Son coup de gueule, à propos du désenchantement de la jeunesse française, est salutaire : Que des jeunes gens la quittent (la France) pour une vie d'aventure, d'idéal, d'action, d'engagement, je peux le comprendre puisque la République n'est plus capable de proposer l'aventure, l'idéal, l'action, l'engagement et qu'elle érige en modèles des comédiens de série B, des animateurs télé, des footballeurs décérébrés, des acteurs de cinéma, des chanteurs de radio-crochets télévisés... Il déplore qu'aujourd'hui, le grand formateur des consciences ne soit plus l'école, mais l'écran (télé, Net, tweet). Se rend à plusieurs évidences concomitantes : l'islam est une religion qui monte en puissance en Europe. Et, en France, à titre d'exemple, l'islam de France est encore financé par des pays qui n'ont aucune raison d'aimer ce pays... L'Occident est par ailleurs en bout de course. L'Europe est moribonde, elle ne survivra pas, et comme toutes les civilisations en phase d'effondrement, elle montre des signes de décadence : l'argent roi, la perte de tous les repères éthiques et moraux, l'impunité des puissants, l'impuissance des politiciens, le sexe dépourvu de sens, le marché qui fait partout la loi, l'analphabétisme de masse, l'illettrisme de ceux qui nous gouvernent, la disparition des communautés familiales ou nationales au profit des tribus égotistes et locales, la superficialité devenue règle générale, la passion pour les jeux du cirque, la déréalisation et le triomphe de la dénégation, le règne du sarcasme, le chacun pour soi... Dès lors le soufisme pacifiste (d'origine irakienne), ne peut rien contre le salafisme (et le djihadisme, sa mortifère sécrétion). Pas davantage, l'espoir (voeu pieux) d'un islam républicain ne pourrait quoi que ce soit. Ose penser par toi-même!, était la devise des Lumières, rappelle Onfray. Et d'ajouter : Cesse de penser, obéis, soumets-toi!, voilà na nouvelle devise de la gauche islamophile. L'auteur de La puissance d'exister rejoint ainsi la pensée d'un Houellebecq, d'un Finkielkraut, d'un Sansal. D'ailleurs, Onfray déborde du cadre philosophique pour entrer de plain-pied dans l'espace politique, lorsqu'il voue aux gémonies les actes pleutres d'un gouvernement de "gauche", se limitant à des messages compassionnels (tellement narcissiques, dédouanants, égoïstes, exhibitionnistes), avouant par là même son impuissance à lutter efficacement contre un islam de guerre totale, lequel, selon l'auteur, ne voit plus tellement l'intérêt de changer de direction en allant vers un islam de paix, lorsque la conquête par la guerre lui paraît soudain si aisée. La Soumission, encore, comme un terrible refrain... La dernière charge d'Onfray est une adresse désabusée, presque contrite, qui exprime le regret de ne pas se tromper, hélas, au regard de l'Histoire, lorsqu'il pense qu'il est peut-être trop tard, car la politique étrangère de la France depuis vingt-cinq ans, écrit-il, expose les Français sans pouvoir les protéger quand ripostent ceux qu'ils agressent... Car tous les assoiffés de pouvoir préfèrent se servir de la France plutôt que de la servir. (...) La carte de la paix aurait valu la peine d'être jouée, conclut-il avec une certaine mélancolie. Certes, il y faut moins de testostérone et plus de matière grise... L.M.
 Surprenant Alain Duault, dont on connaît la bonhommie lorsqu'il parle de musique classique à la télé, ou d'opéra avant le film, au cinéma. Cet homme - et c'est moins connu - , est aussi un poète délicat, qui utilise souvent le mot verso, notamment dans ses poèmes d'amour, car il se plait à retourner les mots comme un chercheur de champignons retourne la feuille du bout du bâton, ou un amoureux son corps à elle. Poésie/Gallimard publie une anthologie de ses recueils parus depuis 2002, Où vont nos nuits perdues. J'y ai relevé celui-ci :
Surprenant Alain Duault, dont on connaît la bonhommie lorsqu'il parle de musique classique à la télé, ou d'opéra avant le film, au cinéma. Cet homme - et c'est moins connu - , est aussi un poète délicat, qui utilise souvent le mot verso, notamment dans ses poèmes d'amour, car il se plait à retourner les mots comme un chercheur de champignons retourne la feuille du bout du bâton, ou un amoureux son corps à elle. Poésie/Gallimard publie une anthologie de ses recueils parus depuis 2002, Où vont nos nuits perdues. J'y ai relevé celui-ci :
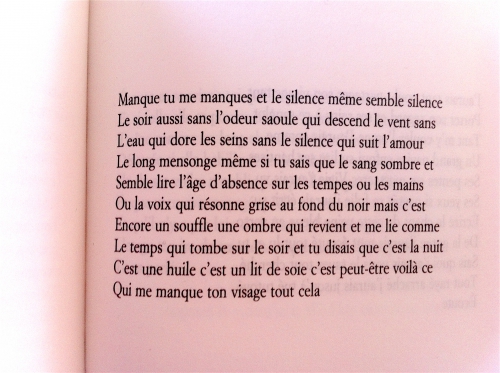
Et celui-là, dans un autre registre :
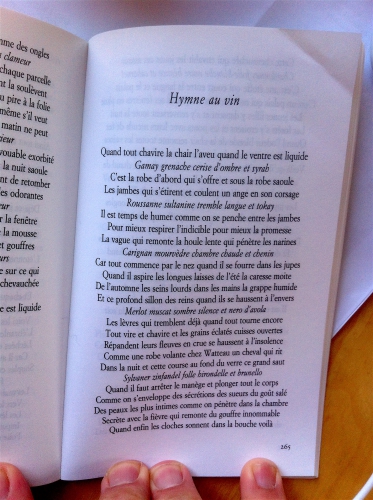
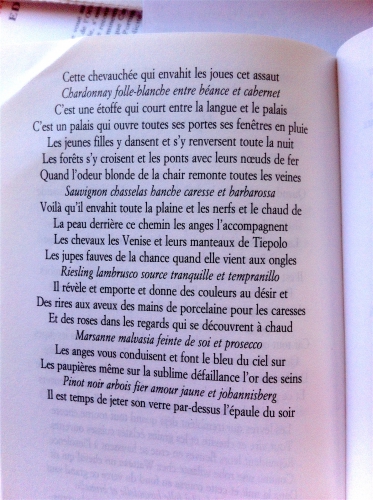
 Anise Koltz est une poétesse forte. Son mot cingle, trace avec économie, percute. Elle pratique l'oxymore, Rien n'est plus obscur et mystérieux que la clarté, prévient-elle. Extraits de Somnanbule du jour, son anthologie personnelle qui paraît - et c'est un événement, au Luxembourg -, dans la collection Poésie/Gallimard :
Anise Koltz est une poétesse forte. Son mot cingle, trace avec économie, percute. Elle pratique l'oxymore, Rien n'est plus obscur et mystérieux que la clarté, prévient-elle. Extraits de Somnanbule du jour, son anthologie personnelle qui paraît - et c'est un événement, au Luxembourg -, dans la collection Poésie/Gallimard :
Abattez mes branches
sciez moi en morceaux
les oiseaux continueront à chanter
dans mes racines
---
Chaque aube
est une promesse d'éternité
Chaque couchant
sa flamboyante annulation
---
Mon corps est chaud
comme le seuil d'une église
Quand tu entres en moi
la Bible divague
---
J'aime te sentir
sur moi
comme un pont écroulé
ma rivière
polira tes pierres
---
Marcher
sans rien atteindre
jusqu'à devenir chemin
---
Je ne crois plus en Dieu
désormais
ce sera à Lui
de croire en moi
---
Seule je rôde
repoussée
comme un animal sauvage
qui a été touché
par les humains
---
JE T'AIME
Je t'aime
parce que ton amour
inventé pour voler
est un faucon
qui s'est posé sur mon poing
 Nous vivons avec cette collection depuis que nous avons appris à lire la beauté dans le mot, la fragilité sur le givre, l'amour dans le silence des regards. Nous avions commencé par la base : Apollinaire, Baudelaire, Rimbaud, Nerval, Eluard, Valéry, Hölderlin, Rilke, Jouve, Perse, Neruda, Toulet, et puis vinrent vite Char, Ponge, Jaccottet, Mallarmé, Lorca, Paz, Dupin, Reverdy, Ungaretti, les Haïkus, Desbordes-Valmore, Ritsos, Jabès, et des dizaines d'autres. Cette collection fétiche est devenue le talisman de notre bibliothèque. Ses poche les plus précieux. Nous ne l'avons jamais perdue de vue, nous avons guetté chaque parution, fait l'acquisition de presque tous, oui, c'est vrai. Cheminer avec prenait tout son sens. Offrir un joli volume blanc barré de petits portraits de son auteur, possède un poids particulier. C'était, et c'est toujours un cadeau chargé. Mais comme l'aile du papillon que porte une fourmi, dirait Ungaretti. Ou bien, comme on tend un oiseau vivant dans le berceau de ses mains à celle qui craint encore de le toucher. La collection fête donc aujourd'hui ses cinquante années d'existence. Un demi-siècle, déjà, que la poésie est popularisée, que du bonheur ineffable peut être savouré, partagé, transmis. Combien de fois ai-je offert Fureur et mystère, Les Matinaux, Le Parti pris des choses, Vie d’un homme, La Centaine d’amour, Lettera amorosa,
Nous vivons avec cette collection depuis que nous avons appris à lire la beauté dans le mot, la fragilité sur le givre, l'amour dans le silence des regards. Nous avions commencé par la base : Apollinaire, Baudelaire, Rimbaud, Nerval, Eluard, Valéry, Hölderlin, Rilke, Jouve, Perse, Neruda, Toulet, et puis vinrent vite Char, Ponge, Jaccottet, Mallarmé, Lorca, Paz, Dupin, Reverdy, Ungaretti, les Haïkus, Desbordes-Valmore, Ritsos, Jabès, et des dizaines d'autres. Cette collection fétiche est devenue le talisman de notre bibliothèque. Ses poche les plus précieux. Nous ne l'avons jamais perdue de vue, nous avons guetté chaque parution, fait l'acquisition de presque tous, oui, c'est vrai. Cheminer avec prenait tout son sens. Offrir un joli volume blanc barré de petits portraits de son auteur, possède un poids particulier. C'était, et c'est toujours un cadeau chargé. Mais comme l'aile du papillon que porte une fourmi, dirait Ungaretti. Ou bien, comme on tend un oiseau vivant dans le berceau de ses mains à celle qui craint encore de le toucher. La collection fête donc aujourd'hui ses cinquante années d'existence. Un demi-siècle, déjà, que la poésie est popularisée, que du bonheur ineffable peut être savouré, partagé, transmis. Combien de fois ai-je offert Fureur et mystère, Les Matinaux, Le Parti pris des choses, Vie d’un homme, La Centaine d’amour, Lettera amorosa,  Capitale de la douleur, Vergers, L’Embrasure, Hypérion, Les Contrerimes, Plupart du temps, La Quête de joie, Ma Vie sans moi, Liberté sur parole, Le Seuil, le sable… Combien ! Ces compagnons dans le jardin de nos lectures quotidiennes nous sont devenus indispensables comme l’air et l’eau, le feu de ses yeux et le vin d’après (photo ci-contre). Agée de cinquante
Capitale de la douleur, Vergers, L’Embrasure, Hypérion, Les Contrerimes, Plupart du temps, La Quête de joie, Ma Vie sans moi, Liberté sur parole, Le Seuil, le sable… Combien ! Ces compagnons dans le jardin de nos lectures quotidiennes nous sont devenus indispensables comme l’air et l’eau, le feu de ses yeux et le vin d’après (photo ci-contre). Agée de cinquante ans, riche de plus de cinq cents titres, la collection que dirige aujourd’hui André Velter, poète lui-même (Poésie/Gallimard fut lancée en 1966 par Alain Jouffroy et Robert Carlier, puis elle fut pilotée par André Fermigier, et, successivement par Jean-Loup Champion, Marc Delaunay, et enfin par André Velter depuis 1998), saisit l'occasion du Printemps de poètes pour offrir un immense bouquet de livres contemporains. Ils sont presque tous, là, sous ma main, sur la table (voir photos ci-dessus) : et tout d’abord le précieux Infiniment proche. Le désespoir n’existe pas, de Zeno Bianu - qui fait son entrée dans la collection – et je suis certain que cela est vécu, par un poète français vivant, comme une espèce d’intronisation dans un singulier panthéon : on doit se sentir un peu pléiadisé, comme on dit… Il y a le délicat Richard Rognet, avec Elégies pour un temps de vivre. Dans les méandres des saisons. Il y a le solaire Abdellatif Laâbi, avec L’arbre à poèmes. Le déroutant James Sacré, et ses Figures qui bougent un peu. Nous trouvons aussi la grande poétesse luxembourgeoise Anise Koltz, à l'oeuvre abondante, méconnue, forte, avec Somnanbule du jour, Jacques Darras et L’indiscipline de l’eau, Alain Duault pou Où vont nos nuits perdues. Avant ce feu d’artifice anniversaire, ce furent, récemment, les indispensables Lusiades de Luis de Camoes, qui paraissaient. Constamment sur le qui-vive poétique, la collection emblématique alterne le classique et le moderne, l'étranger et l'hexagonal, publie anthologies et éditions bilingues, ainsi que des coffrets splendides (trois sont déjà parus), d’extraits de certains volumes devenus des indispensables, et qui constituent des cadeaux en formes
ans, riche de plus de cinq cents titres, la collection que dirige aujourd’hui André Velter, poète lui-même (Poésie/Gallimard fut lancée en 1966 par Alain Jouffroy et Robert Carlier, puis elle fut pilotée par André Fermigier, et, successivement par Jean-Loup Champion, Marc Delaunay, et enfin par André Velter depuis 1998), saisit l'occasion du Printemps de poètes pour offrir un immense bouquet de livres contemporains. Ils sont presque tous, là, sous ma main, sur la table (voir photos ci-dessus) : et tout d’abord le précieux Infiniment proche. Le désespoir n’existe pas, de Zeno Bianu - qui fait son entrée dans la collection – et je suis certain que cela est vécu, par un poète français vivant, comme une espèce d’intronisation dans un singulier panthéon : on doit se sentir un peu pléiadisé, comme on dit… Il y a le délicat Richard Rognet, avec Elégies pour un temps de vivre. Dans les méandres des saisons. Il y a le solaire Abdellatif Laâbi, avec L’arbre à poèmes. Le déroutant James Sacré, et ses Figures qui bougent un peu. Nous trouvons aussi la grande poétesse luxembourgeoise Anise Koltz, à l'oeuvre abondante, méconnue, forte, avec Somnanbule du jour, Jacques Darras et L’indiscipline de l’eau, Alain Duault pou Où vont nos nuits perdues. Avant ce feu d’artifice anniversaire, ce furent, récemment, les indispensables Lusiades de Luis de Camoes, qui paraissaient. Constamment sur le qui-vive poétique, la collection emblématique alterne le classique et le moderne, l'étranger et l'hexagonal, publie anthologies et éditions bilingues, ainsi que des coffrets splendides (trois sont déjà parus), d’extraits de certains volumes devenus des indispensables, et qui constituent des cadeaux en formes  de pavés que l’on se plait à lancer sur le lit d’une amie. Le dernier « compilait » le meilleur, de Frénaud à Robin, de Guillevic à Bonnefoy (soulignez, sur la photo ci-dessus, comme on peut monter un poème avec les titres, mis ligne à ligne, et l'un sur l'autre, de ces petits volumes). Pour l’occasion, outre les recueils de poètes contemporains précités, la collection publie une édition limitée sur fond coloré de dix titres phares (photo ci-dessous). Ne vous en privez pas : lisez et offrez des poèmes. Et longue vie à Poésie/Gallimard. L.M.
de pavés que l’on se plait à lancer sur le lit d’une amie. Le dernier « compilait » le meilleur, de Frénaud à Robin, de Guillevic à Bonnefoy (soulignez, sur la photo ci-dessus, comme on peut monter un poème avec les titres, mis ligne à ligne, et l'un sur l'autre, de ces petits volumes). Pour l’occasion, outre les recueils de poètes contemporains précités, la collection publie une édition limitée sur fond coloré de dix titres phares (photo ci-dessous). Ne vous en privez pas : lisez et offrez des poèmes. Et longue vie à Poésie/Gallimard. L.M.
Char, Apollinaire, Michaux, Perse, Ponge, Eluard, Aragon, Lorca, haïkus japonais, Neruda
René Char enluminé par Alexandre Galpérine (Gallimard) :

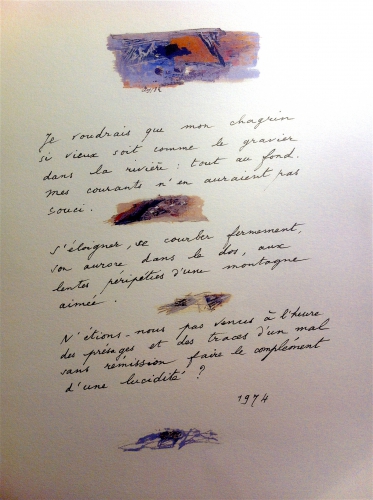
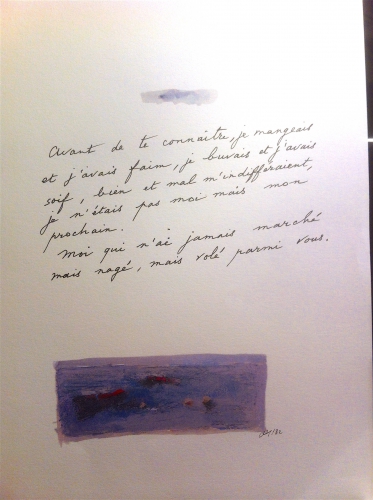
Nietzsche, l'ultime fragment d'Aurore porte à la réflexion...
Nous autres aéronautes de l’esprit. — Tous ces oiseaux hardis qui s’envolent vers des espaces lointains, toujours plus lointains, — il viendra certainement un moment où ils ne pourront aller plus loin, où ils se percheront sur un mât ou sur quelque aride récif — bien heureux encore de trouver ce misérable asile ! Mais qui aurait le droit de conclure qu’il n’y a plus devant eux une voie libre et sans fin et qu’ils ont volé si loin qu’on peut voler ? Pourtant, tous nos grands initiateurs et tous nos précurseurs ont fini par s’arrêter, et quand la fatigue s’arrête elle ne prend pas les attitudes les plus nobles et les plus gracieuses : il en sera ainsi de toi et de moi ! Mais qu’importe de toi et de moi !D’autres oiseaux voleront plus loin ! Cette pensée, cette foi qui nous anime, prend son essor, elle rivalise avec eux, elle vole toujours plus loin, plus haut, elle s’élance tout droit dans l’air, au-dessus de notre tête et de l’impuissance de notre tête, et du haut du ciel elle voit dans les lointains de l’espace, elle voit des troupes d’oiseaux bien plus puissants que nous qui s’élanceront dans la direction où nous nous élancions, où tout n’est encore que mer, mer, et encore mer ! — Où voulons-nous donc aller ? Voulons-nous franchir la mer ? Où nous entraîne cette passion puissante, qui prime pour nous toute autre passion ? Pourquoi ce vol éperdu dans cette direction, vers le point où jusqu’à présent tous les soleilsdéclinèrent et s’éteignirent ? Dira-t-on peut- être un jour de nous que, nous aussi, gouvernant toujours vers l’ouest, nous espérions atteindre une Inde inconnue, — mais que c’était notre destinée d’échouer devant l’infini ? Ou bien, mes frères, ou bien ? —
Fragment 532 :
« L’amour rend égaux ». — L’amour veut épargner à celui à qui il se voue tout sentiment d’être étranger, il est par conséquent plein de dissimulation et d’assimilation, il trompe sans cesse et il joue une égalité qui n’existe pas en réalité. Et cela se fait si instinctivement que des femmes aimantes nient cette dissimulation et cette duperie douce et continuelle et prétendent avec audace que l’amour rend égaux (ce qui veut dire qu’il fait un miracle !) — Ce phénomène est très simple lorsqu’une personne se laisse aimer, et ne juge pas nécessaire de feindre, laissant cela à l’autre personne aimante : mais il n’y a pas comédie plus embrouillée et plus inextricable que lorsque tous deux sont en pleine passion l’un pour l’autre, et que, par conséquent, chacun renonce à soi-même et se met sur le pied de l’autre, voulant partout faire comme lui : alors aucun des deux ne sait plus ce qu’il doit imiter, ce qu’il doit feindre, pour quoi il doit se donner. La belle folie de ce spectacle est trop belle pour ce monde et trop subtile pour l’œil humain.
Lisez le discours de réception d'Alain Finkielkraut, prononcé hier à l'Académie française, pour ses éclats d'intelligence purs, sa déclaration d'amour de la France à la France, pour son éloge subtil de Félicien Marceau, et lisez aussi la réponse de Pierre Nora, qui figure une sorte de bref et brillant essai. Y sont circonscrites, toutes les facettes fascinantes de la personnalité de "Finki". Voici deux purs joyaux. A lire un peu partout sur le Net, notamment ci-dessous en cliquant sur les liens dédiés :
 Ecrire sur la mort de sa mère est devenu un genre littéraire, me disait mon ami et éditeur Olivier Frébourg, tandis que je lui donnais à lire un manuscrit sur le motif. Mais nul ne semble armé pour pouvoir écrire sur la mort de son propre enfant. Pas même mon autre ami Didier Pourquery. Et pourtant Didier did it. Agathe, sa fille, était née en 1984 avec une vilaine mucoviscidose. Elle subit une, puis deux greffes de poumon, elle toussa les vingt-trois années de sa vie durant, souffrit. Elle était plus gaie que gaie, elle était intelligente, aimante, aimée, et un jour elle adressa un sms aux siens, après avoir appris de son médecin, devenu un confident, que ses jours étaient comptés, qui disait je vous aime. Et c'est là qu'en lisant L'été d'Agathe (Grasset), petit chef d'oeuvre de pudeur et d'amour viscéral, nos larmes éclatent et notre ventre se noue. Pour se détendre aussitôt, car Didier Pourquery écrit juste, avec le ton exact, la mesure du mot, le sens de l'émotion contenue, du tact idoine, la vérité crue au bout du stylo (nous l'entendons écrire), même si parfois cela déborde, et c'est normal. Le père ne cache pas combien il est souvent désemparé, maladroit, impuissant, lorsqu'il doit improviser devant tant d'inédit et de douleur à dompter du mieux qu'il peut. L'auteur achève cette adresse à sa fille d'un Je t'aime qui prend le poids, énorme, de l'aile du papillon que porte une fourmi, comme l'écrivit Ungaretti. Didier avait repris ses carnets de notes - il a tant noté tandis qu'il espérait de toutes ses forces, avec la mère et les soeurs d'Agathe, et tandis que sa fille vivait, entre un hôpital et l'île d'Oléron, où, un jour d'août 2007, elle fut dispersée par des parents pieds nus - ainsi qu'elle le désirait, et il a accompli un devoir extraordinaire de père. Celui que nul ne souhaite à aucun homme. Et cela donne un livre précieux entre tous, parce qu'il nous parle, avec les mots simples de l'amour et de la douleur que l'on s'efforce d'enfouir, avec des mots empreints d'une douceur et d'une grâce magiques, de l'existence essentielle. Un livre surhumain. L.M.
Ecrire sur la mort de sa mère est devenu un genre littéraire, me disait mon ami et éditeur Olivier Frébourg, tandis que je lui donnais à lire un manuscrit sur le motif. Mais nul ne semble armé pour pouvoir écrire sur la mort de son propre enfant. Pas même mon autre ami Didier Pourquery. Et pourtant Didier did it. Agathe, sa fille, était née en 1984 avec une vilaine mucoviscidose. Elle subit une, puis deux greffes de poumon, elle toussa les vingt-trois années de sa vie durant, souffrit. Elle était plus gaie que gaie, elle était intelligente, aimante, aimée, et un jour elle adressa un sms aux siens, après avoir appris de son médecin, devenu un confident, que ses jours étaient comptés, qui disait je vous aime. Et c'est là qu'en lisant L'été d'Agathe (Grasset), petit chef d'oeuvre de pudeur et d'amour viscéral, nos larmes éclatent et notre ventre se noue. Pour se détendre aussitôt, car Didier Pourquery écrit juste, avec le ton exact, la mesure du mot, le sens de l'émotion contenue, du tact idoine, la vérité crue au bout du stylo (nous l'entendons écrire), même si parfois cela déborde, et c'est normal. Le père ne cache pas combien il est souvent désemparé, maladroit, impuissant, lorsqu'il doit improviser devant tant d'inédit et de douleur à dompter du mieux qu'il peut. L'auteur achève cette adresse à sa fille d'un Je t'aime qui prend le poids, énorme, de l'aile du papillon que porte une fourmi, comme l'écrivit Ungaretti. Didier avait repris ses carnets de notes - il a tant noté tandis qu'il espérait de toutes ses forces, avec la mère et les soeurs d'Agathe, et tandis que sa fille vivait, entre un hôpital et l'île d'Oléron, où, un jour d'août 2007, elle fut dispersée par des parents pieds nus - ainsi qu'elle le désirait, et il a accompli un devoir extraordinaire de père. Celui que nul ne souhaite à aucun homme. Et cela donne un livre précieux entre tous, parce qu'il nous parle, avec les mots simples de l'amour et de la douleur que l'on s'efforce d'enfouir, avec des mots empreints d'une douceur et d'une grâce magiques, de l'existence essentielle. Un livre surhumain. L.M.
C'est l'un des plus beaux passages du Roi des Aulnes, de Michel Tournier, qui vient de nous quitter. Page 223 (en collection Blanche, de 1970), voici que l'ogre de Rominten, qui figure Göring, grand amateur de chasse, de venaison, de grands vins de Bourgogne et de Bordeaux, et aussi d'excès en tous genres, se trouve face à un grand cerf, le Candélabre :
 L'un des plus nobles Reichjägermeisterhirsche était à coup sûr le Candélabre dont l'Oberforstmeister tenait la chronique presque mois par mois, et qui promettait de devenir le roi des hardes de Rominten. Un soir que Göring, emmitouflé comme un ours, piétinait lourdement dans la neige molle pour relever des traces de loups qu'on lui avait signalées, le Candélabre surgit, comme une apparition, dans un entrelacs de rameaux givrés. Sombre statue d'ébène, il portait haut sur son encolure musculeuse un buisson de vingt-quatre andouillers distribués aussi régulièrement que les nervures d'un cristal de glace. Il était grand et droit comme un arbre, un arbre vivant et respirant, aux oreilles dardées, aux yeux clairs comme des miroirs, qui faisait face aux trois hommes. Les bajoues du grand veneur se mirent à trembler.
L'un des plus nobles Reichjägermeisterhirsche était à coup sûr le Candélabre dont l'Oberforstmeister tenait la chronique presque mois par mois, et qui promettait de devenir le roi des hardes de Rominten. Un soir que Göring, emmitouflé comme un ours, piétinait lourdement dans la neige molle pour relever des traces de loups qu'on lui avait signalées, le Candélabre surgit, comme une apparition, dans un entrelacs de rameaux givrés. Sombre statue d'ébène, il portait haut sur son encolure musculeuse un buisson de vingt-quatre andouillers distribués aussi régulièrement que les nervures d'un cristal de glace. Il était grand et droit comme un arbre, un arbre vivant et respirant, aux oreilles dardées, aux yeux clairs comme des miroirs, qui faisait face aux trois hommes. Les bajoues du grand veneur se mirent à trembler.


CommuniquéToutes nos vies 2.pdf
Stéphane Guibourgé, l'un des meilleurs écrivains français vivants, en est l'auteur. Alors précipitez-vous vers un inexorable bonheur de lecture, un plaisir du texte avoué. Ici, tout n'est que sensibilité, poésie, écorche vive, peaux à nu, vérité fondamentale, mots dits essentiels, par l'homme lige et la femme fatale, sentiments extrêmes, regards tus, sexes purs, amour dur, et intransigeant.
¡Vaya!
Merci à Clotilde Briard :
Ce papier sur mon dicOchic (lien ci-dessous, et extrait) :
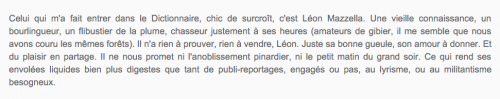
Merci à Orianne Nouailhac, qui pilote Vigneron magazine.
Ce weel-end (5/6 décembre):
Salon du livre de Boulogne-Billancourt (Espace Landowsky) : présentation - signature du "Dictionnaire chic du vin" (éd. Ecriture), samedi et dimanche après-midi.
http://salonlivrebb.blogspot.fr/p/auteurs-2015.html
Puis, signatures-lectures-dégustations la semaine prochaine au Pays basque :
Jeudi 10 déc., dès 19h, à La Galupe, restaurant-librairie à Urt (au bord de l'Adour, près de Bayonne, "chez Barthes"!..).
Samedi 12 déc. à partir de 19h à l'Hôtel-spa Regina (Biarritz), et dès le matin, chez Christian Bedat, caviste indépendant à Biarritz-La Négresse : aux Celliers des Docks, donc. Venez nombreux, ça sent Noël, et les cadeaux... Héhé...
Et encore, le 22 déc., à la librairie L'Alinéa (Bayonne).


http://www.gourmetsandco.com/culture/15320-dictionnaire-chic-du-vin-leon-mazella
Parue ce matin (notule de Michel Dovaz) :

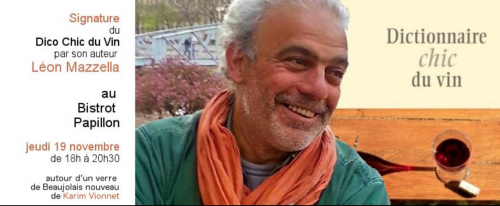
6, rue Papillon, 75009 Paris.

Papier initialé J.-M. L. S.
Confirmez (par téléphone) si vous venez. On mangera et on boira bon. Basque et bon.
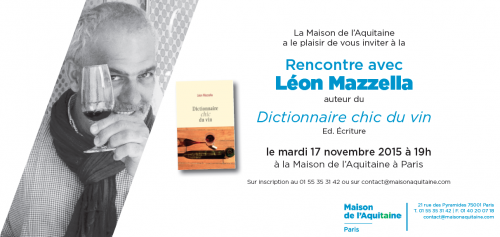
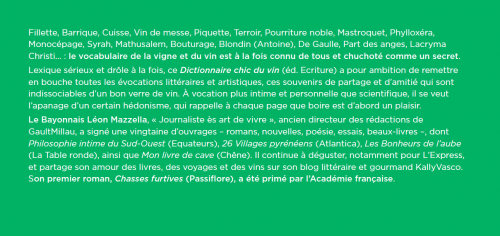
 Le vin sans additif rend addictif et c'est heureux. Antonin Iommi-Amunategui part en guerre contre les intrants, ces ajouts peu amènes qui dopent la vigne en la dévoyant, la chimie aidant. Avec son Manifeste pour le vin naturel (éd. de l'épure), mince (24 pages, 7€) comme une tranche de serrano, mais précieux comme un flacon de The Picrate, ce blogueur (allez surfer sur no wine is innocent), engagé mais calme, fixe correctement les points sur les "i", afin de (tenter de) clouer le bec aux apôtres aveugles du vin chimiquement trafiqué, cela en vissant quelques vérités neuves, ou en cours de développement. Autrement dit, sa plaquette sent le soufre, mais elle n'en contient pas, et son discours est à peine filtré. Camus aurait appelé cela la radicalité de la nuance. Le vin dit naturel, ou vivant, résumé "bio" par commodité, car nous nous perdons encore souvent dans le maquis des dénominations, entre certificat Ecocert, TerraVitis, conversion en trois ans, label AB, et j'en passe, sans oublier l'étage supérieur de la biodynamie, qui n'a rien à boire... Mais ce n'est pas le sujet de ce papier. Le vin naturel, donc, n'est plus un vin à la mode bobo, élaboré à la va comme je te pousse, consommé uniquement dans les bistros parisiens branchés par des gosiers qui ne connaissent que l'épate et capables d'avaler du vinaigre en disant c'est super!, un vin qui, il faut l'avouer, a réservé et réserve encore son lot de mauvaises surprises organoleptiques (l'intervention humaine, au moins a minima, ne remplacera jamais complètement le laisser-faire total de la nature). L'effet prend racine, s'étend, se propage façon puzzle sur l'ensemble du territoire, car les vignerons (pas) réunis se posent question, échangent timidement et agissent ici et là. Le consommateur suit, porté par le souci élémentaire de cesser d'engloutir des saloperies. Aujourd'hui, la consommation de vins plus ou moins purs ne cesse de croître. Le marché du vin bio hexagonal, lisais-je cette semaine, c'est plus de 64 000 ha de vignes (et ça continue d'augmenter, surtout en Espagne et en Italie). Cela représente, en France, en 2015, 11% du marché des produits issus de l'agriculture biologique. Et ce vin-là commence à bien s'exporter vers des marchés dits traditionnels (Allemagne, Royaume-Uni). Un signe. Le phénomène est par conséquent désormais pris au sérieux. Et nous espérons qu'il gardera encore longtemps tout ce qui bâtit sa bienheureuse singularité, à savoir ses côtés artisanal (small is always beautiful), sain, traçable, durable, et non plus seulement rousseauiste, version simpliste, baba, bobo : Ca, c'était avant, soit hier à peine. Antonin l'exprime d'emblée : J'ai pris trop mon pied avec des vins naturels pour ne pas les défendre en tant que catégorie : celle, bancale, polémique, du vin idéal. Un brin utopiste, l'auteur pourrait convaincre son lecteur qu'un vin idéal peut cohabiter dans un monde meilleur, ou bien qu'un monde idéal pourrait voir le jour, où l'on ne boirait que des vins naturels, donc meilleurs (car il est surtout question de goût, avec les vins naturels). Le paradoxe de ce type d'entreprise - que nous partageons à 100% -, est qu'il pourrait à terme noyer (je n'ai pas dit broyer) le vin naturel dans les rouages de la grande distribution actuelle, au lieu de quoi, vécu encore comme une rareté (sa quête procure des plaisirs de copains en vadrouille sur le chemin des zincs), il se recherche et se trouve chez les passeurs que sont les cavistes avisés, et dans les bistrots malins, au coeur desquels le taulier comme le client aiment donner du temps au temps, et de rire et d'aimer le simple, le beau, le bon. Puis, vient le plaisir du partage, en faisant passer. La dissémination agit bien ainsi, façon missi dominici soft. Car, méfions-nous : lorsque la parole est, ne serait-ce qu'un rien imposée, elle sent le diktat et cela n'est historiquement jamais bon, voire contreproductif, à l'instar de certaines révolutions. Brandir des dieux comme Jules Chauvet sent parfois la secte, donc l'exclusion. Condamner sans appel celui qui soufre (son vin) est stupide (et pis, en plus, ne pas soufrer a minima et à la "mise", c'est la garantie de produire de la piquette! CQFD). Ces manières de faire, non seulement divisent, mais font fuir le curieux volontaire. En revanche, militer, répandre la parole, faire goûter, informer en somme, tout bonnement, creuse le sillon, certes à la vitesse de l'escargot (slowly), ou de la tortue de la fable, mais sûrement. Je réfuterai, pour qualifier ce petit livre salutaire, l'emploi du mot combat, trop guerrier, ou bien pas assez pacifique, et donc oxymorique. Le vin nu, selon la belle expression donnée par Alice Feiring, citée par l'auteur, a toujours été là, précise Antonin. Ce n'est donc pas une mode, enchérit-il. Et d'affirmer aussitôt que son avénement est un retour qui est aussi une avancée. Lumineux! Le livre passe également en revue l'oeuvre de personnages emblématiques, de Jacques Néauport (théoricien fondamental à la parole pleine de bon sens : le vin naturel, c'est tout bête, c'est un vin sans intrants, c'est tout) à Eric Callcut (et son vin Graal), en passant par Thierry Puzelat, Pierre Overnoy ou encore Olivier Cousin (vignerons de respect). Enfin, la question qui se pose à tout produit qui prend ainsi de l'envergure, est sa nécessaire réglementation. Certains rebelles la refusent au nom d'une indépendance anti normative. Discours vain, statique, obtus, voire réactionnaire, à nos yeux. Force est d'admettre qu'une reconnaissance légale claire hisserait, distinguerait, identifierait le produit. Et le protègerait des sournoiseries industrielles. Débat en cours. Chacun semble au moins s'accorder sur la nécessité de nommer tous les ingrédients contenus dans une bouteille de vin, puisque le jus de la treille fermenté demeure l'un des derniers produits alimentaires emballés à pouvoir se passer de ces informations capitales, et réputées obligatoires depuis belle lurette. Par bonheur, les gardiens du temple comme Antonin Iommi-Amunategui veilleront toujours au raisin. Prenons-en de la graine. L.M.
Le vin sans additif rend addictif et c'est heureux. Antonin Iommi-Amunategui part en guerre contre les intrants, ces ajouts peu amènes qui dopent la vigne en la dévoyant, la chimie aidant. Avec son Manifeste pour le vin naturel (éd. de l'épure), mince (24 pages, 7€) comme une tranche de serrano, mais précieux comme un flacon de The Picrate, ce blogueur (allez surfer sur no wine is innocent), engagé mais calme, fixe correctement les points sur les "i", afin de (tenter de) clouer le bec aux apôtres aveugles du vin chimiquement trafiqué, cela en vissant quelques vérités neuves, ou en cours de développement. Autrement dit, sa plaquette sent le soufre, mais elle n'en contient pas, et son discours est à peine filtré. Camus aurait appelé cela la radicalité de la nuance. Le vin dit naturel, ou vivant, résumé "bio" par commodité, car nous nous perdons encore souvent dans le maquis des dénominations, entre certificat Ecocert, TerraVitis, conversion en trois ans, label AB, et j'en passe, sans oublier l'étage supérieur de la biodynamie, qui n'a rien à boire... Mais ce n'est pas le sujet de ce papier. Le vin naturel, donc, n'est plus un vin à la mode bobo, élaboré à la va comme je te pousse, consommé uniquement dans les bistros parisiens branchés par des gosiers qui ne connaissent que l'épate et capables d'avaler du vinaigre en disant c'est super!, un vin qui, il faut l'avouer, a réservé et réserve encore son lot de mauvaises surprises organoleptiques (l'intervention humaine, au moins a minima, ne remplacera jamais complètement le laisser-faire total de la nature). L'effet prend racine, s'étend, se propage façon puzzle sur l'ensemble du territoire, car les vignerons (pas) réunis se posent question, échangent timidement et agissent ici et là. Le consommateur suit, porté par le souci élémentaire de cesser d'engloutir des saloperies. Aujourd'hui, la consommation de vins plus ou moins purs ne cesse de croître. Le marché du vin bio hexagonal, lisais-je cette semaine, c'est plus de 64 000 ha de vignes (et ça continue d'augmenter, surtout en Espagne et en Italie). Cela représente, en France, en 2015, 11% du marché des produits issus de l'agriculture biologique. Et ce vin-là commence à bien s'exporter vers des marchés dits traditionnels (Allemagne, Royaume-Uni). Un signe. Le phénomène est par conséquent désormais pris au sérieux. Et nous espérons qu'il gardera encore longtemps tout ce qui bâtit sa bienheureuse singularité, à savoir ses côtés artisanal (small is always beautiful), sain, traçable, durable, et non plus seulement rousseauiste, version simpliste, baba, bobo : Ca, c'était avant, soit hier à peine. Antonin l'exprime d'emblée : J'ai pris trop mon pied avec des vins naturels pour ne pas les défendre en tant que catégorie : celle, bancale, polémique, du vin idéal. Un brin utopiste, l'auteur pourrait convaincre son lecteur qu'un vin idéal peut cohabiter dans un monde meilleur, ou bien qu'un monde idéal pourrait voir le jour, où l'on ne boirait que des vins naturels, donc meilleurs (car il est surtout question de goût, avec les vins naturels). Le paradoxe de ce type d'entreprise - que nous partageons à 100% -, est qu'il pourrait à terme noyer (je n'ai pas dit broyer) le vin naturel dans les rouages de la grande distribution actuelle, au lieu de quoi, vécu encore comme une rareté (sa quête procure des plaisirs de copains en vadrouille sur le chemin des zincs), il se recherche et se trouve chez les passeurs que sont les cavistes avisés, et dans les bistrots malins, au coeur desquels le taulier comme le client aiment donner du temps au temps, et de rire et d'aimer le simple, le beau, le bon. Puis, vient le plaisir du partage, en faisant passer. La dissémination agit bien ainsi, façon missi dominici soft. Car, méfions-nous : lorsque la parole est, ne serait-ce qu'un rien imposée, elle sent le diktat et cela n'est historiquement jamais bon, voire contreproductif, à l'instar de certaines révolutions. Brandir des dieux comme Jules Chauvet sent parfois la secte, donc l'exclusion. Condamner sans appel celui qui soufre (son vin) est stupide (et pis, en plus, ne pas soufrer a minima et à la "mise", c'est la garantie de produire de la piquette! CQFD). Ces manières de faire, non seulement divisent, mais font fuir le curieux volontaire. En revanche, militer, répandre la parole, faire goûter, informer en somme, tout bonnement, creuse le sillon, certes à la vitesse de l'escargot (slowly), ou de la tortue de la fable, mais sûrement. Je réfuterai, pour qualifier ce petit livre salutaire, l'emploi du mot combat, trop guerrier, ou bien pas assez pacifique, et donc oxymorique. Le vin nu, selon la belle expression donnée par Alice Feiring, citée par l'auteur, a toujours été là, précise Antonin. Ce n'est donc pas une mode, enchérit-il. Et d'affirmer aussitôt que son avénement est un retour qui est aussi une avancée. Lumineux! Le livre passe également en revue l'oeuvre de personnages emblématiques, de Jacques Néauport (théoricien fondamental à la parole pleine de bon sens : le vin naturel, c'est tout bête, c'est un vin sans intrants, c'est tout) à Eric Callcut (et son vin Graal), en passant par Thierry Puzelat, Pierre Overnoy ou encore Olivier Cousin (vignerons de respect). Enfin, la question qui se pose à tout produit qui prend ainsi de l'envergure, est sa nécessaire réglementation. Certains rebelles la refusent au nom d'une indépendance anti normative. Discours vain, statique, obtus, voire réactionnaire, à nos yeux. Force est d'admettre qu'une reconnaissance légale claire hisserait, distinguerait, identifierait le produit. Et le protègerait des sournoiseries industrielles. Débat en cours. Chacun semble au moins s'accorder sur la nécessité de nommer tous les ingrédients contenus dans une bouteille de vin, puisque le jus de la treille fermenté demeure l'un des derniers produits alimentaires emballés à pouvoir se passer de ces informations capitales, et réputées obligatoires depuis belle lurette. Par bonheur, les gardiens du temple comme Antonin Iommi-Amunategui veilleront toujours au raisin. Prenons-en de la graine. L.M.
Mazzella_Dictionnaire chic du vin_Tentation_Automne 2015.pdf

http://gretagarbure.com/2015/10/11/nos-mille-feuilles-nos-feuilletages-de-la-semaine-66/
Le début du papier (cliquez ci-dessus pour le lire in extenso) :
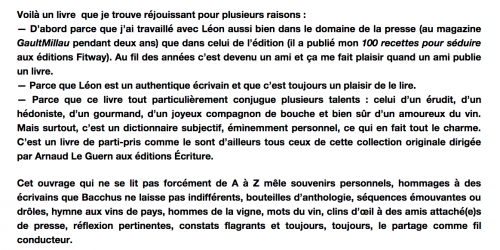
Dans le magazine Saveurs paru hier :
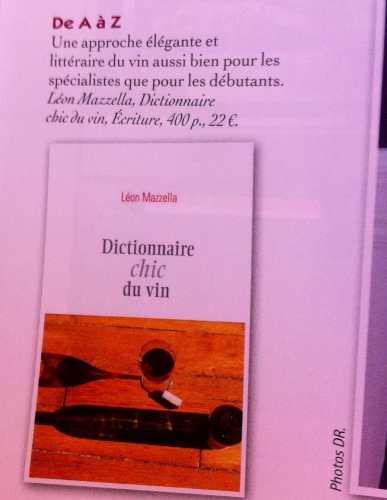

Mazzella_Dictionnaire chic du vin_Terredevins.fr_7 octobre 2015.pdf
Après un papier d'Isabelle de Montvert-Chaussy dans le magazine Terre de Vins de septembre (version papier), voici un papier Net + Tweeter de Benoît Lasserre, dans le même support : re-merci à BL qui remet donc le cou-verre, après Sud-Ouest (lire post précédent).

Merci à Benoît Lasserre :
Mazzella_Dictionnaire chic du vin_SudOuest.fr_7 octobre 2015.pdf

http://www.editionsecriture.com/actualite/?id=89171

http://www.cafe-litteraire68.com/#!les-evenements/c188p

Les éditions ECRITURE ont la réponse :
https://www.dropbox.com/s/jdt3pym0tvioni8/BROCHURE-CHIC-SS%20TRAITS.pdf?dl=0

H-S Passion du Vin. Merci à Sylvie Bodin pour ce papier.
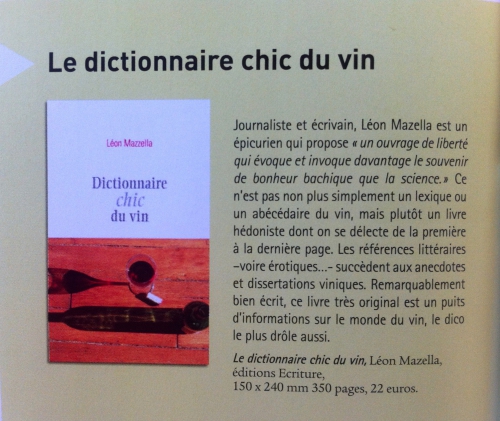
Au Clos de Vougeot (Bourgogne), le week-end dernier (salon Livres en Vignes) :
 Sur le chemin clos qui mène à Vougeot.
Sur le chemin clos qui mène à Vougeot.

Une élégante cherche l'auteur... qui la photographie.
Du beau monde venu signer.


Le dîner du chapitre (samedi) roboratif à souhait (Livres en Vignes ou l'autre salon du cholestérol)...
Ce joli papier de JP Gené, dans Le Monde ainsi qu'une mention de la collection dans L'Obs qui paraît ce matin. C'est la journée, après Lire (voir le post précédent, ci-dessous), who's next avant ce soir?..
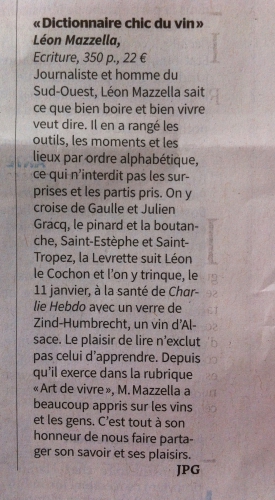


Un joli papier signé Christine Ferniot :


 Dans le n°118 qui paraît, le bel article de Jean-Marc Gatteron :
Dans le n°118 qui paraît, le bel article de Jean-Marc Gatteron :
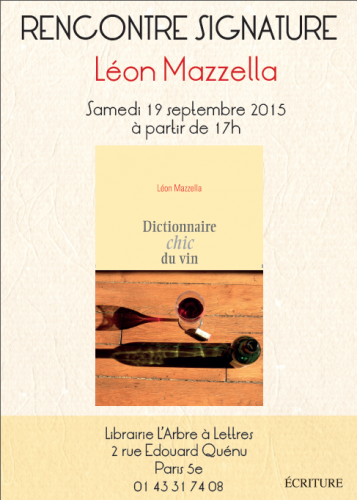
(Merci à Christian Authier pour cette belle page).
Si vous n'avez rien de mieux à écouter tout à l'heure (de 20h à 21h), allumez la radio : l'émission de Frédéric Taddei, "Europe1 Social Club", accueille Denis Tillinac, Serge Bramly, Christian Berst et votre serviteur.

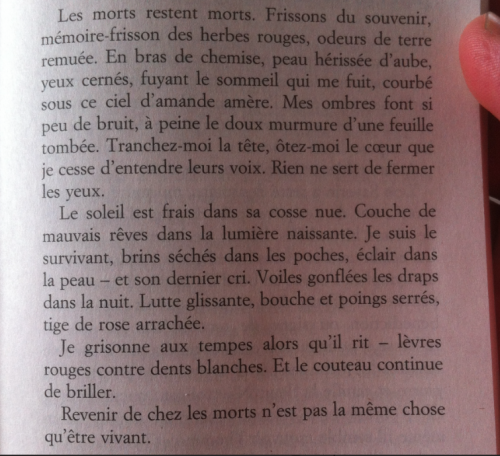 ... de pénétrer une oeuvre est souvent d'en lire la première page. L'incipit, et au-delà de lui. Voici celle des Nouveaux monstres, de Simonetta Greggio, qui reparaît en format de poche et qui fait suite à son magnifique Dolce Vita (Stock, et Poche). Ce livre, qui resserre, relate, compresse, analyse, crie, les années 1978-2014 en Italie, son pays, cette Botte tissée de relations troubles, impures, incestueuses, grotesques, picaresques, baroques, insolentes et risibles comme certaines amours - entre l'Etat, le Vatican (l'autre Etat) et la Mafia (l'Etat suprême?). Un grand livre.
... de pénétrer une oeuvre est souvent d'en lire la première page. L'incipit, et au-delà de lui. Voici celle des Nouveaux monstres, de Simonetta Greggio, qui reparaît en format de poche et qui fait suite à son magnifique Dolce Vita (Stock, et Poche). Ce livre, qui resserre, relate, compresse, analyse, crie, les années 1978-2014 en Italie, son pays, cette Botte tissée de relations troubles, impures, incestueuses, grotesques, picaresques, baroques, insolentes et risibles comme certaines amours - entre l'Etat, le Vatican (l'autre Etat) et la Mafia (l'Etat suprême?). Un grand livre.
Mon Dictionnaire chic du vin figure dans la première sélection du Prix Renaudot essai, selon le site de L'Obs : bibliobs (cliquer ci-dessous), mais pas sur les listes publiées par les sites du Figaro (lefigaro.fr) et du Monde (lemonde.fr). On se calme : Sherlock-Bacchus mène l'enquête!..

 Un papier d'Emmanuel Hecht sur mon dicOchic. Détail : je cherche l'auteur des jeux de mots cités, qui sont anonymes.
Un papier d'Emmanuel Hecht sur mon dicOchic. Détail : je cherche l'auteur des jeux de mots cités, qui sont anonymes.
Enfin : le livre paraît le 16. Réservez-le.
http://www.lexpress.fr/culture/livre/l-homme-des-tavernes-de-a-a-z_1714398.html
Précision : le livre paraît le 16.

http://www.theglamattitude.com/index.php/indispensable-dictionnaire-chic-du-vin/
 Le meilleur livre de la rentrée de septembre est paru en juin. Les Œuvres complètes de l’immense Louis-René des Forêts (1918-2000), sont le très beau cadeau de l’été, que la collection Quarto de Gallimard (une collection qui se bonifie considérablement avec le temps *, en laissant sur le carreau ses concurrentes : Bouquins/Laffont, Omnibus), a fait aux aficionados de l’auteur inoubliable du Bavard et d’Ostinato, pour ne citer que deux ouvrages majeurs que l’on se plait à relire régulièrement, pour le plaisir de la langue, celui de l’émotion forte, très forte, que des Forêts instille (« faire passer dans les mots la sève fertilisante sans laquelle ils ne sont que du bois mort »). L’édition, assurée par le talentueux Dominique Rabaté, universitaire sans les défauts inhérents à la profession, est un spécialiste de l’auteur. Le volumineux pavé (1342 pages) s’ouvre sur un précieux album de famille, où de nombreuses photos, des lettres (pas seulement à des écrivains célèbres, mais aussi à des amis très chers – comme l’entendait Montaigne, et pas facebook -, tels Jean de Frotté), une biographie précise et chaleureuse, sont agréablement dispersées, afin d’entrer dans l’œuvre – par une nouvelle inédite, de surcroît, intitulée Les Coupables -, de la manière la plus douce qui soit, la plus musicale, pourrait-on dire, puisque Louis-René des Forêts fut habité toute sa vie par la musique, au point de faire de son premier roman, Les Mendiants, une sorte de suite polyphonique, et de chacun de ses livres, l’écho au « fil conducteur » de son existence. Le volume que nous tenons en mains est par ailleurs riche de témoignages nombreux et prestigieux, qui vont de Maurice Blanchot (et son célèbre texte sur Le Bavard, intitulé La Parole vaine, qui figura dans une édition rare en 10/18), à Jean-Louis Ezine (un entretien clé à propos d’Ostinato), en passant par Philippe Jaccottet (superbe texte d’analyse droite et rigoureuse d’un écrivain que le grand poète de Grignan admire), Michel Leiris, Raymond Queneau (des Forêts participa avec Monsieur Zazie, à la création de l’Encyclopédie de La Pléiade, avant de devenir membre du comité de lecture de « la Banque de France de l’édition », laquelle publia, avec sa filiale le Mercure de France, la majeure partie de son œuvre), et encore André Frénaud, Pascal Quignard, Marcel Arland, Jean Roudaut, Pierre Klossowski, Charles du Bos, André du Bouchet… Du beau linge, et des textes enrichissants, tant sur ce que l’on apprend de l’auteur de Pas à pas jusqu’au dernier, que sur le travail, l’écriture ou tout simplement l’amitié de ces compagnons de route, de ces « alliés substantiels ». Il fut beaucoup reproché à des Forêts de cesser d’écrire, après avoir conquis un lectorat fidèle et ayant pris goût. Il se mit alors à peindre dix années durant et se tût – littérairement -, environ dix de plus (et le volume « donne à voir » ses peintures, tourmentées, imprégnées à la fois d’un surréalisme figuratif, et d’une fantasmagorie à la Jérôme Bosch). Il faut savoir que l’année 1965 fut la cassure majeure de la vie de l’écrivain. Sa fille Elisabeth mourut accidentellement à l’âge de quatorze ans, et d’une telle déchirure, nul ne se remet. Cependant, le père terrassé, désagrégé, commence alors à bâtir en silence, pierre à pierre, un travail de deuil qui ressemble à la tâche de Sisyphe, ou bien à une entreprise vaine et condamnée d’avance. Cela s’appellera, après plusieurs tentatives de renoncement, quelques publications fragmentaires en revue, Ostinato, en 1997. (Au Mercure de France d’abord, dans L’Imaginaire/Gallimard aujourd’hui, en plus de l’édition monumentale dont nous rendons compte). Un chef d’œuvre, même si cette expression est par trop usitée et par conséquent galvaudée. Un livre inclassable et incassable, bien qu’il semble fait de cristal. Et de cendre, ou plutôt de pluie d’étoiles. Ostinato, ou obstinément, le devoir d’achèvement, est l'un des plus somptueux hommages faits à la langue française de ces dernières décennies. Ce livre semble avoir été écrit comme Beethoven composa ses plus beaux quatuors, soit une fois devenu totalement sourd. Des Forêts l’entendait un peu, et sans forfanterie, de cette oreille (et il les avait grandes). Ostinato, avec Le Bavard, Les Mégères de la mer, les Poèmes de Samuel Wood aussi, sont de ces textes que l’on a plaisir à lire à voix haute à un être cher, tout en marchant, livre en main, dans la campagne ou dans un sous-bois. Livre de recueillement, long poème en prose, livre d’une vie, livre-vie, livre de la déchirure et de l’impossible reconstruction, il est l’offrande musicale d’un auteur précieux et trop méconnu, à la fois à la littérature, au questionnement sur la langue – son pouvoir, sa raison d’être pour l’auteur, et pour un hypothétique lecteur aussi -, à cette « vieille arme ébréchée du langage », et enfin à l’essence de la vie même. Nous imaginons sans peine Le Bavard et son célèbre incipit : « Je me regarde souvent dans la glace. », lu au théâtre par un Sami Frey, un Claude Rich, un Jean-François Balmer (à la manière des Braises, de Sandor Marai, ou de Novecento, d’Alessandro Baricco, ou encore de Pour un oui ou pour un non, de Nathalie Sarraute : vous voyez ?..). Car il y a dans chacun des livres de Louis-René des Forêts, à la fois la suggestion musicale et le plaisir du texte qui ne demande qu’à être partagé… musicalement, fut-ce à la voix, notre principal, primitif instrument. Des Forêts est encore de ces noms d’auteurs qui se chuchotent. Le seul fait d’apercevoir quelqu’un lire l’un de ses livres, dans un transport en commun par exemple (mais cela est rarissime), suffit à nous persuader que nous appartenons à une même confrérie, et que nous souhaitons, l’inconnu(e) comme soi-même, qu’elle ne demeure pas une société secrète. La littérature a le don subtil de générer ce type de menu plaisir; et c’est heureux. Ecoutons Dominique Rabaté, qui ouvre son texte de présentation avec ces mots : « L’éclat du rire, le sel des larmes et la toute-puissante sauvagerie : voilà en une formule ternaire magnifique ce à quoi fait encore appel Louis-René des Forêts dans le dernier de ses grands livres, Ostinato. La vivacité d’une ironie frondeuse, l’amertume vivifiante qui déchire le cœur mais le baigne de sève marine, le sursaut de révolte puisé à même la force du monde extérieur auquel il faut s’accorder, ce sont là les qualités de cette ‘’voix de l’enfant’’ dont son œuvre fait résonner toutes les harmoniques. » Des Forêts fut toute sa vie également habité par la poésie. Ses amis et compagnons de la revue L’Ephémère se nomment Paul Celan, Jacques Dupin, Yves Bonnefoy, en plus des du Bouchet et Leiris précités. Les « voies et détours de sa fiction » emprunteront ainsi les voies royales du poème (de facture volontiers classique, voire hugolienne), en plus de la peinture. Sans jamais oublier une portée musicale pour toile de fond. Ce trio d’expressions, cette recherche pugnace de la clé qui ouvrira(it) tout, empêcheront ce « vœu de silence » majuscule qui manqua priver le lecteur de certains livres importants de Louis-René des Forêts, sommes-nous tentés d’ajouter égoïstement. L’auteur vécut si douloureusement cette « interminable expiation qui se vit dans la déchéance de survivre »... Habité par une « souffrance qui frappe si haut que la voix se retire », des Forêts lâcha : « S’imposer silence par dévotion au langage, c’est aussi comme sous-entendre que les mots sont facteurs de dévoiement. » Louis-René des Forêts fut encore l’écrivain braconnier qui pratiquait le détournement. Mais la littérature ne peut-elle pas être définie par le seul mot de détour ? C’est en tout cas ce que nous croyons fermement. A cet instant, il convient de prévenir de deux choses : des Forêts a été perçu comme « un écrivain pour écrivains ». Vous savez, cette expression commode qui permet de mettre dans un tiroir les très grands comme Julien Gracq, les maîtres, les « patrons », aurait dit Nourissier, en interdisant de facto leur accès « gratuit ». Un aveu d'élitisme corportatiste, en somme… Cela est considérablement réducteur, même si c'est extrêmement flatteur pour l’auteur qui se voit ainsi « classé ». Or, des Forêts est bien plus qu’un auteur que ses pairs respectent et dont ils se défendent de s’inspirer (tout au plus s’en imprègnent-ils, et c’est déjà un baume, un onguent suffisants). Il ne fut pas non plus, un précurseur ou un apôtre, à son corps défendant, de l’autofiction, et encore moins un adepte de la confession narcissique. Ni La Chambre des enfants, encore moins Face à l’immémorable – belle réflexion sur l’acte grave d’écrire -, ou même Le Malheur au Lido, ne constituent des textes dont une impudeur à peine déguisée aurait guidé la plume de leur auteur. Dominique Rabaté évoque plutôt une « autobiographie extérieure » (à propos d’Ostinato), comme on peut parler, avec humour, de journal extime, dès lors que l’on décide de rendre public ses carnets… Suivant en cela la belle formule du critique Robert Kanters (nous citons de mémoire) : « Le roman et le journal intime sont comme le vêtement et sa doublure, et cette dernière est d’une étoffe si fine et si précieuse que l’on peut être tenté de porter un jour le vêtement retourné. » En lisant des Forêts, auteur fragile, nous relevons des « manières de traces », nous découvrons « le corps obscurci de la mémoire », « tout ce qui respire à ciel ouvert » (couleurs, odeurs, humeurs), là où « le temps reste à la neige, le cœur brûlant toujours d’anciennes fièvres ». Nous éprouvons physiquement l’épaisseur des silences en picorant ses livres, et nous écoutons « les sourdes vibrations de sa fièvre prise comme un fleuve dans le gel qui craque au premier souffle printanier. » Une phrase, magnifique entre toutes, suffit à circonscrire l’âme et la rigueur de la prose poétique de son auteur : « Que jamais la voix de l’enfant en lui ne se taise, qu’elle tombe comme un don du ciel offrant aux mots desséchés l’éclat de son rire, le sel de ses larmes, sa toute-puissante sauvagerie. » Qu’on ne se méprenne donc pas : des Forêts a toujours tenu son je à distance, en respectant cette pudeur essentielle qui distinguera toujours le vécu mis en prose du livre authentique. C’est ainsi que, depuis Lucrèce, une voix intérieure, « venue d’ailleurs », parfois, peut toucher à l’universel. Cela s’appelle encore la littérature. Faites passer. Léon Mazzella
Le meilleur livre de la rentrée de septembre est paru en juin. Les Œuvres complètes de l’immense Louis-René des Forêts (1918-2000), sont le très beau cadeau de l’été, que la collection Quarto de Gallimard (une collection qui se bonifie considérablement avec le temps *, en laissant sur le carreau ses concurrentes : Bouquins/Laffont, Omnibus), a fait aux aficionados de l’auteur inoubliable du Bavard et d’Ostinato, pour ne citer que deux ouvrages majeurs que l’on se plait à relire régulièrement, pour le plaisir de la langue, celui de l’émotion forte, très forte, que des Forêts instille (« faire passer dans les mots la sève fertilisante sans laquelle ils ne sont que du bois mort »). L’édition, assurée par le talentueux Dominique Rabaté, universitaire sans les défauts inhérents à la profession, est un spécialiste de l’auteur. Le volumineux pavé (1342 pages) s’ouvre sur un précieux album de famille, où de nombreuses photos, des lettres (pas seulement à des écrivains célèbres, mais aussi à des amis très chers – comme l’entendait Montaigne, et pas facebook -, tels Jean de Frotté), une biographie précise et chaleureuse, sont agréablement dispersées, afin d’entrer dans l’œuvre – par une nouvelle inédite, de surcroît, intitulée Les Coupables -, de la manière la plus douce qui soit, la plus musicale, pourrait-on dire, puisque Louis-René des Forêts fut habité toute sa vie par la musique, au point de faire de son premier roman, Les Mendiants, une sorte de suite polyphonique, et de chacun de ses livres, l’écho au « fil conducteur » de son existence. Le volume que nous tenons en mains est par ailleurs riche de témoignages nombreux et prestigieux, qui vont de Maurice Blanchot (et son célèbre texte sur Le Bavard, intitulé La Parole vaine, qui figura dans une édition rare en 10/18), à Jean-Louis Ezine (un entretien clé à propos d’Ostinato), en passant par Philippe Jaccottet (superbe texte d’analyse droite et rigoureuse d’un écrivain que le grand poète de Grignan admire), Michel Leiris, Raymond Queneau (des Forêts participa avec Monsieur Zazie, à la création de l’Encyclopédie de La Pléiade, avant de devenir membre du comité de lecture de « la Banque de France de l’édition », laquelle publia, avec sa filiale le Mercure de France, la majeure partie de son œuvre), et encore André Frénaud, Pascal Quignard, Marcel Arland, Jean Roudaut, Pierre Klossowski, Charles du Bos, André du Bouchet… Du beau linge, et des textes enrichissants, tant sur ce que l’on apprend de l’auteur de Pas à pas jusqu’au dernier, que sur le travail, l’écriture ou tout simplement l’amitié de ces compagnons de route, de ces « alliés substantiels ». Il fut beaucoup reproché à des Forêts de cesser d’écrire, après avoir conquis un lectorat fidèle et ayant pris goût. Il se mit alors à peindre dix années durant et se tût – littérairement -, environ dix de plus (et le volume « donne à voir » ses peintures, tourmentées, imprégnées à la fois d’un surréalisme figuratif, et d’une fantasmagorie à la Jérôme Bosch). Il faut savoir que l’année 1965 fut la cassure majeure de la vie de l’écrivain. Sa fille Elisabeth mourut accidentellement à l’âge de quatorze ans, et d’une telle déchirure, nul ne se remet. Cependant, le père terrassé, désagrégé, commence alors à bâtir en silence, pierre à pierre, un travail de deuil qui ressemble à la tâche de Sisyphe, ou bien à une entreprise vaine et condamnée d’avance. Cela s’appellera, après plusieurs tentatives de renoncement, quelques publications fragmentaires en revue, Ostinato, en 1997. (Au Mercure de France d’abord, dans L’Imaginaire/Gallimard aujourd’hui, en plus de l’édition monumentale dont nous rendons compte). Un chef d’œuvre, même si cette expression est par trop usitée et par conséquent galvaudée. Un livre inclassable et incassable, bien qu’il semble fait de cristal. Et de cendre, ou plutôt de pluie d’étoiles. Ostinato, ou obstinément, le devoir d’achèvement, est l'un des plus somptueux hommages faits à la langue française de ces dernières décennies. Ce livre semble avoir été écrit comme Beethoven composa ses plus beaux quatuors, soit une fois devenu totalement sourd. Des Forêts l’entendait un peu, et sans forfanterie, de cette oreille (et il les avait grandes). Ostinato, avec Le Bavard, Les Mégères de la mer, les Poèmes de Samuel Wood aussi, sont de ces textes que l’on a plaisir à lire à voix haute à un être cher, tout en marchant, livre en main, dans la campagne ou dans un sous-bois. Livre de recueillement, long poème en prose, livre d’une vie, livre-vie, livre de la déchirure et de l’impossible reconstruction, il est l’offrande musicale d’un auteur précieux et trop méconnu, à la fois à la littérature, au questionnement sur la langue – son pouvoir, sa raison d’être pour l’auteur, et pour un hypothétique lecteur aussi -, à cette « vieille arme ébréchée du langage », et enfin à l’essence de la vie même. Nous imaginons sans peine Le Bavard et son célèbre incipit : « Je me regarde souvent dans la glace. », lu au théâtre par un Sami Frey, un Claude Rich, un Jean-François Balmer (à la manière des Braises, de Sandor Marai, ou de Novecento, d’Alessandro Baricco, ou encore de Pour un oui ou pour un non, de Nathalie Sarraute : vous voyez ?..). Car il y a dans chacun des livres de Louis-René des Forêts, à la fois la suggestion musicale et le plaisir du texte qui ne demande qu’à être partagé… musicalement, fut-ce à la voix, notre principal, primitif instrument. Des Forêts est encore de ces noms d’auteurs qui se chuchotent. Le seul fait d’apercevoir quelqu’un lire l’un de ses livres, dans un transport en commun par exemple (mais cela est rarissime), suffit à nous persuader que nous appartenons à une même confrérie, et que nous souhaitons, l’inconnu(e) comme soi-même, qu’elle ne demeure pas une société secrète. La littérature a le don subtil de générer ce type de menu plaisir; et c’est heureux. Ecoutons Dominique Rabaté, qui ouvre son texte de présentation avec ces mots : « L’éclat du rire, le sel des larmes et la toute-puissante sauvagerie : voilà en une formule ternaire magnifique ce à quoi fait encore appel Louis-René des Forêts dans le dernier de ses grands livres, Ostinato. La vivacité d’une ironie frondeuse, l’amertume vivifiante qui déchire le cœur mais le baigne de sève marine, le sursaut de révolte puisé à même la force du monde extérieur auquel il faut s’accorder, ce sont là les qualités de cette ‘’voix de l’enfant’’ dont son œuvre fait résonner toutes les harmoniques. » Des Forêts fut toute sa vie également habité par la poésie. Ses amis et compagnons de la revue L’Ephémère se nomment Paul Celan, Jacques Dupin, Yves Bonnefoy, en plus des du Bouchet et Leiris précités. Les « voies et détours de sa fiction » emprunteront ainsi les voies royales du poème (de facture volontiers classique, voire hugolienne), en plus de la peinture. Sans jamais oublier une portée musicale pour toile de fond. Ce trio d’expressions, cette recherche pugnace de la clé qui ouvrira(it) tout, empêcheront ce « vœu de silence » majuscule qui manqua priver le lecteur de certains livres importants de Louis-René des Forêts, sommes-nous tentés d’ajouter égoïstement. L’auteur vécut si douloureusement cette « interminable expiation qui se vit dans la déchéance de survivre »... Habité par une « souffrance qui frappe si haut que la voix se retire », des Forêts lâcha : « S’imposer silence par dévotion au langage, c’est aussi comme sous-entendre que les mots sont facteurs de dévoiement. » Louis-René des Forêts fut encore l’écrivain braconnier qui pratiquait le détournement. Mais la littérature ne peut-elle pas être définie par le seul mot de détour ? C’est en tout cas ce que nous croyons fermement. A cet instant, il convient de prévenir de deux choses : des Forêts a été perçu comme « un écrivain pour écrivains ». Vous savez, cette expression commode qui permet de mettre dans un tiroir les très grands comme Julien Gracq, les maîtres, les « patrons », aurait dit Nourissier, en interdisant de facto leur accès « gratuit ». Un aveu d'élitisme corportatiste, en somme… Cela est considérablement réducteur, même si c'est extrêmement flatteur pour l’auteur qui se voit ainsi « classé ». Or, des Forêts est bien plus qu’un auteur que ses pairs respectent et dont ils se défendent de s’inspirer (tout au plus s’en imprègnent-ils, et c’est déjà un baume, un onguent suffisants). Il ne fut pas non plus, un précurseur ou un apôtre, à son corps défendant, de l’autofiction, et encore moins un adepte de la confession narcissique. Ni La Chambre des enfants, encore moins Face à l’immémorable – belle réflexion sur l’acte grave d’écrire -, ou même Le Malheur au Lido, ne constituent des textes dont une impudeur à peine déguisée aurait guidé la plume de leur auteur. Dominique Rabaté évoque plutôt une « autobiographie extérieure » (à propos d’Ostinato), comme on peut parler, avec humour, de journal extime, dès lors que l’on décide de rendre public ses carnets… Suivant en cela la belle formule du critique Robert Kanters (nous citons de mémoire) : « Le roman et le journal intime sont comme le vêtement et sa doublure, et cette dernière est d’une étoffe si fine et si précieuse que l’on peut être tenté de porter un jour le vêtement retourné. » En lisant des Forêts, auteur fragile, nous relevons des « manières de traces », nous découvrons « le corps obscurci de la mémoire », « tout ce qui respire à ciel ouvert » (couleurs, odeurs, humeurs), là où « le temps reste à la neige, le cœur brûlant toujours d’anciennes fièvres ». Nous éprouvons physiquement l’épaisseur des silences en picorant ses livres, et nous écoutons « les sourdes vibrations de sa fièvre prise comme un fleuve dans le gel qui craque au premier souffle printanier. » Une phrase, magnifique entre toutes, suffit à circonscrire l’âme et la rigueur de la prose poétique de son auteur : « Que jamais la voix de l’enfant en lui ne se taise, qu’elle tombe comme un don du ciel offrant aux mots desséchés l’éclat de son rire, le sel de ses larmes, sa toute-puissante sauvagerie. » Qu’on ne se méprenne donc pas : des Forêts a toujours tenu son je à distance, en respectant cette pudeur essentielle qui distinguera toujours le vécu mis en prose du livre authentique. C’est ainsi que, depuis Lucrèce, une voix intérieure, « venue d’ailleurs », parfois, peut toucher à l’universel. Cela s’appelle encore la littérature. Faites passer. Léon Mazzella
---
* Avec les récents volumes consacrés à Modiano, Maupassant, Montaigne, J.-B. Pontalis et très récemment Boualem Sansal, Quarto s’affirme en effet comme une collection de « semi-poche » (« de sac », plutôt) de premier plan.
Louis-René des Forêts, Œuvres complètes, Quarto/Gallimard, 28€.
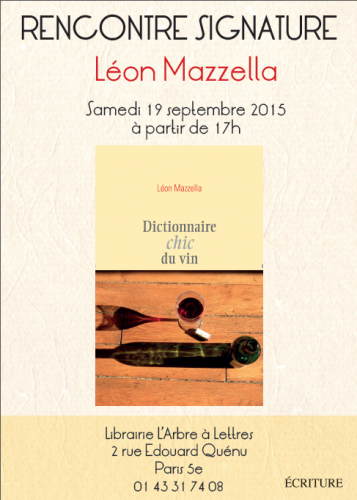
Merci à (la plume sagace d') Olivier Mony.
 Chaque fois (ces temps-ci, c'est quasiment chaque jour), cela me fait bizarre de le voir à la salle de gym (nous fréquentons la même et je ne vous donnerai pas son adresse, même sous la torture*). Un si grand écrivain** dans un corps si chétif a de quoi surprendre. Sa démarche lente, son air dubitatif devant les instruments de musculation, son short trop grand, son silence, ses regards sombres... Accepterait-il la soumission aux machines d'entretien du corps... Saisit-il ici matière à un prochain livre... Je me demande. Pour une fois, il n'enchaîne pas les cigarettes. Michel Houellebecq prend soin de lui. N'allez pas croire.
Chaque fois (ces temps-ci, c'est quasiment chaque jour), cela me fait bizarre de le voir à la salle de gym (nous fréquentons la même et je ne vous donnerai pas son adresse, même sous la torture*). Un si grand écrivain** dans un corps si chétif a de quoi surprendre. Sa démarche lente, son air dubitatif devant les instruments de musculation, son short trop grand, son silence, ses regards sombres... Accepterait-il la soumission aux machines d'entretien du corps... Saisit-il ici matière à un prochain livre... Je me demande. Pour une fois, il n'enchaîne pas les cigarettes. Michel Houellebecq prend soin de lui. N'allez pas croire.
J'en ai rencontré pas mal, des écrivains, et je continue d'en fréquenter. Ma plus belle rencontre fut Julien Gracq. Indépassable. Là, en baskets et tee-shirt trempé de sueur salutaire (pour ce qui me concerne), je ne me sens pas prêt pour une rencontre. Lui non plus, cela semble certain. Continuons par conséquent de brûler nos calories, à force de pédaler, de ramer, de courir surplace, de rêver en dedans, tandis que notre corps exsude, exulte d'une certaine façon, et que nous observons le granTécrivain en coin. Pour la soumission, nous verrons. Plus tard. Mais je ne suis plus très loin de penser, avec Alain Finkielkraut (ce qui suit est une phrase qu'il m'a dite lorsque je l'ai longuement interviewé pour L'Express, le 11 janvier dernier), que le premier parti de France est devenu celui de la soumission... Avec ou sans Houellebecq, c'est bien vu, non?
P.S. : je me fiche pour le moment de la (récente) polémique Le Monde et Ariane Chemin / Michel Houellebecq. Lisons la série de papiers que la très talentueuse journaliste consacre à l'auteur des Particules élémentaires, à paraître dès lundi dans notre quotidien préféré, et parlons-en (éventuellement) après.
Ariane Chemin / Michel Houellebecq. Lisons la série de papiers que la très talentueuse journaliste consacre à l'auteur des Particules élémentaires, à paraître dès lundi dans notre quotidien préféré, et parlons-en (éventuellement) après.
---
* Ceux qui veulent mon RIB n'ont qu'à m'écrire. Ah, mais!
** J'adore le lire, y compris sa poésie. Ses romans visionnaires, même s'ils prennent une gîte légère depuis peu sur le plan purement littéraire, ses essais déguisés en romans, donc, demeurent une lecture nécessaire, comme on parle de décryptage, pas à pas, de notre société mise à nu. Et c'est ainsi que Houellebecq est (plus) grand (qu'Allah).