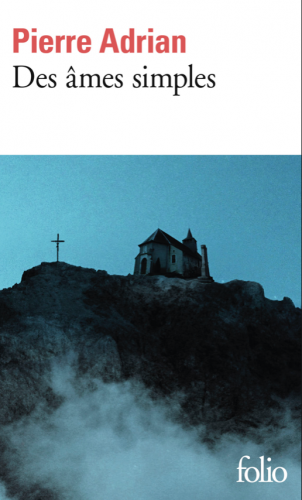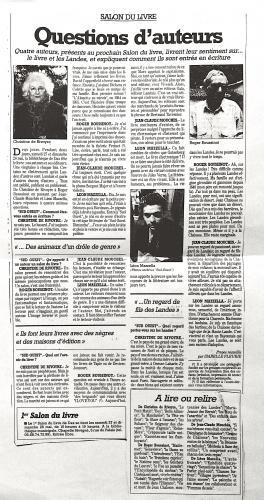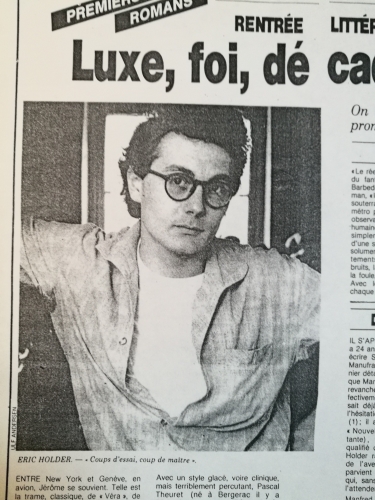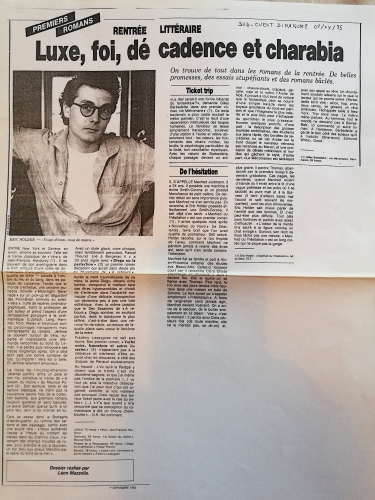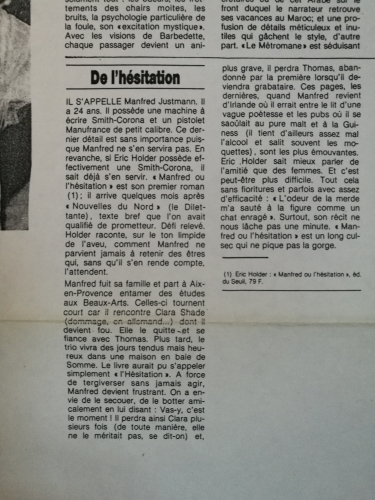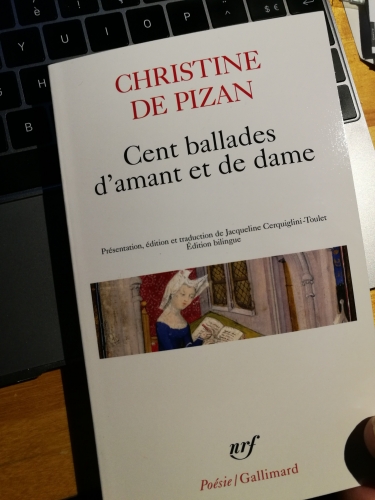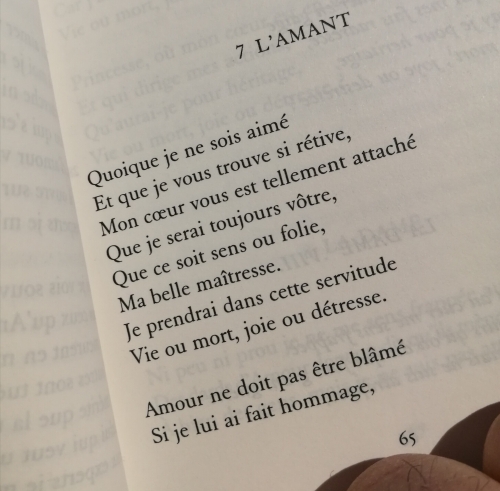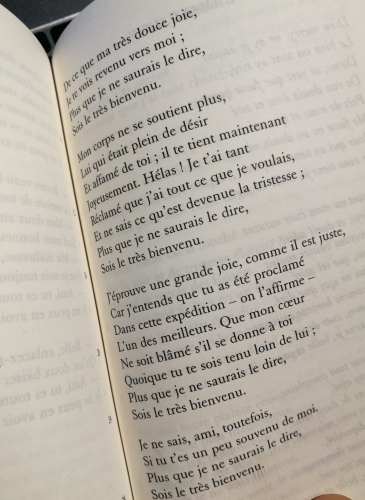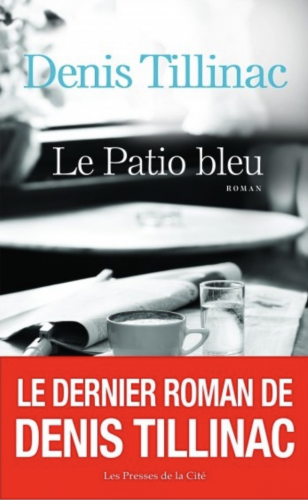 Il y eut, douloureusement, le roman posthume de Denis Tillinac, Le Patio bleu (Les Presses de la Cité). Sa page de faux-titre sans dédicace – et pour cause, résonna longtemps comme le timbre éraillé de sa voix, « Comment tu vas!.. ». Il y a tout là-dedans, il y a beaucoup dans cet épais roman riche d’images percutantes et de phrases aussi tendres qu’assassines parfois, et si justes, si fortes. Il s’y trouve une maturité de romancier impeccablement ramassée, une intrigue tillinacienne totale, la province gersoise, Condom – d’Artagnan n’est pas loin -, des Rastignac femelles, le désir d’en découdre avec une bourgeoise a priori rangée, les intrigues de ministère comme il y en eut de cour, les coups bas ou fourrés, l’amitié triomphale, les non-dits et les ouï-dire, la tendresse des paysages d’une France encore profonde dans tous les sens du terme, une mélancolie viscérale et bougonne par crainte de paraître trop délicate, des traits d’une justesse dans le mille à faire pâlir le La Bruyère des Caractères. Une ambiance IVe République, avec un Chirac en culottes courtes, une atmosphère « rad-soc » qui eut cours dans les campagnes qu’un jacobinisme arrogant ignorait, de Bellême (Perche) à Tulle (Corrèze), en passant par Condom, donc. Un air de Claude Sautet à la caméra plane sur ce dernier opus de Denis, et l’on se souvient tout à trac de son regard de saurien lorsque le silence se faisait parfois, qu’il suspendait sa cigarette (moment rare), et que nous l’entendions nous dire tant de choses dans le virage du rien. Salut l’ami.
Il y eut, douloureusement, le roman posthume de Denis Tillinac, Le Patio bleu (Les Presses de la Cité). Sa page de faux-titre sans dédicace – et pour cause, résonna longtemps comme le timbre éraillé de sa voix, « Comment tu vas!.. ». Il y a tout là-dedans, il y a beaucoup dans cet épais roman riche d’images percutantes et de phrases aussi tendres qu’assassines parfois, et si justes, si fortes. Il s’y trouve une maturité de romancier impeccablement ramassée, une intrigue tillinacienne totale, la province gersoise, Condom – d’Artagnan n’est pas loin -, des Rastignac femelles, le désir d’en découdre avec une bourgeoise a priori rangée, les intrigues de ministère comme il y en eut de cour, les coups bas ou fourrés, l’amitié triomphale, les non-dits et les ouï-dire, la tendresse des paysages d’une France encore profonde dans tous les sens du terme, une mélancolie viscérale et bougonne par crainte de paraître trop délicate, des traits d’une justesse dans le mille à faire pâlir le La Bruyère des Caractères. Une ambiance IVe République, avec un Chirac en culottes courtes, une atmosphère « rad-soc » qui eut cours dans les campagnes qu’un jacobinisme arrogant ignorait, de Bellême (Perche) à Tulle (Corrèze), en passant par Condom, donc. Un air de Claude Sautet à la caméra plane sur ce dernier opus de Denis, et l’on se souvient tout à trac de son regard de saurien lorsque le silence se faisait parfois, qu’il suspendait sa cigarette (moment rare), et que nous l’entendions nous dire tant de choses dans le virage du rien. Salut l’ami.
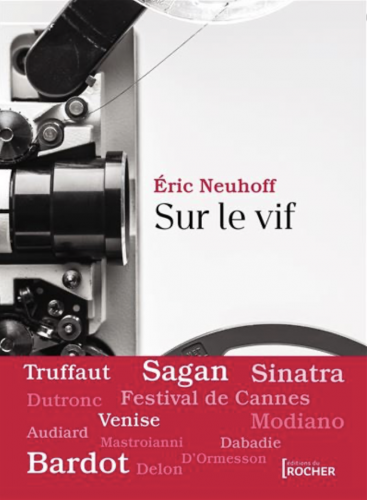 Il y eut la somme de chroniques d’Éric Neuhoff parues dans Le Figaro, sous le titre Sur le vif (Le Rocher), évoqué brièvement ici il y a peu, pour nous offrir le plaisir de relire les phrases brèves et toniques, à la Nimier, le style félin et claquant de son héritier spirituel. Qu’il évoque Biarritz, Brigitte Bardot, Los Angeles, Françoise Sagan, la Fontaine de Trévi, Frédéric Berthet, Cadaqués, Stallone comme Mastroianni, le Toulouse de Christian Authier ou encore l’une de ses idoles, Frank Sinatra, Dieppe ou Truman Capote, Le Ritz ou Michel Déon, Neuhoff délivre ses denses déclarations d’amour comme on ne délivre plus des compressions de César, car lui le fait avec tact et sensibilité, intelligence et style. Un pur bonheur.
Il y eut la somme de chroniques d’Éric Neuhoff parues dans Le Figaro, sous le titre Sur le vif (Le Rocher), évoqué brièvement ici il y a peu, pour nous offrir le plaisir de relire les phrases brèves et toniques, à la Nimier, le style félin et claquant de son héritier spirituel. Qu’il évoque Biarritz, Brigitte Bardot, Los Angeles, Françoise Sagan, la Fontaine de Trévi, Frédéric Berthet, Cadaqués, Stallone comme Mastroianni, le Toulouse de Christian Authier ou encore l’une de ses idoles, Frank Sinatra, Dieppe ou Truman Capote, Le Ritz ou Michel Déon, Neuhoff délivre ses denses déclarations d’amour comme on ne délivre plus des compressions de César, car lui le fait avec tact et sensibilité, intelligence et style. Un pur bonheur.
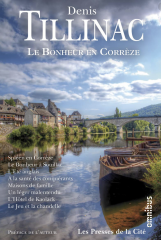
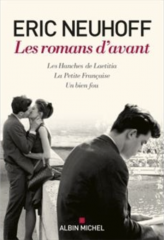 Et, comme le hasard n’existe pas, il y eut deux compilations fraternelles quasiment au même moment à l’étal des librairies : d'un côté, les romans corréziens de « Tilli » chez Omnibus, Le Bonheur en Corrèze, qui rassemble en un épais pavé huit de ses romans essentiels, et de l’autre, trois romans indispensables de Neuhoff réunis par Albin Michel, Les romans d’avant.
Et, comme le hasard n’existe pas, il y eut deux compilations fraternelles quasiment au même moment à l’étal des librairies : d'un côté, les romans corréziens de « Tilli » chez Omnibus, Le Bonheur en Corrèze, qui rassemble en un épais pavé huit de ses romans essentiels, et de l’autre, trois romans indispensables de Neuhoff réunis par Albin Michel, Les romans d’avant.
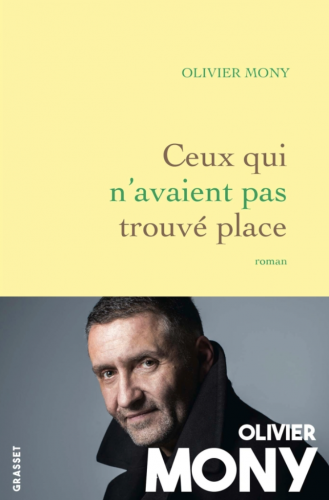 Il y eut le premier roman d’Olivier Mony, Ceux qui n’avait pas trouvé place (Grasset) retardé pour cause de pandémie, enfin entre nos mains (nous l’achetâmes le jour de sa parution), un bref roman modianesque en diable – tant qu’on croirait entendre la voix de Patrick le Nobel le dicter, avec des personnages foutraques, soit attachants (Serge, bien sûr, Elkoubi, etc, et puis Piètre, et d’autres), un Bordeaux lisse et troussé en connaisseur, et au fond un livre comme un tapis volant sur lequel nous sommes priés gentiment d’embarquer, ce que nous avons fait gaiement.
Il y eut le premier roman d’Olivier Mony, Ceux qui n’avait pas trouvé place (Grasset) retardé pour cause de pandémie, enfin entre nos mains (nous l’achetâmes le jour de sa parution), un bref roman modianesque en diable – tant qu’on croirait entendre la voix de Patrick le Nobel le dicter, avec des personnages foutraques, soit attachants (Serge, bien sûr, Elkoubi, etc, et puis Piètre, et d’autres), un Bordeaux lisse et troussé en connaisseur, et au fond un livre comme un tapis volant sur lequel nous sommes priés gentiment d’embarquer, ce que nous avons fait gaiement.
Il y eut cette belle surprise stylistique, 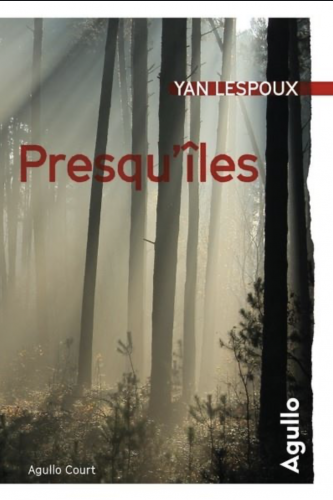 rugueuse et âpre, si vraie « avé l’accent » médocain, ces très courtes nouvelles qui circonscrivent des personnages forts, durs, à la Franck Bouysse, des scènes d’un quotidien que peu connaissent, sauvage, reculé, essentiel car forestier, chasseur, braconnier, rude, d’une vérité crue à côté de laquelle steak tartare et carpaccio passent pour des carnes cuites. Presqu’îles, de Yan Lespoux (Agullo) est un livre précieux comme un premier roman de Sylvie Germain ou de Jean Carrière. Un beau cèpe cru dans ce beau voisinage gionesque-là...
rugueuse et âpre, si vraie « avé l’accent » médocain, ces très courtes nouvelles qui circonscrivent des personnages forts, durs, à la Franck Bouysse, des scènes d’un quotidien que peu connaissent, sauvage, reculé, essentiel car forestier, chasseur, braconnier, rude, d’une vérité crue à côté de laquelle steak tartare et carpaccio passent pour des carnes cuites. Presqu’îles, de Yan Lespoux (Agullo) est un livre précieux comme un premier roman de Sylvie Germain ou de Jean Carrière. Un beau cèpe cru dans ce beau voisinage gionesque-là...
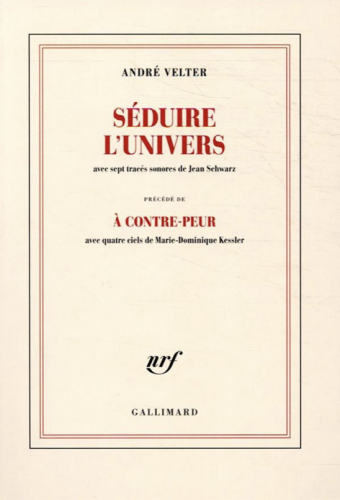
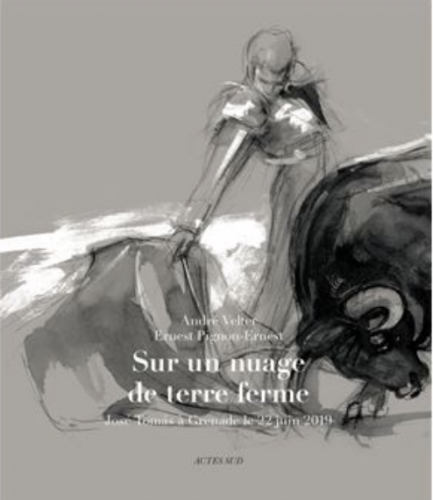 Il y eut l’annonce du Printemps des poètes, avec pour thème Le Désir, loué par Sophie Nauleau chez Actes Sud (nous attendons l’ouvrage), et des phares ici et là pour éclairer la route du mot qui émeut plus qu’un coup de foudre. André Velter, compagnon de la précitée, livre Séduire l’Univers, précédé de À contre-peur, illustré de « tracés sonores » de Jean Schwarz (le premier), et de quatre « ciels » de Marie-Dominique Kessler (le second). Il s’agit de l’un de ces livres composés à plusieurs mains, dont Velter a l’habitude, et qui produisent un dialogue en fruition, une poésie non pas amalgamée, mais épousée, risquons un mot : « puzzle-isée », c’est l’agudeza de Baltasar Gracián invoquée par l’auteur, autrement dit l’acuité ingénieuse, dont il est ici question. « Par-delà l’espace et le temps », dit l’auteur, « il est des affinités électives, ou ce que Julien Gracq appelait des consanguinités d’esprit, qui ne peuvent durablement rester sans résurgence. »
Il y eut l’annonce du Printemps des poètes, avec pour thème Le Désir, loué par Sophie Nauleau chez Actes Sud (nous attendons l’ouvrage), et des phares ici et là pour éclairer la route du mot qui émeut plus qu’un coup de foudre. André Velter, compagnon de la précitée, livre Séduire l’Univers, précédé de À contre-peur, illustré de « tracés sonores » de Jean Schwarz (le premier), et de quatre « ciels » de Marie-Dominique Kessler (le second). Il s’agit de l’un de ces livres composés à plusieurs mains, dont Velter a l’habitude, et qui produisent un dialogue en fruition, une poésie non pas amalgamée, mais épousée, risquons un mot : « puzzle-isée », c’est l’agudeza de Baltasar Gracián invoquée par l’auteur, autrement dit l’acuité ingénieuse, dont il est ici question. « Par-delà l’espace et le temps », dit l’auteur, « il est des affinités électives, ou ce que Julien Gracq appelait des consanguinités d’esprit, qui ne peuvent durablement rester sans résurgence. »
Ainsi, par ailleurs, cet ouvrage de plus en collaboration : André Velter avec Ernest Pignon-Ernest (nous avons évoqué ici même les précédents), nommé Sur un nuage de terre ferme (Actes Sud) et où il est question de tauromachie, mots et dessins mêlés, plus précisément de José Tomás à Grenade le 22 juin 2019. Faena mystique entre toutes. La grâce transcendée en textes et en traits, le vertige, un certain duende, l’émotion qui frissonne durablement ; un torero « sur un nuage de terre ferme ». Soit une chanson de geste d'un singulier maestro qui, lorsqu’il se rend aux arènes, laisse son corps à l’hôtel (dixit Francis Marmande). Le sable et l’indicible, en somme.
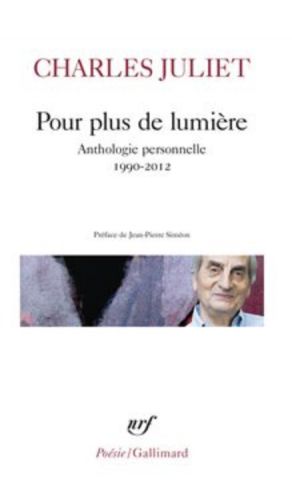 Il y eût la somme infiniment précieuse, l’anthologie personnelle de l’immense Charles Juliet que propose Poésie/Gallimard, Pour plus de lumière, 1990-2012. L’essentiel, choisi donc par l’auteur lui-même (à l’instar de Commune présence, de Char, et de L’encre serait de l’ombre, de Jaccottet), d’une poésie placée sous le signe d’une « ardente recherche de la lumière » (et je m’autorise à reproduire ici, avec ces quelques mots, un extrait de la dédicace que l’auteur a rédigée sur mon exemplaire). Nous y retrouvons les recueils majeurs comme Affûts, Ce pays du silence, Moisson... Des trésors réunis en un seul recueil lourd et compact, que l’on a envie de trimbaler chaque week-end, où que l’on aille.
Il y eût la somme infiniment précieuse, l’anthologie personnelle de l’immense Charles Juliet que propose Poésie/Gallimard, Pour plus de lumière, 1990-2012. L’essentiel, choisi donc par l’auteur lui-même (à l’instar de Commune présence, de Char, et de L’encre serait de l’ombre, de Jaccottet), d’une poésie placée sous le signe d’une « ardente recherche de la lumière » (et je m’autorise à reproduire ici, avec ces quelques mots, un extrait de la dédicace que l’auteur a rédigée sur mon exemplaire). Nous y retrouvons les recueils majeurs comme Affûts, Ce pays du silence, Moisson... Des trésors réunis en un seul recueil lourd et compact, que l’on a envie de trimbaler chaque week-end, où que l’on aille.
Il y eut, dans la même collection fétiche, Poésie/Gallimard, une « compil »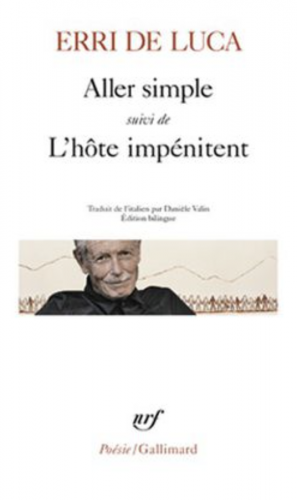 (bilingue) d’Erri de Luca, Aller simple, suivi de L’hôte impénitent, où l’on retrouve l’auteur limpide d’œuvre sur l’eau. Poésie presque parlée, comme récitée à l’église le matin, morale par endroits, humble toujours, où la barque et le filet du pêcheur, ses quelques prises, ont la grâce du simple recueillant avec reconnaissance ce qui lui suffit. Demi-surprise : Aller simple évoque l’épopée tragique des migrants échouant tant bien que mal sur les côtes italiennes, ou la poésie devient politique, militante, mais avant tout humaniste avec une remarquable sobriété qui rappelle les récits de Primo Levi. Cependant, les poèmes qui composent L'hôte impénitent nous font retrouver le De Luca romancier devenu alpiniste mystique, et toujours sensuel, dont les épaules porteront toujours les traces salées de la Méditerranée, du côté de l'île d'Ischia...
(bilingue) d’Erri de Luca, Aller simple, suivi de L’hôte impénitent, où l’on retrouve l’auteur limpide d’œuvre sur l’eau. Poésie presque parlée, comme récitée à l’église le matin, morale par endroits, humble toujours, où la barque et le filet du pêcheur, ses quelques prises, ont la grâce du simple recueillant avec reconnaissance ce qui lui suffit. Demi-surprise : Aller simple évoque l’épopée tragique des migrants échouant tant bien que mal sur les côtes italiennes, ou la poésie devient politique, militante, mais avant tout humaniste avec une remarquable sobriété qui rappelle les récits de Primo Levi. Cependant, les poèmes qui composent L'hôte impénitent nous font retrouver le De Luca romancier devenu alpiniste mystique, et toujours sensuel, dont les épaules porteront toujours les traces salées de la Méditerranée, du côté de l'île d'Ischia...
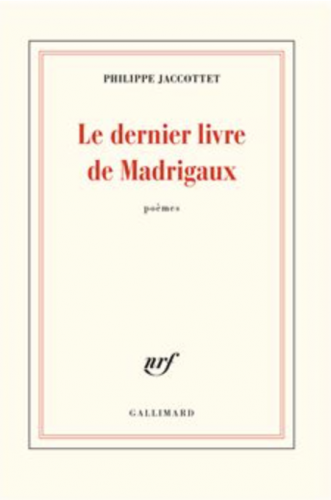
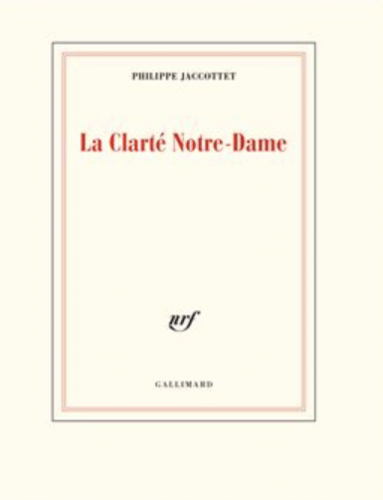 Enfin, il y eut, juste après la disparition du très grand Philippe Jaccottet, deux inédits, Le dernier livre de Madrigaux, et La Clarté Notre-Dame (Gallimard), pour nous rappeler à l’essentiel, soit au chant fragile des oiseaux à l’aube dans un verger de peu planté de longue date à Grignan, dans la Drôme, l’écho d’une cloche des Vêpres à Salernes (où vécut sur le tard le regretté Pierre Moinot), « dans l’enceinte sacrée, très-haut » (Hölderlin), des mots simples comme de ces brindilles dont Char rêvait de bâtir un rempart, des mots tragiques à peine d’un poète avouant son grand âge et citant Hölderlin encore comme on lance un grappin, « Énigme, ce qui sourd pur ». Des textes essentiels et crépusculaires, et néanmoins heureux, surtout lorsqu’il s’agit d’évoquer Claudio Monteverdi, « c’est par urgence que sa voix prend feu ». « Ainsi lié, je me délivre de l’hiver »... Jaccottet a rejoint, à 95 ans, « le tissu bleu du ciel ». Et nous continuerons d’entretenir commerce quotidien avec son œuvre capitale. L.M.
Enfin, il y eut, juste après la disparition du très grand Philippe Jaccottet, deux inédits, Le dernier livre de Madrigaux, et La Clarté Notre-Dame (Gallimard), pour nous rappeler à l’essentiel, soit au chant fragile des oiseaux à l’aube dans un verger de peu planté de longue date à Grignan, dans la Drôme, l’écho d’une cloche des Vêpres à Salernes (où vécut sur le tard le regretté Pierre Moinot), « dans l’enceinte sacrée, très-haut » (Hölderlin), des mots simples comme de ces brindilles dont Char rêvait de bâtir un rempart, des mots tragiques à peine d’un poète avouant son grand âge et citant Hölderlin encore comme on lance un grappin, « Énigme, ce qui sourd pur ». Des textes essentiels et crépusculaires, et néanmoins heureux, surtout lorsqu’il s’agit d’évoquer Claudio Monteverdi, « c’est par urgence que sa voix prend feu ». « Ainsi lié, je me délivre de l’hiver »... Jaccottet a rejoint, à 95 ans, « le tissu bleu du ciel ». Et nous continuerons d’entretenir commerce quotidien avec son œuvre capitale. L.M.


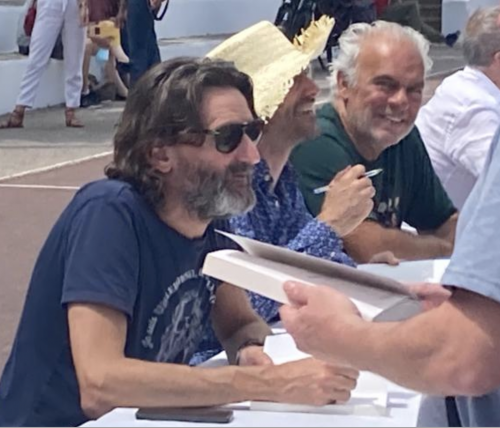



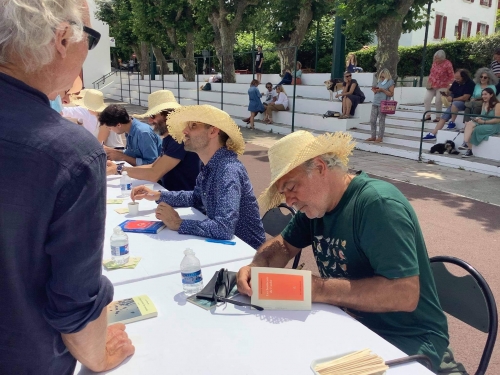
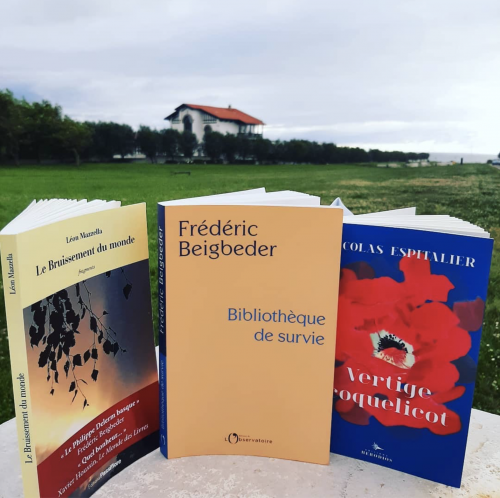
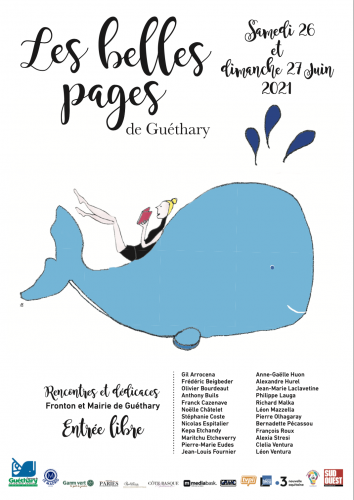
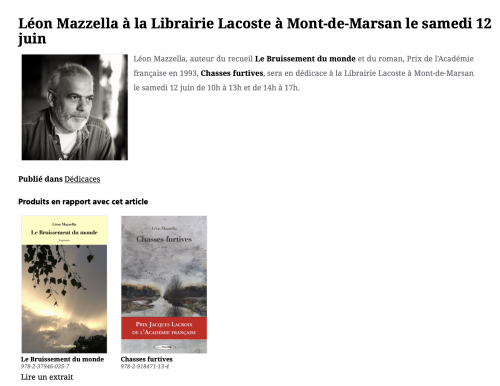

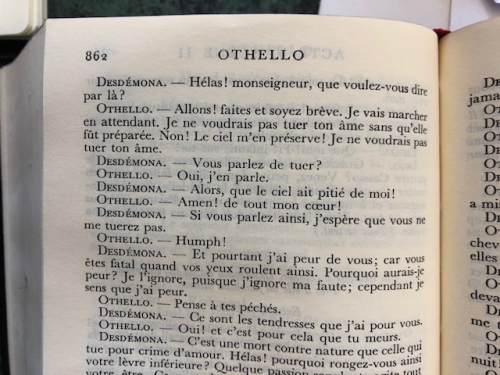
 La cuvée T (rouge) 2018 du château Trians, AOP côteaux varois en Provence, produit par Emmanuel Delhom et sa famille, est un vin bio (depuis 2012) capiteux, généreux, ample, très présent, avec des syrah de caractère (80% de l’encépagement) à peine tutoyées par des grenaches (20%) qui ne s’en laissent pas compter. Un vin gourmand et gorgé de notes de fruits rouges. Le flacon, râblé et large d’épaules, donne le ton en désignant son contenu. 18,50€
La cuvée T (rouge) 2018 du château Trians, AOP côteaux varois en Provence, produit par Emmanuel Delhom et sa famille, est un vin bio (depuis 2012) capiteux, généreux, ample, très présent, avec des syrah de caractère (80% de l’encépagement) à peine tutoyées par des grenaches (20%) qui ne s’en laissent pas compter. Un vin gourmand et gorgé de notes de fruits rouges. Le flacon, râblé et large d’épaules, donne le ton en désignant son contenu. 18,50€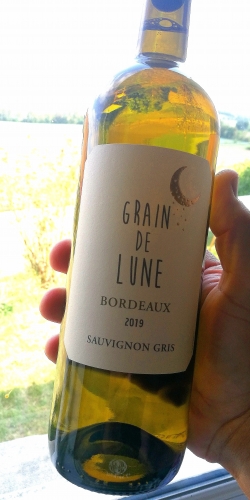 bordeaux blanc singulier, car le cépage dont il est issu est relativement confidentiel. Robe jaune pâle, des notes d’agrumes mais pas trop, bouche élégante, finale à peine musquée. C’est le compagnon idéal pour un filet de merlu ou des grosses gambas rôties.. C’est Producta vignobles qui propose cette nouvelle cuvée craft pour à peine 5€
bordeaux blanc singulier, car le cépage dont il est issu est relativement confidentiel. Robe jaune pâle, des notes d’agrumes mais pas trop, bouche élégante, finale à peine musquée. C’est le compagnon idéal pour un filet de merlu ou des grosses gambas rôties.. C’est Producta vignobles qui propose cette nouvelle cuvée craft pour à peine 5€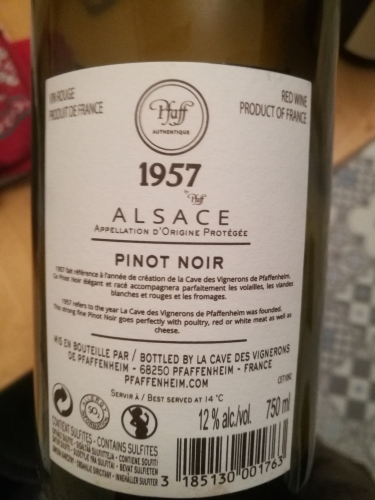 Le Pinot noir 1957 by Pfaff est un AOP Alsace 2019 qui fait écho à la date de création de la cave des vignerons de Pfaffenheim. La gamme propose aussi un riesling, un gewurztraminer et un pinot gris. Nous avons choisi de découvrir le Pinot noir, lequel offre une belle robe rubis, un nez agréable pourvu de notes franches de framboise et de fraise, et une réelle présence en bouche, avec des tanins délicats. 12€
Le Pinot noir 1957 by Pfaff est un AOP Alsace 2019 qui fait écho à la date de création de la cave des vignerons de Pfaffenheim. La gamme propose aussi un riesling, un gewurztraminer et un pinot gris. Nous avons choisi de découvrir le Pinot noir, lequel offre une belle robe rubis, un nez agréable pourvu de notes franches de framboise et de fraise, et une réelle présence en bouche, avec des tanins délicats. 12€ partie de la nouvelle gamme bio de la famille Abbots & Delaunay, célèbre pour son savoir-faire bourguignon. Nous sommes cependant sur les collines de Limoux (Sud de France) avec ce flacon sérieux. Belle robe pourpre, nez de petits fruits rouges et noirs (framboise et myrtille dominent), bouche ronde et délicate avec une finale légèrement boisée. Les tanins, tendrement épicés, s’expriment au bout d’une trentaine de minutes, lorsque le vin a trouvé son équilibre. 13€
partie de la nouvelle gamme bio de la famille Abbots & Delaunay, célèbre pour son savoir-faire bourguignon. Nous sommes cependant sur les collines de Limoux (Sud de France) avec ce flacon sérieux. Belle robe pourpre, nez de petits fruits rouges et noirs (framboise et myrtille dominent), bouche ronde et délicate avec une finale légèrement boisée. Les tanins, tendrement épicés, s’expriment au bout d’une trentaine de minutes, lorsque le vin a trouvé son équilibre. 13€ Brio 2009, second vin du château Cantenac Brown, est une splendeur lorsqu’on le marie à une txuleta de bœuf souletin maturée à souhait, mais également pour lui seul ! Ce margaux de noble extraction (3e cru classé 1855), sur un millésime des plus réussis de ces vingt dernières années et davantage, est un régal de gourmandise et de fruité (cerise mûre, pruneau en finale), d’élégance (tanins formidables), et de délicatesse (léger vanillé) alliés à une force intérieure qui signe les vins des grands terroirs bordelais. Ajoutez une fraîcheur et une longueur exceptionnelle, et vous n’attendez pas la fin du repas pour passer commande. 40€ environ.
Brio 2009, second vin du château Cantenac Brown, est une splendeur lorsqu’on le marie à une txuleta de bœuf souletin maturée à souhait, mais également pour lui seul ! Ce margaux de noble extraction (3e cru classé 1855), sur un millésime des plus réussis de ces vingt dernières années et davantage, est un régal de gourmandise et de fruité (cerise mûre, pruneau en finale), d’élégance (tanins formidables), et de délicatesse (léger vanillé) alliés à une force intérieure qui signe les vins des grands terroirs bordelais. Ajoutez une fraîcheur et une longueur exceptionnelle, et vous n’attendez pas la fin du repas pour passer commande. 40€ environ. sympas. Il y a un blanc moelleux, un Pacherenc du Vic-Bilh 2019 proposé en demi-bouteille : jolies notes d’ananas mûr et d’agrumes confits. Un vin pas trop chargé en « sucre », avec une pointe d’acidité qui donne un coup de fouet bienvenu (6,40€). Et un Madiran. Nous avons dégusté ce dernier dans le millésime 2019 avec beaucoup de plaisir. Il est issu de tannats et des cabernets (sauvignon et franc) d’une belle vérité. Franc, direct, voilà un madiran de caractère qui peut se résumer par les mots de puissance élégante. Belle robe grenat sombre, nez de fruits noirs (mûre) et de réglisse. Bouche soyeuse, avec des notes épicées (vanille). Un régal avec un simple magret. 6,95€
sympas. Il y a un blanc moelleux, un Pacherenc du Vic-Bilh 2019 proposé en demi-bouteille : jolies notes d’ananas mûr et d’agrumes confits. Un vin pas trop chargé en « sucre », avec une pointe d’acidité qui donne un coup de fouet bienvenu (6,40€). Et un Madiran. Nous avons dégusté ce dernier dans le millésime 2019 avec beaucoup de plaisir. Il est issu de tannats et des cabernets (sauvignon et franc) d’une belle vérité. Franc, direct, voilà un madiran de caractère qui peut se résumer par les mots de puissance élégante. Belle robe grenat sombre, nez de fruits noirs (mûre) et de réglisse. Bouche soyeuse, avec des notes épicées (vanille). Un régal avec un simple magret. 6,95€ La cave du Marmandais offre de L’Air Libre avec ses deux flacons sans sulfites ajoutés. Ce sont un rouge (merlot 65%t, malbec, cabernet franc) et un rosé (cabernet sauvignon 53%, cabernet franc, merlot, malbec, fer servadou) tout simples, élevés en cuve inox, sans chichis, de vrais vins de copains, de fraîcheur, de charme, de fruité léger et d’apéro. 6,50€
La cave du Marmandais offre de L’Air Libre avec ses deux flacons sans sulfites ajoutés. Ce sont un rouge (merlot 65%t, malbec, cabernet franc) et un rosé (cabernet sauvignon 53%, cabernet franc, merlot, malbec, fer servadou) tout simples, élevés en cuve inox, sans chichis, de vrais vins de copains, de fraîcheur, de charme, de fruité léger et d’apéro. 6,50€
 Garouge et Déshaltère. Les étiquettes de ces deux vins sont drôles, et leur jeu de mots bienvenu. Le premier est un 100% syrah 2020 des Collines Rhodaniennes pourvu d’un nez riche en fraise des bois et en mara aussi. Bouche gourmande, simple, on sent les jeunes syrah, n’hésitez pas à rafraîchir la bouteille tandis que vous disposez la chiffonnade de jamón et de chorizo de bellota. Déshaltère 2020, est lui aussi issu de syrah, et il se revendique moelleux. Or, il est plutôt agréablement sec. À servir « frappé », ce rosé humble au nez de fruits rouges et de bonbon anglais présente une grande douceur persistante en bouche. Alliances : un fromage de chèvre frais. 5,90€
Garouge et Déshaltère. Les étiquettes de ces deux vins sont drôles, et leur jeu de mots bienvenu. Le premier est un 100% syrah 2020 des Collines Rhodaniennes pourvu d’un nez riche en fraise des bois et en mara aussi. Bouche gourmande, simple, on sent les jeunes syrah, n’hésitez pas à rafraîchir la bouteille tandis que vous disposez la chiffonnade de jamón et de chorizo de bellota. Déshaltère 2020, est lui aussi issu de syrah, et il se revendique moelleux. Or, il est plutôt agréablement sec. À servir « frappé », ce rosé humble au nez de fruits rouges et de bonbon anglais présente une grande douceur persistante en bouche. Alliances : un fromage de chèvre frais. 5,90€ Rouge Fusion 2018 de la Cave de Lugny est une vraie découverte. Cédric Gayet fait se rencontrer Pinot noir et Gamay, et « ça le fait ». Le mariage est connu. Mais, là, il y a du nouveau : les gamay sont élevés en fûts de chêne et en cuves, et les pinots le sont en cuves classiques et en cuve béton ovoïde six mois durant, vous savez ces grands œufs que l’on voit de plus en plus dans les chais ? L’assemblage suit, qui produit un vin étonnament aromatique. Cerise, framboise explosent au nez, et la bouche, ronde, est d’une grande tendresse. Étiquette sympa et un brin militante, avec l’œuf qui y figure. 11,20€
Rouge Fusion 2018 de la Cave de Lugny est une vraie découverte. Cédric Gayet fait se rencontrer Pinot noir et Gamay, et « ça le fait ». Le mariage est connu. Mais, là, il y a du nouveau : les gamay sont élevés en fûts de chêne et en cuves, et les pinots le sont en cuves classiques et en cuve béton ovoïde six mois durant, vous savez ces grands œufs que l’on voit de plus en plus dans les chais ? L’assemblage suit, qui produit un vin étonnament aromatique. Cerise, framboise explosent au nez, et la bouche, ronde, est d’une grande tendresse. Étiquette sympa et un brin militante, avec l’œuf qui y figure. 11,20€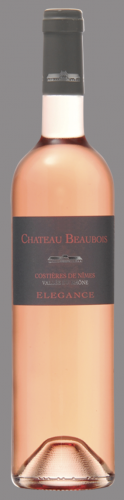
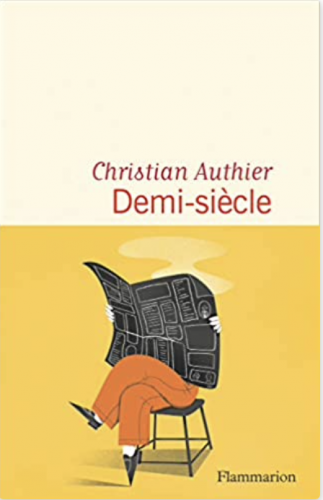 Avec « Demi-siècle », Christian Authier se lâche davantage qu’à l’accoutumée. Sa prose est plus déliée, décontractée, farcie par endroits de parler à voix haute (il manque juste le son). Les formules, les traits, les remarques sur notre monde tel qu'il va plus ou moins bien sont toujours aussi ciselées, percutantes et pertinentes, mais il y a davantage de laisser faire, de tableaux minutieusement décrits dans un style d’une souplesse féline – les deux soirées de la fin du livre (surtout la longue première, hilarante), sont un régal fitzgeraldien, ou capotien (si ça se dit, pour Truman). Nous retrouvons l’auteur et son double, Patrick Berthet (la fidélité à la référence de ce patronyme est devenue indéfectible), journaliste « vieille école » ignorant les réseaux sociaux, cultivant un goût précis pour les bons flacons dont chacun, débouché au fil des pages, est précisément nommé (de Gramenon, des Foulards rouges, de Drappier, de Selosse, de l’Anglore, nous sommes informés de cuvées précises, et pas des moindres – et les partageons en pensée avec Patrick et ses potes tout en lisant). Laurence – une fois n’est pas coutume, une femme d’importance, escorte le narrateur, et il s’agit là d’un amour fort. Ces deux là s’aiment à Paris, à Toulouse (dont on connaît à la fin du livre le nom de chaque rue et place), à Istanbul, à Beyrouth sans mesure, et avec une franchise intérieure enviable. « Demi-siècle » est un brin désenchanté comme les quatre ou cinq précédents romans de Authier, bardé de touches à la Houellebecq sur notre triste époque numérisée et envahie par des Arthur qui sont davantage Andersen que Rimbaud. C’est un livre toujours aussi imprégné de cinéma – une drogue dure -, de rock de légende, et de littérature de référence, comme on le dirait de « la puissance de feu d’un croiseur et des flingues de concours ». Les codes, les lieux (comme le Comptoir du relais, à l’Odéon, Paris VI), sont nombreux, et les aficionados, ou bien les habitués de la production de Christian Authier, s’amusent à les reconnaître en les annotant en marge, au crayon. Un jeu toujours réconfortant, façon chat qui ronronne, affalé sur le chauffage. Et la lecture de ce roman tendre et croquant à la fois comme une saint-jacques impeccablement snackée en devient un régal pâtissier. L.M.
Avec « Demi-siècle », Christian Authier se lâche davantage qu’à l’accoutumée. Sa prose est plus déliée, décontractée, farcie par endroits de parler à voix haute (il manque juste le son). Les formules, les traits, les remarques sur notre monde tel qu'il va plus ou moins bien sont toujours aussi ciselées, percutantes et pertinentes, mais il y a davantage de laisser faire, de tableaux minutieusement décrits dans un style d’une souplesse féline – les deux soirées de la fin du livre (surtout la longue première, hilarante), sont un régal fitzgeraldien, ou capotien (si ça se dit, pour Truman). Nous retrouvons l’auteur et son double, Patrick Berthet (la fidélité à la référence de ce patronyme est devenue indéfectible), journaliste « vieille école » ignorant les réseaux sociaux, cultivant un goût précis pour les bons flacons dont chacun, débouché au fil des pages, est précisément nommé (de Gramenon, des Foulards rouges, de Drappier, de Selosse, de l’Anglore, nous sommes informés de cuvées précises, et pas des moindres – et les partageons en pensée avec Patrick et ses potes tout en lisant). Laurence – une fois n’est pas coutume, une femme d’importance, escorte le narrateur, et il s’agit là d’un amour fort. Ces deux là s’aiment à Paris, à Toulouse (dont on connaît à la fin du livre le nom de chaque rue et place), à Istanbul, à Beyrouth sans mesure, et avec une franchise intérieure enviable. « Demi-siècle » est un brin désenchanté comme les quatre ou cinq précédents romans de Authier, bardé de touches à la Houellebecq sur notre triste époque numérisée et envahie par des Arthur qui sont davantage Andersen que Rimbaud. C’est un livre toujours aussi imprégné de cinéma – une drogue dure -, de rock de légende, et de littérature de référence, comme on le dirait de « la puissance de feu d’un croiseur et des flingues de concours ». Les codes, les lieux (comme le Comptoir du relais, à l’Odéon, Paris VI), sont nombreux, et les aficionados, ou bien les habitués de la production de Christian Authier, s’amusent à les reconnaître en les annotant en marge, au crayon. Un jeu toujours réconfortant, façon chat qui ronronne, affalé sur le chauffage. Et la lecture de ce roman tendre et croquant à la fois comme une saint-jacques impeccablement snackée en devient un régal pâtissier. L.M.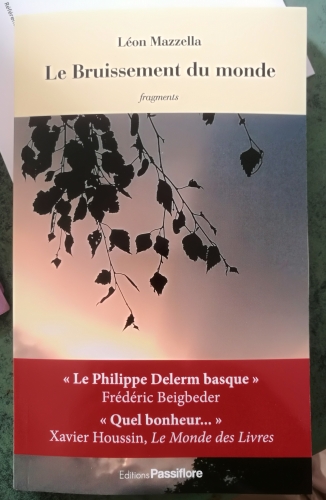
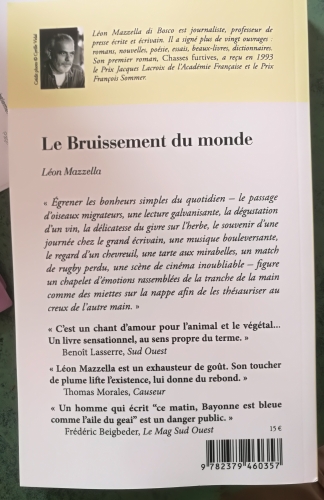
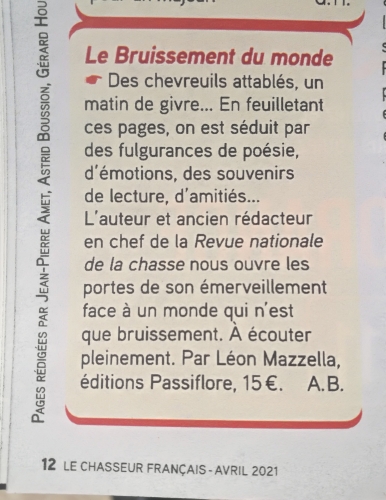
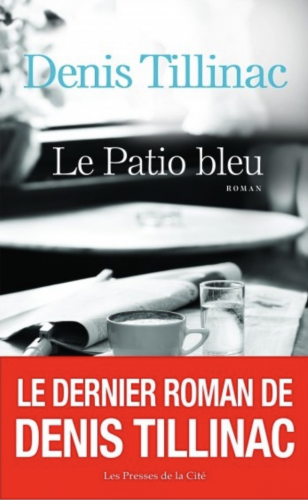 Il y eut, douloureusement, le roman posthume de Denis Tillinac, Le Patio bleu (Les Presses de la Cité). Sa page de faux-titre sans dédicace – et pour cause, résonna longtemps comme le timbre éraillé de sa voix, « Comment tu vas!.. ». Il y a tout là-dedans, il y a beaucoup dans cet épais roman riche d’images percutantes et de phrases aussi tendres qu’assassines parfois, et si justes, si fortes. Il s’y trouve une maturité de romancier impeccablement ramassée, une intrigue tillinacienne totale, la province gersoise, Condom – d’Artagnan n’est pas loin -, des Rastignac femelles, le désir d’en découdre avec une bourgeoise a priori rangée, les intrigues de ministère comme il y en eut de cour, les coups bas ou fourrés, l’amitié triomphale, les non-dits et les ouï-dire, la tendresse des paysages d’une France encore profonde dans tous les sens du terme, une mélancolie viscérale et bougonne par crainte de paraître trop délicate, des traits d’une justesse dans le mille à faire pâlir le La Bruyère des Caractères. Une ambiance IVe République, avec un Chirac en culottes courtes, une atmosphère « rad-soc » qui eut cours dans les campagnes qu’un jacobinisme arrogant ignorait, de Bellême (Perche) à Tulle (Corrèze), en passant par Condom, donc. Un air de Claude Sautet à la caméra plane sur ce dernier opus de Denis, et l’on se souvient tout à trac de son regard de saurien lorsque le silence se faisait parfois, qu’il suspendait sa cigarette (moment rare), et que nous l’entendions nous dire tant de choses dans le virage du rien. Salut l’ami.
Il y eut, douloureusement, le roman posthume de Denis Tillinac, Le Patio bleu (Les Presses de la Cité). Sa page de faux-titre sans dédicace – et pour cause, résonna longtemps comme le timbre éraillé de sa voix, « Comment tu vas!.. ». Il y a tout là-dedans, il y a beaucoup dans cet épais roman riche d’images percutantes et de phrases aussi tendres qu’assassines parfois, et si justes, si fortes. Il s’y trouve une maturité de romancier impeccablement ramassée, une intrigue tillinacienne totale, la province gersoise, Condom – d’Artagnan n’est pas loin -, des Rastignac femelles, le désir d’en découdre avec une bourgeoise a priori rangée, les intrigues de ministère comme il y en eut de cour, les coups bas ou fourrés, l’amitié triomphale, les non-dits et les ouï-dire, la tendresse des paysages d’une France encore profonde dans tous les sens du terme, une mélancolie viscérale et bougonne par crainte de paraître trop délicate, des traits d’une justesse dans le mille à faire pâlir le La Bruyère des Caractères. Une ambiance IVe République, avec un Chirac en culottes courtes, une atmosphère « rad-soc » qui eut cours dans les campagnes qu’un jacobinisme arrogant ignorait, de Bellême (Perche) à Tulle (Corrèze), en passant par Condom, donc. Un air de Claude Sautet à la caméra plane sur ce dernier opus de Denis, et l’on se souvient tout à trac de son regard de saurien lorsque le silence se faisait parfois, qu’il suspendait sa cigarette (moment rare), et que nous l’entendions nous dire tant de choses dans le virage du rien. Salut l’ami.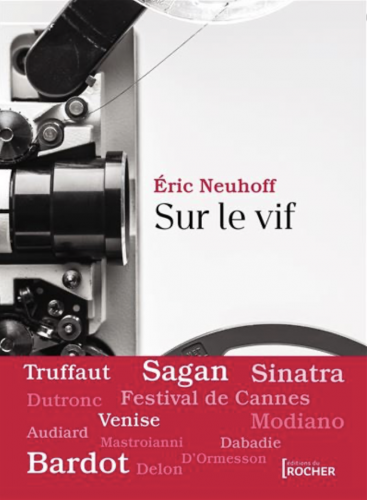 Il y eut la somme de chroniques d’Éric Neuhoff parues dans Le Figaro, sous le titre Sur le vif (Le Rocher), évoqué brièvement ici il y a peu, pour nous offrir le plaisir de relire les phrases brèves et toniques, à la Nimier, le style félin et claquant de son héritier spirituel. Qu’il évoque Biarritz, Brigitte Bardot, Los Angeles, Françoise Sagan, la Fontaine de Trévi, Frédéric Berthet, Cadaqués, Stallone comme Mastroianni, le Toulouse de Christian Authier ou encore l’une de ses idoles, Frank Sinatra, Dieppe ou Truman Capote, Le Ritz ou Michel Déon, Neuhoff délivre ses denses déclarations d’amour comme on ne délivre plus des compressions de César, car lui le fait avec tact et sensibilité, intelligence et style. Un pur bonheur.
Il y eut la somme de chroniques d’Éric Neuhoff parues dans Le Figaro, sous le titre Sur le vif (Le Rocher), évoqué brièvement ici il y a peu, pour nous offrir le plaisir de relire les phrases brèves et toniques, à la Nimier, le style félin et claquant de son héritier spirituel. Qu’il évoque Biarritz, Brigitte Bardot, Los Angeles, Françoise Sagan, la Fontaine de Trévi, Frédéric Berthet, Cadaqués, Stallone comme Mastroianni, le Toulouse de Christian Authier ou encore l’une de ses idoles, Frank Sinatra, Dieppe ou Truman Capote, Le Ritz ou Michel Déon, Neuhoff délivre ses denses déclarations d’amour comme on ne délivre plus des compressions de César, car lui le fait avec tact et sensibilité, intelligence et style. Un pur bonheur.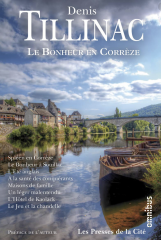
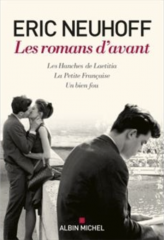 Et, comme le hasard n’existe pas, il y eut deux compilations fraternelles quasiment au même moment à l’étal des librairies : d'un côté, les romans corréziens de « Tilli » chez Omnibus, Le Bonheur en Corrèze, qui rassemble en un épais pavé huit de ses romans essentiels, et de l’autre, trois romans indispensables de Neuhoff réunis par Albin Michel, Les romans d’avant.
Et, comme le hasard n’existe pas, il y eut deux compilations fraternelles quasiment au même moment à l’étal des librairies : d'un côté, les romans corréziens de « Tilli » chez Omnibus, Le Bonheur en Corrèze, qui rassemble en un épais pavé huit de ses romans essentiels, et de l’autre, trois romans indispensables de Neuhoff réunis par Albin Michel, Les romans d’avant.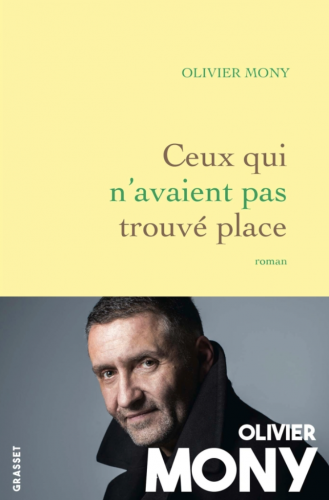 Il y eut le premier roman d’Olivier Mony, Ceux qui n’avait pas trouvé place (Grasset) retardé pour cause de pandémie, enfin entre nos mains (nous l’achetâmes le jour de sa parution), un bref roman modianesque en diable – tant qu’on croirait entendre la voix de Patrick le Nobel le dicter, avec des personnages foutraques, soit attachants (Serge, bien sûr, Elkoubi, etc, et puis Piètre, et d’autres), un Bordeaux lisse et troussé en connaisseur, et au fond un livre comme un tapis volant sur lequel nous sommes priés gentiment d’embarquer, ce que nous avons fait gaiement.
Il y eut le premier roman d’Olivier Mony, Ceux qui n’avait pas trouvé place (Grasset) retardé pour cause de pandémie, enfin entre nos mains (nous l’achetâmes le jour de sa parution), un bref roman modianesque en diable – tant qu’on croirait entendre la voix de Patrick le Nobel le dicter, avec des personnages foutraques, soit attachants (Serge, bien sûr, Elkoubi, etc, et puis Piètre, et d’autres), un Bordeaux lisse et troussé en connaisseur, et au fond un livre comme un tapis volant sur lequel nous sommes priés gentiment d’embarquer, ce que nous avons fait gaiement.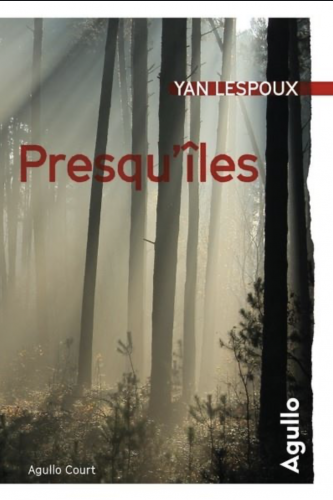 rugueuse et âpre, si vraie « avé l’accent » médocain, ces très courtes nouvelles qui circonscrivent des personnages forts, durs, à la Franck Bouysse, des scènes d’un quotidien que peu connaissent, sauvage, reculé, essentiel car forestier, chasseur, braconnier, rude, d’une vérité crue à côté de laquelle steak tartare et carpaccio passent pour des carnes cuites. Presqu’îles, de Yan Lespoux (Agullo) est un livre précieux comme un premier roman de Sylvie Germain ou de Jean Carrière. Un beau cèpe cru dans ce beau voisinage gionesque-là...
rugueuse et âpre, si vraie « avé l’accent » médocain, ces très courtes nouvelles qui circonscrivent des personnages forts, durs, à la Franck Bouysse, des scènes d’un quotidien que peu connaissent, sauvage, reculé, essentiel car forestier, chasseur, braconnier, rude, d’une vérité crue à côté de laquelle steak tartare et carpaccio passent pour des carnes cuites. Presqu’îles, de Yan Lespoux (Agullo) est un livre précieux comme un premier roman de Sylvie Germain ou de Jean Carrière. Un beau cèpe cru dans ce beau voisinage gionesque-là...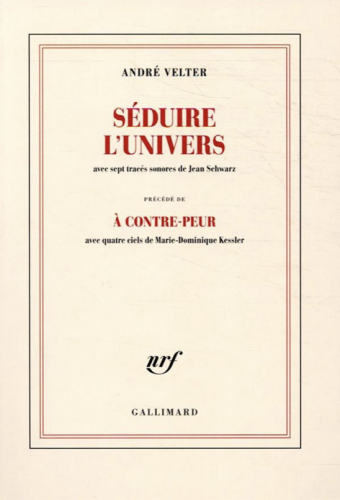
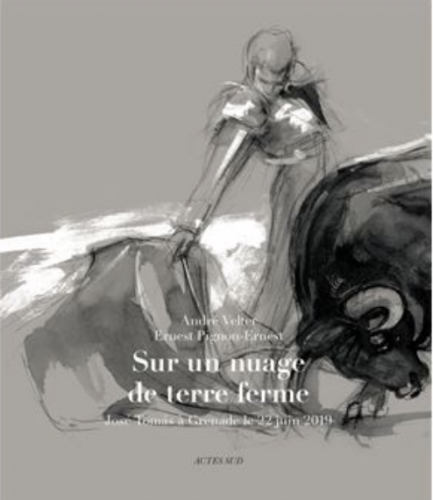 Il y eut l’annonce du Printemps des poètes, avec pour thème Le Désir, loué par Sophie Nauleau chez Actes Sud (nous attendons l’ouvrage), et des phares ici et là pour éclairer la route du mot qui émeut plus qu’un coup de foudre. André Velter, compagnon de la précitée, livre Séduire l’Univers, précédé de À contre-peur, illustré de « tracés sonores » de Jean Schwarz (le premier), et de quatre « ciels » de Marie-Dominique Kessler (le second). Il s’agit de l’un de ces livres composés à plusieurs mains, dont Velter a l’habitude, et qui produisent un dialogue en fruition, une poésie non pas amalgamée, mais épousée, risquons un mot : « puzzle-isée », c’est l’agudeza de Baltasar Gracián invoquée par l’auteur, autrement dit l’acuité ingénieuse, dont il est ici question. « Par-delà l’espace et le temps », dit l’auteur, « il est des affinités électives, ou ce que Julien Gracq appelait des consanguinités d’esprit, qui ne peuvent durablement rester sans résurgence. »
Il y eut l’annonce du Printemps des poètes, avec pour thème Le Désir, loué par Sophie Nauleau chez Actes Sud (nous attendons l’ouvrage), et des phares ici et là pour éclairer la route du mot qui émeut plus qu’un coup de foudre. André Velter, compagnon de la précitée, livre Séduire l’Univers, précédé de À contre-peur, illustré de « tracés sonores » de Jean Schwarz (le premier), et de quatre « ciels » de Marie-Dominique Kessler (le second). Il s’agit de l’un de ces livres composés à plusieurs mains, dont Velter a l’habitude, et qui produisent un dialogue en fruition, une poésie non pas amalgamée, mais épousée, risquons un mot : « puzzle-isée », c’est l’agudeza de Baltasar Gracián invoquée par l’auteur, autrement dit l’acuité ingénieuse, dont il est ici question. « Par-delà l’espace et le temps », dit l’auteur, « il est des affinités électives, ou ce que Julien Gracq appelait des consanguinités d’esprit, qui ne peuvent durablement rester sans résurgence. »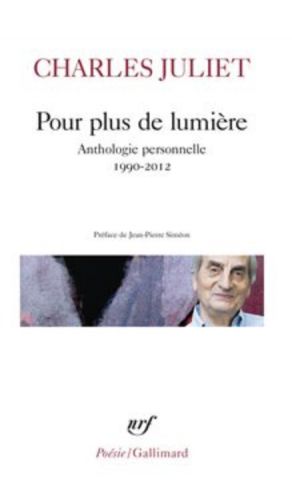 Il y eût la somme infiniment précieuse, l’anthologie personnelle de l’immense Charles Juliet que propose Poésie/Gallimard, Pour plus de lumière, 1990-2012. L’essentiel, choisi donc par l’auteur lui-même (à l’instar de Commune présence, de Char, et de L’encre serait de l’ombre, de Jaccottet), d’une poésie placée sous le signe d’une « ardente recherche de la lumière » (et je m’autorise à reproduire ici, avec ces quelques mots, un extrait de la dédicace que l’auteur a rédigée sur mon exemplaire). Nous y retrouvons les recueils majeurs comme Affûts, Ce pays du silence, Moisson... Des trésors réunis en un seul recueil lourd et compact, que l’on a envie de trimbaler chaque week-end, où que l’on aille.
Il y eût la somme infiniment précieuse, l’anthologie personnelle de l’immense Charles Juliet que propose Poésie/Gallimard, Pour plus de lumière, 1990-2012. L’essentiel, choisi donc par l’auteur lui-même (à l’instar de Commune présence, de Char, et de L’encre serait de l’ombre, de Jaccottet), d’une poésie placée sous le signe d’une « ardente recherche de la lumière » (et je m’autorise à reproduire ici, avec ces quelques mots, un extrait de la dédicace que l’auteur a rédigée sur mon exemplaire). Nous y retrouvons les recueils majeurs comme Affûts, Ce pays du silence, Moisson... Des trésors réunis en un seul recueil lourd et compact, que l’on a envie de trimbaler chaque week-end, où que l’on aille.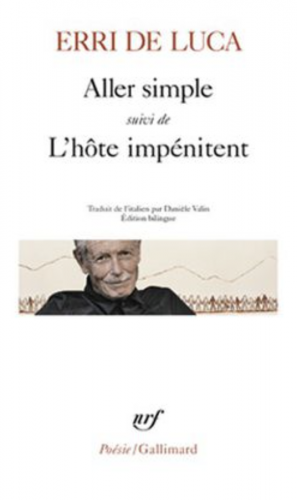 (bilingue) d’Erri de Luca, Aller simple, suivi de L’hôte impénitent, où l’on retrouve l’auteur limpide d’œuvre sur l’eau. Poésie presque parlée, comme récitée à l’église le matin, morale par endroits, humble toujours, où la barque et le filet du pêcheur, ses quelques prises, ont la grâce du simple recueillant avec reconnaissance ce qui lui suffit. Demi-surprise : Aller simple évoque l’épopée tragique des migrants échouant tant bien que mal sur les côtes italiennes, ou la poésie devient politique, militante, mais avant tout humaniste avec une remarquable sobriété qui rappelle les récits de Primo Levi. Cependant, les poèmes qui composent L'hôte impénitent nous font retrouver le De Luca romancier devenu alpiniste mystique, et toujours sensuel, dont les épaules porteront toujours les traces salées de la Méditerranée, du côté de l'île d'Ischia...
(bilingue) d’Erri de Luca, Aller simple, suivi de L’hôte impénitent, où l’on retrouve l’auteur limpide d’œuvre sur l’eau. Poésie presque parlée, comme récitée à l’église le matin, morale par endroits, humble toujours, où la barque et le filet du pêcheur, ses quelques prises, ont la grâce du simple recueillant avec reconnaissance ce qui lui suffit. Demi-surprise : Aller simple évoque l’épopée tragique des migrants échouant tant bien que mal sur les côtes italiennes, ou la poésie devient politique, militante, mais avant tout humaniste avec une remarquable sobriété qui rappelle les récits de Primo Levi. Cependant, les poèmes qui composent L'hôte impénitent nous font retrouver le De Luca romancier devenu alpiniste mystique, et toujours sensuel, dont les épaules porteront toujours les traces salées de la Méditerranée, du côté de l'île d'Ischia...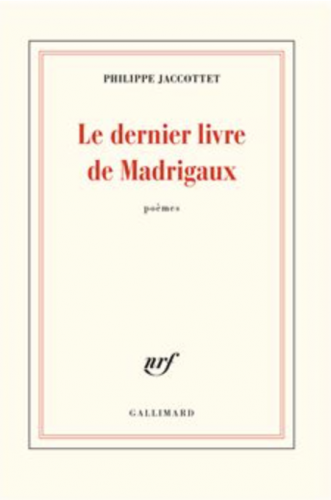
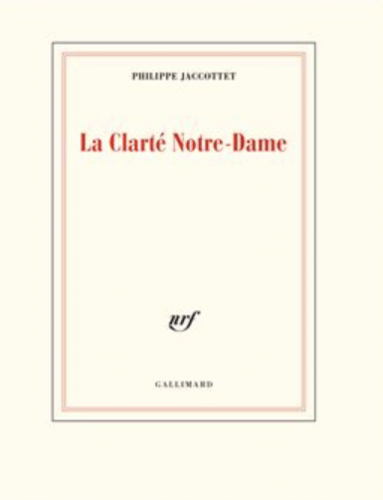 Enfin, il y eut, juste après la disparition du très grand Philippe Jaccottet, deux inédits, Le dernier livre de Madrigaux, et La Clarté Notre-Dame (Gallimard), pour nous rappeler à l’essentiel, soit au chant fragile des oiseaux à l’aube dans un verger de peu planté de longue date à Grignan, dans la Drôme, l’écho d’une cloche des Vêpres à Salernes (où vécut sur le tard le regretté Pierre Moinot), « dans l’enceinte sacrée, très-haut » (Hölderlin), des mots simples comme de ces brindilles dont Char rêvait de bâtir un rempart, des mots tragiques à peine d’un poète avouant son grand âge et citant Hölderlin encore comme on lance un grappin, « Énigme, ce qui sourd pur ». Des textes essentiels et crépusculaires, et néanmoins heureux, surtout lorsqu’il s’agit d’évoquer Claudio Monteverdi, « c’est par urgence que sa voix prend feu ». « Ainsi lié, je me délivre de l’hiver »... Jaccottet a rejoint, à 95 ans, « le tissu bleu du ciel ». Et nous continuerons d’entretenir commerce quotidien avec son œuvre capitale. L.M.
Enfin, il y eut, juste après la disparition du très grand Philippe Jaccottet, deux inédits, Le dernier livre de Madrigaux, et La Clarté Notre-Dame (Gallimard), pour nous rappeler à l’essentiel, soit au chant fragile des oiseaux à l’aube dans un verger de peu planté de longue date à Grignan, dans la Drôme, l’écho d’une cloche des Vêpres à Salernes (où vécut sur le tard le regretté Pierre Moinot), « dans l’enceinte sacrée, très-haut » (Hölderlin), des mots simples comme de ces brindilles dont Char rêvait de bâtir un rempart, des mots tragiques à peine d’un poète avouant son grand âge et citant Hölderlin encore comme on lance un grappin, « Énigme, ce qui sourd pur ». Des textes essentiels et crépusculaires, et néanmoins heureux, surtout lorsqu’il s’agit d’évoquer Claudio Monteverdi, « c’est par urgence que sa voix prend feu ». « Ainsi lié, je me délivre de l’hiver »... Jaccottet a rejoint, à 95 ans, « le tissu bleu du ciel ». Et nous continuerons d’entretenir commerce quotidien avec son œuvre capitale. L.M.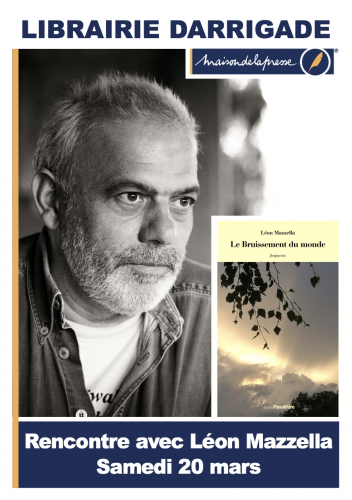
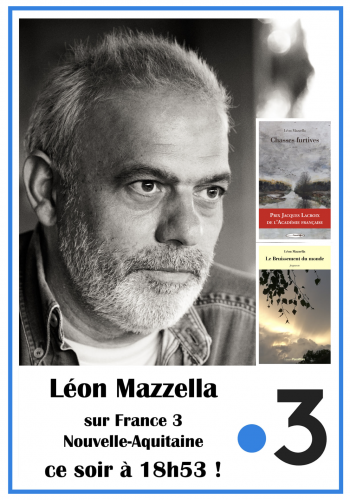
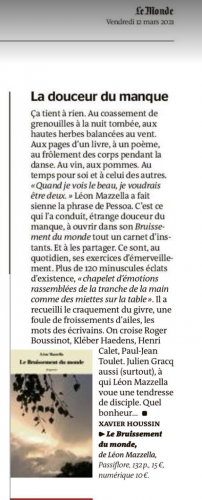

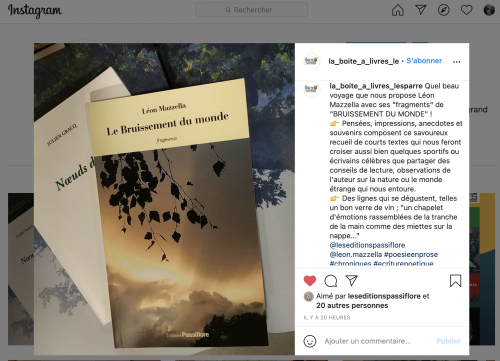

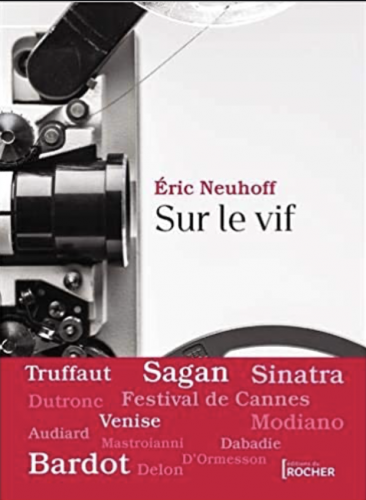 vin est un Largo de Haendel. Il fut dégusté pour lui-même au premier verre, puis il escorta avec élégance, voire avec courtoisie, un dos de cabillaud épais et juteux. J'ajoute qu'il épouse par ailleurs la lecture des chroniques parues dans Le Figaro et rassemblées, d'Éric Neuhoff, Sur le vif, car il y a là aussi une mélancolique douceur sous le claquant du masque d'un Hussard sachant comme personne dire ses préférences et taire ses blessures. Un vin et un livre à la fois légers et profonds. Le grand style, quoi. L.M.
vin est un Largo de Haendel. Il fut dégusté pour lui-même au premier verre, puis il escorta avec élégance, voire avec courtoisie, un dos de cabillaud épais et juteux. J'ajoute qu'il épouse par ailleurs la lecture des chroniques parues dans Le Figaro et rassemblées, d'Éric Neuhoff, Sur le vif, car il y a là aussi une mélancolique douceur sous le claquant du masque d'un Hussard sachant comme personne dire ses préférences et taire ses blessures. Un vin et un livre à la fois légers et profonds. Le grand style, quoi. L.M.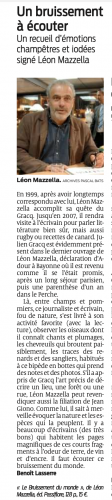
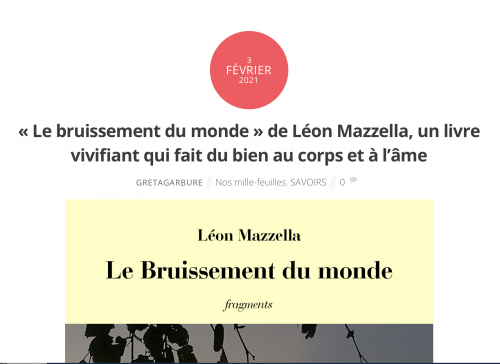
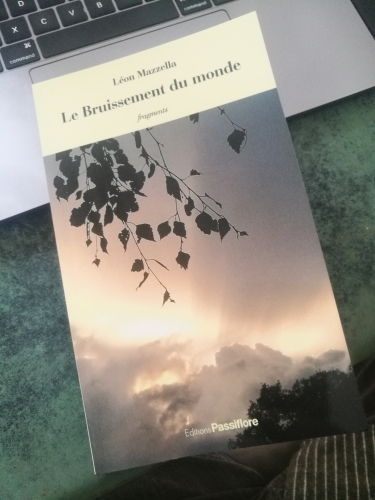
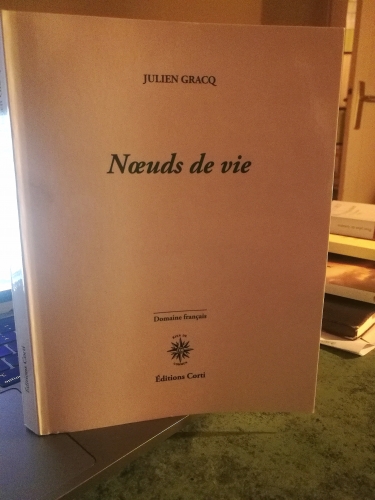
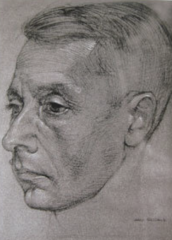 (*) Éditions Corti, 18€ (notons que le prénom de José Corti a disparu de l’enseigne, et que depuis quelques années déjà, les livres publiés sous la houlette de Bertrand Fillaudeau, co-directeur avec Fabienne Raphoz, mais pas parce que l'oiseau, hélas, sont dûment massicotés et plus non-découpés ; comme tous les autres en somme. Rien de commun, ou presque...). Ci-contre, portrait de l'auteur par Hans Bellmer qui était accroché dans le salon où il recevait ses aficionados...
(*) Éditions Corti, 18€ (notons que le prénom de José Corti a disparu de l’enseigne, et que depuis quelques années déjà, les livres publiés sous la houlette de Bertrand Fillaudeau, co-directeur avec Fabienne Raphoz, mais pas parce que l'oiseau, hélas, sont dûment massicotés et plus non-découpés ; comme tous les autres en somme. Rien de commun, ou presque...). Ci-contre, portrait de l'auteur par Hans Bellmer qui était accroché dans le salon où il recevait ses aficionados...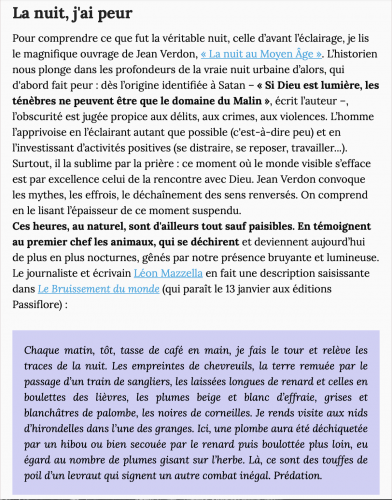
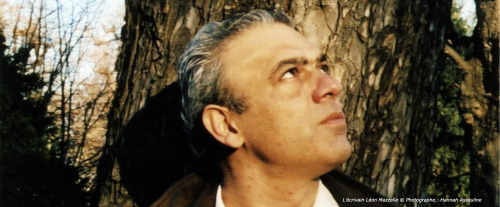
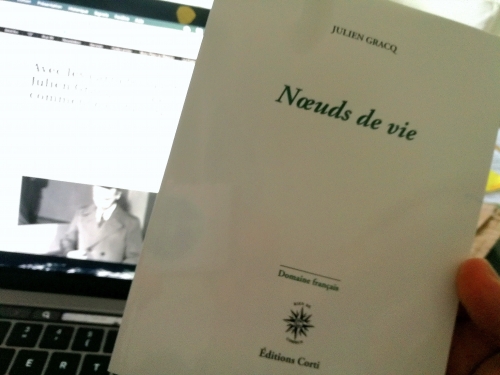
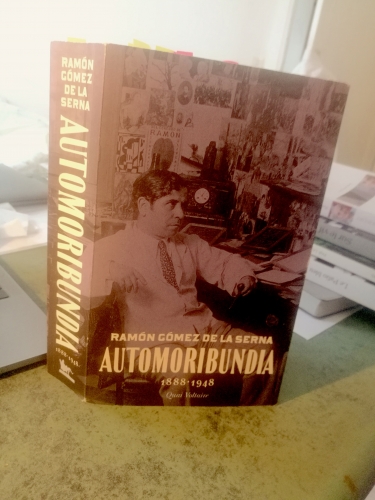
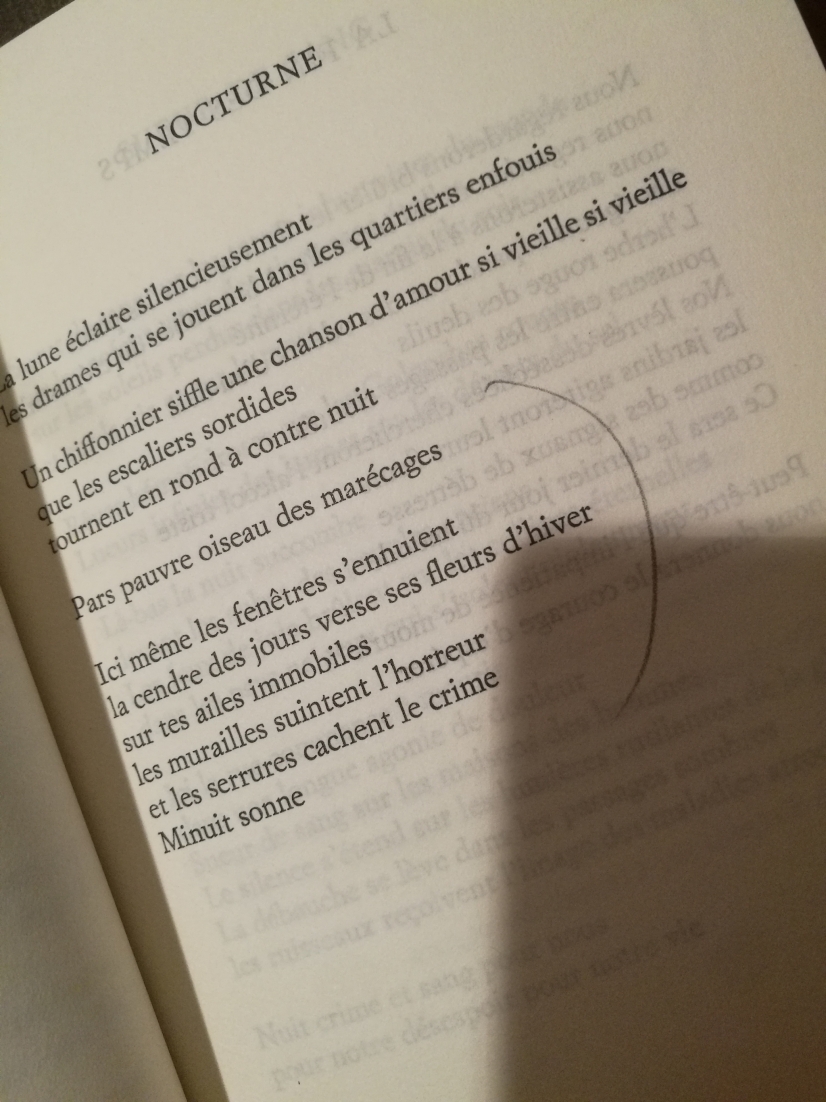
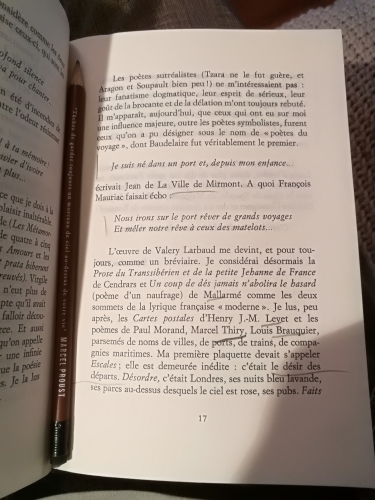
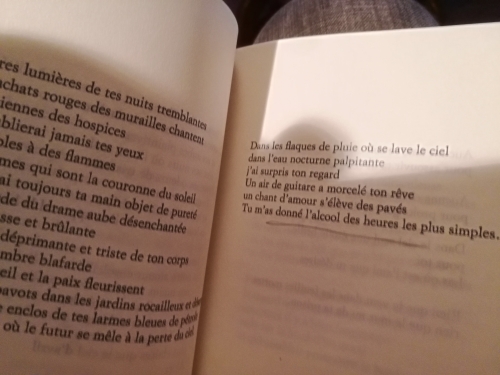
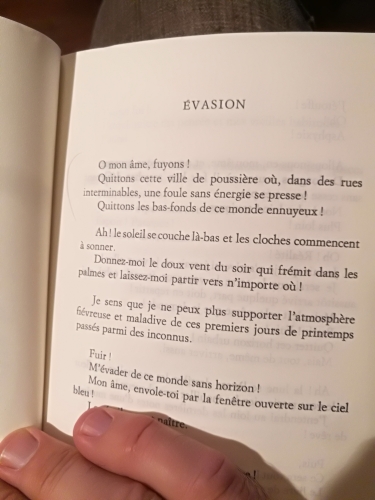
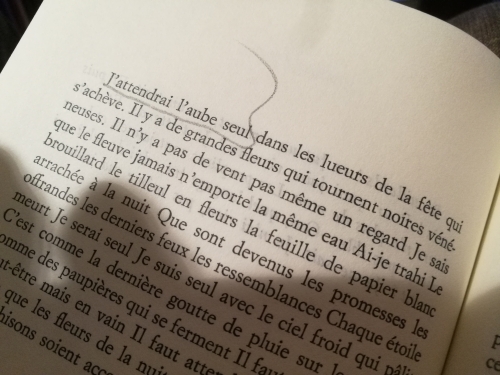
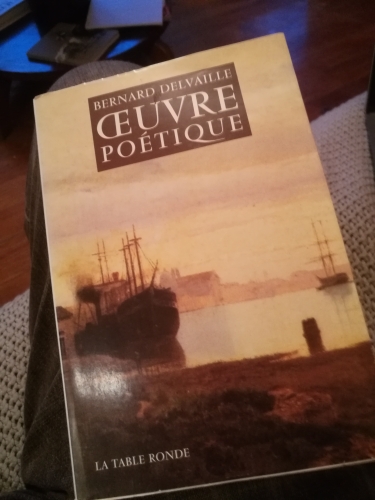
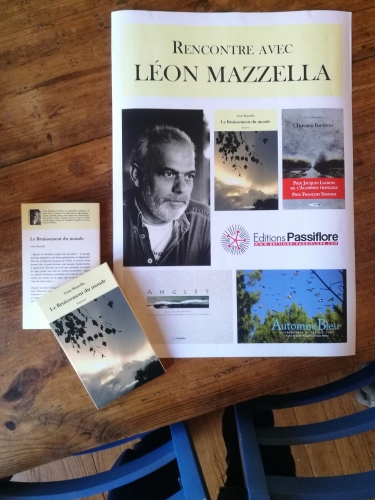


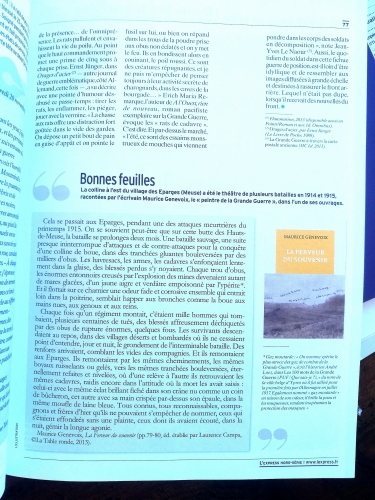 Et, dans cette attente... La Petite Vermillon (La Table Ronde) propose plusieurs titres de Maurice Genevoix : Rroû, La Mort de près, Trente mille jours, et Pour Genevoix, splendide hommage rendu par Michel Bernard (l'un des ardents artisans du transfert des cendres de Genevoix qui aura lieu cet après-midi en haut de la Montagne Sainte-Geneviève, avec feu Bernard Maris et feue la femme de Maris, Sylvie Genevoix, fille de Maurice,). Voir aussi à La Table Ronde (en grand format, donc), La Ferveur du souvenir, sur la Grande Guerre également (essais rassemblés par Laurence Campa, dont le travail sur l'oeuvre de Genevoix - et celle d'Apollinaire - est admirable. Photo ci-dessus d'un extrait que j'eus plaisir à publier dans le même gros hors-série de L'Express cité plus haut). Les classiques de Maurice Genevoix (Raboliot, La Forêt perdue, La Dernière harde, mais également Forêt voisine, Rémi des Rauches,...) sont disponibles en format de poche, au Livre de Poche, chez Garnier Flammarion, aux Cahiers Rouges (Grasset), ou encore en folio. Il faut lire, et relire à la fois le Genevoix de la boucherie tragique des Éparges, et celui des forêts solognotes braconnières et des bords de Loire hantés par une faune mystérieuse...
Et, dans cette attente... La Petite Vermillon (La Table Ronde) propose plusieurs titres de Maurice Genevoix : Rroû, La Mort de près, Trente mille jours, et Pour Genevoix, splendide hommage rendu par Michel Bernard (l'un des ardents artisans du transfert des cendres de Genevoix qui aura lieu cet après-midi en haut de la Montagne Sainte-Geneviève, avec feu Bernard Maris et feue la femme de Maris, Sylvie Genevoix, fille de Maurice,). Voir aussi à La Table Ronde (en grand format, donc), La Ferveur du souvenir, sur la Grande Guerre également (essais rassemblés par Laurence Campa, dont le travail sur l'oeuvre de Genevoix - et celle d'Apollinaire - est admirable. Photo ci-dessus d'un extrait que j'eus plaisir à publier dans le même gros hors-série de L'Express cité plus haut). Les classiques de Maurice Genevoix (Raboliot, La Forêt perdue, La Dernière harde, mais également Forêt voisine, Rémi des Rauches,...) sont disponibles en format de poche, au Livre de Poche, chez Garnier Flammarion, aux Cahiers Rouges (Grasset), ou encore en folio. Il faut lire, et relire à la fois le Genevoix de la boucherie tragique des Éparges, et celui des forêts solognotes braconnières et des bords de Loire hantés par une faune mystérieuse...
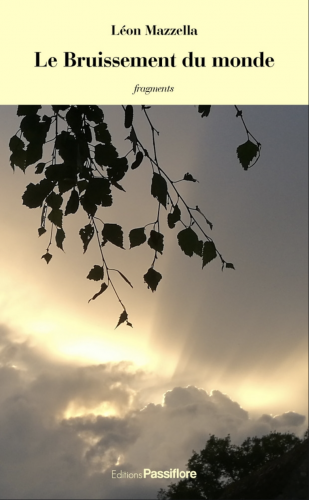
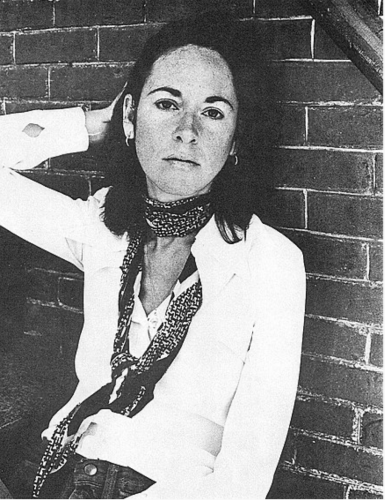
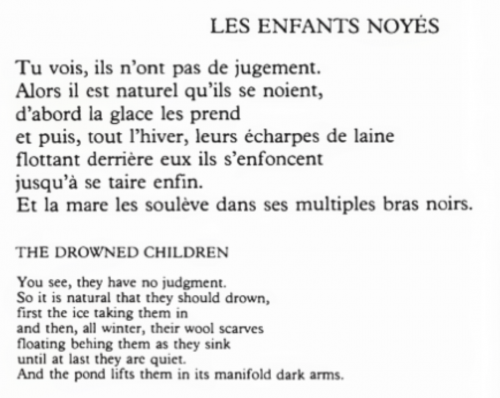
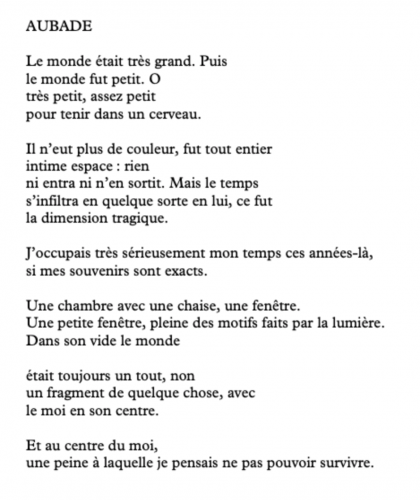
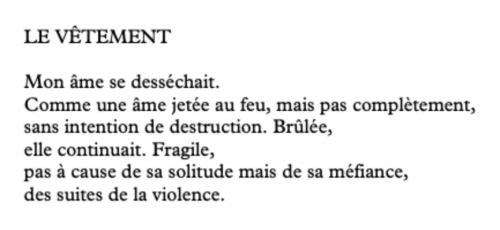
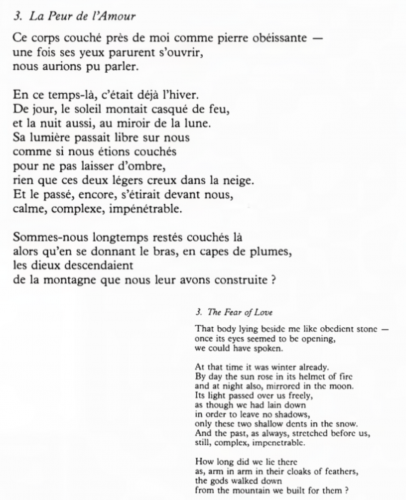
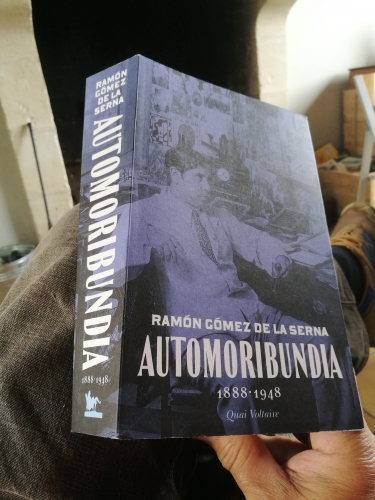

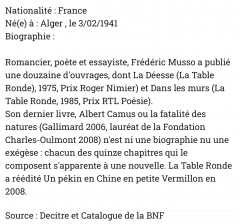
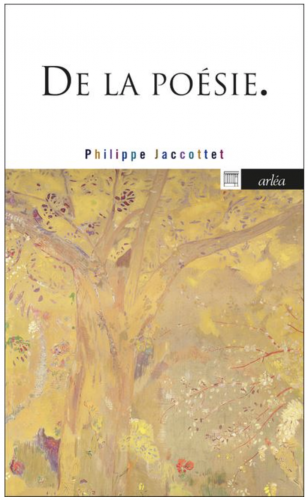
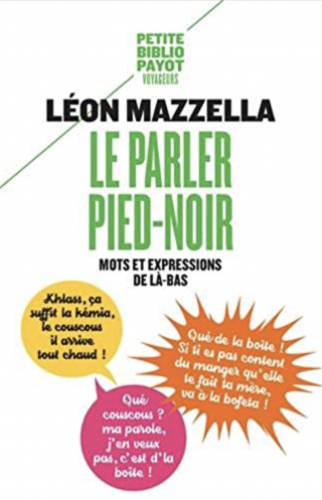
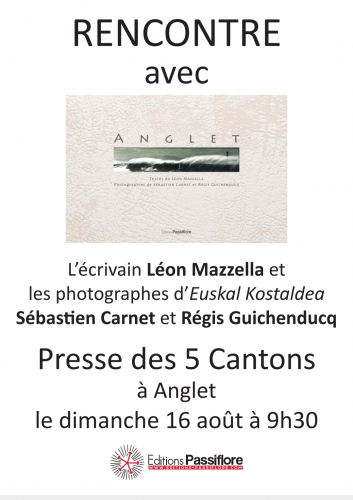
 Douglas Potier, jeune élu sans étiquette âgé de 25 ans, appartenant au conseil municipal de la commune de Bolbec, Seine-Maritime, aurait pris à partie plusieurs élues de son assemblée en les traitant de « bécasses » et d’ « animal de ferme », au motif qu’elles s’efforçaient de couvrir sa parole lorsqu’il la prenait. Je me fiche totalement de la teneur locale du débat, et de l’enjeu dont il fut question. Y compris des animaux de ferme. Je souhaite juste rectifier certains tirs (à canon lisse, c’est préférable), en chuchotant à ce trublion qui souhaite que « les bécasses qui ricanent (...) soient rappelées à l’ordre », qu'il a, ce faisant (pan!) prononcé une ineptie ornithologique, cynégétique, ontologique, et autres giques. Ce qui me turlupine, c’est cette tendance à vouloir comparer la supposée bêtise féminine (je sens qu’en écrivant ces deux mots, je vais écoper d’au moins 2 963 lynchages de la part des procureuses de la raie publique), à un oiseau, Scolopax rusticola, lequel est doté d’une intelligence tellement rare qu’elle est (inconsciemment) jalousée par l’ensemble de la gent ailée. Car, oui, la bécasse est un oiseau d’une subtilité exceptionnelle, d’une discrétion qui devrait servir d’exemple au traoerisme ambiant (lequel rappelle, un cran en dessous, un certain nabilisme auréolé d’une pensée historique, « Allo, quoi ! » souvenez-vous, en référence à un shampoing, dont les vertus étaient éloignées de celles que la lecture de Spinoza procure jusqu'au cuir chevelu). Que cette « dame au long bec », ou « mordorée », la bécasse donc, d’une habileté naturelle extrême, d’une humilité qui n’a d’égale que son mimétisme, lequel augmente son sens de la pudeur et de l’élégance, ne saurait continuer de souffrir de passer pour le synonyme d’attributs négatifs, idiots, décervelés. La bécasse, la « dame des bois », solitaire le plus clair de son temps, est un oiseau (féminisé, quel que soit son sexe), que tout amateur, tout ornithologue improvisé, tout chasseur dévot, vénère comme une Déesse. Alors, lorsque, sans même avoir besoin de dégainer Maupassant et ses splendides « Contes de la bécasse » comme on épaule un calibre 20 au pied d’un chêne perdu dans une pinède landaise (au hasard) à l’instant où la cloche du chien se tait, je dirai juste à Stéphanie Kerbarh, députée de Seine-Maritime prompte à condamner les propos « sexistes » de Douglas Potier – mais surtout à ce dernier -, qu’il devraient mieux choisir ou colporter les noms de volatiles dont les femmes de leur conseil et de leur assemblée sont affublées. Au moins par respect pour les oiselles. S’il vous plaît. Que n’avons-nous pas entendu parler plutôt de « triple buse » (pourquoi triple, d’ailleurs, je me le demande chaque fois), de « dinde », et autres (têtes de) « linottes ». Non. Retenez juste que la bécasse, donc, est un oiseau d’une « intelligence » rare (je risque le mot, car Darwin roupille, et que Buffon prend l'apéro - j’en profite !), qui fascine depuis l’aube de l’humanité civilisée, tout être humain botté épris de beauté sauvage, sensible et pure. Bref, être traitée de bécasse est un honneur, mesdames. CQFD. L.M.
Douglas Potier, jeune élu sans étiquette âgé de 25 ans, appartenant au conseil municipal de la commune de Bolbec, Seine-Maritime, aurait pris à partie plusieurs élues de son assemblée en les traitant de « bécasses » et d’ « animal de ferme », au motif qu’elles s’efforçaient de couvrir sa parole lorsqu’il la prenait. Je me fiche totalement de la teneur locale du débat, et de l’enjeu dont il fut question. Y compris des animaux de ferme. Je souhaite juste rectifier certains tirs (à canon lisse, c’est préférable), en chuchotant à ce trublion qui souhaite que « les bécasses qui ricanent (...) soient rappelées à l’ordre », qu'il a, ce faisant (pan!) prononcé une ineptie ornithologique, cynégétique, ontologique, et autres giques. Ce qui me turlupine, c’est cette tendance à vouloir comparer la supposée bêtise féminine (je sens qu’en écrivant ces deux mots, je vais écoper d’au moins 2 963 lynchages de la part des procureuses de la raie publique), à un oiseau, Scolopax rusticola, lequel est doté d’une intelligence tellement rare qu’elle est (inconsciemment) jalousée par l’ensemble de la gent ailée. Car, oui, la bécasse est un oiseau d’une subtilité exceptionnelle, d’une discrétion qui devrait servir d’exemple au traoerisme ambiant (lequel rappelle, un cran en dessous, un certain nabilisme auréolé d’une pensée historique, « Allo, quoi ! » souvenez-vous, en référence à un shampoing, dont les vertus étaient éloignées de celles que la lecture de Spinoza procure jusqu'au cuir chevelu). Que cette « dame au long bec », ou « mordorée », la bécasse donc, d’une habileté naturelle extrême, d’une humilité qui n’a d’égale que son mimétisme, lequel augmente son sens de la pudeur et de l’élégance, ne saurait continuer de souffrir de passer pour le synonyme d’attributs négatifs, idiots, décervelés. La bécasse, la « dame des bois », solitaire le plus clair de son temps, est un oiseau (féminisé, quel que soit son sexe), que tout amateur, tout ornithologue improvisé, tout chasseur dévot, vénère comme une Déesse. Alors, lorsque, sans même avoir besoin de dégainer Maupassant et ses splendides « Contes de la bécasse » comme on épaule un calibre 20 au pied d’un chêne perdu dans une pinède landaise (au hasard) à l’instant où la cloche du chien se tait, je dirai juste à Stéphanie Kerbarh, députée de Seine-Maritime prompte à condamner les propos « sexistes » de Douglas Potier – mais surtout à ce dernier -, qu’il devraient mieux choisir ou colporter les noms de volatiles dont les femmes de leur conseil et de leur assemblée sont affublées. Au moins par respect pour les oiselles. S’il vous plaît. Que n’avons-nous pas entendu parler plutôt de « triple buse » (pourquoi triple, d’ailleurs, je me le demande chaque fois), de « dinde », et autres (têtes de) « linottes ». Non. Retenez juste que la bécasse, donc, est un oiseau d’une « intelligence » rare (je risque le mot, car Darwin roupille, et que Buffon prend l'apéro - j’en profite !), qui fascine depuis l’aube de l’humanité civilisée, tout être humain botté épris de beauté sauvage, sensible et pure. Bref, être traitée de bécasse est un honneur, mesdames. CQFD. L.M. Petite brassée à dominante poétique (comme souvent, ici). Les Poèmes bleus de Georges Perros disent sa Bretagne avec simplicité, comme l'auteur des fameux Papiers collés savait le faire. Avec fluidité et de manière percutante, comme un coup de poing de coton. Tout en souplesse et délicatesse bourrue.
Petite brassée à dominante poétique (comme souvent, ici). Les Poèmes bleus de Georges Perros disent sa Bretagne avec simplicité, comme l'auteur des fameux Papiers collés savait le faire. Avec fluidité et de manière percutante, comme un coup de poing de coton. Tout en souplesse et délicatesse bourrue.  L'oeuvre poétique d'Andrée Chedid est quasiment rassemblée en un copieux volume, Textes pour un poème, suivi de Poèmes pour un texte. Préfacée par "M", Matthieu Chédid, son petit-fils, cette somme s'attache à la concision, à la lucidité sans compromis. La poésie est naturelle. Elle est l'eau de notre seconde soif, écrit-elle. Tout elle...
L'oeuvre poétique d'Andrée Chedid est quasiment rassemblée en un copieux volume, Textes pour un poème, suivi de Poèmes pour un texte. Préfacée par "M", Matthieu Chédid, son petit-fils, cette somme s'attache à la concision, à la lucidité sans compromis. La poésie est naturelle. Elle est l'eau de notre seconde soif, écrit-elle. Tout elle...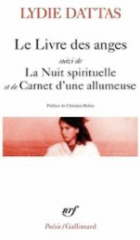 De Lydie Dattas, Le Livre des anges, suivi deLa Nuit spirituelle (écrit pour Jean Genet), et de Carnet d'une allumeuse, sont l'essentiel de l'oeuvre de cette étonnante femme qui épousa Alexandre Bouglione (du cirque éponyme), et créa avec lui le cirque Romanès (Alexandre, Romanès cette fois, publia par la suite des poèmes chez Gallimard...), et compagne de Christian Bobin... Sa poésie possède une puissance lyrique qui n'a d'égale que la sensualité de ses vers libres, sauvages. Lisez Dattas.
De Lydie Dattas, Le Livre des anges, suivi deLa Nuit spirituelle (écrit pour Jean Genet), et de Carnet d'une allumeuse, sont l'essentiel de l'oeuvre de cette étonnante femme qui épousa Alexandre Bouglione (du cirque éponyme), et créa avec lui le cirque Romanès (Alexandre, Romanès cette fois, publia par la suite des poèmes chez Gallimard...), et compagne de Christian Bobin... Sa poésie possède une puissance lyrique qui n'a d'égale que la sensualité de ses vers libres, sauvages. Lisez Dattas. De Joris-Karl Huysmans, Le Drageoir aux épices, et Croquis parisiens sont loin d'égaler À rebours ou tout autre texte en prose de cet auteur devenu culte, et pléiadisé de fraîche date. Sauf que l'esthète que nous savons se situe dans la droite ligne des poètes aimant la prose poétique, comme Aloysius Bertrand et Charles Baudelaire. Chez Huysmans, la moindre scène de rue, de brasserie, sert à croquer des personnages anonymes, à la vie minuscule, et ils en deviennent des gravures, des eaux (de vie) fortes.
De Joris-Karl Huysmans, Le Drageoir aux épices, et Croquis parisiens sont loin d'égaler À rebours ou tout autre texte en prose de cet auteur devenu culte, et pléiadisé de fraîche date. Sauf que l'esthète que nous savons se situe dans la droite ligne des poètes aimant la prose poétique, comme Aloysius Bertrand et Charles Baudelaire. Chez Huysmans, la moindre scène de rue, de brasserie, sert à croquer des personnages anonymes, à la vie minuscule, et ils en deviennent des gravures, des eaux (de vie) fortes.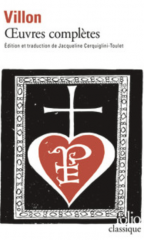 Folio nous offre les Oeuvres complètes de François Villon dans une édition bilingue (ancien français - français moderne) pilotée par la savante Jacqueline Cerquigny-Toulet. Le poète médiéval maudit, le mauvais garçon, le voyou de Paris, hors-la-loi, taulard à plusieurs reprises, banni, s'éclipsa avec tant de tact qu'on perdit sa trace en 1463. Il avait trente-deux ans, et déjà bâti une oeuvre universelle. Je, François Villon, se fiche de l'amour courtois comme d'une guigne, il trousse, détrousse, profane tout. Entêtant.
Folio nous offre les Oeuvres complètes de François Villon dans une édition bilingue (ancien français - français moderne) pilotée par la savante Jacqueline Cerquigny-Toulet. Le poète médiéval maudit, le mauvais garçon, le voyou de Paris, hors-la-loi, taulard à plusieurs reprises, banni, s'éclipsa avec tant de tact qu'on perdit sa trace en 1463. Il avait trente-deux ans, et déjà bâti une oeuvre universelle. Je, François Villon, se fiche de l'amour courtois comme d'une guigne, il trousse, détrousse, profane tout. Entêtant. Pour finir, quelque chose de nettement plus sérieux. L'auteur, ses droits et ses devoirs, par l'avocat écrivain spécialisé dans les affaires éditoriales le plus connu de Paris, Emmanuel Pierrat. 850 pages où il est question de censure, de contrats, de droits d'auteur, de diffamation, d'adaptation, de la misère des poètes, des méandres complexes de la judiciarisation croissante de tous les métiers - y compris ceux (-là) de liberté... Vademecum à feuilleter comme un dictionnaire, l'ouvrage, inédit, fera date (au fil de son actualisation). J'y ai cherché rapidement des choses sur le scandale de l'AGESSA, sécurité sociale des auteurs à laquelle tout écrivain cotise à chaque euro perçu, et qui ne reversera RIEN lorsque les pauvres plumitifs, les cracheurs d'encre et de beauté, lorsque les voleurs de feu désireront prendre leur retraite, mais je n'ai rien trouvé dans "le" Pierrat. Affaire à suivre. Folio. L.M.
Pour finir, quelque chose de nettement plus sérieux. L'auteur, ses droits et ses devoirs, par l'avocat écrivain spécialisé dans les affaires éditoriales le plus connu de Paris, Emmanuel Pierrat. 850 pages où il est question de censure, de contrats, de droits d'auteur, de diffamation, d'adaptation, de la misère des poètes, des méandres complexes de la judiciarisation croissante de tous les métiers - y compris ceux (-là) de liberté... Vademecum à feuilleter comme un dictionnaire, l'ouvrage, inédit, fera date (au fil de son actualisation). J'y ai cherché rapidement des choses sur le scandale de l'AGESSA, sécurité sociale des auteurs à laquelle tout écrivain cotise à chaque euro perçu, et qui ne reversera RIEN lorsque les pauvres plumitifs, les cracheurs d'encre et de beauté, lorsque les voleurs de feu désireront prendre leur retraite, mais je n'ai rien trouvé dans "le" Pierrat. Affaire à suivre. Folio. L.M. Hommage au Père Magloire, célébrissime calvados, pour cette
Hommage au Père Magloire, célébrissime calvados, pour cette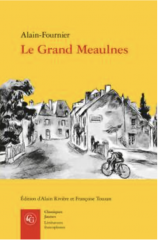 cuvée Fraternité à prix plancher (17,90€ la bouteille de 50 cl.). Il s’agit d’un Hors-d’Âge issu de lots vieillis 12 ans au moins. C’est rond, d’une grande douceur vanillée, avec des notes fruitées et légèrement torréfiées. Cette édition spéciale fêtera les 200 ans de la marque. À déguster au crépuscule, sec, voire frappé, en faisant tourner quelques glaçons dans le verre afin de le refroidir instantanément (puis jetez la glace). Ça fonctionne bien avec Mozart comme avec Bob Marley, ainsi qu'avec quelques pages du Grand Meaulnes. L.M.
cuvée Fraternité à prix plancher (17,90€ la bouteille de 50 cl.). Il s’agit d’un Hors-d’Âge issu de lots vieillis 12 ans au moins. C’est rond, d’une grande douceur vanillée, avec des notes fruitées et légèrement torréfiées. Cette édition spéciale fêtera les 200 ans de la marque. À déguster au crépuscule, sec, voire frappé, en faisant tourner quelques glaçons dans le verre afin de le refroidir instantanément (puis jetez la glace). Ça fonctionne bien avec Mozart comme avec Bob Marley, ainsi qu'avec quelques pages du Grand Meaulnes. L.M.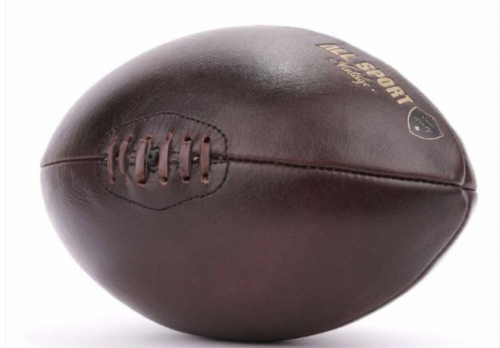
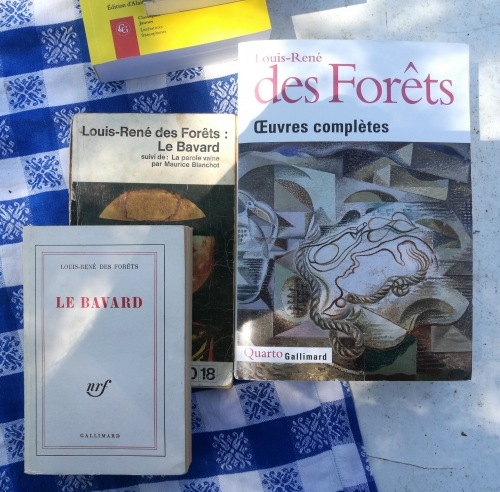

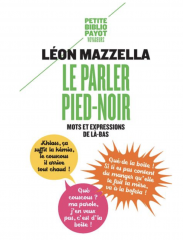
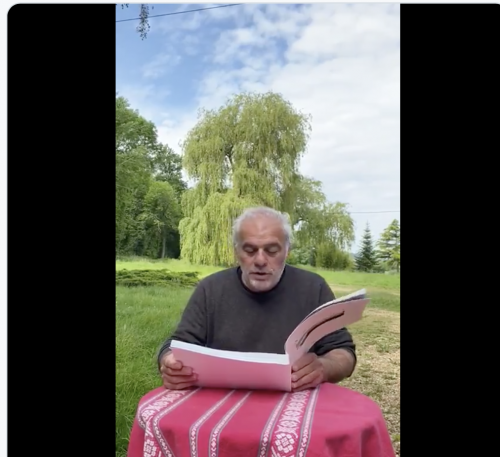


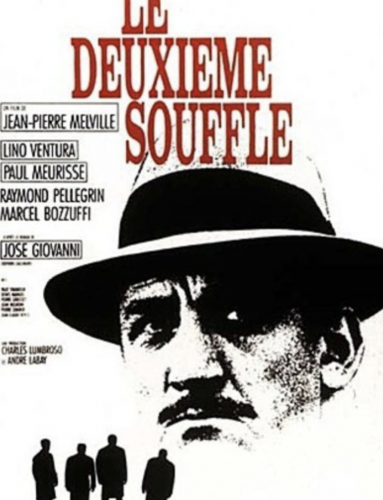
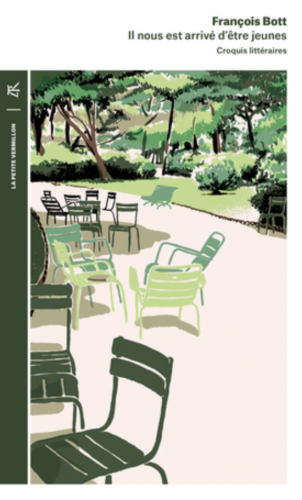
 En ces temps de guerre contre un ennemi invisible, et tandis que le mot confinement est sur toutes nos lèvres masquées, le Printemps des Poètes* a lui aussi réduit sa voilure. Au lieu de renoncer ou de faire l’apprentissage de la résignation, nous sommes encouragés en haut-lieu à lire. Alors pourquoi pas de la poésie, laquelle ne doit pas prendre un ris. La phrase de Christian Bobin placée en titre de cette note est un étendard. Sophie Nauleau, la directrice artistique du Printemps des Poètes, nous avait donné il y a deux ans « La Poésie à l’épreuve de soi », dédié à l’Ardeur, et qui fut commenté ici même. Voici, afin d’épouser le thème du Printemps de cette année, le Courage (après la Beauté, l'an passé), « Espère en ton courage » (les deux chez Actes Sud). Référence directe aux vers de Corneille,
En ces temps de guerre contre un ennemi invisible, et tandis que le mot confinement est sur toutes nos lèvres masquées, le Printemps des Poètes* a lui aussi réduit sa voilure. Au lieu de renoncer ou de faire l’apprentissage de la résignation, nous sommes encouragés en haut-lieu à lire. Alors pourquoi pas de la poésie, laquelle ne doit pas prendre un ris. La phrase de Christian Bobin placée en titre de cette note est un étendard. Sophie Nauleau, la directrice artistique du Printemps des Poètes, nous avait donné il y a deux ans « La Poésie à l’épreuve de soi », dédié à l’Ardeur, et qui fut commenté ici même. Voici, afin d’épouser le thème du Printemps de cette année, le Courage (après la Beauté, l'an passé), « Espère en ton courage » (les deux chez Actes Sud). Référence directe aux vers de Corneille, 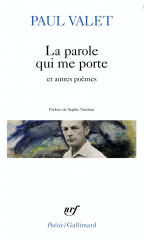
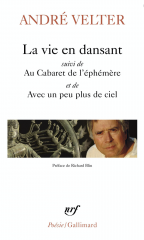 défoncer toute la Nuit », ou encore « Une rigueur sauvage / M'envahit quand j'écris », du même poète dont Cioran évoquait le « lyrisme frénétique ». Résonnent également les mots de Rilke extraits de ses « Lettres à un jeune poète », « Au fond, le seul courage qui nous soit demandé est de faire face à l’étrange, au merveilleux, à l’inexplicable que nous rencontrons ». Marceline Desbordes-Valmore écrivit « Le malheur me rend le courage ». Le mince ouvrage de Nauleau devient une sorte d’anthologie du courage en poésie où l’on trouve à la fois Hugo et André Velter – dont parait le beau recueil « La vie en dansant » (suivi de « Au cabaret de l’éphémère », et de « Avec un peu plus de ciel », Poésie/Gallimard) -, Mahmoud Darwich et Bartabas, Michaux et le délicat Zeno Bianu. Citons le splendide Adonis, pour finir, « Apprendre le courage d'une luciole / qui porte le feu / sur des ailes si petites. » L.M.
défoncer toute la Nuit », ou encore « Une rigueur sauvage / M'envahit quand j'écris », du même poète dont Cioran évoquait le « lyrisme frénétique ». Résonnent également les mots de Rilke extraits de ses « Lettres à un jeune poète », « Au fond, le seul courage qui nous soit demandé est de faire face à l’étrange, au merveilleux, à l’inexplicable que nous rencontrons ». Marceline Desbordes-Valmore écrivit « Le malheur me rend le courage ». Le mince ouvrage de Nauleau devient une sorte d’anthologie du courage en poésie où l’on trouve à la fois Hugo et André Velter – dont parait le beau recueil « La vie en dansant » (suivi de « Au cabaret de l’éphémère », et de « Avec un peu plus de ciel », Poésie/Gallimard) -, Mahmoud Darwich et Bartabas, Michaux et le délicat Zeno Bianu. Citons le splendide Adonis, pour finir, « Apprendre le courage d'une luciole / qui porte le feu / sur des ailes si petites. » L.M.
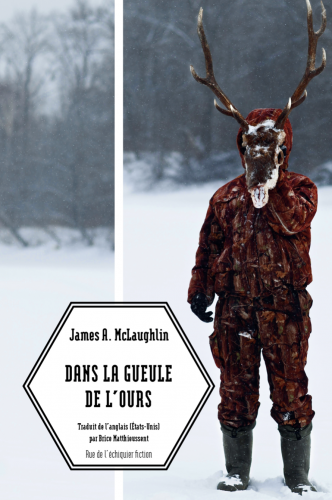 Ça se confirme. Dans la gueule de l'ours, de James A. McLaughlin (Rue de l'échiquier) - déjà évoqué ici, lire plus bas -, est un grand (premier) roman de nature sauvage qui sent bon les veines nouées, fluides, riches de Jim Harrison, Norman McLean, Rick Bass, James Crumley, Thomas Mc Guane... C'est puissant, rugueux, âpre, rude, fort en muscles, en alcool, en mots, en regards, en gestes, en sentiments exacerbés. La langue est somptueuse, qui abonde de descriptions tantôt lyriques tantôt sèches. Rice Moore, ce criminel en cavale devenu garde forestier au fin fond des Appalaches, ne nous quitte pas. Le cartel mexicain de la drogue à ses trousses devient anecdotique, lorsqu'il nous emporte dans son enquête sur ces ours mutilés pour en extraire la vésicule qui vaut de l'or en Chine. La mafia est là, nous la sentons partout. Mais nous ressentons davantage, pour notre bonheur, la nature brute de l'environnement aussi hostile qu'apprivoisable qui chatouille un héros peu ordinaire, au caractère trempé; inoubliable.
Ça se confirme. Dans la gueule de l'ours, de James A. McLaughlin (Rue de l'échiquier) - déjà évoqué ici, lire plus bas -, est un grand (premier) roman de nature sauvage qui sent bon les veines nouées, fluides, riches de Jim Harrison, Norman McLean, Rick Bass, James Crumley, Thomas Mc Guane... C'est puissant, rugueux, âpre, rude, fort en muscles, en alcool, en mots, en regards, en gestes, en sentiments exacerbés. La langue est somptueuse, qui abonde de descriptions tantôt lyriques tantôt sèches. Rice Moore, ce criminel en cavale devenu garde forestier au fin fond des Appalaches, ne nous quitte pas. Le cartel mexicain de la drogue à ses trousses devient anecdotique, lorsqu'il nous emporte dans son enquête sur ces ours mutilés pour en extraire la vésicule qui vaut de l'or en Chine. La mafia est là, nous la sentons partout. Mais nous ressentons davantage, pour notre bonheur, la nature brute de l'environnement aussi hostile qu'apprivoisable qui chatouille un héros peu ordinaire, au caractère trempé; inoubliable.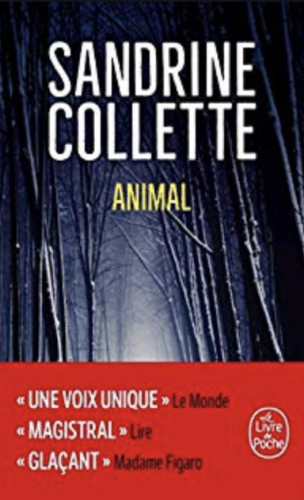 Idem pour Animal, - évoqué lui aussi il y a quelques jours -, de Sandrine Collette (Livre de poche), championne en intrigues sinueuses. Mara se fera prendre (euphémisme) par l'ours au Kamtchatka, puis elle ira à la rencontre du tigre en Asie, plus loin. Et de son enfance. La recherche de ses propres limites, la quête du sauvage en soi, la part d'animalité que nous possédons tous, que d'aucuns refoulent par commodité, mais que d'autres fouillent et s'efforcent d'extraire afin de la regarder en face comme le crâne dans la main d'Hamlet, Collette nous la pose sur la table comme on y dépose un coeur sanguinolent ou un foie frais, brut. Les territoires d'une impossible approche mais d'une certaine rencontre, à travers Lior, cette Diane chasseresse d'un outre-monde, deviennent un lieu inconnu des cartes, seulement repérable par les membres d'une communauté invisible. Celles des chamans de l'impossible. En faites-vous partie?
Idem pour Animal, - évoqué lui aussi il y a quelques jours -, de Sandrine Collette (Livre de poche), championne en intrigues sinueuses. Mara se fera prendre (euphémisme) par l'ours au Kamtchatka, puis elle ira à la rencontre du tigre en Asie, plus loin. Et de son enfance. La recherche de ses propres limites, la quête du sauvage en soi, la part d'animalité que nous possédons tous, que d'aucuns refoulent par commodité, mais que d'autres fouillent et s'efforcent d'extraire afin de la regarder en face comme le crâne dans la main d'Hamlet, Collette nous la pose sur la table comme on y dépose un coeur sanguinolent ou un foie frais, brut. Les territoires d'une impossible approche mais d'une certaine rencontre, à travers Lior, cette Diane chasseresse d'un outre-monde, deviennent un lieu inconnu des cartes, seulement repérable par les membres d'une communauté invisible. Celles des chamans de l'impossible. En faites-vous partie?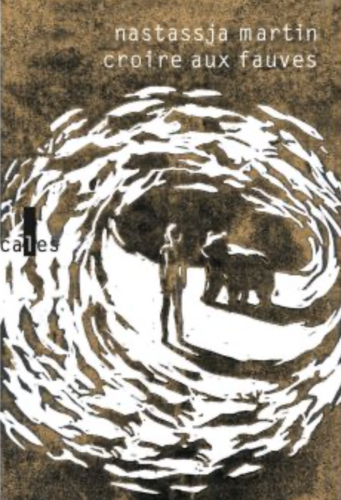 C'est un peu ce que Natassja Martin nous chuchote à voix basse, avec son magnifique récit, Croire aux fauves (Verticales), d'une beauté renversante. Ethnologue, elle faillit disparaître dans la gueule d'un ours, au Kamtchatka, elle aussi. L'animal lui fit grâce, ce qui la lia indéfiniment à lui, non sans la défigurer et lui faire endurer un temps long dans les hopîtaux russes - ce qui vaut de superbes passages sur l'univers médical, loin du confort d'une Pitié-Salpetrière... Natassja devient incarnée, habitée, intriquée, possédée. Autre. Devenue mathuka (ourse), l'auteur se métamorphose à son corps défendant en devenant mieux : miedka, marquée par l'ours. Soit moitié humaine, moitié animale. Le récit devient mystique. La quête de l'auteure mutilée sublime par ses évocations douces d'un corps à corps d'un autre temps et d'un autre monde, d'une dimension immesurable, ce que personne ne peut imaginer dans son tranquille quotidien. Ecrit dans une langue percutante et dépouillée, Croire aux fauves (*) transcende la littérature qui croit au qui-vive, au miroir dans le silence de l'autre, à la territorialité, à la puissance, à la grâce, au baiser qui ne tue pas, à la paternité, au don, à la fluidité complexe des rôles, à la fascination. À l'essence même de la chasse dans ce qu'elle a de plus sublime, philosophique, sage, essentiel.
C'est un peu ce que Natassja Martin nous chuchote à voix basse, avec son magnifique récit, Croire aux fauves (Verticales), d'une beauté renversante. Ethnologue, elle faillit disparaître dans la gueule d'un ours, au Kamtchatka, elle aussi. L'animal lui fit grâce, ce qui la lia indéfiniment à lui, non sans la défigurer et lui faire endurer un temps long dans les hopîtaux russes - ce qui vaut de superbes passages sur l'univers médical, loin du confort d'une Pitié-Salpetrière... Natassja devient incarnée, habitée, intriquée, possédée. Autre. Devenue mathuka (ourse), l'auteur se métamorphose à son corps défendant en devenant mieux : miedka, marquée par l'ours. Soit moitié humaine, moitié animale. Le récit devient mystique. La quête de l'auteure mutilée sublime par ses évocations douces d'un corps à corps d'un autre temps et d'un autre monde, d'une dimension immesurable, ce que personne ne peut imaginer dans son tranquille quotidien. Ecrit dans une langue percutante et dépouillée, Croire aux fauves (*) transcende la littérature qui croit au qui-vive, au miroir dans le silence de l'autre, à la territorialité, à la puissance, à la grâce, au baiser qui ne tue pas, à la paternité, au don, à la fluidité complexe des rôles, à la fascination. À l'essence même de la chasse dans ce qu'elle a de plus sublime, philosophique, sage, essentiel.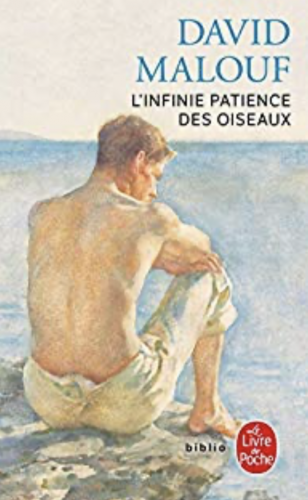 David Malouf, avec L'infinie patience des oiseaux (Livre de Poche), offre un roman d'une fluidité envoûtante. Deux hommes se retrouvent sur le terrain de l'ornithologie, leur passion. Ils ambitionnent de créer un sanctuaire dédié aux oiseaux en Australie, où cela se déroule. Jim et Ashley sont complices d'une certaine approche de la Nature. Les descriptions des marais qu'ils arpentent et étudient sont splendides. Un personnage féminin (comme dans tout roman aux clés basiques) interfère, et Imogen, photographe, surgit. L'amour aussi, entre Jim et elle. Mais la Grande Guerre explose. Les garçons s'engagent et se retrouvent sur le Front, du côté d'Ypres, de sinistre mémoire. L'horreur est méticuleusement décrite, sans filtre, et l'insoutenable devient tolérable à la lecture, grâce aux oiseaux migrateurs - alouettes, notamment -, à un torcol aussi, décrits avec amour par deux jeunes soldats - égarés fondamentaux comme le furent tous les soldats australiens, anglais, français, allemands... -, et trouvant la force de s'émouvoir de l'insouciance des volatiles que le vacarme des obus ne semblait pas déranger outre mesure. Magnifique. Quatre bijoux. L.M.
David Malouf, avec L'infinie patience des oiseaux (Livre de Poche), offre un roman d'une fluidité envoûtante. Deux hommes se retrouvent sur le terrain de l'ornithologie, leur passion. Ils ambitionnent de créer un sanctuaire dédié aux oiseaux en Australie, où cela se déroule. Jim et Ashley sont complices d'une certaine approche de la Nature. Les descriptions des marais qu'ils arpentent et étudient sont splendides. Un personnage féminin (comme dans tout roman aux clés basiques) interfère, et Imogen, photographe, surgit. L'amour aussi, entre Jim et elle. Mais la Grande Guerre explose. Les garçons s'engagent et se retrouvent sur le Front, du côté d'Ypres, de sinistre mémoire. L'horreur est méticuleusement décrite, sans filtre, et l'insoutenable devient tolérable à la lecture, grâce aux oiseaux migrateurs - alouettes, notamment -, à un torcol aussi, décrits avec amour par deux jeunes soldats - égarés fondamentaux comme le furent tous les soldats australiens, anglais, français, allemands... -, et trouvant la force de s'émouvoir de l'insouciance des volatiles que le vacarme des obus ne semblait pas déranger outre mesure. Magnifique. Quatre bijoux. L.M.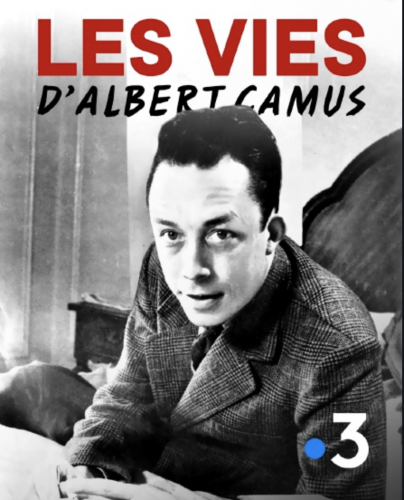
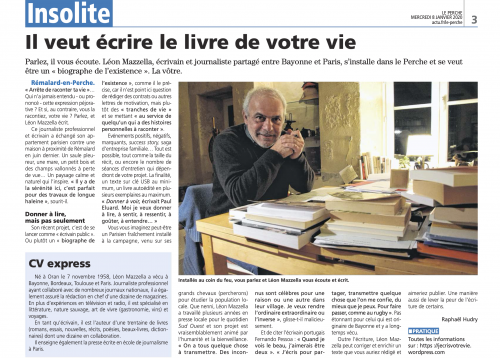

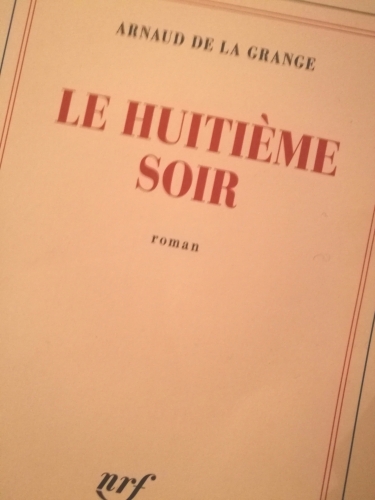
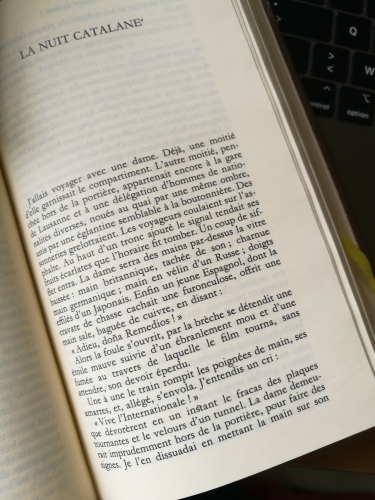
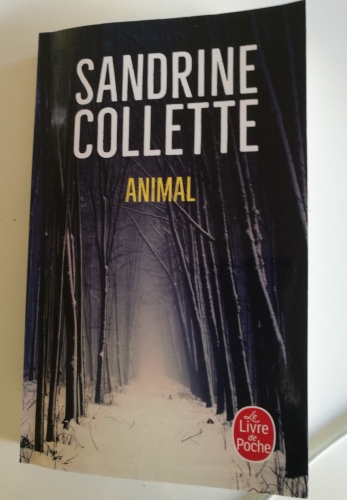
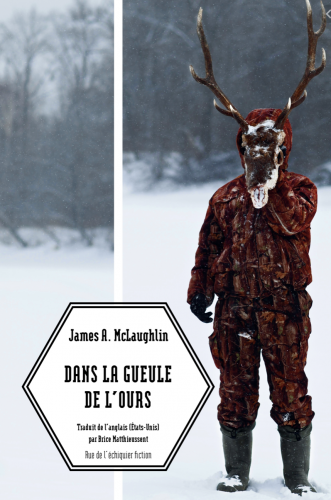
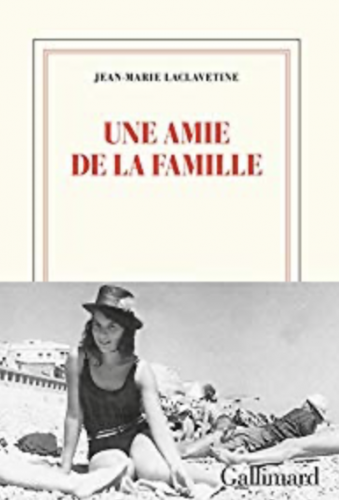
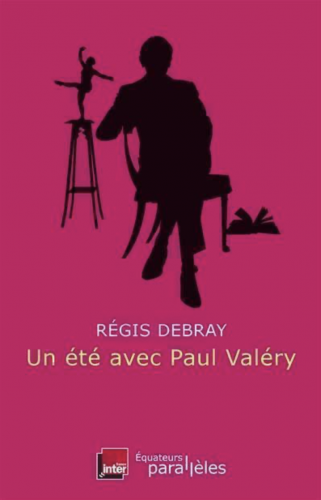
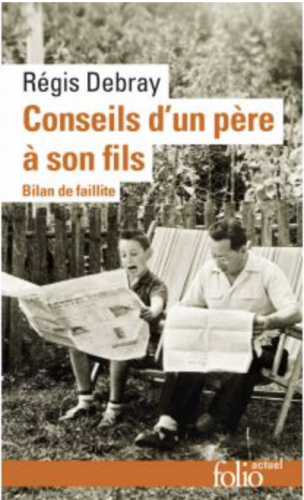
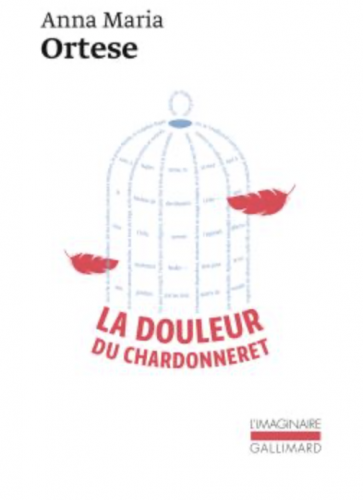

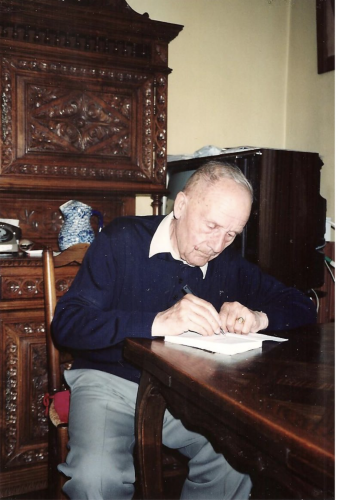
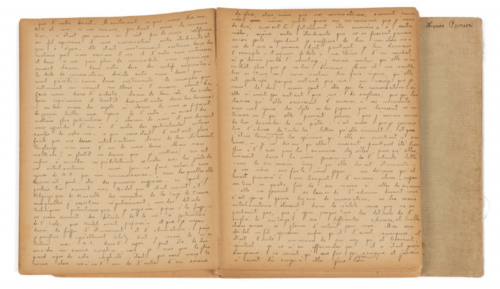

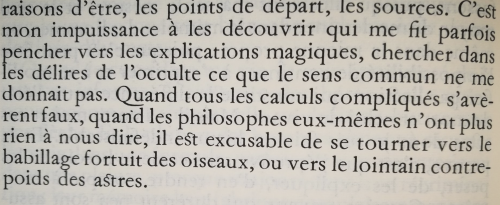
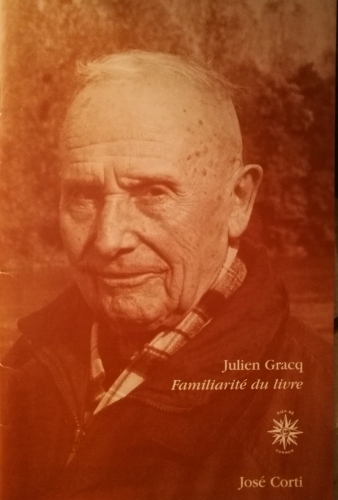
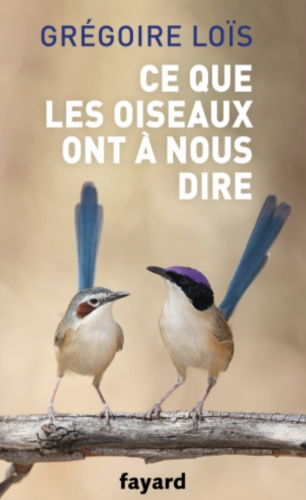
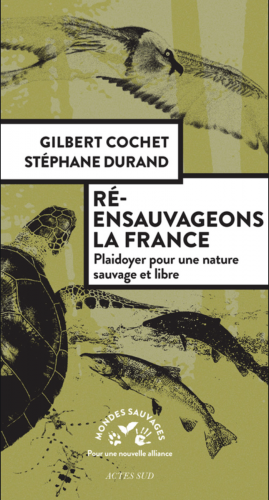 Ré-ensauvageons la France est un beau cri prononcé par Gilbert Cochet et Stéphane Durand (Actes Sud, dans la remarquable collection Mondes Sauvages). Ce plaidoyer pour une nature sauvage et libre (c'est le sous-titre), est un cri d'alarme assorti d'une batterie de propositions encourageantes, optimistes. Les constats sont durs, au chapitre de la litanie des disparitions, des dangers en tout genre, et du spectre de l'annihilation biologique qui menacerait évidemment l'espèce humaine à la suite des espèces animales. La Nature résiste pourtant avec une belle énergie. La forêt prospère, le grand gibier aussi (peut-être trop, selon les agriculteurs et les sylviculteurs), les grands prédateurs (ours, loup, lynx) reviennent, accompagnés parfois par des programmes naturalistes controversés. Il y a toute la place dans notre bel hexagone pour accueillir une biodiversité large, renaissante, plus nombreuse, plus variée, et en pleine forme. Ce livre de deux spécialistes (Cochet est agrégé de Sciences de la vie et de la terre, et il est attaché au Muséum national d'histoire naturelle. Durand est biologiste et ornithologue), parie sur une nouvelle alliance basée sur le triptyque abondance/diversité/proximité. Preuves à l'appui en 176 pages toniques et bourrées d'informations fraîches et précises.
Ré-ensauvageons la France est un beau cri prononcé par Gilbert Cochet et Stéphane Durand (Actes Sud, dans la remarquable collection Mondes Sauvages). Ce plaidoyer pour une nature sauvage et libre (c'est le sous-titre), est un cri d'alarme assorti d'une batterie de propositions encourageantes, optimistes. Les constats sont durs, au chapitre de la litanie des disparitions, des dangers en tout genre, et du spectre de l'annihilation biologique qui menacerait évidemment l'espèce humaine à la suite des espèces animales. La Nature résiste pourtant avec une belle énergie. La forêt prospère, le grand gibier aussi (peut-être trop, selon les agriculteurs et les sylviculteurs), les grands prédateurs (ours, loup, lynx) reviennent, accompagnés parfois par des programmes naturalistes controversés. Il y a toute la place dans notre bel hexagone pour accueillir une biodiversité large, renaissante, plus nombreuse, plus variée, et en pleine forme. Ce livre de deux spécialistes (Cochet est agrégé de Sciences de la vie et de la terre, et il est attaché au Muséum national d'histoire naturelle. Durand est biologiste et ornithologue), parie sur une nouvelle alliance basée sur le triptyque abondance/diversité/proximité. Preuves à l'appui en 176 pages toniques et bourrées d'informations fraîches et précises.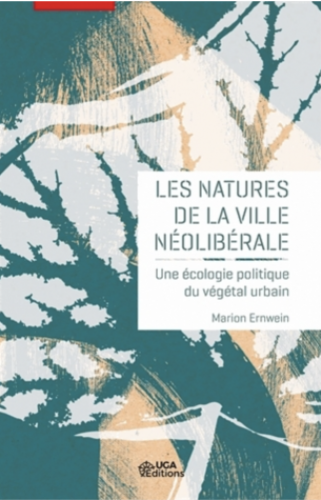 Sur un autre registre, Marion Ernwein donne Les natures de la ville néolibérale. Sous-titré : Une écologie politique du végétal urbain (UGA éditions : Université Grenoble Alpes, collection Ecotopiques). Fruit d'une enquête de terrain menée à Genève notamment sur plusieurs années, cet ouvrage d'une richesse et d'une culture immenses, emprunte autant à la philosophie qu'à l'architecture, à la sociologie et bien sûr aux sciences naturelles, et intéressera au premier chef les paysagistes et tous ceux qui ont souci des politiques d'aménagement d'espaces verts urbains, non plus comme des natures mortes, mais de plus en plus vivants, participatifs, dynamiques, inscrits dans un bien-être collectif durable, écosystémique, et néanmoins hyper urbain. L'auteur enseigne la géographie à Oxford, et développe ici, avec brio, une nouvelle écologie politique du végétal urbain donc, à la lumière des nouveaux enjeux environnementaux. Magistral. L.M.
Sur un autre registre, Marion Ernwein donne Les natures de la ville néolibérale. Sous-titré : Une écologie politique du végétal urbain (UGA éditions : Université Grenoble Alpes, collection Ecotopiques). Fruit d'une enquête de terrain menée à Genève notamment sur plusieurs années, cet ouvrage d'une richesse et d'une culture immenses, emprunte autant à la philosophie qu'à l'architecture, à la sociologie et bien sûr aux sciences naturelles, et intéressera au premier chef les paysagistes et tous ceux qui ont souci des politiques d'aménagement d'espaces verts urbains, non plus comme des natures mortes, mais de plus en plus vivants, participatifs, dynamiques, inscrits dans un bien-être collectif durable, écosystémique, et néanmoins hyper urbain. L'auteur enseigne la géographie à Oxford, et développe ici, avec brio, une nouvelle écologie politique du végétal urbain donc, à la lumière des nouveaux enjeux environnementaux. Magistral. L.M.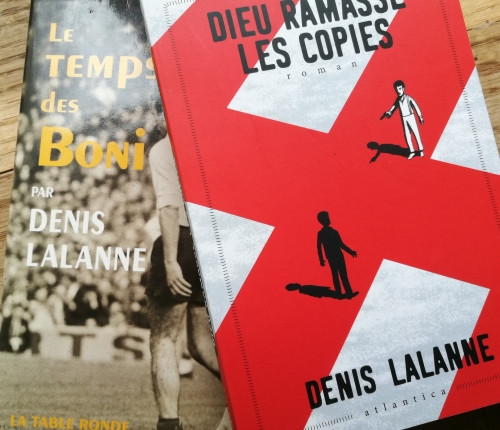
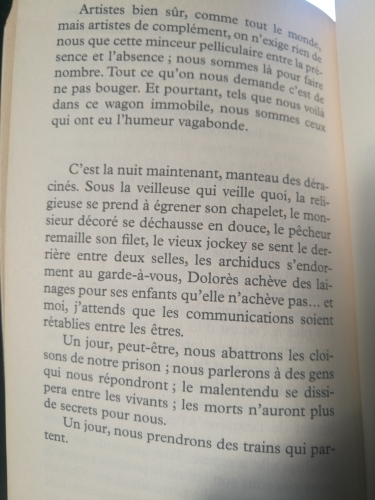
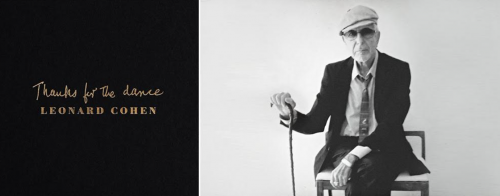
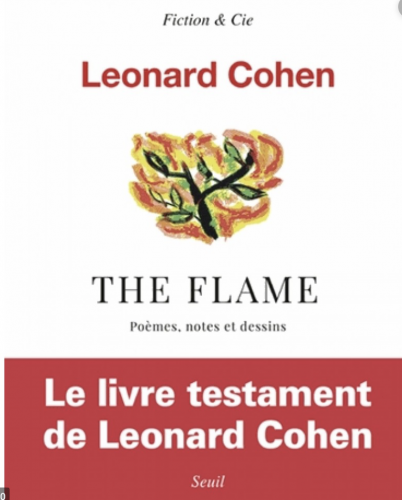 P.S. : je ne saurais trop recommander un magnifique album de ses poèmes, dessins, chansons, que je feuillette au gré, avec beaucoup d'émotion et toujours sa musique en fond de lecture - comme on parle de fond de sauce... L.M.
P.S. : je ne saurais trop recommander un magnifique album de ses poèmes, dessins, chansons, que je feuillette au gré, avec beaucoup d'émotion et toujours sa musique en fond de lecture - comme on parle de fond de sauce... L.M.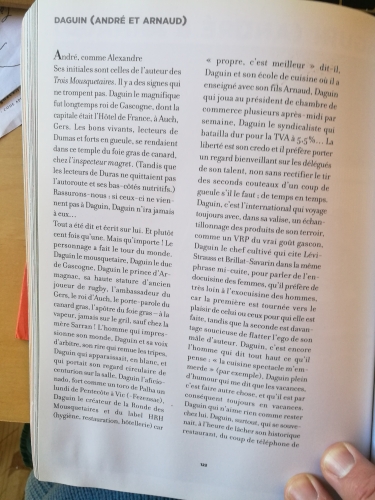
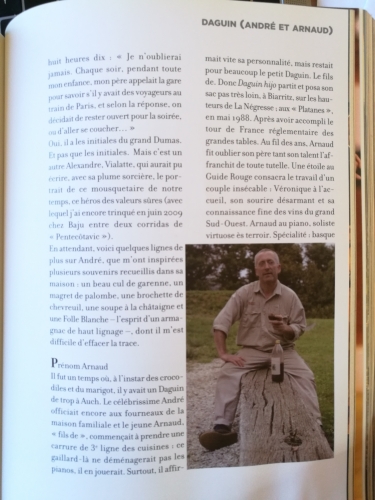
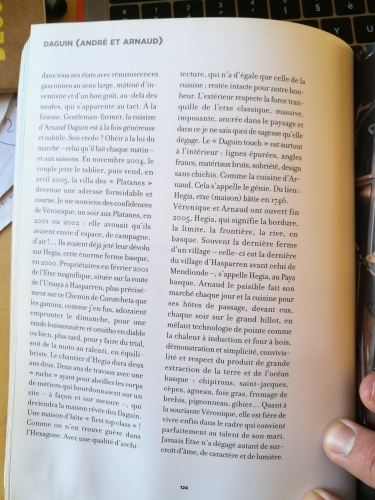

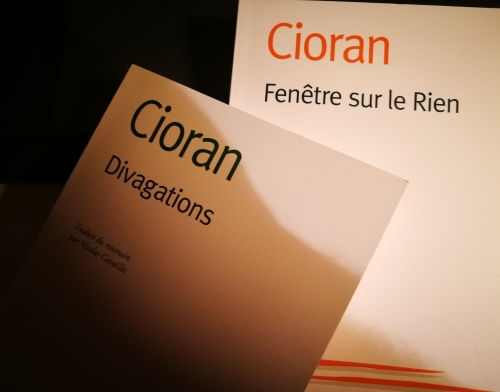
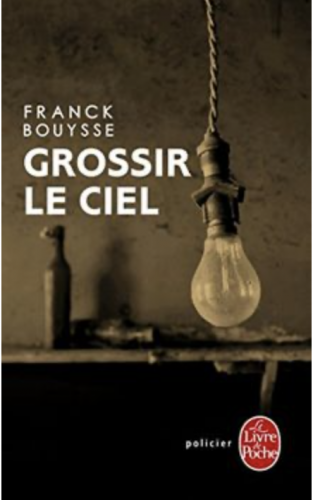 La force de Franck Bouysse est comparable à celle du Jean Carrière de L'épervier de Maheux. Avec Grossir le ciel (Le Livre de Poche), l'auteur, très remarqué cette année avec un nouveau roman qu'il nous faudra lire bientôt (Né d'aucune femme), livre un roman âpre, avec de rares personnages sauvages et durs, qui vivent reclus au fin fond des Cévennes, marqués par des secrets de famille bien ou mal gardés, et qui s'occupent de vaches, de champs, du tracteur, du fusil pour chasser des grives, du chien appelé Mars pour unique réconfort. Ils s'appellent Gus, Abel, et ils ont la poésie des gosses qui voient dans un merle faisant la roue un grand tétras amoureux. Gus a la certitude absolue d'être un fruit pourri conçu dans la violence et la haine, toujours accroché sur l'arbre d'une généalogie sans nom. Il y a des meurtres, du sordide, des mystères, des traces de pas qui inquiètent, des êtres furtifs, la nuit, les petites annonces du Chasseur français que l'on feuillette sur la toile cirée devant l'âtre, en se disant je devrais peut-être essayer. La vie dure de ces solitaires par défaut ou par destinée est leur quotidien comme s'il neigeait chaque jour de l'année, et Bouysse a le talent de savoir décrire dans une langue forte, des arbres déplumés comme des arêtes de gros poissons décharnés, le sang qui frappe régulièrement contre les tempes, le vent qui s'engouffre sous les bardeaux d'une grange en glissant sur le silence comme une araignée d'eau sur une mare étale. Oui, le Jean Carrière que nous aimons, fils
La force de Franck Bouysse est comparable à celle du Jean Carrière de L'épervier de Maheux. Avec Grossir le ciel (Le Livre de Poche), l'auteur, très remarqué cette année avec un nouveau roman qu'il nous faudra lire bientôt (Né d'aucune femme), livre un roman âpre, avec de rares personnages sauvages et durs, qui vivent reclus au fin fond des Cévennes, marqués par des secrets de famille bien ou mal gardés, et qui s'occupent de vaches, de champs, du tracteur, du fusil pour chasser des grives, du chien appelé Mars pour unique réconfort. Ils s'appellent Gus, Abel, et ils ont la poésie des gosses qui voient dans un merle faisant la roue un grand tétras amoureux. Gus a la certitude absolue d'être un fruit pourri conçu dans la violence et la haine, toujours accroché sur l'arbre d'une généalogie sans nom. Il y a des meurtres, du sordide, des mystères, des traces de pas qui inquiètent, des êtres furtifs, la nuit, les petites annonces du Chasseur français que l'on feuillette sur la toile cirée devant l'âtre, en se disant je devrais peut-être essayer. La vie dure de ces solitaires par défaut ou par destinée est leur quotidien comme s'il neigeait chaque jour de l'année, et Bouysse a le talent de savoir décrire dans une langue forte, des arbres déplumés comme des arêtes de gros poissons décharnés, le sang qui frappe régulièrement contre les tempes, le vent qui s'engouffre sous les bardeaux d'une grange en glissant sur le silence comme une araignée d'eau sur une mare étale. Oui, le Jean Carrière que nous aimons, fils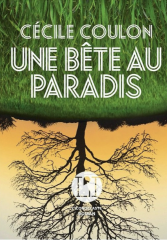 spirituel de Giono, se retrouve dans Bouysse. Pas dans sa pâle copie, à la lecture fort décevante de Une bête au paradis, de Cécile Coulon (L'Iconoclaste), dont on a fait grand cas au début de l'automne, et puis flop... Avec même de drôles de coïncidences : le nom d'Abel pour désigner un personnage principal, chez Coulon, mais authentique chez Bouysse, et Paradis - nom de personnage chez Bouysse, de lieu chez Coulon. Étrange... (Le livre de Bouysse est paru en 2014, et celui de Coulon à la fin de l'été 2019). Mais, passons.
spirituel de Giono, se retrouve dans Bouysse. Pas dans sa pâle copie, à la lecture fort décevante de Une bête au paradis, de Cécile Coulon (L'Iconoclaste), dont on a fait grand cas au début de l'automne, et puis flop... Avec même de drôles de coïncidences : le nom d'Abel pour désigner un personnage principal, chez Coulon, mais authentique chez Bouysse, et Paradis - nom de personnage chez Bouysse, de lieu chez Coulon. Étrange... (Le livre de Bouysse est paru en 2014, et celui de Coulon à la fin de l'été 2019). Mais, passons.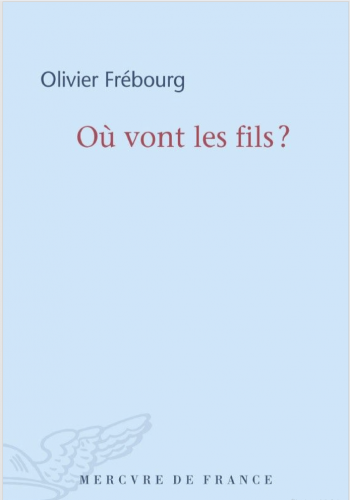 Bien sûr, nous aimons La panthère des neiges, de Sylvain Tesson (Gallimard), car nous lisons avec plaisir et fidélité cet auteur, et le succès mérité de son dernier récit n'avait pas besoin d'un Renaudot surprise, mais c'est tant mieux.
Bien sûr, nous aimons La panthère des neiges, de Sylvain Tesson (Gallimard), car nous lisons avec plaisir et fidélité cet auteur, et le succès mérité de son dernier récit n'avait pas besoin d'un Renaudot surprise, mais c'est tant mieux. 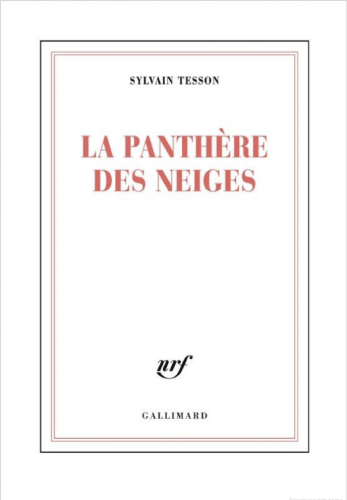 La découverte par Sylvain Tesson le globe-trotter, de la magie, des mystères de l'affût et des énormes plaisirs qu'il peut procurer, y compris celui de la bredouille, car elle est alors toujours chargée d'émotions intenses, donne un récit captivant. Guetter la rarissime et menacée panthère des neiges au Tibet, à 5 000 mètres d'altitude et par -30°C, hisse l'animal majestueux, princier, au rang de mythe, de Saint Graal, d'improbable inaccessible, de reine des confins. Se savoir vu sans voir qui nous a repéré depuis longtemps, le "ce qui est là et que l'on ne voit pas", figure un autre plaisir profond de chasseur photographe comme Vincent Munier, que Sylvain Tesson accompagne, ou de chasseur tout court (et nous en connaissons un rayon). Pour ces choses si précieuses de nos jours tant encombrés de futilité et de fatuité, pour la belle langue de l'auteur, pour ses références poétiques aussi, cette panthère-là devient inoubliable.
La découverte par Sylvain Tesson le globe-trotter, de la magie, des mystères de l'affût et des énormes plaisirs qu'il peut procurer, y compris celui de la bredouille, car elle est alors toujours chargée d'émotions intenses, donne un récit captivant. Guetter la rarissime et menacée panthère des neiges au Tibet, à 5 000 mètres d'altitude et par -30°C, hisse l'animal majestueux, princier, au rang de mythe, de Saint Graal, d'improbable inaccessible, de reine des confins. Se savoir vu sans voir qui nous a repéré depuis longtemps, le "ce qui est là et que l'on ne voit pas", figure un autre plaisir profond de chasseur photographe comme Vincent Munier, que Sylvain Tesson accompagne, ou de chasseur tout court (et nous en connaissons un rayon). Pour ces choses si précieuses de nos jours tant encombrés de futilité et de fatuité, pour la belle langue de l'auteur, pour ses références poétiques aussi, cette panthère-là devient inoubliable.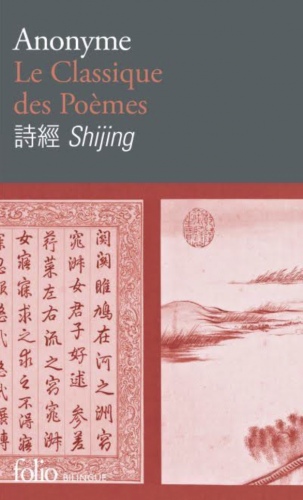 Le Classique des Poèmes, Shijing (folio bilingue), est un épatant recueil de poésie chinois anonyme (et c'est encore plus beau lorsque c'est anonyme, aurait déclaré Cyrano). Les Classiques désignent dans ce vaste pays continent les indispensables de la littérature que tout lettré se doit de connaître. Ils sont au nombre de cinq : Yijing (Le Classique des Changements), Shujing (Le Classique des Documents), Lijing (Le Classique des Rites), Yuejing (Le Classique des Musiques), et Shijing, qui est le plus ancien recueil de poésie chinoise, puisqu'il date de l'Antiquité. Confucius aurait paraît-il compilé ces chants amoureux d'origine populaire, de facture simple comme une chanson d'Agnès Obel, qu'ils décrivent une barque de cyprès qui ballotte au gré du courant et devient par métaphore un coeur accablé, Une belle femme décrite à la manière des contes des Mille et une nuits, Le vent d'aurore (où) pique un faucon/sur la forêt touffue du nord. Ou encore les ailes de l'éphémère, cet insecte d'une infinie délicatesse comme l'est chacun de ces poèmes. L.M.
Le Classique des Poèmes, Shijing (folio bilingue), est un épatant recueil de poésie chinois anonyme (et c'est encore plus beau lorsque c'est anonyme, aurait déclaré Cyrano). Les Classiques désignent dans ce vaste pays continent les indispensables de la littérature que tout lettré se doit de connaître. Ils sont au nombre de cinq : Yijing (Le Classique des Changements), Shujing (Le Classique des Documents), Lijing (Le Classique des Rites), Yuejing (Le Classique des Musiques), et Shijing, qui est le plus ancien recueil de poésie chinoise, puisqu'il date de l'Antiquité. Confucius aurait paraît-il compilé ces chants amoureux d'origine populaire, de facture simple comme une chanson d'Agnès Obel, qu'ils décrivent une barque de cyprès qui ballotte au gré du courant et devient par métaphore un coeur accablé, Une belle femme décrite à la manière des contes des Mille et une nuits, Le vent d'aurore (où) pique un faucon/sur la forêt touffue du nord. Ou encore les ailes de l'éphémère, cet insecte d'une infinie délicatesse comme l'est chacun de ces poèmes. L.M.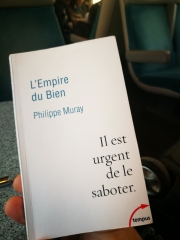 Philippe Muray, son classique L'Empire du Bien, et Cigarettes after sex en concert vont bien ensemble =>
Philippe Muray, son classique L'Empire du Bien, et Cigarettes after sex en concert vont bien ensemble => 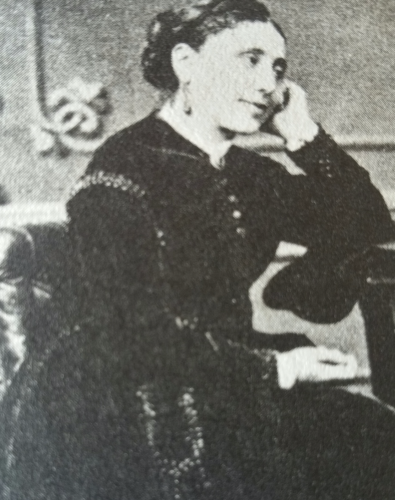
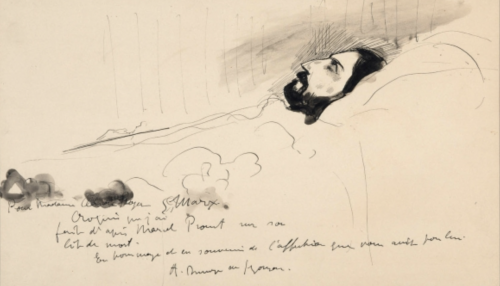
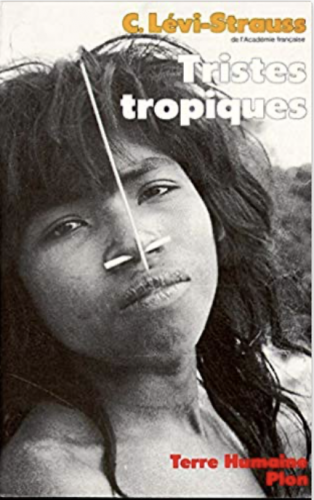 Je relisais
Je relisais 


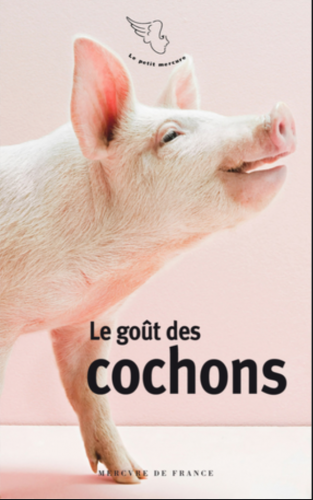 Blandine Vié est une sacrée auteure gourmande, passionnée de cochon au point de lui consacrer un ouvrage il y a peu et des articles à la ribambelle sur le site Greta Garbure qu’elle co-anime avec son complice Patrick de Mari. D’ailleurs, l’un de ses « posts » mis en ligne a été retenu dans une mini-anthologie de la fameuse collection « le goût de » au Mercure de France. Dans « Le goût des cochons » (8,20€) figure, aux côtés de classiques comme Renard (avec un extrait célèbre des « Histoires Naturelles »), Claudel (et un délicieux poème en prose décrivant la bête), Maupassant (avec un texte de jeunesse), Huysmans (un extrait de « En route »), Hugo (et un émouvant poème, « Le porc et le sultan »), Verlaine (avec un détonnant pastiche des « Amants » de Baudelaire, intitulé « La Mort des cochons », pornographique à souhait, tiré de « L’Album zutique » qu’il coécrivit avec Léon Valade) et, plus près de nous, Jérôme Ferrari (et un extrait brut de son « Sermon sur la chute de Rome », décrivant un paysan Corse occupé à châtrer les verrats), ou Philippe Sollers (en amoureux délicat de la chair du cochon, dont il fait l’éloge)... Figure donc un texte délicieux de Blandine Vié au sujet de l’étymologie des mots du cochon, de la truie et de ses attributs, intitulé « Une vulve de truie peut en cacher une autre ! » À l’arrière-train où vont les choses, et sans évoquer la peste porcine africaine qui fait des ravages en Chine, donc le bonheur des éleveurs bretons, et qui est provisoirement circonscrite dans les Ardennes belges, mieux vaut en rire en s’instruisant - grâce à ce texte bref et dense, érudit et drôle à la fois. Blandine y enchaîne comme dans un rébus le sens caché des mots, dont les évocations rebondissent et jouent à ... saute-cochon. Remarque : ce
Blandine Vié est une sacrée auteure gourmande, passionnée de cochon au point de lui consacrer un ouvrage il y a peu et des articles à la ribambelle sur le site Greta Garbure qu’elle co-anime avec son complice Patrick de Mari. D’ailleurs, l’un de ses « posts » mis en ligne a été retenu dans une mini-anthologie de la fameuse collection « le goût de » au Mercure de France. Dans « Le goût des cochons » (8,20€) figure, aux côtés de classiques comme Renard (avec un extrait célèbre des « Histoires Naturelles »), Claudel (et un délicieux poème en prose décrivant la bête), Maupassant (avec un texte de jeunesse), Huysmans (un extrait de « En route »), Hugo (et un émouvant poème, « Le porc et le sultan »), Verlaine (avec un détonnant pastiche des « Amants » de Baudelaire, intitulé « La Mort des cochons », pornographique à souhait, tiré de « L’Album zutique » qu’il coécrivit avec Léon Valade) et, plus près de nous, Jérôme Ferrari (et un extrait brut de son « Sermon sur la chute de Rome », décrivant un paysan Corse occupé à châtrer les verrats), ou Philippe Sollers (en amoureux délicat de la chair du cochon, dont il fait l’éloge)... Figure donc un texte délicieux de Blandine Vié au sujet de l’étymologie des mots du cochon, de la truie et de ses attributs, intitulé « Une vulve de truie peut en cacher une autre ! » À l’arrière-train où vont les choses, et sans évoquer la peste porcine africaine qui fait des ravages en Chine, donc le bonheur des éleveurs bretons, et qui est provisoirement circonscrite dans les Ardennes belges, mieux vaut en rire en s’instruisant - grâce à ce texte bref et dense, érudit et drôle à la fois. Blandine y enchaîne comme dans un rébus le sens caché des mots, dont les évocations rebondissent et jouent à ... saute-cochon. Remarque : ce florilège fait la part belle au côté immonde du cochon davantage qu’à ses qualités. C’est toujours comme ça ! La relation de l’homme avec cette « bête singulière » (titre d’un ouvrage capital, de référence, sur le sujet et dont un extrait aurait pu figurer dans ce petit bouquin : « La Bête singulière. Les juifs, les chrétiens et le cochon », de Claudine Fabre-Vassas (Gallimard, Bibliothèque des Sciences humaines), est ambiguë depuis les origines. Nous lui ressemblons tant ! Je laisse le dernier mot à Churchill : « Donnez-moi un cochon ! Il vous regarde dans les yeux et vous considère comme son égal. » L.M.
florilège fait la part belle au côté immonde du cochon davantage qu’à ses qualités. C’est toujours comme ça ! La relation de l’homme avec cette « bête singulière » (titre d’un ouvrage capital, de référence, sur le sujet et dont un extrait aurait pu figurer dans ce petit bouquin : « La Bête singulière. Les juifs, les chrétiens et le cochon », de Claudine Fabre-Vassas (Gallimard, Bibliothèque des Sciences humaines), est ambiguë depuis les origines. Nous lui ressemblons tant ! Je laisse le dernier mot à Churchill : « Donnez-moi un cochon ! Il vous regarde dans les yeux et vous considère comme son égal. » L.M.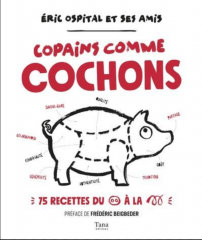
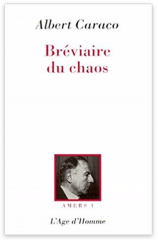 Trop méconnu, cet homme (1919-1971), ce philosophe à la pensée noire et sans ambages, ce pessimiste glacial qui considérait que « les ombres de la mort sont les épices de l'amour », ayant eu le dégoût absolu de la vie, des religions, du sexe, de lui-même (pas gai, vous dis-je, le mec), et à côté duquel Kraus et Lichtenberg sont des amuseurs, Schopenhauer un professionnel donc trop loin du sujet, Cioran un styliste, Guardini un faiseur, Judrin un cousin éloigné, et Stifter et Pavese des frères ès suicide métaphysique (en plus d'être oedipien, avec Madame Mère, chez Caraco). Je ne vous dis rien sur sa vie, tout ça. Fouillez. Juste quelques phrases qui vous donneront le ton, et l'envie - ou pas - d'entrer dans cette oeuvre singulière entre toutes. L.M. :
Trop méconnu, cet homme (1919-1971), ce philosophe à la pensée noire et sans ambages, ce pessimiste glacial qui considérait que « les ombres de la mort sont les épices de l'amour », ayant eu le dégoût absolu de la vie, des religions, du sexe, de lui-même (pas gai, vous dis-je, le mec), et à côté duquel Kraus et Lichtenberg sont des amuseurs, Schopenhauer un professionnel donc trop loin du sujet, Cioran un styliste, Guardini un faiseur, Judrin un cousin éloigné, et Stifter et Pavese des frères ès suicide métaphysique (en plus d'être oedipien, avec Madame Mère, chez Caraco). Je ne vous dis rien sur sa vie, tout ça. Fouillez. Juste quelques phrases qui vous donneront le ton, et l'envie - ou pas - d'entrer dans cette oeuvre singulière entre toutes. L.M. :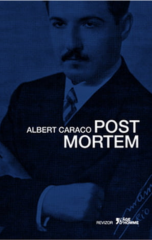 manquerons-nous d’air et nous nous exterminerons pour subsister, nous finirons par nous manger les uns les autres et nos spirituels nous accompagneront dans cette barbarie, nous fûmes théophages et nous serons anthropophages, ce ne sera qu’un accomplissement de plus. Alors on verra, mais à découvert, ce que nos religions renfermaient de barbarie, ce sera l’incarnation de nos impératifs catégoriques et la présence devenue réelle de nos dogmes, la révélation de nos mystères effroyables et l’application de nos légendes plus inhumaines sept fois que nos lois pénales. »
manquerons-nous d’air et nous nous exterminerons pour subsister, nous finirons par nous manger les uns les autres et nos spirituels nous accompagneront dans cette barbarie, nous fûmes théophages et nous serons anthropophages, ce ne sera qu’un accomplissement de plus. Alors on verra, mais à découvert, ce que nos religions renfermaient de barbarie, ce sera l’incarnation de nos impératifs catégoriques et la présence devenue réelle de nos dogmes, la révélation de nos mystères effroyables et l’application de nos légendes plus inhumaines sept fois que nos lois pénales. »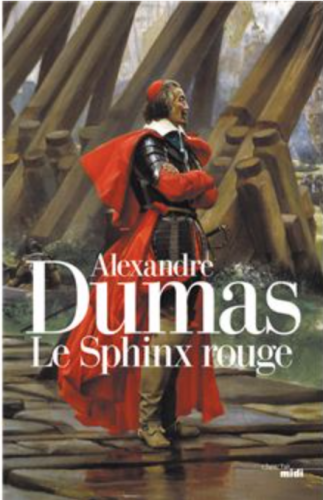 La formule est relativement simple pour qui souhaite agrémenter un dimanche après-midi d’août avec des lectures qui emportent plus sûrement qu’une bourrasque. Prenez quelques contes et nouvelles de Maupassant pour vous faire l’esprit comme on se fait la bouche ou les jambes : Amour, Les Bécasses, Les Tombales,
La formule est relativement simple pour qui souhaite agrémenter un dimanche après-midi d’août avec des lectures qui emportent plus sûrement qu’une bourrasque. Prenez quelques contes et nouvelles de Maupassant pour vous faire l’esprit comme on se fait la bouche ou les jambes : Amour, Les Bécasses, Les Tombales,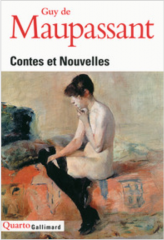 Miss Harriet, cela suffit, puis emparez-vous du Sphynx rouge, la suite des Trois Mousquetaires, d’Alexandre Dumas (initialement connu sous le titre du Comte de Moret). L’histoire survient juste après le siège de La Rochelle, soit bien avant Vingt ans après. Il n’y a plus de Mousquetaires, mais un portrait vibrant du duc de Richelieu tient lieu ici de colonne vertébrale, et sur plus de sept cents pages. C’en est fait. Voici le retour tonitruant, au grand galop, de votre âme d’enfant ayant tant aimé lire tard sous les draps les romans d’aventure, de cape et d’épée, Jules Verne, Rudyard Kipling, Fennimore Cooper... Vous vous calez, bien allongé sur le canapé, les pieds sur l’accoudoir d’en face, un coussin supplémentaire sous la nuque. L’immense talent de Dumas est là, dès la troisième page, qui décrit un certain Étienne Latil, attablé dans une auberge à l’enseigne de La Barbe peinte, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie dans le quartier du Marais, à Paris. Il vous prend par le col et n’entend pas vous lâcher de sitôt. Il fera sans doute nuit lorsque vous lèverez une première fois les yeux du livre pourtant lourd à vos bras tendus, ou posé en angle sur votre ventre : « Sa rapière, dont la poignée était à la portée de sa main, s’allongeait de sa hanche sur sa cuisse et glissait comme une couleuvre entre ses deux jambes croisées l’une sur l’autre. C’était un homme de trente-six à trente-huit ans, dont on pouvait d’autant mieux voir le visage, au dernier rayon de lumière qui filtrait par les étroits vitraux losangés de plomb donnant sur la rue, qu’il avait suspendu son feutre à l’espagnolette de la fenêtre. (...) Son nez droit et son menton en saillie indiquaient la volonté poussée jusqu’à l’entêtement, tandis que la courbe inférieure de sa mâchoire, accentuée à la manière de celle des animaux féroces, indiquait ce courage irréfléchi dont il ne faut pas savoir gré à celui qui le possède, puisqu’il n’est point chez lui le résultat du libre arbitre, mais le simple produit d’instincts carnassiers ; enfin, tout le visage, assez beau, offrait le caractère d’une franchise brutale, qui pouvait faire craindre, de la part du porteur de cette physionomie, des accès de colère et de violence, mais qui ne laissait pas même soupçonner des actes de duplicité, de ruse ou de trahison. » Élégance et désinvolture. Fougue et franchise. Force et panache. Le pouvoir de Dumas est inaltérable. Cela fonctionne, s'enchaîne comme la saison 3 de La Casa de Papel : que vous le vouliez ou non, vous êtes embarqués dans le torrent d'une calle Estafeta du ciné, de la littérature, du bonheur de se laisser aller au simple. Nous aimons régresser, ronronner en le lisant, entrer dans le récit, avoir derechef treize ou quatorze ans, chausser des bottes de buffle abaissées au-dessous du genou, porter une chemise bouffant à la ceinture, revêtir un justaucorps de drap aux manches longues et serré à la taille, et veiller à ce que son épée ne court le risque de se rouiller au fourreau. L.M.
Miss Harriet, cela suffit, puis emparez-vous du Sphynx rouge, la suite des Trois Mousquetaires, d’Alexandre Dumas (initialement connu sous le titre du Comte de Moret). L’histoire survient juste après le siège de La Rochelle, soit bien avant Vingt ans après. Il n’y a plus de Mousquetaires, mais un portrait vibrant du duc de Richelieu tient lieu ici de colonne vertébrale, et sur plus de sept cents pages. C’en est fait. Voici le retour tonitruant, au grand galop, de votre âme d’enfant ayant tant aimé lire tard sous les draps les romans d’aventure, de cape et d’épée, Jules Verne, Rudyard Kipling, Fennimore Cooper... Vous vous calez, bien allongé sur le canapé, les pieds sur l’accoudoir d’en face, un coussin supplémentaire sous la nuque. L’immense talent de Dumas est là, dès la troisième page, qui décrit un certain Étienne Latil, attablé dans une auberge à l’enseigne de La Barbe peinte, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie dans le quartier du Marais, à Paris. Il vous prend par le col et n’entend pas vous lâcher de sitôt. Il fera sans doute nuit lorsque vous lèverez une première fois les yeux du livre pourtant lourd à vos bras tendus, ou posé en angle sur votre ventre : « Sa rapière, dont la poignée était à la portée de sa main, s’allongeait de sa hanche sur sa cuisse et glissait comme une couleuvre entre ses deux jambes croisées l’une sur l’autre. C’était un homme de trente-six à trente-huit ans, dont on pouvait d’autant mieux voir le visage, au dernier rayon de lumière qui filtrait par les étroits vitraux losangés de plomb donnant sur la rue, qu’il avait suspendu son feutre à l’espagnolette de la fenêtre. (...) Son nez droit et son menton en saillie indiquaient la volonté poussée jusqu’à l’entêtement, tandis que la courbe inférieure de sa mâchoire, accentuée à la manière de celle des animaux féroces, indiquait ce courage irréfléchi dont il ne faut pas savoir gré à celui qui le possède, puisqu’il n’est point chez lui le résultat du libre arbitre, mais le simple produit d’instincts carnassiers ; enfin, tout le visage, assez beau, offrait le caractère d’une franchise brutale, qui pouvait faire craindre, de la part du porteur de cette physionomie, des accès de colère et de violence, mais qui ne laissait pas même soupçonner des actes de duplicité, de ruse ou de trahison. » Élégance et désinvolture. Fougue et franchise. Force et panache. Le pouvoir de Dumas est inaltérable. Cela fonctionne, s'enchaîne comme la saison 3 de La Casa de Papel : que vous le vouliez ou non, vous êtes embarqués dans le torrent d'une calle Estafeta du ciné, de la littérature, du bonheur de se laisser aller au simple. Nous aimons régresser, ronronner en le lisant, entrer dans le récit, avoir derechef treize ou quatorze ans, chausser des bottes de buffle abaissées au-dessous du genou, porter une chemise bouffant à la ceinture, revêtir un justaucorps de drap aux manches longues et serré à la taille, et veiller à ce que son épée ne court le risque de se rouiller au fourreau. L.M.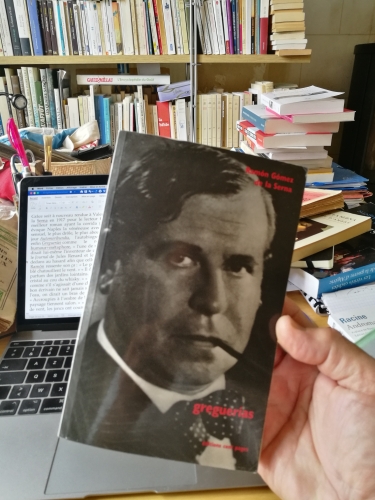 Grâce soit à nouveau rendue à Valery Larbaud d’avoir découvert Ramón Gomez de la Serna en 1917 pour le lecteur français. Nous tenons Le Torero Caracho pour le meilleur roman ayant la corrida pour thème, La Femme d’ambre comme celui qui évoque Naples la vénéneuse avec le plus de subtilité, Seins pour le livre le plus sensuel, le plus drôle, le plus abouti – 300 pages - sur le sujet (nous espérons lire un jour Automoribundia, l'autobiographie de l'auteur encore non traduite), et enfin Greguerías (le terme : humour+métaphore, « l'une de mes cendres quotidiennes », « oeillet sur le mur », disait lui-même l'inventeur de ce trait poétique), comme le recueil de micro-fragments le plus agréable à lire, autant que le Journal de Jules Renard et les Carnets de Cioran, en plus humoristique. Je tape dedans au hasard afin que celle ou celui qui ne connaît pas encore le plaisir de lire Ramón ressente son ça : « Le poète se nourrit de croissants de lune. » « Les épis de blé chatouillent le vent. » « Il devrait exister des jumelles olfactives pour percevoir le parfum des jardins lointains. » « Le glaçon tinte dans le verre comme un grelot de cristal au cou du whisky. » « Le brouillard finit en haillons. » « L’âme quitte le corps comme s’il s’agissait d’une chemise intérieure dont le jour de lessive est venu. » « Le bon écrivain ne sait jamais s’il sait écrire. » « Lorsque le cygne plonge son cou dans l’eau, on dirait un bras de femme cherchant une bague au fond de la baignoire. » « Accroupies à l’ombre de l’arbre qui se trouve au milieu de la plaine, les idées du paysage tiennent salon. » « L’épouvantail a une allure d’espion fusillé. » « Les jours de vent, les joncs ont cours d’escrime. » « La migraine est cette femme pénible qu’on ne veut pas recevoir, mais qui se glisse chez vous en disant :Je sais que vous êtes là. » L.M.
Grâce soit à nouveau rendue à Valery Larbaud d’avoir découvert Ramón Gomez de la Serna en 1917 pour le lecteur français. Nous tenons Le Torero Caracho pour le meilleur roman ayant la corrida pour thème, La Femme d’ambre comme celui qui évoque Naples la vénéneuse avec le plus de subtilité, Seins pour le livre le plus sensuel, le plus drôle, le plus abouti – 300 pages - sur le sujet (nous espérons lire un jour Automoribundia, l'autobiographie de l'auteur encore non traduite), et enfin Greguerías (le terme : humour+métaphore, « l'une de mes cendres quotidiennes », « oeillet sur le mur », disait lui-même l'inventeur de ce trait poétique), comme le recueil de micro-fragments le plus agréable à lire, autant que le Journal de Jules Renard et les Carnets de Cioran, en plus humoristique. Je tape dedans au hasard afin que celle ou celui qui ne connaît pas encore le plaisir de lire Ramón ressente son ça : « Le poète se nourrit de croissants de lune. » « Les épis de blé chatouillent le vent. » « Il devrait exister des jumelles olfactives pour percevoir le parfum des jardins lointains. » « Le glaçon tinte dans le verre comme un grelot de cristal au cou du whisky. » « Le brouillard finit en haillons. » « L’âme quitte le corps comme s’il s’agissait d’une chemise intérieure dont le jour de lessive est venu. » « Le bon écrivain ne sait jamais s’il sait écrire. » « Lorsque le cygne plonge son cou dans l’eau, on dirait un bras de femme cherchant une bague au fond de la baignoire. » « Accroupies à l’ombre de l’arbre qui se trouve au milieu de la plaine, les idées du paysage tiennent salon. » « L’épouvantail a une allure d’espion fusillé. » « Les jours de vent, les joncs ont cours d’escrime. » « La migraine est cette femme pénible qu’on ne veut pas recevoir, mais qui se glisse chez vous en disant :Je sais que vous êtes là. » L.M.
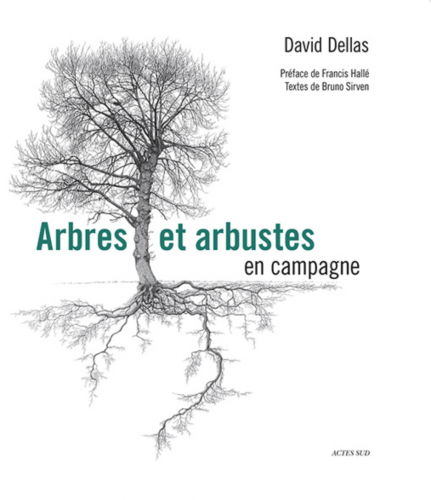 C’est un livre magnifique composé essentiellement (de plus de 120) dessins de David Dellas, artiste de grand talent, conseiller technique au sein d’Arbre & Paysage 32, rugbyman, ainsi que de textes de Bruno Sirven, géographe, et d’une préface du botaniste Francis Hallé. « Arbres et arbustes en campagne » (Actes Sud, 30€, 2è éd. Juillet 2019), fait écho à l’exposition « Nous les Arbres », qui se tient à la Fondation Cartier pour l’art contemporain (Paris) jusqu’au 10 novembre. Ces dessins d’un réalisme puissant, méticuleux, délicat, d’arbres et arbustes champêtres : frêne, aulne, érable, buis, charme, bouleau, peuplier, chêne, marronnier, figuier, sureau, pommier, mûrier, haies... sont formidables de précision et de poésie. Ils nous permettent de renouer avec une tradition des sciences naturelles, en particulier la botanique, qui est de représenter le vivant, le végétal par le dessin ou la gravure. Ainsi, la pédagogie s’associe-t-elle à l’art. Les arbres sont représentés nus, ce qui permet le détail, et avec leurs racines. Les feuilles et les fruits font l’objet de planches distinctes. Ce sont des arbres familiers, que l’on a coutume de voir dans le paysage des campagnes, mais que nous négligeons d’observer, qui sont ici l’objet d’une véritable performance esthétique obéissant à un sens de l’observation hors du commun, allié à une grande sobriété. Les textes s’attardent avec justesse aux bienfaits de chaque « arbre hors forêt », inscrit dans un biotope qu’il épouse – comme l’aulne et la rivière, à la quantité de ressources qu’il produit, à ses rôles bienfaiteurs pour l’écologie, la biodiversité, les agrosystèmes, et pour l’homme – qu’il soit agriculteur ou promeneur. L’arbre purifie l’eau, retient les sols et les protège, accueille quantité d’êtres vivants (insectes, oiseaux, petits mammifères), stocke l’excès de carbone, oxygène l’air, produit de la biomasse, de l’énergie, des écomatériaux, protège du vent, rend les sols vivants, il paysage et aménage l’espace qu’il occupe, redistribue l’énergie solaire, réconcilie l’agriculture avec l’environnement, longtemps opposés, car le modèle agro-sylvo-pastoral souffre souvent d’un manque de complémentarité. L’arbre n’est-il pas tout à la fois paravent, parapluie, parasol, garde-boue, garde-manger, et bien plus encore ? Il doit cesser d’être perçu et utilisé comme « une astuce cosmétique pour camoufler des sites disgracieux », et d'être combattu, abattu par l'agriculture intensive. Plaidoyer pour le « réarbrement », militant d’une politique de l’arbre – non forestier - au sein du territoire, l’ouvrage n’est pas qu’artistique, élégant, sensible, bouleversant par son dénuement chromatique, sa texture, même s’il se contemple bien davantage qu’il ne se lit. Les textes qui l’ornent sont brefs mais denses, ligneux... Ils nous apprennent enfin un glossaire singulier où il est question de taille (émondage et étêtage), de têtards, de trognes, de ragosses, de cépée, de sessille, de drageon, de marcotte, de mycorhize, de nodosité, de phrygane, et autres suber et tire-sève. Un petit bijou, ce bouquin. L.M.
C’est un livre magnifique composé essentiellement (de plus de 120) dessins de David Dellas, artiste de grand talent, conseiller technique au sein d’Arbre & Paysage 32, rugbyman, ainsi que de textes de Bruno Sirven, géographe, et d’une préface du botaniste Francis Hallé. « Arbres et arbustes en campagne » (Actes Sud, 30€, 2è éd. Juillet 2019), fait écho à l’exposition « Nous les Arbres », qui se tient à la Fondation Cartier pour l’art contemporain (Paris) jusqu’au 10 novembre. Ces dessins d’un réalisme puissant, méticuleux, délicat, d’arbres et arbustes champêtres : frêne, aulne, érable, buis, charme, bouleau, peuplier, chêne, marronnier, figuier, sureau, pommier, mûrier, haies... sont formidables de précision et de poésie. Ils nous permettent de renouer avec une tradition des sciences naturelles, en particulier la botanique, qui est de représenter le vivant, le végétal par le dessin ou la gravure. Ainsi, la pédagogie s’associe-t-elle à l’art. Les arbres sont représentés nus, ce qui permet le détail, et avec leurs racines. Les feuilles et les fruits font l’objet de planches distinctes. Ce sont des arbres familiers, que l’on a coutume de voir dans le paysage des campagnes, mais que nous négligeons d’observer, qui sont ici l’objet d’une véritable performance esthétique obéissant à un sens de l’observation hors du commun, allié à une grande sobriété. Les textes s’attardent avec justesse aux bienfaits de chaque « arbre hors forêt », inscrit dans un biotope qu’il épouse – comme l’aulne et la rivière, à la quantité de ressources qu’il produit, à ses rôles bienfaiteurs pour l’écologie, la biodiversité, les agrosystèmes, et pour l’homme – qu’il soit agriculteur ou promeneur. L’arbre purifie l’eau, retient les sols et les protège, accueille quantité d’êtres vivants (insectes, oiseaux, petits mammifères), stocke l’excès de carbone, oxygène l’air, produit de la biomasse, de l’énergie, des écomatériaux, protège du vent, rend les sols vivants, il paysage et aménage l’espace qu’il occupe, redistribue l’énergie solaire, réconcilie l’agriculture avec l’environnement, longtemps opposés, car le modèle agro-sylvo-pastoral souffre souvent d’un manque de complémentarité. L’arbre n’est-il pas tout à la fois paravent, parapluie, parasol, garde-boue, garde-manger, et bien plus encore ? Il doit cesser d’être perçu et utilisé comme « une astuce cosmétique pour camoufler des sites disgracieux », et d'être combattu, abattu par l'agriculture intensive. Plaidoyer pour le « réarbrement », militant d’une politique de l’arbre – non forestier - au sein du territoire, l’ouvrage n’est pas qu’artistique, élégant, sensible, bouleversant par son dénuement chromatique, sa texture, même s’il se contemple bien davantage qu’il ne se lit. Les textes qui l’ornent sont brefs mais denses, ligneux... Ils nous apprennent enfin un glossaire singulier où il est question de taille (émondage et étêtage), de têtards, de trognes, de ragosses, de cépée, de sessille, de drageon, de marcotte, de mycorhize, de nodosité, de phrygane, et autres suber et tire-sève. Un petit bijou, ce bouquin. L.M.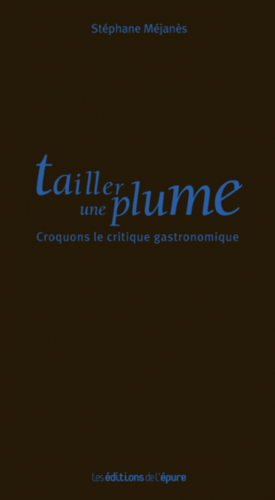 Voici un petit livre à l’insolence tranquille, au ton nonchalant qui fait penser à la voix de François Simon – c’est, comment dire... slow. Voilà. Diablement efficace. Et remarquablement écrit, précis, scrupuleux, ironique souvent, caustique aussi, acide parfois, vrai et semblable toujours. Lorsqu’on peut être soi-même l’objet, voire la cible d’un tel opuscule (nous pratiquons le métier d’explorer et noter tables, chambres, bouteilles, assiettes depuis 1987, même si l’on est un peu rangé des fourchettes, mais pas encore des verres), on se cale bien pour lire ce mini traité d’observation d’un microcosme, d’une petite tribu où chacun lorgne l’autre, le méprise ou le jalouse, le toise ou le peinturlure d’un onguent faux-cul. Tailler une plume, titre sibyllin pour qui connait l’argot, sous-titré croquons la critique gastronomique, signé par l’un de nos pairs, Stéphane Méjanès, est publié aux délicieuses éditions de l’épure de la gourmande libre, de l’hédoniste dans les grandes largeurs Sabine Bucquet-Grenet. 90 pages sans vitriol, composées comme une galerie de portraits, à la manière des Caractères de La Bruyère. Je vous récite le sommaire : la diva, le stakhanoviste, le pique-assiette, l’incognito, l’influenceur, le glouton, le blasé, le tyran, l’antique, l’ingénu. Il ne manque personne à l’appel. Ces portraits fictifs, car sans aucun doute échafaudés à partir d’une galerie de personnages-types, façon puzzle agrégé, sont tellement réels. Et avant tout savoureux, drôles, pertinents davantage qu'impertinents, car subtils, et pointus – ils piquent là où il faut. Côté style, nous avons annoté en marge pas mal d’images justes, de traits, de formules qui font mouche. Un petit régal, à l’instar du goût d’un blanc sur une fine appellation. Mesdames... L.M.
Voici un petit livre à l’insolence tranquille, au ton nonchalant qui fait penser à la voix de François Simon – c’est, comment dire... slow. Voilà. Diablement efficace. Et remarquablement écrit, précis, scrupuleux, ironique souvent, caustique aussi, acide parfois, vrai et semblable toujours. Lorsqu’on peut être soi-même l’objet, voire la cible d’un tel opuscule (nous pratiquons le métier d’explorer et noter tables, chambres, bouteilles, assiettes depuis 1987, même si l’on est un peu rangé des fourchettes, mais pas encore des verres), on se cale bien pour lire ce mini traité d’observation d’un microcosme, d’une petite tribu où chacun lorgne l’autre, le méprise ou le jalouse, le toise ou le peinturlure d’un onguent faux-cul. Tailler une plume, titre sibyllin pour qui connait l’argot, sous-titré croquons la critique gastronomique, signé par l’un de nos pairs, Stéphane Méjanès, est publié aux délicieuses éditions de l’épure de la gourmande libre, de l’hédoniste dans les grandes largeurs Sabine Bucquet-Grenet. 90 pages sans vitriol, composées comme une galerie de portraits, à la manière des Caractères de La Bruyère. Je vous récite le sommaire : la diva, le stakhanoviste, le pique-assiette, l’incognito, l’influenceur, le glouton, le blasé, le tyran, l’antique, l’ingénu. Il ne manque personne à l’appel. Ces portraits fictifs, car sans aucun doute échafaudés à partir d’une galerie de personnages-types, façon puzzle agrégé, sont tellement réels. Et avant tout savoureux, drôles, pertinents davantage qu'impertinents, car subtils, et pointus – ils piquent là où il faut. Côté style, nous avons annoté en marge pas mal d’images justes, de traits, de formules qui font mouche. Un petit régal, à l’instar du goût d’un blanc sur une fine appellation. Mesdames... L.M.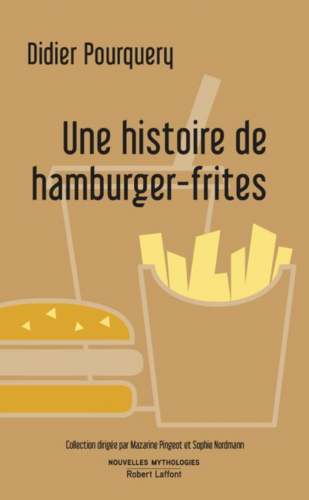 Il n’y a pas de mauvais sujet. C’est ce que l’on répète au journaliste stagiaire faisant la fine bouche parce qu’on l’envoie couvrir un marronnier. C’est comme ça que le métier rentre, assène-t-on. A priori, mener une enquête très approfondie sur l’univers du fast-food, si l’on n’est pas un McDolescent attardé, en focalisant forcément celle-ci sur la gigantesque entreprise aux arches jaunes, peut sembler sinon suspect, au moins audacieux. Didier Pourquery, sans doute aficionado léger du petit pain rond et mou, régressif et transgressif, nocif parce qu’addictif, l’a menée car il souhaitait le faire depuis longtemps, lui qui dévora avec plaisir son premier hamburger-frites à l’âge de 17 ans, en 1971, et pas n’importe où : dans un Dairy Queen Brazier de Chicago. Ça marque. Et nous lisons, grâce à son talent narratif, un essai comme on lit une (belle) histoire avec des personnages, tout ça. Découpée en tranches, l’étude : historique, sociologique (les rites), géographique, économique bien sûr, et aussi sur le plan capital de la nutrition (ça nuit grave !), celui de la mode (comment ça mute ?), et enfin sous l’angle du mauvais esprit, confesse d’emblée l’auteur. Mais l’analyse est totalement sérieuse, d’une précision d’horloger genevois, gavée de références, c’est bien sourcé comme on dit, c’est drôle souvent, et l’on sent le journaliste scrupuleux glissant tantôt vers l’aveu culpabilisant (j’aime ça), tantôt vers l’affirmation dédouanante (c’est vraiment dégueu, tant le système précis mis en place pour « piéger » le consommateur, quelle que soit sa culture, que la charge en lipides et en glucides de tout hamburger-frites). Grâce à plusieurs brassées de chiffres, de statistiques, nous apprenons énormément de choses sur l’univers, la grosse machine dissimulée sous ce « simulacre de repas ». Pourquery se réfère immédiatement au chapitre des « Mythologies » de Roland Barthes (1961) consacré au bifteck-frites (*). L’emblématique plat français, en terre de gastronomie, qui résonnait « sang », a depuis longtemps été détrôné par le hamburger, lequel résonne « sans » : bientôt sans viande, sans bœuf, sans personnel humain... 1961 voit aussi l’apparition des restaurants de fast-food Wimpy, en écho à Popeye, dont le personnage goinfre nommé Gontran dans l’adaptation française, ami de Popeye, se nomme J. Wellington Wimpy. C’est le premier addict aux hamburgers. Jacques Borel, célèbre pour les restauroutes, ouvrit cette année-là le premier Wimpy français. En 1972, le premier McDonald’s de France ouvre à Créteil. Depuis, on en compte 1 300 au pays du foie gras et des grands crus classés, et la filiale française est la plus rentable au monde derrière le réseau US. Déroutante France. C’est le French paradox... Le bouquin de Didier Pourquery devient captivant au fil des pages, car outre l’histoire des KFC, Burger King, Freetime (souvenez-vous de Christophe Salengro disant : my teinturier is rich), et autres concurrents du géant McDo et ses 37 000 « restaurants », la préhistoire du hamburger (Hambourg), l’histoire du steack haché, l’idée de le placer entre deux tranches de pain, jusqu’à la Hamburger University, « le Princeton du fast-food » qui a déjà form(at)é 80 000 managers de McDo, dans les veines desquels on est en droit de se demander si ce n’est pas du ketchup qui circule, il y a le décodage sociologique et psychologique de l’acte de se rendre dans un fast-food et d’y consommer, auquel se livre l’auteur avec un savoir et un tact qui emporte le lecteur. Il est question d’« expérience » pour désigner ces actes, de la « production d’une histoire comestible plus que d’une nourriture concrète ». Chacun sait que c’est de la junk-food, soit de la malbouffe, mais nous savons que les horribles photos qui ornent les paquets de cigarettes n’empêchent pas davantage le fumeur de tirer sur sa clope (12 millions de décès dans le monde dus à la malbouffe, contre 7 millions au tabac en 2015. Quand même...). Cela m’évoque les épouvantails dans les champs sur lesquels se posent les oiseaux... L'efficacité des firmes de fast-food est vraiment redoutable. Pourquery s’attarde à juste titre sur des petites choses, comme ça, qui relèvent du rite : manger – forcément - avec ses mains, piquer une frite sur le plateau avant de s’asseoir, puis dans le plateau de l'autre, cette lenteur que nous craignons, et notre impatience qui monte comme du lait dans la casserole lorsque la commande n’arrive pas dans la seconde, les néo-burgers revisitant aujourd’hui le mythe et le simulacre en même temps, en tentant de « purifier » tout ça. L’archétype étant la petite chaîne tellement friendly Big Fernand. Le moment le plus tragique peut-être est cet article de Lorraine de Foucher paru dans Le Monde du 2 novembre 2018, intitulé « Le McDo a remplacé le café du village », cité par Didier Pourquery. Ce papier m'avait alerté. Le mot village y est un peu exagéré, car la chaîne ne s’installe pas encore dans de petits bleds désormais dépourvus d’école, d’épicerie fourre-tout, où un office mensuel est célébré à l’église, et où le dernier bar, en fermant définitivement sa porte, sonne le glas de la dernière possibilité de se retrouver, d’être encore socialisés, ensemble – au moins entre hommes, comme dans le baitemannageo, ou « maison des hommes » bâti au centre de chaque village Bororo, et décrit par Claude Lévi-Strauss dans « Tristes Tropiques » (Plon/Terre Humaine, page 248). Mais force est d’admettre que dans des bourgs et des villes de petite taille, lorsqu’un McDo ouvre, c’est un peu de vie qui revient... dans un cadre particulier. Reste que cette « Histoire de hamburger-frites » sous-titrée « comment un simulacre de repas a-t-il séduit le monde entier ? » se lit comme on boit un demi un jour de canicule, ou comme on dévore un Big Mac. L.M.
Il n’y a pas de mauvais sujet. C’est ce que l’on répète au journaliste stagiaire faisant la fine bouche parce qu’on l’envoie couvrir un marronnier. C’est comme ça que le métier rentre, assène-t-on. A priori, mener une enquête très approfondie sur l’univers du fast-food, si l’on n’est pas un McDolescent attardé, en focalisant forcément celle-ci sur la gigantesque entreprise aux arches jaunes, peut sembler sinon suspect, au moins audacieux. Didier Pourquery, sans doute aficionado léger du petit pain rond et mou, régressif et transgressif, nocif parce qu’addictif, l’a menée car il souhaitait le faire depuis longtemps, lui qui dévora avec plaisir son premier hamburger-frites à l’âge de 17 ans, en 1971, et pas n’importe où : dans un Dairy Queen Brazier de Chicago. Ça marque. Et nous lisons, grâce à son talent narratif, un essai comme on lit une (belle) histoire avec des personnages, tout ça. Découpée en tranches, l’étude : historique, sociologique (les rites), géographique, économique bien sûr, et aussi sur le plan capital de la nutrition (ça nuit grave !), celui de la mode (comment ça mute ?), et enfin sous l’angle du mauvais esprit, confesse d’emblée l’auteur. Mais l’analyse est totalement sérieuse, d’une précision d’horloger genevois, gavée de références, c’est bien sourcé comme on dit, c’est drôle souvent, et l’on sent le journaliste scrupuleux glissant tantôt vers l’aveu culpabilisant (j’aime ça), tantôt vers l’affirmation dédouanante (c’est vraiment dégueu, tant le système précis mis en place pour « piéger » le consommateur, quelle que soit sa culture, que la charge en lipides et en glucides de tout hamburger-frites). Grâce à plusieurs brassées de chiffres, de statistiques, nous apprenons énormément de choses sur l’univers, la grosse machine dissimulée sous ce « simulacre de repas ». Pourquery se réfère immédiatement au chapitre des « Mythologies » de Roland Barthes (1961) consacré au bifteck-frites (*). L’emblématique plat français, en terre de gastronomie, qui résonnait « sang », a depuis longtemps été détrôné par le hamburger, lequel résonne « sans » : bientôt sans viande, sans bœuf, sans personnel humain... 1961 voit aussi l’apparition des restaurants de fast-food Wimpy, en écho à Popeye, dont le personnage goinfre nommé Gontran dans l’adaptation française, ami de Popeye, se nomme J. Wellington Wimpy. C’est le premier addict aux hamburgers. Jacques Borel, célèbre pour les restauroutes, ouvrit cette année-là le premier Wimpy français. En 1972, le premier McDonald’s de France ouvre à Créteil. Depuis, on en compte 1 300 au pays du foie gras et des grands crus classés, et la filiale française est la plus rentable au monde derrière le réseau US. Déroutante France. C’est le French paradox... Le bouquin de Didier Pourquery devient captivant au fil des pages, car outre l’histoire des KFC, Burger King, Freetime (souvenez-vous de Christophe Salengro disant : my teinturier is rich), et autres concurrents du géant McDo et ses 37 000 « restaurants », la préhistoire du hamburger (Hambourg), l’histoire du steack haché, l’idée de le placer entre deux tranches de pain, jusqu’à la Hamburger University, « le Princeton du fast-food » qui a déjà form(at)é 80 000 managers de McDo, dans les veines desquels on est en droit de se demander si ce n’est pas du ketchup qui circule, il y a le décodage sociologique et psychologique de l’acte de se rendre dans un fast-food et d’y consommer, auquel se livre l’auteur avec un savoir et un tact qui emporte le lecteur. Il est question d’« expérience » pour désigner ces actes, de la « production d’une histoire comestible plus que d’une nourriture concrète ». Chacun sait que c’est de la junk-food, soit de la malbouffe, mais nous savons que les horribles photos qui ornent les paquets de cigarettes n’empêchent pas davantage le fumeur de tirer sur sa clope (12 millions de décès dans le monde dus à la malbouffe, contre 7 millions au tabac en 2015. Quand même...). Cela m’évoque les épouvantails dans les champs sur lesquels se posent les oiseaux... L'efficacité des firmes de fast-food est vraiment redoutable. Pourquery s’attarde à juste titre sur des petites choses, comme ça, qui relèvent du rite : manger – forcément - avec ses mains, piquer une frite sur le plateau avant de s’asseoir, puis dans le plateau de l'autre, cette lenteur que nous craignons, et notre impatience qui monte comme du lait dans la casserole lorsque la commande n’arrive pas dans la seconde, les néo-burgers revisitant aujourd’hui le mythe et le simulacre en même temps, en tentant de « purifier » tout ça. L’archétype étant la petite chaîne tellement friendly Big Fernand. Le moment le plus tragique peut-être est cet article de Lorraine de Foucher paru dans Le Monde du 2 novembre 2018, intitulé « Le McDo a remplacé le café du village », cité par Didier Pourquery. Ce papier m'avait alerté. Le mot village y est un peu exagéré, car la chaîne ne s’installe pas encore dans de petits bleds désormais dépourvus d’école, d’épicerie fourre-tout, où un office mensuel est célébré à l’église, et où le dernier bar, en fermant définitivement sa porte, sonne le glas de la dernière possibilité de se retrouver, d’être encore socialisés, ensemble – au moins entre hommes, comme dans le baitemannageo, ou « maison des hommes » bâti au centre de chaque village Bororo, et décrit par Claude Lévi-Strauss dans « Tristes Tropiques » (Plon/Terre Humaine, page 248). Mais force est d’admettre que dans des bourgs et des villes de petite taille, lorsqu’un McDo ouvre, c’est un peu de vie qui revient... dans un cadre particulier. Reste que cette « Histoire de hamburger-frites » sous-titrée « comment un simulacre de repas a-t-il séduit le monde entier ? » se lit comme on boit un demi un jour de canicule, ou comme on dévore un Big Mac. L.M.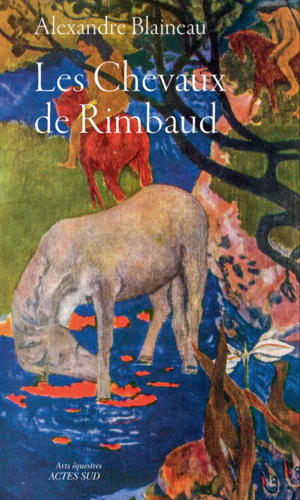 Nous avions beaucoup aimé Montaigne à cheval (Points/Seuil), du regretté Jean Lacouture, car le livre caracolait et nous montrait un Montaigne toujours en selle, avide d’en découdre avec la découverte du monde qui l’entourait, du Périgord à l’Italie. Voici Les Chevaux de Rimbaud, d’Alexandre Blaineau, un spécialiste de la littérature équestre (Actes Sud, en librairie le 4 septembre), bouquin captivant qui dévoile un Voyant méconnu, et qui n’aima rien comme chevaucher, lui aussi. Nous l’imaginions exclusivement marcheur, picoté par les blés, foulant l’herbe ardennaise menue... Il monta pourtant abondamment, dans la seconde partie de sa vie. À Chypre, et surtout dans l’Afrique orientale qu’il aima et qui l’aimât tant. Le désert Somali qu’il traverse durant vingt jours le cul sur une selle, Harar bien sûr, et durablement, où il fit commerce (et se laissa photographier une fois), l’immense plateau de Boubassa, les rives de la mer Rouge, Barr-Adjam, Aden, le Yémen entier le virent aller l’amble, trottant, galopant, (se) fuyant peut-être ; sans doute... Rimbaud l’Abyssin fut ainsi, et aussi, un homme aux chevaux de vent. Semelles dans les étriers. Par bonheur sans plomb dans la cervelle. Nous l’imaginons alors comme un second Lawrence d’Arabie, la tête enveloppée d’un chech blanc crème, les paupières poussiéreuses, la peau cuivrée, tannée, la gorge sèche comme un oued en août, le regard bleu peut-être. Qui peut me dire quelle fut la couleur des yeux d’Arthur, car j’ai égaré le 06 de Verlaine ? Le « marchand cavalier » qui désespère les mauvaises récoltes de café et menace cent fois d’acheter un cheval et de (re)foutre le camp, celui qui cherche un beau jour à faire l’acquisition de quatre baudets étalons, qui écrit à sa famille de taiseux (son frère Frédéric, alcoolo, l’était plus que les autres), le 25 février 1890, « Il faut se taire », est infiniment touchant dans sa vie orientale narrée ici avec talent et précision, comme à chaque page, vers, mot d’Une Saison en Enfer. En refermant ce livre érudit, captivant, nourri d’histoires et de recherches pointues sur un Rimbaud « exilé fictif », ayant dans le regard l’expression du « défi résigné », ses longues jambes, ses bras ballants (rien de commun avec Jack Kerouac, quoique d’aucuns soient tentés de...), ce livre citant avec plaisir Thomas Mayne Reid, le père du roman d’aventures façon western, méconnu hélas, ce livre qui nous rappelle ceux du rimbaldien absolu, shooté aux Illuminations Alain Borer (en particulier son Rimbaud en Abyssinie), il devient impossible de ne pas trouver en chaque cheval aperçu un rien, un brin rimbaldien, de ressentir autrement les mouvements de sa crinière comme ceux de son « épaule qui frissonne sans cause » dit Julien Gracq dans Liberté grande, et de voir en chaque cavalier croisé désormais un nomade, impatient comme un orage désiré, allant en avant, calme et... en zigzag vers la mer, ou n’importe quoi, voire l’éternité, té!.. L.M.
Nous avions beaucoup aimé Montaigne à cheval (Points/Seuil), du regretté Jean Lacouture, car le livre caracolait et nous montrait un Montaigne toujours en selle, avide d’en découdre avec la découverte du monde qui l’entourait, du Périgord à l’Italie. Voici Les Chevaux de Rimbaud, d’Alexandre Blaineau, un spécialiste de la littérature équestre (Actes Sud, en librairie le 4 septembre), bouquin captivant qui dévoile un Voyant méconnu, et qui n’aima rien comme chevaucher, lui aussi. Nous l’imaginions exclusivement marcheur, picoté par les blés, foulant l’herbe ardennaise menue... Il monta pourtant abondamment, dans la seconde partie de sa vie. À Chypre, et surtout dans l’Afrique orientale qu’il aima et qui l’aimât tant. Le désert Somali qu’il traverse durant vingt jours le cul sur une selle, Harar bien sûr, et durablement, où il fit commerce (et se laissa photographier une fois), l’immense plateau de Boubassa, les rives de la mer Rouge, Barr-Adjam, Aden, le Yémen entier le virent aller l’amble, trottant, galopant, (se) fuyant peut-être ; sans doute... Rimbaud l’Abyssin fut ainsi, et aussi, un homme aux chevaux de vent. Semelles dans les étriers. Par bonheur sans plomb dans la cervelle. Nous l’imaginons alors comme un second Lawrence d’Arabie, la tête enveloppée d’un chech blanc crème, les paupières poussiéreuses, la peau cuivrée, tannée, la gorge sèche comme un oued en août, le regard bleu peut-être. Qui peut me dire quelle fut la couleur des yeux d’Arthur, car j’ai égaré le 06 de Verlaine ? Le « marchand cavalier » qui désespère les mauvaises récoltes de café et menace cent fois d’acheter un cheval et de (re)foutre le camp, celui qui cherche un beau jour à faire l’acquisition de quatre baudets étalons, qui écrit à sa famille de taiseux (son frère Frédéric, alcoolo, l’était plus que les autres), le 25 février 1890, « Il faut se taire », est infiniment touchant dans sa vie orientale narrée ici avec talent et précision, comme à chaque page, vers, mot d’Une Saison en Enfer. En refermant ce livre érudit, captivant, nourri d’histoires et de recherches pointues sur un Rimbaud « exilé fictif », ayant dans le regard l’expression du « défi résigné », ses longues jambes, ses bras ballants (rien de commun avec Jack Kerouac, quoique d’aucuns soient tentés de...), ce livre citant avec plaisir Thomas Mayne Reid, le père du roman d’aventures façon western, méconnu hélas, ce livre qui nous rappelle ceux du rimbaldien absolu, shooté aux Illuminations Alain Borer (en particulier son Rimbaud en Abyssinie), il devient impossible de ne pas trouver en chaque cheval aperçu un rien, un brin rimbaldien, de ressentir autrement les mouvements de sa crinière comme ceux de son « épaule qui frissonne sans cause » dit Julien Gracq dans Liberté grande, et de voir en chaque cavalier croisé désormais un nomade, impatient comme un orage désiré, allant en avant, calme et... en zigzag vers la mer, ou n’importe quoi, voire l’éternité, té!.. L.M.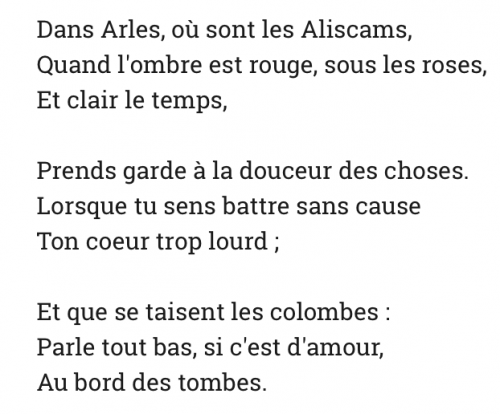
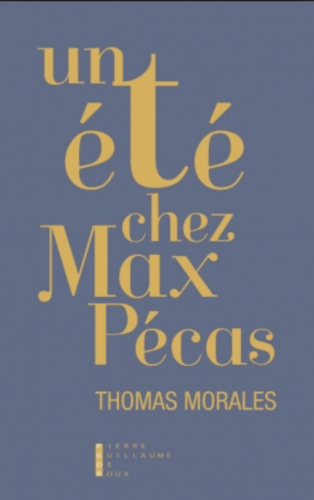
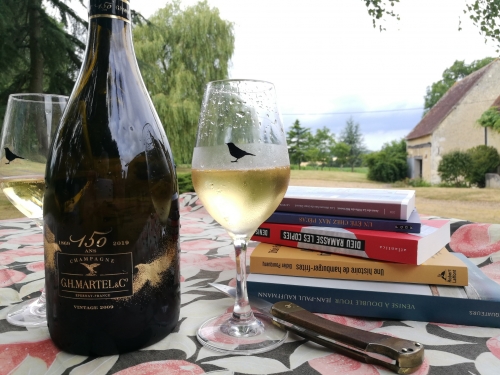
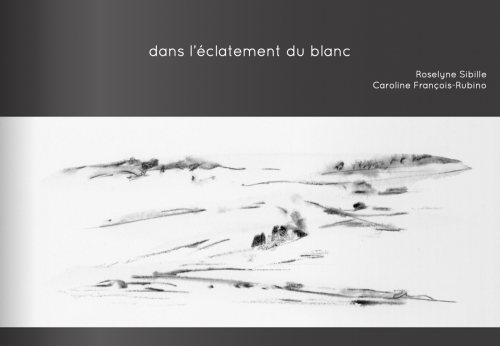

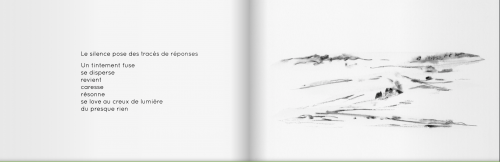
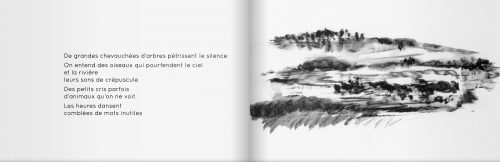
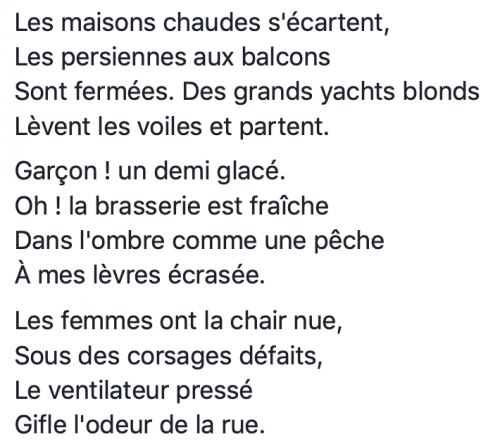



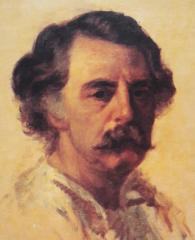 Il y a toujours des Chevaliers errants dans le monde. Ils ne redressent plus les torts avec la lance, mais les ridicules avec la raillerie, et Mesnilgrand était de ces Chevaliers-là. Il avait le don du sarcasme. Mais ce n'était pas le seul don que le Dieu de la force lui eût fait. Quoique, dans son économie animale, le caractère fût sur le premier plan, comme chez presque tous les hommes d'action, l'esprit, resté en seconde ligne, n'en était pas moins, pour lui et contre les autres, une puissance. Nul doute que si le chevalier de Mesnilgrand avait été un homme heureux, il
Il y a toujours des Chevaliers errants dans le monde. Ils ne redressent plus les torts avec la lance, mais les ridicules avec la raillerie, et Mesnilgrand était de ces Chevaliers-là. Il avait le don du sarcasme. Mais ce n'était pas le seul don que le Dieu de la force lui eût fait. Quoique, dans son économie animale, le caractère fût sur le premier plan, comme chez presque tous les hommes d'action, l'esprit, resté en seconde ligne, n'en était pas moins, pour lui et contre les autres, une puissance. Nul doute que si le chevalier de Mesnilgrand avait été un homme heureux, il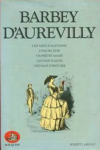 n'eût été très spirituel; mais, malheureux, il avait des opinions de désespéré et, quand il était gai, chose rare, une gaité de désespéré; (...)
n'eût été très spirituel; mais, malheureux, il avait des opinions de désespéré et, quand il était gai, chose rare, une gaité de désespéré; (...)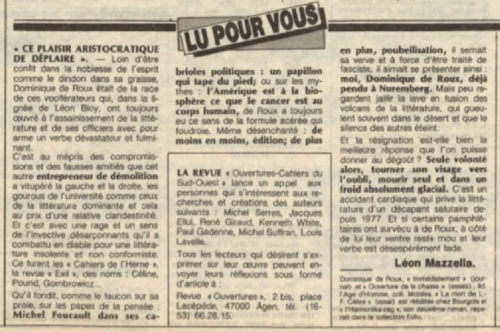
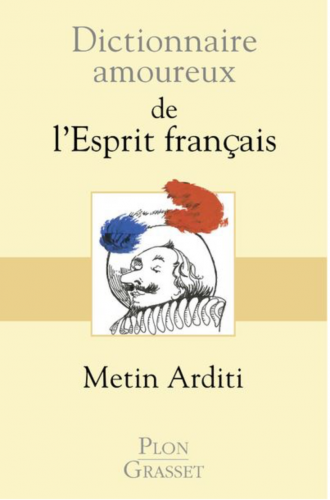 Nous attendions beaucoup mais sans raison – sinon l’excitation suscitée par son titre – de ce Dictionnaire amoureux consacré à l’Esprit français (Plon/Grasset, 670 p., 25€). Metin Arditi y livre de belles pages, mais son abécédaire semble davantage tenir du fourre-tout intelligent, de l’auberge espagnole brillante tant il apparait davantage comme un collage façon puzzle, que d’un vrai projet cohérent, autant sur le fond que pour son style. Certaines entrées consacrées à des personnages célèbres figurent de sensibles mini portraits souffrant cependant d’être surchargés d’interminables citations. D’autres semblent bâclées (Gastronomie : une succession de recettes et de généralités, Cinéma : un florilège de résumés de films). D’autres encore campent là comme par erreur, ou bien leur propos n’apporte pas grand-chose (Exécutions capitales, Mauvais films, Solder la facture). Les entrées consacrées au panache, à Cyrano (via l’entrée Rostand) peuvent laisser sur notre faim, car on se prépare à lire un feu d’artifice. Le lecteur regrette au fond que les principes d’élégance, de séduction, de beauté, d’humour, de courtoisie, le goût de la conversation et du trait ne soient qu’évoqués comme ça, ne soient jamais claquants, convaincants. Sans doute voulions-nous à tout prix lire un bréviaire qui aurait assemblé les plumes de Jules Renard, Sacha Guitry, Pierre Desproges et Voltaire dans un Bic à 4 couleurs. Au lieu de quoi nous tombons sur d'étranges entrées comme celle qui est intitulée Victime exemplaire de l’obsession du panache, et dont le texte se résume à ces deux mots : Françoise Nyssen. Las... L’avantage de ce kaléidoscope est que l’on trouve en rayon à la fois Boulez, Fauré et Gainsbourg, Char, Grandes Écoles, de Gaulle et Montesquieu, les Guignols de l’info, Yves Montand et Saint-Simon, Jambon-beurre et Michelin (le guide), TGV et Jansénisme. Il y a aussi une entrée nommée Lourdeur.
Nous attendions beaucoup mais sans raison – sinon l’excitation suscitée par son titre – de ce Dictionnaire amoureux consacré à l’Esprit français (Plon/Grasset, 670 p., 25€). Metin Arditi y livre de belles pages, mais son abécédaire semble davantage tenir du fourre-tout intelligent, de l’auberge espagnole brillante tant il apparait davantage comme un collage façon puzzle, que d’un vrai projet cohérent, autant sur le fond que pour son style. Certaines entrées consacrées à des personnages célèbres figurent de sensibles mini portraits souffrant cependant d’être surchargés d’interminables citations. D’autres semblent bâclées (Gastronomie : une succession de recettes et de généralités, Cinéma : un florilège de résumés de films). D’autres encore campent là comme par erreur, ou bien leur propos n’apporte pas grand-chose (Exécutions capitales, Mauvais films, Solder la facture). Les entrées consacrées au panache, à Cyrano (via l’entrée Rostand) peuvent laisser sur notre faim, car on se prépare à lire un feu d’artifice. Le lecteur regrette au fond que les principes d’élégance, de séduction, de beauté, d’humour, de courtoisie, le goût de la conversation et du trait ne soient qu’évoqués comme ça, ne soient jamais claquants, convaincants. Sans doute voulions-nous à tout prix lire un bréviaire qui aurait assemblé les plumes de Jules Renard, Sacha Guitry, Pierre Desproges et Voltaire dans un Bic à 4 couleurs. Au lieu de quoi nous tombons sur d'étranges entrées comme celle qui est intitulée Victime exemplaire de l’obsession du panache, et dont le texte se résume à ces deux mots : Françoise Nyssen. Las... L’avantage de ce kaléidoscope est que l’on trouve en rayon à la fois Boulez, Fauré et Gainsbourg, Char, Grandes Écoles, de Gaulle et Montesquieu, les Guignols de l’info, Yves Montand et Saint-Simon, Jambon-beurre et Michelin (le guide), TGV et Jansénisme. Il y a aussi une entrée nommée Lourdeur. 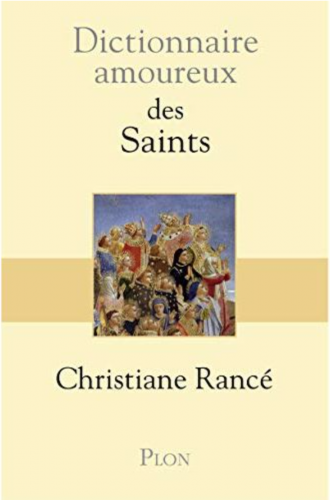 Compagnons de l'invisible
Compagnons de l'invisible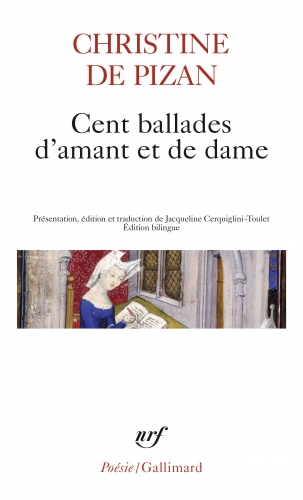 Savez-vous - mais qui peut prétendre savoir ce qui suit, aujourd'hui? - savez-vous donc que dans la théorie courtoise, le baiser représente le quatrième degré de l'amour dans une hiérarchie qui en compte cinq, selon le modèle des cinq sens? Le baiser correspond à celui du goût. Et cela nous est déjà si délicieux de l'apprendre. C'est Jacqueline Cerquiglini-Toulet (un lien de parenté avec Paul-Jean? - J'ai demandé, elle l'ignore), fervente préfacière et éditrice de ces ballades de Christine de Pizan, qui l'écrit. L'ouvrage, Cent ballades d'amant et de dame, est d'importance (Poésie/Gallimard, 10€). D'une part nous lisons un homme d'une loyauté sans faille, quoique, et d'autre part, les réponses d'une femme aimante mais infiniment prudente. Les amants dialoguent au fil de cent poèmes, ce qui n'est pas rien lorsque le désir attise. Ce sont des lettres, des messages, des hommages, des envois, des plaintes parfois, de fougueuses adresses, des reproches aussi, des invites, un faux dialogue peut-être, la distance entretient l'absence en tentant de la dissoudre, le choix du mot fait le reste, maintient, magnifie, tient tout cet édifice d'une intense fragilité droit. À l'époque de Christine de Pizan (1364, Venise - 1430, Poissy), la ballade est une forme à trois strophes avec un refrain d'un ou deux vers. Dans ces Cent ballades d'amant et de dame, si pressantes, la longueur des strophes est délicieusement écourtée parfois, et la taille des vers varie au gré de la disposition des rimes... Les 336 pages du recueil nous offrent ainsi un bouquet de retenue,
Savez-vous - mais qui peut prétendre savoir ce qui suit, aujourd'hui? - savez-vous donc que dans la théorie courtoise, le baiser représente le quatrième degré de l'amour dans une hiérarchie qui en compte cinq, selon le modèle des cinq sens? Le baiser correspond à celui du goût. Et cela nous est déjà si délicieux de l'apprendre. C'est Jacqueline Cerquiglini-Toulet (un lien de parenté avec Paul-Jean? - J'ai demandé, elle l'ignore), fervente préfacière et éditrice de ces ballades de Christine de Pizan, qui l'écrit. L'ouvrage, Cent ballades d'amant et de dame, est d'importance (Poésie/Gallimard, 10€). D'une part nous lisons un homme d'une loyauté sans faille, quoique, et d'autre part, les réponses d'une femme aimante mais infiniment prudente. Les amants dialoguent au fil de cent poèmes, ce qui n'est pas rien lorsque le désir attise. Ce sont des lettres, des messages, des hommages, des envois, des plaintes parfois, de fougueuses adresses, des reproches aussi, des invites, un faux dialogue peut-être, la distance entretient l'absence en tentant de la dissoudre, le choix du mot fait le reste, maintient, magnifie, tient tout cet édifice d'une intense fragilité droit. À l'époque de Christine de Pizan (1364, Venise - 1430, Poissy), la ballade est une forme à trois strophes avec un refrain d'un ou deux vers. Dans ces Cent ballades d'amant et de dame, si pressantes, la longueur des strophes est délicieusement écourtée parfois, et la taille des vers varie au gré de la disposition des rimes... Les 336 pages du recueil nous offrent ainsi un bouquet de retenue, 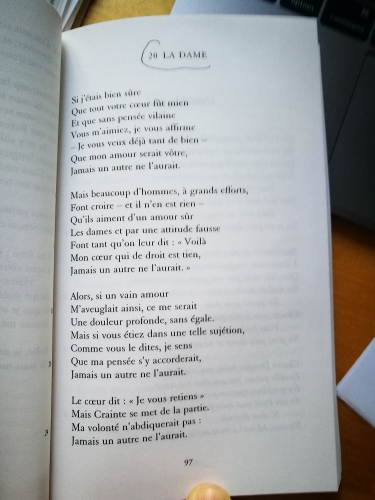 l'expression parfaite de l'amour courtois cher aux troubadours : Que votre doux amour soit vers moi tourné / Car mon coeur est déjà plus noir qu'une mûre, lit-on dès le premier envoi. Ce qui fait délice, c'est la nomination de l'alternance : L'Amant, La Dame, L'Amant, La Dame, se répondent et nous suivons un ping-pong amoureux d'une fine délicatesse, un échange d'une stupéfiante modernité : Le dard d'amour qui, comme il se doit, / T'enverra des pensers / Pleins de désir, par divers sentiers, / Tantôt joyeux, tantôt douloureux... La ballade 20 (photo jointe) exprime une affirmation féministe de bon aloi. À laquelle la Dame ajoute, quelques pages plus loin, des vers à nos yeux définitifs : À rien ne sert de résister, / Amour est mon adversaire, / Je ne peux m'y soustraire. Car, il s'agit là, au détour de quelque strophe, d'une joute jouant sur le désir de l'autre : Car je ne veux que votre doux vouloir. / Votre volonté seule est la mienne... dit-il, tandis qu'elle semble, semble seulement, lâcher prise : Je suis vôtre, vous m'avez justement conquise, / Il n'est plus besoin que j'en sois requise, / Amour le veut; vous avez trouvé le chemin /Pour prendre mon coeur / Sans mauvaise ruse, par
l'expression parfaite de l'amour courtois cher aux troubadours : Que votre doux amour soit vers moi tourné / Car mon coeur est déjà plus noir qu'une mûre, lit-on dès le premier envoi. Ce qui fait délice, c'est la nomination de l'alternance : L'Amant, La Dame, L'Amant, La Dame, se répondent et nous suivons un ping-pong amoureux d'une fine délicatesse, un échange d'une stupéfiante modernité : Le dard d'amour qui, comme il se doit, / T'enverra des pensers / Pleins de désir, par divers sentiers, / Tantôt joyeux, tantôt douloureux... La ballade 20 (photo jointe) exprime une affirmation féministe de bon aloi. À laquelle la Dame ajoute, quelques pages plus loin, des vers à nos yeux définitifs : À rien ne sert de résister, / Amour est mon adversaire, / Je ne peux m'y soustraire. Car, il s'agit là, au détour de quelque strophe, d'une joute jouant sur le désir de l'autre : Car je ne veux que votre doux vouloir. / Votre volonté seule est la mienne... dit-il, tandis qu'elle semble, semble seulement, lâcher prise : Je suis vôtre, vous m'avez justement conquise, / Il n'est plus besoin que j'en sois requise, / Amour le veut; vous avez trouvé le chemin /Pour prendre mon coeur / Sans mauvaise ruse, par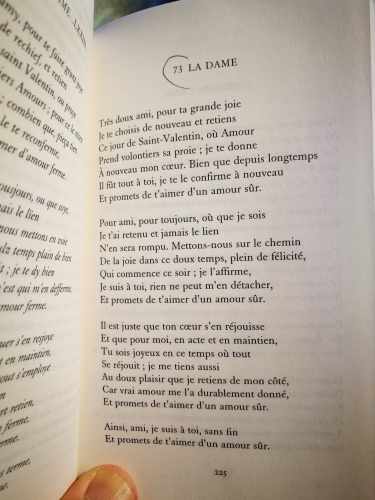 une très loyale quête. / Je le sais en vérité, je m'en suis bien enquise, / Et puisqu'il me plaît ainsi, en toute guise, / Du bien en résultera pour moi. Ce à quoi répond tardivement, et c'est agaçant, l'amant balourd mais lucide et d'une belle patience - à sa décharge, ainsi que d'une capacité à accepter les coups portés : Vrais amants courtois, sachez qu'il n'est dureté / Que de se séparer de sa dame et maîtresse. L'Amant se déclare, sans forfaiture aucune, comme étant un serviteur lige, et cela est d'une
une très loyale quête. / Je le sais en vérité, je m'en suis bien enquise, / Et puisqu'il me plaît ainsi, en toute guise, / Du bien en résultera pour moi. Ce à quoi répond tardivement, et c'est agaçant, l'amant balourd mais lucide et d'une belle patience - à sa décharge, ainsi que d'une capacité à accepter les coups portés : Vrais amants courtois, sachez qu'il n'est dureté / Que de se séparer de sa dame et maîtresse. L'Amant se déclare, sans forfaiture aucune, comme étant un serviteur lige, et cela est d'une 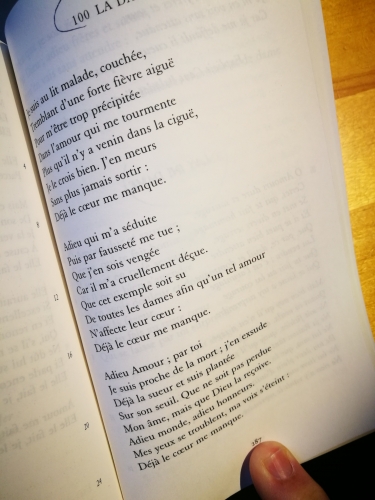
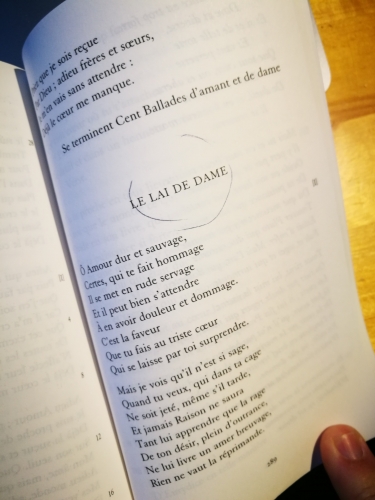 100, jointe), qu'une réalité va corroborer : Je m'y fiai : mon coeur se fend en deux / Car sa parole séduisante, trompeuse, / Et son maintien courtois et aimable / M'affirmaient qu'il disait vérité, / Et tel n'était le cas, c'est bien prouvé : / Il a déshérité mon coeur de la joie. Tout est déjà dit, là, sur la légendaire lâcheté masculine. Le cuir me part (Mon coeur se brise), déclare la Dame. Le lecteur est subjugué par tant de droiture sans ambages, de franchise intérieure sans détour. L.M.
100, jointe), qu'une réalité va corroborer : Je m'y fiai : mon coeur se fend en deux / Car sa parole séduisante, trompeuse, / Et son maintien courtois et aimable / M'affirmaient qu'il disait vérité, / Et tel n'était le cas, c'est bien prouvé : / Il a déshérité mon coeur de la joie. Tout est déjà dit, là, sur la légendaire lâcheté masculine. Le cuir me part (Mon coeur se brise), déclare la Dame. Le lecteur est subjugué par tant de droiture sans ambages, de franchise intérieure sans détour. L.M.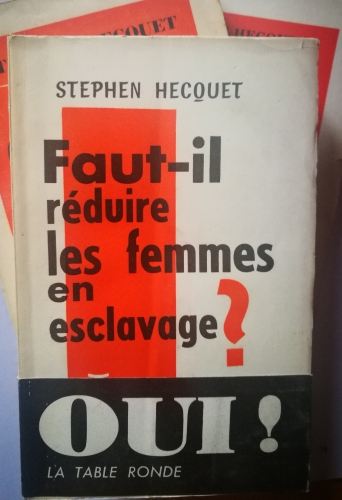
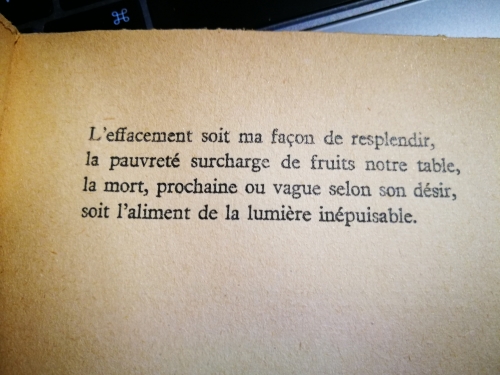
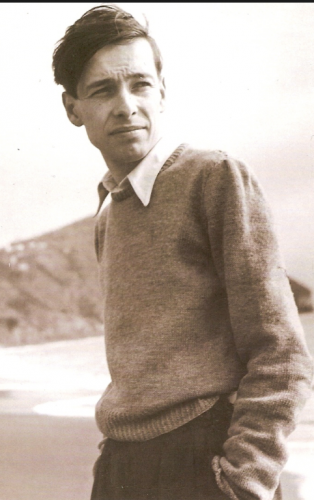 Mais la femme, les amis,
Mais la femme, les amis, 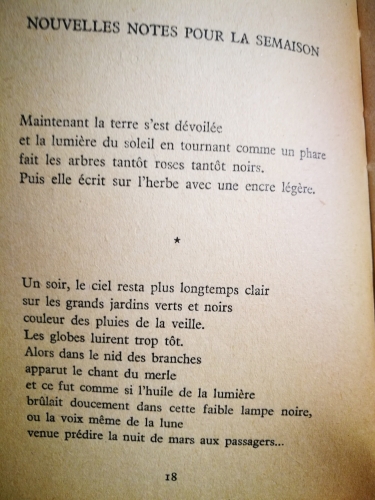
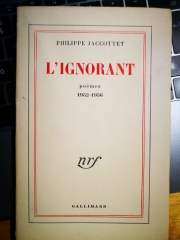 ... se trouvent dans L'Ignorant, recueil de poèmes datant de 1952 à 1956, paru en 1957 chez Gallimard, lu la première fois à l'âge de vingt ans, et toujours aussi galvanisant lorsque je le reprends. Extrait choisi parce que le chant du merle ivre d'amour berce mes jours depuis une paire de semaines, et que ces notes annoncent les futurs carnets de La Semaison. L.M.
... se trouvent dans L'Ignorant, recueil de poèmes datant de 1952 à 1956, paru en 1957 chez Gallimard, lu la première fois à l'âge de vingt ans, et toujours aussi galvanisant lorsque je le reprends. Extrait choisi parce que le chant du merle ivre d'amour berce mes jours depuis une paire de semaines, et que ces notes annoncent les futurs carnets de La Semaison. L.M.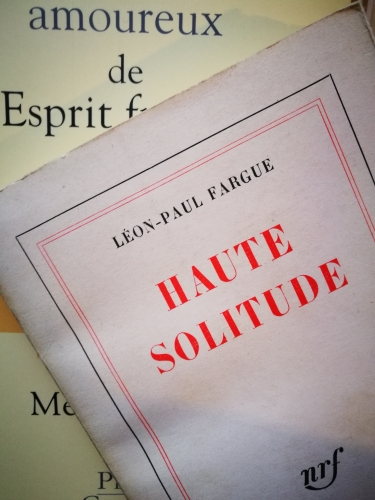
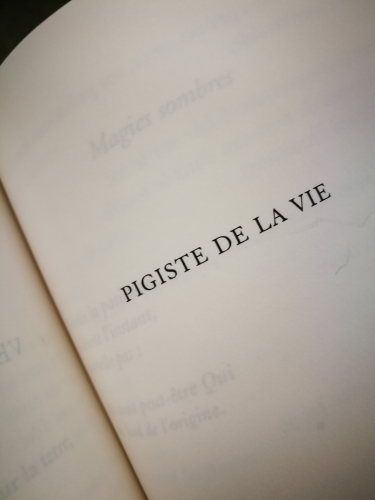
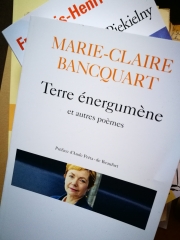
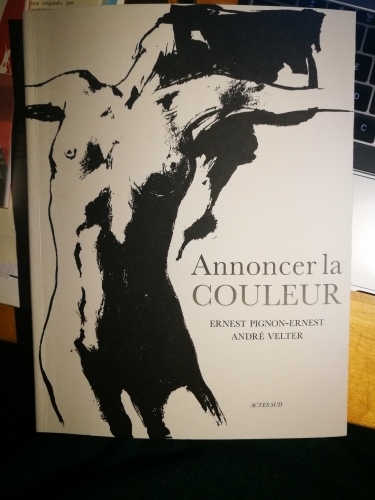 Ces deux-là n'en finissent pas -pour notre bonheur- de produire ensemble. On se souvient de Zingaro, suite équestre, plus récemment de
Ces deux-là n'en finissent pas -pour notre bonheur- de produire ensemble. On se souvient de Zingaro, suite équestre, plus récemment de 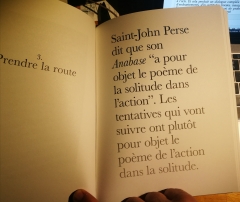 (Actes Sud, 29€) le nouvel album à deux mains ou plutôt à deux peaux car, lorsque nous évoquons la poésie, qu'elle soit écrite ou dessinée, il s'agit de sensibilité pure, donc de ce qui fait agir, soit du premier livre de l'homme (la peau, selon Valéry). André Velter, poète, et Ernest Pignon-Ernest, artiste, unissent leur talent respectif pour nous donner régulièrement des albums précieux parcourus d'hybridations évolutives. Car, comme l'écrit d'emblée Velter, la main pense,
(Actes Sud, 29€) le nouvel album à deux mains ou plutôt à deux peaux car, lorsque nous évoquons la poésie, qu'elle soit écrite ou dessinée, il s'agit de sensibilité pure, donc de ce qui fait agir, soit du premier livre de l'homme (la peau, selon Valéry). André Velter, poète, et Ernest Pignon-Ernest, artiste, unissent leur talent respectif pour nous donner régulièrement des albums précieux parcourus d'hybridations évolutives. Car, comme l'écrit d'emblée Velter, la main pense,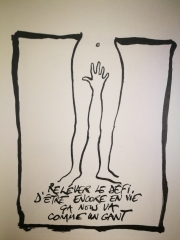
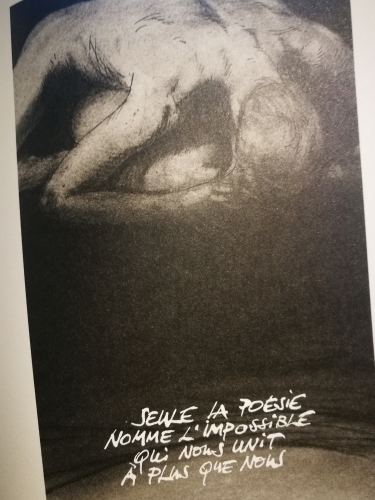
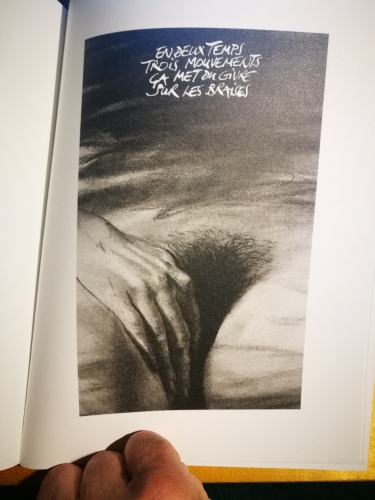
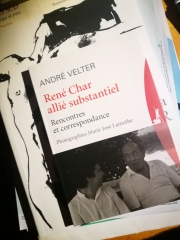 Je signale également René Char allié substantiel, d'André Velter - qui connut bien l'immense poète universel de l'Isle-sur-la-Sorgue (éd. Le Passeur, 16,90€) -, car il s'agit d'un échange épistolaire précieux pour l'auteur avec le maître, assorti de poèmes épars mais crus et denses, moelleux et corsés, et de photos certes redondantes, mais donnant à voir les regards, l'émotion peut-être, des mots que l'on devine, et que nous retrouvons dans les messages qu'André Velter retranscrit avec pudeur, en se gardant bien de voler la vedette dans cet échange jamais impudique. L.M.
Je signale également René Char allié substantiel, d'André Velter - qui connut bien l'immense poète universel de l'Isle-sur-la-Sorgue (éd. Le Passeur, 16,90€) -, car il s'agit d'un échange épistolaire précieux pour l'auteur avec le maître, assorti de poèmes épars mais crus et denses, moelleux et corsés, et de photos certes redondantes, mais donnant à voir les regards, l'émotion peut-être, des mots que l'on devine, et que nous retrouvons dans les messages qu'André Velter retranscrit avec pudeur, en se gardant bien de voler la vedette dans cet échange jamais impudique. L.M.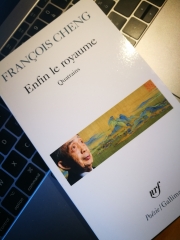
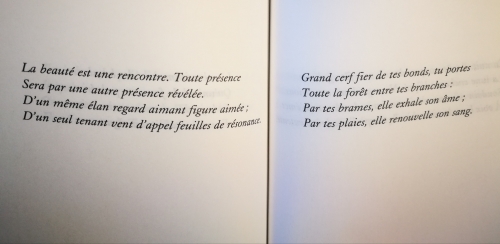
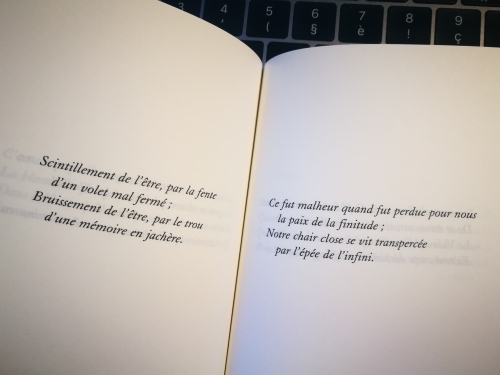
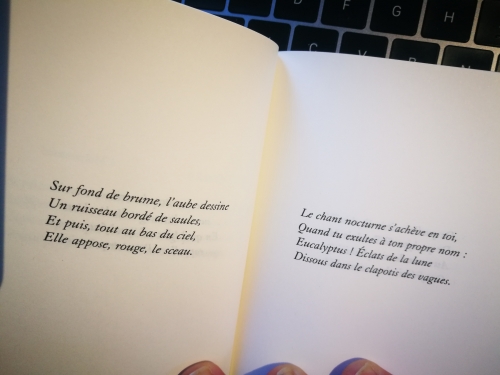

 Alliances
Alliances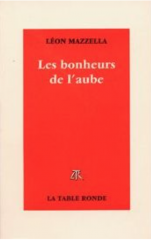 Je pensais l'avoir signalé ici, mais non. J'eus la surprise au coeur de l'été dernier de découvrir un papier élogieux et délicieusement tardif sur l'un de mes livres paru fin 2001 et qui, finaliste du Prix Goncourt de la Nouvelle, manqua cette distinction d'un cheveu. Le voici - il est signé Rita, blogueuse littéraire - et si cela vous incite, hâtez-vous, car le bouquin est en voie d'épuisement chez l'éditeur, lequel n'envisage pas de le réimprimer ou de le reprendre en format de poche dans La Petite Vermillon =>
Je pensais l'avoir signalé ici, mais non. J'eus la surprise au coeur de l'été dernier de découvrir un papier élogieux et délicieusement tardif sur l'un de mes livres paru fin 2001 et qui, finaliste du Prix Goncourt de la Nouvelle, manqua cette distinction d'un cheveu. Le voici - il est signé Rita, blogueuse littéraire - et si cela vous incite, hâtez-vous, car le bouquin est en voie d'épuisement chez l'éditeur, lequel n'envisage pas de le réimprimer ou de le reprendre en format de poche dans La Petite Vermillon =>