C’est parce que la première phrase d’un roman est courte qu’elle en dit long. Les phrases longues sont nombreuses aussi, mais elles ne possèdent ni le lapidaire, ni le dense. Le « fulgur ».
Faire court devrait être la règle…
Prenez « Le Voyage au bout de la nuit » : « Ca a débuté comme ça ». Tout Céline est déjà là, ramassé en cinq mots.
Avec Radiguet, la première phrase du « Diable au corps » résume à merveille la lecture à venir et jette le trouble en passant ; un rien perverse : « Je vais encourir bien des reproches ».
Les premières phrases sont parfois du littéraire pur : Tolstoï « Le silence s’est fait dans Moscou ».
Conrad « Il mesurait six pieds, à un pouce près, peut-être deux, était bâti avec force, et venait droit sur vous, les épaules légèrement voûtées, la tête en avant, avec un regard fixe jeté par en dessous qui vous faisait penser à un taureau prêt à charger ».
Stendhal « Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi, et d’apprendre au monde qu’après tant de siècles César et Alexandre avaient un successeur ».
Trois tons propres.
Il y a aussi l’essence de la littérature, peut-être : « Je me regarde souvent dans la glace » (L.R. des Forêts).
Et l’on regrette alors que la quatrième phrase du « Paludes » de Gide (une sotie certes, davantage qu’un roman au sens strict), ne soit pas la première : « Je répondis : J’écris Paludes ». Tout, absolument tout, est, ou serait, dit.
Et puis « ce-quelque-chose-d’essentiel », c’est le trait d’esprit : Erri de Luca « Le poisson n’est poisson qu’une fois dans la barque ». L’humour : Henry Roth « Debout devant l’évier de la cuisine, les yeux fixés sur les robinets de cuivre qui brillaient si loin de lui et sur la goutte d’eau pendue au bout de leur nez, qui grossissait lentement, puis tombait, David prit conscience une fois de plus que ce monde avait été créé sans tenir compte de lui ».
Blondin « Un matin sur deux, Quentin Albert descendait le Yang-tsé-kiang dans son lit-bateau : trois mille kilomètres jusqu’à l’estuaire, vingt-six jours de rivière quand on ne rencontrait pas les pirates, double ration d’alcool de riz si l’équipage indigène négligeait de se mutiner ».
La surprise mâtinée d’une touche de grossièreté : Vargas Llosa « Bordel de merde de vérole du cul ! balbutia Lituma en sentant qu’il allait vomir ».
Boyd « Mon premier acte en entrant dans ce monde fut de tuer ma mère ».
La force de l’envoi : Camus « Aujourd’hui, maman est morte ».
La sagacité de la formule : Fuentes « Il n’est pire servitude que l’espoir d’être heureux ».
L’aphorisme –de soie-, déguisé sous l’habit –d’une étoffe plus épaisse-, de la prose romanesque : Mishima « Pendant de nombreuses années, j’ai soutenu que je pouvais me rappeler des choses vues à l’époque de ma naissance ».
La beauté ample et l’affirmation –avec si peu pourtant-, d’une marque, d’un style propre : Gracq « Depuis que son train avait passé les faubourgs et les fumées de Charleville, il semblait à l’aspirant Grange que la laideur du monde se dissipait : il s’aperçut qu’il n’y avait plus en vue une seule maison ».
Garcia Marquez « L’année de mes quatre-vingt dix ans, j’ai voulu m’offrir une folle nuit d’amour avec une adolescente vierge ».
Il y a aussi la phrase étendard, celle que l’on chuchote entre soi et entre membres de la tribu : Mclean ! « Dans notre famille, nous ne faisons pas clairement le partage entre la religion et la pêche à la mouche ».
O’Brien, dans une moindre mesure « Dès mon plus jeune âge, j’ai été fasciné par la migration des animaux sauvages ».
L’intention romanesque ambitieuse aussi (charnelle, volubile, romantique, gourmande, généreuse, ampoulée par endroits), est contenue dans l’espace d’une première phrase de roman et, miracle, il arrive qu’elle parvienne à y tenir sans déborder : Cohen « Descendu de cheval, il allait le long des noisetiers et des églantiers, suivi des deux chevaux que le valet d’écurie tenait par les rênes, allait dans les craquements du silence, torse nu sous le soleil de midi, allait et souriait, étrange et princier, sûr d’une victoire ».
L’air connu, qu’il est si plaisant de reconnaître, n’est pas en reste avec Proust bien sûr (« Longtemps … »), ou Hemingway « Il était une fois un vieil homme, tout seul dans son bateau, qui pêchait au milieu du Gulf-Stream ».
Mais aussi avec Kafka « Un matin, au sortir d’un rêve agité, Grégoire Samra s’éveilla transformé dans son lit en une véritable vermine ».
Nizan « J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie ». A condition d’admettre cette exception : il y a là deux phrases. Mais elles sont insécables.
Cervantes « En un village de la Manche, du nom duquel je ne me veux souvenir, demeurait, il n’y a pas longtemps, un gentilhomme de ceux qui ont lance au ratelier, targe antique, roussin maigre et lévrier bon coureur ».
Flaubert « C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Halmicar ».
Nabokov « Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins ».
Eco « Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu ».
Ces phrases font quatre-vingt fois le tour du monde chaque jour. Elles sont, dans toutes les langues, sur les lèvres de tous les aficionados. Magie du passage littéraire !
La première phrase d’un roman possède la puissance fugitive du passeur.
Elle esquisse, incite, prend, lie, gifle ou plonge dans un fading ouaté. Elle n’est jamais désintéressée : elle entend bien dire.
De Zweig (« Sur le grand paquebot qui à minuit devait quitter New York à destination de Buenos-Aires, régnait le va-et-vient habituel du dernier moment »), à Grass (« Pour Noël, j’avais envie d’un rat, car j’espérais des mots déclencheurs pour un poème traitant de l’éducation du genre humain »), ou Aragon (« La première fois qu’Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide »), nous naviguons de la beauté narrative à l’idée sèche incrustée dans le style. Deux mondes. Trois phrases, trois auteurs parmi des milliers, trois romans, trois œuvres majeures.
Ainsi les premières phrases de romans (célèbres), deviennent un kaléidoscope, un florilège protéiforme, une bombe à rêves, un feu d’artifice parce que la littérature est ce qu’il y a de plus multicolore au monde.
L’immédiateté de la première phrase d’un roman confond. C’est d‘elle que l’on attend le plus.
Elle est le visage, le premier regard de la première rencontre.
Il est facile d’en tomber amoureux.
Elle peut être déterminante et agir aussi comme un repoussoir. Ce sont encore des invitations au voyage, qu’il soit réel ou métaphorique : Delibes « Le trois-mâts le Hamburg, une galacée à rame et à voile destinée au cabotage, à la ligne fine et d’une longueur de cinq aunes, dépassa lentement l’embouchure et s’élança vers la haute mer ».
Gary « Depuis l’aube, le chemin suivait la colline à travers un fouillis de bambous et d’herbe où le cheval et le cavalier disparaissaient parfois complètement ; puis la tête du jésuite réapparaissait sous son casque blanc, avec son grand nez osseux au-dessus des lèvres viriles et ironiques et les yeux perçants qui évoquaient bien plus des horizons illimités que les pages d’un bréviaire ».

Les premières phrases de romans sont des tickets d’entrée dans les œuvres. L’ouvreuse ne porte pas de guillemets car l’accès est libre.
Ici, j’ai seulement voulu vous livrer au jeu des devinettes : quels sont les romans qui commencent comme çà ? Ne trichez pas. Relisez et jouez. La littérature, c’est ludique, aussi.



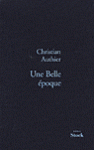 Le quatrième roman de Christian Authier, Une Belle époque, (lire la note intitulée Province, publiée le 26 août), possède l’épaisseur, le corps tranquille et l’amplitude des livres de la maturité, comme on dit dans les feuilles littéraires. Authier sait construire un roman de 300 pages qui alterne le récit des péripéties politico-humanitaires, légères, d’une bande de potes, tous anciens de Sciences-Po Toulouse, dans les années quatre-vingt-dix, jusqu’aux élections de 95 (la machine politique, véreuse, et le clan Baudis en particulier, sont ici laminés en règle), la peinture ironique d'une droite qui essaya de devenir la plus sympa après avoir été la plus bête du monde, et une histoire d’amour avec une Clémence au charme envoûtant. Sans oublier de traiter au vitriol La Dépêche du Midi (à peine déguisée en Gazette) et le passé nauséabond de la famille qui possède encore le journal toulousain. Je serais d’ailleurs curieux de connaître les provisions pour procès de Stock, son éditeur. Authier détruit avec humour les suffisants, les parvenus de l'économie locale, les emperlousées des cocktails de préfecture, comme Muriel Barbéry a su le faire dans les cent premières pages de son élégant Hérisson. Authier y ajoute une distance qui est la marque des auteurs de fond. Ceux qui savent être sans concession, y compris avec eux-mêmes. Qui n'ont pas besoin de décrire le tragique des événements pour que nous le ressentions jusqu'à la moelle, avec le recours, simple à première vue, au verbe rare, à l’adjectif pudique, à la phrase courte et néanmoins souple : il faut parfois sacrifier à la tentation littéraire authentique, qui est de dire ces choses réputées indicibles que le lecteur a déjà vécues. La mélancolie d’Authier navigue au plus près du fil de l’eau lorsqu’il décrit Clémence, dont « la fraîcheur me ramenait vers ces contrées où l’impatience se marie à la langueur et à l’assurance qu’un soleil de printemps réchauffera toujours l’eau froide des grands âges ». Page 248, la jeune femme devient une déesse. L'image de la vérité, qui ne dure jamais. Rappelle que tout le reste n'est pas littérature. Authier, qui ne lâche son lecteur qu'à la dernière ligne, l'étreint avec la ceinture de l’émotion, par touches, à pas de loup, vers ce plaisir étrange que l’on dit textuel. Une réussite.
Le quatrième roman de Christian Authier, Une Belle époque, (lire la note intitulée Province, publiée le 26 août), possède l’épaisseur, le corps tranquille et l’amplitude des livres de la maturité, comme on dit dans les feuilles littéraires. Authier sait construire un roman de 300 pages qui alterne le récit des péripéties politico-humanitaires, légères, d’une bande de potes, tous anciens de Sciences-Po Toulouse, dans les années quatre-vingt-dix, jusqu’aux élections de 95 (la machine politique, véreuse, et le clan Baudis en particulier, sont ici laminés en règle), la peinture ironique d'une droite qui essaya de devenir la plus sympa après avoir été la plus bête du monde, et une histoire d’amour avec une Clémence au charme envoûtant. Sans oublier de traiter au vitriol La Dépêche du Midi (à peine déguisée en Gazette) et le passé nauséabond de la famille qui possède encore le journal toulousain. Je serais d’ailleurs curieux de connaître les provisions pour procès de Stock, son éditeur. Authier détruit avec humour les suffisants, les parvenus de l'économie locale, les emperlousées des cocktails de préfecture, comme Muriel Barbéry a su le faire dans les cent premières pages de son élégant Hérisson. Authier y ajoute une distance qui est la marque des auteurs de fond. Ceux qui savent être sans concession, y compris avec eux-mêmes. Qui n'ont pas besoin de décrire le tragique des événements pour que nous le ressentions jusqu'à la moelle, avec le recours, simple à première vue, au verbe rare, à l’adjectif pudique, à la phrase courte et néanmoins souple : il faut parfois sacrifier à la tentation littéraire authentique, qui est de dire ces choses réputées indicibles que le lecteur a déjà vécues. La mélancolie d’Authier navigue au plus près du fil de l’eau lorsqu’il décrit Clémence, dont « la fraîcheur me ramenait vers ces contrées où l’impatience se marie à la langueur et à l’assurance qu’un soleil de printemps réchauffera toujours l’eau froide des grands âges ». Page 248, la jeune femme devient une déesse. L'image de la vérité, qui ne dure jamais. Rappelle que tout le reste n'est pas littérature. Authier, qui ne lâche son lecteur qu'à la dernière ligne, l'étreint avec la ceinture de l’émotion, par touches, à pas de loup, vers ce plaisir étrange que l’on dit textuel. Une réussite.
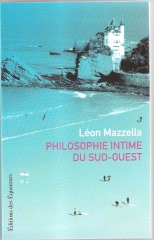











 Sauf peut-être... -mais je l'ai à peine entamé, dans Le Canapé rouge de Michèle Lesbre (éd. Sabine Wespieser) : p.16, déjà : "Je savais que le véritable voyage se fait au retour, quand il inonde les jours d'après au point de donner cette sensation prolongée d'égarement d'un temps à un autre, d'un espace à un autre."
Sauf peut-être... -mais je l'ai à peine entamé, dans Le Canapé rouge de Michèle Lesbre (éd. Sabine Wespieser) : p.16, déjà : "Je savais que le véritable voyage se fait au retour, quand il inonde les jours d'après au point de donner cette sensation prolongée d'égarement d'un temps à un autre, d'un espace à un autre."
 Retour en terre
Retour en terre Il y a des textes de 4ème de couverture qui donnent immédiatement envie d'entrer dans le livre qu'elles résument. Celui-ci par exemple Philosophie de la corrida, qui paraît chez Fayard :
Il y a des textes de 4ème de couverture qui donnent immédiatement envie d'entrer dans le livre qu'elles résument. Celui-ci par exemple Philosophie de la corrida, qui paraît chez Fayard : A la faveur d'un hors-série "Rugby" que je conconcte entièrement en ce moment (Coupe du Monde oblige) pour VSD, je relis Antoine Blondin avec un bonheur intact. Les enfants du bon Dieu, par exemple. C'est son second roman et il reparaît cette semaine dans La Petite Vermillon, la collection de poche de La Table ronde. Alain Cresciucci, biographe de Blondin, rappelle ceci dans sa préface, à propos de la petite musique d'Antoine : Roger Nimier parlait de "blondinisme" dont il avait tiré le verbe "blondiner" : "Façon d'entrer dans le monde en utilisant son coeur comme ouvre-boîte". Voici de quoi faire chavirer les plus rétifs et tous ceux qui ne sont encore jamais entrés chez Monsieur Jadis, qui n'ont jamais aperçu Un Singe en hiver, mais qui possèdent une Humeur vagabonde... J'en profite pour signaler (également dans la Petite Vermillon) la reprise du premier livre de mon ami Olivier Frébourg : Roger Nimier, trafiquant d'insolence. C'est brillant, nerveux, ça claque. C'est de la vitamine effervescente.
A la faveur d'un hors-série "Rugby" que je conconcte entièrement en ce moment (Coupe du Monde oblige) pour VSD, je relis Antoine Blondin avec un bonheur intact. Les enfants du bon Dieu, par exemple. C'est son second roman et il reparaît cette semaine dans La Petite Vermillon, la collection de poche de La Table ronde. Alain Cresciucci, biographe de Blondin, rappelle ceci dans sa préface, à propos de la petite musique d'Antoine : Roger Nimier parlait de "blondinisme" dont il avait tiré le verbe "blondiner" : "Façon d'entrer dans le monde en utilisant son coeur comme ouvre-boîte". Voici de quoi faire chavirer les plus rétifs et tous ceux qui ne sont encore jamais entrés chez Monsieur Jadis, qui n'ont jamais aperçu Un Singe en hiver, mais qui possèdent une Humeur vagabonde... J'en profite pour signaler (également dans la Petite Vermillon) la reprise du premier livre de mon ami Olivier Frébourg : Roger Nimier, trafiquant d'insolence. C'est brillant, nerveux, ça claque. C'est de la vitamine effervescente. Marqué par le message d’Héraclite et par celui d’Hölderlin, Char se situe dans la filiation directe de ces grands voyants. Poète solaire, de l’éclair et du fragment, de « la radicalité de la nuance » (l’expression est de son ami Albert Camus), René Char est aujourd’hui fêté comme l’immense poète qu’il est. Aimé passionnément, plébiscité, lu par de plus en plus de jeunes, la poésie de Char a même inspiré au moins deux générations de poètes, dont une a déjà pris sa retraite. Car le plus difficile peut-être, lorsqu’on entretient un commerce avec la poésie morale de Char, avec ses aphorismes parfois abscons, ses déclarations fulgurantes –derrière lesquelles il nous semble chaque fois entendre sa voix forte à l’accent provençal-, soit avec l’essentiel des poèmes qui composent ses recueils majeurs : Fureur et mystère, Les Matinaux, La Parole en archipel, Le Nu perdu, Recherche de la base et du sommet, c’est de savoir se débarrasser progressivement de Char, dont l’influence est tentaculaire. Char envoûte. Char nous dure. Ils sont nombreux à être tentés de faire de sa poésie, non seulement un oeuvre de chevet, mais un bréviaire pour chaque matin qui se lève. Un compagnon de route. Un viatique. Un allié substantiel… Citer Char peut devenir une manie. Il en existe de pires. Mais, à la manière d’un conseil à un jeune poète, j’ai envie de chuchoter que le danger est alors de se trouver sous emprise. Il faut, à la fin, se garder de Char...
Marqué par le message d’Héraclite et par celui d’Hölderlin, Char se situe dans la filiation directe de ces grands voyants. Poète solaire, de l’éclair et du fragment, de « la radicalité de la nuance » (l’expression est de son ami Albert Camus), René Char est aujourd’hui fêté comme l’immense poète qu’il est. Aimé passionnément, plébiscité, lu par de plus en plus de jeunes, la poésie de Char a même inspiré au moins deux générations de poètes, dont une a déjà pris sa retraite. Car le plus difficile peut-être, lorsqu’on entretient un commerce avec la poésie morale de Char, avec ses aphorismes parfois abscons, ses déclarations fulgurantes –derrière lesquelles il nous semble chaque fois entendre sa voix forte à l’accent provençal-, soit avec l’essentiel des poèmes qui composent ses recueils majeurs : Fureur et mystère, Les Matinaux, La Parole en archipel, Le Nu perdu, Recherche de la base et du sommet, c’est de savoir se débarrasser progressivement de Char, dont l’influence est tentaculaire. Char envoûte. Char nous dure. Ils sont nombreux à être tentés de faire de sa poésie, non seulement un oeuvre de chevet, mais un bréviaire pour chaque matin qui se lève. Un compagnon de route. Un viatique. Un allié substantiel… Citer Char peut devenir une manie. Il en existe de pires. Mais, à la manière d’un conseil à un jeune poète, j’ai envie de chuchoter que le danger est alors de se trouver sous emprise. Il faut, à la fin, se garder de Char... connu Char, André Velter, publie une édition exceptionnellement belle, précieuse, de Lettera amorosa (enluminée par Georges Braque et Jean Arp). Il s’agit sans doute du plus beau poème d’amour en prose française du XX ème siècle (avec Prose pour l’étrangère, de Julien Gracq). Lettera amorosa devrait être à l’authentique poésie de l’amour pur, ce que Belle du seigneur est devenue au fil des ans, pour le roman de l’amour fou : le cadeau idéal à faire à celle ou celui que l’on aime. C’est en tout cas tout le « mal » que je souhaite à ce magnifique petit livre bleu. De même que je souhaite à tous ceux que l’environnement et l’esprit de l’œuvre de Char intéressent (Char est en effet indissociable des amitiés nombreuses qu’il noua avec les peintres qui comptent le plus aujourd’hui), de plonger dans le magnifique album que Marie-Claude Char donne à Flammarion : Pays de René Char. L’épouse du poète de l’Isle-sur-la-Sorgue n’a de cesse d’œuvrer au rayonnement de cette œuvre capitale, et qui ne fait que grandir, depuis la disparition de son auteur en février 1988. Ce nouvel ouvrage de Madame Char, d’une très haute tenue, nous fait pénétrer l’intimité du monde de René Char. Aux Busclats, à Paris, en Alsace, ailleurs, en famille, en compagnie d’amis : résistants, compagnons de son village, artisans, peintres célèbres : Gaspérine, Braque, Giacometti, Staël, écrivains et poètes : Camus, Eluard, Dupin, compagnons de route artistique comme les époux Zervos. Tant d’autres personnages admirables, inconnus ou célèbres, ayant fait du chemin avec, à Céreste notamment, ayant vécu la simplicité des jours, l’importance de l’art, le sérieux –ou l’impérieuse nécessité plutôt-, de la poésie, en commune présence avec le poète. « Partout en son Pays : la poésie », souligne Marie-Claude Char. Un ouvrage de référence paraît. Char est splendidement fêté. L.M.
connu Char, André Velter, publie une édition exceptionnellement belle, précieuse, de Lettera amorosa (enluminée par Georges Braque et Jean Arp). Il s’agit sans doute du plus beau poème d’amour en prose française du XX ème siècle (avec Prose pour l’étrangère, de Julien Gracq). Lettera amorosa devrait être à l’authentique poésie de l’amour pur, ce que Belle du seigneur est devenue au fil des ans, pour le roman de l’amour fou : le cadeau idéal à faire à celle ou celui que l’on aime. C’est en tout cas tout le « mal » que je souhaite à ce magnifique petit livre bleu. De même que je souhaite à tous ceux que l’environnement et l’esprit de l’œuvre de Char intéressent (Char est en effet indissociable des amitiés nombreuses qu’il noua avec les peintres qui comptent le plus aujourd’hui), de plonger dans le magnifique album que Marie-Claude Char donne à Flammarion : Pays de René Char. L’épouse du poète de l’Isle-sur-la-Sorgue n’a de cesse d’œuvrer au rayonnement de cette œuvre capitale, et qui ne fait que grandir, depuis la disparition de son auteur en février 1988. Ce nouvel ouvrage de Madame Char, d’une très haute tenue, nous fait pénétrer l’intimité du monde de René Char. Aux Busclats, à Paris, en Alsace, ailleurs, en famille, en compagnie d’amis : résistants, compagnons de son village, artisans, peintres célèbres : Gaspérine, Braque, Giacometti, Staël, écrivains et poètes : Camus, Eluard, Dupin, compagnons de route artistique comme les époux Zervos. Tant d’autres personnages admirables, inconnus ou célèbres, ayant fait du chemin avec, à Céreste notamment, ayant vécu la simplicité des jours, l’importance de l’art, le sérieux –ou l’impérieuse nécessité plutôt-, de la poésie, en commune présence avec le poète. « Partout en son Pays : la poésie », souligne Marie-Claude Char. Un ouvrage de référence paraît. Char est splendidement fêté. L.M. "Sur toute chose la neige a posé une nappe de silence.
"Sur toute chose la neige a posé une nappe de silence. Le dernier roman de Philippe Besson, Se résoudre aux adieux (Julliard), est un bijou de tact, de retenue, de clairvoyance psychologique, et d'analyse d'une rupture. Besson a choisi le roman épistolaire à une voix (elle lui adresse des lettres auxquelles il ne répond pas), pour dire une douleur et un silence, une fuite et une remontée à la surface de la vie, et cela permet au texte d'être plus bouleversant encore. Une réussite, en somme, sur un sujet affreusement banal, donc délicat à traiter.
Le dernier roman de Philippe Besson, Se résoudre aux adieux (Julliard), est un bijou de tact, de retenue, de clairvoyance psychologique, et d'analyse d'une rupture. Besson a choisi le roman épistolaire à une voix (elle lui adresse des lettres auxquelles il ne répond pas), pour dire une douleur et un silence, une fuite et une remontée à la surface de la vie, et cela permet au texte d'être plus bouleversant encore. Une réussite, en somme, sur un sujet affreusement banal, donc délicat à traiter. Mon père m'aurait fait ce cadeau à Noël. Je suis allé me l'offrir à sa place, cet après-midi. Les poésies complètes de Federico Garcia Lorca en Pléiade. Sans attendre. Noël n'existe pas. Ou plus de la même manière.
Mon père m'aurait fait ce cadeau à Noël. Je suis allé me l'offrir à sa place, cet après-midi. Les poésies complètes de Federico Garcia Lorca en Pléiade. Sans attendre. Noël n'existe pas. Ou plus de la même manière. ...La phrase de Margaret Atwood citée par Jonathan Littell (auteur des Bienveillantes), dans l'entretien qu'il a accordé au Monde :
...La phrase de Margaret Atwood citée par Jonathan Littell (auteur des Bienveillantes), dans l'entretien qu'il a accordé au Monde : Michel Onfray, dont je vous invite à lire le magnifique dernier opus, "La puissance d'exister. Manifeste hédoniste" (Grasset), écrit ceci, à la fin de son émouvante préface en forme d'aveu tranquille, intitulée "Autoportrait à l'enfant" :
Michel Onfray, dont je vous invite à lire le magnifique dernier opus, "La puissance d'exister. Manifeste hédoniste" (Grasset), écrit ceci, à la fin de son émouvante préface en forme d'aveu tranquille, intitulée "Autoportrait à l'enfant" : Bon, d'accord, nous sommes des dizaines de milliers de fans. Mais moi je viens de vous rejoindre! Bonjour le retard. "Dans les bois éternels" m'a scotché de plaisir. Je viens d'avaler "L'homme à l'envers", je commence à dévorer "Pars vite et reviens tard", et j'ai, en attente, sur la table de chevet, "Un peu plus loin sur la droite" et "Sans feu ni lieu". Après, je piquerai "Debout les morts", offert à mon fils, qui a aimé immédiatement. Bonjour l'avance!
Bon, d'accord, nous sommes des dizaines de milliers de fans. Mais moi je viens de vous rejoindre! Bonjour le retard. "Dans les bois éternels" m'a scotché de plaisir. Je viens d'avaler "L'homme à l'envers", je commence à dévorer "Pars vite et reviens tard", et j'ai, en attente, sur la table de chevet, "Un peu plus loin sur la droite" et "Sans feu ni lieu". Après, je piquerai "Debout les morts", offert à mon fils, qui a aimé immédiatement. Bonjour l'avance!
 Femmes de soie et autres oiseaux de passage, un beau bouquin de poésie de 200 pages, rehaussé d'un dessin de Francine Van Hove, est l'anthologie de mes meilleurs poèmes publiés en plaquettes -et inédits pour la plupart, depuis vingt ans et des poussières. Ils sont tous dédiés à LA femme. Séguier, son éditeur depuis décembre 1999, ne l'exploîtera plus. J'ai acquis ses derniers exemplaires. Je les cède, ici, pour 12€ port compris. Sommaire : Femmes de soie, Désert provisoire, L'ortie, L'aube, Nuit siamoise, L'harfang, L'oiseau, Chair et feu, Corrida, Azka...
Femmes de soie et autres oiseaux de passage, un beau bouquin de poésie de 200 pages, rehaussé d'un dessin de Francine Van Hove, est l'anthologie de mes meilleurs poèmes publiés en plaquettes -et inédits pour la plupart, depuis vingt ans et des poussières. Ils sont tous dédiés à LA femme. Séguier, son éditeur depuis décembre 1999, ne l'exploîtera plus. J'ai acquis ses derniers exemplaires. Je les cède, ici, pour 12€ port compris. Sommaire : Femmes de soie, Désert provisoire, L'ortie, L'aube, Nuit siamoise, L'harfang, L'oiseau, Chair et feu, Corrida, Azka... Achetez ce livre, ses droits sont reversés à l'association "Vaincre le cancer".
Achetez ce livre, ses droits sont reversés à l'association "Vaincre le cancer".




 « J’aimerais que ma vie ne laissât pas après elle d’autre murmure que celui d’une chanson de guetteur,
« J’aimerais que ma vie ne laissât pas après elle d’autre murmure que celui d’une chanson de guetteur,
 Les premières phrases de romans sont des tickets d’entrée dans les œuvres. L’ouvreuse ne porte pas de guillemets car l’accès est libre.
Les premières phrases de romans sont des tickets d’entrée dans les œuvres. L’ouvreuse ne porte pas de guillemets car l’accès est libre.