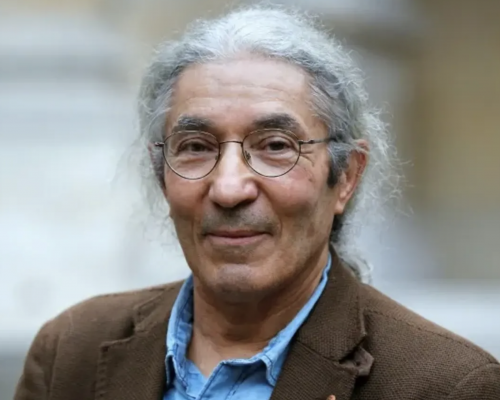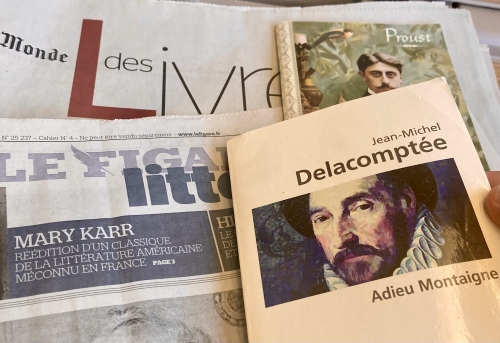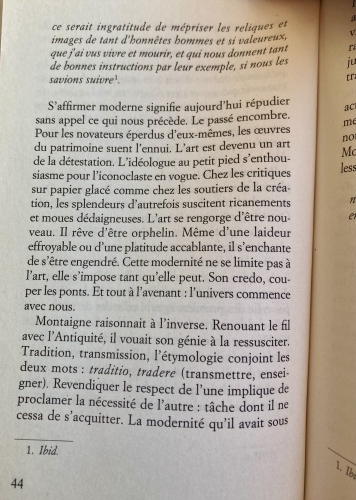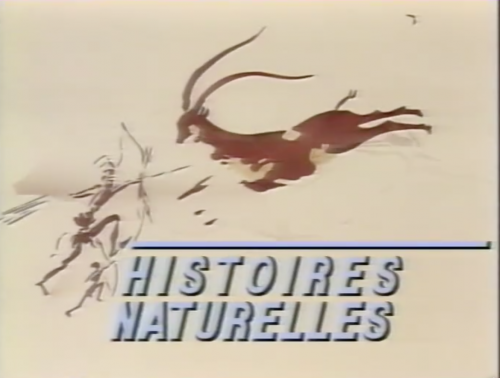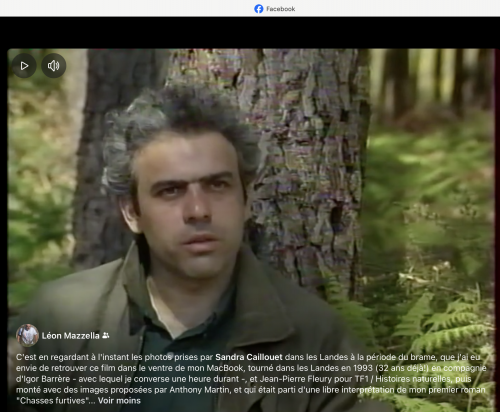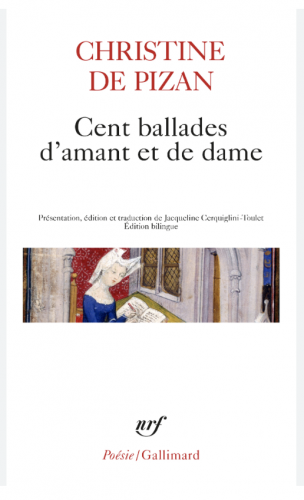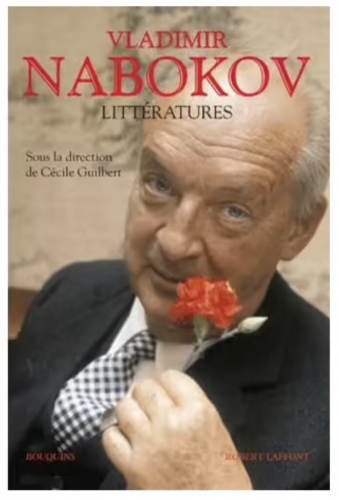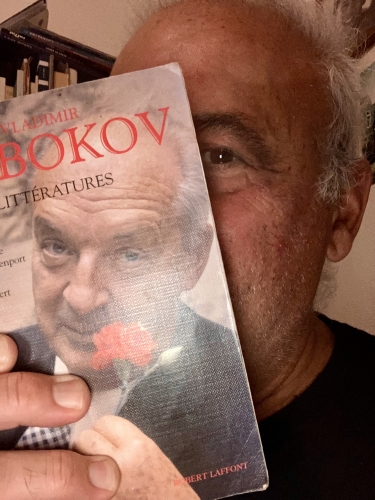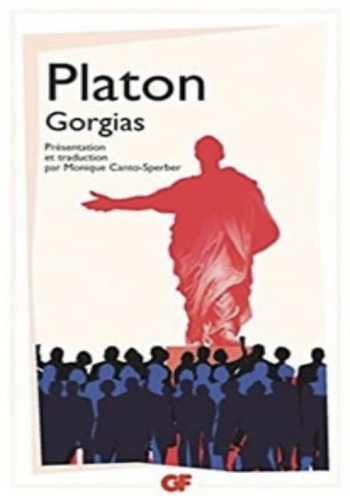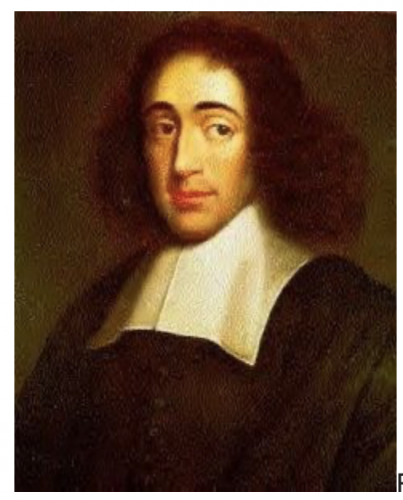Cela pourrait rester goffmanien - pour parler comme les étudiants en ethno -, en référence aux travaux célèbres d'Erving Goffman * sur les comportements sociaux. La littérature peut mieux faire et c'est l'une de ses vertus.
La scène se passe à la plage de la Petite Chambre d'Amour. Plus exactement sur le parapet qui la surplombe. L'océan est agité, la marée haute et rebelle. Les vagues frappent les blocs de pierre extraits de la montagne proche, empilés là pour amoindrir l'ardeur de la mer qui érode la côte.
Un homme de petite taille, vêtu pauvrement mais avec soin : veste bleue élimée, pantalon assorti, chemise blanche à col "pelle à tarte" ouvert généreusement sur un poitrail plat, imberbe et maigre. Physique sec. Comme le sont sans doute ses gestes, et comme sa diction doit être : sèche. Rêche et abrupte. Par rafales, cet homme doit parler.
Il tire sur une Gitane maïs plus qu'il ne la fume. Il est debout sur le parapet que les vagues menacent d'éclabousser d'un instant, l'autre.
Les séries de vagues frappent, toujours plus menacantes.
Le petit homme regarde l'horizon; impassible.
Avec, en plus, cet air d'écouter les éléments comme on entend sans l'écouter, un bavard anonyme et aviné au comptoir d'un bar. Sans prendre la peine de répondre à ses questions enchaînées et qui n'attendent d'ailleurs aucune réponse, mais seulement une approbation automatique.
Sans affect apparent, quoi.
Soudain, une vague plus forte que les autres explose, gicle et inonde le petit homme debout sur le parapet.
Le douche.
Au lieu de s'exclamer et de reculer, l'homme "sec" ne bouge pas. Trempé, stoïque, il continue de tirer sur ce qui reste de sa Gitane imbibée. L'eau dégouline de ses cheveux jusqu'à ses pieds. Le regard des passants alentour, témoins de ce qui lui arrive, le paralyse plus sûrement qu'une injection d'anésthésiant.
Cet homme foudroyé est en train de vivre l'un des moments les plus douloureux de sa vie.
Il regarde l'horizon. Imperturbable perturbé jusqu'aux os de l'âme.
Je partage sa douleur profonde du mieux que je peux. A distance. Impuissant. Juste témoin.
A l'heure où j'écris cette scène (30 octobre 2006, 23h45), l'homme ne se trouve plus sur ce parapet de La Chambre d'Amour.
Et pour cause. Cette scène s'est passée il y a trente ans environ. Mais il m'a semblé capable de rester là l'éternité, tant je devinais son désir double de devenir invisible, ou bien d'être changé en statue.
Ce récit (envie de l'écrire enfin, ce soir), est une espèce de stèle en souvenir d'une scène quotidienne, ordinaire, excepté dans la Creuse, le Quercy, et autres lieux où l'Océan, de notoriété publique et donc largement admise, ne vient jamais frapper les parapets. Mais alors, jamais... L.M.
---
* Sociologue canadien (1922-1982) que nous étudions à Sciences-Po, surtout son livre intitulé La mise en scène de la vie quotidienne (Minuit).