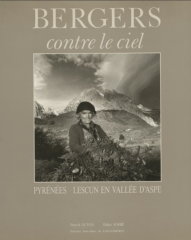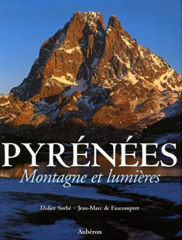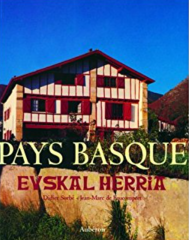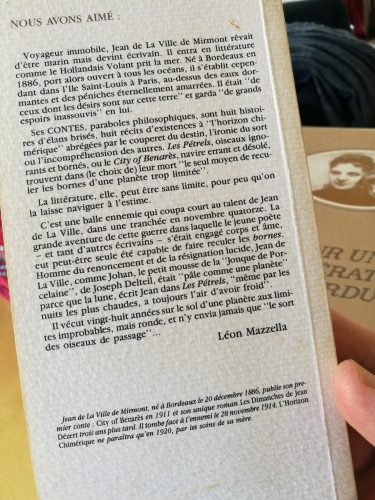le cul de bobo
Voici l'une des quatre nouvelles affiches tordantes signées Michel Tolmer, en vente 12€ chacune (30x40) sur le site de glougueule (pour les hommes de glou!). Avec glougueule, l'art de l'autodérision coule de source. L.M.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Voici l'une des quatre nouvelles affiches tordantes signées Michel Tolmer, en vente 12€ chacune (30x40) sur le site de glougueule (pour les hommes de glou!). Avec glougueule, l'art de l'autodérision coule de source. L.M.


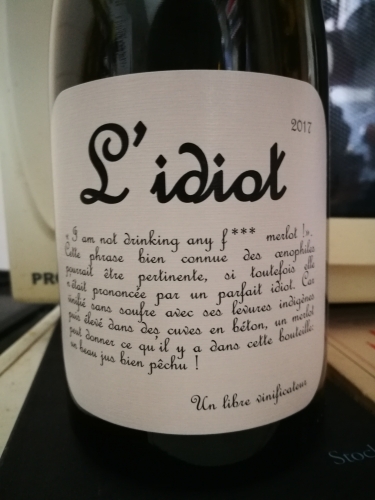 Ce domaine audois, dirigé depuis 2010 par le couple Stéphanie Maurel et Olivier Ramé (130 ha), a un pied dans l’AOC Cabardès et un autre en IGP Pays d’OC.
Ce domaine audois, dirigé depuis 2010 par le couple Stéphanie Maurel et Olivier Ramé (130 ha), a un pied dans l’AOC Cabardès et un autre en IGP Pays d’OC.
Il propose quatre nouveautés parmi ses micro-cuvées (de 2 500 à 6 000 bouteilles) baptisées « Les Dissidents » : Paul, Candide, et « Les Païens » : Le Paria et L’idiot.
Trois rouges et un blanc, volontairement déclassés en « Vin de France » afin de s’amuser davantage avec les cépages, en vigneron anticonformiste et expérimental.
Olivier Ramé aime les vins « sans maquillage, vibrants, tendus, témoins de leur endroit ».
Paul 2016 (100% cabernet franc, élevé en jarres de terre cuite de 125 l) se définit comme une cuvée de tendresse à l’instar de celle que des parents prodiguent à leur enfant. C’est en effet frais et concentré, tendu même, avec un beau nez de cassis, légèrement mentholé, et pourvu d’une jolie longueur (18€).
Candide 2017 (100% chenin, vieilli en foudre de 20 hl) est un blanc vivifiant et bien présent en bouche. Ample, avec de la chair, mais aussi légèrement minéral et augmenté d’une pointe subtile de salinité (18€).
Le Paria 2017 (100% grenache, vinifié en cuve béton), est un « Païen » (60 000 cols pour cette gamme moins confidentielle), soit un vrai vin de copains des fins d’après-midi d’été : gourmand, friand, juteux, fruité à souhait, soit sans chichis – il appelle la charcuterie et les rires (9€).
L’idiot 2017 (100% merlot) : sans soufre, levures indigènes, cuves en béton, n’est pas un vin dostoïevskien, mais plus modestement un jus de merlot qui « envoie » du croquant et de la fraîcheur à gogo. Joli nez de fruits noirs, bouche longue et complexe. Allumez le barbecue et envoyez les côtelettes ! (9€). L.M.

Deux nouvelles cuvées en édition limitée (30 000 bouteilles, dont 2/3 en rouge) au domaine Gayda (sis dans l’Aude) : « En Passant », rouge (80% syrah, 20% cinsault) et blanc (70% macabeu, 30% viognier). Deux vins légers et sans autre prétention que celle de désaltérer sans prendre le chou. Les vignes dont ils sont issus proviennent du Roussillon et du Minervois. Gourmandise, fraîcheur, et simplicité sont au rendez-vous dans les deux couleurs.
fraîcheur, et simplicité sont au rendez-vous dans les deux couleurs.
Inspirée de « The Passenger », hymne rock d’Iggy Pop, cette paire nomade signe des vins de soif à vocation éphémère, car Gayda se livrera chaque année à ce type d’essais dans son « labo » à l’esprit aventurier plus qu’expérimental.
9€ la bouteille, en rouge ou en blanc.
L.M.
 Château Cos Labory est un Saint-Estèphe (5è Cru Classé en 1855) comme on les aime : corpulent mais pas bodybuildé, gentleman-writer davantage que farmer. Distingué, opulent, bien présent en bouche, à la suite d'un nez d'une finesse remarquable, il représente une espèce de synthèse médocaine, car c'est équilibré et possède souvent le ton (soit le goût) juste, précis, ciselé même.
Château Cos Labory est un Saint-Estèphe (5è Cru Classé en 1855) comme on les aime : corpulent mais pas bodybuildé, gentleman-writer davantage que farmer. Distingué, opulent, bien présent en bouche, à la suite d'un nez d'une finesse remarquable, il représente une espèce de synthèse médocaine, car c'est équilibré et possède souvent le ton (soit le goût) juste, précis, ciselé même.
Propriété familiale de 18 ha sise sur la colline de Cos, le domaine jouit d'un sous-sol de graves quaternaires des plus accortes. Bernard Audoy dirige ce beau terroir dont on prétend que c'est la meilleure croupe du coin...
Cos Labory 2012 (40% merlot, 60% cabernet-sauvignon) est suave, son nez vif, de fruits rouges et noirs de sous-bois, est persistant. Belle longueur en bouche également. Un vin charmeur (30€).
Cos Labory 2011 (39% de merlot), élevé dans des fûts neufs pour moitié, est très Saint-Estèphe, soit souple et puissant à la fois. Plus terrien que le précédent, il présente un peu d'épices douces en bouche et des saveurs boisées d'arrière-automne au nez. Un vin sincère (32€).
 Côté second vin (30% de la production totale, laquelle est de 100 000 bouteilles), Charme de Cos 2015 (un peu moins de merlot que de cabernet-sauvignon) est encore un peu rugueux, les tanins fondront bientôt. Il convient de l'attendre. (16€).
Côté second vin (30% de la production totale, laquelle est de 100 000 bouteilles), Charme de Cos 2015 (un peu moins de merlot que de cabernet-sauvignon) est encore un peu rugueux, les tanins fondront bientôt. Il convient de l'attendre. (16€).
Tandis que Charme de Cos 2012 (28% de merlot) offre une belle gourmandise en bouche. C'est friand de bout en bout (15€).
Ces vins ont été dégustés - notamment - sur une belle selle d'agneau préparée par Mathieu Pacaud, du restaurant Apicius (Paris 8è), table qu'il possède depuis peu (à la suite de Jean-Pierre Vigato). L.M.

Plaimont (AOC Saint-Mont), exemplaire « cave coop’ », offre un nouveau rosé estival plein de franchise et qui ne se la joue pas « modeux ». Les Bastions 2017 possède une robe claire sans être diaphane, voire translucide. Pas de clientélisme outrancier, en terre gersoise. Cela est issu de Tannat, Cabernet-Sauvignon et Pinenc pour la couleur locale. Le nez est frais, les fruits rouges croquants et un rien acides – framboise, groseille, excitent tendrement les narines. La bouche est totalement dénuée de ces arômes de pamplemousse jaune qui nous font fuir en cette saison et avec les vins de cette couleur. C’est franc de fruit, acidulé à la marge, avec un brin de gourmandise qui signe une volonté généreuse. La paroi du verre s’orne d’un léger perlant absent en bouche. C’est délicat, assez long, et fort bienvenu pour escorter un poisson de rivière à la chair fragile, augmenté d’un zeste citrique et d’un demi-tour de moulin à poivre (6,90€). Envoie le riz! L.M.

Il est toujours émouvant de tomber sur un vieux cliché jauni, écorné, maltraité par le temps et sur lequel nous peinons à distinguer des détails, mais qui nous parle. Cette photo m’a été adressée (dans le corps d’un e-mail) par mon pote Jacques Ferrandez lorsqu’il travaillait à l’adaptation en BD du « Premier homme » d’Albert Camus (paru chez Gallimard l’an passé), car il me demandait si les cargos de l’armement familial, dont le port d’attache était alors celui d’Oran, avaient pu transporter Camus depuis le port d’Alger à un moment ou à un autre. Je signale en passant le très émouvant livre autobiographique de Jacques, « Entre mes deux rives », paru au Mercure de France : l’Algérie natale, Alger, le quartier de Belcourt où vécurent Camus, Sansal, Ferrandez !, Nice, l’exil, Boualem Sansal à Tipasa, Catherine Camus à Lourmarin, l’adaptation en BD de l’œuvre de son illustre(é) père, Ferrandez le camusien habité est entièrement là, et c’est écrit avec un grande sensibilité et une humilité qui forcent le respect.
Je ne connaissais pas cette photo. Je fis par conséquent appel à mon cousin Gérard Bengio, mémoire familiale vive de ce qui touche à la Méditerranée et à tout ce qui navigue sur elle, car un détail m’intriguait : la cheminée noire. Chaque cheminée des navires familiaux étant barrée d’un beau bleu ciel serti d’un grand « M » blanc, je m’interrogeais.
Gérard leva aussitôt l’énigme : l’armement Léon Mazzella & Cie avait repris l’armement Yaffil, à cette époque (aux alentours de la Seconde guerre mondiale?) et la cheminée de leurs navires était noire. Mais pourquoi alors « un » Léon Mazzella (il y en a toujours eu un pour en chasser un autre, et ce jusque dans les années 1980), parait-il ainsi sa cheminée de la couleur du deuil, et non pas de son bleu ciel et blanc maison ?.. Il me faudra rappeller Gérard.
« La photo a été prise sur le Quai du Sénégal, au port d’Oran, puisque nous devinons la colline de Santa-Cruz en arrière-plan, ainsi que le môle de l’Amirauté, à l’arrière port », précise mon petit cousin. Et comme il s’agit d’une cargaison de billons (tronçons d'arbres), cela ne fait aucun doute : seul ce quai en avait la charge... La date ? – J’ai un indice : l’homme au costume (plein centre) est mon grand-père Léon, décédé le 9 août (le jour de la St-Amour) 1951 d’une crise de cœur que l’on dit cardiaque dans une chambre d’hôtel faisant face à la gare Saint-Lazare, Paris huitième. Il se trouvait là « pour affaires » maritimes, mais les mauvaises langues familiales disent qu’il périt à la manière de Félix Faure d’une fatale fellation peut-être, à tout le moins d’une union pénétrante et adultérine, fait qui fit dire au facétieux Clémenceau à propos du Président Faure : Il a voulu vivre César, il est mort Pompée. Puis-je ajouter que l'abbé dépêché sur les lieux s'enquit de la vigueur du premier personnage de l'État en ses termes : Le Président a-t-il encore sa connaissance? Et qu'il lui fut répondu in petto : Non, elle vient de s'enfuir en empruntant l'escalier de service... Le trait, délicieux de galanterie et de finesse espiègle, est depuis consigné dans les annales élyséennes...
Bien plus simplement, l'épouse de Léon, ma grand-mère prénommée Orabuena car elle était née Juive de Tétouan, puis rebaptisée Bonheur, sa traduction, en se mariant à l’église avec son Procidien de mari (de Procida, l’île méconnue – qu’elle le reste! - du Golfe de Naples), en fut marrie, mais point brisée. Il fallut tenir bon, en femme de caractère bien trempé. L’apparence demeura ferme, flegmatique, voire fondue dans du métal point mou et propre à empêcher toute armure de se fendre un jour, une nuit. Ni étain ni plomb dans la famille, sauf l'un pour le decorum des tables, et l'autre pour la chasse. Du fer, de l’acier, et que le cœur se bronze et jamais ne se brise. Elle sortit d’ailleurs mon père Léon du Lycée Lamoricière, où il passait ses deux bacs, afin de sculpter un armateur de dix-sept ans, flanqué contre sa mère expert-comptable et véritable patronne de la modeste entreprise, comme un daguet (il n’était plus faon tacheté, ses bois donnaient de l'avant) constamment à apprendre le métier contre sa biche de mère courage. L'époque était au privilège de masculinité, au droit d'aînesse et, in situ, au devoir de respect absolu à la culture et aux traditions méditerranéennes ancrées dans un melting-pot culturel bigarré, métissé jusqu'à plus soif et dénué de toute arrière-pensée raciste, comme on dit.
L’omerta à propos des circonstances du décès du grand-père Léon demeure, car lorsqu’il m’arrive encore de titiller ma vieille tante Thérèse, sa fille (la sœur de mon père), celle-ci glisse aussitôt sur l’affaire de ses géraniums qui fleurissent tardivement – c’est bizarre, tu ne trouves pas?.. Ou bien sur celle du mur de sa terrasse bayonnaise, côté jardin en pente, lequel menace ruine. Évoquer - fut-ce de loin - la sexualité du père ne sera jamais chose aisée, me souffle Sigmund Lacan.
C’était un « coureur » au fond, selon l’expression d’alors, un inoffensif Barbe bleue comme son frère Giacomi, et aussi l’autre, rescapé des tranchées de 14, Antoniuccio je crois... Juste bon à trousser les femmes de ménage successives de la propriété de Pont-Albin, à Misserghin, sise sur « les hauteurs de la ville » (d'Oran)... Cette page d’histoire familiale me séduit par son côté bovaryen à sa marge, doté d’un accent à la Maupassant dans ses haltes aux auberges de campagne, mâtiné d’une dose de machisme napolitain (totalement anachronique en ces temps d'une pruderie de Quaker), mais à l'effet immédiat sur les saintes nitouches déguisées en vierges effarouchées, et faisant aussitôt rire à gorge déployée tout ce qu’un quai peut compter de marins rayés et un zinc d’amis soiffards...
Gérard, fin connaisseur, précise que ce bâtiment (je reviens au cliché), est le bateau « souche » des futurs navires de la classe Victory, Empire, puis Liberty ship américains, caractérisés par la mâture en forme d’arche portée. J’affectionne ce type de détail parfaitement inutile au commun des mortels, surtout s’il est sujet au mal de mer, mais qui possède le claquant d’un poème, mâture en arche portée... Et grise l’oreille à la manière de ce qui agace actuellement ma vue, et qui se nomme joliment « les corps flottants » (des fantômes en forme de mouches qui passent devant l’œil, produisant des sous-ensembles flous, dirait Jacques Laurent, et ne laissant pas les corps tranquilles... Mon « vitré » se distend avec l’âge, mais je n’envisage pas encore de double vitrage pour le blanc de mes yeux, pas plus que mon aïeul ne pensa à porter des lunettes... à double foyer).
Or, donc, cette photo. Je la regarde et je rêve. D’une Algérie où je naquis et où je passai trois années y pico– et demie pour être précis. Je n’y suis pas encore retourné, malgré mes velléités lorsque, par exemple, je fis paraître chez Rivages « Le parler pied-noir » en 1989. Le FIS y montrant déjà le bout de sa sinistre morgue, il fut préférable d’attendre un peu. Sauf que un peu me dure.
Cette proue droite me fascine. Mon regard a toujours été attiré par ces navires façon brise-glace, l’arrondi à leur base en moins, car ce tranchant de lame, cette rectitude de col amidonné, comme celui que porte (sans la prothèse rigide) Erich Von Stroheim dans « La Grande illusion » (celui de Karl Lagerfeld ne parvient pas à m’émouvoir), lorsque le commandant Von Rauffenstein s’adresse à Pierre Fresnay : « Monsieur de Boëldieu... », sont infiniment émouvants. À quai comme en pleine guerre. L.M.
Michel Onfray, extrait d'une interview donnée au Figaro daté d'avant-hier :


 J'aime bien, à l'inverse de certains de mes confrères se bouchant trop souvent le nez, découvrir sans réticence ce qui se fait et se vend par palettes en grande distribution. Ainsi de cette énorme entreprise chilienne, Viña San Pedro, laquelle se targue de dire que toutes les deux secondes, trois bouteilles de ses vins de la gamme Gato Negro sont ouvertes quelque part dans le monde. On dirait là une parole de brasseur industriel. Et pourrait rebuter, faire frémir. Et bien non. Gato Negro, le chat noir, se décline dans les trois couleurs, et chacune coûte 4,50€.
J'aime bien, à l'inverse de certains de mes confrères se bouchant trop souvent le nez, découvrir sans réticence ce qui se fait et se vend par palettes en grande distribution. Ainsi de cette énorme entreprise chilienne, Viña San Pedro, laquelle se targue de dire que toutes les deux secondes, trois bouteilles de ses vins de la gamme Gato Negro sont ouvertes quelque part dans le monde. On dirait là une parole de brasseur industriel. Et pourrait rebuter, faire frémir. Et bien non. Gato Negro, le chat noir, se décline dans les trois couleurs, et chacune coûte 4,50€.
Le rouge issu de carménère nous a profondément déplu, avec son mauvais goût de serpillère moisie et de légumes suris en voie de décomposition. Nous avons mis cela au débit du compte d'une bouteille défectueuse : ¡ a probar otra vez ! Si l'occasion se présente, car nous ne la provoquerons pas.
En revanche, le rosé (cabernet sauvignon), avec ses arômes de fraise très mûre et écrasée, et de framboise croquante, est plaisant, simple à souhait. Il appelle le jambon serrano de base et le chorizo doux pour un apéro sans chichis. La bouteille se dévisse, ce qui augmente l'usage de sa simplicité amicale.
Le blanc, issu de sauvignon, avec ses flaveurs nettes de mangue molle et d'ananas vif (genre Victoria), n'est pourvu d'aucune acidité excessive, ni de la moindre douceur opportuniste et souvent rédhibitoire. À ce prix-là, c'est cadeau, et convenable sur les premières huîtres n°3 venues, quelle que soit leur extraction marine, ou bien sur un cabécou pas trop fait, mais doté de mordant. L.M.
Merci à cette lectrice qui a exhumé soudain ces trois petits textes que j'avais totalement oubliés (variations sur « l'art » de ne rien dire, publiées sur ce blog même à la mi-mai 2008 : archives ouvertes à l’onglet dédié), et que je ressors volontiers, en joignant ces quelques mots de réflexion : À leur relecture, je constate que le texte 2 est bien meilleur que le 1, et que le 3 rivalise avec le 2. Conclusion évidente : cet exercice améliore l'écriture. C'est une sorte de « travail », qui ne consiste pas, comme à l'habitude, à élaguer, condenser, corriger, densifier, tonifier un seul et même texte. Cette façon de faire, en opérant par déclinaison, est avant tout ludique. Et parfaitement... inutile, au fond, n'est-ce pas? Puisqu'il s'agit de « l'art » de ne rien dire. Et comme « c'est bien plus beau lorsque c'est inutile », me souffle Cyrano, cela devient essentiel.
Nous pourrions nous amuser longtemps ainsi, sans même nous livrer à des exercices de styleà la Raymond Queneau (ou à la manière de Cyrano encore, et sa tirade du nez), mais juste en variant, justement, et à peine, par touches, quelques mots, quelques tournures de phrases :
1
22h38 13 mai 2008
Des fois je me demande si...
... Je ne devrais pas écrire, chaque jour, ici, sur ce chien que je nourris (KallyVasco ne portera jamais de collier), des choses comme... les notes qui noircissent mes carnets Moleskine successifs, lesquels s'accumulent sur une table et font la poussière (au moins comme çà, quelqu'un la fait...). Cela donnerait, pour cette fin de journée : Après le désormais traditionnel (et merveilleux) déjeuner du mardi en compagnie de mes deux soeurs, chez La Nonna Inès cette fois, rue de l'Arbalète (ah! le lard de Colonatta!), j'ai repris ma voiture après quatre mois de suspension de permis. Bizarre... Travaillé -comme d'habitude- dans la joie avec Gérard, Marie et Sophie à plusieurs dossiers simultanément. VSD J.O., Rome, 7 erreurs... Puis, à la fraîche, Gérard, trop fatigué, est rentré se coucher. Long apéro vraiment bien, amical et complice à fond, au Café Cassette avec Sophie (préféré, ce soir, au Vieux-Colombier). Ce rade fut l'une de mes annexes lorsque je vivais rue de Rennes. Moments simples et bavards, jusqu'à l'heure de son dîner prévu avec une de ses anciennes collègues. Flâné à St-Germain, l'air était doux, la lumière baissait gentiment, je me sentais bien, si bien. Echoué volontairement parmi les livres de ma pharmacie préférée, du quartier, "L'Ecume des pages", à la recherche de "Diego et Frida" pour l'offrir comme promis à Angélique. "Livre manquant"! Pris (pour ne pas sortir bredouille -je déteste cela), "La Philosophie comme manière de vivre", de Pierre Hadot, immense socratique, et "Rome et l'amour" de Pierre Grimal. Passé à la BNP consulter mon solde, puis acheté deux havanes, nouveaux sur le marché et dont j'ai entendu du bien : l'Obus de Juan Lopez. le module est orné d'une bague sur laquelle j'ai lu, pour la première fois, "Exclusivo Francia". Rentré à 22 heures. Nourri le chat de ma fille (en pension depuis hier soir pour cause de déménagement et de concours divers ici et là). Penser à dîner, mais je n'ai pas faim. Rien ne presse. Plus rien ne presse. Rien, au fond, n'a jamais pressé, ne doit jamais presser. Thé vert à la menthe. Ayo, Léonard Cohen, Catpower. Blog (J'y suis!). Ne pas oublier le réveil : re-boulot dès 8h30 à Montrouge!.. Et voilà.
Mais cela, à la vérité, ne présenterait, franchement, aucun intérêt. Nous sommes bien d'accord...
2
14h23 14 mai 2008
Deux fois je me demande si...
(otraversion sur « l'art » de ne rien dire)
Le mardi, je déjeune en compagnie de mes deux sœurs. Nous sommes allés chez La Nonna Inès aujourd’hui, rue de l'Arbalète. L’évocation de nos parents disparus a encore besoin de drôlerie pour habiller la tendresse. Elles sont belles, mes sœurs. J’observe notre trio, désormais serré comme un bouton de rose. Il ne saurait faillir. J'ai démarré la voiture avec une impression inédite. Je ne l’avais pas utilisée depuis quatre mois. Suspension de permis. J’ai rejoint Gérard, Marie et Sophie à Montrouge. Nous avons travaillé –dans la joie comme toujours, à plusieurs dossiers. En fin de journée, Marie est partie et Gérard opposa une réelle fatigue à ma proposition d’aller dîner. Nous avons pris un apéritif amical et complice, Sophie et moi, au Café Cassette. Avec Le Vieux-Colombier, ce furent mes annexes lorsque je vivais rue de Rennes. Sophie avait un dîner. Je lus la sérénité sur son visage. Elle manifesta un bien-être raffermi. J’ai flâné à St-Germain avant de rentrer. L’air était doux, la lumière tendre. Je me sentais bien. J’ai échoué à trouver "Diego et Frida", de Le Clézio, à la librairie L'Ecume des pages, puis j’ai acheté un havane orné d'une bague étrange, mentionnant "Exclusivo Francia". Je viens d'arriver, il est vingt-deux heures, je n’ai pas faim. Je nourris le chat de ma fille, pensionnaire depuis hier soir pour cause de déménagement. Rien ne presse. Plus rien ne presse. Rien, au fond, n'a jamais pressé, ne doit jamais presser. J’affale ma voilure, relâche la carcasse, me sers un thé vert à la menthe, allume le havane, lance Ten New Songs de Léonard Cohen, flâne sur mon blog. Note ceci...
La lune monte. Le ciel paraît noir. Je le sais étoilé. Je prends conscience de mon être-au-monde. Le quotidien empêche de savourer le pur bonheur d’exister. Demain, je me lèverai tôt, prendrai le petit-déjeuner dans le salon baigné de soleil et retournerai aux écritures.
3
16h11 14 mai 2008
Trois fois je me demande si...
(variétés, suite)
Mardi. Muriel et Pascale toujours aussi belles. Surtout devant une assiette d’antipasti del nonno. À côté d’elles, les brunes qui passent devant la terrasse paraissent fades. Ce sont mes sœurs, pourquoi ? La voiture sent le renfermé après quatre mois de jachère. Putain de garde à vue (penser à créer ce Prix littéraire que je nommerai Le GAVé. Il récompensera le plus beau récit de Garde A Vue. Avis…). Bosser avec Gérard et les filles me fait aimer le travail autant que la plage. Gérard conduit trop. Ses aller-retour hebdomadaires à Izotges, Gers, le crèvent. Nous n’irons pas au bal, ce soir. En revanche, l’œil malicieux de Sophie invite à décompresser autour de deux Perrier-tranche. Notre amitié cristallise comme un pot de miel au fond d’un placard de résidence secondaire. Elle a un dîner. Sur son visage, je lis une sérénité qui me fait plaisir. J’aime Saint-Germain-des-Près en cette saison, encore basse. Rien ne presse. Personne ne m’attend, excepté le chat de ma fille, à l’appétit vagabond. Havanes, librairie. Enfin échoué, je dépose ma carcasse, sac de marin, savoure mon être-au-monde en regardant le ciel noir que je sais étoilé. Le quotidien oblige à négliger notre conscience du pur bonheur d’exister. Léonard Cohen, un thé vert, mon chien (ce blog). « Et si la littérature était un animal qu’on traîne à ses côtés, nuit et jour, un animal familier et exigeant, qui ne vous laisse jamais en paix, qu’il faut aimer, nourrir, sortir ? » (Roger Grenier). Pour un peu, je me sentirais à la campagne. Manquent les parfums de la nuit : menthe glacée, ronce, terre tiède.
Voici trois poèmes extraits de Femmes de soie et autres oiseaux de passage (210 pages, Séguier, décembre 1999). L'éditeur avait alors eut l'idée d'imprimer plusieurs affiches de format 30x40 à l'intention des libraires. En voici donc trois, rescapées, scotchées sur un mur, avec la couverture du livre, rehaussée d'une oeuvre de Francine Van Hove intitulée Au soleil :
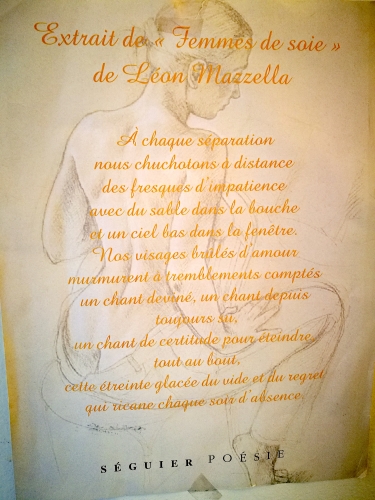
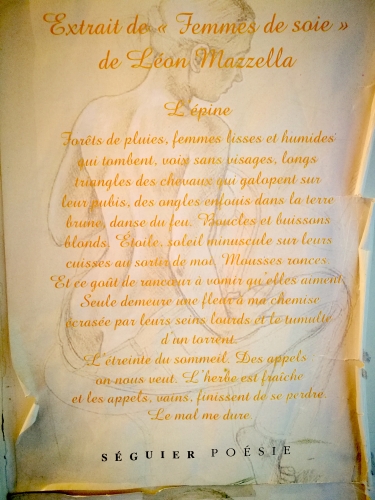
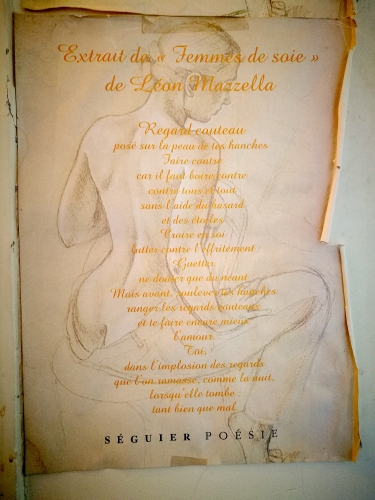
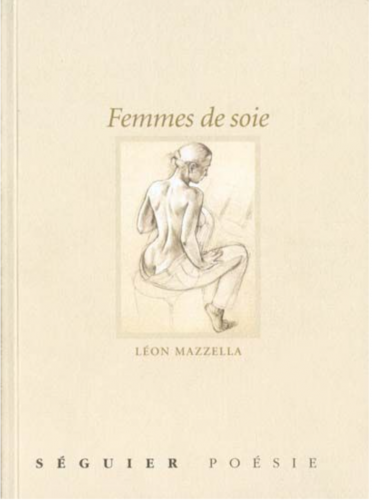
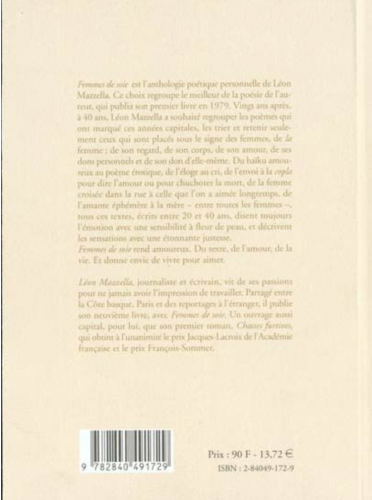
 Attiré d’abord par le nom, eu égard à ma passion des oiseaux, et même à l’affection particulière que je nourris à l’adresse des turdidés (eux qui m’ont jadis tant nourri), puis par l’écho vu plus que lu en musardant sur quelque gazette numérique à la mode se piquant de savoir reloader l’univers de la gastronomie, et enfin par un quartier que j’ai plaisir à voir rajeunir et prendre des couleurs grâce à ses tables accortes – le onzième arrondissement de Paris -, j’ai poussé la porte de Grive, ouvert en novembre dernier, qui est le mois de la migration de ces oiseaux, qu’ils soient mauvis, musicienne, litorne ou draine. Qu’elle ne fut pas ma surprise de voir qu’en fait de grive, il s’agissait d’un merle, plastronnant perpendiculairement, en l'enseigne plantée au mur du numéro 18 de la rue Bréguet, gravé sur d'élégants verres (si jolis que j'en ai acheté 18, à 4€ pièce) ou encore imprimé sur les facturettes. Plus noir que noir et aucunement grivelé.
Attiré d’abord par le nom, eu égard à ma passion des oiseaux, et même à l’affection particulière que je nourris à l’adresse des turdidés (eux qui m’ont jadis tant nourri), puis par l’écho vu plus que lu en musardant sur quelque gazette numérique à la mode se piquant de savoir reloader l’univers de la gastronomie, et enfin par un quartier que j’ai plaisir à voir rajeunir et prendre des couleurs grâce à ses tables accortes – le onzième arrondissement de Paris -, j’ai poussé la porte de Grive, ouvert en novembre dernier, qui est le mois de la migration de ces oiseaux, qu’ils soient mauvis, musicienne, litorne ou draine. Qu’elle ne fut pas ma surprise de voir qu’en fait de grive, il s’agissait d’un merle, plastronnant perpendiculairement, en l'enseigne plantée au mur du numéro 18 de la rue Bréguet, gravé sur d'élégants verres (si jolis que j'en ai acheté 18, à 4€ pièce) ou encore imprimé sur les facturettes. Plus noir que noir et aucunement grivelé.
« Faute de grives, on mange des merles » : Je poussai donc la porte à l’heure du déjeuner en plein proverbe vantant l’indigence sachant philosopher sur la disette en congédiant les papilles. J’objectai à peine assis, afin de manifester mon étonnement ornithologique. Il me fut répondu en me tendant la carte (courte, elle change souvent au gré de la fraîcheur du marché) que « c’était la même famille ». Certes, un porc d’élevage industriel et un sanglier sont eux aussi de la même famille, comme une tomate et un ananas sont des fruits. Je préférai donc y voir une silhouette en ombre chinoise... Cette absence de souci de la précision laissait-elle augurer un écho laxiste en cuisine ? Nous allions voir. La décoration est fraîche, dans cette salle aux dimensions menues et dont un mur expose des bouteilles d’assez bonne origine, mais convenue dans le quartier (du bio à bobo, mais pas que), avec vente à emporter (vins, huîtres). De vastes peintures figurant des produits (huître, pomme pelée), viennent d’être remplacées par des photographies évoquant notamment la pêche en mer. Couteaux Nontron sur table, du bois un peu partout...
Allons-y, allons-zo ! Une entrée pour deux attirait : tartare de truite de Banka (la fameuse saumonée de l’élevage en pleine montagne basque de Peyo Petricorena – j’en ai encore dit du bien dans L’Express récemment), voilà qui allait ouvrir l’appétit. Malheureusement, nous n’avons pas retrouvé la subtilité habituelle de la chair de ce poisson dans les petits morceaux crus marinés, ni dans le coeur de truite épais et ferme à souhait. Il ne suffit pas de nommer les « petits » producteurs comme on prénomme les vignerons (ça vous classe), de pratiquer le name dropping des suffisants-à-la-triste-mine-qui-savent, eux, pour qu'un passage en cuisine fasse de tout produit un bonheur dans l’assiette. Là, je fus perplexe, car en fait de transformation, hormis un assaisonnement basique...
Nous apprîmes que le cochon était de Bayeux, et élevé « à la ferme bio en circuit court », que les huîtres de Saint-Vaast-la-Hougue d'Yvan Dernis étaient « naturelles de pleine mer » (une huître artificielle serait-elle stérilisée?), et les poissons de « pêche durable ». Les herbes, comme l’oxalys, l'oseille rouge et le pissenlit, sont « ramassées à la main », mais nous ne voyons guère comment les cueillir mécaniquement, et le faire avec les pieds présente quelque inconvénient. Alors, oui, bien sûr qu’il est louable, ce souci de « sourcer » convenablement les produits, mais de là à s’agenouiller devant l’adjectif bio (lequel cache tant d'arnaques - Oui, mais bon, c'est cool, tu vois)... Encore faut-il ne pas en faire une carte de visite en forme de sésame, l’habit ne faisant pas le moine. Il faut surtout flatter le (bon) produit comme il convient.
La côte de porc était hélas sèche, dure, et sans saveur particulière. Le poulet choisi par mon vis à vis idem. Purée de céleri, champignons de Paris ici, pommes de terre là... Herbes et fleurs parsemées pour « la jouer Iñaki » peut-être, mais celles-ci n’épatent plus le chaland. Leur goût, en contrepoint, est en revanche utile, car il fait office de condiment. Les plats déçoivent donc par leur exécution sommaire, leur banalité dans la construction, leur manque de pertinence, et avant tout par leurs saveurs en berne. Nous n’avions évidemment pas envie de « tester » une table en prenant une douzaine d’huîtres (22€). J'hésitai cependant à prendre des couteaux en entrée, et les coques aussi... J'y retournerai afin de me risquer sur le homard, et tenter le lieu jaune : pleine mer en avant toute !
Quant au service, il est, comment dire... dans la lune, sinon distrait – mais fort aimable. Les prix sont chouia marxistes (Thierry), eu égard aux paramètres (notoriété, réputation), soit disproportionnés. Et, justement, les portions sont de surcroît chiches. Comptez 8 à 12€ l’entrée, 19 à 22€ le plat, 10€ le dessert (20€ l’assortiment de fromages), le verre de vin est à partir de 5€ (bien). Un acte de grivèlerie tenterait le malhonnête. Au lieu de quoi j’ai filé (pas loin de) cent sacs au toubib, pour parler comme Le Mexicain des Tontons flingueurs, qui sait être grivois. Grave. L.M.
prix sont chouia marxistes (Thierry), eu égard aux paramètres (notoriété, réputation), soit disproportionnés. Et, justement, les portions sont de surcroît chiches. Comptez 8 à 12€ l’entrée, 19 à 22€ le plat, 10€ le dessert (20€ l’assortiment de fromages), le verre de vin est à partir de 5€ (bien). Un acte de grivèlerie tenterait le malhonnête. Au lieu de quoi j’ai filé (pas loin de) cent sacs au toubib, pour parler comme Le Mexicain des Tontons flingueurs, qui sait être grivois. Grave. L.M.
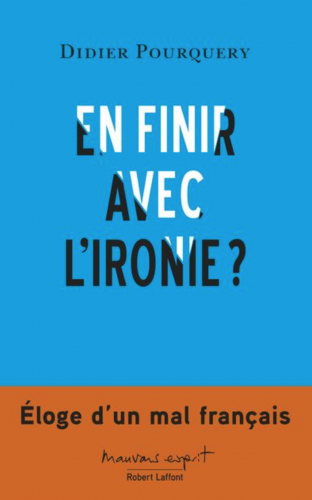 Avec En finir avec l’ironie ?, le journaliste et écrivain Didier Pourquery signe un salutaire éloge d’une passion française, voisine de palier du second degré : Résistance, curiosité, agilité, légèreté, contrôle, dans le désordre, voilà toute l’actualité du second degré comme art martial essentiel. Nous voici prévenus, avec ce brillant mode d'emploi en 160 pages de l'antidote majeur à toutes les doxas.
Avec En finir avec l’ironie ?, le journaliste et écrivain Didier Pourquery signe un salutaire éloge d’une passion française, voisine de palier du second degré : Résistance, curiosité, agilité, légèreté, contrôle, dans le désordre, voilà toute l’actualité du second degré comme art martial essentiel. Nous voici prévenus, avec ce brillant mode d'emploi en 160 pages de l'antidote majeur à toutes les doxas.
----------
L'essai est tonique et drôle, qui dissèque un mal, une sorte d'insolence ou de mauvais esprit (qu'Emmanuel Macron fustigea dans son discours du 7 mai 2017), et qui se trouve pile-poil dans le collimateur des suffisants, des tristes sires, des allergiques à l’humour qui décape et autres adeptes du politiquement correct...
L'apologie de l’ironie de Didier Pourquery cadre d’emblée : Le système ironique est un état d’esprit, une attitude, un regard légèrement distancié, un sourire en coin, une construction qui relève de la fantaisie... L’ironie n’est pas non plus de l’humour : Il s’agit simplement de prendre du recul face aux "choses graves", de remettre en question(s) le "bon sens". Ce que le philosophe Vladimir Jankélévitch (auteur notamment de L'ironie, Champs/Flammarion) appelait « la bonne conscience joyeuse de l’ironie » est un piège à vaniteux, précise Pourquery. Nous savons depuis Socrate, « éternel casse-pied » comme le surnomme l’auteur, et sa fameuse ironie consistant à désarmer le sophiste en pratiquant la maïeutique (l’art d’accoucher les esprits, comme un obstétricien de l’âme), que le second degré fait réfléchir en détruisant les illusions, les hypocrisies. (...) L’interrogation systématique et paradoxale est le cœur de l’ironie. En feignant l’ignorance et en semblant détaché, Socrate combattait la médiocrité et la facilité des idées toutes faites. L’ironie est donc une arme salutaire contre la morgue ambiante et les discours tordus. L’antiphrase est l’une de ses munitions favorites, avec la litote, l’hyperbole et autres figures de style. Ou encore la boutade.
Résister et rester léger
Pourquery rend hommage aux princes du second degré, de Søren Kierkegaard à Sacha Guitry, en passant par Mark Twain, le-regretté-Pierre-Desproges, Woody Allen et ... le Gorafi ! Sans oublier des « mouvements » : le kitsch, le camp. Il prend soin de distinguer l’ironie de la dérision – qui est une moquerie teintée de mépris. Et du cynisme des enfants de Diogène, lesquels foisonnent en politique et à la télé, mais qui sont bien plus arrogants que l’inventeur de cette attitude, n’étant pas du même tonneau... Les ennemis du second degré, seconde partie du livre, passe en revue les sérieux... qui se prennent au sérieux, tous ceux que le doute n’habite pas, les chiennes (comme les chiens) de garde, les intégristes de toutes obédiences vouant aux gémonies le Voltaire piquant et agaçant, tous les indignés qui s’imaginent détenir le monopole de la sincérité, les sectaires, les Khmers rouges ou verts, les néo-staliniens (qui sont légion), sans oublier les nouveaux donneurs de leçons qui officient sur Internet et que l’on appelle les trolls. Le troll est un imbécile digital, écrit Pourquery. C’est un drôle de drolle (pour parler Bordeluche) qui se pose en policier plumitif de la morale (mais laquelle ?), et qui ne laisse aucune chance à la nuance et au paradoxe. Et l’auteur d’ajouter : Le Net, c’est la cage aux trolls. Certaines pages sont tordantes, comme l’idée du « déjeuner de cuistres » (pour changer du dîner de cons), campé comme un passage des Caractères de La Bruyère. Face à « la marée montante de la bêtise », aurait dit Albert Camus, l’ironiste, qui n’est jamais dupe, résiste. Comme l’alu ! Sa grande force est de savoir rester léger. La dérision cogne, le cynisme flingue et l’ironie renverse. L’ironie met l’adversaire "sur le cul". Poids légers... L.M.
---
Didier Pourquery, En finir avec l’ironie ? Robert Laffont, coll. Mauvais esprit, 17€
À propos d'autres ouvrages de Didier Pourquery évoqués ici =>
https://bit.ly/23m6av0 - https://bit.ly/1Zlqx7G - https://bit.ly/1xiBUAD
Bon sang ! Voilà que le nouveau roman de Christian Authier, au titre un peu moins saganien que d'habitude, « Des heures heureuses », et où il est question du monde des vins naturels, est annoncé chez Flammarion (il paraît le 2 mai). Il était donc temps que je récupère « Les Mondes de Michel Déon », trop longtemps prêté, parce que c’est un livre important, et que cela faisait un moment que je voulais écrire le papier ci-dessous.
------
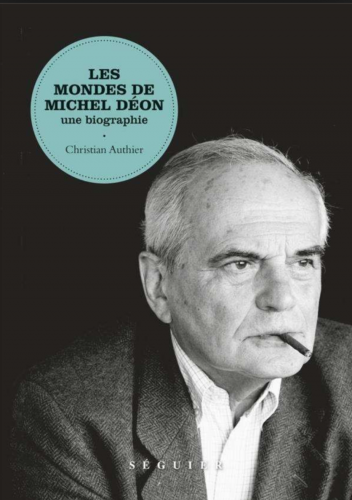 Il y avait le Déon de Pol Vandromme et celui d’Éric Neuhoff, voici celui de Christian Authier. « Les Mondes de Michel Déon » (Séguier) n’est pas une biographie ordinaire. Ce n’est pas non plus une hagiographie. C’est un voyage sentimental dans l’univers de l’auteur des Poneys sauvages et du Taxi mauve. Un « voyage en Déonie », comme l’écrit lui-même Authier. L’auteur prévient d’emblée son lecteur : la nostalgie qui irrigue les livres de Michel Déon n’est pas rancie. Elle se conjugue au présent. Il lui était redevable, car il sait qu’« il n’est pas donné à tout le monde de rencontrer un écrivain qui a illuminé votre jeunesse, qui vous a chuchoté à l’oreille durant des journées et des nuits de lecture des histoires vous aidant à vivre. » D’autant qu’à l’opposé de nombre de gensdelettres imbus, égotistes, vaniteux, Michel Déon incarne « une élégance, une générosité, une modestie qui faisaient de lui un seigneur. » Durant toute sa vie d'écrivain (enfin) reconnu, cet auteur pudique et discret, stendhalien et gionien, jamais cassant ou froid comme d’aucuns le croient encore, n’aura eu de cesse de déceler, de flatter et de soutenir les jeunes talents, de militer en leur faveur, de convaincre les différents jurys littéraires auxquels il a appartenu d'attribuer en chœur des récompenses encourageantes, fut-ce le modeste Prix Jacques-Lacroix de l’Académie française. Les enfants de Déon sont aujourd’hui aussi nombreux que reconnaissants. Authier, lauréat du Roger-Nimier en 2006, est de la bande.
Il y avait le Déon de Pol Vandromme et celui d’Éric Neuhoff, voici celui de Christian Authier. « Les Mondes de Michel Déon » (Séguier) n’est pas une biographie ordinaire. Ce n’est pas non plus une hagiographie. C’est un voyage sentimental dans l’univers de l’auteur des Poneys sauvages et du Taxi mauve. Un « voyage en Déonie », comme l’écrit lui-même Authier. L’auteur prévient d’emblée son lecteur : la nostalgie qui irrigue les livres de Michel Déon n’est pas rancie. Elle se conjugue au présent. Il lui était redevable, car il sait qu’« il n’est pas donné à tout le monde de rencontrer un écrivain qui a illuminé votre jeunesse, qui vous a chuchoté à l’oreille durant des journées et des nuits de lecture des histoires vous aidant à vivre. » D’autant qu’à l’opposé de nombre de gensdelettres imbus, égotistes, vaniteux, Michel Déon incarne « une élégance, une générosité, une modestie qui faisaient de lui un seigneur. » Durant toute sa vie d'écrivain (enfin) reconnu, cet auteur pudique et discret, stendhalien et gionien, jamais cassant ou froid comme d’aucuns le croient encore, n’aura eu de cesse de déceler, de flatter et de soutenir les jeunes talents, de militer en leur faveur, de convaincre les différents jurys littéraires auxquels il a appartenu d'attribuer en chœur des récompenses encourageantes, fut-ce le modeste Prix Jacques-Lacroix de l’Académie française. Les enfants de Déon sont aujourd’hui aussi nombreux que reconnaissants. Authier, lauréat du Roger-Nimier en 2006, est de la bande.
Collants clichés
Déon reste associé à des clichés adhésifs et c’est dommage, puisque réducteur. Il y a d'abord Déon le Hussard, compagnon de route et de déroute de Nimier, Blondin, Laurent et autres désengagés viscéraux : Haedens, Vailland, Hecquet, Marceau, Mohrt, Nourissier, Curtis, Perret, Dutourd, et même Frank... Cette droite buissonnière et mousquetaire, celle des copains d’abord pour unique cause, « désinvolte, rieuse, frondeuse », précise Authier, anarchisante, ironique, insolente et anti sartrienne, celle qui disait « savoir désespérer jusqu’au bout » (Nimier), plaidait pour « l’amour vagabond » (Fraigneau), cette génération romanesque et mélancolique, allergique à « la politique dans un roman » (Stendhal), comme à la morgue du Nouveau Roman et autres postures mortifères et nauséeuses, et dont « la panoplie littéraire » (Frank) était taillée comme un costume trois pièces : « les voitures rapides, l’alcool et les jolies femmes ».
Parmi les autres clichés, il y a Déon le Grec, et Déon l’Irlandais... Lors que l’auteur de Je me suis beaucoup promené, de Bagages pour Vancouver et de Je vous écrit d’Italie... n’a pas consigné que sa vie à Patmos, Spetsai et dans le Connemara. La Corrida, par exemple, évoque les États-Unis. Car Déon était un bourlingueur qui aima partir et découvrir le Portugal, le Brésil, le Maroc ou l’Espagne à la manière d’un Valery Larbaud. Ses retours dans ces contrées lui procureront le désagrément du voyageur qui a connu des terres plus ou moins vierges, devenues la proie d’un tourisme massif et mal élevé étant parvenu à faire plier des pays somme toute corruptibles. Alors, lorsque Déon rejoint l’Académie française, on le suppose rangé des avions et des Liners. Il repart aussitôt, et nous envoie des livres tantôt sensuels et solaires depuis l’Italie « pour répondre au besoin irrésistible de vivre les histoires que d’autres n’ont pas toujours su me raconter », tantôt graves et crépusculaires comme le splendide La Montée du soir. Authier rappelle avec justesse que le roman, pour Stendhal, est « un miroir promené le long d’une route », et que ceux de Déon, comme il l’a dit lui-même, « témoignent d’une époque, fut-ce souvent à contre-courant ». Une époque « où les femmes laissent des regrets et où les hommes tiennent parole ».
Maurras et de Gaulle
D’aucuns vouent aux gémonies un Chardonne, un Morand, un Drieu tout en fichant la paix à Céline et mettent Déon dans le même panier au motif que ce dernier a adhéré, dix années durant, dès l’âge de 14 ans à l'Action française (en prenant sa carte le 7 février 1934 des mains du futur comédien François Périer), par fidélité à une certaine idée du royalisme et à la figure tutélaire de Charles Maurras, antisémite notoire (que l’on ne commémorera pas cette année, au nom d’un sectarisme gouvernemental des plus obtus, confondant commémoration et célébration). L'ancien secrétaire de rédaction (de 1942 à 1944) du journal L'Action française, ne doit évidemment pas masquer l'écrivain qu'il devint. D'aucuns lisent ou relisent le Voyage au bout de la nuit en continuant d'ignorer les essais nauséabonds de Céline comme Bagatelles pour un massacre. Et Authier de préciser que si l'Action française soutint Pétain, elle rejeta la politique de collaboration mise en oeuvre par Vichy...
L’un des mérites du livre de Christian Authier est justement de nous éclairer sur des pans méconnus de la vie de Déon. Qu’il s’agisse de fêlure amoureuse : les pages consacrées à Olivia/Gloria et la place unique que cette femme occupa dans le cœur de l’auteur de Je ne veux jamais l’oublier, sont aussi tendres qu’enrichissantes, et puis on y voit Déon « l’écrivain du bonheur » - autre cliché tenace - au Pays basque... « L’amour ne triomphe que dans le souvenir. Le roman est là pour le sauver du désenchantement ». Ou qu’il soit question d’engagement indéfectible. L’Algérie française, par exemple, a mobilisé quatre de ses livres, comme Mégalonose ou bien sûr L’Armée d’Algérie et la pacification, et elle est présente dans trois autres. Déon découvre cette terre en avril 1958, et la visite dans les moindres recoins. Adversaire de l’amalgame qui a encore cours, il précise : « C’est parce que les Français d’Algérie ne sont pas tous de gros colons prévaricateurs, mais de petits cultivateurs, de modestes artisans, des chauffeurs de camions ou des maçons que l’Algérie – à qui la découvre – apparait soudain comme une réalité française, par ses défauts comme par ses qualités. » Lorsqu’il publie pour la première fois à La Table Ronde de Roland Laudenbach, la maison d’édition sise alors au 40 rue du Bac est un repaire très Algérie française (Susini, Brune, Soustelle, Bidault, Héduy, Laurent en sont), voire OAS. En tout cas très anti-gaulliste (le de Gaulle de la trahison d’Alger et du parjure d’Évian), mais pouvant être gaullien par ailleurs, comme on est justement maurrassien, et sachant rendre hommage sans coup férir à Bastien-Thiry ainsi qu’à Degueldre.
Fêlures d’enfance
Du Déon journaliste, une opinion peu rigoureuse ne retient que sa chronique théâtrale à Aspects de la France, alors qu’il fit longtemps flèche de tout bois (ou plume de toute encre) afin de nourrir sa famille, de Marie-Claire et ELLE à Sud-Ouest Dimanche... Tout en travaillant longtemps dans l’édition, notamment chez Plon, puis comme bras droit de Laudenbach à La Table Ronde.
Mais le Déon le plus authentique se trouve encore ailleurs. « Nos plus ineffaçables chagrins sont d’enfance. Le reste de l’existence se passe à les défier ou à redresser les ruines », écrit Déon le fils unique dans un petit livre éclairant sur les déchirures durables, et injustement méconnu, La Chambre de ton père. Il faut le lire juste avant Parlons-en..., conversation précieuse entre un père et sa fille, Michel et Alice Déon, devenant une confession au fil des pages. Nous y lisons par exemple ceci : « Avec quoi écrivons-nous nos romans ? Avec des larmes séchées, des rires étranglés, des joies fugaces et avec les amertumes que laissent les espérances trahies. » Tout Déon.
Authier nous apprend également que Michel Déon rencontra Chantal Renaudeau d’Arc (qui devint sa femme le 15 mars 1963), un soir de réveillon 1957 chez Christine de Rivoyre, autour de trois kilos de truffe... C’est ce genre d’anecdotes qui rendent la lecture du Déon d’Authier si charmante. C'est de savoir par exemple qu’Alice (qui préside aujourd’hui les éditions de La Table Ronde) a grandi en Grèce, un pays figurant une longue escale dans la vie de « nomade sédentaire » (Pol Vandromme osa l’oxymore) que fut Michel Déon. L’écrivain a trimbalé sa petite famille de Spetsai à Galway, soit là où « un peuple a su préserver sa singularité face au rouleau compresseur de l’uniformisation. » Menant une vie simple face à la Méditerranée, puis au cœur des marais verts de Tynagh. Une vie « à la fois humble et aristocratique », précise Authier dans cet hommage de 190 pages qui dresse un portrait inoubliable de l’expression même de « la gratitude, l’élégance, la franchise du cœur mâtinée de pudeur : c’était Déon. » L.M.
---
Les Mondes de Michel Déon. Une biographie, par Christian Authier (Séguier), 21€
 Après Tomy&Co (22, rue Surcouf, Paris 7), Tomy Gousset a ouvert Hugo&Co il y a environ un mois (48, rue Monge, Paris 5). Le jeune chef d’origine cambodgienne que l’on avait découvert au restaurant Pirouette – dont on peut dire qu’il a contribué à sculpter le succès (rue Mondétour, Paris 1) et qui, après être passé par l’école Ferrandi, a fait ses classes chez Yannick Alléno (Le Meurice), Daniel Boulud (à New York) et Alain Solivérès (Taillevent), des nuls n'est-ce pas, aime mélanger les styles culinaires (asiatique, espagnol, italien, français bien sûr) lorsqu’il sent que ça peut « tenir debout », et pas banalement pour la jouer fusion. Sa deuxième adresse – testée hier soir -, est plus cool côté carte que la première, mais aussi authentiquement bistronomique, davantage conviviale également avec, entre autres, sa grande table d’hôte trônant majestueusement, comme dans les établissements successifs de Julien Duboué (Afaria, Dans les Landes mais à Paris, A Noste). Il y a aussi un petit comptoir qui permet de déguster côte à côte tout en parlant « au vol » avec le chef, lequel achève de dresser chaque assiette avec une méticulosité d’horloger genevois de ses dix doigts que prolongent des avant-bras abondamment tatoués (désormais, les jeunes chefs non tatoués se comptent justement sur les doigts d’une main. Par bonheur, ils ne passent pas tous plusieurs heures par semaine chez leur coiffeur spécialiste de la coupe footeux). Tomy dresse donc, en gardant un œil sur la salle et l’autre en cuisine – appelons cela l’indispensable strabisme divergeant du boss, et non sans avoir les deux oreilles à l’écoute (totale), en lançant de temps à autre quelques mots (d’ordre) secs et d’une redoutable efficacité immédiate : c’est le côté chef d’orchestre sans baguette. La décoration est, disons : roots (cagettes aux murs ornées de bouteilles et de plantes, par exemple), qui rappelle les bistrots new-yorkais et les lieux actuellement branchés de la Côte basque espagnole. Le nom de l’établissement m’évoque celui de l’un de mes éditeurs : Hugo & Cie. Or, il fait simplement référence au prénom du fils de Tomy (et renvoie au nom du restaurant espagnol qui s’y trouvait précédemment : Casa Hugo). Dans l’assiette, la patte Gousset est assurément là : produits à forte identité, saveurs puissantes, associations justes, précises et efficaces : il s’agit plutôt d’une empreinte. La Brioche vapeur « Bao » à la queue de bœuf, légumes en pickles et cacahuètes (à droite sur la photo) figure une entrée bluffante et déjà plébiscitée par les amateurs. Notons que, à l’instar de Julien Dumas (Lucas Carton) mais pas d’un Alain Passard qui possède son propre potager, les légumes cuisinés par Tomy proviennent d’une parcelle de potager qu’il détient aux Jardins (bios) du Château de Courances, dans la région de Melun, via Tomato&Co (entreprise originale proposant – aux particuliers comme aux professionnels - des parcelles sur mesure, plantées à la carte, commandées à distance et entretenues par des jardiniers). Ainsi, les asperges vertes fendues qui recouvraient des morceaux généreux de joue de bœuf snackée (d’un fondant délicieux) eux-mêmes posés sur de bonnes panisses croustillantes, étaient-elles riches en saveurs originelles. Une autre entrée
Après Tomy&Co (22, rue Surcouf, Paris 7), Tomy Gousset a ouvert Hugo&Co il y a environ un mois (48, rue Monge, Paris 5). Le jeune chef d’origine cambodgienne que l’on avait découvert au restaurant Pirouette – dont on peut dire qu’il a contribué à sculpter le succès (rue Mondétour, Paris 1) et qui, après être passé par l’école Ferrandi, a fait ses classes chez Yannick Alléno (Le Meurice), Daniel Boulud (à New York) et Alain Solivérès (Taillevent), des nuls n'est-ce pas, aime mélanger les styles culinaires (asiatique, espagnol, italien, français bien sûr) lorsqu’il sent que ça peut « tenir debout », et pas banalement pour la jouer fusion. Sa deuxième adresse – testée hier soir -, est plus cool côté carte que la première, mais aussi authentiquement bistronomique, davantage conviviale également avec, entre autres, sa grande table d’hôte trônant majestueusement, comme dans les établissements successifs de Julien Duboué (Afaria, Dans les Landes mais à Paris, A Noste). Il y a aussi un petit comptoir qui permet de déguster côte à côte tout en parlant « au vol » avec le chef, lequel achève de dresser chaque assiette avec une méticulosité d’horloger genevois de ses dix doigts que prolongent des avant-bras abondamment tatoués (désormais, les jeunes chefs non tatoués se comptent justement sur les doigts d’une main. Par bonheur, ils ne passent pas tous plusieurs heures par semaine chez leur coiffeur spécialiste de la coupe footeux). Tomy dresse donc, en gardant un œil sur la salle et l’autre en cuisine – appelons cela l’indispensable strabisme divergeant du boss, et non sans avoir les deux oreilles à l’écoute (totale), en lançant de temps à autre quelques mots (d’ordre) secs et d’une redoutable efficacité immédiate : c’est le côté chef d’orchestre sans baguette. La décoration est, disons : roots (cagettes aux murs ornées de bouteilles et de plantes, par exemple), qui rappelle les bistrots new-yorkais et les lieux actuellement branchés de la Côte basque espagnole. Le nom de l’établissement m’évoque celui de l’un de mes éditeurs : Hugo & Cie. Or, il fait simplement référence au prénom du fils de Tomy (et renvoie au nom du restaurant espagnol qui s’y trouvait précédemment : Casa Hugo). Dans l’assiette, la patte Gousset est assurément là : produits à forte identité, saveurs puissantes, associations justes, précises et efficaces : il s’agit plutôt d’une empreinte. La Brioche vapeur « Bao » à la queue de bœuf, légumes en pickles et cacahuètes (à droite sur la photo) figure une entrée bluffante et déjà plébiscitée par les amateurs. Notons que, à l’instar de Julien Dumas (Lucas Carton) mais pas d’un Alain Passard qui possède son propre potager, les légumes cuisinés par Tomy proviennent d’une parcelle de potager qu’il détient aux Jardins (bios) du Château de Courances, dans la région de Melun, via Tomato&Co (entreprise originale proposant – aux particuliers comme aux professionnels - des parcelles sur mesure, plantées à la carte, commandées à distance et entretenues par des jardiniers). Ainsi, les asperges vertes fendues qui recouvraient des morceaux généreux de joue de bœuf snackée (d’un fondant délicieux) eux-mêmes posés sur de bonnes panisses croustillantes, étaient-elles riches en saveurs originelles. Une autre entrée remarquable (à gauche sur la photo) est composée de fines tranches de bœuf fumé (une chiffonade d’une délicatesse de dentellière) accompagnées de noisettes torréfiées. De même, un autre plat mémorable (puisque j’y dînais en compagnie de mon fils) – nous avons d'ailleurs parié qu’il serait appelé à connaître le succès, s’intitule maquereaux tiédis et sauce chimichurri (condiment argentin légèrement pimenté) fregolas (petites pâtes sardes en forme de mini boulettes) et shitakés (champignons), et enfin pignons de pin : un délice d’harmonie des flaveurs. Une impression générale se dégage de ce repas (sans desserts : une autre fois), c’est celle de douceur, de moelleux, de régressif même (ainsi que je l’avais fortement ressenti en découvrant il y a dix-neuf ans le talent de Philippe Conticini), même si Tomy Gousset prend soin de flatter l’ouïe avec du croquant, voire du croustillant ici et là : pickles, asperges, noisettes, pignons, surface des panisses comme celle des shitakés... Ça « envoie », et ça « ping-pongue » agréablement, mais la douceur l’emporte au gong, et il y a par ailleurs cette touche générale et délicate de fumé qui semble inspirer, survoler la cuisine. Un mot sur la remarquable carte des vins qui fait la part belle aux blancs, même si l’on y lit des noms de vignerons, en bio pour la plupart, et bien « dans le verre du temps », puisque nous les retrouvons dans nombre d’adresses – car, justement, cela fait toujours du bien de se dire : Té ! On va prendre Les Reflets, de Thierry Michon, c'est toujours super ! Et puis, ça rassure, on est bien, là. Un superlatif pour le service, car il est sincèrement formidable : efficace, prévenant, souriant, aimable, discret. La note ? Entrées de 7 à 16€ (12 pour les deux citées), de 16 à 19€ pour les plats (19 pour les deux cités), excepté les 600 g de faux filet maturé et fumé au foin & jus à la moelle, pour deux personnes : 70€, qui ne perdent d’ailleurs rien pour attendre !.. Desserts : 9€. Coefficient multiplicateur raisonnable pratiqué sur la cave. L’adresse étant d’ores et déjà full up, il est, comme on dit, prudent de réserver en composant le 09 53 92 62 77. L.M.
remarquable (à gauche sur la photo) est composée de fines tranches de bœuf fumé (une chiffonade d’une délicatesse de dentellière) accompagnées de noisettes torréfiées. De même, un autre plat mémorable (puisque j’y dînais en compagnie de mon fils) – nous avons d'ailleurs parié qu’il serait appelé à connaître le succès, s’intitule maquereaux tiédis et sauce chimichurri (condiment argentin légèrement pimenté) fregolas (petites pâtes sardes en forme de mini boulettes) et shitakés (champignons), et enfin pignons de pin : un délice d’harmonie des flaveurs. Une impression générale se dégage de ce repas (sans desserts : une autre fois), c’est celle de douceur, de moelleux, de régressif même (ainsi que je l’avais fortement ressenti en découvrant il y a dix-neuf ans le talent de Philippe Conticini), même si Tomy Gousset prend soin de flatter l’ouïe avec du croquant, voire du croustillant ici et là : pickles, asperges, noisettes, pignons, surface des panisses comme celle des shitakés... Ça « envoie », et ça « ping-pongue » agréablement, mais la douceur l’emporte au gong, et il y a par ailleurs cette touche générale et délicate de fumé qui semble inspirer, survoler la cuisine. Un mot sur la remarquable carte des vins qui fait la part belle aux blancs, même si l’on y lit des noms de vignerons, en bio pour la plupart, et bien « dans le verre du temps », puisque nous les retrouvons dans nombre d’adresses – car, justement, cela fait toujours du bien de se dire : Té ! On va prendre Les Reflets, de Thierry Michon, c'est toujours super ! Et puis, ça rassure, on est bien, là. Un superlatif pour le service, car il est sincèrement formidable : efficace, prévenant, souriant, aimable, discret. La note ? Entrées de 7 à 16€ (12 pour les deux citées), de 16 à 19€ pour les plats (19 pour les deux cités), excepté les 600 g de faux filet maturé et fumé au foin & jus à la moelle, pour deux personnes : 70€, qui ne perdent d’ailleurs rien pour attendre !.. Desserts : 9€. Coefficient multiplicateur raisonnable pratiqué sur la cave. L’adresse étant d’ores et déjà full up, il est, comme on dit, prudent de réserver en composant le 09 53 92 62 77. L.M.
 Rosé 2017 : L’Impertinent du château des Estanilles (Faugères). Grenache, Cinsault plus 10% de Mourvèdre ont passé six mois en cuves inox. Robe pâle, diaphane. Joli nez de framboise mûre et de fraise, d’ananas à point aussi. Bouche douce, sans aspérité ni agressivité (comme c'est trop souvent le cas, avec ces violentes notes d’agrumes que l’on a fini par détester, car elles ne nous éloignent pas du vin et donc du raisin : elles nous en exilent !). C’est minéral et d’une grande fraîcheur fruitée – avec une discrète pointe d’acidité en fin de bouche, plutôt bienvenue, « nettoyante ». Un rosé qui appelle à la rescousse les filets de rougets grillés et posés sur une tapenade noire, puis une caponata un peu relevée, déposée contre des côtelettes d’agneau (11€). L.M.
Rosé 2017 : L’Impertinent du château des Estanilles (Faugères). Grenache, Cinsault plus 10% de Mourvèdre ont passé six mois en cuves inox. Robe pâle, diaphane. Joli nez de framboise mûre et de fraise, d’ananas à point aussi. Bouche douce, sans aspérité ni agressivité (comme c'est trop souvent le cas, avec ces violentes notes d’agrumes que l’on a fini par détester, car elles ne nous éloignent pas du vin et donc du raisin : elles nous en exilent !). C’est minéral et d’une grande fraîcheur fruitée – avec une discrète pointe d’acidité en fin de bouche, plutôt bienvenue, « nettoyante ». Un rosé qui appelle à la rescousse les filets de rougets grillés et posés sur une tapenade noire, puis une caponata un peu relevée, déposée contre des côtelettes d’agneau (11€). L.M.

Champagne rosé : Chassenay d’Arce. Un joli brut (Pinot
noir/Chardonnay : 65/35) de la Côte des Bar ayant mûri trois ans en cave (et trois mois après dégorgement). Chassenay d'Arc est une Maison de Vignerons (rassemblant 130 familles qui exploitent 325 hectares). Robe saumonée dense et luisante. Cordon discret. Flaveurs de petits fruits rouges frais, et aussi confits. Bouche ample et suave où l’on retrouve la fraise mûre et une pointe épicée mais douce. À tenter pour vivifier un tataki de thon rouge tiède – sans soja, puis avec un dessert ton sur ton : une coupe de gariguettes nature – sans basilic (24,90€). L.M.
 Rosé 2017 : Cuvée Le Village, du domaine de la Métairie d’Alon (IGP Pays d’Oc, bio). Il s’agit d’un Pinot noir vinifié comme un vin blanc (pressurage direct), par des Bourguignons installés en Languedoc (Catherine et Laurent Delaunay). Robe pâle, nez nettement minéral, soutenu de fruits rouges (cassis, framboise), note d’agrumes discrète, bouche d’une grande fraîcheur. À tenter avec du lapin ou des rougets, les deux escortés d’une tapenade noire (13,95€).
Rosé 2017 : Cuvée Le Village, du domaine de la Métairie d’Alon (IGP Pays d’Oc, bio). Il s’agit d’un Pinot noir vinifié comme un vin blanc (pressurage direct), par des Bourguignons installés en Languedoc (Catherine et Laurent Delaunay). Robe pâle, nez nettement minéral, soutenu de fruits rouges (cassis, framboise), note d’agrumes discrète, bouche d’une grande fraîcheur. À tenter avec du lapin ou des rougets, les deux escortés d’une tapenade noire (13,95€).
Rosé 2017 : Chinon de René Couly, 100% Cabernet franc, est forcément empreint de douceur, il y a presque un note sucrée. La robe est profonde, sombre, le nez de fraise est généreux, et la bouche est ample, avec une note de bonbon acidulé et une pointe légère de cédrat confit. Idéal pour accompagner la cuisine asiatique (7,10€).
Couly, 100% Cabernet franc, est forcément empreint de douceur, il y a presque un note sucrée. La robe est profonde, sombre, le nez de fraise est généreux, et la bouche est ample, avec une note de bonbon acidulé et une pointe légère de cédrat confit. Idéal pour accompagner la cuisine asiatique (7,10€).
 Rosé 2017 : Cuvée Villa La vie en rose, de l’avisé négociant du Sud-Ouest Osmin & Cie. Le champion de la mise en avant des cépages autochtones, propose une négrette (le cépage de Fronton) et rend ainsi hommage à la ville rose (Toulouse). Jolie robe pâle, nez flatteur et généreux de petits fruits rouges, d’une grande fraîcheur. Bouche douce, suave, sans sucrosité ni notes d’agrumes : le bonheur. C’est élégant, cela peut accompagner l’apéro et aussi bien escorter un repas de l’entrée au dessert (cuisine de la mer, asiatique, italienne, espagnole). Coup de cœur (7,50€).
Rosé 2017 : Cuvée Villa La vie en rose, de l’avisé négociant du Sud-Ouest Osmin & Cie. Le champion de la mise en avant des cépages autochtones, propose une négrette (le cépage de Fronton) et rend ainsi hommage à la ville rose (Toulouse). Jolie robe pâle, nez flatteur et généreux de petits fruits rouges, d’une grande fraîcheur. Bouche douce, suave, sans sucrosité ni notes d’agrumes : le bonheur. C’est élégant, cela peut accompagner l’apéro et aussi bien escorter un repas de l’entrée au dessert (cuisine de la mer, asiatique, italienne, espagnole). Coup de cœur (7,50€).
 Rosé 2014 « de gastronomie » : cuvée Légende du domaine Estandon (Côtes de Provence). Flacon très classe pour ce rosé haut de gamme (Grenache et Rolle) tablant sur la garde, soit à contre-courant de tous ces rosés provençaux qui ne tiennent qu’un été, certains péniblement. Robe profonde, brillante, nez de fruits secs, de melon, avec une pointe exotique. Bouche franche et longue, fraîche et pleine, épicée sur la fin, avec des notes de fruits confits du plus bel effet. Idéal sur une poularde crémée, un lapin herbé, un poisson de roche grillé (18,90€).
Rosé 2014 « de gastronomie » : cuvée Légende du domaine Estandon (Côtes de Provence). Flacon très classe pour ce rosé haut de gamme (Grenache et Rolle) tablant sur la garde, soit à contre-courant de tous ces rosés provençaux qui ne tiennent qu’un été, certains péniblement. Robe profonde, brillante, nez de fruits secs, de melon, avec une pointe exotique. Bouche franche et longue, fraîche et pleine, épicée sur la fin, avec des notes de fruits confits du plus bel effet. Idéal sur une poularde crémée, un lapin herbé, un poisson de roche grillé (18,90€).
Rosé 2017 : Cuvée Jeanne B. du domaine Brusset, Côtes-du-Rhône (Grenache, Cinsault, Syrah). Une robe de belle tenue, un nez franc de fraise mûre, une bouche assez longue, un vin friand qui appelle les copains pour l’apéro (7,50€).
Côtes-du-Rhône (Grenache, Cinsault, Syrah). Une robe de belle tenue, un nez franc de fraise mûre, une bouche assez longue, un vin friand qui appelle les copains pour l’apéro (7,50€).
 Blanc 2015 : Cuvée Caroline du château de Chantegrive, Graves (Sémillon et Sauvignon 50/50) en culture raisonnée. Un de nos chouchous, aussi charmant que sa propriétaire, Marie-Hélène Lévêque. Un nez souple et intense à la fois où dominent les fleurs blanches, une bouche suave à peine boisée, avec des notes briochée, de pêche et d’abricot. Une grande douceur. Formidable avec un ceviche de Saint-Jacques et algues japonaises (le 29 mars dernier au restaurant Apicius, à Paris, repris depuis peu par Mathieu Pacaud – lequel succède au grand Jean-Pierre Vigato : lourd challenge…). 16,50€.
Blanc 2015 : Cuvée Caroline du château de Chantegrive, Graves (Sémillon et Sauvignon 50/50) en culture raisonnée. Un de nos chouchous, aussi charmant que sa propriétaire, Marie-Hélène Lévêque. Un nez souple et intense à la fois où dominent les fleurs blanches, une bouche suave à peine boisée, avec des notes briochée, de pêche et d’abricot. Une grande douceur. Formidable avec un ceviche de Saint-Jacques et algues japonaises (le 29 mars dernier au restaurant Apicius, à Paris, repris depuis peu par Mathieu Pacaud – lequel succède au grand Jean-Pierre Vigato : lourd challenge…). 16,50€.
Blanc 2017 : Goûté à l’apéritif, la robe encore trouble comme un de ces vins bourrus, un « bourret », que l’on boit à la régalade en palombière accompagné de châtaignes grillées, de mûres, de quelques pommes acides et de raisin… La cuvée Caroline 2017 fait figure de rescapée, voire de miraculée des gelées du 27 au 29 avril qui ont ruiné l’intégralité du Chantegrive 2017 rouge, et surtout d’un orage de grêle d’une violence rare que les blancs ont pris de plein fouet le 27 août, la veille des vendanges. Ramassés rapidement, les raisins à pleine maturité furent très peu nombreux, mais le vin dont ils sont issus présente d’ores et déjà une complexité aromatique prometteuse, au sein de laquelle la pêche de vigne vole habilement leur (soi-disant) priorité aux agrumes, l’air de dire : y’en a marre... À regoûter dans quelques mois.
 Blanc 2015 : Rareté du domaine – lequel a obtenu la certification HVE 3 (Haute valeur environnementale), soit le top, partagé avec 120 domaines à peine dans l’hexagone -, notons que le Cérons 2015 est un pur joyau. Chantegrive produit 5 000 bouteilles à chaque millésime d’exception. Cela faisait d’ailleurs dix ans qu’il n’y en avait pas eu, de ce liquoreux injustement méconnu. Cette petite appellation voisine de Cadillac, Loupiac, Barsac, Sainte-Croix du Mont et Sauternes, produit depuis toujours des blancs moins gras, plus vifs et plus nerveux que la plupart de ceux du Sauternais. Un 100% Sémillon (idéal avec le soufflé au chocolat de Mathieu Pacaud, mais aussi pour épauler une poularde à la crème, ou bien pour escorter un fromage à pâte persillée), avec sa robe dorée, son nez miellé, épicé, sa fraîcheur généreuse en bouche dotée de notes confites, est un ravissement que l’on a tendance à négliger, voire à oublier, à notre époque autoritairement light. (30€).
Blanc 2015 : Rareté du domaine – lequel a obtenu la certification HVE 3 (Haute valeur environnementale), soit le top, partagé avec 120 domaines à peine dans l’hexagone -, notons que le Cérons 2015 est un pur joyau. Chantegrive produit 5 000 bouteilles à chaque millésime d’exception. Cela faisait d’ailleurs dix ans qu’il n’y en avait pas eu, de ce liquoreux injustement méconnu. Cette petite appellation voisine de Cadillac, Loupiac, Barsac, Sainte-Croix du Mont et Sauternes, produit depuis toujours des blancs moins gras, plus vifs et plus nerveux que la plupart de ceux du Sauternais. Un 100% Sémillon (idéal avec le soufflé au chocolat de Mathieu Pacaud, mais aussi pour épauler une poularde à la crème, ou bien pour escorter un fromage à pâte persillée), avec sa robe dorée, son nez miellé, épicé, sa fraîcheur généreuse en bouche dotée de notes confites, est un ravissement que l’on a tendance à négliger, voire à oublier, à notre époque autoritairement light. (30€).
Muscadet : à la faveur d’une belle et large dégustation des « Vins de Nantes » en février dernier à Paris, nous avons relevé dans nos filets quelques poissons secs issus de Melon de Bourgogne pas piqués des vers de vase. Parmi les crus du Muscadet (je ne jure plus que par les crus communaux), Le domaine David 2012, à Vallet (Goulaine) impose son amplitude, son gras, sa générosité, sa rondeur et son acidité bien tempérée (10€). Du côté de la Haye Fouassière, le domaine de la Foliette 2010 présente un joli équilibre (10,80€). À Monnières Saint-Fiacre, Véronique Günther-Chéreau propose L’Ancestrale Monnières 2014 qui offre une souplesse remarquable mais sans suivi – car ça manque un peu de corps (12€). En revanche, en Muscadet Sèvre-et-Maine sur Lie tout simple, le Comte Saint-Hubert, dans les millésimes 1989 (une tension remarquable), 2000 (perlant mais fuyant), et surtout 2014, déjà puissant, gras, prometteur, étonne le palais.
de Nantes » en février dernier à Paris, nous avons relevé dans nos filets quelques poissons secs issus de Melon de Bourgogne pas piqués des vers de vase. Parmi les crus du Muscadet (je ne jure plus que par les crus communaux), Le domaine David 2012, à Vallet (Goulaine) impose son amplitude, son gras, sa générosité, sa rondeur et son acidité bien tempérée (10€). Du côté de la Haye Fouassière, le domaine de la Foliette 2010 présente un joli équilibre (10,80€). À Monnières Saint-Fiacre, Véronique Günther-Chéreau propose L’Ancestrale Monnières 2014 qui offre une souplesse remarquable mais sans suivi – car ça manque un peu de corps (12€). En revanche, en Muscadet Sèvre-et-Maine sur Lie tout simple, le Comte Saint-Hubert, dans les millésimes 1989 (une tension remarquable), 2000 (perlant mais fuyant), et surtout 2014, déjà puissant, gras, prometteur, étonne le palais.
 Vers Mouzillon-Tillières, la GAEC Luneau Michel et fils, en présentant Tradition Stanislas 2003 (10,30€), fait un carton, car c’est superbe ! L’expression aromatique, la douceur, le gras, la rondeur et la suavité le disputent à une puissance retenue, délicate. Top. Vers Vallet, le domaine Petiteau 2012 désigne à nos papilles concentrées un équilibre acidité-fraîcheur des plus justes, avec cette amplitude en bouche qui fait tendre le verre vide vers la bouteille encore pleine (9€). Pour finir en Muscadet Sèvre-et-Maine sur lie, la GAEC Olivier, Père et fils, domaine de la Grenaudière, est étonnement présent dans le millésime 1978, pourvu d’une acidité et d’une expression aromatique vivaces. Le 1980 envoie une finale étonnamment puissante, fruitée bien que confite. Le 1986 garde une tenson et une force quasi musculaire.
Vers Mouzillon-Tillières, la GAEC Luneau Michel et fils, en présentant Tradition Stanislas 2003 (10,30€), fait un carton, car c’est superbe ! L’expression aromatique, la douceur, le gras, la rondeur et la suavité le disputent à une puissance retenue, délicate. Top. Vers Vallet, le domaine Petiteau 2012 désigne à nos papilles concentrées un équilibre acidité-fraîcheur des plus justes, avec cette amplitude en bouche qui fait tendre le verre vide vers la bouteille encore pleine (9€). Pour finir en Muscadet Sèvre-et-Maine sur lie, la GAEC Olivier, Père et fils, domaine de la Grenaudière, est étonnement présent dans le millésime 1978, pourvu d’une acidité et d’une expression aromatique vivaces. Le 1980 envoie une finale étonnamment puissante, fruitée bien que confite. Le 1986 garde une tenson et une force quasi musculaire.
Preuve que le Melon ne se bonifie pas, mais qu’il explose littéralement de qualités en vieillissant sous terre dans des cuves en béton, peinard… L.M. (à suivre)
Ma dernière chronique J'aime, dans la septième et ultime livraison de INTERCALÉ (ex FLAIR-Play) : cliquez sur => INTERCALÉ-7-Leon.pdf


Ce matin, je me suis levé tôt, j'ai bu du café, puis je suis sorti, j'ai acheté la presse, un croissant que j'ai aussitôt dévoré en mettant plein de feuilletage sur mon écharpe... C'est passionnant, n'est-ce pas? -Vous allez voir : J'ai alors observé mes congénères. Et bien figurez-vous que j'en ai vu plusieurs, deux-trois, si-si, qui ne regardaient pas et ne tapotaient pas sur leur téléphone en marchant. Je vous jure que c'est vrai. Bon, évidemment, j'ai évité pas mal de collisions avec tous les autres zombies, et je me suis dit : si je leur demandais quelle est la couleur du ciel aujourd'hui, ils ne sauraient répondre.
Ci-dessous, sur des sujets voisins comme l'urgence de capturer au lieu de vivre, l'absorption de tout l'être par la bonde de l'écran, l'inquiétante addiction des jeunes à leur prison psychique (le smartphone), le curieux besoin d'être en public mais reclus avec son ordinateur portable, le côté si insolite (et bientôt très classe) de lire un journal, l'outrecuidance d'utiliser un ordinateur portable au restaurant (comme celle, honnie, de téléphoner dans les transports en commun), etc., voici des illustrations pathétiquement vraies de notre époque, signées du satiriste autrichien Gerhard Haderer, au regard acide, sans concession et un rien désabusé. L.M.

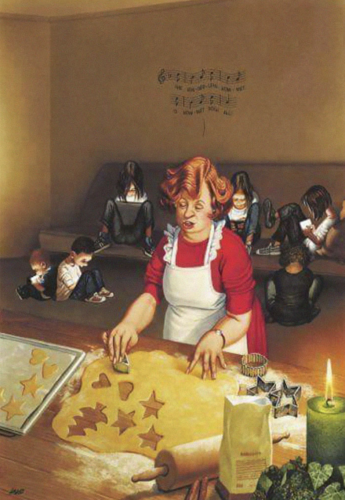

 Ce matin, une douceur printanière semble vouloir prendre possession de la ville en dépit d’une grisaille et d’une humidité persistantes jouant à cache-cache avec un soleil généreux lorsqu'il se pousse du coude. J’aperçois un couple de mésanges bleues sur un acacia. Les deux boulettes fines volètent frénétiquement de branche en branche - les mésanges sont sans cesse à leur affaire, qui est de se nourrir. Elles m'évoquent (et ce n'est pas gentil pour elles), les rats de coquetèles, qui semblent affamés tant ils s'empiffrent comme des porcs, lors que la plupart sont des gens aisés et plutôt gras.
Ce matin, une douceur printanière semble vouloir prendre possession de la ville en dépit d’une grisaille et d’une humidité persistantes jouant à cache-cache avec un soleil généreux lorsqu'il se pousse du coude. J’aperçois un couple de mésanges bleues sur un acacia. Les deux boulettes fines volètent frénétiquement de branche en branche - les mésanges sont sans cesse à leur affaire, qui est de se nourrir. Elles m'évoquent (et ce n'est pas gentil pour elles), les rats de coquetèles, qui semblent affamés tant ils s'empiffrent comme des porcs, lors que la plupart sont des gens aisés et plutôt gras.
Cette simple observation d'un couple d'oiseaux fragiles et menus sur de frêles branches (à l'instar de cet arbre peint par Egon Schiele), m'emplit de bonheur. Une certaine forme de délicatesse inscrit ce début de semaine dans la paix. Me viennent des vers que j'ai souvent en tête, de Giuseppe Ungaretti :
La vie lui est d'un poids énorme
Comme aile d'abeille morte
À la fourmi qui la traîne.
---
La vita gli è di peso enorme
Come liggiù quell'ale d'ape morta
Alla formicola che la trascina.
Je réalise tout à trac que le « chien » - je nomme ainsi ce blog, a déjà douze ans. Je me revois l'ouvrant sur les bons conseils de mon amie Alina Reyes, chez elle : T’embêtes pas à créer un site, un blog suffit. 26 mars 2006 - 26 mars 2018. Je ne découvre qu'à l'instant une funeste coïncidence avec l’anniversaire du massacre de la rue d'Isly à Alger (le 26 mars 1962, l'armée française tire sur la foule de ses compatriotes venus manifester pacifiquement. Bilan : 80 morts, 200 blessés. Je ne m'étendrai pas).
Je pense surtout à ce chiffre devenu fétiche, puisqu’il désigne l'alphabet, et que sans ses 26 lettres je ne suis rien et nous sommes peu de choses. C'est un chiffre auquel je rends hommage chaque fois que possible : avec mon livre 26 villages pyrénéens par exemple. Voire avec Les bonheurs de l'aube, même si j'ai échoué à l’emplir de vingt-six nouvelles, car j'écrivis les vingt qui le composent en un lieu enchanteur, l'île de Formentera et que, de retour à la brutalité de la grande ville, mon bras bloqua et la plume sécha...
Voici donc KallyVasco, 12 ans d’âge comme un single malt déjà fait, 1 627 articles, 3 835 commentaires. Des visiteurs toujours plus nombreux et des pages consultées par centaines, voire par milliers chaque jour. Avant l'irruption, l'invasion des réseaux sociaux, les commentaires abondaient, ici même. À présent, comme je reproduis mes articles insérés dans KallyVasco, à la fois sur mon compte Twitter et sur ma page Facebook, c'est sur cette dernière plateforme (sans doute plus simple d'utilisation), que ça réagit avec prédilection.
Il y a ainsi dans le ventre de ce blog des archives à foison pour y flâner : nourritures terrestres et spirituelles, livres, vins, voyages, sensations, billets d'humeur, d'humour, amour, amitié, images, sons - soit des plaisirs simples en partage avec vous, dont je loue la fidélité. Tel est mon beau souci. Et puisque j'ai créé KallyVasco afin de « faire passer » l'émotion décrite davantage qu'écrite, the chien must go on. L.M.













Vous ne trouvez pas qu’il y en a marre de ces rosés chargés de flaveurs d’agrumes, au nez comme en bouche ? Certains sont si rebutants qu’ils ne donnent pas envie d’aller au-delà d’un paresseux et dépité reniflage car, loin d’exposer au moins un nez de pomelo rose et mûr, plus sucré qu’acide, ils envoient une charge de pamplemousse jaune pas mûr et à la peau épaisse. C’est tout simplement désagréable, lorsque nous savons que nous tenons un verre de vin en main, et qu’il est issu de raisin. Même au petit-déjeuner, on n’en voudrait pas en jus pressé. Nous évoquons pourtant ici les rosés de l’été (millésime 2017, sauf exception précisée).
Mais, cette tendance qui obéit à une mode (je m’interroge sur l’obscur objet du désir de retrouver de tels arômes lorsqu’on déguste un vin frais, mais bon…), s’impose et semble avoir l’oreille dure et le regard obtus.
À LA RECHERCHE DU RAISIN PERDU
Récemment, et grâce à la complicité hautement professionnelle de l'agence Clair de Lune, nous avons pu découvrir (au restaurant Baltard au Louvre, à Paris 1er, le 7 mars dernier), et donc déguster quantité de rosés (soixante-treize, pour être précis) de Provence 2017, dans les AOC suivantes : Côtes de Provence, Côtes de Provence Sainte-Victoire, Côtes de Provence La Londe, Côtes de Provence Pierrefeu, Coteaux d’Aix-en-Provence, Coteaux Varois en Provence. Beaucoup possédaient cette caractéristique qui, à mes papilles, constitue une aberration rédhibitoire. Nous ne les citerons évidemment pas. Ce sont ceux qui, sur mon carnet de dégustation, portent juste les trois lettres « agr. » pour agrumes, et qui me signifient non sans coup férir. Voire aaarrrghhh, soit aigre. D’autres comportent les initiales « b.a. » pour bonbon acidulé – une autre caractéristique au long cours, une résistante à oeillères, bien qu’aussi ringarde que la crème catalane au dessert et le couple de pompons sur les mocassins.
 En revanche, d’aucuns, les happy few, se révélèrent fidèles à une certaine vinosité, à une acidité juste, un fruité équilibré, un abord friand qui appelle les copains et la charcuterie ou les poissons de roche grillés à la rescousse. Bref, la plupart sentaient quand même l’apéro des beaux jours et le far niente d’un printemps et d’un été à conquérir au limonadier. Leurs flacons sont photographiées ci-dessus.
En revanche, d’aucuns, les happy few, se révélèrent fidèles à une certaine vinosité, à une acidité juste, un fruité équilibré, un abord friand qui appelle les copains et la charcuterie ou les poissons de roche grillés à la rescousse. Bref, la plupart sentaient quand même l’apéro des beaux jours et le far niente d’un printemps et d’un été à conquérir au limonadier. Leurs flacons sont photographiées ci-dessus.
SÉLECTION PARSÉVÈRE
- Ainsi de la puissante cuvée Virginie du château Angueiroun (Côtes de Provence), une Réserve dotée d’un nouvel habillage, et dominée par la, ou le grenache (j’hésite toujours, et avec d’autres cépages aussi, que j’aime féminiser ou pas, c’est selon) : 13€.
- La cuvée Tendance (?) du domaine Clos Cibonne (Cru classé, Côtes de Provence) possède une belle matière tant au nez qu’en bouche - assez longue cette dernière -, et son fruité ne fait pas semblant de l’être (15€).
- La cuvée Le rosé secret, du domaine des Sarrins (Côtes de Provence), 23€ quand même – il faudra que j’écrive bientôt un papier sur le prix devenu dingo de certains rosés…-, est plaisant, herbacé, vert mais gras : allez comprendre des fois la magie des contraires, l’équilibre de la carpe qui tend sa nageoire au lapin !
- La cuvée Terres du Loou, du domaine éponyme (Coteaux varois en Provence) exprime une vinosité idoine et salutaire par les bibines qui courent. C’est complexe, riche, opulent même en fin de bouche. Et ça ne coûte que 8€ : avis aux buveurs d’étiquettes !..
- La cuvée Marie-Christine, du château de l’Aumérade (Cru classé, Côtes de Provence) est un vin doté d’un équilibre remarquable, aromatique à souhait, les fruits à chair blanche et jaune s’y fleurent à plein nez et s'y croquent à belle bouche (13€).
- Parmi les « classiques », la cuvée Clarendon du domaine Gavoty (Côtes de Provence) séduit par sa légèreté florale, sa délicatesse de dentelle qu’un coup d’étrier corsé contredit en arrière-bouche : il y a de l’esprit Carmen dans le verre, et nous aimons cela (15€).
- Le château Coussin de la famille Sumeire, 13€ (Côtes de Provence), ou une autre cuvée familiale, César à Sumeire Coussin, 22€ (Côtes de Provence Sainte-Victoire), comme la cuvée Rose et Or du célébrissime château Minuty, 22€ (Côtes de Provence), ont déçu. Mollesse ici, excès d’agrumes là. Et pas d'avantage à donner non plus à la cuvée Confidentielle de Figuière, 25,60€ (Côtes de Provence La Londe). Pour ne citer que quelques stars.
- Le Château, cuvée du château Beaupré (Coteaux d’Aix-en-Provence) est d’une suavité rare (10,50€).
- La cuvée Syagria du domaine La Gayolle (Coteaux Varois en Provence) est assez intéressant, car il retient avec l’amplitude de sa bouche, fraîche et généreuse en diable. Un point spécial pour l’originalité de la forme du flacon, laquelle se discute (9,50€).
- La cuvée Pierres Précieuses, du domaine Croix-Rousse, - en biodynamie - (Côtes de Provence 2016, 17€), expose une jolie douceur lascive à la Gauguin, à peine troublée par des saveurs susurrées façon « La pie qui chante », vous voyez ?..
- Le sérieux surgit tout à trac de la cuvée La Londe, du domaine Les Fouques (Côtes de Provence La Londe, 11,50€), en biodynamie lui aussi, vineux et léger à la fois : c’est un militaire en permission…
- La cuvée Réal Rosé du Clos Réal (Côtes de Provence) possède une discrète complexité aromatique qui appelle la charcuterie au secours comme Roland à Roncevaux afin que cesse une certaine boucherie. C’est délicat, ça coûte à peine 8,70€ et c’est en biodynamie. Que demande le peuple ?
- Et bien que le domaine des Hauts du Clos, biodynamique Côtes de Provence à 8€ soit à la hauteur. Mais non. Ceci est juste acidulé convenablement, doux et agréable : voici – néanmoins - le vin de l’apéro de l’été : sans chichis et amical à mort.
- Quant au meilleur (selon notre jugement), gardé pour la fin, il se nomme Silice, cuvée du château Gasqui, à la robe profonde, presque « clairet », au nez très soutenu, à la bouche charnue gourmande, à ce vin vrai qui se mâche, et pourvu d’une excellente nervosité jusqu'au bout de l'arrière luette. À ce stade de France, nous convoquons illico presto des rougets grillés comme s’il en pleuvait, ainsi que du canard laqué à hue et à dia – et pourquoi pas ? C’est là encore en biodynamie (Ecocert, Demeter), c’est en Côtes de Provence (2016), cela coûte 12,50€ et ça les vaut. Vraiment. L.M.
du château Gasqui, à la robe profonde, presque « clairet », au nez très soutenu, à la bouche charnue gourmande, à ce vin vrai qui se mâche, et pourvu d’une excellente nervosité jusqu'au bout de l'arrière luette. À ce stade de France, nous convoquons illico presto des rougets grillés comme s’il en pleuvait, ainsi que du canard laqué à hue et à dia – et pourquoi pas ? C’est là encore en biodynamie (Ecocert, Demeter), c’est en Côtes de Provence (2016), cela coûte 12,50€ et ça les vaut. Vraiment. L.M.
Une heure de tchatche, chez Mollat à Bordeaux, le 4 décembre dernier, au sujet du livre Anglet.
Avec Florence Defos du Rau (éditrice, Passiflore), Jean-Michel Barate (Mairie d'Anglet), Sébastien Carnet (photographe), Régis Guichenducq (photographe) et moi-même => Anglet chez Mollat

Vidéo (lien ci-dessous) d'une émission signée Lionel Andia, diffusée sur TVPI, télévision locale (Pyrénées-Atlantiques, Landes).
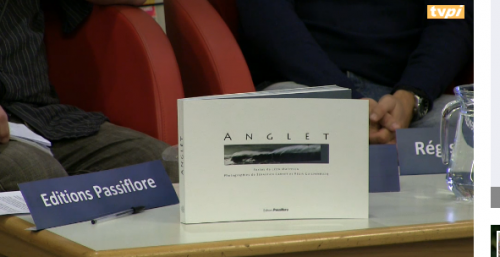





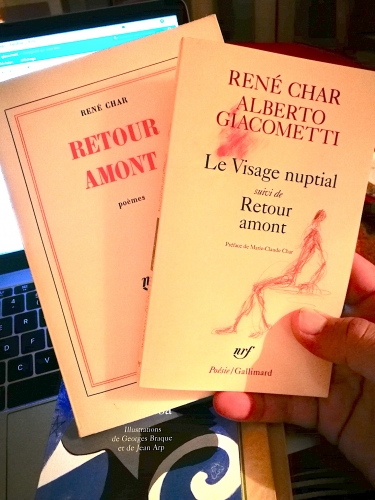 Vernissage de l’exposition René Char - Alberto Giacometti ce mardi 20 vers 19 h. à la Galerie Gallimard, à deux pas de « la Banque de France de l’édition » (l’expression est de Philippe Sollers), soit au bout de la rue Gaston-Gallimard, puis juste à droite (*).
Vernissage de l’exposition René Char - Alberto Giacometti ce mardi 20 vers 19 h. à la Galerie Gallimard, à deux pas de « la Banque de France de l’édition » (l’expression est de Philippe Sollers), soit au bout de la rue Gaston-Gallimard, puis juste à droite (*).
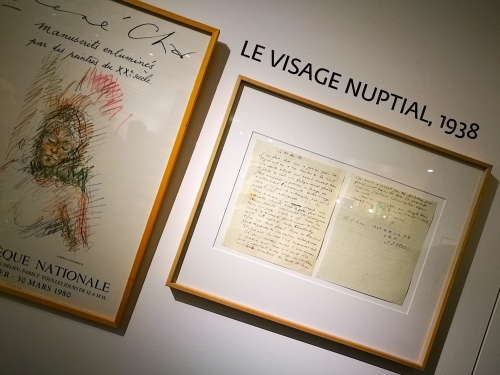

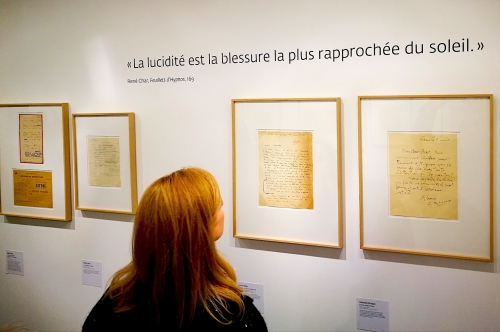


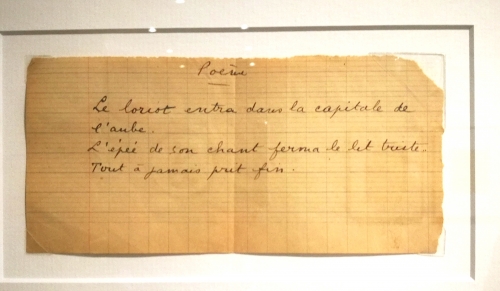
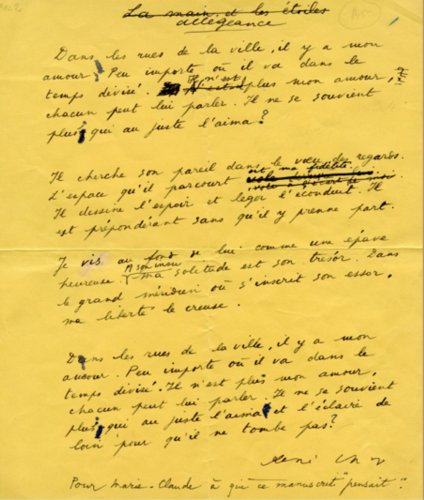
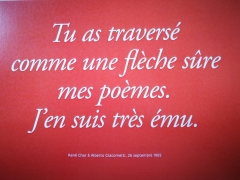


 Du beau monde, de Christiane Taubira au grand poète Adonis en passant par Vénus Khoury-Ghata, est venu ce soir pour rendre hommage à l’initiative salutaire de Marie-Claude Char, qui est simplement de continuer de faire vivre l’œuvre de René, en l'alliant comme avant avec les artistes qui entretinrent des amitiés fructueuses.
Du beau monde, de Christiane Taubira au grand poète Adonis en passant par Vénus Khoury-Ghata, est venu ce soir pour rendre hommage à l’initiative salutaire de Marie-Claude Char, qui est simplement de continuer de faire vivre l’œuvre de René, en l'alliant comme avant avec les artistes qui entretinrent des amitiés fructueuses.
LA GALERIE DES ALLIÉS SUBSTANTIELS
Cette galerie a ouvert ses portes en novembre dernier avec une exposition consacrée à Patti Smith et ses affinités littéraires - rimbaldiennes avant tout. L'un de ses buts est de renouer avec l’indéfectible compagnonnage des peintres, ces « alliés substantiels », comme les nommait Char, et des poètes, et les écrivains en général.
Voilà une cohérence qui fait plaisir à voir : Gaston entretenait déjà commerce (au sens de Montaigne, pas des argentiers) avec les artistes autant qu’avec ses auteurs. Une galerie d’art, la Galerie de la NRF, ouvrit ainsi en 1931 au sein même des locaux de la maison d’édition, rue Sébastien-Bottin, et où Fautrier – entre autres - exposa. L’expérience dura trois années.
La Galerie de la Pléiade prit le relais après la Seconde guerre mondiale, au 17 rue de l'Université. Prassinos, Masson, Dubuffet, d’autres, y accrochèrent leurs toiles, sous l’impulsion de Jean Paulhan, dont le flair et le goût étaient sûrs. L'aventure dura jusqu’en 1951.
UNE TRADITION MAISON
La Galerie Gallimard, sise au 30 rue de l'Université, constitue par conséquent le prolongement de cette formidable tradition aimant et sachant mêler, entremêler textes et œuvres graphiques issues de l’art moderne, ou brut, et contemporain, ainsi que de la BD et de la photographie de haut-vol.
Antoine Gallimard le déclare lui-même : « Si le livre est notre métier, nous savons aussi que la création littéraire est plus que jamais liée à toutes les formes d’expression culturelle et artistique, comme l’a si bien montré Malraux ».
Après une expo sur les romans de Camus (L’Étranger, Le Premier homme) illustrés par l’ami Jacques Ferrandez, voici donc – afin de célébrer les trente ans de la disparition de René Char, et les soixante-dix ans de la parution de Fureur et mystère, son recueil majeur et des plus lus, une exposition sur l’amitié forte et profondément sincère qui existât entre le poète de l’Isle-sur-la-Sorgue et le génial sculpteur et dessinateur transalpin.
La collection Poésie/Gallimard, qui change de mains puisque André Velter a pris sa retraite en passant le flambeau à Jean-Pierre Siméon, publie une édition précieuse du Visage nuptial : il s’agit d’un fac-similé sur fond beige, enrichi des œuvres de Giacometti créées pour enluminer les textes (ici manuscrits) de Char. L'ensemble est suivi de Retour amont, recueil imprégné de nature, dédié aux abords des Busclats jusqu'à la frise des Dentelles de Montmirail, rehaussé également de dessins du même artiste, tandis que Le Visage nuptial est un poème d'amour majuscule.
UNE AMITIÉ FORTE
Notons que certaines oeuvres de Giacometti ont été exécutées aux crayons de couleurs, ce qui fut rare, et détonne chez un aficionado de toujours de la mine de plomb, et du noir & blanc par principe éthique et esthétique.
Évidemment, en format de poche, cette lecture double n’est pas des plus confortables, mais bon… (le manuscrit original est détenu à la Bibliothèque nationale pour un temps... certain).
Le thème de l’exposition s’intitule « Une conversation souveraine ». Celle-ci est logiquement proposée par Marie-Claude Char, en gardienne du temple infiniment bienveillante, et qui signe d'ailleurs la préface de cette édition du Visage nuptial. À noter qu'un bref échange de correspondance entre les deux artistes figure en annexe du petit livre, et que celui-ci est entre tous éclairant quant à leur amitié forte, et leur souci d'accomplir alors - avec le concours de Guy Levis Mano, premier éditeur de ces plaquettes aujourd'hui réunies - un travail exigeant, scrupuleux, et reposant sur une évidente connivencia.
Voici donc un vrai cadeau pour tout ceux qui passeront par là avant le 14 avril : l’occasion - émouvante - de pouvoir contempler à loisir des originaux d'Alberto Giacometti, des poèmes manuscrits de René Char, comme le célèbre Allégeance, le délicat Effacement du peuplier, ou encore ce trait tragiquement génial qui signe la déclaration de guerre : 3 septembre 1939 (Le loriot entra dans la capitale de l'aube...), ainsi que des éditions rares, des estampes, des lettres, des hommages, quelques photos éparses et enfin des citations emblématiques (extraites de Fureur et mystère et des Feuillets d'Hypnos) que chaque familier de l’œuvre de Char a constamment sur le bout des lèvres. Une réussite. L.M.
---------
 (*) Galerie Gallimard, 30/32 rue de l'Université, Paris 75007, www.galeriegallimard.com : Exposition Char/Giacometti du 22 mars au 14 avril, du mardi au samedi de 13 h à 19 h. Un coin librairie permet d'acquérir éditions courantes et pour bibliophiles. Le Visage nuptial en Poésie/Gallimard coûte 9 € seulement. Prochaine exposition : André Malraux, éditeur d’extraordinaire.
(*) Galerie Gallimard, 30/32 rue de l'Université, Paris 75007, www.galeriegallimard.com : Exposition Char/Giacometti du 22 mars au 14 avril, du mardi au samedi de 13 h à 19 h. Un coin librairie permet d'acquérir éditions courantes et pour bibliophiles. Le Visage nuptial en Poésie/Gallimard coûte 9 € seulement. Prochaine exposition : André Malraux, éditeur d’extraordinaire.
Nota Bene : le buffet fut arrosé par les côtes-du-rhône basiques en blanc et en rouge de la famille Perrin. Du classique mais solide. Cohérent, là encore, avec le voisinage des vins de l'appellation Ventoux chers à Char. Nous aurions été néanmoins sensibles à davantage de complicité, soit à déguster plutôt deux Vacqueyras (un rouge, et un rare blanc). Mais, bon... Là, nous exagérons.
Addendum : je tombe sur ceci lors que je mets ce texte en ligne : http://lemde.fr/2ppZzma À suivre!.. Et ça aussi : http://www.fondation-giacometti.fr
Une fois n'est pas coutume : ce blog, dédié aux plaisirs littéraires et bachiques, aux voyages et à la gastronomie, s'ouvre exceptionnellement à un coup de calgon éprouvé hier soir à propos de Mayotte.
-----
 QUEL BORDEL !
QUEL BORDEL !
Je m'interroge sur le bordel ambiant : Le quotidien italien Il Tempo titre ce 5 mars : "Che bordello", comme suite aux résultats des élections législatives de dimanche soir qui ont vu chuter Matteo Renzi et monter les mouvements populistes de Matteo Salvini (La Ligue) ou de Luigi di Maio (Cinque Stelle), sans parler de la toujours vivace momie du vieux caïman Silvio Berlusconi et son parti, en embuscade active (et soutien de Salvini)...
De son côté, le quotidien Les Nouvelles de Mayotte titre (non sans espièglerie) sa Une et son édito de ce lundi dans les mêmes termes : "Le bordel En Marche". Car c'est vraiment le bordel dans le 101 ème département français (créé en 2011). La République semble délaisser sa population, laquelle souffre d'insécurité croissante, de précarité, de sous-équipement, de grèves depuis plus de deux semaines (des barrages bloquent partiellement l'île), de menaces lourdes de paralyser ses très prochaines élections législatives partielles (18 et 25 mars) ... En dénonçant "la brutalité" ambiante en Italie (dixit Emmanuel Macron aujourd'hui), l'exécutif semble assez peu se soucier de ses ressortissants vivant loin de métropole.
laquelle souffre d'insécurité croissante, de précarité, de sous-équipement, de grèves depuis plus de deux semaines (des barrages bloquent partiellement l'île), de menaces lourdes de paralyser ses très prochaines élections législatives partielles (18 et 25 mars) ... En dénonçant "la brutalité" ambiante en Italie (dixit Emmanuel Macron aujourd'hui), l'exécutif semble assez peu se soucier de ses ressortissants vivant loin de métropole.
Or, oui, ça chauffe, ça barde, l'atmosphère de guerre civile couve à Mayotte. Qui s'en soucie? Les Comoriens clandestins débarquant quotidiennement en terre de "welfare state" sont désormais bien plus nombreux que les Mahorais, ce qui engendre des tensions fortes, des débordements devenant insupportables (des enfants se rendent armés de "t'chombos" - machettes - à l'école : http://bit.ly/2Fpyo46), des actes de violence, des agressions, soit une délinquance ordinaire face à laquelle les autorités semblent ne pouvoir / ne vouloir faire face...
face à laquelle les autorités semblent ne pouvoir / ne vouloir faire face...  Les Français de métropole vivant dans ce département, et qui y travaillent, seraient clairement entre le marteau et l'enclume en cas d'insurrection générale.
Les Français de métropole vivant dans ce département, et qui y travaillent, seraient clairement entre le marteau et l'enclume en cas d'insurrection générale.
Ce climat délétère ressemble, par certains points, à la situation de(s trois départements de) l'Algérie en 1962, lorsque "la Grande Zohra" - le général de Gaulle - les lâcha. Nous avions "compris"... Mais qui s'inquiète de cela. Qui? Vu qu'à Mayotte, il n'y a guère de pétrole mais seulement des bananes. Et une situation géopolitique stratégique - mais, justement...
Certainement pas Gérard Collomb qui envisage de faire de l'île une Zone de sécurité prioritaire (ZSP) comme on joue à l'apprenti sorcier en effectuant des tests de vivisection. Pas davantage Annick Girardin, la ministère de l'Outre-Mer, qui saupoudre timidement en envoyant, pressée d'agir, quelques policiers en renfort (sera-ce vraiment les deux pelotons de gendarmerie annoncés, ainsi que dix policiers de la PAF, la Police aux frontières?..).
aux frontières?..).
Lorsque l'on s'aperçoit que Mayotte constitue par ailleurs un véritable désert médical où presque aucun médecin spécialiste n'exerce/ne veut venir exercer, nous pouvons craindre que cette région ultrapériphérique ne devienne aussi un désert policier, sinon un territoire où le ratio forces de l'ordre/population serait cruellement insuffisant...
 A la lecture de ces mesures jugées trop faibles par l'opinion publique de l'île, nous hésitons à qualifier ce bordel de grotesque ou bien de proie du mépris. L'édito excédé des Nouvelles de Mayotte évoque des errements, des atermoiements, une exaspération maximale qui ne sont pas des vues de l'esprit (nous nous sommes rendus sur place et avons donc pu voir, constater, un certain nombre de choses...). La Une de France Mayotte, bien que plus tendre, n'est pas en reste. Celle de Mayotte Hebdo est alarmiste.
A la lecture de ces mesures jugées trop faibles par l'opinion publique de l'île, nous hésitons à qualifier ce bordel de grotesque ou bien de proie du mépris. L'édito excédé des Nouvelles de Mayotte évoque des errements, des atermoiements, une exaspération maximale qui ne sont pas des vues de l'esprit (nous nous sommes rendus sur place et avons donc pu voir, constater, un certain nombre de choses...). La Une de France Mayotte, bien que plus tendre, n'est pas en reste. Celle de Mayotte Hebdo est alarmiste.
En attendant la visite espérée de M. Macron, Laurent Wauquiez est "opportunément" arrivé ce 5 mars sur l'île pour tenter de comprendre ce qui s'y passe... (Lire Le Figaro du jour : http://bit.ly/2FW6RFi).
Malheureusement, dans l'Etat jacobin dans lequel nous vivons, le problème de la circulation sur les voies sur berges parisiennes et l'administration catastrophique de la capitale, placée sous la férule maladroite d'Anne Hidalgo - des sujets certes fort importants - monopolisent l'attention de mes confrères devenus de plus en plus rétifs au sacro-saint "terrain", se contentant d'infos peinardes faisant du buzz et se déroulant juste au bout de leur nez. Bordel!.. L.M.
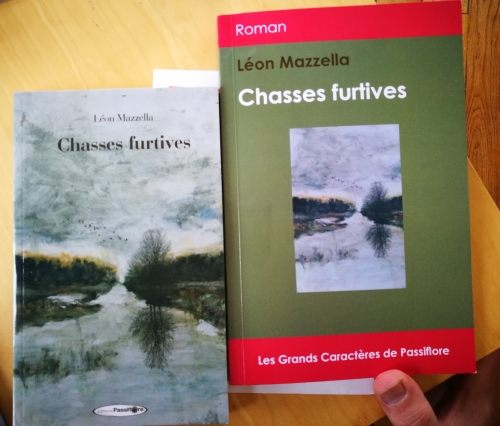 Me voici donc, avec quatre consoeurs des merveilleuses éditions Passiflore - pilotées par les talentueuses Florence Defos du Rau et Patricia Martinez -, décliné en édition grand format, saisie en corps 18 à l'attention de ceux qui aiment lire mais qui ont la vue basse, comme on dit : il s'agit, pour mes consoeurs, de Fabienne Thomas, Marie-Laure Hubert Nasser, Pascale Dewambrechies, et Chantal Detcherry.
Me voici donc, avec quatre consoeurs des merveilleuses éditions Passiflore - pilotées par les talentueuses Florence Defos du Rau et Patricia Martinez -, décliné en édition grand format, saisie en corps 18 à l'attention de ceux qui aiment lire mais qui ont la vue basse, comme on dit : il s'agit, pour mes consoeurs, de Fabienne Thomas, Marie-Laure Hubert Nasser, Pascale Dewambrechies, et Chantal Detcherry.
Cette édition a la taille d'un cahier, avec des pages lisibles de loin, confortables à bout de bras, que l'on feuillette comme un tapuscrit ou presque. J'ai personnellement la joie d'y donner à lire (en bonus) une préface dont me gratifia Michel Déon en 1995, ainsi qu'une lettre de Pierre Moinot - autre académicien, auteur d'un inoubliable Guetteur d'ombre (Prix Femina 1979), datant de la parution de ce petit bouquin en 1992. C'est la quatrième version de Chasses furtives. Après ses éditions chez J&D, puis Gerfaut, chez Passiflore en version normale, voici - et chez le même éditeur donc -, celle en Grands Caractères, laquelle prolonge d'ailleurs la version numérique (e-book). Pour que continue de vivre la littérature, faites passer! L.M.
Ci-dessous, la lettre de Pierre Moinot, et pour extrait, le début du livre :
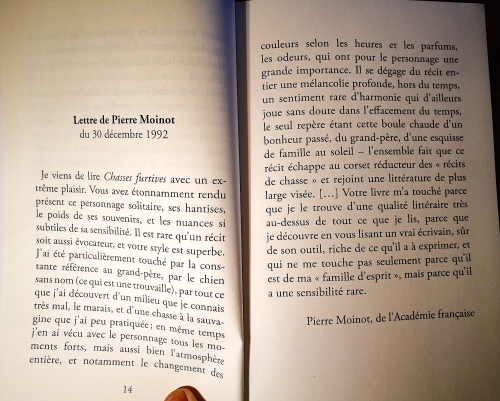
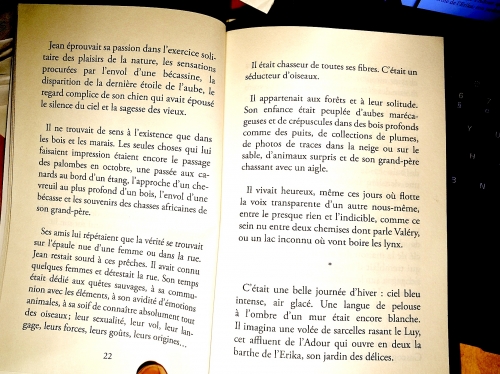
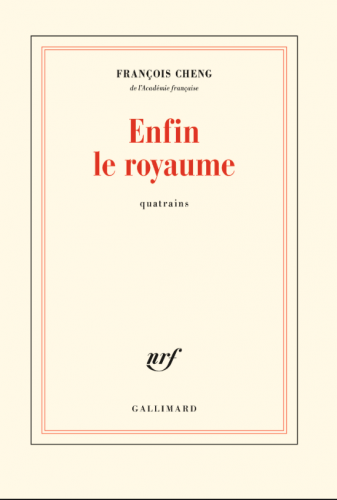 Ton âme, tu la sais sans la voir, mais tu vois
Ton âme, tu la sais sans la voir, mais tu vois
Celle d’un autre quand il s’émeut ou se confie.
Miracle des regards croisés, fenêtre ouverte :
Voyant l’âme de l’autre, tu vois la tienne propre.
Cet extrait de Enfin le royaume (Gallimard), recueil de quatrains de François Cheng, poète (et académicien) délicat, discret, subtil, qui nous a déjà donné des perles comme A l'orient de tout, ou La vraie gloire est ici (Poésie/Gallimard) est à recopier, à plier et à offrir, à glisser dans sa poche ou dans son sac, entre ses seins ou dans le creux de son oreille...
Plus personne n'écrit de quatrains, aujourd'hui. Voilà un genre tombé en désuétude et ravivé par ce recueil profond, qui nous fait oublier le dépouillement tant aimé du haïku, et tout aussi essentiel, tout autant ouvert à la réflexion sensible, à la méditation épurée.
François Cheng pense qu'un seul quatrain peut résumer toute une vie. C'est dire combien ce genre poétique strict (5-7-5-7 pieds) est une poésie en pensée figurant le concentré. Une contrainte vers l'essentiel. Une démarche vers l'irréductible.
Ecrire un quatrain, c'est faire voeu de concision, de retenue, de condensation, de cristallisation, c'est émonder, épurer, dit-il. C'est consentir à la brisure. Soit renoncer au bavardage, faire voeu de silence et d'observation bienveillante du monde, du paysage, du regard et de l'âme de l'autre.
Voici deux autres quatrains contenus dans ce précieux recueil, histoire de s'en convaincre davantage :
Le sort de la bougie est de brûler.
Quand monte l'ultime volute de fumée,
Elle lance une invite en guise d'adieu :
"Entre deux feux soit celui qui éclaire!"
Et celui-ci :
Nous avons bu tant de rosées
En échange de notre sang
Que la terre cent fois brûlée
Nous sait bon gré d'être vivants.
Et nous aimons. L.M.
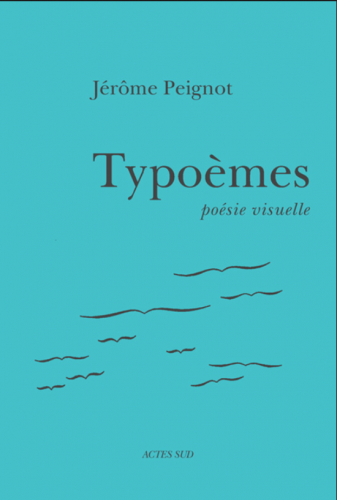 Francis Ponge passa sa vie à analyser la poétique des choses à travers les mots qui les désignent et son parti pris est indépassable.
Francis Ponge passa sa vie à analyser la poétique des choses à travers les mots qui les désignent et son parti pris est indépassable.
Jérôme Peignot joue quant à lui avec la forme des mots en proposant une lecture typographique ludique, érotique, humoristique. Ses Typoèmes (Actes Sud) sont une cour de récré où palindromes, anagrammes et esperluettes se bousculent comme des mômes espiègles.
Cette invitation à la lecture typographique du monde à travers les jeux entre les lettres désigne une poésie visuelle précise réclamant une attention qui débouche sur une réflexion légère.
A l'instar des mots-valises, la typoésie est communicative : elle donne immédiatement envie de créer des typoèmes, comme nous avons aussitôt envie de trouver des mots-valises lorsque nous en lisons quelques uns : nous nous prenons délicieusement au jeu...
Il s'agit en somme de jongler avec les mots de différentes façons, mais avec une dimension poétique dans la seconde manière, faite de simplicité facétieuse, voire de douce grivoiserie. Avec la typoésie, nous jouons par conséquent davantage avec les lettres. Peignot nous invite ainsi à retrouver l'étymologie graphique des êtres et des choses. Amusons-nous. L.M.
Trois exemples parmi tant : 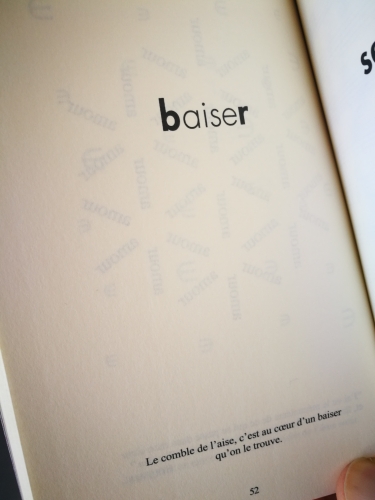
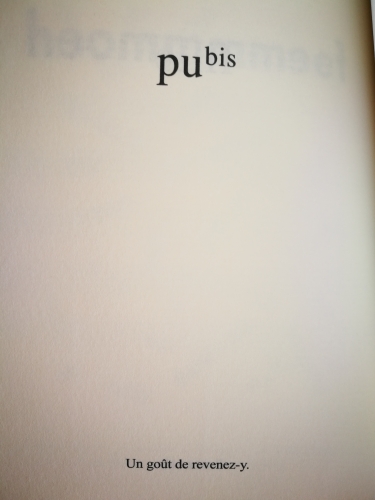
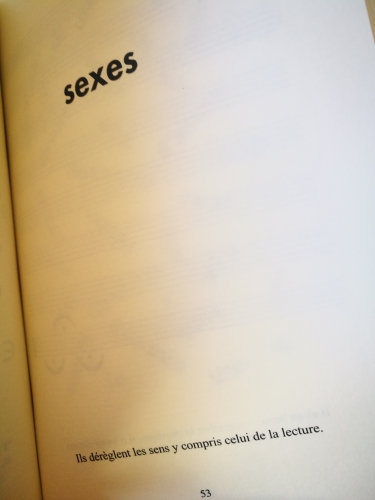
 L'ardeur est le thème du 20 ème Printemps des Poètes qui débute demain et qui s'achèvera le 19 mars.
L'ardeur est le thème du 20 ème Printemps des Poètes qui débute demain et qui s'achèvera le 19 mars.
Sophie Nauleau, nouvelle directrice artistique d'une manifestation d'envergure nationale désormais, publie à cette occasion un petit manifeste charmant aux éditions Actes Sud : La poésie à l'épreuve de soi figure une sorte d'anthologie personnelle liée par les mots sensibles d'une femme habitée depuis son enfance toulousaine par le poème, le mot fulgurant, l'ardente urgence de dire l'émotion, le bonheur ineffable d'habiter poétiquement le monde, pour reprendre le mot fameux de Hölderlin. La couverture est signée Ernest Pignon-Ernest, qui montre un être ailé dans un élan ardent. Ardere, en
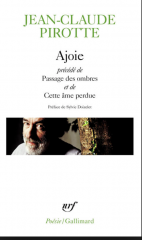 latin, signifie brûler, briller. (Zélos, en grec). Son anagramme est : durera. Ça parle. L'éclair me dure, nous chuchote l'immense René Char devenu classique, dont on célèbre le trentième anniversaire de la disparition, chez Gallimard, avec une édition collector de Fureur et mystère, l'un de ses plus fameux recueils paru il y a soixante-dix ans déjà, et une édition illustrée par Alberto Giacometti du Visage nuptial, suivi de Retour amont, ces deux volumes en Poésie/Gallimard. Tout comme Ajoie, du délicat et regretté Jean-Claude Pirotte, qui comprend aussi Passage des ombres et Cette âme perdue, ou encore Mathématique générale de l'Infini, du turbulent Serge Pey. Sophie Nauleau souligne dans son petit bouquin très intime que, contrairement au vin, l'ardeur poétique résiste aux siècles. C'est tellement vrai. Elle n'en finit jamais de résonner, ajoute-t-elle. Gronde en sourdine. Elle feule en solitaire. Elle sommeille en douce. Elle guette son heure - sereine en sa forêt de la longue attente. La poésie est comme le lait sur le feu. L.M.
latin, signifie brûler, briller. (Zélos, en grec). Son anagramme est : durera. Ça parle. L'éclair me dure, nous chuchote l'immense René Char devenu classique, dont on célèbre le trentième anniversaire de la disparition, chez Gallimard, avec une édition collector de Fureur et mystère, l'un de ses plus fameux recueils paru il y a soixante-dix ans déjà, et une édition illustrée par Alberto Giacometti du Visage nuptial, suivi de Retour amont, ces deux volumes en Poésie/Gallimard. Tout comme Ajoie, du délicat et regretté Jean-Claude Pirotte, qui comprend aussi Passage des ombres et Cette âme perdue, ou encore Mathématique générale de l'Infini, du turbulent Serge Pey. Sophie Nauleau souligne dans son petit bouquin très intime que, contrairement au vin, l'ardeur poétique résiste aux siècles. C'est tellement vrai. Elle n'en finit jamais de résonner, ajoute-t-elle. Gronde en sourdine. Elle feule en solitaire. Elle sommeille en douce. Elle guette son heure - sereine en sa forêt de la longue attente. La poésie est comme le lait sur le feu. L.M.
 Je fus à Bruges en fin de semaine et c'était avant-hier à peine. Je retrouvai la « Venise du Nord » enserrée dans une gangue de froid moscovite. Je revêtis moi-même des accessoires laineux d’usage polaire d'ordinaire, et que je n’utilise guère qu’à la faveur d’une approche fort hivernale de sangliers polonais ou de cerfs bulgares.
Je fus à Bruges en fin de semaine et c'était avant-hier à peine. Je retrouvai la « Venise du Nord » enserrée dans une gangue de froid moscovite. Je revêtis moi-même des accessoires laineux d’usage polaire d'ordinaire, et que je n’utilise guère qu’à la faveur d’une approche fort hivernale de sangliers polonais ou de cerfs bulgares.
Une obsession m’animait. Revoir les Primitifs flamands au Groeningenmuseum. Cela paraissait si raccord en un tel lieu. Revoir des toiles à l'émotion idoine. Y aller comme on s'évade d'une peinture de Brueghel pour patiner ou bien porter un renard piégé dans son dos.
Or, j’ignorais qu’il fallut quelques années à peine pour que mes armes se rendissent à une si roide évidence : le tourisme de masse (ou la masse touristique) avait à ce point explosé, ici y compris, qu’il me submergea plus sûrement qu'une avalanche. Un magma, une soupe épaisse - que dis-je, un Cap sans bonne espérance, une Péninsule charnelle sans issue enserrèrent mon plaisir simplet de déambuler le long des canaux de cette cité entre toutes adorée pour ses charmes même - ce, jusqu’à la suffocation.
Je fus, oui, sidéré par tant de congénères à ce point butés par l’obsession du selfie. Vous savez : cette façon si moderne de se mirer tel Narcisse dans le reflet de son minois, mais sans ostentation ni précaution d'usage, et pas dans l’eau d’un lac paisible : sur l’écran pathétique de nos solitudes numériques… Il y avait tant d'insolents selfie-sticks tendus – plusieurs manquèrent m’éborgner, au risque consolateur de ressembler tout à trac à un personnage du Jardin des Délices ou bien du Jugement dernier, de Jérôme Bosch -, que je me crus un instant piégé au cœur d’une forêt de haubans sirupeux et ne tintinnabulant point, enserré dans un fort peu plaisant port de plaisance sans aucune complaisance ni humanité. Emprisonné. Loin, très loin d'une sensation réconfortante, à la manière d'une invitation parmi les lances de La Reddition de Breda, fascinant tableau de Velazquez (visible au musée du Prado, à Madrid).
Stupéfait par tant de marée in-humaine, je manquai m'insurger avec véhémence, mais l'esprit belge interdit subtilement, et par bonheur, un tel débordement. Au lieu de quoi je capitulai en conséquence et à ma manière. Il y avait là tant de troupeaux suivant un petit drapeau tenu à bout de bras par un guide hurlant dans un micro dûment fixé à sa mâchoire ou bien derrière son oreille. Ailleurs, quelques pétasses rose bonbon acidulé façon Hello Kitty, voyageant seules, pulvérisaient le record de selfies à la minute, sous leur bonnet pastel à pompons gesticulant, ridicule. Il y avait…
Aucun ne regardait Bruges - je le jure. Aucun n'avait de souci architectural, ou poétique, ou bien de bienveillance pour les cygnes en couple, les corbeaux freux en maraude, ou encore pour la mousse d'un vert émeraude confondant, laissée sur le haut des parois des canaux (ce vert unique, en partage avec celui de la Jaguar Mark 2, ou bien celui de la Rover 2000 d'un identique vert anglais, roue de secours moulée sous la malle arrière, roues à rayons bien entendu pour la première). La suffocation, dis-je.
Lorsque je la visitai il y a quelques années cette cité des eaux, elle me fut à ce point vierge de toute vulgarité qu'elle m’apparut atrocement provinciale. Une toile de Vermeer eut pu être tendue sans ménagement ni crainte sur le châssis de jours radieux et doucement caressés par un soleil poli, le long de paisibles canaux bordés de splendides bâtisses médiévales avec fenêtres à meneaux et petits carreaux de verre dépoli et coloré, précieusement entourés d’étain, que je n'en eus subi ni outrage ni surprise.
Un bijou. Une toile de maître, c'était ça.
Restait à gagner le Groeningen au plus vite. Vu que les frites qui nous furent servies, industrielles et décongelées (un réel choc, là), que les solettes eurent la maigreur anorexique des mannequins des années deux mille, que les croquettes aux crevettes bavèrent une lassitude crémeuse peu avenante, que les vol-au-vent nous aguichèrent sans talent aucun… Une angoisse légitime monta :
Et si une autre forêt de selfie-sticks devait être traversée, à défaut d’avoir le droit de la scier à sa base d'un coup large de sabre, à l’entrée du musée, nous même lancé au galop de notre lourd cheval rescapé de la bataille d'Eylau... Mais non. Miracle. – Personne au guichet. Au point que le lieu sembla fermé.
La paix simple, le soupir large, la détente méritée des muscles, le repos des nerfs enfin retrouvé, les allées propices à la réflexion sur tant d’œuvres picturales sujettes à interrogation de par leur profusion de détails, leur précision d’horloger genevois dans le trait, l’expression, le vouloir-dire, furent un bain de jouvence (ce, en dépit de travaux colossaux nous privant de la plupart des salles et donc des œuvres qu'elles recèlent…). Les Primitifs étaient partiellement là, mais bien là.
Et je crois pouvoir écrire qu’un Jan Van Eyck me lança un clin d’œil complice que je n'osai capturer, mais retenir seulement. Entre mes mains ardentes - pleines d’ardeur à transmettre, et avides d'en découdre. Soit de partager cette détention. Ce que voilà. Puisque l’ardeur durera. Et ceci est, je crois, un bel anagramme. L.M.
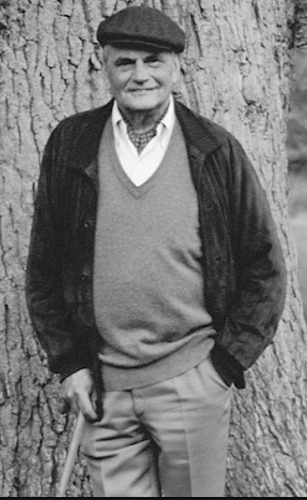 Déon sans sépulture, cela ressemble à un déjeuner sans soleil, et ce n’est pas Alfa sans Roméo. Plutôt Les Trompeuses espérances. Si l’injustice perdure, ce sera Je ne veux jamais l’oublier. Cela ne fleure pas vraiment Tout l’amour du monde, mais peut signifier que Mentir est tout un art. Et, un jour peut-être, Taisez-vous, j’entends venir un ange. Difficile pour l’heure de prendre l’affaire À la légère. Sur le motif, Michel observera le silence d’une tombe préférant - d’outre - ignorer les propos légalistes d’une cave élue à propos d’un caveau municipal. D’où qu’il soit, je le soupçonne de s’en ficher un peu, réduit en cendres qu’il est, écrivain de plein vent qu’il fut, et je l’imagine plus volontiers dispersé pour partie au-dessus des marais irlandais de Tynagh, et pour autre saupoudré en Méditerranée, depuis Le balcon de Spetsai. Dans les eaux après avoir fait de vieux os. Seulement, un vent pervers souffle dans le peu d’esprit des édiles de la mairie de Paris, cité où il naquit en 1919. De sourdes raisons vont-elles éclore, à l’instar de la désinscription de Maurras de l’agenda des commémorations ? (Déon fut un temps le secrétaire de rédaction de L’Action française). Ne soyons pas mauvaise langue. Il y a surtout qu’Alice Déon, la fille de l’auteur du précieux dialogue Parlons-en…, souhaite que les aficionados de son père puissent lui rendre visite en un lieu parisien saint et reposant (comme le cimetière Montparnasse), à proximité de nombre de pairs peinards. Un imbroglio administratif en interdit l’accès, au nom d’un égalitarisme absolutiste qui souffre cependant de coups de canifs dans la Déclaration, soigneusement enterrés (le cas de l’écrivaine américaine Susan Sontag en est un exemple, ainsi que le rapporte opportunément Le Figaro de ce jour). Quoiqu’il advienne, c'est l’esprit de Michel Déon qui compte sous la terre comme au ciel. Et celui-ci est deux fois immortel. C'est d'un académicien qu'il s'agit, et de l'auteur d’une œuvre inaltérable à laquelle nous retournons pour nous ressourcer en ces temps de manque, à la manière des Poneys sauvages se désaltérant au bord d’un étang d'humanité. L.M.
Déon sans sépulture, cela ressemble à un déjeuner sans soleil, et ce n’est pas Alfa sans Roméo. Plutôt Les Trompeuses espérances. Si l’injustice perdure, ce sera Je ne veux jamais l’oublier. Cela ne fleure pas vraiment Tout l’amour du monde, mais peut signifier que Mentir est tout un art. Et, un jour peut-être, Taisez-vous, j’entends venir un ange. Difficile pour l’heure de prendre l’affaire À la légère. Sur le motif, Michel observera le silence d’une tombe préférant - d’outre - ignorer les propos légalistes d’une cave élue à propos d’un caveau municipal. D’où qu’il soit, je le soupçonne de s’en ficher un peu, réduit en cendres qu’il est, écrivain de plein vent qu’il fut, et je l’imagine plus volontiers dispersé pour partie au-dessus des marais irlandais de Tynagh, et pour autre saupoudré en Méditerranée, depuis Le balcon de Spetsai. Dans les eaux après avoir fait de vieux os. Seulement, un vent pervers souffle dans le peu d’esprit des édiles de la mairie de Paris, cité où il naquit en 1919. De sourdes raisons vont-elles éclore, à l’instar de la désinscription de Maurras de l’agenda des commémorations ? (Déon fut un temps le secrétaire de rédaction de L’Action française). Ne soyons pas mauvaise langue. Il y a surtout qu’Alice Déon, la fille de l’auteur du précieux dialogue Parlons-en…, souhaite que les aficionados de son père puissent lui rendre visite en un lieu parisien saint et reposant (comme le cimetière Montparnasse), à proximité de nombre de pairs peinards. Un imbroglio administratif en interdit l’accès, au nom d’un égalitarisme absolutiste qui souffre cependant de coups de canifs dans la Déclaration, soigneusement enterrés (le cas de l’écrivaine américaine Susan Sontag en est un exemple, ainsi que le rapporte opportunément Le Figaro de ce jour). Quoiqu’il advienne, c'est l’esprit de Michel Déon qui compte sous la terre comme au ciel. Et celui-ci est deux fois immortel. C'est d'un académicien qu'il s'agit, et de l'auteur d’une œuvre inaltérable à laquelle nous retournons pour nous ressourcer en ces temps de manque, à la manière des Poneys sauvages se désaltérant au bord d’un étang d'humanité. L.M.
---
J'évoquerai bientôt Les mondes de Michel Déon, une biographie signée Christian Authier (Séguier)
 Vous souhaitez être dégoûté du théâtre, détester Shakespeare, haïr les comédiens : Allez donc voir le Macbeth mis en scène par Stéphane Braunschweig à l'Odéon (Paris VIème, vous avez jusqu'au 10 mars pour ce faire). Car, voilà une mise en scène indigente comme on en voit guère plus, sinon dans certains Lycées de province, lors des kermesses de fin d'année animées par les théâtreux boutonneux de classes de seconde.
Vous souhaitez être dégoûté du théâtre, détester Shakespeare, haïr les comédiens : Allez donc voir le Macbeth mis en scène par Stéphane Braunschweig à l'Odéon (Paris VIème, vous avez jusqu'au 10 mars pour ce faire). Car, voilà une mise en scène indigente comme on en voit guère plus, sinon dans certains Lycées de province, lors des kermesses de fin d'année animées par les théâtreux boutonneux de classes de seconde.
L'amateurisme est ici un euphémisme. L'emphase un diminutif. La cohésion d'une troupe une vue de l'esprit. Le décor une plaisanterie. Le jeu des acteurs une chimère. L'émotion un rêve. L'enchainement improbable des scènes une pitoyable dose de sueur. La narration impose un train laborieux. La récitation scolaire d'un texte pourtant beau figure une punition (même si les époux Macbeth sont en soi une tragique et intemporelle sinécure relativement aisée à dynamiser, voire à dynamiter - on en a vu d'autres, des Macbeth davantage sentis, autrement plus incarnés).
Rien ne va. Rien ne passe : aucun courant, aucune sensation, rien. De rien. Près de trois heures à se morfondre et à enrager, et même si les voisins de rang foutent le camp un à un, rester pour voir. Jusqu'au bout -Heureusement, à la fin il y en a qui sifflent le spectacle. Cela conforte. De maigres applaudissements convenus signent un satisfecit poli, voire syndical.
Shakespeare fut absent hier soir, l'à-peu-préisme souverain, le laxisme éloquent, la déception majuscule. Le plaisir enfin, en berne totale. Ni Py ni Bondy (mais pas Strehler) n'étaient parvenus à nous infliger une telle peine sans raison valable. Nous n'avions pourtant commis aucune infraction ni aucun crime avant de venir... La scène de l'Odéon nous est (provisoirement) devenue une sous-rien. ¡Hasta la vista! L.M.
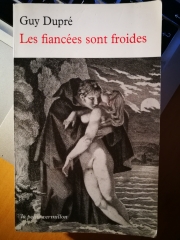 Hommage à l'écrivain discret Guy Dupré, disparu il y a quelques jours à presque 90 ans sans faire davantage de bruit que son œuvre et sa voix n'en firent jamais, et qui laisse quelques romans précieux comme « Les fiancées son froides » (salué à sa parution en 1953 - l'auteur avait vingt-cinq ans à peine - par Julien Green, Julien Gracq, François Mauriac et André Breton), « Le Grand Coucher », et « Les Mamantes ». Ni antimoderne ni hussard, romantique à l'Allemande, barrésien, grand styliste avant tout, Dupré est de ces auteurs dont on murmure le nom comme circule un sésame, et dont l'écho illumine aussitôt le regard des membres d'une confrérie sans tête.
Hommage à l'écrivain discret Guy Dupré, disparu il y a quelques jours à presque 90 ans sans faire davantage de bruit que son œuvre et sa voix n'en firent jamais, et qui laisse quelques romans précieux comme « Les fiancées son froides » (salué à sa parution en 1953 - l'auteur avait vingt-cinq ans à peine - par Julien Green, Julien Gracq, François Mauriac et André Breton), « Le Grand Coucher », et « Les Mamantes ». Ni antimoderne ni hussard, romantique à l'Allemande, barrésien, grand styliste avant tout, Dupré est de ces auteurs dont on murmure le nom comme circule un sésame, et dont l'écho illumine aussitôt le regard des membres d'une confrérie sans tête.  Avant-hier. Numéro anniversaire (le 50ème) du Monde des Livres, supplément culte du quotidien, et de moins intéressant (et prescripteur) au fil du temps. Mais chaque jeudi après-midi, c'est pavlovien, il nous le faut, même s'il nous arrive de soupirer désormais après l'avoir parcouru, lors que nous le lisions de bout en bout avec un appétit féroce et à force de pain, allant jusqu'à saucer l'assiette à regret. Aujourd'hui, c'est sans pain ni peine que nous lui préférons Le Figaro Littéraire, bu chaque jeudi matin jusqu'à la lie, ainsi que le très bon supplément consacré aux livres de La Croix (nous négligeons depuis belle lurette, le jeudi toujours, celui de Libération, devenu insignifiant).
Avant-hier. Numéro anniversaire (le 50ème) du Monde des Livres, supplément culte du quotidien, et de moins intéressant (et prescripteur) au fil du temps. Mais chaque jeudi après-midi, c'est pavlovien, il nous le faut, même s'il nous arrive de soupirer désormais après l'avoir parcouru, lors que nous le lisions de bout en bout avec un appétit féroce et à force de pain, allant jusqu'à saucer l'assiette à regret. Aujourd'hui, c'est sans pain ni peine que nous lui préférons Le Figaro Littéraire, bu chaque jeudi matin jusqu'à la lie, ainsi que le très bon supplément consacré aux livres de La Croix (nous négligeons depuis belle lurette, le jeudi toujours, celui de Libération, devenu insignifiant).
Ce numéro anniversaire comporte un long papier signé de Raphaelle Bacqué contant l'histoire du supplément depuis sa création en 1967 : les années Jacqueline Piatier, et puis les autres, placées sous la houlette de François Bott (les meilleures selon nous), Josyane Savigneau, les météoriques Franck Nouchi, Robert Solé, avant d'arriver à Jean Birnbaum, actuel responsable...
Figurent aussi dans ce numéro quelques morceaux d'anthologie, des extraits de critiques signés par les plumes qui s'y sont succédées. Et, justement, lorsqu'on tombe sur quelque trait de Pierre-Henri Simon, collaborateur et académicien, évoquant en 1968 Belle du Seigneur d'Albert Cohen, nous nous pourléchons : C'est long, c'est inégal, il y a du mauvais goût et quelques steppes de prose sableuse qu'on aurait envie de traverser en hélicoptère. Mais une fois engagé, pris dans le récit, on lit, on veut lire encore, aller jusqu'au bout. C'est tellement vrai de ce pavé empâté qui aurait bénéficié d'une cure d'amaigrissement avant impression (en particulier aux interminables parties touchant à la Société des Nations). C'est surtout bien asséné, avec cet art rare de la causticité bien tempérée.
Ailleurs, c'est le célèbre feuilletoniste Bertrand Poirot-Delpech, qui tint le rez-de-chaussée (de la première page du supplément) le plus envié de Paris, se livrant à un pastiche de sa rubrique en faisant du Poirot par collage de tics (sans oublier de louer un académicien ou deux comme il le fit chaque semaine, menant ainsi une longue campagne un rien flagorneuse pour sa propre élection). L'ancien chroniqueur judiciaire et auteur d'un Grand dadais que l'histoire de la littérature n'a pas jugé utile de consigner, invente un écrivain, Marelier, et son oeuvre. Extrait : La gravité n'exclut pas, chez Marelier, un humour décapant, et salubre en nos temps d'empois. Sans parler de son écriture, où Barthes sut déceler un grain entre l'orge et la semoule, quelque chose comme le tapioca... La critique avait alors du style et du panache, non?
Ailleurs qu'au Monde et aux mêmes périodes, Bernard Frank nous envoûtait de ses chroniques bavardes avec brio, regorgeant d'une mauvaise foi de génie. Renaud Matignon avait l'éloge flatteur aussi sincère que l'exécution sommaire. Et Angelo Rinaldi déglaçait à l'acide, ciselait des papiers que nous n'aurions raté sous aucun prétexte. La critique littéraire avait de la gueule.
A l'instar d'un genre littéraire en voie de disparition, le pamphlet, il semble qu'elle soit devenue moins critique justement, et que le manque d'espace commande que l'on encense seulement. Malheureusement pas toujours avec ce claquant éloignant tout soupçon de collusion, et qui distingue d'emblée une chronique brillante sur l'aile d'une recension propre sur elle. L.M.
Je persiste à penser que mon Flaubert préféré est sa correspondance. Particulièrement ses lettres à Louise Colet. En voici un exemple :
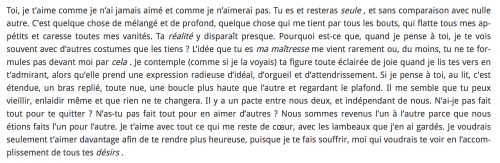
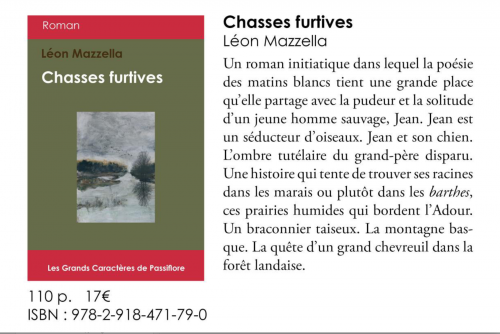 La police des caractères reste ma préférée.
La police des caractères reste ma préférée.
J'apprécie son autorité sur la chose jugée publiable.
Elle met de l'ordre dans l'écriture depuis des siècles en jonglant avec vingt-six lettres.
Lorsqu'elle est grande, elle devient lisible de loin, confortable de près, repose les yeux qui peuvent regarder ailleurs, entre deux pages...
Ces caractères-là n'ont rien de mauvais. Que du bon, sommes-nous tentés d'ajouter...
Il y a un an je me retrouvai pour la première fois en format de poche (avec Le Parler pied-noir qui passait de Rivages à la Petite Bibli Payot/Voyageurs).
Voici que je me retrouve aujourd'hui en Grands Caractères, soit en corps 18 - à l'intention de ceux qui peinent à lire de plus petits : Chasses furtives (mon premier roman) existe désormais sous trois formes : en version livre classique, en version e-book, et aujourd'hui en version Grands Caractères, en compagnie d'autres titres publiés par Passiflore (*). Qu'on se le lise... L.M.
---
(*) La vie plus un chat, de Chantal Detcherry, L'Effacement, de Pascale Dewambrechies, La carapace de la tortue, de Marie-Laure Hubert Nasser, L'Enfant roman, de Fabienne Thomas.
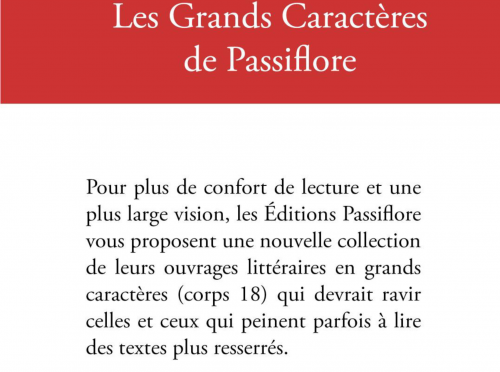
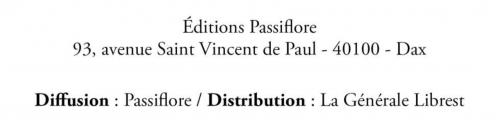
 Je me souviens bien d'une poularde de Bresse, et avec davantage de précision du son que fit la croûte qu'il me fallut casser avec l'épaule d'une cuiller afin de découvrir et commencer d'absorber un petit lac circulaire : la soupe VGE à la truffe, ou plutôt le grouillant salmigondis d'une colonie de truffes en déroute, en morceaux et en soupe... Cela se passa à Bocuse-ville... Je me souviens surtout du regard gras, valisé, lippu même, mais palpitant comme un oiseau que l'on tient avec peine et délicatesse entre nos paumes juste jointes et pas serrées... Du regard - appuyé - de Monsieur Paul. Je me trouvais là plus ou moins pour GaultMillau comme on dit, dont j'assurais alors la direction des rédactions (du magazine et des guides), mais justement et délibérément sans aucune obligation, soit sans carnet de notes à noircir, décontracté du stylo; à la fraîche de surcroît... Pourvu du seul plaisir d'une errance mycologique choisie. En ouiquende, aurait écrit Roger Nimier, ou bien luxueusement en visite. Et aussi (car, même en roue libre j'ai un angle d'attaque en tête, c'est plus fort que moi) pour l'ineffable plaisir d'échanger avec la sensibilité vive et qui bouillait sous une longue toque blanche (coiffant une tête bien faite ayant toujours préféré la bonne vieille casquette en tweed qui renifle la sauvagine), à propos des sarcelles rebelles et des bécassines tellement furtives de la Dombes - oiseaux vénérés que j'ai toujours adoré décrocher du plus loin que je le pouvais avec mon léger calibre 20 et à contre vent, tandis que Monsieur Paul confessait sans ambages préférer son calibre 12, afin d'assurer, appuya-t-il de sa voix rétablissante. C'était son côté saucier. Celui que nous regretterons ce soir et à l'instar d'une épaule, au creux d'une époque light et rabougrie, pleutre et en manque de sel. L.M.
Je me souviens bien d'une poularde de Bresse, et avec davantage de précision du son que fit la croûte qu'il me fallut casser avec l'épaule d'une cuiller afin de découvrir et commencer d'absorber un petit lac circulaire : la soupe VGE à la truffe, ou plutôt le grouillant salmigondis d'une colonie de truffes en déroute, en morceaux et en soupe... Cela se passa à Bocuse-ville... Je me souviens surtout du regard gras, valisé, lippu même, mais palpitant comme un oiseau que l'on tient avec peine et délicatesse entre nos paumes juste jointes et pas serrées... Du regard - appuyé - de Monsieur Paul. Je me trouvais là plus ou moins pour GaultMillau comme on dit, dont j'assurais alors la direction des rédactions (du magazine et des guides), mais justement et délibérément sans aucune obligation, soit sans carnet de notes à noircir, décontracté du stylo; à la fraîche de surcroît... Pourvu du seul plaisir d'une errance mycologique choisie. En ouiquende, aurait écrit Roger Nimier, ou bien luxueusement en visite. Et aussi (car, même en roue libre j'ai un angle d'attaque en tête, c'est plus fort que moi) pour l'ineffable plaisir d'échanger avec la sensibilité vive et qui bouillait sous une longue toque blanche (coiffant une tête bien faite ayant toujours préféré la bonne vieille casquette en tweed qui renifle la sauvagine), à propos des sarcelles rebelles et des bécassines tellement furtives de la Dombes - oiseaux vénérés que j'ai toujours adoré décrocher du plus loin que je le pouvais avec mon léger calibre 20 et à contre vent, tandis que Monsieur Paul confessait sans ambages préférer son calibre 12, afin d'assurer, appuya-t-il de sa voix rétablissante. C'était son côté saucier. Celui que nous regretterons ce soir et à l'instar d'une épaule, au creux d'une époque light et rabougrie, pleutre et en manque de sel. L.M.
Autre extrait du fameux chapitre VI de la IIIème partie (Frédéric s'adresse à Mme Arnoux) :
Mon coeur, comme de la poussière, se soulevait derrière vos pas. Vous me faisiez l'effet d'un clair de lune par une nuit d'été, quand tout est parfums, ombres douces, blancheurs, infini; et les délices de la chair et de l'âme étaient contenues pour moi dans votre nom que je me répétais, en tâchant de le baiser sur mes lèvres. Je n'imaginais rien au delà.
 Extrait de L'Education sentimentale (III, 6) de Flaubert :
Extrait de L'Education sentimentale (III, 6) de Flaubert :
Il voyagea.
Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l’étourdissement des paysages et des ruines, l’amertume des sympathies interrompues.
Il revint.
Il fréquenta le monde, et il eut d’autres amours, encore. Mais le souvenir continuel du premier les lui rendait insipides ; et puis la véhémence du désir, la fleur même de la sensation était perdue. Ses ambitions d’esprit avaient également diminué. Des années passèrent ; et il supportait le désœuvrement de son intelligence et l’inertie de son cœur.

... Et je continuerai d'y publier ma chronique J'aime.
En voici un extrait, paru dans le n°6 actuellement en kiosque :

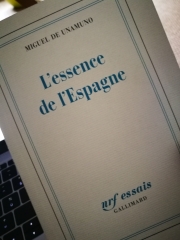 Plus j'entends parler de la Catalogne et des Catalans, et plus j'ai envie de lire des choses sur l'Espagne et l'esprit Castillan. Ainsi ai-je repris Don Quijote de la Mancha, les aventures du chevalier à la triste figure, et lu les cinq essais que Miguel de Unamuno écrivit en 1895 sur l'esprit castizo : L'essence de l'Espagne (Gallimard, 1967). Le titre originel est Autour du casticisme. Difficile à comprendre tel quel, d'où le titre français un brin elliptique. Unamuno y est péremptoire, défend la pureté d'une race (casta) et son ambition expansionniste - au moins sur la Péninsule. L'époque nageait dans ce mood. Il convient donc de le lire avec les précautions d'usage et de distance qui s'imposent, et non en critiquant le fond à la lumière du présent (ce que notre époque, de plus en plus idiote,
Plus j'entends parler de la Catalogne et des Catalans, et plus j'ai envie de lire des choses sur l'Espagne et l'esprit Castillan. Ainsi ai-je repris Don Quijote de la Mancha, les aventures du chevalier à la triste figure, et lu les cinq essais que Miguel de Unamuno écrivit en 1895 sur l'esprit castizo : L'essence de l'Espagne (Gallimard, 1967). Le titre originel est Autour du casticisme. Difficile à comprendre tel quel, d'où le titre français un brin elliptique. Unamuno y est péremptoire, défend la pureté d'une race (casta) et son ambition expansionniste - au moins sur la Péninsule. L'époque nageait dans ce mood. Il convient donc de le lire avec les précautions d'usage et de distance qui s'imposent, et non en critiquant le fond à la lumière du présent (ce que notre époque, de plus en plus idiote,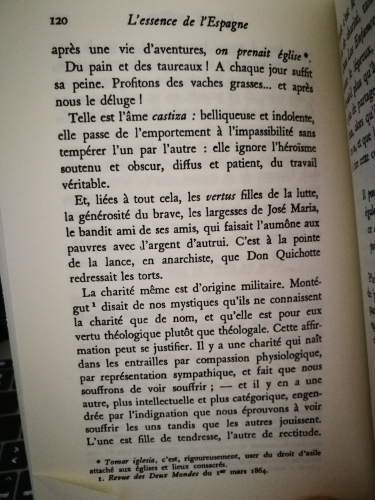
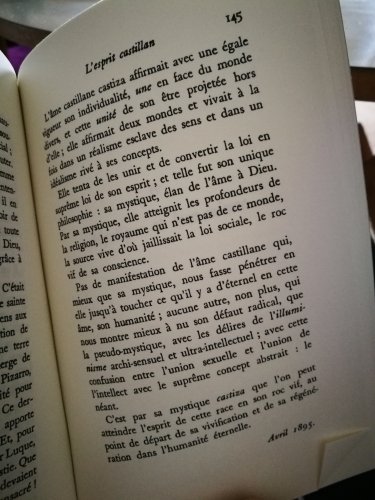 fait quotidiennement et sur tout sujet)... Ces essais, un peu lourdingues, au style ampoulé, correspondent à l'esprit bouillonnant du jeune essayiste qui donnera plus tard Le sentiment tragique de la vie, son essai majeur, mûr, philosophiquement plus argumenté, ainsi que de délicieux Contes (dont on peut lire des extraits en folio 2€ sous le titre Des yeux pour voir). Unamuno magnifie sans retenue l'esprit castillan, en le revêtant un peu arbitrairement des atours les plus remarquables de l'âme méditerranéenne en ce qu'elle a d'admirable. Pourquoi pas. Mais cela semble être une vision idéalisée relevant de la projection d'une certaine âme, davantage que d'une âme certaine : belliqueuse et indolente, elle passe de l'emportement à l'impassibilité sans tempérer l'un par l'autre : Telle est l'âme castiza : elle ignore l'héroïsme soutenu et obscur, diffus et patient, du travail véritable. (...) L'âme castillane castiza affirmait avec une égale vigueur son individualité, une en face du monde divers, et cette unité de son être projetée hors d'elle; elle affirmait deux mondes et vivait à la fois dans un réalisme esclave des sens et dans un idéalisme rivé à ses concepts. Obscur, n'est-ce pas?.. Mieux vaut par conséquent replonger dans l'idéal chevaleresque d'un dévoreur de romans aux visions hallucinatoires mais tellement drôles et si lucides à la fois, soit dans les ingénieuses et truculentes aventures de l'hidalgo et de son fidèle Sancho (dans la belle traduction dépoussiérée qu'en a donné au Seuil Aline Schulman), car se battre contre des moulins à vent vaut bien d'autres combats et bien des messes : Ayant comme on le voit, complètement perdu l'esprit, il lui vint la plus étrange pensée que jamais fou ait pu concevoir. Il crut bon et nécessaire, tant pour l'éclat de sa propre renommée que pour le service de sa patrie, de se faire chevalier errant, et d'aller par le monde avec ses armes et son cheval chercher les aventures, comme l'avaient fait avant lui ses modèles, réparant, comme eux, toutes sortes d'injustices, et s'exposant aux hasards et aux dangers, dont il sortirait vainqueur et où il gagnerait une gloire éternelle. Quichotte (1605) est, comme chacun sait, à la fois le mythe fondateur de l'Espagne contemporaine, et l'acte de
fait quotidiennement et sur tout sujet)... Ces essais, un peu lourdingues, au style ampoulé, correspondent à l'esprit bouillonnant du jeune essayiste qui donnera plus tard Le sentiment tragique de la vie, son essai majeur, mûr, philosophiquement plus argumenté, ainsi que de délicieux Contes (dont on peut lire des extraits en folio 2€ sous le titre Des yeux pour voir). Unamuno magnifie sans retenue l'esprit castillan, en le revêtant un peu arbitrairement des atours les plus remarquables de l'âme méditerranéenne en ce qu'elle a d'admirable. Pourquoi pas. Mais cela semble être une vision idéalisée relevant de la projection d'une certaine âme, davantage que d'une âme certaine : belliqueuse et indolente, elle passe de l'emportement à l'impassibilité sans tempérer l'un par l'autre : Telle est l'âme castiza : elle ignore l'héroïsme soutenu et obscur, diffus et patient, du travail véritable. (...) L'âme castillane castiza affirmait avec une égale vigueur son individualité, une en face du monde divers, et cette unité de son être projetée hors d'elle; elle affirmait deux mondes et vivait à la fois dans un réalisme esclave des sens et dans un idéalisme rivé à ses concepts. Obscur, n'est-ce pas?.. Mieux vaut par conséquent replonger dans l'idéal chevaleresque d'un dévoreur de romans aux visions hallucinatoires mais tellement drôles et si lucides à la fois, soit dans les ingénieuses et truculentes aventures de l'hidalgo et de son fidèle Sancho (dans la belle traduction dépoussiérée qu'en a donné au Seuil Aline Schulman), car se battre contre des moulins à vent vaut bien d'autres combats et bien des messes : Ayant comme on le voit, complètement perdu l'esprit, il lui vint la plus étrange pensée que jamais fou ait pu concevoir. Il crut bon et nécessaire, tant pour l'éclat de sa propre renommée que pour le service de sa patrie, de se faire chevalier errant, et d'aller par le monde avec ses armes et son cheval chercher les aventures, comme l'avaient fait avant lui ses modèles, réparant, comme eux, toutes sortes d'injustices, et s'exposant aux hasards et aux dangers, dont il sortirait vainqueur et où il gagnerait une gloire éternelle. Quichotte (1605) est, comme chacun sait, à la fois le mythe fondateur de l'Espagne contemporaine, et l'acte de 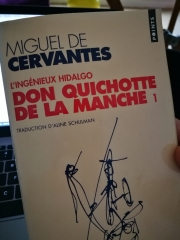
 naissance du roman moderne. Aussi, revenons-nous toujours à Cervantes. Par plaisir autant que par besoin. L.M.
naissance du roman moderne. Aussi, revenons-nous toujours à Cervantes. Par plaisir autant que par besoin. L.M.
 Cinq ans après sa disparition, Pierre Veilletet c'est, encore et toujours, une oeuvre qui compte : sept livres essentiels à lire, à relire et à faire passer.
Cinq ans après sa disparition, Pierre Veilletet c'est, encore et toujours, une oeuvre qui compte : sept livres essentiels à lire, à relire et à faire passer.
(Cette notule au format chiche qui m''était imposé chaque semaine par cette rédaction, annonce le "Tout Veilletet" que chaque amateur de vraie littérature doit posséder. Précision : le prix Albert-Londres distingue chaque année un grand reportage. Il récompensa celui que P.V. - qui fit toute sa carrière de journaliste à Sud-Ouest (il fut mon premier rédacteur en chef) -, effectua sur la longue agonie de Franco). L.M.

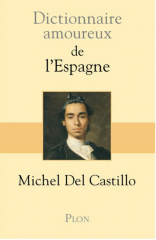 Pour bien parler une langue, il ne suffit pas d’en connaître le vocabulaire et la grammaire sur le bout des doigts ou plutôt des papilles. Il faut encore connaître ses mots qui sont autant de concepts singuliers, capables de définir l’âme d'un peuple. Ainsi de l’Espagnol. Quelques exemples parmi beaucoup d’autres :
Pour bien parler une langue, il ne suffit pas d’en connaître le vocabulaire et la grammaire sur le bout des doigts ou plutôt des papilles. Il faut encore connaître ses mots qui sont autant de concepts singuliers, capables de définir l’âme d'un peuple. Ainsi de l’Espagnol. Quelques exemples parmi beaucoup d’autres :
Nada. Rien, mais plus encore. Un sentiment. « Un songe éveillé, une contemplation, voire une méditation, une espèce de tristesse mêlée de terreur, une volupté amère. Une moue boudeuse » (Michel Del Castillo). Une attitude attirante. Une défense. Une métaphysique. Rien à voir avec le néant. Plutôt le vide imparfait. Quelque chose comme ça.
Cortesía. Au-delà de la courtoisie. Plus que la politesse. Un art de vivre en commun forgé au fil des siècles.
Quiero : Je veux. J’aime. Tout ensemble. Volonté et désir se rejoignent. Tendent vers la possession. Idem pour Esperar : à la fois attendre. Et espérer.
Quedar bien. Faire une belle sortie. Y compris en quittant ce monde, si possible. De tous les gestes, le dernier n’est-il pas le plus important, sinon le plus émouvant… Mais c'est au quotidien, dans les petites attitudes, que l'on apprend à quedar bien.
Castizo. Un mot évoquant la caste, la noblesse. Une certaine pureté. Et la Castille. C’est la vivacité, la grâce et l’élégance réunies. De caste, de race. Nous pouvons aussi voir dans cette attitude (Miguel de Unamuno approfondît le sujet) la vocation universaliste de la province la plus pauvre de la Péninsule. Ne parle-t-on pas le Castillan (par opposition au Catalan, au Basque)?
Honor y honra. L’honneur est à distinguer du sens de la dignité. Subtilité.
Aguante. Endurer, ou supporter, mais avec fierté. Maîtrise. Résister avec impassibilité et dédain. Très torerista. Pour être précis, très Manolete.
Zarzuela. Pot-au-feu de pescados y mariscos. Ronce. Et aussi le plaisir naïf de l’abandon, propre au peuple, quand une morale bourgeoise laisse engoncé dans la retenue. Et ce n’est pas encore la vulgarité. Plutôt un lâcher-prise cathartique.
L.M.

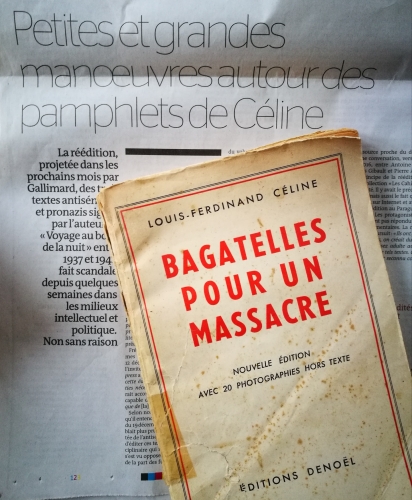 Par un après-midi de l'été 1980, après avoir cueilli des framboises dans le jardin dacquois des grands-parents de mon amie de l'époque, nous montâmes au grenier pour en vérifier à l'ombre les saveurs dérivées.
Par un après-midi de l'été 1980, après avoir cueilli des framboises dans le jardin dacquois des grands-parents de mon amie de l'époque, nous montâmes au grenier pour en vérifier à l'ombre les saveurs dérivées.
A l'heure des soupirs, je tombai sur ce livre allongé sous un linceul de poussière, et l'emportai - davantage en souvenir de ce moment passé entre les boites à chapeaux et les malles chargées d'histoire, que pour la raison de sa rareté, que j'ignorai encore.
Plus tard je l'appris, et maintins constamment l'objet à distance du Voyage au bout de la nuit (que d'ailleurs je ne pus jamais lire; pas mon truc, le verbe célinien). Me disant : un jour je verrai bien de quoi il retourne...
Aujourd'hui, tandis que sa réédition prochaine avec celle des deux autres pamphlets antisémites de Céline pose question, je ne me suis toujours pas résolu à le lire. Pas même à l'ouvrir pour en saisir une seule phrase, car cette idée seule me répugne. Le dégoût. L.M.

En découvrant l'existence (j'ai d'abord cru à un canular) d'une eau de parfum reprenant le titre du livre le plus emblématique de l'oeuvre de Julien Gracq, je suis resté coi (après une voiture nommée Picasso, voilà que..., ai-je aussitôt pensé, marri), puis je suis bien resté trois minutes devant la photo de ce flacon, hébété comme un macareux moine devant un galet rond. Ayant retrouvé mes esprits, je ne me suis pas résolu à appuyer sur le rectangle rouge (ci-dessous), malgré un fétichisme tenace. Frontière. L.M.

Aharon Appelfeld est mort hier 4 janvier. Hommage.
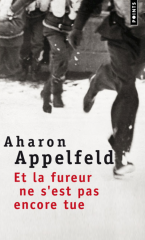 J'ai plaisir à lire des livres dont on parle peu, qui ne font de bruit que celui des pages que l'on tourne et qui possèdent pourtant des qualités immenses et insoupçonnées du grand public; ce que je regrette. "Et la fureur ne s'est pas encore tue", d'Aharon Appelfeld, par exemple, du grand humaniste hanté par les camps, n'est pas un larmoiement à la Elie Wiesel, mais plutôt un hymne à la fraternité, un éloge de la dignité humaine, qui rapproche Appelfeld de Primo Lévi. L'horreur innommable nous est ici décrite calmement, sans haine, car toujours percent le courage et l'espoir à la surface de l'Enfer. C'est d'un grand message d'humanité et d'humilité qu'il s'agit, avec, au bout d'une interminable errance dans la neige et la forêt -avec la peur du nazi, la faim, le froid, les loups, après une évasion d'un camp, le cadre d'un chateau dans la ville de Naples pour havre, ouvert aux survivants, avant le chemin du Retour, si existent encore pour chacun, et ce chemin et des Lieux. Le bonheur de lecture ne vient pas à l'improviste, avec les livres d'Appelfeld, mais il surgit doucement à la faveur d'une sorte de petit miracle : je pense à l'allégorie de la musique de Bach ou Brahms jouée par un trio, et à la lecture du Livre, qui parviennent à transfigurer les visages des réfugiés. Ainsi reviennent-ils à la vie, s'échappent-ils un instant de l'horreur qui les hante et les hantera tout leur vie... Le narrateur au moignon ajoute alors : Tout ce qui n'est pas compréhensible n'est pas forcément étrange.
J'ai plaisir à lire des livres dont on parle peu, qui ne font de bruit que celui des pages que l'on tourne et qui possèdent pourtant des qualités immenses et insoupçonnées du grand public; ce que je regrette. "Et la fureur ne s'est pas encore tue", d'Aharon Appelfeld, par exemple, du grand humaniste hanté par les camps, n'est pas un larmoiement à la Elie Wiesel, mais plutôt un hymne à la fraternité, un éloge de la dignité humaine, qui rapproche Appelfeld de Primo Lévi. L'horreur innommable nous est ici décrite calmement, sans haine, car toujours percent le courage et l'espoir à la surface de l'Enfer. C'est d'un grand message d'humanité et d'humilité qu'il s'agit, avec, au bout d'une interminable errance dans la neige et la forêt -avec la peur du nazi, la faim, le froid, les loups, après une évasion d'un camp, le cadre d'un chateau dans la ville de Naples pour havre, ouvert aux survivants, avant le chemin du Retour, si existent encore pour chacun, et ce chemin et des Lieux. Le bonheur de lecture ne vient pas à l'improviste, avec les livres d'Appelfeld, mais il surgit doucement à la faveur d'une sorte de petit miracle : je pense à l'allégorie de la musique de Bach ou Brahms jouée par un trio, et à la lecture du Livre, qui parviennent à transfigurer les visages des réfugiés. Ainsi reviennent-ils à la vie, s'échappent-ils un instant de l'horreur qui les hante et les hantera tout leur vie... Le narrateur au moignon ajoute alors : Tout ce qui n'est pas compréhensible n'est pas forcément étrange.
 Dans "Le garçon qui voulait dormir", Aharon Appelfeld s'autodécrit à travers les traits du jeune Erwin, 17 ans, recueilli en Palestine (encore sous mandat après la guerre), et qui commence une seconde vie déjà, au moment de bâtir Israël. L'adolescent ne trouve l'apaisement que dans le sommeil. Il semble vouloir oublier, tandis qu'il cultive inconsciemment les souvenirs. En réalité, la fuite inexorable et prégnante dans le sommeil lui permet de retrouver ses parents morts dans les profondeurs de la nuit, lui qui doit aussi désapprendre sa langue maternelle pour apprendre l'hébreu. C'est puissant et tendre à la fois, prodigieusement onirique et tendu, et à la fois accroché au réel. Un livre aussi bouleversant que l'inoubliable "Histoire d'une vie", du même auteur disparu hier, et dont voici deux extraits :
Dans "Le garçon qui voulait dormir", Aharon Appelfeld s'autodécrit à travers les traits du jeune Erwin, 17 ans, recueilli en Palestine (encore sous mandat après la guerre), et qui commence une seconde vie déjà, au moment de bâtir Israël. L'adolescent ne trouve l'apaisement que dans le sommeil. Il semble vouloir oublier, tandis qu'il cultive inconsciemment les souvenirs. En réalité, la fuite inexorable et prégnante dans le sommeil lui permet de retrouver ses parents morts dans les profondeurs de la nuit, lui qui doit aussi désapprendre sa langue maternelle pour apprendre l'hébreu. C'est puissant et tendre à la fois, prodigieusement onirique et tendu, et à la fois accroché au réel. Un livre aussi bouleversant que l'inoubliable "Histoire d'une vie", du même auteur disparu hier, et dont voici deux extraits :
 "C'était l'enclos (Keffer) des chiens-loups utilisés pour monter la garde, pour la chasse, et principalement pour les chasses des hommes (...) Un jour arriva un convoi dans lequel se trouvaient des petits enfants. Le commandant du camp ordonna de les déshabiller et de les pousser dans l'enclos. Les enfants furent dévorés aussitôt, apparemment, car nous n'entendîmes pas de cris. Et cela devint une habitude..."
"C'était l'enclos (Keffer) des chiens-loups utilisés pour monter la garde, pour la chasse, et principalement pour les chasses des hommes (...) Un jour arriva un convoi dans lequel se trouvaient des petits enfants. Le commandant du camp ordonna de les déshabiller et de les pousser dans l'enclos. Les enfants furent dévorés aussitôt, apparemment, car nous n'entendîmes pas de cris. Et cela devint une habitude..."
"Nous avons l'habitude d'entourer les grandes catastrophes de mots afin de nous en protéger. Les premiers mots de ma main furent des appels désespérés pour trouver le silence qui m'avait entouré pendant la guerre et pour le faire revenir vers moi. Avec le même sens que celui des aveugles, j'ai compris que dans ce silence était cachée mon âme et que, si je parvenais à le ressusciter, peut-être que la parole juste me reviendrait".
L.M.
C'est à lire en Points (Seuil).

Merveilleuse Séville qui prend le soin de réaliser un assemblage d'azulejos pour inviter - en termes choisis - les élèves du collège San Isidro à ne pas déranger les oiseaux qui vivent et nichent dans l'enceinte de celui-ci. Cela peut se lire depuis la rue, à l'entrée de l'établissement, et c'est empreint de délicatesse ferme. Le tact, et l'expression du respect fondamental. Soit l'élégance. La marque andalouse.
De même, flâner dans les rues de cette ville splendide, c'est retrouver le chant du moineau domestique (passer domesticus) que l'on oublie, dans les grandes villes françaises où ce passereau se raréfie, mais jadis si courant que nul ne prêtait attention aux piafs. Ils sont nombreux à piailler, à venir jusqu'à vos pieds recueillir quelque miette, aux terrasses des plazas comme celle de Doña Elvira. Et entendre simplement une conversation de moineaux (avant de les apercevoir) augmente le plaisir esthétique du voyage. L.M.
 C'est l'un des plus beaux dialogues platoniciens. Socrate y est au plus haut de sa forme, pour exprimer l'art de la réthorique, la tempérance, la bienveillance, la justice (et son mal suprême corollaire : celui de n'être pas puni pour l'injustice que l'on commet); la domination des désirs et donc le bonheur (aux accents épicuriens) : Qui veut être heureux doit se vouer à la poursuite de la tempérance et doit la pratiquer...
C'est l'un des plus beaux dialogues platoniciens. Socrate y est au plus haut de sa forme, pour exprimer l'art de la réthorique, la tempérance, la bienveillance, la justice (et son mal suprême corollaire : celui de n'être pas puni pour l'injustice que l'on commet); la domination des désirs et donc le bonheur (aux accents épicuriens) : Qui veut être heureux doit se vouer à la poursuite de la tempérance et doit la pratiquer...
Tout Socrate y est résumé, jusqu'à la métaphore de l'épisode de la ciguë. L'art de la politique, le rôle du citoyen dans la Cité, la définition du pilote, la vile incapacité pour un homme à se défendre... Bon, évidemment, Platon sépare l'âme et le corps au moment de la mort, et semble curieusement faire l'éloge de la sophistique au détour d'une tirade à l'adresse de Calllicalès. (N'est pas Spinoza qui veut).
Gorgias ou la lumière sur les sentiments et les comportements. Le relire, c'est prendre un bain de jouvence, plonger dans un jacuzzi électrique. C'est faire le plein de sourire. L.M.
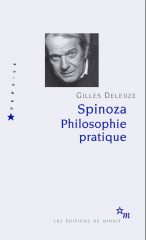 L'Ethique, oeuvre de Baruch Spinoza, s'impose de jour en jour comme le livre essentiel. Signe : je le range à côté des Essais de Montaigne et de Socrate pêle-mêle (les dialogues divers de Platon). Gilles Deleuze, dont le Spinoza Philosophie pratique (Minuit) constitue, à mes yeux, un complément d'objet direct précieux de cette oeuvre, résume clairement la question des passions tristes, qui polluent la vie de l'être humain, quelle que soit sa confession, ou obédiance, soumission, adhésion... Depuis la naissance du premier monothéisme. Depuis l'invention du Politique. Depuis que le pouvoir existe. Depuis trop longtemps...
L'Ethique, oeuvre de Baruch Spinoza, s'impose de jour en jour comme le livre essentiel. Signe : je le range à côté des Essais de Montaigne et de Socrate pêle-mêle (les dialogues divers de Platon). Gilles Deleuze, dont le Spinoza Philosophie pratique (Minuit) constitue, à mes yeux, un complément d'objet direct précieux de cette oeuvre, résume clairement la question des passions tristes, qui polluent la vie de l'être humain, quelle que soit sa confession, ou obédiance, soumission, adhésion... Depuis la naissance du premier monothéisme. Depuis l'invention du Politique. Depuis que le pouvoir existe. Depuis trop longtemps...
Quid de la méthode géométrique selon Spinoza : la satire, écrit le génial philosophe de la joie, du désir et de la puissance d'exister, c'est tout ce qui prend plaisir à l'impuissance et à la peine des hommes, tout ce qui exprime le mépris et la moquerie, tout ce qui se nourrit d'accusations, de malveillances, de dépréciations, d'interprétations basses, tout ce qui brise les âmes (le tyran a besoin d'âmes brisées, comme les âmes brisées, d'un tyran).
Car Spinoza, souligne Deleuze, ne cesse de dénoncer dans toute son oeuvre trois sortes de personnages : l'homme aux passions tristes; l'homme qui exploite ces passions tristes, qui a besoin d'elles pour asseoir son pouvoir; enfin, l'homme qui s'attriste sur la condition humaine et les passions de l'homme en général. L'esclave, le tyran et le prêtre...
Traité théologico-politique (car, en effet, il n'y a pas que L'Ethique dans l'oeuvre de S.), préface, extrait : Le grand secret du régime monarchique et son intérêt profond consistent à tromper les hommes, en travestissant du nom de religion la crainte dont on veut les tenir en bride; de sorte qu'ils combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut.
Deleuze : Le tyran a besoin de la tristesse des âmes pour réussir, tout comme les âmes tristes ont besoin d'un tyran pour subvenir et propager. Ce qui les unit, de toute manière, c'est la haine de la vie, le ressentiment contre la vie.
Au rang des passions tristes, Spinoza compte - énumère, même, dans cet ordre : la tristesse, la haine, l'aversion, la moquerie, la crainte, le désespoir, le morsus conscientae, la pitié, l'indignation, l'envie, l'humilité, le repentir, l'abjection, la honte, le regret, la colère, la vengeance, la cruauté. (Ethique, III).
Spinoza oppose à cela la vraie cité, qui propose au citoyen l'amour de la liberté plutôt que l'espoir des récompenses ou même la sécurité des biens. Car, c'est aux esclaves, non aux hommes libres, qu'on donne des récompenses pour leur bonne conduite.
Donc, foin des passions tristes! Car, en écoutant Spinoza, et Nietzsche après lui (et les éclairages qu'en a donné Deleuze), il convient de dénoncer toutes ces falsifications de la vie, toutes ces valeurs au nom desquelles nous déprécions la vie : nous ne vivons pas, nous ne menons qu'un semblant de vie, nous ne songeons qu'à éviter de mourir, et toute notre vie est un culte de la mort...
L.M.
Note que je rédigeai il y a neuf ans sur ce blog, et sur laquelle je retombai à l'instant.
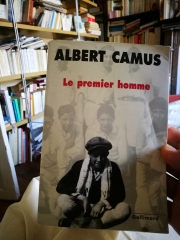 Jeune, je demandais aux êtres plus qu'ils ne pouvaient donner : une amitié continuelle, une émotion permanente. Je sais leur demander maintenant moins qu'ils peuvent donner : une compagnie sans phrases. Et leurs émotions, leur amitié, leurs gestes nobles gardent à mes yeux leur valeur entière de miracle : un entier effet de la grâce.
Jeune, je demandais aux êtres plus qu'ils ne pouvaient donner : une amitié continuelle, une émotion permanente. Je sais leur demander maintenant moins qu'ils peuvent donner : une compagnie sans phrases. Et leurs émotions, leur amitié, leurs gestes nobles gardent à mes yeux leur valeur entière de miracle : un entier effet de la grâce.
Albert Camus, Le premier homme
 Paris, 22 décembre 2007. Nous prenons la route pour Bayonne avec les enfants afin d'aller passer Noël en famille lorsque C., que nous venons juste de quitter, m’apprend la nouvelle d’un coup de téléphone bref, comme si elle annonçait la disparition d’un proche. Un flash radio et puis voilà. Julien Gracq vient de mourir.
Paris, 22 décembre 2007. Nous prenons la route pour Bayonne avec les enfants afin d'aller passer Noël en famille lorsque C., que nous venons juste de quitter, m’apprend la nouvelle d’un coup de téléphone bref, comme si elle annonçait la disparition d’un proche. Un flash radio et puis voilà. Julien Gracq vient de mourir.
Parvenus sur l'autoroute, je téléphone à mon ami Benoît Lasserre, grand reporter à Sud-Ouest, ainsi qu’à mon pote Didier Pourquery, qui dirige alors la rédaction de Libération tout en prévenant ma fille et mon fils : le voyage va être particulier. J’ai besoin de m’exprimer d’urgence. Un tic de journaliste. Et de lecteur « partisan », disait-il lorsque j’évoquais ses livres…
Je dicte le texte pour Sud-Ouest à ma fille qui le saisit sur un petit ordinateur tandis que je conduis sur l’A10. Tu as intérêt à te presser mon vieux, il me faut ton papier avant 16h si tu veux qu'il paraisse demain, avait prévenu Benoît. Par chance, une station-service d’autoroute accueillît une clé USB et procéda à l'envoi d'un e-mail. Je donnais un texte plus long à Libé après Noël depuis un hôtel de Fontarrabie, qui parut aux premiers jours de janvier.
Ce besoin de rendre hommage. Julien Gracq n’était plus. Je pensais égoïstement : fini ses livres à venir (*), adieu lettres, visites à Saint-Florent-le-Vieil, agapes à La Gabelle, tout ça.
Dix ans après, ce 22 décembre 2017, je me souviens d'un Gracq serein face à l’idée de la mort : Je suis en surnuméraire, disait-il en évoquant ses pairs. D’aucuns me pensent déjà mort depuis longtemps, lancait-il avec une espièglerie qui dissimulait mal une peine légère, en dentelle. Je quitterai ce monde sans regret (tant je ne m'y reconnais plus), assénait-il.
Je pense à la radicalité de ses nuances, au non qui ouvrait chacune de ses phrases, aux silences, à la Loire juste devant le salon où il recevait les groupies dont j’étais, je le relis au hasard, ayant un « commerce » (au sens où Montaigne emploie ce mot) avec les volumes usés de son oeuvre, qui sont devenus des potes, un chien que l’on caresse négligemment en regardant le feu; des compagnons nourrissants.
Un écrivain ne meurt que lorsque nous l’avons oublié. Aucun risque avec un tel monument. Je me réjouis de savoir que 5 000 Rivage des Syrtes sortent des presses chaque année (il m’avait fièrement donné le chiffre). Sans parler des vingt autres titres. Le cercle des initiés s’agrandit. Gracq est devenu un classique.
Je donnais une conférence à son sujet le 7 novembre dernier à l’Institut français de la mode, sollicité par l'ami Lucas Delattre, et que France Culture diffusa le lendemain. Il y avait là un parterre d’étudiants attentifs (quatre à peine sur une cinquantaine avaient entendu parler de l'auteur du Beau ténébreux), voire pressés d’en découdre avec son oeuvre, puisqu'ils commandaient les ouvrages sur Internet avant la fin de l'intervention.
Cela fait du bien de savoir que le mélancolique aspirant Grange, la sensuelle et féline Mona, l'austère et altier Aldo, la mystérieuse et envoûtante Vanessa, la poésie en prose droite d'une Sieste en Flandre hollandaise, le cours capricieux et digitalisant des Eaux étroites, les fragments buissonniers mais précis qui irriguent les Carnets du grand chemin, les essais salutaires, secs, rigoureux de En lisant en écrivant rencontrent de nouveaux lecteurs, soit des passeurs en puissance.
Passer, faire passer. Rien ne compte davantage. C’est à la belle santé de ces nouveaux passeurs que je pense d'abord, ce matin.
L.M.
---
(*) Depuis, sont parus Manuscrits de guerre et Les Terres du couchant (Corti).
Formidable édito de Riss dans Charlie qui paraît. C'est salutaire, décapant, alors faites passer, car c'est d'utilité publique :

En images









... Et c'est d'ailleurs ce que préconise Laurène Bigeau dans Les Grands Ducs : cliquez => Offrez le DicoChic de Léon
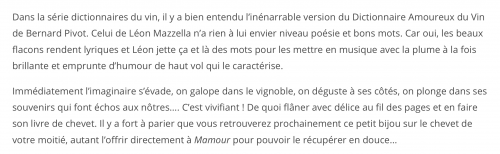

Signatures à Anglet le week-end prochain :
Vendredi 15 à partir de 16h au Carrefour BAB2;
Samedi 16 à partir de 11H : conférence-signature à la bibliothèque Quintaou;
Samedi 16, de 15h à 17h, au Centre Leclerc;
Dimanche 17 à partir de 9h30, à la librairie-maison de la presse des Cinq Cantons.
Lire ci-dessous : l'interview donnée à Nathalie Gomez pour Anglet Magazine, qui paraît.





Curieux comme ce célèbre poème de Sully Prudhomme (1839-1907, il fut, en 1901, le premier prix Nobel de littérature de l'histoire) résonne à la manière des non moins fameux derniers mots de Henri Calet (1904-1956), dans Peau d'ours (Ne me secouez pas, je suis plein de larmes). Une même sensibilité extrême, celle qui définit la littérature en ce qu'elle renferme de plus ténu.
LE VASE BRISÉ
Le vase où meurt cette verveine
D'un coup d'éventail fut fêlé ;
Le coup dut effleurer à peine :
Aucun bruit ne l'a révélé.
Mais la légère meurtrissure,
Mordant le cristal chaque jour,
D'une marche invisible et sûre
En a fait lentement le tour.
Son eau fraîche a fui goutte à goutte,
Le suc des fleurs s'est épuisé ;
Personne encore ne s'en doute ;
N'y touchez pas, il est brisé.
Souvent aussi la main qu'on aime,
Effleurant le cœur, le meurtrit ;
Puis le cœur se fend de lui-même,
La fleur de son amour périt ;
Toujours intact aux yeux du monde,
Il sent croître et pleurer tout bas
Sa blessure fine et profonde ;
Il est brisé, n'y touchez pas.
René-François Sully Prudhomme
Je n'ai jamais cru au hasard. Je viens juste de tomber sur cette photo que je ne connaissais pas en surfant sur la Toile. Et voici onze ans, ce 2 décembre, que mon père a disparu.
On y voit l'un des cargos de feu l'armement maritime familial, portant le nom de mon grand-père, de mon père et le mien (ainsi que son port d'attache : Bayonne). Le bandeau de la cheminée frappée d'un M blanc est bleu ciel. La coque est noire, les châteaux blancs, les chaloupes orange et bâchées de vert.
La photo (signée Bernardas Aleknavičius), a été prise au début des années 1970 dans le port de Klaipėda, en Lituanie, où le Léon, ainsi que mon père le désignait, se rendait régulièrement.
Le navire est visiblement chargé, vu le tirant d'eau qui est presque à calaison (son maximum), mais j'ignore ce qu'il a dans ses flancs.
Je n'ai pas pour habitude de consigner des informations personnelles d'ordre familial, sur ce blog. Cette exception confirme la règle. L.M.


C'est en kiosque pour deux mois, et ce sont des extraits de ma chronique libre intitulée "J'aime" (séquence : Rugby et culture, rubrique : Ressentir).
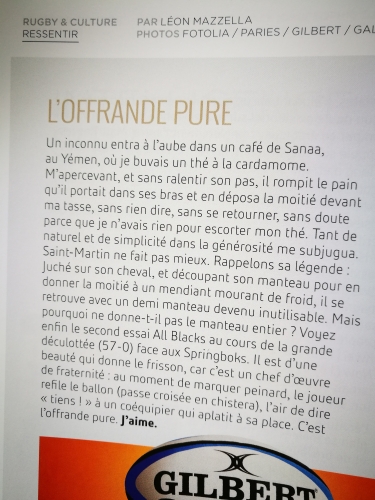
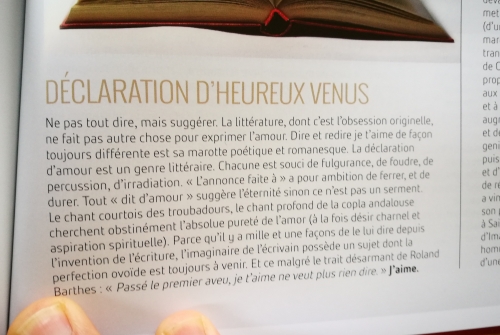

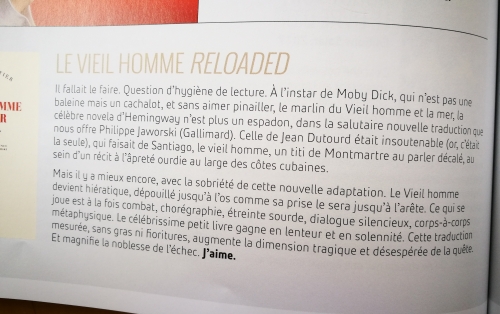

Le courage (Athos), le panache (Cyrano), l’honneur (les Résistants), l’humilité (notre héritage judéo-chrétien). Quatre raisons - il y en a d’autres -, de lire « La Nostalgie de l’honneur », de Jean-René Van der Plaetsen (Grasset), prix Interallié 2017.
Voici un entretien avec l'auteur paru dans Le Figaro : La Nostalgie de l'honneur

 Un bordeaux supérieur, château La Verrière à Landerrouat (85% merlot,15% cabernet-sauvignon), stupéfiant de concentration et de vérité - loin de ces centaines de bordeaux buvardeux, rêches, austères mais sans classe -, s’ouvre à nous ( : trois amateurs). Le viticulteur se nomme Alain Bessette et son œnologue Jean-Louis Vinolo. Les vignes sont en conduite raisonnée. Le flacon ne coûte pas 6€, c'est donc une superbe affaire : c’est élégant et vigoureux, souple et riche, dense et fruité à souhait, pur et propre, avons-nous envie d’ajouter.
Un bordeaux supérieur, château La Verrière à Landerrouat (85% merlot,15% cabernet-sauvignon), stupéfiant de concentration et de vérité - loin de ces centaines de bordeaux buvardeux, rêches, austères mais sans classe -, s’ouvre à nous ( : trois amateurs). Le viticulteur se nomme Alain Bessette et son œnologue Jean-Louis Vinolo. Les vignes sont en conduite raisonnée. Le flacon ne coûte pas 6€, c'est donc une superbe affaire : c’est élégant et vigoureux, souple et riche, dense et fruité à souhait, pur et propre, avons-nous envie d’ajouter.
Il fait partie des six nouveaux Bordeaux et Bordeaux Supérieur rouges « de talent », sélectionnés récemment dans le millésime 2015, au cours d’une dégustation à l’aveugle d’une centaine de flacons. Et c'est notre chouchou...
Le second, la cuvée Fougue (100% merlot, 7,50€) du château Saincrit porte bien son nom. L’énergie d’un étalon au galop donne rendez-vous à une douceur en finale –souplesse, suavité et puissance retenue -, qui signent l’esprit de dompteur de sa viticultrice, Florence Prud’homme. Passionnée de cheval, elle a placé une licorne pour blason de son domaine, sis à Saint-André-de-Cubzac. Détail d’importance : aéré longuement, le vin s’ouvre avec bénéfice comme les cuisses d’une jument d’avril.
Saincrit porte bien son nom. L’énergie d’un étalon au galop donne rendez-vous à une douceur en finale –souplesse, suavité et puissance retenue -, qui signent l’esprit de dompteur de sa viticultrice, Florence Prud’homme. Passionnée de cheval, elle a placé une licorne pour blason de son domaine, sis à Saint-André-de-Cubzac. Détail d’importance : aéré longuement, le vin s’ouvre avec bénéfice comme les cuisses d’une jument d’avril.
 Le troisième lauréat, château Les Reuilles, cuvée Héritage AL (60% merlot, 40% cabernet-sauvignon, 9€), élaboré par l’équipe de Patrick Todesco, qui siège à Savignac-de-Duras dans le Lot-et-Garonne (aux confins de l’Entre-Deux-Mers et de Saint-Emilion) – le vignoble est situé dans l’aire de l’appellation Bordeaux Sainte-Foy -, offre un nez de fruits noirs mûrs et de violette, assez caractéristique. Cette cuvée haut de gamme du domaine est le fruit d’une sélection qui jouit d’un élevage d’un an en barriques partiellement neuves. C’est opulent, concentré sans être embarrassant, car fluide et jamais lourd. Une réussite, là aussi.
Le troisième lauréat, château Les Reuilles, cuvée Héritage AL (60% merlot, 40% cabernet-sauvignon, 9€), élaboré par l’équipe de Patrick Todesco, qui siège à Savignac-de-Duras dans le Lot-et-Garonne (aux confins de l’Entre-Deux-Mers et de Saint-Emilion) – le vignoble est situé dans l’aire de l’appellation Bordeaux Sainte-Foy -, offre un nez de fruits noirs mûrs et de violette, assez caractéristique. Cette cuvée haut de gamme du domaine est le fruit d’une sélection qui jouit d’un élevage d’un an en barriques partiellement neuves. C’est opulent, concentré sans être embarrassant, car fluide et jamais lourd. Une réussite, là aussi.
Château Barreyre, géré par Claude Gaudin (Vitigestion), exprime ce qu’il peut et pour moins de 10€ cependant. Soit une belle expression, honorable mais guère davantage, d’un pourcentage correctement conduit de 70% merlot - 30% cabernet-sauvignon, élevage sous bois une année durant (1/4 de fûts neufs), mais dont le résultat est on ne peut plus académique, bordelais mais moyen, tannique ce qu’il faut, fruité ce qu’il convient. Zéro surprise (mûre, cassis correctement dosés, soyeux de série œcuménique, élégance pile au rendez-vous mais sans entrain – vous saisissez ?.. ). Un « bordeaux supérieur » comme il s’en trouve près de mille, ou à peine moins.
qu’il peut et pour moins de 10€ cependant. Soit une belle expression, honorable mais guère davantage, d’un pourcentage correctement conduit de 70% merlot - 30% cabernet-sauvignon, élevage sous bois une année durant (1/4 de fûts neufs), mais dont le résultat est on ne peut plus académique, bordelais mais moyen, tannique ce qu’il faut, fruité ce qu’il convient. Zéro surprise (mûre, cassis correctement dosés, soyeux de série œcuménique, élégance pile au rendez-vous mais sans entrain – vous saisissez ?.. ). Un « bordeaux supérieur » comme il s’en trouve près de mille, ou à peine moins.
 « Au suivant », me souffle Jacques Brel : le château Pierrail (90% merlot, 10% cabernet franc - ? - 12€), est d’une austérité étrange, qui n’a rien de monacal ni de militaire, mais qui fait sérieux. C’est Erich Von Stroheim sans son col amidonné, de Boïeldieu sans ses jambières, le désert sans les Tartares, les Syrtes sans Amirauté. Il manque quelque chose à ces merlots pourtant habiles à séduire le nez, mais impuissants à garder en bouche ce « tssa », cette indéfinissable saveur qui persiste à retenir, coûte que coûte, notre présence redoutable, soit en avant-poste. Néanmoins, Pierrail parle, ou plutôt chuchote. Il possède une certaine classe qui ne se détecte pas à la première gorgée. C’est là son mérite.
« Au suivant », me souffle Jacques Brel : le château Pierrail (90% merlot, 10% cabernet franc - ? - 12€), est d’une austérité étrange, qui n’a rien de monacal ni de militaire, mais qui fait sérieux. C’est Erich Von Stroheim sans son col amidonné, de Boïeldieu sans ses jambières, le désert sans les Tartares, les Syrtes sans Amirauté. Il manque quelque chose à ces merlots pourtant habiles à séduire le nez, mais impuissants à garder en bouche ce « tssa », cette indéfinissable saveur qui persiste à retenir, coûte que coûte, notre présence redoutable, soit en avant-poste. Néanmoins, Pierrail parle, ou plutôt chuchote. Il possède une certaine classe qui ne se détecte pas à la première gorgée. C’est là son mérite.
Le château Landereau, cuvée Prestige, enfin, qui appartient aux vignobles Bruno Baylet à Sadirac, est un pur merlot vieilli en fûts neufs 18 mois durant, qui titre 14,5° d’alcool (la Terre se réchauffe, n’est-ce pas ?), mais qui ne fleure pas la « tisane de bois », ni les éthers, ces saveurs alcooleuses et peu racoleuses qui flirtent parfois avec des arômes de térébenthine. Rien de tout cela dans un verre de Landereau prestigieux (13€). En revanche, son sérieux rebute un peu. C’est certes capiteux, riche, mais peut-être trop, et je ne vois qu’une daube de sanglier ou bien une côte de bœuf bien maturée pour le calmer en l’épaulant. Question d’accords. Ce n’est donc pas un vin d’apéro. Ni de tafiole. Et c’est ainsi que, kaléidoscopique, Bordeaux est grande. L.M.
Sadirac, est un pur merlot vieilli en fûts neufs 18 mois durant, qui titre 14,5° d’alcool (la Terre se réchauffe, n’est-ce pas ?), mais qui ne fleure pas la « tisane de bois », ni les éthers, ces saveurs alcooleuses et peu racoleuses qui flirtent parfois avec des arômes de térébenthine. Rien de tout cela dans un verre de Landereau prestigieux (13€). En revanche, son sérieux rebute un peu. C’est certes capiteux, riche, mais peut-être trop, et je ne vois qu’une daube de sanglier ou bien une côte de bœuf bien maturée pour le calmer en l’épaulant. Question d’accords. Ce n’est donc pas un vin d’apéro. Ni de tafiole. Et c’est ainsi que, kaléidoscopique, Bordeaux est grande. L.M.


Le Désert des Tartares, de Dino Buzzati, adapté au cinéma en 1976 par Valerio Zurlini, avec une distribution mirifique : Fernando Rey, Vittorio Gassman, Max Von Sydow, Philippe Noiret, Jean-Louis Trintignant, Laurent Terzieff, Giuliano Gemma, Francisco Rabal, Helmut Griem... Et un jeune Jacques Perrin impérial, est de ces films, à l’instar de La 317ème Section ou du Crabe-Tambour, pour ne citer que deux opus signés Pierre Schoendoerffer avec Jacques Perrin et d’immenses Bruno Cremer, Jean Rochefort, Jacques Dufilho pour escorte, qui laissent des traces dans notre mémoire. Celle-ci est faite de vertu (virtus), d’honneur, de dignité, de parole donnée, de fidélité, de respect, de courage enfin. Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq plane sur ce Désert, et le lieutenant Drogo ressemble tellement à Aldo que parfois nous les confondons dans une lecture croisée ou plutôt mêlée agréablement, sans dissociation excessive.
Un tressaillement de coque
Nous trouvons, en prêtant l’oreille et l’attention, un même vrombissement ourdi, une marée montante, un bourdonnement, un « tressaillement de coque ». Au lieu de citer Buzzati, je choisis de citer l’humilité de Gracq à propos de son propre Rivage, roman frère (*) du Désert : « J’aurais voulu qu’il ait la majesté paresseuse du premier grondement lointain de l’orage, qui n’a aucun besoin de hausser le ton pour s’imposer, préparé qu’il est par une longue torpeur imperçue » (En lisant en écrivant). J’ai revu le film adapté du Désert, ce mardi soir, et j’en garde derechef le sentiment suranné d’une morale perdue, d’un art d’être, d’un comportement fraternel entre tous admirable ; profondément humain, en somme, là, sur cet « excipient inerte », comme Gracq qualifiait le matériau géographique de son Rivage. Et cet « imperçu » volontaire est magnifié par Valerio Zurlini ainsi que par les puissantes jumelles de la Capitainerie, brandies entre les créneaux du Fort Bastiani, siège d'un roman de l'attente (d'un ennemi)... Ce qui se raréfie possède un prix, et ce livre ainsi que ce film fidèle au texte de Buzzati, en sont l’inestimable preuve. Il s’agit là d’un septième art révolu, eu égard à l’indigence de la production ambiante, laquelle ne serait presque rien sans son Botox technologique. Faites donc passer. L.M.
brandies entre les créneaux du Fort Bastiani, siège d'un roman de l'attente (d'un ennemi)... Ce qui se raréfie possède un prix, et ce livre ainsi que ce film fidèle au texte de Buzzati, en sont l’inestimable preuve. Il s’agit là d’un septième art révolu, eu égard à l’indigence de la production ambiante, laquelle ne serait presque rien sans son Botox technologique. Faites donc passer. L.M.
---
(*) J'évoquerai ultérieurement la tout aussi évidente fraternité du Rivage et du Désert avec Sur les falaises de marbre, d'Ernst Jünger.
Photo © Régis Guichenducq. Bayonne, le 22 octobre dernier. 
Textes de Léon Mazzella, Photographies de Sébastien Carnet et Régis Guichenducq. CLIQUEZ ICI POUR COMMANDER L'OUVRAGE => éditions Passiflore
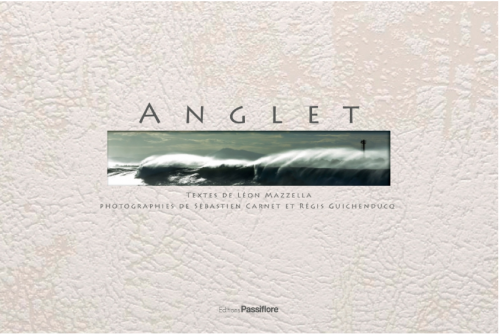
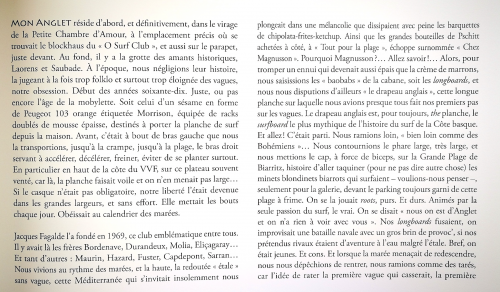
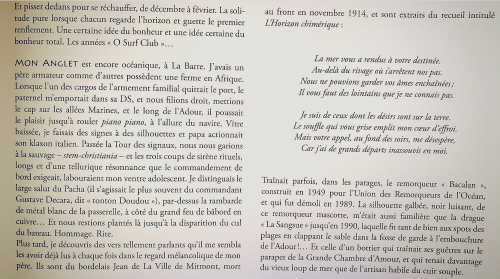
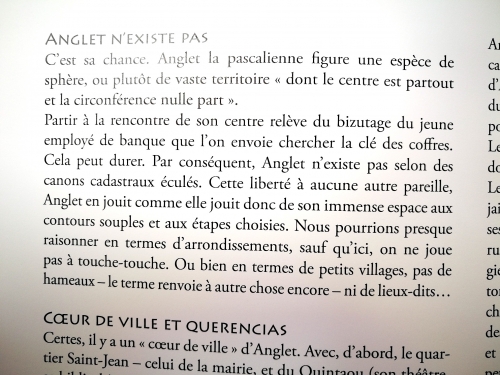

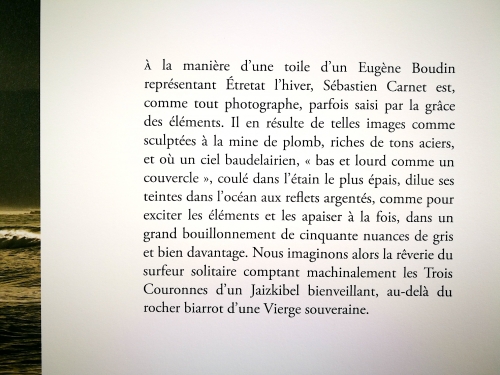
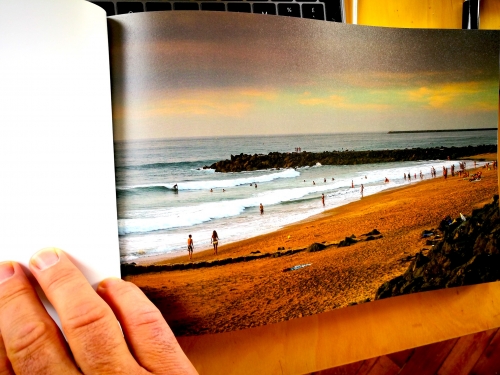
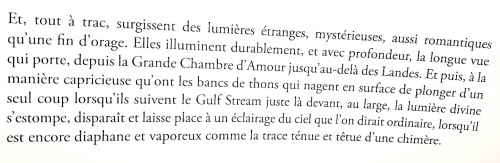
 Il y a des prix littéraires qui prennent le goût de l'extrême onction. La grande anthropologue Françoise Héritier, décédée ce matin, jour de ses 84 ans (*), auteur d'un délicieux et si personnel Le sel de la vie, en marge de ses livres majeurs, avait reçu le 8, soit il y a une semaine, un prix spécial du jury Femina pour l'ensemble de son oeuvre. Aura-t-elle eu le temps d'en savourer le funeste artifice?..
Il y a des prix littéraires qui prennent le goût de l'extrême onction. La grande anthropologue Françoise Héritier, décédée ce matin, jour de ses 84 ans (*), auteur d'un délicieux et si personnel Le sel de la vie, en marge de ses livres majeurs, avait reçu le 8, soit il y a une semaine, un prix spécial du jury Femina pour l'ensemble de son oeuvre. Aura-t-elle eu le temps d'en savourer le funeste artifice?..
---
Bravo, au passage, au talentueux Jean-Luc Coatalem, qui a décroché le Femina essai (pour lequel Héritier concourrait), avec son hommage prenant à Victor Segalen : Mes pas vont ailleurs (Stock).
L.M.
(*) La dernière fois que je l'ai croisée, lors d'un salon littéraire il y a un an environ, elle se déplaçait sur un fauteuil roulant et ses cervicales avaient de la peine à maintenir sa tête droite.
 Reprendre ce livre-là de Pascal Jardin et se délecter de ses images, de ses traits et de ses portraits. Extraits au hasard :
Reprendre ce livre-là de Pascal Jardin et se délecter de ses images, de ses traits et de ses portraits. Extraits au hasard :
L'enfance c'est le point d'eau. On y revient toujours.
La vie a tapé sur moi comme sur un tambour...
... la marée qui monte à la vitesse d'un cheval au galop dans la Baie du Mont Saint-Michel...
La torpédo est une Ford noire, trapue, décapotable, à malle arrière spider. Ses larges marchepieds, ses phares comme des marmites à confiture et ses roues à rayons lui donnent fière allure. (...) ... le chemin ravaudé avec du mâchefer craque comme des pommes chips sous les roues de la torpédo.
L'Angleterre : une monarchie, un brouillard, une île immense flottant au milieu d'une mer de thé.
Alain Delon : son magnétisme animal le dispute à sa ruse d'aventurier aguerri. (...) Il promène sur le monde un regard d'acier où semblent briller des larmes venues de la petite enfance.
Yves Salgues (qui fut journaliste à Jours de France) : Débordant de vitriol, il trempait par devoir alimentaire sa plume dans le miel, racontant avec flamme et circonspection les grossesses des reines, les mariages de Bardot. C'était Céline à la Semaine de Suzette. Sa pensée est zébrée et ses phrases chantantes prennent naturellement la forme des alexandrins. Son esprit chimérique baigne dans un cocktail de vapeurs indéfinissables, aussi la moindre de ses explications est-elle touffue et luxuriante comme la forêt amazonienne.
Pierre Fresnay : ce soir-là j'ai vu en chair et en os le capitaine de Boïeldieu avec ses bandes molletières, son air modeste et noble. (...) Il n'était pas accompagné d'Eric Von Stroheim mais de sa femme, Yvonne Printemps. Elle était belle, comme on peut l'être avec un corps d'éphèbe, une taille élancée, une cascade de cheveux d'or, un esprit pointu, un nez retroussé d'une drôlerie extrême et puis sa voix avec des inflexions incomparables, comme des sourires. Tout de suite, je les ai aimés, tous les deux. Ils appartenaient et appartiennent encore à la race des impossibles. Lui était solide comme une digue, sur laquelle venaient se briser inlassablement les colères fantasques de sa femme.
Jean Anouilh : Trente ans après (leur première rencontre) le génie n'avait toujours pas pris chez lui le visage de Mozart. Une consternation universelle et aiguë s'étalait sur sa figure de clerc de notaire et, derrière ses lunettes rondes, brillaient deux yeux terribles qui ne semblaient voir qu'en lui-même.
Jean Gabin : ... Non, ça suffit! Allez-y voir vous même. C'est disponible dans Les Cahiers Rouges (Grasset). Moi, je continue de le lire... L.M.
 Non, décidément rien ne l'arrête. Martine Brana, distillatrice basque, après avoir ajouté à sa gamme emblématique (poire, prune, framboise...) une clémentine bio de Corse, puis un Gin au piment d'Espelette, propose à présent une eau de vie de Cédrat bio de Corse - élevée en cuves inox afin de préserver toute la fraîcheur de ce fruit doté de qualités organoleptiques exceptionnelles -, dont la suavité et la fraîcheur sont confondantes. Le nez est aussi puissant que séducteur, infiniment fruité et zesté, et l'attaque en bouche est forte comme une aube dans la forêt de Vizzavona, avec ce rien de résiné qui envoie du caractère. Il faut avouer que l'association de la Corse et du Pays basque, fut-elle alambiquée, ne produit pas de petit lait... Très belle persistance en arrière-bouche. On en redemande. 722 flacons seulement (50 cl, 44°, 83€). Dépêchez-vous, c'est un bijou. L.M.
Non, décidément rien ne l'arrête. Martine Brana, distillatrice basque, après avoir ajouté à sa gamme emblématique (poire, prune, framboise...) une clémentine bio de Corse, puis un Gin au piment d'Espelette, propose à présent une eau de vie de Cédrat bio de Corse - élevée en cuves inox afin de préserver toute la fraîcheur de ce fruit doté de qualités organoleptiques exceptionnelles -, dont la suavité et la fraîcheur sont confondantes. Le nez est aussi puissant que séducteur, infiniment fruité et zesté, et l'attaque en bouche est forte comme une aube dans la forêt de Vizzavona, avec ce rien de résiné qui envoie du caractère. Il faut avouer que l'association de la Corse et du Pays basque, fut-elle alambiquée, ne produit pas de petit lait... Très belle persistance en arrière-bouche. On en redemande. 722 flacons seulement (50 cl, 44°, 83€). Dépêchez-vous, c'est un bijou. L.M.
Cavistes, ou bien : brana.fr
 Un lépreux : Merci Seigneur El Cid.
Un lépreux : Merci Seigneur El Cid.
Rodrigue : Tu sais donc comment on m’appelle.
Le lépreux : Il n’y à qu’un seul homme en Espagne qui puisse humilier un Roi et faire boire un lépreux à son outre.
Une bonne nouvelle arrive ce matin : les oeuvres complètes de Georges Perros sont réunies en un seul volume (Quarto/Gallimard, 1600 pages). Nous relirons ses Papiers collés avec une ferveur intacte. Perros, c'est un peu comme Desproges : il manque.
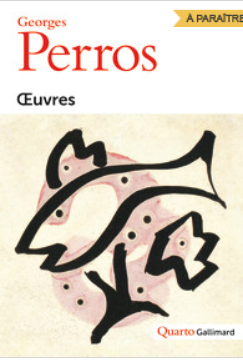
Cliquez ici pour écouter => Gracq/LM/ France Culture
Petite erreur, ci-dessous, sur le site de la station : la conférence a été enregistrée avant-hier matin 7 novembre. LM

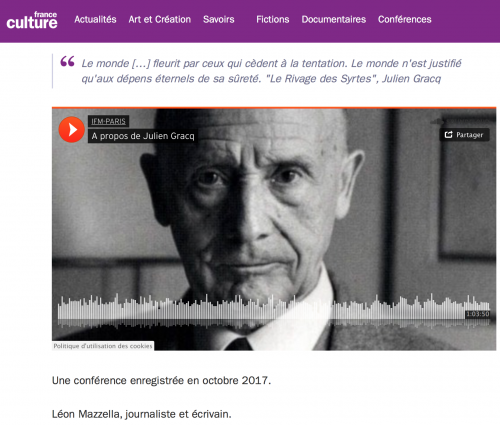
Cliquez ici pour écouter => Conférence sur Julien Gracq

L'Institut Français de la Mode (Paris), où j'interviens parfois (le mois dernier sur Les grands vins français, puis au sujet des Fromages emblématiques de notre hexagone), m'invitait à venir évoquer l'oeuvre de Julien Gracq (et l'homme) ce matin. Un régal, un cadeau pour moi. Un vrai bonheur, surtout grâce à Lucas Delattre, et à un parterre d'étudiants de joli calibre. L.M.

Les Foodies
L’ITHAÏLIE DANS LE MARAIS
Un trio international aux commandes d'un néo-bistrot gastro mais pas trop. Cuisine créative du jeune chef italo-thaï. Superbes produits mais pas trop chers. Inventivité ma non troppo, là encore. Service tendre. Déco chic. Un bon rapport subtilité/prix.
------

 D’emblée, c’est l'élégance de la décoration qui frappe agréablement le regard lancé large dans la salle : la pierre brute et patinée alterne sur les murs avec des vitraux multicolores cadrés façon Mondrian du meilleur effet, le sol est carrelé de noir, de gris et de blanc, un bleu roi – la couleur marquante du lieu – habille les cadres des grandes fenêtres, le plafond, ainsi que les fauteuils qui font face à de longues banquettes vertes, la vaisselle est design et chic (superbes verres à dégustation), comme l’accueil et le service de Keenan, qui vient d’Afrique du Sud. Tout cela est bienveillant, discret et de bon goût. La direction est assurée par Alex, Russe
D’emblée, c’est l'élégance de la décoration qui frappe agréablement le regard lancé large dans la salle : la pierre brute et patinée alterne sur les murs avec des vitraux multicolores cadrés façon Mondrian du meilleur effet, le sol est carrelé de noir, de gris et de blanc, un bleu roi – la couleur marquante du lieu – habille les cadres des grandes fenêtres, le plafond, ainsi que les fauteuils qui font face à de longues banquettes vertes, la vaisselle est design et chic (superbes verres à dégustation), comme l’accueil et le service de Keenan, qui vient d’Afrique du Sud. Tout cela est bienveillant, discret et de bon goût. La direction est assurée par Alex, Russe
 ayant bourlingué aux States. Une formule à 21€ à déjeuner (entrée + plat, ou plat + dessert), attire forcément le chaland. Les prix sont autrement élevés à la carte, mais la cuisine du chef Davide Galloni, mi-italien (Milan), mi-thaïlandais (ci-contre), à la fois originale et subtile, retient le même chaland. C’est que l’homme, encore jeune, a déjà roulé sa toque à travers le monde. D’où son sens pointu de la « fusion », et mesuré de l’expérimentation. Revue de détail :
ayant bourlingué aux States. Une formule à 21€ à déjeuner (entrée + plat, ou plat + dessert), attire forcément le chaland. Les prix sont autrement élevés à la carte, mais la cuisine du chef Davide Galloni, mi-italien (Milan), mi-thaïlandais (ci-contre), à la fois originale et subtile, retient le même chaland. C’est que l’homme, encore jeune, a déjà roulé sa toque à travers le monde. D’où son sens pointu de la « fusion », et mesuré de l’expérimentation. Revue de détail :
Inspirations croisées davantage que fusionnées
L’amuse-bouche (ci-dessus) est composé d'une chips de risotto à l’encre de seiche bien croustillante, surmontée d’un tartare de langoustine puissant et à l’agréable texture collante. Le ton est donné.
Puis, l’air de rien, soit sans nous en rendre compte, nous avons fait un repas italien type : antipasto, pasta, secondo piatto, dolce : la totale.

 L’entrée choisie (23€) ce 24 octobre dernier, fut un tartare de langoustine (plus morcelé, plus délié qu’en amuse-bouche) sur un lit de stracciatella (le cœur de la burrata, soit la crème de sa crème), croûtons de pain à l’encre de seiche (noir sur blanc, comme le carrelage), demi-tomates cerises et une eau de tomate riche en saveur pour arroser l’ensemble. Rien de saillant ne vient jouer les mâles dominants, dans ce plat onctueux, sinon le citronné léger mais salutaire du tartare, qui envoie son « pep’s » au détour d’une bouchée. C’est smooth, fin. Discret, en somme.
L’entrée choisie (23€) ce 24 octobre dernier, fut un tartare de langoustine (plus morcelé, plus délié qu’en amuse-bouche) sur un lit de stracciatella (le cœur de la burrata, soit la crème de sa crème), croûtons de pain à l’encre de seiche (noir sur blanc, comme le carrelage), demi-tomates cerises et une eau de tomate riche en saveur pour arroser l’ensemble. Rien de saillant ne vient jouer les mâles dominants, dans ce plat onctueux, sinon le citronné léger mais salutaire du tartare, qui envoie son « pep’s » au détour d’une bouchée. C’est smooth, fin. Discret, en somme.
Un nid de tagliatelle (maison) avec en son sein un jaune d’œuf cuit à basse température (déjà délayé sur la photo), l’ensemble parsemé de copeaux de truffe blanche d’Alba comme autant de plumes et de duvet éparpillés, constitue un plat simple (il n’y a pas lieu d’évoquer ici le prix du kilo de truffe blanche), brut, à trois ingrédients (plus un indispensable soupçon de beurre fondu avec de l’huile d’olive), des plus réussis car, c’est fort mais pas trop, onctueux encore, délicat. Direct (33€).
L’ancien sur le moderne et dessert reloaded
Les suprême et cuisse désossée (et reconstituée) de pintade (24€) sauce Penang, copieux,
 sur un lit de quinoa rouge, grains de raisin frais, et feuilles d’épinard fumées – c’est d’ailleurs servi sous cloche - translucide et pas en argenterie comme au resto de grand-papa -, afin de laisser la fumée se répandre sous les narines au moment de servir-, sans oublier un jus d’ail noir chinois (fermenté une année durant), qui signe l'ensemble sans pour autant donner dans la peinture sur assiette, devenue si ringarde, forme un recueil d’alliances surprenant. Le fumé ne nuit pas, au contraire. Le jus des raisins est bienvenu, même si le suprême n’est pas sec (mais sa peau manque de croustillant), et la cuisse grise est moelleuse. Le quinoa reste croquant, et l’épinard d’une fraîche fermeté. Un patchwork à reprendre une prochaine fois.
sur un lit de quinoa rouge, grains de raisin frais, et feuilles d’épinard fumées – c’est d’ailleurs servi sous cloche - translucide et pas en argenterie comme au resto de grand-papa -, afin de laisser la fumée se répandre sous les narines au moment de servir-, sans oublier un jus d’ail noir chinois (fermenté une année durant), qui signe l'ensemble sans pour autant donner dans la peinture sur assiette, devenue si ringarde, forme un recueil d’alliances surprenant. Le fumé ne nuit pas, au contraire. Le jus des raisins est bienvenu, même si le suprême n’est pas sec (mais sa peau manque de croustillant), et la cuisse grise est moelleuse. Le quinoa reste croquant, et l’épinard d’une fraîche fermeté. Un patchwork à reprendre une prochaine fois.
 Jardinmisu (8€) est un dessert pour jeune paysagiste créatif ou vieil accro du jardinage tiré au cordeau. Un carré de faux gazon pour tapis sur une assiette ronde (il vaudrait mieux insérer l’herbe synthétique dans un assiette carrée), sur lequel est posé un vrai petit pot de fleur, contient un tiramisu reloaded. Qu’on en juge : ne cherchez pas à retrouver le goût du café, il n’entre pas dans cette composition – aux deux sens du terme. En revanche, nous trouvons du thé vert (matcha) japonais à l’orange, des biscuits broyés Amaretti au bon goût d’amande, et surtout des morceaux de cartucci – fameux biscuits toscans croquants aux amandes -, au lieu des boudoirs, mais en dilution ; pas dressés. Le crémeux est idéal, et un léger goût de pralin surgit en arrière-bouche. Des fleurs roses et délicieuses d’hortensia et des feuilles en pâte d'amande décorent le tout. C’est réussi. En somme, hormis la musique d’ambiance peut-être un peu trop présente, et le manque de ce que j'appelle le « tsssk » (ou pep’s), ici ou là dans l’assiette, l’adresse se pose d’évidence parmi les néo-bistrots fusion qui comptent, dans le Marais.
Jardinmisu (8€) est un dessert pour jeune paysagiste créatif ou vieil accro du jardinage tiré au cordeau. Un carré de faux gazon pour tapis sur une assiette ronde (il vaudrait mieux insérer l’herbe synthétique dans un assiette carrée), sur lequel est posé un vrai petit pot de fleur, contient un tiramisu reloaded. Qu’on en juge : ne cherchez pas à retrouver le goût du café, il n’entre pas dans cette composition – aux deux sens du terme. En revanche, nous trouvons du thé vert (matcha) japonais à l’orange, des biscuits broyés Amaretti au bon goût d’amande, et surtout des morceaux de cartucci – fameux biscuits toscans croquants aux amandes -, au lieu des boudoirs, mais en dilution ; pas dressés. Le crémeux est idéal, et un léger goût de pralin surgit en arrière-bouche. Des fleurs roses et délicieuses d’hortensia et des feuilles en pâte d'amande décorent le tout. C’est réussi. En somme, hormis la musique d’ambiance peut-être un peu trop présente, et le manque de ce que j'appelle le « tsssk » (ou pep’s), ici ou là dans l’assiette, l’adresse se pose d’évidence parmi les néo-bistrots fusion qui comptent, dans le Marais.
Léon Mazzella
Texte et photos.
------
 Carte des vins française. Petit choix – suffisant – de vins au verre (de 6 à 9€). Bon pic saint-loup (Mas de l’Oncle, 2016).
Carte des vins française. Petit choix – suffisant – de vins au verre (de 6 à 9€). Bon pic saint-loup (Mas de l’Oncle, 2016).
Trois brunchs au choix le dimanche.
Les Foodies : 6-8, Square Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris.
Dernière soirée ma masterclass privée crozes-hermitage hier soir 26 octobre, sur invitation de Pierre-Guillaume, chez son amie Jane, en compagnie de cinq autres initiés. Dégustation enjouée, avec un Rouvre de Yann Chave toujours aussi souverain, un Clos des grives de Laurent Combier consensuel, un Domaine des Grands Chemins de Delas surprenant, et un blanc de Laurent Habrard gourmand. Pour escorte, il y avait de bons produits charcutiers et fromagers de l'Aveyron et au-delà.
Léon Mazzella, alias Kally Vasco





 Signature enjouée hier matin aux Cinq Cantons, avec Sébastien et Régis. Pas mal d'amis passaient acheter Sud-Ouest Dimanche - et puis pas que!.. 40 exemplaires signés, casse-croûte au jambon truffé et côtes-du-rhône. Et puis, à ma querencia, la Petite Chambre d'Amour, ces lumières divines au couchant...
Signature enjouée hier matin aux Cinq Cantons, avec Sébastien et Régis. Pas mal d'amis passaient acheter Sud-Ouest Dimanche - et puis pas que!.. 40 exemplaires signés, casse-croûte au jambon truffé et côtes-du-rhône. Et puis, à ma querencia, la Petite Chambre d'Amour, ces lumières divines au couchant...


Enchainement des signatures de notre livre ANGLET (Passiflore) avec les talentueux photographes Sébastien Carnet et Régis Guichenducq. Ici, à la FNAC de Bayonne, cet après-midi. Plus de 100 exemplaires signés depuis hier soir (à la Mairie d'Anglet, surtout, pour la sortie officielle). On remet le couvert demain matin à 9h30 aux Cinq Cantons. Qu'on se le dise au fond des bois...
soir (à la Mairie d'Anglet, surtout, pour la sortie officielle). On remet le couvert demain matin à 9h30 aux Cinq Cantons. Qu'on se le dise au fond des bois...


cliquez => VIDEOANGLET

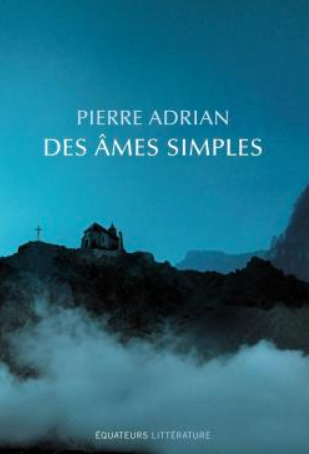 Que ceux qui n'ont pas encore lu Des âmes simples, de Pierre Adrian, publié aux Equateurs par l'ami Olivier Frébourg, saisissent l'occasion de le faire, avec l'attribution - hier -, du (très enviable) Prix Roger-Nimier à ce jeune auteur de 26 ans, pour son splendide récit (davantage que roman), d'une austérité et d'une vérité stupéfiantes. L'univers de frère Pierre, curé dévoué en vallée d'Aspe, conscience de tant d'âmes qu'il aide à être, l'atmosphère de l'abbaye de Sarrance, le quotidien des habitants désoeuvrés, aux "vies minuscules" (écrirait Pierre Michon), vivotant dans des villages oubliés, la beauté de la nature, la force du silence, la foi, l'écoute... L'humanité enfin, qui se dégage de ce texte écrit dans un style épuré et d'une hiératique sobriété, force le respect. Un grand livre, que j'ai déjà pas mal offert, d'ailleurs. Faites passer! L.M.
Que ceux qui n'ont pas encore lu Des âmes simples, de Pierre Adrian, publié aux Equateurs par l'ami Olivier Frébourg, saisissent l'occasion de le faire, avec l'attribution - hier -, du (très enviable) Prix Roger-Nimier à ce jeune auteur de 26 ans, pour son splendide récit (davantage que roman), d'une austérité et d'une vérité stupéfiantes. L'univers de frère Pierre, curé dévoué en vallée d'Aspe, conscience de tant d'âmes qu'il aide à être, l'atmosphère de l'abbaye de Sarrance, le quotidien des habitants désoeuvrés, aux "vies minuscules" (écrirait Pierre Michon), vivotant dans des villages oubliés, la beauté de la nature, la force du silence, la foi, l'écoute... L'humanité enfin, qui se dégage de ce texte écrit dans un style épuré et d'une hiératique sobriété, force le respect. Un grand livre, que j'ai déjà pas mal offert, d'ailleurs. Faites passer! L.M.
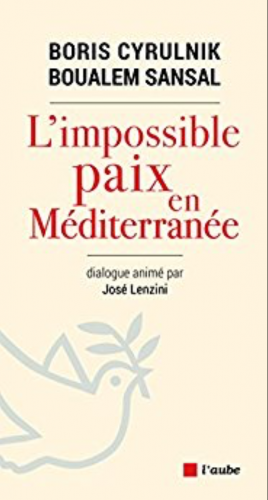 Le nouveau livre de Boualem Sansal est une conversation avec Boris Cyrulnik animée par José Lenzini, lequel pilote la collection Méditerranées aux éditions de l'aube, où ce petit livre est publié. Son titre annonce la couleur sombre de la réflexion : L'impossible paix en Méditerranée. Il est question d'islamisme bien sûr, donc de terrorisme mondial, de volonté de conquête du monde par la violence, de l'inextricable conflit israélo-palestinien, de l'échec des printemps arabes qui ont chassé des dictatures mais ont réislamisé durablement des pays entiers, des collusions entre l'extrême droite et l'extrême gauche européennes et de leur sympathie inavouée pour l'islamisme le plus virulent, d'une certaine déconstruction de l'espace méditerranéen à force d'implosions et d'explosions imminentes, du gouvernement d'une bande de grands coquins qui tiennent la planète (Assad, Poutine, Trump, Jinping...), de la mainmise de l'ONU et de l'UNESCO par des pays arabes assez peu soucieux des droits de l'homme (on ne parle même pas de ceux de la femme), de l'empathie intellectuelle évidente, voire de la correspondance entre Sansal et Camus, de la suite terriblement logique : réparation, repentance, vengeance, comme conséquence à la décolonisation, des similitudes troublantes entre nazisme et islamisme, de la permanence de la haine, de l'impossible paix (Cyrulnik souligne que seulement dix pays ne sont actuellement pas en guerre dans le monde, aujourd'hui), d'un nouvel antisémitisme qui ne dit pas son nom mais qui avance ici et là, des tristes constats selon lesquels, d'une part les hommes se font la guerre pour des croyances, et d'autre part la violence est le ciment des peuples, du vaste danger de la nahda (renaissance) qui appelle tous les musulmans à l'éveil et à la mobilisation, et encore des tentatives d'apaisement modestes - la part du colibri à l'incendie de la forêt amazonienne -, comme le Rassemblement mondial des écrivains pour la paix, dont Boualem Sansal est l'un des principaux initiateurs... J'ai lu ce dialogue hier soir, et j'en suis ressorti galvanisé, mais à l'envers. Il s'agit cependant d'un constat froid, réaliste hélas, pas d'un discours alarmiste ou mortifère, ou forçant le trait noir sur le monde tel qu'il va mal. Très mal... L.M.
Le nouveau livre de Boualem Sansal est une conversation avec Boris Cyrulnik animée par José Lenzini, lequel pilote la collection Méditerranées aux éditions de l'aube, où ce petit livre est publié. Son titre annonce la couleur sombre de la réflexion : L'impossible paix en Méditerranée. Il est question d'islamisme bien sûr, donc de terrorisme mondial, de volonté de conquête du monde par la violence, de l'inextricable conflit israélo-palestinien, de l'échec des printemps arabes qui ont chassé des dictatures mais ont réislamisé durablement des pays entiers, des collusions entre l'extrême droite et l'extrême gauche européennes et de leur sympathie inavouée pour l'islamisme le plus virulent, d'une certaine déconstruction de l'espace méditerranéen à force d'implosions et d'explosions imminentes, du gouvernement d'une bande de grands coquins qui tiennent la planète (Assad, Poutine, Trump, Jinping...), de la mainmise de l'ONU et de l'UNESCO par des pays arabes assez peu soucieux des droits de l'homme (on ne parle même pas de ceux de la femme), de l'empathie intellectuelle évidente, voire de la correspondance entre Sansal et Camus, de la suite terriblement logique : réparation, repentance, vengeance, comme conséquence à la décolonisation, des similitudes troublantes entre nazisme et islamisme, de la permanence de la haine, de l'impossible paix (Cyrulnik souligne que seulement dix pays ne sont actuellement pas en guerre dans le monde, aujourd'hui), d'un nouvel antisémitisme qui ne dit pas son nom mais qui avance ici et là, des tristes constats selon lesquels, d'une part les hommes se font la guerre pour des croyances, et d'autre part la violence est le ciment des peuples, du vaste danger de la nahda (renaissance) qui appelle tous les musulmans à l'éveil et à la mobilisation, et encore des tentatives d'apaisement modestes - la part du colibri à l'incendie de la forêt amazonienne -, comme le Rassemblement mondial des écrivains pour la paix, dont Boualem Sansal est l'un des principaux initiateurs... J'ai lu ce dialogue hier soir, et j'en suis ressorti galvanisé, mais à l'envers. Il s'agit cependant d'un constat froid, réaliste hélas, pas d'un discours alarmiste ou mortifère, ou forçant le trait noir sur le monde tel qu'il va mal. Très mal... L.M.
 Elle récidive, l'experte en couenneries, avec sa plume gourmande, saupoudrée de traits à l'humour vif de son complice Patrick de Mari. A eux deux, ils animent le site gretagarbure Mais là, c'est Blandine Vié, auteur de tant de livres de cuisine ayant trait aux testicules, à la morue, à la cuisine aphrodisiaque... Qui mène la danse des canards gras. En ces temps light et veganisés de buveurs d'eau à la grise mine, soit en ces temps tristes à mourir de soif ou de faim de xingar, l'auteur publie 99+1 (bonnes) raisons de manger du gras (Artémis, 7,90€). Ce petit bouquin est un éloge lipide au beurre et à la graisse, une ode à l'huile et au saindoux , une apologie de la ventrèche et du colonnata, et c'est joliment bardé, ficelé et troussé d'une maquette pimpante. Les amateurs de lard contemporain apprécieront la mini anthologie littéraire qui s'est glissée entre deux tranches pages, et où Voltaire et Zola côtoient Audiard et Manchette. Dans ce florilège qui double sans coup férir les cinquante nuances de gras, la sensualité a la frite, puisqu'il faut frotter son lard
Elle récidive, l'experte en couenneries, avec sa plume gourmande, saupoudrée de traits à l'humour vif de son complice Patrick de Mari. A eux deux, ils animent le site gretagarbure Mais là, c'est Blandine Vié, auteur de tant de livres de cuisine ayant trait aux testicules, à la morue, à la cuisine aphrodisiaque... Qui mène la danse des canards gras. En ces temps light et veganisés de buveurs d'eau à la grise mine, soit en ces temps tristes à mourir de soif ou de faim de xingar, l'auteur publie 99+1 (bonnes) raisons de manger du gras (Artémis, 7,90€). Ce petit bouquin est un éloge lipide au beurre et à la graisse, une ode à l'huile et au saindoux , une apologie de la ventrèche et du colonnata, et c'est joliment bardé, ficelé et troussé d'une maquette pimpante. Les amateurs de lard contemporain apprécieront la mini anthologie littéraire qui s'est glissée entre deux tranches pages, et où Voltaire et Zola côtoient Audiard et Manchette. Dans ce florilège qui double sans coup férir les cinquante nuances de gras, la sensualité a la frite, puisqu'il faut frotter son lard contre le sien, nous rappelle Rabelais. Tous les lipophiles décomplexés liront par conséquent avec délice ce livre léger et sans recettes, cette fête des mots et de la liberté d'aimer dévorer ce que la morale réprouve. Noël aux dindons, Pâques aux jambons, clame un proverbe gretagarburien. On approuve! L'art, le vrai, n'est pas en reste, puisque les peintres préférés de l'auteur sont, évidemment, Eugène Boudin et Francis Bacon... Achetez ce bouquin tordant, et lisez-le à haute voix à votre voisin(e) de matelas, un dimanche de grasse matinée avec des croissants beurre plein le plateau. L.M.
contre le sien, nous rappelle Rabelais. Tous les lipophiles décomplexés liront par conséquent avec délice ce livre léger et sans recettes, cette fête des mots et de la liberté d'aimer dévorer ce que la morale réprouve. Noël aux dindons, Pâques aux jambons, clame un proverbe gretagarburien. On approuve! L'art, le vrai, n'est pas en reste, puisque les peintres préférés de l'auteur sont, évidemment, Eugène Boudin et Francis Bacon... Achetez ce bouquin tordant, et lisez-le à haute voix à votre voisin(e) de matelas, un dimanche de grasse matinée avec des croissants beurre plein le plateau. L.M.

Chaude ambiance à fond crozes-hermitage, hier soir chez Thibaut (dans le XVIII ème, à Paris) et ses dix amis attentifs, curieux, dont trois américains amateurs, et certains pourvus d'un nez exceptionnel. Le blanc de Laurent Habrard a séduit, le Rouvre de Yann Chave a fléchi, le Clos des grives de Laurent Combier a conquis, le domaine des Grands Chemins de Delas a bluffé. Comme quoi, les masterclass privées se suivent et ne se ressemblent pas. En dépit d'une température estivale, le vin, être bien vivant, demeure souverain, surtout avec des syrah imprévisibles comme autant de Carmen... ¡Olé! Léon Mazzella



Le livre paraît en librairie vendredi prochain 20 octobre.



 Heureusement, le plaisir ne s’évalue pas à l’aune d'un nombre d’euros. Témoin, cette dégustation des cuvées du domaine Ventenac, dirigé par Stéphanie Maurel et son mari Olivier Ramé. Nous sommes en AOP Cabardès (Aude, Languedoc), et sur 160 ha conduits en agriculture raisonnée (Terra Vitis). Les cépages s’y épanouissent, et les cuvées leur ressemblent, qui sont d’apparence modestes, mais d’une belle fraîcheur, et d’une teneur étonnante. La cuvée Stéphanie (2016) est un merlot friand aux notes de fruits rouges croquants, vif et long qui coûte 6€ à peine. Je souligne. Idem pour la cuvée Pierre (2016), - en référence au grand-père d’Olivier, le mari de Stéphanie -, issue de cabernet-franc, d’une droiture et d’une amplitude aussi croquante que délicatement épicée (6€). La Grande Réserve de Georges (2014), en référence au père d’Alain Maurel, fondateur du domaine (50% de cabernet sauvignon, 40% de syrah et 10% de merlot), nous envoie certes du tabac blond, du moka, de la puissance « sous la pédale, pied droit » mais bon… C’est déjà chouia too much, si je puis l’écrire ainsi (9,5€), car nous sentons une volonté de concentration inhabituelle, à tout le moins peu naturelle. Enfin, le Mas Ventenac (22€) ne nous a pas séduit, à cause sans doute de son côté parkerisé qui nous semble (et nous souhaitons nous tromper) un rien forcé.
Heureusement, le plaisir ne s’évalue pas à l’aune d'un nombre d’euros. Témoin, cette dégustation des cuvées du domaine Ventenac, dirigé par Stéphanie Maurel et son mari Olivier Ramé. Nous sommes en AOP Cabardès (Aude, Languedoc), et sur 160 ha conduits en agriculture raisonnée (Terra Vitis). Les cépages s’y épanouissent, et les cuvées leur ressemblent, qui sont d’apparence modestes, mais d’une belle fraîcheur, et d’une teneur étonnante. La cuvée Stéphanie (2016) est un merlot friand aux notes de fruits rouges croquants, vif et long qui coûte 6€ à peine. Je souligne. Idem pour la cuvée Pierre (2016), - en référence au grand-père d’Olivier, le mari de Stéphanie -, issue de cabernet-franc, d’une droiture et d’une amplitude aussi croquante que délicatement épicée (6€). La Grande Réserve de Georges (2014), en référence au père d’Alain Maurel, fondateur du domaine (50% de cabernet sauvignon, 40% de syrah et 10% de merlot), nous envoie certes du tabac blond, du moka, de la puissance « sous la pédale, pied droit » mais bon… C’est déjà chouia too much, si je puis l’écrire ainsi (9,5€), car nous sentons une volonté de concentration inhabituelle, à tout le moins peu naturelle. Enfin, le Mas Ventenac (22€) ne nous a pas séduit, à cause sans doute de son côté parkerisé qui nous semble (et nous souhaitons nous tromper) un rien forcé.  Certes, c’est du parcellaire, du cousu main, du rendement minimal maîtrisé… Et de la macération minutée, du remontage et du pigeage scrupuleux, puis un élevage sous bois calculé en proportions (neuf/pas neuf). Au fond, c’est assez lourdingue, mais ça se veut corpulent et dense. Or, ça en fait des tonnes. Aussi, allez-y plutôt les yeux fermés sur les premières cuvées d’une « complexe simplicité » oxymorique qui me fait sourire. Elles valent 6€ et procurent un petit bonheur simple, ces affranchies du body building. L.M.
Certes, c’est du parcellaire, du cousu main, du rendement minimal maîtrisé… Et de la macération minutée, du remontage et du pigeage scrupuleux, puis un élevage sous bois calculé en proportions (neuf/pas neuf). Au fond, c’est assez lourdingue, mais ça se veut corpulent et dense. Or, ça en fait des tonnes. Aussi, allez-y plutôt les yeux fermés sur les premières cuvées d’une « complexe simplicité » oxymorique qui me fait sourire. Elles valent 6€ et procurent un petit bonheur simple, ces affranchies du body building. L.M.
 Nous connaissions le château La Levrette, superbe bordeaux (rouge et blanc) élaboré dans le triangle d’or du Blayais par Laetitia Mauriac, et que j’évoque dans mon « Dictionnaire chic du vin » (lire plus bas les pages 213-214). Voici le chardonnay En Levrette, cuvée du domaine des Marnes Blanches, dans le Jura. Blanc ouillé, bio, élaboré par Géraud et Pauline Fromont sur un terroir à calcaires gryphées, son étiquette est sans équivoque.
Nous connaissions le château La Levrette, superbe bordeaux (rouge et blanc) élaboré dans le triangle d’or du Blayais par Laetitia Mauriac, et que j’évoque dans mon « Dictionnaire chic du vin » (lire plus bas les pages 213-214). Voici le chardonnay En Levrette, cuvée du domaine des Marnes Blanches, dans le Jura. Blanc ouillé, bio, élaboré par Géraud et Pauline Fromont sur un terroir à calcaires gryphées, son étiquette est sans équivoque.
 Dans les deux cas, l’allusion originelle est claire, mais elle diverge (et dix verges, c’est beaucoup, me souffle Pierre Desproges) : d’un côté, la référence à une race de lévrier italien ainsi qu’à la femelle du lévrier commun figure, silhouettée, la queue glissée entre les pattes de derrière, sur l’étiquette du vin de Laetitia Mauriac. Celle aux lièvres qui bouquinent (se reproduisent) à la saison des amours, sur la parcelle où le chardonnay pousse, est signalée – non sans malice -, sur la contre-étiquette du vin des époux Fromont. Cependant, la seconde référence est un poil abusive, car, si le lièvre mâle se dit aussi bouquin – d’où le mot bouquinage, éloigné de toute lecture, fut-elle licencieuse (on le nomme aussi capucin, oreillard, rouquin…), et eu égard à l'activité à laquelle se livre alors le... léporidé, la femelle du lièvre se nomme hase, comme celle du lapin, lapine… Mais pas levrette. Qu’importe, après tout ! Le chardonnay enjoué du Jura y va d’ailleurs franco, et anticipe nos traits d’esprit. La rédaction a tout prévu (agrandissez la photo) : ce vin, subtil étreinte d'un terroir (...) sera le partenaire idéal de vos acrobaties gourmandes (...) En Levrette vous mettra à genoux… J’ai découvert par hasard son existence sur Internet, ce matin. Je ne l’ai donc pas encore eu en mains, ni goûté ci-devant (par derrière). Ce qui ne saurait tarder, au moins pour m’initier à une gymnastique – strictement œnologique -, consistant à associer lever de coude et génuflexion : Et hop, et hop… L.M.
Dans les deux cas, l’allusion originelle est claire, mais elle diverge (et dix verges, c’est beaucoup, me souffle Pierre Desproges) : d’un côté, la référence à une race de lévrier italien ainsi qu’à la femelle du lévrier commun figure, silhouettée, la queue glissée entre les pattes de derrière, sur l’étiquette du vin de Laetitia Mauriac. Celle aux lièvres qui bouquinent (se reproduisent) à la saison des amours, sur la parcelle où le chardonnay pousse, est signalée – non sans malice -, sur la contre-étiquette du vin des époux Fromont. Cependant, la seconde référence est un poil abusive, car, si le lièvre mâle se dit aussi bouquin – d’où le mot bouquinage, éloigné de toute lecture, fut-elle licencieuse (on le nomme aussi capucin, oreillard, rouquin…), et eu égard à l'activité à laquelle se livre alors le... léporidé, la femelle du lièvre se nomme hase, comme celle du lapin, lapine… Mais pas levrette. Qu’importe, après tout ! Le chardonnay enjoué du Jura y va d’ailleurs franco, et anticipe nos traits d’esprit. La rédaction a tout prévu (agrandissez la photo) : ce vin, subtil étreinte d'un terroir (...) sera le partenaire idéal de vos acrobaties gourmandes (...) En Levrette vous mettra à genoux… J’ai découvert par hasard son existence sur Internet, ce matin. Je ne l’ai donc pas encore eu en mains, ni goûté ci-devant (par derrière). Ce qui ne saurait tarder, au moins pour m’initier à une gymnastique – strictement œnologique -, consistant à associer lever de coude et génuflexion : Et hop, et hop… L.M.
---------


Notons qu’il existe par ailleurs une bière artisanale nommée Levrette (goûtée en aout dernier dans les Cévennes), qui elle aussi, ne se prive pas d’allusions grivoises sur son habillage, puisque sur le col de la bouteille, nous pouvons lire (voir ci-contre) : Une petite Levrette entre amis, puis, plus bas, Bière blonde de position... A vos marques !
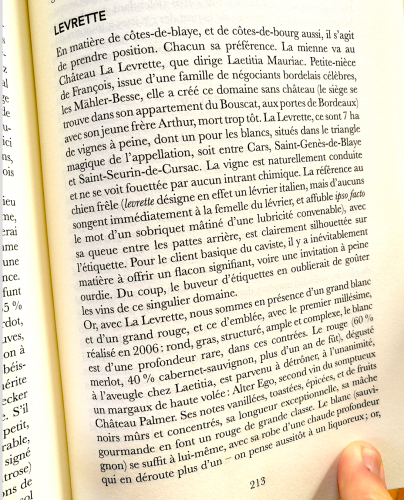
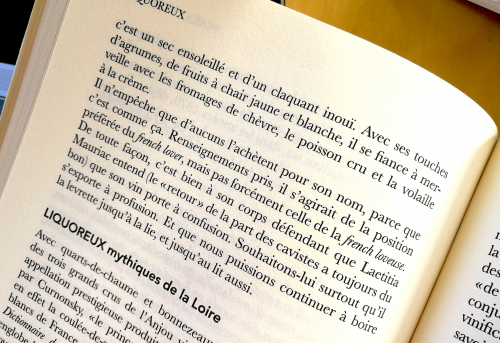
Seconde prestation "apéro (qui tire en longueur avec bonheur) crozes-hermitage", Un sommelier dans mon canap' : unsommelierdansmoncanap.com chez Agnès, cette fois (dans le Marais, à Paris), avec ses cinq ami(e)s. J'ai eu affaire à des connaisseurs, pour cette soirée "ma masterclass privée", à des fans de Laurent Combier et de son consensuel et infiniment respectable Clos des Grives, mais époustouflés aussi par Le Rouvre de Yann Chave. Faut dire, aussi, hein... Sans parler du stupéfiant domaine des Grands chemins, de Delas, (et oui!), un nom si "gracquien", et du blanc sensuel (bio) issu de marsanne de Laurent Habrard, "vigneron heureux"... Il fut question d'onctuosité, de robe d'encre, de fruits noirs, d'épices douces, et de salinité aussi, de persistance, de tanins soyeux, de délicatesse, de paradoxe enfin : les crozes peuvent être si "oxymoriques" - soit, à la fois puissants et délicats, raffinés et gentlemen-farmers... On adore. L.M.


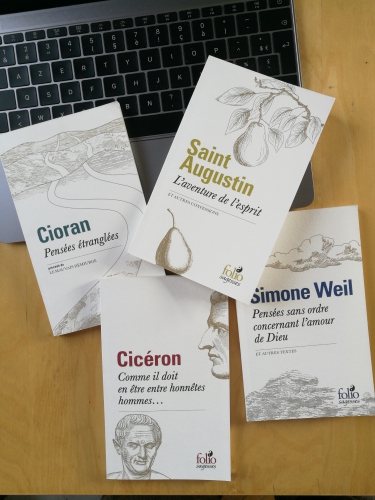 Nous l’avons déjà écrit ici, mais nous remettons le couvert avec enthousiasme : la collection folio sagesses (3,50€ chaque volume) est une aubaine. Une centaine de pages
Nous l’avons déjà écrit ici, mais nous remettons le couvert avec enthousiasme : la collection folio sagesses (3,50€ chaque volume) est une aubaine. Une centaine de pages de Cicéron, de Cioran, de Saint-Augustin, de Simone Weil (pour citer les dernières parutions), ou bien d’Epictète, Voltaire, Marc-Aurèle,
de Cicéron, de Cioran, de Saint-Augustin, de Simone Weil (pour citer les dernières parutions), ou bien d’Epictète, Voltaire, Marc-Aurèle,
Montaigne, La Rochefoucauld, Gandhi, La Bruyère, Sénèque, Alain, Machiavel, Thoreau… Et à ce prix-là, ce sont des vitamines de bonheur, un feu d'artifice philosophique. Faites passer ! Mieux : « abandonnez » ces ouvrages, une fois lus, sur un banc public, une banquette de train. Avec un peu de chance, ils continueront de vivre en propageant leur sage parole. L.M.
-------
Collection folio sagesses, 3,50€
L’escorteur d’escadre « Jauréguiberry » (du nom – d’ailleurs - d’un quai de bord de Nive à Bayonne, bordé de restaurants accortes). Mr Lucifer dans le rôle du chat (noir et docile). Dufilho, Rich, Perrin, Rochefort donc, ce soir. L’apparition divine et diaphane d’Aurore Clément. Revu pour la 4ème fois, Le Crabe-Tambour, en hommage double ou triple. En hommage. A Schoendoerffer d’abord. Aux suivants après. A commencer par l’immense JR. Un très grand film, un excellent livre. Un état d’esprit inaltérable. LM



Bon, je m'y prends un peu à l'avance : A l'attention de tous ceux qui seront dans les parages - Bienvenue! Afin de partager un verre, deux mots, trois rires, et repartir avec un livre signé à trois mains.
J'ajoute que, outre cette présentation le jour même de la sortie du bouquin, il y a trois autres signatures au cours du week-end :
- le samedi 21 octobre de 11h à 12h30 à la librairie Darrigade à Biarritz ;
- le samedi 21 octobre à 15h à la FNAC d’Anglet ;
- le dimanche 22 octobre à 9h30 à la Maison de la Presse des 5 cantons d’Anglet.

L'opération de découverte des vins de l'appellation Crozes-Hermitage reprend du service, et nous avec, qui sommes ses "sommeliers" à domicile dévoués.
https://www.unsommelierdansmoncanap.com/#accueil
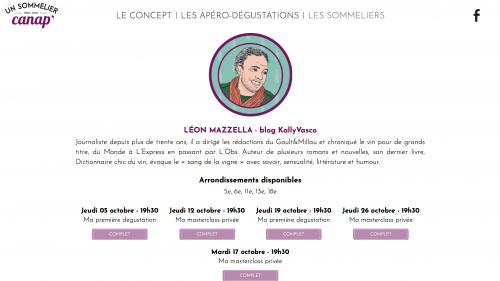
 C'est aux côtés de prestigieuses signatures (Sophie Surullo, Christophe Schaeffer, Benoît Jeantet, Nemer Habib, Vincent Péré-Lahalle, François Trillo, entre autres) que je me (re)trouve à chaque numéro, avec ma double page de J'aime. FLAIR Play magazine, c'est du rugby et beaucoup plus que ça. Ne manquez pas, dans cette cinquième livraison, les reportages, portraits et entretiens sur et avec François Berléand, Imanol Harinordoquy, Philippe Lafon, Mourad Boudjellal, Pierre Berbizier, Christine Hanizet, Henri Estirac... Un numéro copieux où il est pas mal question de rugby au féminin. 140 pages de bonheur viral : Faites passer!
C'est aux côtés de prestigieuses signatures (Sophie Surullo, Christophe Schaeffer, Benoît Jeantet, Nemer Habib, Vincent Péré-Lahalle, François Trillo, entre autres) que je me (re)trouve à chaque numéro, avec ma double page de J'aime. FLAIR Play magazine, c'est du rugby et beaucoup plus que ça. Ne manquez pas, dans cette cinquième livraison, les reportages, portraits et entretiens sur et avec François Berléand, Imanol Harinordoquy, Philippe Lafon, Mourad Boudjellal, Pierre Berbizier, Christine Hanizet, Henri Estirac... Un numéro copieux où il est pas mal question de rugby au féminin. 140 pages de bonheur viral : Faites passer!
Ci-dessous, ma double page qui paraît, où il est question de l'épaisseur d'une toile de Nicolas de Staël, du croquant idéal du chipiron, du frôlement de la hanche (extrait joint), des larmes en littérature, de l'impossible consolation, et de la règle de la patate chaude... L.M.

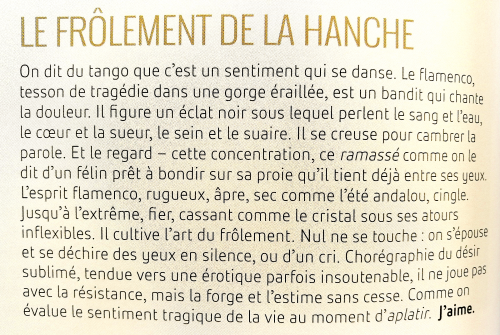
 Victorino Martin Andrès s'est éteint. Ses "victorinos" continueront de sortir, vêtus de leur robe cendrée dans les arènes de première catégorie. L'éleveur de légende surnommé à ses débuts el paleto (le plouc) par l'aristocratie de la corne, aura prouvé à ce mundillo qu'il était le meilleur, et que son bon sens campesino avait du bon ¡Suerte!
Victorino Martin Andrès s'est éteint. Ses "victorinos" continueront de sortir, vêtus de leur robe cendrée dans les arènes de première catégorie. L'éleveur de légende surnommé à ses débuts el paleto (le plouc) par l'aristocratie de la corne, aura prouvé à ce mundillo qu'il était le meilleur, et que son bon sens campesino avait du bon ¡Suerte!
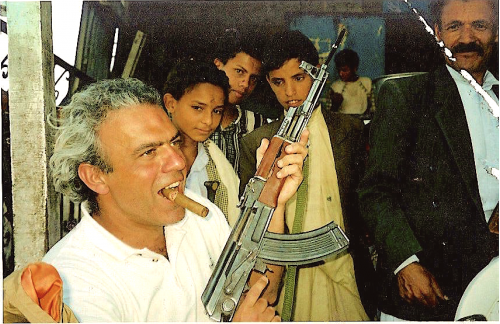 Au fin fond du Yémen, il y a quelques années. Je viens de m'emparer de la Kalachnikov de l'homme que l'on voit à droite, subjugué que j'ai osé le faire, dans ce rade où nous prenons un café à la cardamome, avec mes compagnons de voyage. Je m'apprêtais alors à allumer un cigare (Specially Selected de Ramon Allones, pour les chieurs tentés de me poser la question), lorsque me vint cette idée saugrenue. Peu après, je lui ai rendu son arme (chaque homme, là-bas, même jeune, en possède une semblable, en plus de sa jambiya, ce poignard recourbé porté au milieu de la ceinture, que l'on aperçoit à peine, ici), et lui ai offert un cigare. Nous avons fumé ensemble, plus ou moins peinards. Ca l'a détendu. Puis, nous avons mâché le qât, car il m'en offrit un sachet...
Au fin fond du Yémen, il y a quelques années. Je viens de m'emparer de la Kalachnikov de l'homme que l'on voit à droite, subjugué que j'ai osé le faire, dans ce rade où nous prenons un café à la cardamome, avec mes compagnons de voyage. Je m'apprêtais alors à allumer un cigare (Specially Selected de Ramon Allones, pour les chieurs tentés de me poser la question), lorsque me vint cette idée saugrenue. Peu après, je lui ai rendu son arme (chaque homme, là-bas, même jeune, en possède une semblable, en plus de sa jambiya, ce poignard recourbé porté au milieu de la ceinture, que l'on aperçoit à peine, ici), et lui ai offert un cigare. Nous avons fumé ensemble, plus ou moins peinards. Ca l'a détendu. Puis, nous avons mâché le qât, car il m'en offrit un sachet...
Détail important (que j'avais d'ailleurs oublié) : j'ai fiché mon inséparable stylo à plume Mont-Blanc au bout du canon. Comme quoi, hein...
 C'est un restaurant japonais comme il en existe des brochettes dans la rue Sainte-Anne, voisine. Nous sommes du côté de l'Opéra, à Paris, rue de Ventadour précisément. La table se nomme Sara, même s'il est écrit Soba à l'entrée. Et pour cause : On y entre pour manger des soba, soit des nouilles à base de farine de sarrasin (faites sur place, paraît-il - au sous-sol, sans doute) et servies chaudes ou froides avec, au choix : tofu, poulet, boeuf... Ca ne casse pas non plus trois pattes à un canard laqué. Mais ce n'est pas ça, le problème. Le problème vient du patron et de sa haine affichée (il a très visiblement un réel souci, le gonze), qui officie en salle, et traite le client - non Japonais - comme un caporal chef ses trouffions dans Full Metal Jacket... Malaise, malaise! A moins d'être maso (le Parisien aime bien se faire maltraiter par la gouaille des vieux serveurs, dans les brasseries, mais là, il s'agit d'un autre niveau d'agressivité), ça ne le fait pas et ça ne le fera jamais : Le client est houspillé, engueulé lorsqu'il demande quelque chose, le boss a une obsession, qui est de retirer, de confisquer même tout objet à peine utilisé, carafe d'eau comprise, il aboie au lieu de répondre, affecte une morgue impatiente et méprisante à la prise de la commande qui frise l'inconvenance. Il ne dit ni bonjour ni au revoir, a des gestes brusques, des attitudes plus que déplaisantes, violentes, oui : je pèse le mot. Du jamais vu. Et lorsque des clients japonais entrent et s'assoient, ils ont aussitôt droit à la danse du ventre, aux rires, à l'allant incroyable du même patron. Dr Jekyll et Mr Hyde. On croit rêver devant tant d'aplomb, d'ostentation, d'agression caricaturale. Ce n'est de surcroît pas donné (11€-22€ le soba). C'est la double peine, lorsqu'on vient de subir un tel traitement. Ciao, petit caporal!. L.M.
C'est un restaurant japonais comme il en existe des brochettes dans la rue Sainte-Anne, voisine. Nous sommes du côté de l'Opéra, à Paris, rue de Ventadour précisément. La table se nomme Sara, même s'il est écrit Soba à l'entrée. Et pour cause : On y entre pour manger des soba, soit des nouilles à base de farine de sarrasin (faites sur place, paraît-il - au sous-sol, sans doute) et servies chaudes ou froides avec, au choix : tofu, poulet, boeuf... Ca ne casse pas non plus trois pattes à un canard laqué. Mais ce n'est pas ça, le problème. Le problème vient du patron et de sa haine affichée (il a très visiblement un réel souci, le gonze), qui officie en salle, et traite le client - non Japonais - comme un caporal chef ses trouffions dans Full Metal Jacket... Malaise, malaise! A moins d'être maso (le Parisien aime bien se faire maltraiter par la gouaille des vieux serveurs, dans les brasseries, mais là, il s'agit d'un autre niveau d'agressivité), ça ne le fait pas et ça ne le fera jamais : Le client est houspillé, engueulé lorsqu'il demande quelque chose, le boss a une obsession, qui est de retirer, de confisquer même tout objet à peine utilisé, carafe d'eau comprise, il aboie au lieu de répondre, affecte une morgue impatiente et méprisante à la prise de la commande qui frise l'inconvenance. Il ne dit ni bonjour ni au revoir, a des gestes brusques, des attitudes plus que déplaisantes, violentes, oui : je pèse le mot. Du jamais vu. Et lorsque des clients japonais entrent et s'assoient, ils ont aussitôt droit à la danse du ventre, aux rires, à l'allant incroyable du même patron. Dr Jekyll et Mr Hyde. On croit rêver devant tant d'aplomb, d'ostentation, d'agression caricaturale. Ce n'est de surcroît pas donné (11€-22€ le soba). C'est la double peine, lorsqu'on vient de subir un tel traitement. Ciao, petit caporal!. L.M.
---
PS : Sara n'a rien à voir avec Yen, autre Japonais " à soba" créé par le même investisseur japonais (M. Kitada), sis rue St-Benoît dans le 6ème arr., mais autrement plus accueillant, raffiné, subtil, et carrément classe.
 L’endroit est avenant, comme l’accueil et le service. Nous nous trouvons au début de la rue Ramey, dans le 18ème arrondissement de Paris, soit en haut, dans une zone moins vivante qu'en bas, passée la rue Custine. C'est le Village Ramey.
L’endroit est avenant, comme l’accueil et le service. Nous nous trouvons au début de la rue Ramey, dans le 18ème arrondissement de Paris, soit en haut, dans une zone moins vivante qu'en bas, passée la rue Custine. C'est le Village Ramey.
L’espace de cette cave à manger est confortable avec ses salles, son bar, la mezzanine, la petite terrasse… La déco est vintage sympa, brune, roots et néanmoins claire. Joli carrelage d'époque, patine bienvenue sur le gros radiateur, bois, cuir : on se sent immédiatement bien.
La cuisine s’essaie à des tendances lourdes ayant cours encore actuellement (on ne parle plus de mode évanescente) dans le paysage des fourneaux parisiens, tenus par de plus ou moins jeunes chefs avisés et inspirés par les vents d’extrême-orient notamment (Adeline Grattard/Yam’Tcha, Iñaki Aizpitarte/Chateaubriand, William Ledeuil/The Kitchen Galerie, et KGB, pour n’en citer que trois parmi trente).
Mais l’imitation, à La Traversée, balbutie, elle est encore superficielle, les saveurs sont mal accordées, hésitantes, sans franchise ou bien trop concentrées, soit too much, et certains plats sont franchement huileux. L’harmonie n’est pas encore au rendez-vous - normal, ils ont ouvert à la mi septembre ! Leur intention est grande et c’est déjà louable. Il faudra « attendre de voir » comment cela évolue ces prochains mois.
mal accordées, hésitantes, sans franchise ou bien trop concentrées, soit too much, et certains plats sont franchement huileux. L’harmonie n’est pas encore au rendez-vous - normal, ils ont ouvert à la mi septembre ! Leur intention est grande et c’est déjà louable. Il faudra « attendre de voir » comment cela évolue ces prochains mois.
La carte des vins (bios, voire nature) est en revanche judicieuse, et des noms de vignerons « attendus » sont au rendez-vous. C’est bien, et le rapport qualité/prix du verre est bienvenu (4 à 6€), comme celui de la carte (trop courte cependant, trop tapas façon « raciones » à San Seba pour qui souhaite manger copieusement - à l’exception du très savoureux boeuf de Salers grillé).
Il faut surtout y aller pour boire des canons d'Olivier Pithon (Mon P'tit Pithon, cotes catalanes), du château Guibeau (montagne saint-émilion), le viognier de Freesia (mas d'Espanet, Cévennes), ou encore le gamay friand de Nicolas Dubost (Just drink it). Ou bien des bières tendance issues des nombreuses micro-brasseries qui fleurissent un peu partout, y compris en ville, et même d'un Gin fabriqué à un jet de cailloux, rue Labat : Lord Barbès. Tous ces verres seront dûment accompagnés d'une planche de fromages du Jura ou de charcuterie (14€ chacune), d'oeufs : pickled eggs bio (7€), curcuma et poireaux frits, de haricots verts en tempura (à condition qu'ils soient épongés), de croquettes de truite fumée et pomme de terre, sur lit de haricots de Paimpol, ou encore de cette savoureuse pièce de boeuf de Salers (16€) correctement grillée, donc, et surmontée de lamelles d'artichaut et d'allumettes de poireaux frits (bis repetita). L.M.
---
La Traversée, 2 rue Ramey, Paris 18, est pilotée par un petit groupe d'amis : Charles, Vincent (en cuisine), Witold, et Camille. Formules à déjeuner : 17€ et 20€.
https://www.latraverseeparis.com
Didier Sorbé, photographe pyrénéiste de grand talent, a été retrouvé sans vie hier matin, à genoux, appareil photo en mains, en Vallée d'Ossau, près du lac de Moundelhs. Pensées pour Hélène, sa femme. L.M.