bière
http://www.huffingtonpost.fr/leon-mazzella/etudes-sur-la-biere_b_5620102.html?utm_hp_ref=france
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
http://www.huffingtonpost.fr/leon-mazzella/etudes-sur-la-biere_b_5620102.html?utm_hp_ref=france
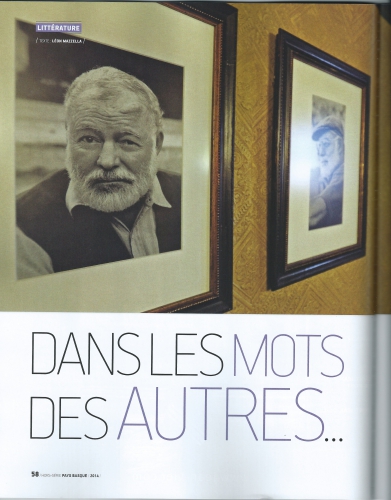 Papier donné au spécial Pays basque de Pyrénées magazine (en kiosque tout l'été).
Papier donné au spécial Pays basque de Pyrénées magazine (en kiosque tout l'été).
Terre d’écriture et d’écrivains, le Pays basque a toujours généré de la littérature et n’a jamais laissé indifférents les hommes et les femmes de plume, écrivains voyageurs du XIXème siècle ou pas, au point d’en avoir marqué certains à vie. Et de continuer de marquer leurs lecteurs. Par Léon Mazzella.
-------
Victor Hugo, dans son fameux « Voyage aux Pyrénées », donne le ton en affirmant, avec un enthousiasme et une assurance renversants, que « la langue basque est une patrie, j’ai presque dit une religion ». Cette déclaration servira d’étendard à une littérature de langue basque dont nous parlerons dans une prochaine édition, et qui va de Bernat Etxepare à Bernardo Atxaga et ses émules. La langue, donc. La matrice. Et l’enfance, aussi. Déterminante, l’enfance.
Voyez Barthes, Roland Barthes. Son choc bayonnais lui durera jusqu’à sa mort accidentelle : « Car lire un pays, c’est d’abord le percevoir selon le corps et la mémoire du corps. (…) Au fond, il n’est Pays que de l’enfance », écrit-il à propos de Bayonne. « Rien, par exemple, n’a plus d’importance dans mon souvenir que les odeurs de ce quartier ancien, entre Nive et Adour, qu’on appelle le petit-Bayonne »… Barthes, le Parisien et l’enfant d’Urt (où il repose), fut sensible à la lumière, « noble et subtile à la fois ; jamais grise, jamais basse (même lorsque le soleil ne luit pas), c’est une lumière-espace », écrit-il encore dans « Incidents », « définie moins par les couleurs dont elle affecte les choses (comme dans l’autre Midi) que par la qualité éminemment habitable qu’elle donne à la terre. »
Cette déclaration d’amour, Hugo la partage, et il donna des pages inoubliables sur Biarritz : « Je ne sache pas d’endroit plus charmant et plus magnifique que Biarritz », sur Saint-Sebastien et sur Pasajes : « Cet endroit magnifique et charmant comme tout ce qui a le double caractère de la joie et de la grandeur, ce leu inédit qui est un des plus beaux que j’aie jamais vus, (…) ce petit éden rayonnant où j’arrivais par hasard, et sans savoir où j’étais, s’appelle en espagnol Pasages et en français le Passage ». À propos de Bayonne : « …Resté dans ma mémoire comme un lieu vermeil et souriant. C’est là qu’est le plus ancien souvenir de mon cœur. (…) C’est là que j’ai vu poindre, dans le coin le plus obscur de mon âme, cette première lueur inexprimable, aube divine de l’âme. »
"… et quand vous entrez dans Bayonne, l'enchantement commence."
Si Hugo a visiblement eu une histoire forte avec Bayonne, nous ne sommes pas en reste avec Pierre Loti. L’auteur de « Ramuntcho » et du « Pays basque », surtout, véritable ode à un pays adoré, regrette qu’une telle terre, si belle, soit déjà vendue à un tourisme qui néglige sa beauté, sa pureté. Loti, qui loua en 1894, puis acheta une maison au bord de la Bidassoa à Hendaye, baptisée « Bakhar Etxea » (la Maison du solitaire), et qui y mourut en 1923, sera un amoureux absolu de cette terre de recueillement, qui lui fit écrire ces textes parmi les plus profonds et les plus sentis.
Flaubert, dans son « Voyage aux Pyrénées et en Corse », est subjugué en arrivant : « … L’ennui des plaines blanches du midi vous quitte, il vous semble que le vent de la montagne va souffler jusqu’à vous, et quand vous entrez dans Bayonne, l’enchantement commence. (…) Jusqu’à présent j’adore Bayonne et voudrais y vivre ; à l’heure qu’il est je suis assis sur ma malle, à écrire (…) L’Adour est un beau fleuve qu’il faut voir comme je l’ai vu, quand le soleil couchant assombrit ses flots azurés, que son courant, calme le soir, glisse le long des rives couvertes d’herbes. » On voudrait tout citer, tant le Flaubert voyageur, à la plume étincelante, fait briller le Pays basque. Une dernière phrase : « J’étais triste quand j’ai quitté Bayonne et je l’étais encore en quittant Pau ; je pensais à l’Espagne, à ce seul après-midi où j’y fus, ce qui fait que Pau m’a semblé ennuyeux. »
Pour la distinction Basques – Béarnais, il faut lire la monumentale « Histoire de France » de Michelet (tome3) : « Le joli petit homme sémillant de la plaine, qui a la langue si prompte, la main aussi (le Basque), et le fils de la montagne ; qui la mesure rapidement de ses grandes jambes, agriculteur habile et fier de sa maison, dont il porte le nom (le Béarnais)… ».
Stendhal aussi a aimé Bayonne, ville « resserrée », note-t-il dans son fameux « Journal de voyage de Bordeaux à Valence en 1838 ». Il se promène : Saint-Jean-de-Luz, Béhobie, Fontarrabie… Remarque la beauté sauvage des femmes : « Toutes les femmes sont pieds nus, et, chose qui est étrange, par le vent affreux et la pluie qui verse à tout moment, elles sont nu-tête. Leurs cheveux forment une tresse qui descend presque jusqu’aux jarrets. »
"… elle frémit encore, mais de plaisir."
Hippolite Taine, dans son « Voyage aux eaux des Pyrénées » illustré par Gustave Doré (1855), souligne la gaîté et le caractère espagnol de Bayonne, mais semble chagrin à la vue de la mer qui « ronge la côte » à Biarritz, et où « un mauvais gazon troué et malade » froisse son plaisir. À Saint-Jean-de-Luz, l’océan devient « un Dieu lugubre et hostile, toujours grondant, sinistre… ». Plus loin (il semble de meilleure humeur), « la mer sourit dans sa robe bleue, frangée d’argent, plissée par le dernier souffle de la brise ; elle frémit encore, mais de plaisir… »
Laissons-le et prenons le « Voyage en Espagne » de Théophile Gautier (1840), qui note : « Des torrents capricieux comme des femmes vont et viennent… », et qui est surpris, du côté d’Urrugne, par la « physionomie sanguinaire et barbare (des maisons) due à la bizarre coutume de peindre en rouge antique ou sang de bœuf les volets, les portes et les poutres… ».
Viollet-le-Duc, à qui l’on doit le château d’Abbadia (1870), parcourt l’arrière-pays, et nous lisons dans ses « Lettres » de 1833 (à son père notamment), rehaussées d’aquarelles célèbres, qu’il randonne souvent du côté de Bidarray, du Pas de Roland, de Baïgorry aussi. Il admire la Nive, porte un regard de peintre sur les paysages, mais sait aussi relever, du côté d’Itxassou, la force de la gastronomie locale : « Nous arrivâmes à une auberge ; la femme de l’aubergiste seule comprenait le français, et nous lui demandâmes du vin et de la soupe ; toute la cuisine basque des paysans (qui se borne à très peu de choses) est poivrée de manière à emporter la bouche, leur vin même semble avoir un goût de poivre ou de piment. »
Prosper Mérimée visite une première fois le Pays basque en 1830. L’auteur de « Carmen » tombera amoureux de Sainte-Engrâce notamment, sera très ami avec Eugénie de Montijo et écrira des lettres magnifiques qui flattent l’âme du pays : « Nous autres gens du Pays basque, nous avons un accent qui nous fait reconnaître facilement des Espagnols ; en revanche, il n’y en a pas un qui puisse seulement apprendre à dire baï, jaona. Carmen donc n’eut pas de peine à deviner que je venais des provinces…. », écrit-il en 1861. Le regard du voyageur du XIX ème siècle est donc changeant. Paul-Jean Toulet est autrement délicat dans ses « Contrerimes », et son admiration poétique du pays et des gens qui l’habitent est un chef-d’oeuvre de tact. « Bayonne ! Un pas sous les Arceaux, /Que faut-il davantage / Pour y mettre son héritage / Ou son cœur en morceaux. »
"… pour juger, pour aimer, il faut venir et rester…"
Jules Supervielle possède peut-être autant de délicatesse, avec la fin de ce poème intitulé « Coucher de soleil basque » : « C’est l’heure où, chaque jour, dans une étreinte pure / La Montagne et le Ciel mêlent leurs chevelures ».
Plus près de nous, divers auteurs comtemporains comme Florence Delay, une enfant de Bayonne, qui a notamment donné le roman « Etxemendi », Philippe Djian, qui a signé « Impardonnables », vécut un temps à Biarritz et qui déclare « j’ai l’impression d’avoir trouvé mes racines au pays basque », Jean Echenoz, qui y fut en immersion à la faveur de l’écriture de son « Ravel », Marie Darrieussecq, une autre Bayonnaise qui évoque son pays natal à l’occasion (« Précisions sur les vagues »), ou encore Daniel Herrero, qui sait décrire avec un style inimitable les rugbymen basques, dans son « Dictionnaire amoureux du rugby », prolongent la prose empathique d’un Joseph Peyré, d’un Pierre Benoît ou encore d’un Francis Jammes, même si ce dernier est moins subtil peut-être que Toulet - tous sont amoureux de leur terre. Et l’on s’aperçoit alors que les écrivains locaux (mais pas de langue Basque – objet, nous l’avons dit, d’une prochain article), comme les écrivains voyageurs qui se retrouvent à aimer le Pays basque, rivalisent d’enthousiasme pour cette terre que Roland Barthes invite à ne pas trop photographier, car « pour juger, pour aimer, il faut venir et rester, de façon à pouvoir parcourir toute la moire des lieux, des saisons, des temps, des lumières ». L.M.
 Bibliographie :
Bibliographie :
Roland Barthes, « Incidents », Seuil.
Victor Hugo, « Voyage aux Pyrénées. De Bordeaux à Gavarnie », Cairn.
Pierre Loti, "Ramuntcho", « le Pays basque », Aubéron.
Michelet, « Histoire de France », t.3, Les Equateurs.
Stendhal, « Journal de voyage de Bordeaux au Pont du Gard", Pimientos.
H.Taine, « Voyage aux eaux des Pyrénées », Hachette.
T.Gautier, « Quand on voyage », Lévy frères.
Viollet-le-Duc, « Lettres », Amis du musée pyrénéen.
P.Mérimée, « Lettres d’Espagne », Complexe.
P-J. Toulet, « Les contrerimes », Poésie/Gallimard.
J.Supervielle, « Poèmes », Gallimard.
F.Delay, « Etxemendi », folio.
P.Djian, « Impardonnables », folio.
J.Echenoz, « Ravel », Minuit.
M.Darrieussecq, « Précisions sur les vagues », POL et « La mer console de toutes les laideurs », Cairn.
D.Herrero, « Dictionnaire amoureux du rugby », Plon.
J.Peyré, « De mon Béarn à la terre basque », Marrimpouey.
P.Benoît, « Le Pays basque », Nathan.
F.Jammes, « de l’angélus de l’aube à l’angélus du soir », Poésie/Gallimard.
Ernesto de Iruña
Papa Hem’ (Ernest Hemingway) aura fait davantage pour « las Sanfermines » (les fêtes de Pampelune), qu’aucun office de tourisme ou campagne de pub aurait pu faire, et ça continue ! La chambre qu’il occupa entre 1923 et 1959 (il participa neuf fois à la feria des ferias) à l’Hôtel La Perla – conservée dans son suc - est réservée pendant les fêtes jusqu’en 2050. Sa statue trône devant les arènes qui accueillent vers 7h06 les toros de l’après-midi, à l’issue d’un encierro quotidien, au cours de la semana grande (qui se tient traditionnellement du 7 au 14 juillet), et que d’aucuns pensent courir comme Hemingway le fit - ce que personne ne peut affirmer (y compris son biographe d’entre les biographes, A.E. Hotchner, lequel, du bout des lèvres semble-t-il, murmure dans « Papa Hemingway », que dans son jeune âge, Hemingway avaitcouru devant les taureaux…) ; et ce au péril de leur vie. Et les coups de cornes sont généreux, qui frappent à l’occasion des citoyens américains aficionados à leur auteur favori davantage qu’a los toros. Il n’empêche ! La légende Hem’, car l’auteur de « Le soleil se lève aussi » - the livre sur Pampelune ! (et de « Mort dans l’après-midi » aussi), a la peau dure. Papa Hem’ suivit également quelques corridas bayonnaises, mais c’est Pamplona qui l’ancra dans la fête, son esprit, ses beuveries, son débridé païen, son culte du toro-toro, ses mines d’écriture que tout cela engendra – pour notre bonheur de lecteurs. L.M.
---
A.E. Hotchner, « Papa Hemingway », éd. Calmann-Lévy.
Edmond d’Arnaga
Edmond Rostand, né à Marseille, où il repose, et mort de la grippe espagnole à l’âge de 50 ans à Paris en 1918, n’aura rien écrit sur le Pays basque, et pourtant, avec sa fameuse et somptueuse résidence Arnaga, située à Cambo, ce Rostand-là fait partie du paysage littéraire régional. Le génial auteur d’un des textes les plus beaux de la langue française, doublé d’un des textes porteurs d’une morale humaine difficilement dépassable – Cyrano de Bergerac -, s’il avait écrit sur le Pays basque, aurait certainement donné des pages étincelantes. C’est le Luchonnais, où il résida dans sa jeunesse, qui l’inspira davantage. Et c’est en convalescence d’une pleurésie, à Cambo en 1900, qu’il est séduit par le pays et fait édifier Arnaga, devenue Musée Edmond Rostand : www.arnaga.com L.M.
Voici un papier que j'ai donné à Pyrénées magazine et qui paraît dans le spécial Pays basque, avec un superbes photos signées Dominique Chauvet.
 LE COEUR DES BASQUES
LE COEUR DES BASQUES
Ville à l’histoire gasconne,Bayonne est marquée depuis le XX ème siècle par la culture basque, au point d’être considérée comme la capitale du Pays basque nord... Mais le débat est vieux comme Lapurdum. Par Léon Mazzella. Photos : Dominique Chauvet.
Bayonne est-elle une ville basque ou une ville gasconne ? Si cette question que l’on se pose encore est devenue une antienne, c’est qu’elle n’est toujours pas tranchée, sinon à la sauce normande : ptêt’ ben qu’oui, ptêt’ben qu’non. Nous irons plus loin : la situation géographique de Bayonne, d’abord, lui donne droit de cité en Euzkadi. Située aux confins des Landes et du Pays basque, elle est incontestablement réputée capitale de la Côte basque, comme Pau est celle du Béarn, dans un département ou les Pyrénées, de Basses dès 1790, sont devenues Atlantiques en 1969. C’est par extension et presque naturellement que Bayonne est considérée aujourd’hui comme la capitale du Pays basque français dans son ensemble. Capitale économique du Bassin de l’Adour, port de commerce d’importance (le 9ème de l’hexagone par l’importance de son trafic), Bayonne a par ailleurs toujours joué un rôle d’aspirateur des énergies humaines, notamment celles du Pays basque intérieur. Lapurdum (son nom latin, qui a donné Labourd), est par ailleurs située à la frontière occidentale entre le Pays basque et la Gascogne. À la sortie de Bayonne en prenant la rue Maubec, on arrive très vite dans les Landes – Tarnos est à peine à une encablure et demie de la gare. Si l’on se penche sur l’origine du peuplement de la ville de Bayonne, on s’aperçoit vite que les Vascons (habitants d’une zone englobant la Navarre espagnole et remontant jusque dans les Landes, grosso modo), ancêtres des Gascons (la langue gasconne est d’ailleurs un mélange de vascon et de latin), peuplent dès avant les Basques la future cité, qui appartient à une région appelée Novempopulanie, puis justement Vasconie (dès 626). Néanmoins, la chute de l’empire romain voit apparaître les Basques, ou Baskones, et le mot glisse vers celui de Gascons. Cherchez l’erreur… Comme ils venaient de l’actuelle province de Navarre espagnole, cela ne pose pas de problème historique majeur. On parlera gascon à Bayonne jusqu’au début du XXème siècle, car Bayonne, comme capitale du Labourd jusqu’en 1177, avant d’être rattachée au duché d’Aquitaine, restera donc une ville gasconne pendant des siècles. La langue française chasse progressivement la langue gasconne, qui fut pourtant la langue officielle de la région de Bayonne pendant au moins 400 ans, tandis que de nombreux Basques venus de l’arrière-pays s’installent dans la ville tout au long du siècle dernier. Ainsi cohabitent trois langues, de nos jours. L’occitan gascon, devenu minoritaire, régresse considérablement, le basque résiste au français, qui est omnipotent, parce que les Basques constituent une minorité qui sait s’imposer, devenue au fil du XXème siècle, une population bayonnaise influente.
UNE VILLE MÉTISSÉE
D’ailleurs, à ce stade de l’exploration de Bayonne, ville hybride, autant gasconne que basque, ou peu s’en faut pour certains, résolument gasconne pour d’autres ou seulement basque pour d’autres encore, nous pouvons affirmer que, historiquement, Bayonne fut gasconne et qu’elle est devenue basque à l’époque contemporaine, et qu’en tant que ville européenne, au passé notamment enrichi par la communauté Juive venue du Portugal au moment de l’Inquisition, et qui s’installa dans le quartier Saint-Esprit (lequel fut lui-même gascon jusqu’en 1857, date à laquelle il est rattaché à Bayonne), c’est une cité aux cultures métissées – ce qui en fait sa richesse. Terre de brassage et de mélange, de langues distinctes et d’apports humains, économiques, culturels, religieux divers, avec l’Espagne à proximité, l’océan et un port d’accueil, les Landes de Gascogne au nord et le Pays basque « sur place », Bayonne est une ville des confins, une ville frontière sans barrières, une ville que l’on répugne à quitter, une ville de ponts entre les cultures. La toponymie originelle des rues, des lieux-dits, même si elle est aujourd’hui « francisée », se partage les trois langues et est « entretenue » sur les panneaux de signalisation et la signalétique générale. Plusieurs émissions de télévision, de radios, des chroniques dans certains journaux sont en Basque et en Gascon. Les ikastolas encouragent l’apprentissage de l’euskara (le gascon n’est cependant guère enseigné officiellement), les académies, tant basque que gasconne, continuent de produire des études savantes, puisque la question fait encore couler beaucoup d’encre, mais il est à noter aussi, avec bonheur d’ailleurs, que les acteurs culturels, issus du monde associatif, s’accordent désormais en collaborant à l’occasion de « semaines » riches d’animations collectives basques et gasconnes à la fois.
DES SYMBOLES BASQUES FORTS
Gorka Robles Aranguiz, chanteur basque bien connu à Bayonne, souligne d’emblée que Ibai Ona (la bonne rivière) qui a donné Bayonne, est un nom basque ! Et pan. Et l’homme à la voix qui porte et aux rires homériques enchaîne en évoquant la présence, à Bayonne, du seul musée qui se revendique exclusivement basque ! À Bilbao, c’est un musée d’art contemporain qui fait la gloire de la ville, tandis qu’ici, c’est le Musée basque, ou Maison Dagourette. Notons cependant l’existence du musée San Telmo, à Saint-Sébastien, le plus vieux musée du Pays basque d’ailleurs, qui ouvrit ses portes en 1902. Ce musée de la société basque et de la citoyenneté se trouve néanmoins « de l’autre côté », et la présence du Musée basque sur les quais de la Nive renforce le rôle – de plus en plus indubitable - de Bayonne capitale basque depuis plusieurs décennies. Car, en effet, dès le début du siècle dernier, un phénomène quasi naturel, logique, a fait couler, découler, venir à Bayonne, depuis la campagne, depuis la montagne, depuis l’Espagne aussi, au marché hebdomadaire, au stade, une population basque de plus en plus nombreuse, qui a progressivement pris racine, notamment dans le quartier Saint-André.
UNE CONQUÊTE VENUE DE L’ARRIÈRE-PAYS
Clément Soulé, emblématique patron du Café des Pyrénées (qu’il a vendu il y a sept ans et qu’il ouvrit le 1er avril 1982), évoque le Petit Bayonne en ces termes : « on l’a conquis ! ». On, ce sont les Basques du Pays intérieur, surtout les Souletins, s’agissant du quartier Saint-andré. Ce mouvement de conquête connut une accélération dans les années 1980. À l’instar de Biarritz, où de nombreux Béarnais choisirent de s’installer, de nombreux Basques des villages environnants et des vallées plus lointaines posèrent leur sac dans le quartier du Petit Bayonne, plus populaire que le Grand Bayonne, traditionnellement bourgeois. C’est ainsi que des familles de Tardets, comme les Soulé, de Mauléon aussi, et d’autres originaires de Saint-Jean-Pied-de-Port, de Saint-Palais, d’Hasparren, « colonisèrent » plusieurs quartiers de Bayonne en imprimant rapidement leur marque euzkadienne. Prenons la place Saint-André avec son grand parking. C’est là que de nombreux autobus venaient de l’intérieur du pays, c’est donc là que les gens échangeaient les nouvelles, chaque mardi, jeudi et samedi. Certes, le quartier vécut aussi des périodes sombres, notamment avec les années ETA, IK (Iparretarrak) et GAL. La rue Pannecau, entre autres, demeure une partie de la ville où une forte identité basque, largement revendiquée par la jeunesse, a pris le relais des années où c’était des réfugiés, les « Réfus », qui hantaient les lieux, surtout dans les années 1983 à 1987, ainsi que le souligne Colette Larraburu (1). Une trentaine d’assassinats perpétrés par le GAL, notamment au Café des Pyrénées même le 29 mars 1985, ainsi qu’au célèbre café-hôtel Mon Bar, au bar Lagunekin, ou encore chez Etxabe (tous situés rue Pannecau), des explosions criminelles (à commencer par celle de la librairie Zabal, spécialisée dans la culture basque, et qui ouvrit ces années noires), ont marqué les esprits à jamais et certains murs en portent encore les stigmates. Le quartier fut longtemps déserté, et pour cause, et il fallut plus d’une dizaine d’années pour qu’il retrouve une atmosphère paisible et son sens inné de la fête. « Le quartier Pannecau », dit Clément Soulié, fonctionne comme un petit village où chacun se connaît et provient d’un coin du Pays basque intérieur, tout le monde y a échafaudé vaillamment sa petite stratégie de l’occupation des lieux, en y travaillant, en montant des commerces, en reprenant des pas-de-porte, modestement d’abord. Bayonne fonctionne un peu par communautés, en somme, » ajoute Clément, « Ce n’est pas contre les Gascons que les Basques de l’intérieur ont conquis une partie de la ville, ça a toujours fonctionné comme cela : les Béarnais à Biarritz, les Juifs à Saint-Esprit, les Basques entre Nive et Adour. » Clément Soulé reconnaît cependant que sa communauté est moins performante que celle des Auvergnats (de Paris), par exemple, pour s’entraider. « Autrement, c’est Bayonne dans sa totalité qui serait aujourd’hui annexée par les Basques de l’intérieur ! », lance-t-il en souriant.
LE RÔLE CAPITAL DES FÊTES
« Cependant, jusque dans les années 1980, parler Basque à l’école, ça ne passait pas bien », rappelle Gorka Robles, « et le syndrome des histoires belges où le Basque remplace un Belge a la couenne dure ! ». Le Gascon était la langue de la bourgeoisie bayonnaise jusqu’au XIXème siècle, et ce jusqu’en Guipuzkoa, où c’était le peuple, surtout rural, qui parlait Basque. Répétons le, Bayonne assume aujourd’hui son rôle de capitale du Pays basque nord, comme Pampelune celui de capitale du Pays basque sud – c’est historique, pour la Navarre en tout cas, Vitoria tenant le rôle de capitale administrative. « La culture basque impulse la culture bayonnaise dans son ensemble, précise encore Gorka. Il n’est qu’à citer certaines initiatives innovantes comme le Bizi ! (mouvement alternatif alter mondialiste), et les deux ikastolas que compte la ville, bien sûr. » Un signe ne trompe pas, vient des autorités : le drapeau basque flotte au balcon de la Mairie de Bayonne… La chance énorme, sur ce sujet, c’est Baionako Bestak, les Fêtes de Bayonne : un million de personnes, un océan rouge et blanc, en cinq jours, voit des gens chanter et danser en langue basque, et les spectacles proposés ont beau être différents les uns des autres, chacun a plus ou moins consciemment le sentiment de venir faire la fête dans la capitale du Pays basque. Pis, qui pense venir faire la fête dans Bayonne, ville gasconne ?.. L.M.

Pratique :
- Le Festival gascon de Bayonne, organisé par le Ligam Gascon deu Baish-Ador (LGBA), tiendra sa 5ème édition au cours de la première semaine de juillet prochain. Rens ; : 0559086422
- Bizi ! www.bizimugi.eu
- Académie gascoune de Bayonne : www.gasconha.com
- Académie de la langue basque (Bayonne : 0559256426).
- Baionako Bestak, les Fêtes de Bayonne 2014 se dérouleront du 23 au 27 juillet. www.fetes.bayonne.fr
- Lire : (1) « Rendez-vous Place Saint-André. Trente ans de vie au Café des Pyrénées, de Colette Larraburu. Préface de Léon Mazzella (éd. Elkar).
- Festival musical Black & Basque, en septembre, lieu d’échanges culturels entre les peuples Afro-américain et Basque, créé il y a quatre ans par Christian Borde, alias Moustic (Groland, sur Canal+). www.blackandbasque.com
- Bar-restaurant sympa du moment, à l’ambiance jeune et basque garantie : Kalostrape, 22, rue Marengo, à deux pas de la Place St-André.
GASCON
« Comment peut-on être Persan ? » demandait Montesquieu. Comment peut-on être Gascon ?.. On ne le devient pas, on l’est de naissance. C’est un caractère, une manière d’être au monde, de penser, de marcher, de parler, de rire et de chanter, d’aimer et de préférer, de manger et de boire, de donner et de partager, de faire la fête et de cultiver l’amitié avec autant de soin que la vigne, une façon de vivre le paysage, de caresser la plaine, de rentrer dans l’Océan, d’écouter la forêt, de voir la montagne, de songer la ville, de vivre le village, de dompter un étranger un peu trop conquistador. C’est une attitude de tous les instants, un accent, un regard, une fierté, une franchise, un laisser-aller contrôlé, une morale, un savoir-vivre à nul autre pareil. Parmi les Gascons auxquels je pense aussitôt, je compte Jean-Jacques Lesgourgues, vigneron en Armagnac, à Bordeaux et en Madiran. Mécène, collectionneur d’art contemporain, Jean-Jacques est l’archétype du Gascon total. Je pense aussi à Jean Lafforgue, érudit, ancien libraire emblématique du temple des livres bordelais : Mollat. Je pense à Jean-Pierre Xiradakis, autre Bordelais aux origines grecques, restaurateur à l’enseigne de « La Tupiña ». Je pense enfin à Joël Dupuch, ostréiculteur sur le Bassin, amateur au sens noble du terme, ex rugbyman et cultivateur d’amitié. Le Gascon est un égoïste qui ne pense qu’aux autres. Un aventurier qui néglige l’objet pour la cause, un homme qui n’adhère à rien sauf au plaisir qu’il souhaite « faire passer ». Le Gascon est le contraire du militant. C’est un rugbyman au quotidien qui donne le ballon comme une offrande, parce que « ça » doit jouer, jamais stagner. Et pas que le dimanche après-midi. C’est un joueur qui fête la défaite, un homme qui engage sa vie pour son salut, à l’instar de « l’Aventurier » comme l’écrivain Roger Stéphane en dressa le « Portrait » dans un livre éponyme fameux. (Extrait de : « Le Sud-Ouest vu par Léon Mazzella ». Hugo & Cie).
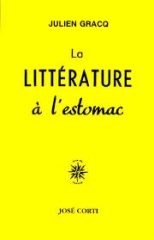 J'ai le sentiment que Julien Gracq, en 1949 (année de la rédaction de l'increvable pamphlet intitulé : "La littérature à l'estomac"), avait déjà prévu la BéèFMisation de l'info...
J'ai le sentiment que Julien Gracq, en 1949 (année de la rédaction de l'increvable pamphlet intitulé : "La littérature à l'estomac"), avait déjà prévu la BéèFMisation de l'info...
« même happement avide des nouvelles fraîches, aussitôt bues partout à la fois comme l’eau par le sable, aussitôt amplifiées en bruits, monnayées en échos, en rumeurs de coulisses... »
Julien Gracq, La Littérature à l'estomac (Corti).
 Papier paru dans le hors-série "vins" de L'Express il y a quelques jours => allez, zou! tous au kiosque! Pour que vive la presse écrite!
Papier paru dans le hors-série "vins" de L'Express il y a quelques jours => allez, zou! tous au kiosque! Pour que vive la presse écrite!
Rhums agricoles
LUXE, CANNE ET VOLUPTÉ
Par Léon Mazzella
Il y a le rhum de mélasse – à la sonorité déjà dégradante, issue de résidus de sucrerie, et dont on fait la plupart des rhums basiques de la planète. Et puis il y a le rhum de canne, issu de la fermentation et de la distillation du vesou, le jus de canne à sucre. Et ça a une autre allure – au nez comme en bouche. Pour cela, il n’y a guère que la Martinique (et la Guadeloupe, bien que celle-ci ne bénéficie d’aucune AOC) qui vaillent. D’aucuns en produisent à La Réunion et à Maurice, mais force est d’admettre que les seigneurs de l’agricole nichent sous les tropiques antillais, rompus depuis des siècles à l’élaboration minutieuse du rhum à base exclusive de jus de canne. Le rhum agricole doit son acte de naissance au Père Jean-Baptiste Labat qui, en 1694, bricola une guildive (eau-de-vie sucrée) afin de soigner la fièvre. Ce qui autorise les guadeloupéens (en créole, « pèrlaba » désigne un esprit fûté) à se considérer comme les inventeurs de cet alcool, car le missionnaire dominicain l’élabora à l’artisanale distillerie Poisson, sur l’île de Marie-Galante. La culture de la canne connut alors un essor considérable qui dura jusqu’à l’aube du siècle dernier.
Une AOC pour la Martinique
Il y a eu les dix commandements, les douze salopards et les sept samouraïs ; et puis il y a les onze rhums. De la Martinique. En obtenant une AOC le 5 novembre 1996, les apôtres de la canne à sucre, plante introduite dans l’île en 1638 par Christophe Colomb, ont hissé le rhum agricole et le rhum agricole vieux au niveau des meilleurs alcools européens. Que celui qui n’a jamais confondu un excellent cognac, voire un armagnac ou un calvados (lire par ailleurs dans ce numéro) avec un rhum agricole vieux en les dégustant à l’aveugle, lève le doigt. Ces liqueurs ambrées répondent aux jolis noms de Depaz, Lamauny, Bally, Clément, Neisson, Dillon et autres J.M. (Crassous de Médeuil, pour les intimes), Trois Rivières, Old Nick, Saint-James, Habitation Saint-Etienne (HSE pour les initiés du rhum de Gros-Morne)… Rappelons d’une ligne qu’il y a peu encore, le rhum entrait dans nos foyers par la cuisine, au placard pâtisserie, et n’en sortait, ni à l’heure de l’apéritif, ni à celle du digestif. Il aura fallu la mode des cocktails pour que le rhum agricole (blanc, d’abord) sorte du bois (et du formica). Le rhum ambré et le rhum vieux attendaient leur heure. Aujourd’hui, ce dernier s’apprécie seul comme une autre eau-de-vie brune, à l’instar d’un armagnac, et escorte à l’occasion son vieil ami le havane. À l’heure où les tourments de la vie quotidienne encombrent notre esprit, un rhum, un cigare, et ainsi soit-il ! Cela permet en effet de tirer un trait sur les soucis tout en faisant apparaître des saveurs de vieux souvenirs, des splendeurs aromatiques où se mêlent soleil et miel, canne et vanille, poivre et cuir, touffeur humide et sourire caraïbe. Avec un couple aussi sensuel, tout est affaire de calme et de volutes. Luxe, canne et volupté, en somme.
 DU VESOU AU FOUDRE
DU VESOU AU FOUDRE
Le « vin de canne », ou vesou, titre 5 petits degrés. Il est issu de la fermentation éthylique du jus par l’action des levures naturelles, puis il est distillé (en continu) dans un alambic à colonne, composé de plateaux « d’épuisement » qui reçoivent le vin par le haut. Le résultat titre 70°, qu’il convient de diluer jusqu’à obtenir 55° ou 50°, selon que l’on souhaite faire un rhum ambré, un rhum vieux, ou un rhum paille ou bien un blanc, bien sûr (ils sont tous « agricoles »). Les rhums agricoles passent de un à quinze ans en foudres de chêne. Quatre ans sont nécessaires pour obtenir un VSOP, six pour un XO, et entre huit et douze ans pour qualifier un rhum « Vieux hors d’âge ». L.M.
 Papier sur les livres évoquant le vin et autres breuvages paru dans le hors-série vins de L'EXPRESS / L.M.
Papier sur les livres évoquant le vin et autres breuvages paru dans le hors-série vins de L'EXPRESS / L.M.
L’AUTODÉRISION DE L’AMATEUR BOBO
Mimi, Fifi & Glouglou, par Michel Tolmer, L’épure, 96 p., 22€
Les habitués de l’hilarant site Glougueule, « pour les hommes et les femmes de glou », créé par Michel Quesnot, connaissent les aventures - sous-titrées : « Petit traité de dégustation » - de ce trio de joyeux drilles qui n’a qu’une obsession : déguster des vins à l’aveugle. Michel Tolmer, célèbre dessinateur au service de la dive, nous régale en pratiquant l’autodérision avec finesse. Car son trio, loin d’occuper « les territoires de l’arrogance et de la morgue », comme le dit justement dans sa préface Jacques Ferrandez, autre auteur célèbre de BD et compagnon de zinc, se vautre avec joie dans la syntaxe du bobo qui ne désigne un vin que par le prénom du vigneron, ou bien par la parcelle inconnue dont est issu ledit vin. Un grand moment de rigolade à lire à la régalade.
 LE RUBAN MAGIQUE
LE RUBAN MAGIQUE
La magie du 45è parallèle, par Olivier Bernard et Thierry Dussard, Féret, 160 p., 19,50€
Ce ruban planétaire –situé entre le 45ème et le 50ème parallèle -, est une sorte de ligne de démarcation, « une ligne de partage où convergent les équilibres », résume Olivier Bernard (Domaine de Chevalier, dans les Graves), coauteur de cet ouvrage avec le journaliste Thierry Dussard et vingt-six contributeurs aussi prestigieux dans leur domaine propre, que Michel Serres, Alain Dutournier, Jean-Louis Chave et Jean-Robert Pitte. C’est donc à la fois une bonne étoile et un beau mystère, car il permet d’engendrer des vins exceptionnels sur son sillage. Comme il existe ainsi une ligne de partage du vin (à l’instar de celle des eaux), une « ligne à haute tension » qui ne donne « rien de trop », souligne l’écrivain Jean-Paul Kauffmann dans sa préface. C’est le méridien de Greenwich des amateurs du sang de la vigne, « le tracé de l’excellence », « le fil rouge de l’excellence viticole », précise Aubert de Villaine (même si le 45è touche surtout Bordeaux et si la Côte d’Or se situe sur le 47è). Car il faut s’y résoudre : c’est là que ça passe, par ce juste milieu que ça se passe, là que l’équilibre se fait et que l’excellence naît, par le biais d’une alchimie aussi poétique que scientifique, mais que l’indispensable savoir-faire de l’homme vigneron parachève. Parallèle jacta est, pourrait-on ajouter.
LA BIBLE EFFERVESCENTE
Un parfum de champagne, par Richard Juhlin, Féret, 400 p., 54,50€
L’auteur, réputé être le plus grand expert au monde des vins de Champagne, est un surdoué du nez, un souverain pif ! Il en a dégusté et noté 8000 pour cet énorme livre appelé à faire date. Œnologue suédois, journaliste wine globe-trotter et conférencier recherché, Richard Juhlin offre cette somme dont l’ambition est d’être, de son propre aveu, « une approche aromatique orientée sur le plaisir de la dégustation, reflétant ma propre philosophie de l’effervescence champenoise ». Une sorte d’autobiographie ouvre le livre, qui se poursuit naturellement par des chapitres évoquant l’histoire, la géographie, le savoir-faire champenois, enrichie d’une galerie de portraits et de l’écho prodigieux du champagne dans nos univers culturels. Il s’agit cependant d’un propos personnel à chaque page, car Juhlin est davantage épicurien que technicien : « je transforme en mots ces instants fragiles de la dégustation où je sens le champagne », écrit-il par exemple. La seconde partie de l’album, qui passe en revue 8000 flacons, force le respect, car non seulement les notes reflètent un talent, mais elles font également écho, avec sensibilité et respect, aux hommes et aux femmes qui élaborent le vin le plus magique du monde. Et l’auteur d’ajouter « une chose est certaine, après avoir dégusté tous ces Champagne, la vie est trop courte pour boire du cava espagnol ! ». Pop…
LE VERRE EST UN PASSEUR D’ÉMOTION
Inspirations, par Gérard-Philippe Manbillard, Glénat, 25€
L’idée, originale, revient à Christian Michellod, qui créa la Fondation Moi pour Toit, destinée à venir en aide aux enfants de Colombie. Puis ce livre, pour évoquer les vins du Valais (Suisse) en invitant des stars du cinéma, du sport, de la littérature, de la mode ou de la musique à photographier le plus librement possible un verre de vin. Cela produit un livre estuaire, « dont les histoires se rejoignent comme des rivières qui se jettent à la mer ». De Paul Smith à Sandrine Bonnaire, d’Eric Neuhoff à Viggo Mortensen ou encore de Jacques Dutronc à Zinédine Zidane et Sarah Moon, 56 regards très personnels et redoutablement esthétiques pour la plupart composent un album singulier.
Toit, destinée à venir en aide aux enfants de Colombie. Puis ce livre, pour évoquer les vins du Valais (Suisse) en invitant des stars du cinéma, du sport, de la littérature, de la mode ou de la musique à photographier le plus librement possible un verre de vin. Cela produit un livre estuaire, « dont les histoires se rejoignent comme des rivières qui se jettent à la mer ». De Paul Smith à Sandrine Bonnaire, d’Eric Neuhoff à Viggo Mortensen ou encore de Jacques Dutronc à Zinédine Zidane et Sarah Moon, 56 regards très personnels et redoutablement esthétiques pour la plupart composent un album singulier.
TRONCHES ANGEVINES
Vignerons d’Anjou, Gueules de Vignerons, par Jean-Yves Bardin (photos) et Patrick Rigourd (textes), Anovi, 128 p., 22 €
C’est un livre de douceur. Angevine, pour le coup. La galerie de portraits brut nature de cette pléiade de vignerons d’Anjou est une ode à l’humain qui travaille la vigne avec talent, constance et pugnacité tout en respectant les lois naturelles et en repoussant l’intrant chimique comme la peste. Il y a des stars : Nicolas Joly, Agnès et René Mosse, Patrick Baudouin, Mark Angeli, Jo Pithon, Vincent Ogereau… D’autres un peu moins connus. La plupart travaillent « en bio » et tous affichent ici leur authenticité, car ces portraits saisis sur le vif comme une côte sur la braise, disent l’Anjou vigneron qui hisse son savoir-faire au plus haut depuis quelques années, et vise les sommets. Feu !
SAKÉ MODE D’EMPLOI
L’Art du saké, par Toshiro Kuroda, photos d’Iris L., La Martinière, 224 p., 49€
Toshiro Kuroda est un sakéologue passionné par ce produit japonais méconnu, sorte de « bière de riz », fabriqué à base de riz rond, poli, fermenté, puis pasteurisé et qui exprime une palette aromatique à faire pâlir les vins les plus complexes. L’auteur nous dit tout sur l’élaboration du saké et sur les différentes familles de cet alcool plusieurs fois millénaire : sakés aromatiques, de goûts, de fraîcheur, matures. Sakés namazake (crus), futsushu (de table), junmaï (sans distillat d’alcool), de garde, ou encore kimoto (au levurage naturel). Il nous ouvre également les portes des grandes maisons de saké. Le livre – aux photos splendides, s’accompagne enfin de recettes au saké signées par de grands chefs français. Zen et raffiné
Ô MAGNY !
Into wine, une invitation au plaisir, par Olivier Magny, 10/18, 250 p., 13,10€
Le créateur de l’école de dégustation Ô Chateau et du bar à vins parisien éponyme, est un sommelier autodidacte passionné, ayant le beau souci de transmettre son goût pour le sang de la vigne avec humour et fraîcheur. Olivier Magny raconte ici son propre parcours dans le monde joyeux des vignerons du monde entier avec sensibilité et humilité. Il est question dans cet ouvrage un peu fourre-tout de biodynamie, de wine-makers, de bouteilles coups de cœur, des courbes comparées de ventes de pauillac et de Prozac, de l’affligeante propagande anti-vin, de l’art de lire une étiquette ou encore des « terroiristes ». Une saine invitation au plaisir à picorer au hasard.
 ODE EN BD À LA BOURGOGNE
ODE EN BD À LA BOURGOGNE
Chroniques de la vigne, par Fred Bernard, Glénat, 152 p., 19,50€
Auteur de nombreuses BD pour la jeunesse, Fred Bernard, né à Savigny-les-Beaune, fils et petit-fils de vignerons, choisit de raconter le vignoble bourguignon à travers une conversation atypique et chaleureuse avec son grand-père. L’ouvrage est enrichi d’extraits lumineux des « Effets psychologiques du vin », d’Edmondo de Amicis (L’Anabase). Les dessins sont sensibles, et l’approche « tutoyante » du vin par les propos tendrement passionnés du papy, rendent l’ouvrage infiniment touchant.
ALIMENTAIRE, MON CHER…
Boire sans grossir, sans excès… Et sans nuire à sa santé, par Laure Gasparotto, Flammarion, 230 p., 17 €
Le vin est un aliment. Il fallait le rappeler et l’hédoniste Professeur Jean-Didier Vincent l’exprime brillamment dans sa préface. Laure Gasparotto prolonge cette tautologie de façon quasi scientifique : dis-moi quel est ton métabolisme et je te dirai quels vins boire, lance d’emblée l’auteure (en précisant d’ailleurs que les vins dits naturels ne sont pas davantage bons pour la santé que les autres). Laure invite à boire avec modération, toujours pour le plaisir et plutôt en mangeant, nous aide consciencieusement à choisir les vins afin de ne pas grossir, établit des « points santé » selon les couleurs, les appellations et même selon les domaines ! Apprendre ainsi que le champagne d’Anselme Selosse est bon pour notre corps, réjouit l’esprit (en taquinant le porte-monnaie), mais bon, tant qu’on a la santé…
AUBERT DE VILLAINE A DISPARU
La Romanée contée, Pinot noir contre Dragon blanc, par Simmat & Bercovici, Vents d’Ouest, 64 p., 12,50€
Le duo a encore frappé. Le journaliste Benoist Simmat au stylo (infos garanties bien « sourcées »), et Philippe Bercovici, « l’homme qui dessine plus vite que son ombre » aux crayons, nous donnent une nouvelle BD en forme de polar bachique ayant pour thème l’énigmatique disparition, lors d’une soirée donnée à Clos Vougeot, du plus célèbre vigneron français, Aubert de Villaine, « l’homme de la Romanée-Conti ». Et c’est parti !.. Le lecteur se régale, croise Bernard Pivot, François Pinault, Robert Parker et Louis Ng, milliardaire chinois, embarque pour Macao, le tout dans un tourbillon hilarant et captivant comme un thriller. Remettez-nous ça !
SAINT-EMILION VU DE L’INTERIEUR
Esprit de Saint-Emilion, par Daniel Rey et Geneviève Jamin, photos de Flavio Pagani, Les éditions d’Autils, 264 p., xxx €
Plus d’un million de personnes visitent chaque année Saint-Emilion, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, mais personne, ou si peu, ne pénètre l’intérieur des châteaux les plus célèbres du cru. C’est à ce voyage que « Esprit de Saint-Emilion » nous convie, en faisant la part belle aux photos. En feuilletant, nous avons le sentiment d’être un instant l’hôte des propriétaires de crus aussi célèbres qu’Angelus, Ausone, Cheval Blanc ou Troplong-Mondot. Et d’entrer dans le salon de l’un d’eux, d’en investir le canapé, de passer par la cuisine et d’y soulever un couvercle. Pour une fois, nous ne sommes plus les visiteurs des seuls chais. Le lecteur possède les clés, et ici, tout est luxe, calme et volupté, dirait Baudelaire. Raffinement et décoration bourgeoise en disent long sur les habitants des lieux. Peut-être autant que leurs vins eux-mêmes.
Je publie ce papier dans STUDIO Ciné Live magazine de ce mois-ci.

Nous sommes loin de la Croisette, loin des stars, du strass et des paillettes. Le temps du Festival est derrière nous, l’été est déjà là. Passons au comptoir et dans la salle obscure, ou devant notre écran le temps de quelques films. De brasserie en brasserie, nous allons sillonner en pensée les pays de la bière, à commencer par la Belgique, la Hollande –et surtout Amsterdam, Heineken city-, en nous livrant au jeu des alliances impromptues du septième art et de la cervoise.
--------
C’est parti : « On va au Winchester, on boit une bonne bière en attendant que les choses se calment ». Cette réplique se trouve dans le film « Shaun Of The Dead». Une pellicule chargée de zombies un rien romantique, signé Edgar Wright, avec Simon Pegg et Nick Frost. Avec une telle toile, c’est une Pelforth brune qu’il faut, ou bien une Tiger, la bière de Singapour.
Car il existe des bières adaptées à chaque type de film : une Heineken, une 33 Export, sont des « mousses » qui conviennent particulièrement bien aux comédies légères et aux films à l’humour qui flirte parfois avec la gaudriole soft. Ce sont ces DVD que l’on regarde par un dimanche après-midi, lorsque l’on revient de la plage, comme « Dix bonnes raisons de te larguer », comédie davantage dramatique que romantique réalisée par Gil Junger (et adaptation contemporaine de « La mégère apprivoisée », de Shakespeare). Dans « Incognito », d’Eric Lavaine, avec le chanteur Bénabar et Frank Dubosc à l’affiche, il y a ce dialogue piquant : « Mais tu peux pas mettre un slip, bordel ?- Pourquoi ?- Bah, je sais pas, tu ne t'es pas dit un moment aujourd'hui, tiens je vais mettre un slip ? (…) - Pas de slip, pas de bière !.. » C’est plutôt drôle, et donc rafraîchissant comme une blonde pression.
Dans un registre voisin, le cultissime « Dîner de cons », de Francis Veber, avec Jacques Villeret et Thierry Lermitte, recèle une perle qui offre une touche gastronomique – n’oublions pas la cuisine à la bière, chère aux Flamands : « Moi mon truc, c'est de rajouter une petite goutte de bière quand j'ai battu les œufs ... - L'adresse, bordel ! » Villeret prend d’ailleurs l’accent belge à plusieurs reprises dans ce film désopilant.
Avec les westerns, il ne faut pas hésiter à déguster une Desperados ! Cela s’impose. S’agissant des films d’aventure, de cape et d’épée ou bien des films historiques qui revisitent des mythes inusables, il y a les bières fortes, un brin rustiques : Murphy’s, comme Foster’s se fiancent allègrement à cet extrait de « Robin des Bois, Prince des voleurs », interprété par un Kevin Costner magistral, dans une réalisation tonitruante que nous devons à Kevin Reynolds : « Le manger est à la portée de tous les imbéciles, mais notre seigneur, dans sa divine sagesse, a prévu une meilleure façon de le consommer. Et levons une prière de remerciement à notre créateur qui, dans sa bonté céleste, nous a donné... la bière. » C’est un hommage! Notons que choisir ici de boire une Affligen, une bière d’abbaye et de légende, serait même « raccord ». Les bières brassées par des moines sont mystérieuses. Et grâce soit rendue aux cisterciens qui inventèrent la bière trappiste. Les bières d'abbaye (bénédictines ou norbertines), sont en revanche brassées de façon « laïque », soit rarement au sein d'une abbaye.
 Avec de vieux films devenus des classiques, où les scènes de beuverie abondent, comme « Un singe en hiver », d’Henri Verneuil, interprété par Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo (d’après l’inoubliable roman d’Antoine Blondin), nous pouvons nous laisser aller à choisir des bières toniques et à fort caractère, comme ces trois méditerranéennes : Cruzcampo pour l’Espagne, Moretti pour Italie, Sagres pour le Portugal, et ne pas hésiter non plus à ajouter une larme de Picon dans l’une de ces cervoises : « Le Picon-bière, ça pardonne pas. C'est de ça que mon pauvre papa est mort. Il n'y a rien de plus traître ! » Évidemment, cela reste une réplique. L’exagération est fréquemment de mise, au cinéma.
Avec de vieux films devenus des classiques, où les scènes de beuverie abondent, comme « Un singe en hiver », d’Henri Verneuil, interprété par Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo (d’après l’inoubliable roman d’Antoine Blondin), nous pouvons nous laisser aller à choisir des bières toniques et à fort caractère, comme ces trois méditerranéennes : Cruzcampo pour l’Espagne, Moretti pour Italie, Sagres pour le Portugal, et ne pas hésiter non plus à ajouter une larme de Picon dans l’une de ces cervoises : « Le Picon-bière, ça pardonne pas. C'est de ça que mon pauvre papa est mort. Il n'y a rien de plus traître ! » Évidemment, cela reste une réplique. L’exagération est fréquemment de mise, au cinéma.
Avec des comédies déjantées, voire hallucinogènes, qui flirtent avec le genre thriller, comme le célèbre « Las Vegas Parano », il convient de pencher pour des bières rousses, comme George Killian’s et Adelscott. Cette dernière possède une touche particulière car elle est aromatisée au malt à whisky : « On avait une galaxie multicolore de remontants, sédatifs, hilarants, larmoyants, criants, en plus une bouteille de tequila, une bouteille de rhum, une caisse de bières. (…) Non qu'on ait eu besoin de tout ça pour le voyage, mais quand on démarre un plan drogue, la tendance, c'est de repousser toute limite. » Le film de Terry Gilliam n’y va pas de main morte, comme nous savons, et Benicio del Toro comme Johnny Depp y sont de vrais ambassadeurs de notre boisson de prédilection.
Dans « Un jour sans fin », de Harold Ramis avec un Bill Murray formidable et une Andy MacDowell éblouissante, nous avons cette réplique fameuse, qui va si bien à une bière pression servie directement à la maison, à l’aide un Beertender® en forme d’obus, redoutablement chic et chargé d’une blonde classique, pourquoi pas de l'Amstel : « Toute la vie c'est la même chanson, nettoie ta chambre, tiens-toi droit, essuie-toi les pieds, sois un homme, n'embête pas ta sœur , ne mélange jamais la bière et le vin, oh oui, ne conduis jamais sur la voie ferrée. »
Si nous choisissons de voir un dessin animé, une bière sans alcool comme la Buckler est toute désignée. À la rigueur, nous choisirons une Panach’.
Nous repensons alors au Fischermännele, le petit garçon Fischer des plaques émaillées de notre enfance. Il est assis sur un tonneau et vide goulûment une grande chope. Cette bière alsacienne bien houblonnée se prend à la pression et à la hussarde, sans chichis ni cacahuètes, dans la plupart des bars situés au nord du 45è parallèle. C’est la bière parfaite pour regarder un film tendre, un drame psychologique pourvu d’une happy end.
Enfin, la série culte « Dexter », dans laquelle Michael C. Hall interprète Dexter Morgan, expert en médecine légale et assassin de criminels, il y a cette sortie un brin brutale : « D'habitude, je viens ici pour balancer des corps par le fond. Pas des bouteilles de bière comme un gros dégueulasse. » Associons là d’emblée à des bières étrangères aux noms évoquant le septième art : Star, la bière du Nigeria, ou bien Stella, la bière égyptienne, et nous voici aussitôt propulsés sur la piste aux étoiles. L.M.
Morgan, expert en médecine légale et assassin de criminels, il y a cette sortie un brin brutale : « D'habitude, je viens ici pour balancer des corps par le fond. Pas des bouteilles de bière comme un gros dégueulasse. » Associons là d’emblée à des bières étrangères aux noms évoquant le septième art : Star, la bière du Nigeria, ou bien Stella, la bière égyptienne, et nous voici aussitôt propulsés sur la piste aux étoiles. L.M.
Pseudo : Enzo Luppolo (houblon, en Italien).
 Reportage paru dans le hors-série Vins de L'Express, juin 2014
Reportage paru dans le hors-série Vins de L'Express, juin 2014
Longtemps confiné au rang d’eau-de-vie mineure chez nous, le Calvados a conquis le monde, où il est synonyme du savoir faire français artisanal et prestigieux, tout en plongeant sans complexe dans des cocktails auxquels il doit peut-être sa survie. Reportage en Pays d’Auge. Par Léon Mazzella
-----------
Ne dites plus jamais calva pour évoquer le Calvados. « Dit-on pinard pour désigner un margaux ? », s’indigne Jean-Roger Groult, du domaine éponyme classé en AOC Calvados Pays d’Auge (lire encadré). Ne demandez donc plus jamais « un p’ti calva » pour commander cette eau-de-vie brune qui souffre encore d’une image poussiéreuse et dévalorisante d’alcool que l’on verse dans l’eau chaude pour se requinquer, ou bien dans le café (le café-calva, encore appelé « café nature » dans certains bars de la côte normande), comme de l’image de cette bouteille oubliée en haut de l’armoire du bistro ; au mieux de celle du « trou normand ». L’interprofession s’évertue à redorer le blason d’un alcool quelque peu en déshérence à l’intérieur de ses frontières. Car, à l’étranger – le Calvados s’exporte en moyenne à 55% et jusqu’à 87% dans certaines maisons comme Boulard -, l’eau-de-vie de cidre jouit d’une image forte : celle d’un produit à forte valeur ajoutée culturelle, fruit de l’inimitable savoir-faire français. Artisanal, précieux, chic, raffiné, cosy.
La griffe du Pays d’Auge
Au sein de l’appellation qui représente l’excellence du Calvados, nous trouvons, d’une part un jeune artisan qui se hisse modestement à la première place mondiale – Jean-Roger Groult (Calvados Roger Groult), en respectant la tradition d’un savoir faire maison depuis cinq générations. Pas très loin, un autre trentenaire, œnologue de formation, se plait à expérimenter les effets du bois sur l’eau-de-vie : Guillaume Drouin effectue un travail d’orfèvre, artisanal aussi, depuis trois générations. Nous avons d’autre part un trio de choc avec une puissance de feu considérable, trois Calvados complémentaires, unis pour la force, le luxe et le très haut de gamme à l’exportation : Spirit France, qui regroupe les Calvados Père Magloire – une légende française -, Boulard, et Lecompte. Et entre ces deux pôles, il existe d’autres maisons qui privilégient aussi la qualité et cultivent le prestige français auprès des nouveaux grands marchés comme la Russie et la Scandinavie. Le Calvados du Breuil est de ceux-là. Nous pourrions également citer Pierre Huet, Adrien Camut, Michel Huart, Louis Dupont… Nombreux sont les apôtres du Calvados de respect qui savent s’appuyer sur des méthodes traditionnelles et s’ouvrir à un monde moderne qui répugne de plus en plus à consommer des alcools titrant 40° en fin de repas, mais qui s’intéresse en revanche à leur dilution dans des cocktails de haute volée.
Le meilleur Calvados du monde
Jean-Roger Groult, 32 ans, à la tête de l’exploitation familiale qui porte son nom et qui distille depuis cinq générations du Calvados sur les hauteurs du Pays d’Auge, au sud de l’appellation – à Saint-Cyr du Ronceray très exactement -, peut être fier du travail accompli par les huit personnes qui font vivre la distillerie, car son Calvados Roger Groult 3 ans a été sacré meilleur Calvados du monde, et son Calvados Roger Groult Venerable, Calvados d’argent lors des World Calvados Awards (*), qui se sont tenus à Londres le 20 février dernier. Sa réflexion est simple, qui repose sur le maintien d’une recette ancestrale qui marche – il ne la change donc pas -, mais l’améliore en douceur tout en continuant de plaire à des clients, dont certains suivent la marque depuis plus d’un demi-siècle. Au Clos de la Hurvanière, siège bucolique et typiquement normand de cette dynastie de distillateurs récoltants, 25 variétés de pommes à cidre prospèrent sur 23 hectares (6 en Basse-tige et 17 en Haute-tige), qui fournissent la moitié des fruits nécessaires au domaine (l’autre moitié provient des vergers environnants), et donnent un cidre qui repose lentement près d’un an, avant de subir une double distillation artisanale dans trois petits alambics « à repasse », chauffés exclusivement au feu de bois (250 à 300 stères par an sont nécessaires), puis élevés dans des fûts centenaires. La production annuelle, de 50 000 bouteilles en AOC Calvados Pays d’Auge, est issue de 600 tonnes de fruits. « Le goût Groult, on le reconnaît à l’aveugle ; c’est un style », déclare sans aucune forfanterie Jean-Roger, en plongeant une pipette dans un fût noir. Ce goût, c’est un mélange de finesse, d’élégance, de féminité, de subtilité. Pas d’alcool fort chez Groult, « et tant pis pour les marchés qui en réclament », ajoute-t-il en tendant un verre de son Calvados Vénérable. « Nous avons une approche naturelle du produit depuis 150 ans, car nos fournisseurs traitent à peine leurs arbres et, ici, sans le vouloir, nous faisons de l’agriculture raisonnée, en continuant juste à faire comme on a toujours fait! ». Chez Groult, une tonne de pommes posées sur la plateforme en béton originale, inventée par son grand-père Roger, avant de passer sur un pressoir à bandes, donne 680 litres de jus qui devient cidre. 600 tonnes annuelles donnent 400 000 litres de cidre à 7° à distiller, soit environ 40 000 litres de Calvados. « On ne cherche pas le sur rendement, on distille le cidre qui a un an de cuve – lorsque le minimum légal est de 6 semaines -, ce qui permet de travailler un alcool racé, aromatique, structuré ». Jean-Roger se fiche par ailleurs du bois neuf. « La dernière fois qu’on en a acheté, c’était dans les années 80. En revanche, certains fûts de la maison sont centenaires et n’ont jamais été totalement vidées. Celle-là, dit-il en prélevant dans une vieille barrique du chai historique de l’ancêtre Pierre, mort en 1918, contient plus de 60 millésimes, et donne notre Réserve Ancestrale, d’âge inconnu… On sacrifie ainsi chaque année une partie de la récolte, en l’ajoutant à de vieux Calvados qui prennent le jeune par la main ». Selon un principe qui s’apparente à celui des soleras d’Andalousie, Jean-Roger et son maître de chai ne proposent pas de Calvados millésimés (excepté un 2002) – ils n’ont d’ailleurs pas la demande-, et préfèrent se livrer à un jeu d’assemblages sans fin, « parce que l’assemblage, c’est comme le métissage, cela donne toujours quelque chose de plus beau », déclare Jean-Roger.
L’artisanat haut de gamme
Autre son de serpentin chez Drouin, où la réflexion sur l’origine des fûts utilisés est capitale : ils ont servi au Porto, au Xérès, au Banyuls, au Madère, aux grands Médocs et, une fois grattés et passés au cidre par M. Duchemin, tonnelier à Honfleur, ils confèrent leurs saveurs propres au Calvados. Le travail sur les vieux millésimes – mis en bouteilles après vingt ans de fûts minimum ! – la marque de fabrique Drouin, est également fondamental. Cela donne l’occasion à Guillaume Drouin de se livrer à des expérimentations qui enrichissent sa gamme protéiforme de Calvados (notamment « Expression » : des eaux de vie issues d’un seul type de fût). Les Calvados Drouin ont conquis le monde, d’abord sous la houlette de son père Christian, lequel s’associât avec un distillateur et bouilleur de cru de génie, Pierre Pivet, dont l’alambic ambulant (construit en 1946), désormais fixé, trône et sert toujours (avec deux autres alambics), à la distillation. La douceur de la voix de Guillaume se retrouve d’ailleurs dans un verre de 1993, dans un autre de 1970. Ou encore de 1939 (issu d’un lot de fûts enterrés pendant la guerre, et mis en bouteille 47 ans plus tard, en 1986). Cet homme mesuré aime écouter la nature, observer les vaches lorsqu’elles secouent les pommiers, entendre les pommes tomber. Il la respecte, aussi : hormis la bouillie bordelaise, soit le strict minimum, utilisée dans les vergers, il n’y a aucun intrant artificiel dans le domaine du Cœur de Lion, d’ailleurs en 3ème année de conversion en agriculture raisonnée, et où les pommes sont délicatement écrasées par des presses « à paquet ». Les Calvados sont issus à la fois de cidres jeunes, et sont peu aptes au vieillissement, et de cidres d’un an qui donnent une colonne vertébrale, puissance et complexité aromatique aux Calvados de garde. Malgré ces attentions, Drouin père et fils sont très à l’écoute des nouveaux modes de consommation, en cocktails, de leurs Calvados d’exception. Car leurs meilleurs ambassadeurs sont les barmen et autres mixologistes experts en cocktails, qu’ils s’appellent Colin (du mythique Ritz-Hemingway), Robin (ex-Silencio, à Paris), ou qu’ils animent les nouveaux bars branchés parisiens comme Experimental cocktail club, Marie Celeste, Sherry Butt, et le Coq. Sans parler des bars de l’étranger. De même, Christian Drouin est loin de négliger les 25 à 30 000 visiteurs annuels de son domaine, qui peuvent déguster jusqu’à 35 millésimes, car « cela vaut mieux que toutes les pages de pub ! », renchérit-il en accueillant un groupe de chefs cuisiniers Lettons.
L’esprit français « marketé »
Vincent Boulard, en charge désormais de la communication de Spirit France, bien qu’intarissable sur sa marque éponyme, est fier du développement dans la complémentarité des trois marques du giron : un Père Magloire relooké et rajeuni, au positionnement populaire, un Boulard entre moyen de gamme et prestige, et enfin un Lecompte, qu’il définit comme « le Calvados des connaisseurs ». Trois démarches commerciales distinctes, des marchés communs à la base, un mode de consommation nouveau – sur glace et en cocktails – « en plein boom, et nous accompagnons avec force cette tendance », dit-il, « comme nous demandons à nos maîtres de chai, avec le grand respect qu’on leur doit, car ils restent au centre de notre stratégie, d’élaborer des Calvados assemblés selon une feuille de route, des figures imposées en quelque sorte, afin de répondre aux attentes des consommateurs, pays par pays ». Chez Spirit France, le marketing est roi, la démarche à caractère industriel préside aux choix stratégiques (c’est relatif, eu égard aux volumes : le Cognac représente par exemple 22 fois le Calvados), mais cela n’empêche pas Vincent Boulard et ses équipes de s’intéresser de près au grain du bois, plus ou moins fin, qui diffuse plus ou moins ses tanins, et de passer commande chaque année de centaines de fûts brûlés et montés sur mesure, pour coller à des cahiers des charges pointus. Vincent Boulard sait depuis longtemps (son père le lui avait prédit), qu’il travaille aujourd’hui à vendre du Calvados comme on vend du parfum. D’où le soin considérable apporté au packaging, d’où les carafes et les coffrets luxueux : les flacons, au look « parfum » en effet, atteignent des prix tropéziens pour des Calvados : jusqu’à 350€, comme le multivintage de Lecompte, le Boulard Extra ou le Père Magloire 35 ans d’âge. Certains flacons « top luxe » sont à l’étude, qui atteindront 500€ l’unité. Sans compter les éditions spéciales, les « coups », comme cette cuvée « Ike » (Eisenhower) : 15 exemplaires, dont deux ont été offerts à Barack Obama et à François Hollande le 6 juin prochain. Le reste (sauf un pour les archives) sera vendu au profit des vétérans du Débarquement de Normandie… « Notre chance a été de rechercher et de trouver un investisseur, afin de grandir encore davantage, qui ne soit pas un géant du whisky par exemple, car le petit Calvados s’y serait noyé. Avec Timour Goriaïev – qui nous laisse travailler -, comme avec Christophe Clavé, qui préside Spirit France, le souci est uniquement celui de hisser notre produit vers le Paradis ! », ajoute Vincent Boulard, « et de constituer un joli portefeuille de marques d’eaux-de-vie, ce que nous avons commencé de faire en créant ex-nihilo, en qualité de négociant, l’Armagnac Le Marque en 2012 ». L’homme d’affaires russe Timour Goriaïev, ancien patron des cosmétiques Kalina, qu’il vendit à Unilever, a effectivement pour objectif de faire entrer le Calvados dans l’univers du grand luxe. Il a racheté Pays d’Auge Finances (Boulard, Lecompte et Père Magloire), il y a sept ans, rebaptisé aussitôt l’entreprise Spirit France – l’intention de déborder du Calvados, comme on l’a vu, est claire. Et possède de facto le tiers de la production totale de Calvados. Plusieurs millions d’euros d’investissement ont été injectés dans la modernisation et l’agrandissement de l’outil : un chai gigantesque devrait par exemple être inauguré cette année à Reux, « afin d’anticiper l’accélération de notre développement », précise Vincent Boulard. En amont, l’effort porte sur la sélection drastique des pommes, afin de privilégier avec obsession les arômes des fruits sur le bois et l’alcool. Le chiffre d’affaires escompté de Spirit France est de 20 millions d’euros et plus. La clientèle atteinte est assez peu Normande. La Russie, la Scandinavie, les USA et le Canada, le Japon, la Chine timidement (un bureau a néanmoins été ouvert à Hong-Kong), sont les principaux clients de ces nouveaux Calvados de luxe, que l’on trouve également dans les boutiques des grands aéroports internationaux, ainsi que dans les « bars à calvados ». Le premier du genre propose près de 100 Calvados exclusivement, à l’hôtel Intercontinental Times Square de New York. Top classe !
Une démarche écologique
Tant de strass tranche avec l’accent mis sur l’agriculture raisonnée au château du Breuil. Propriété (de taille plutôt respectable, comparée aux domaines Drouin, ou Groult), de la puissante distillerie suisse Diwisa (vodkas, whiskies, tequilas, gin, etc), du Breuil garde une dimension humaine et naturaliste. Didier Bedu, son directeur, par ailleurs président de l’IDAC (l’interprofession des appellations cidricoles, qui organise notamment les Trophées internationaux des Calvados Nouvelle Vogue depuis 1997, dédiés aux cocktails), est aussi fier du respect de la parité dans l’entreprise, et de l’utilisation de produits 100% français (excepté les bouchons de liège !), qu’il l'est des ruches exerçant une action de pollinisation des vergers du domaine, des chevreuils et des sangliers qui s’y promènent, des cygnes du lac, et des grives du parc arboré qui conduit, au-dessus de la mythique rivière La Touques, jusqu’aux alambics et aux chais (avec quelques fûts de chênes normands !). Cette atmosphère ravit les 38 000 visiteurs annuels du domaine et sa boutique – ce qui en fait la 3ème entreprise touristique de la région, en termes de fréquentation. Au Breuil, nous trouvons aussi bien du Pommeau, un Calvados spécial, le « chocolate blend », conçu avec le chocolatier Michel Cluizel, qu’un Calvados confidentiel, dégusté au domaine, issu des meilleurs assemblages maison, vendu dans une carafe en cristal St-Louis, et qui vaut la bagatelle de 2 250€. De quoi tomber dans les pommes. L.M.
-----
(*) Concours international qui fait partie des World Drinks Awards et qui réunit un jury de professionnels chargés de déguster à l’aveugle. Le Calvados Roger Groult fait partie du club Vignobles & Signatures.
ENCADRÉ
"Y'EN A AUSSI"…
AOC Calvados Pays d’Auge. La plus prestigieuse des trois appellations concernées par l’eau-de-vie normande élaborée à partir de pommes à cidre (29% de la production totale de Calvados), L’AOC Calvados représente 70% de la production et l’appellation Calvados Domfrontais, 1%. Cette dernière produit le Poiré, à base de poires, tandis que les deux autres se concentrent sur quelque 200 variétés de pommes douces (comme la Noël des champs, et la Bedan), douces-amères (le Bisquet, le Moulin à vent), acidulées (la Rambaud, l’Avrolle), amères (Antoinette, le Fréquin rouge, Marie Ménard), même si la plupart des domaines n’utilisent qu’une quarantaine de variétés. « Le Calvados du Domfrontais est une eau-de-vie (distillation simple, alambic à colonne) qui doit contenir 30% de poires (le reste en pommes) », précise Guillaume Drouin, « mais elle en comporte souvent davantage. Très fuitée, plus montante, ses arômes nous parlent très vite : c’est un Calvados droit et franc. Tandis qu’en Pays d’Auge (double distillation obligatoire), le Calvados est plus assis, plus lent à venir car plus complexe, plus souple, plus sage, sur la rondeur ». L.M.
SELECTION /DÉGUSTATION
Château du Breuil XO 20 ans d’âge
La Réserve des Seigneurs (XO 20 ans d’âge) est l’expression du savoir-faire de ce domaine soucieux du respect de la nature. Equilibre, palette aromatique large et rondeur charnue n’empêchent pas souplesse et grande longueur. 65€
Christian Drouin 1993
Ce calvados, qui remporta le prix du meilleur producteur européen de spiritueux, devant cognacs et whiskies, est aussi discret qu’élégant, avec ses arômes beurrés, pâtissiers, et aussi de cire, de tilleul, miellés et un chouia botrytisés (il séjourna dans d’anciens fûts du château Guiraud, sauternes réputé) – un régal ! 92€
Boulard Extra
C’est d’un calvados exigeant qu’il s’agit, car son élégance et sa subtilité attendent une réponse à notre adresse. Gourmand, il est aussi complexe : notes de caramel, de vanille, de violette, d’amande douce et de tarte Tatin soutenues 390€
Roger Groult Vénérable
Le calvados signature de la maison (élu 2ème meilleur calvados du monde cette année), élaboré à partir d’eaux-de-vie de plus de 18 ans d’âge, est un miracle d’élégance et de finesse, de féminité et de subtilité aromatique, avec la douceur de la pomme cuite et une touche de pain d’épices en finale, ainsi que des notes florales, boisées et un fruité pulpeux et croquant à la fois, mais légèrement acidulé aussi : la quintessence (à prix encore doux). 70€
Lecompte multivintage (1988, 1989, 1990) :
Le plus expressif de cette marque d’initiés : élégant, « très calvados », sur le fruit donc, aucune aspérité, fin, avec la touche indispensable de pomme confite en arrière-bouche. 250€

Il est paru. Outre les Bordeaux primeurs et un tour de France des vignobles (lire deux extraits ci-dessous), ce hors-série de 100 pages piloté par Philippe Bidalon, propose une large sélection estivale de champagnes (blancs et rosés), et de vins rosés scrupuleusement triés. J'y signe par ailleurs un reportage sur le Calvados (à lire plus tard), entre autres réjouissances. On peut également y découvrir une enquête sur le prix du foncier dans le vignoble, ainsi qu'un papier sur ces vins étranges qui vieillissent quelque temps sous la mer... Allez, tous au kiosque!
LA MAISON DE NÉGOCE QUI MONTE LIONEL OSMIN et Cie
 Béarnais pur manseng (petit et gros), Lionel Osmin, qui se définit comme un « passeur de vins » - la philosophie du rugby n’est pas loin -, a eu il y a quatre ans l’idée géniale de fédérer la palette des vins du grand Sud-Ouest, vaste région (aux 150 cépages quand même) en créant une société de négoce capable de proposer tous ses crus, de Marcillac à Irouléguy, de Jurançon à Cahors et de Gaillac à Bergerac en passant par Buzet et récemment l'Armagnac! Cette signature transversale fut une première régionale et devint vite un sacré booster pour l’ensemble de la profession, par trop éparpillée jusque là, avec un « chacun dans son coin » en guise de démarche déconcertante. L’idée germait dans la tête de Lionel Osmin depuis que le déclic s’était fait lors d’un stage chez le vigneron du Jurançon Charles Hours, son mentor. Il réunit alors cinq complices (la mention « et Cie » a du sens), dont Benoît Vettorel pour le marketing – l’homme qui a fait le succès phénoménal de Tariquet, et Damiens Sartori (un « faiseur de vins » de haut-vol), plus trois compères pour la force de vente : Jean Alain Ménard, Florian Abadie et Pierre Courdurié. Le pack court vers le succès en chinant, en révélant des talents, en accompagnant les vignerons jusqu’à l’essai entre les potes. Plusieurs gammes figurent au catalogue : Les Villas (vins de cépages, dont le fameux Chambre d’Amour, blanc moelleux -la photo ci-dessus a d'ailleurs été prise a la plage éponyme d'Anglet), les vins d’appellations, les grandes cuvées, qui allient cépages et terroirs, et les cuvées Estela, soit l’excellence des vins du Sud-Ouest mise en bouteilles selon des critères de qualité stricts. Et au premier rang desquels figurent l’authenticité, un sacré caractère, une attitude, une autre dimension en somme : celle d’un Sud-Ouest transcendé. Faites passer ! L.M.
Béarnais pur manseng (petit et gros), Lionel Osmin, qui se définit comme un « passeur de vins » - la philosophie du rugby n’est pas loin -, a eu il y a quatre ans l’idée géniale de fédérer la palette des vins du grand Sud-Ouest, vaste région (aux 150 cépages quand même) en créant une société de négoce capable de proposer tous ses crus, de Marcillac à Irouléguy, de Jurançon à Cahors et de Gaillac à Bergerac en passant par Buzet et récemment l'Armagnac! Cette signature transversale fut une première régionale et devint vite un sacré booster pour l’ensemble de la profession, par trop éparpillée jusque là, avec un « chacun dans son coin » en guise de démarche déconcertante. L’idée germait dans la tête de Lionel Osmin depuis que le déclic s’était fait lors d’un stage chez le vigneron du Jurançon Charles Hours, son mentor. Il réunit alors cinq complices (la mention « et Cie » a du sens), dont Benoît Vettorel pour le marketing – l’homme qui a fait le succès phénoménal de Tariquet, et Damiens Sartori (un « faiseur de vins » de haut-vol), plus trois compères pour la force de vente : Jean Alain Ménard, Florian Abadie et Pierre Courdurié. Le pack court vers le succès en chinant, en révélant des talents, en accompagnant les vignerons jusqu’à l’essai entre les potes. Plusieurs gammes figurent au catalogue : Les Villas (vins de cépages, dont le fameux Chambre d’Amour, blanc moelleux -la photo ci-dessus a d'ailleurs été prise a la plage éponyme d'Anglet), les vins d’appellations, les grandes cuvées, qui allient cépages et terroirs, et les cuvées Estela, soit l’excellence des vins du Sud-Ouest mise en bouteilles selon des critères de qualité stricts. Et au premier rang desquels figurent l’authenticité, un sacré caractère, une attitude, une autre dimension en somme : celle d’un Sud-Ouest transcendé. Faites passer ! L.M.
www.osmin.fr
UNE RÉUSSITE EXCEPTIONNELLE LA FAMILLE PERRIN
 Voilà cinq générations et plus d’un siècle que la famille Perrin fait rayonner les vins de la Vallée du Rhône. D’abord dans son propre terroir et à présent dans plus de quatre-vingts pays. C’est d’une famille soudée, nombreuse, où chacun tient son rôle dans l’entreprise prospère qu’il s’agit. Jacques, le fondateur, avait initié une manière de faire et surtout une façon d’appréhender la nature et le travail de la vigne dans son ensemble qui semblent visionnaires, à l’heure du tout bio et du tout nature. Le magazine britannique spécialisé dans le vin « Decanter » a d’ailleurs élu en mars dernier la famille Perrin personnalité de l’année 2014, notamment pour son activité pionnière en termes d’agriculture biologique (depuis 1950) et biodynamique (dès 1974). Jean-Pierre et François Perrin, ses héritiers, poursuivent ce travail de respect sur ses terres de l’ensemble de cette merveilleuse vallée rhodanienne, côté sud, de Chateauneuf-du-Pape (avec le château de Beaucastel) à Tavel, de Vacqueyras à Cairanne, des Beaumes-de-Venise à Gigondas (avec le clos des Tourelles) en passant par Vinsobres, mais aussi en côtes du rhône septentrionales (côté nord) avec la gamme Nicolas Perrin. Partout, chaque cépage est non pas subi mais dompté et sublimé. « Suivre ses idées au mépris parfois de celles des autres, c’est affirmer son identité, c’est aussi prendre le risque d’être incompris, voire d’être considéré comme marginal », déclarent Jean-Pierre et François. Force est de reconnaître que la pugnacité de cette famille a fait par exemple de La vieille Ferme –l’un des étendards de leur gamme, l’image même des vins du Rhône pour de nombreux consommateurs étrangers. Parmi les dernières activités « successfull » de cette famille très nature, et bien présente en Provence également, notons la collaboration de Marc Perrin - l'homme qui monte, dans le clan, et qui s'occupe déjà de Tablas de Paso Robles, le vignoble californien familial -, avec Brad Pitt et Angelina Jolie à la conception et à l'élaboration de leur célèbre côtes de provence rosé Miraval, classé parmi les 100 meilleurs vins du monde par un autre magazine influent, "The Wine Spectator". L.M.
Voilà cinq générations et plus d’un siècle que la famille Perrin fait rayonner les vins de la Vallée du Rhône. D’abord dans son propre terroir et à présent dans plus de quatre-vingts pays. C’est d’une famille soudée, nombreuse, où chacun tient son rôle dans l’entreprise prospère qu’il s’agit. Jacques, le fondateur, avait initié une manière de faire et surtout une façon d’appréhender la nature et le travail de la vigne dans son ensemble qui semblent visionnaires, à l’heure du tout bio et du tout nature. Le magazine britannique spécialisé dans le vin « Decanter » a d’ailleurs élu en mars dernier la famille Perrin personnalité de l’année 2014, notamment pour son activité pionnière en termes d’agriculture biologique (depuis 1950) et biodynamique (dès 1974). Jean-Pierre et François Perrin, ses héritiers, poursuivent ce travail de respect sur ses terres de l’ensemble de cette merveilleuse vallée rhodanienne, côté sud, de Chateauneuf-du-Pape (avec le château de Beaucastel) à Tavel, de Vacqueyras à Cairanne, des Beaumes-de-Venise à Gigondas (avec le clos des Tourelles) en passant par Vinsobres, mais aussi en côtes du rhône septentrionales (côté nord) avec la gamme Nicolas Perrin. Partout, chaque cépage est non pas subi mais dompté et sublimé. « Suivre ses idées au mépris parfois de celles des autres, c’est affirmer son identité, c’est aussi prendre le risque d’être incompris, voire d’être considéré comme marginal », déclarent Jean-Pierre et François. Force est de reconnaître que la pugnacité de cette famille a fait par exemple de La vieille Ferme –l’un des étendards de leur gamme, l’image même des vins du Rhône pour de nombreux consommateurs étrangers. Parmi les dernières activités « successfull » de cette famille très nature, et bien présente en Provence également, notons la collaboration de Marc Perrin - l'homme qui monte, dans le clan, et qui s'occupe déjà de Tablas de Paso Robles, le vignoble californien familial -, avec Brad Pitt et Angelina Jolie à la conception et à l'élaboration de leur célèbre côtes de provence rosé Miraval, classé parmi les 100 meilleurs vins du monde par un autre magazine influent, "The Wine Spectator". L.M.
www.familleperrin.com
Il est paru. C'est le nouveau hors-série de L'Express que j'ai eu le plaisir de co-réaliser (j'en suis l'un des deux rédacteurs en chef, avec Philippe Bidalon). Allez, Libérez-vous! Tous au kiosque! Pour que vive la presse écrite.
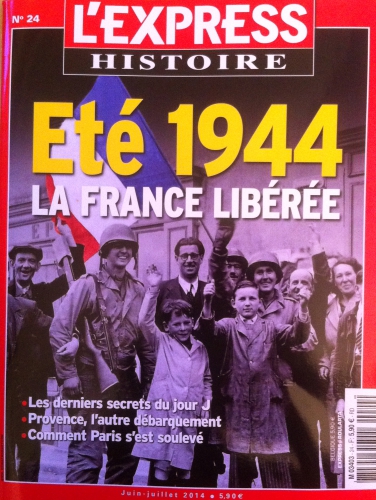
LA GUETTEUSE D’OMBRE
Papier paru dans Billebaude n°3 (éd. Glénat) il y a deux mois environ.

Il y a celles qui chassent, il y a celles qui plument et il y a celles qui savent. La chasse étant une affaire d’hommes, la majorité d’entre elles subissent plus qu’elles n’agissent. Ne parlons pas des Dianes puisqu’elles égalent les chasseurs. Elles sont animées du même feu sacré et elles utilisent une arme : fusil, arc, oiseau de proie ; chiens et cheval. Discrètes sous leur chapeau fin, tenant de leurs doigts minces un calibre vingt, et qui vous décrochent une palombe à limite de portée, qui font mouche avec l’air de ne pas y toucher et cela sans commentaire. Avec juste un léger sourire de satisfaction et un regard qui cherche –quand même- l’approbation sous la frange.
Le gros bataillon féminin est formé de celles qui en ont marre.
Marre, de septembre à janvier, quand ça ne leur prend pas avant et que ça ne dure pas jusqu’à la fin du printemps, de ne jamais passer un dimanche tranquille avec leur homme, à faire la grasse matinée et à paresser toute l’après-midi. Le petit-déjeuner au lit ne sera jamais la tasse de thé de l’homme de chasse. Il faut s’y résoudre.
Marre de plumer et d’écorcher le jeudi, de cuisiner le vendredi et d’écouter, au cours des redoutés repas de chasse, pour la mille et unième fois, les mêmes histoires, le dernier lièvre de montagne, le premier doublé de bécasses du côté d’Ahetze, et le gros sanglier que l’on a laissé passer du côté de Lapitxuri, à Dancharia. Elles se contentent alors de corriger les menteurs. Elles rectifient le tir. Et finissent par être dégoûtées de la chasse et des chasseurs, de leurs armes et de leurs chiens, des dimanches de solitude et de leur ennui de plomb, des nuages de plumes et du sang dans l’évier ; et il n’y a pas jusqu’au parfum du thym dont elles bourrent le cul du garenne pour parvenir à leur faire oublier qu’elles sont à nouveau les marquises aux repas des quatre-vingts chasseurs. Pour le banquet du samedi soir. Rares sont celles qui ont accompagné leur dingue de mari ou d’amant au moins une fois. Et j’en connais deux ou trois qui ont fini par adhérer au rassemblement des opposants à la chasse. Une manière de divorcer en réduisant la communauté aux aguets. Dans l’air conjugal, tendu comme le ressort d’une gâchette, flottent alors le soupçon et la trahison. Le doigt sur la détente à pétition, elles vous pointent de l’autre dès que vous vous sentez droit dans vos bottes vertes. Dès lors, gare au jour où ce ne sera plus du thym qui parfumera le lapin.
*
Il y a enfin les renardes. Celles qui ne porteront jamais une arme mais qui chassent autant que celui qu’elles accompagnent plus qu’elles ne suivent. Parce qu’elles savent. Elles ont compris. Compris que la chasse valait mieux que la prise.
J’en sais une qui ne dort plus dès la fin du mois de juin parce qu’elle passe ses nuits en forêt à écouter les chevreuils. C’est le temps du rut. Elle vit les yeux plantés dans les jumelles, les nuits de pleine lune, à chaque aube, et elle exulte au moindre bruissement de fougères pour l’aboiement d’un brocard ivre d’amour, pour la fuite suave d’une chevrette assouvie. C’est une guetteuse d’ombre, dans l’esprit où l’entendait Pierre Moinot.
Elle accompagne son homme de chasse dans ses marches de sauvage. Elle se lève avant le jour pour le plaisir de l’aube. Souvent avant lui. À son contact, elle a appris à reconnaître les oiseaux selon leur vol, leur plumage, leur taille, leur envergure et leur silhouette ; elle sait aussi reconnaître une trace de daguet de celle d’un vieux cerf. Elle a appris surtout à aimer les oiseaux comme lui. Elle a acquis les réflexes du regard et de la dissimulation. Elle est devenue renarde. Elle chasse de tout son être. Il a réussi à lui inoculer cette passion que son grand-père lui avait lui-même transmise. Lorsqu’ils chassent ensemble, avec pour arme un regard de rapace, leurs sens bandés comme des arcs, cette intimité dans la nature procède de leur amour. Elle en est l’ombre. Le soir venu, lorsqu’elle s’assoupit sur son épaule, elle exhale une tisane de parfums sauvages, un mélange de cèpe, de lichen et de paille brûlée, capable de le transporter –en rêve-, dans un sous-bois trempé d’automne et de faire apparaître une bécasse qui jaillit en chandelle entre deux troncs. En la respirant, il plonge dans ses forêts imaginaires. Elle l’a précédé dans ses rêves. Les yeux fermés, ils fuient le monde.
Léon Mazzella
Photo prise avec mon smartphone devant le château Saint-Maur, qui produit de très bons vins rosés à Cogolin (près de Saint-Tropez), et dont le domaine flambant neuf était inauguré hier soir, au cours d'une jolie fiesta.





 C’est la plus grande hêtraie d’Europe. A cheval sur la France (province basque de Soule) et l’Espagne (Navarre), avec ses 17 000 hectares, c’est une forêt certes exploitée mais très sauvage, où la profondeur du silence n’est troublée à l’automne que par le brame du cerf et le craquement d’une brindille sous le pas d’un chercheur de champignons ou plus rarement sous celui d’un chasseur de bécasse, eu égard à la pente du terrain, qui en rebute plus d'un. Les cèpes d’Iraty se conquièrent car la montagne s’apprivoise, mais celle-ci est relativement douce et la forêt correctement balisée. En octobre, elle se pare d’un mantille rouge, or, mordorée et brune qui n’a rien à envier au manteau forestier québécois. La forêt résonne de cervidés, sangliers et toutes sortes d’oiseaux (palombes, pics, vautours fauves, milans noirs et royaux, grues cendrées, passereaux divers, du pipit à la grive draine) la survolent. L’hiver, lorsque la neige recouvre les cols et le sol de la forêt, Iraty propose 4 pistes de ski de fond (35 km au total) ainsi que des itinéraires balisés pour les randonnées en raquettes : un must ! Se promener une journée dans la forêt en raquettes à la recherche des traces laissées par les animaux sur « le livre de la neige » est un pur bonheur. Le reste de l’année, les sentiers de randonnées sont nombreux en forêt (80 km de pistes forestières au total) et sur les crêtes. Une balade classique mène au Pic des Escaliers, une autre conduit au majestueux Pic d’Orhy (2017m, le point culminant), via la route des cols de chasse à la palombe : Millagate, Odixar, Tharta ou encore Sensibil. On trouve également le GR10 au départ des Chalets d’Iraty. Non loin de là se trouve la crête douce d’Orgambidexka, le « col libre », qui sert de site d’observation privilégié pour les ornithologues en herbe drue –il est situé sur un vrai couloir migratoire. Les amateurs de pêche (omble chevalier, ou saumon de fontaine, truite arc-en-ciel) peuvent s’exercer sur les deux petits lacs d’Iraty-Soule et Iraty-Cize ou bien tenter leur chance, à la mouche, dans la rivière Irati, où les truites farios donnent de la soie à retordre (carte et timbre halieutique en vente aux Chalets). Enfin, les ennemis du silence et de la lenteur peuvent se livrer aux joies du VTT (location sur place) afin de décharger un trop plein d’énergie. Iraty c’est tout cela et bien plus encore. Car c’est un site d’une grande poésie où l’on ressent profondément l’âme du Pays basque dan sa partie la plus âpre ; la Soule. L.M.
C’est la plus grande hêtraie d’Europe. A cheval sur la France (province basque de Soule) et l’Espagne (Navarre), avec ses 17 000 hectares, c’est une forêt certes exploitée mais très sauvage, où la profondeur du silence n’est troublée à l’automne que par le brame du cerf et le craquement d’une brindille sous le pas d’un chercheur de champignons ou plus rarement sous celui d’un chasseur de bécasse, eu égard à la pente du terrain, qui en rebute plus d'un. Les cèpes d’Iraty se conquièrent car la montagne s’apprivoise, mais celle-ci est relativement douce et la forêt correctement balisée. En octobre, elle se pare d’un mantille rouge, or, mordorée et brune qui n’a rien à envier au manteau forestier québécois. La forêt résonne de cervidés, sangliers et toutes sortes d’oiseaux (palombes, pics, vautours fauves, milans noirs et royaux, grues cendrées, passereaux divers, du pipit à la grive draine) la survolent. L’hiver, lorsque la neige recouvre les cols et le sol de la forêt, Iraty propose 4 pistes de ski de fond (35 km au total) ainsi que des itinéraires balisés pour les randonnées en raquettes : un must ! Se promener une journée dans la forêt en raquettes à la recherche des traces laissées par les animaux sur « le livre de la neige » est un pur bonheur. Le reste de l’année, les sentiers de randonnées sont nombreux en forêt (80 km de pistes forestières au total) et sur les crêtes. Une balade classique mène au Pic des Escaliers, une autre conduit au majestueux Pic d’Orhy (2017m, le point culminant), via la route des cols de chasse à la palombe : Millagate, Odixar, Tharta ou encore Sensibil. On trouve également le GR10 au départ des Chalets d’Iraty. Non loin de là se trouve la crête douce d’Orgambidexka, le « col libre », qui sert de site d’observation privilégié pour les ornithologues en herbe drue –il est situé sur un vrai couloir migratoire. Les amateurs de pêche (omble chevalier, ou saumon de fontaine, truite arc-en-ciel) peuvent s’exercer sur les deux petits lacs d’Iraty-Soule et Iraty-Cize ou bien tenter leur chance, à la mouche, dans la rivière Irati, où les truites farios donnent de la soie à retordre (carte et timbre halieutique en vente aux Chalets). Enfin, les ennemis du silence et de la lenteur peuvent se livrer aux joies du VTT (location sur place) afin de décharger un trop plein d’énergie. Iraty c’est tout cela et bien plus encore. Car c’est un site d’une grande poésie où l’on ressent profondément l’âme du Pays basque dan sa partie la plus âpre ; la Soule. L.M.
Photos © CDT64. www.tourisme64.com
Dormir, manger :
Chalets d’Iraty : location de chalets (de 2 à 30 places). www.chalets-iraty.com. Honnête restaurant à proximité (centre).
Chalet Pedro. Une institution en pleine forêt et à cheval sur la rivière Irati. Gîte confortable, restaurant classique et typique, grande terrasse avec le son du torrent , accueil formidable d’Isabelle www.chaletpedro.com
A Larrau, chez Etchemaïté. Autre institution. Hôtel très correct. Restaurant réputé (cuisine basque généreuse, tendance gastro) www.hotel-etchemaite.fr.
A St-Jean-Pied-de-Port, Les Pyrénées, Arrambide père et fils : Hôtel (Relais & Châteaux). Le grand restaurant de l’arrière-pays basque www.hotel-les-pyrenees.com
Carte : TOP25 d’IGN 1346ET. Forêt d’Iraty/Pic d’Orhy.
Equipement :
Vêtements discrets, de pluie, chauds, bonnes chaussures de marche, jumelles, lunettes de soleil, gourde, couteau.
 Ardi gasna (fromage de brebis des bergers du cru, achetez-le chez Mayté, le spécialiste du jambon Ibaïona, qui est excellent, à St-Jean-le-Vieux, avant de monter). Irouléguy (passez chez Jean et Martine Brana à St-Jean-Pied-de-Port et prenez aussi la prune ou la poire, pour la flasque). Pain (si vous montez par l'autre côté, prenez la fougasse -pas trop cuite- à Tardets, dans le virage à la sortie).
Ardi gasna (fromage de brebis des bergers du cru, achetez-le chez Mayté, le spécialiste du jambon Ibaïona, qui est excellent, à St-Jean-le-Vieux, avant de monter). Irouléguy (passez chez Jean et Martine Brana à St-Jean-Pied-de-Port et prenez aussi la prune ou la poire, pour la flasque). Pain (si vous montez par l'autre côté, prenez la fougasse -pas trop cuite- à Tardets, dans le virage à la sortie).
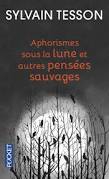 Lire : le must de la poésie de Philippe Jaccottet : L'encre serait
Lire : le must de la poésie de Philippe Jaccottet : L'encre serait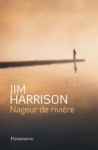 de l'ombre (Poésie/Gallimard), Aphorismes sous la lune, de Sylvain Tesson (Pocket), le dernier livre (deux novelas, genre où il excelle) de (Big) Jim Harrison, et qui arrive ce matin en librairie : Nageur de rivière (Flammarion), ou encore un ou deux classiques comme un bon Thoreau (Walden), et La rivière du sixième jour, de Norman McLean (Points) qui devint Et au milieu coule une rivière, au cinéma.
de l'ombre (Poésie/Gallimard), Aphorismes sous la lune, de Sylvain Tesson (Pocket), le dernier livre (deux novelas, genre où il excelle) de (Big) Jim Harrison, et qui arrive ce matin en librairie : Nageur de rivière (Flammarion), ou encore un ou deux classiques comme un bon Thoreau (Walden), et La rivière du sixième jour, de Norman McLean (Points) qui devint Et au milieu coule une rivière, au cinéma.
C'est un papier que je publie dans le magalogue (magnifique) de Voyageurs du Monde consacré à l'Amérique Latine :

C’est une cuisine forte en gueule et régressive, davantage terrienne que maritime. Toujours relevée, elle flirte avec le sucré, privilégie le mou au dur et le convivial au chichiteux. Certains plats emblématiques sont éloquents, reflètent les traits des deux cultures dont cette gastronomie est issue –d’un côté l’Ibérique et de l’autre un bouquet de traditions locales de chaque pays d’Amérique du Sud. Prenons les Moros y Cristianos ou Congricubains, un classique que l’on retrouve au Nicaragua et au Costa-Rica sous le nom de Gallo pinto et encore de Pabellon criollo au Venezuela et de Rice and beans à Belize. Il est composé de haricots noirs et de riz blanc servis à parts égales mais séparées dans l’assiette. Celui qui les mange les mélange : il « métisse » ainsi moros, les Maures (par extension, les noirs venus d’Afrique) et cristianos, chrétiens blancs venus d’Espagne et du Portugal. Voilà qui donne du sens et exprime un esprit d’ouverture. Cette cuisine est fondée sur une poignée de produits faciles à préparer ou à transformer et dont la vocation roborative rappelle le travail paysan. Elle est humble ; pas pauvre. Son ingénue simplicité la rend touchante. Elle n’est pas figée, plus nutritive qu’inventive ; jamais « light ». Les produits essentiels avec lesquels elle jongle peu parlent d'eux-mêmes : ainsi du maïs, de la patate douce, présents dans de nombreux plats mexicains –pays dont les traditions culinaires dominent le continent. Du tubercule du manioc, ou Yuca, largement utilisé dans les pays andins : Colombie, Pérou, Bolivie. « Chipsé », il donne les Yucas fritas d’Equateur. Au rayon herbes, Maté (Argentine) et Epazote (Mexique) sont aussi essentielles que notre persil. Certains mélanges d’épices (cumin, coriandre) comme le Recado sont typiques du Guatemala. Quant aux piments forts, ils agrémentent systématiquement chaque plat, de la Patagonie au Panama. Les spécialités ayant conquis le monde sont légion. Il n’est qu’à citer les Fajitas (symbole de la cuisine tex-mex), les Empanadas (chaussons farcis de viandes et d’herbes aromatiques), les Tortillas diverses (galettes de maïs), comme les Totopos mexicaines (tortilla chips), les Enchilladas (pimentées), ou encore les Tostones (chips de banane plantain porto-ricaines) et les Tamales de elote (crêpes de maïs honduriennes), pour se convaincre du succès d’une cuisine quotidienne. Sans même évoquer le Guacamole (Mexique, à base d’avocat) et le Chumichuri, cette sauce argentine (ail, cayenne, oignon, persil, origan, huile, vinaigre), qui agrémente les viandes grillées –à commencer par l’excellent bœuf. Parmi les plats familiaux exprimant la fusion des deux cultures fondatrices, les Caldos et autres Cocidos sont omniprésents (ragoûts à base de viande en sauce, de légumes et de patates), comme le Tlalpeño mexicain (poulet, pois chiches, piments, avocat, epazote), ou l'intact Arroz con pollo (riz au poulet) qui a fait le tour de la planète hispanophone, avec le Puchero, sorte de pot-au-feu que l'on trouve notamment au Nicaragua et à Cuba. Equateur et Pérou aiment faire mariner les produits de la mer. Cela donne les Ceviches (crevettes ou poissons crus, citron, épices, ail). La Colombie se plait à concocter des soupes épaisses comme l'Ajiaco bogotano, à base de poulet, patates, légumes, épices, sauce piquante. Le poulet est plus volontiers cuisiné en escabèche au Guatemala. Au Panama, riz et noix coco râpée escortent des spécialités comme le Sancocho (ragoût de poulet très épicé) et la Ropavieja (soupe de bœuf épicée). Aux Honduras, on cuisine avec maestria les fruits de mer, en particulier les Curiles (bouillons de coquillages), les ragoûts généreux comme le Nacatamales (poulet ou porc et légumes en sauce) et le Yuca con chicharron (porc grillé) y mondongo (tripes). Quant au chocolat, excellent au Costa-Rica et en Equateur, il constitue la base de nombreux desserts. En sauce, il dompte les fricassées à base de porc, de canard ou de lapin avec une salutaire douceur. Une autre forme de métissage. L.M.
http://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/Img/brochures/Voyageurs-Amerique-Latine.html
C'est ce que l'on appelle de la bonne came. Celle que je conseille aux journalistes en herbe que sont mes étudiants en
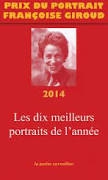
 presse écrite, cette matière en passe d'appartenir à l'archéologie du savoir. Cent portraits parmi les meilleurs parus dans Le Monde sur sept décennies (Pocket, 1000 pages!) - parce qu'il n'y a pas que ceux (excellents, souvent) de la dernière page de Libé. Le portrait, genre très prisé, fut "importé" (des USA vers la France) par Françoise Giroud. D'ailleurs, un prix à son nom récompense le meilleur portrait paru dans la presse écrite, et le millésime 2014, avec dix portraits cousus main, paraît (à La petite vermillon), et c'est encore de la bonne came, pour tous ceux qui aiment ce genre journalistique infiniment littéraire, qui produit de l'histoire à la dimension de l'individu, selon l'expression de Fernand Braudel. Il y a les stars, les inconnus célèbres, les parfaits inconnus qui possèdent de la matière, du jus, un destin brisé ou un quart d'heure de célébrité, de quoi alimenter la narration d'un papier. Il y a des écrivains, des héros, des sportifs de haut niveau, des hommes et des femmes d'Etat, des rock stars, des acteurs, des actrices, des patrons et des paysans, des SDF et des géants de l'immobilier ou de l'architecture. Tous sont matière à aiguiser les sens, à affûter les stylos, à éveiller les dessous de l'être, la face cachée, la part intime, la faille, ce fameux regard fragile, cette moue qui en dit long en observant un silence captivant, que le journaliste guette, provoque, accouche. Tous les portraits que nous pouvons lire dans ces deux ouvrages ont alimenté l'histoire immédiate et ont permis, permettent de mieux lire, de mieux comprendre le cours de la grande histoire. Et puis il y a des signatures : les auteurs de ces portraits retenus ici, et là, sont des plumes, comme on dit dans le jargon. Des encartés de respect. Des femmes et des hommes professionnels qui savent traduire une rencontre, car un bon portrait dans le journal est le condensé d'une rencontre, avec tout le poids qu'il faut donner à ce mot, par trop galvaudé. Une rencontre, oui, mais toujours avec ce qu'il faut d'indispensable distance par rapport au sujet, condition sine qua non afin de faire du journalisme vrai, sans empathie excessive, avec la compréhension idoine, la sensibilité non feinte mais retenue, la traduction précise, au plus près, de la vérité de l'autre, au service duquel nous restons - en presse écrite... Les portraits que nous lisons dans ces deux ouvrages sont comme autant de mini nouvelles, des shorts comme on dit outre-Manche, des condensés d'existence, des morceaux d'anthologie, comme on le dit de celui du boucher. De la bonne came, je vous dis.
presse écrite, cette matière en passe d'appartenir à l'archéologie du savoir. Cent portraits parmi les meilleurs parus dans Le Monde sur sept décennies (Pocket, 1000 pages!) - parce qu'il n'y a pas que ceux (excellents, souvent) de la dernière page de Libé. Le portrait, genre très prisé, fut "importé" (des USA vers la France) par Françoise Giroud. D'ailleurs, un prix à son nom récompense le meilleur portrait paru dans la presse écrite, et le millésime 2014, avec dix portraits cousus main, paraît (à La petite vermillon), et c'est encore de la bonne came, pour tous ceux qui aiment ce genre journalistique infiniment littéraire, qui produit de l'histoire à la dimension de l'individu, selon l'expression de Fernand Braudel. Il y a les stars, les inconnus célèbres, les parfaits inconnus qui possèdent de la matière, du jus, un destin brisé ou un quart d'heure de célébrité, de quoi alimenter la narration d'un papier. Il y a des écrivains, des héros, des sportifs de haut niveau, des hommes et des femmes d'Etat, des rock stars, des acteurs, des actrices, des patrons et des paysans, des SDF et des géants de l'immobilier ou de l'architecture. Tous sont matière à aiguiser les sens, à affûter les stylos, à éveiller les dessous de l'être, la face cachée, la part intime, la faille, ce fameux regard fragile, cette moue qui en dit long en observant un silence captivant, que le journaliste guette, provoque, accouche. Tous les portraits que nous pouvons lire dans ces deux ouvrages ont alimenté l'histoire immédiate et ont permis, permettent de mieux lire, de mieux comprendre le cours de la grande histoire. Et puis il y a des signatures : les auteurs de ces portraits retenus ici, et là, sont des plumes, comme on dit dans le jargon. Des encartés de respect. Des femmes et des hommes professionnels qui savent traduire une rencontre, car un bon portrait dans le journal est le condensé d'une rencontre, avec tout le poids qu'il faut donner à ce mot, par trop galvaudé. Une rencontre, oui, mais toujours avec ce qu'il faut d'indispensable distance par rapport au sujet, condition sine qua non afin de faire du journalisme vrai, sans empathie excessive, avec la compréhension idoine, la sensibilité non feinte mais retenue, la traduction précise, au plus près, de la vérité de l'autre, au service duquel nous restons - en presse écrite... Les portraits que nous lisons dans ces deux ouvrages sont comme autant de mini nouvelles, des shorts comme on dit outre-Manche, des condensés d'existence, des morceaux d'anthologie, comme on le dit de celui du boucher. De la bonne came, je vous dis.
Papier paru dans L'EXPRESS, hors-série La grande histoire du vin :
Traversé par un fleuve capital, tant sur le plan nourricier que commercial, le Val de Loire, avec ses 600 km de long et ses 68 appellation, est un monde viticole à lui tout seul. Par Léon Mazzella (textes et photos - prises volontairement en l'absence de vignes, mais toujours en bord de Loire).
-----
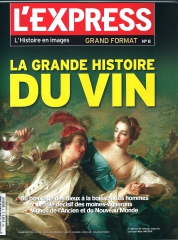 Lorsque Gargantua vint au monde, il s’écria : « A boire ! À boire ! ».Dans le jargon rabelaisien, un tel cri ne réclame pas un bol de Loire mais plutôt un verre de Chinon, en dépit de l’omniprésence bienfaitrice du fleuve-mère, à l’instar du Rhône dans d’autres vallées. Le Val de Loire englobe une grande mosaïque d’appellations plus prestigieuses les unes que les autres, qui courent du Pays Nantais au Centre-Loire, en passant par l’Anjou et la Touraine. Il n’est qu’à citer des noms magiques comme Sancerre, Savennières, Pouilly-Fumé, Côteaux du Loir, Muscadet, Vouvray, Montlouis-sur-Loire, Quarts de Chaume, Saumur-Champigny, Reuilly, Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Quincy pour s’en convaincre. Quatre cépages se taillent la part du lion : chenin et sauvignon côté blanc, cabernet-franc et gamay côté rouge. Treize autres sont néanmoins utilisés.
Lorsque Gargantua vint au monde, il s’écria : « A boire ! À boire ! ».Dans le jargon rabelaisien, un tel cri ne réclame pas un bol de Loire mais plutôt un verre de Chinon, en dépit de l’omniprésence bienfaitrice du fleuve-mère, à l’instar du Rhône dans d’autres vallées. Le Val de Loire englobe une grande mosaïque d’appellations plus prestigieuses les unes que les autres, qui courent du Pays Nantais au Centre-Loire, en passant par l’Anjou et la Touraine. Il n’est qu’à citer des noms magiques comme Sancerre, Savennières, Pouilly-Fumé, Côteaux du Loir, Muscadet, Vouvray, Montlouis-sur-Loire, Quarts de Chaume, Saumur-Champigny, Reuilly, Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Quincy pour s’en convaincre. Quatre cépages se taillent la part du lion : chenin et sauvignon côté blanc, cabernet-franc et gamay côté rouge. Treize autres sont néanmoins utilisés.
Si la région « pense Loire » et vit au rythme de son magnifique fleuve, elle est également imprégnée par la culture hédoniste de l’enfant du pays. Rabelais naquit vers 1494 à la Devinière, près de Chinon, et n’aura de cesse de vanter les bienfaits de la vigne, qu’il consommait sans modération. L’époque n’était pas regardante. « Le vin est ce qu’il y a de plus civilisé au monde », clamait-il avec la truculence que nous savons. La Loire d’un côté et Rabelais de l’autre : les nombreux vignerons du cru, ou plutôt d’une immense palette, possèdent deux vecteurs essentiels.
Avec 600 km et 68 appellations qui frisent l’Atlantique d’un côté et vont frapper aux portes de la Bourgogne de l’autre, le vignoble du Val de Loire est non seulement le plus long de l’Hexagone, mais également le plus complexe, eu égard à l’extraordinaire diversité de ses terroirs. L’Aubance, le Layon, la Sèvre nantaise désignent des affluents de la Loire évocateurs de beaux flacons.
« Nul n’est censé ignorer la Loire »
Comme partout, ce sont les légions romaines qui introduisirent ici la vigne. Pline
 Si « la Loire coule de source », selon un mot fameux, ou bien –selon un jeu de mots, si « Nul n’est censé ignorer la Loire », il faut encore savoir que sans son cheminement au gré du vallon qu’elle creuse en s’élargissant plus ou moins, et où elle sinue, s’insinue, irrigue, aère à qui mieux mieux, selon que l’on se situe dans le Val d’Anjou, ou vers Ponts-de-Cé et Angers, le vignoble ne serait pas ce qu’il est.
Si « la Loire coule de source », selon un mot fameux, ou bien –selon un jeu de mots, si « Nul n’est censé ignorer la Loire », il faut encore savoir que sans son cheminement au gré du vallon qu’elle creuse en s’élargissant plus ou moins, et où elle sinue, s’insinue, irrigue, aère à qui mieux mieux, selon que l’on se situe dans le Val d’Anjou, ou vers Ponts-de-Cé et Angers, le vignoble ne serait pas ce qu’il est.
Rares sont les régions d’appellations, les zones de production d’importance majeure à présenter une telle variété de vins. En effet, le Val de Loire offre toutes les couleurs de la palette vins et toutes les variétés de la planète vins. Qu’on en juge : nous trouvons des vins blancs secs et demi-secs. Des vins liquoreux et moelleux. Des vins pétillants.Des vins rosés. Des vins rouges enfin. Ce très large choix est une richesse exceptionnelle.
Les vins de Loire sont ainsi, qui se définissent comme des vins ayant un fleuve pour terroir : ce fleuve dont la largeur est légendaire, a creusé son lit pour mieux irriguer des sols d’une variété et d’une richesse rares, et pour donner naissance à une grande diversité de terroirs, sur lesquels une mosaïque d’appellations prospèrent, en élaborant des vins à partir d’une gamme de cépages unique au monde et pour la plupart vernaculaires.
terroir : ce fleuve dont la largeur est légendaire, a creusé son lit pour mieux irriguer des sols d’une variété et d’une richesse rares, et pour donner naissance à une grande diversité de terroirs, sur lesquels une mosaïque d’appellations prospèrent, en élaborant des vins à partir d’une gamme de cépages unique au monde et pour la plupart vernaculaires.
Une longue palette de vins
Ajoutons à cela le rôle géopolitique fondamental de la Loire dans l’essor du commerce des vins de cette immense région de production viticole et nous tenons, en du Val de Loire, l’expression de la diversité, de la variété, du choix et avant tout de la qualité. Sur un vaste territoire, le vignoble bénéficie avec superbe de plusieurs additions : celle d’influences climatiques distinctes, et de celle des sols qui s’y trouvent. Les vins y sont par conséquent terriblement expressifs.

La douceur angevine
Puisque la Loire et sa région sont propices aux adages et autres bons mots, qui ne connaît pas la fameuse expression de « douceur angevine » ? Celle-ci désigne le climat qui domine en Anjou-Saumur, et qui est de type océanique tempéré, avec de si faibles amplitudes qu’il semble incapable de faire le moindre grand écart. Si les vents venant surtout de l’Océan sont par essence humides car porteurs de précipitations grâce à l’effet de foehn, le vignoble est protégé par les contreforts de la région de Cholet et des Mauges. Si bien que l’hygrométrie est très différente d’un versant du coteau à l’autre. Ainsi, la douceur angevine s’exprime-t-elle en accueillant par exemple une végétation caractéristique des régions du Sud. Autant d’atouts pour que la vigne s’épanouisse avec bonheur. L.M.
LIQUOREUX MYTHIQUES
Avec Quart-de-Chaume et Bonnezeaux, Savennières est l’un des trois Grands Crus de l’Anjou viticole. Confidentielle, cette appellation prestigieuse produit de grands blancs qui étaient déjà célébrés par Curnonsky, « le prince des gastronomes ».
-----


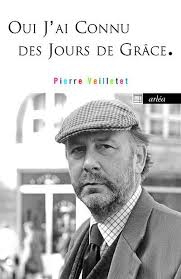
... 'tain, pile un an déjà que Pierre Veilletet s'est fait la malle. Ca va trop vite. Lisez-le, relisons-le. Cela fait toujours un bien fou. Reprendre au hasard Querencia et picorer, lire un chapitre du Vin, leçon de choses, ouvrir Mari-Barbola et éprouver la sensation proustienne de se faire embarquer par la phrase plus sûrement que par une vague... Ce matin, je saisis La Pension des nonnes, car j'évoquais Gênes hier soir. En duo avec La forme d'une ville - le Nantes de Julien Gracq, car j'en fis en 1985 l'un de mes premiers papiers littéraires importants publié dans "Sud-Ouest Dimanche" - que P.V. pilotait alors (qu'à la suite de ce papier, reproduit ci-dessous, j'entamai une relation épistolaire avec J.G. qui ne cessa qu'à sa mort en 2007), que je me trouvais récemment dans cette cité et que l'un et l'autre auteurs ont su parler des villes (Bordeaux, Séville, Rome...) comme personne. Il s'agit de lire comme on compose un repas, comme on examine la carte d'un restaurant, en établissant avec sens et précision la forme d'une fête à venir immédiatement, et lire PV et JG en alternance (pas en entrée puis en plat : ¡a tapear!) est une fête. A table!
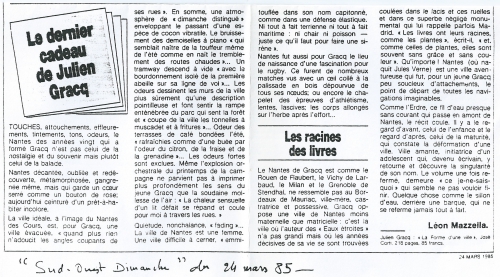
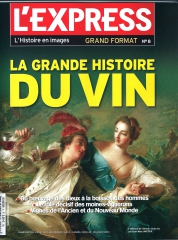 in L'EXPRESS hors-série La grande histoire du vin (en kiosque) :
in L'EXPRESS hors-série La grande histoire du vin (en kiosque) :
Italie
ANCIENNE, FERTILE ET GÉNÉREUSE
par Léon Mazzella
La Botte a toujours été généreuse en sang de la vigne. Avec près de 60 millions d’hectolitres, l’Italie assure, en ce début de XXIème siècle, près de 20% de la production mondiale de vins. C’est dire son poids économique. Et si elle produit de nos jours davantage de vins que n’importe quel pays au monde – en concurrence avec la France certaines années -, elle abreuvait déjà de ses volumes l’empire romain. Ce sont les Grecs qui introduisirent la viticulture en Italie au VIIIè siècle av. J.-C. La Grande Grèce englobe alors l’Italie du Sud et la Sicile et ce sont les Eubéens (de l’île d’Eubée, en mer Egée, en face de l’Attique), qui s’installent les premiers dans leurs colonies, en Italie méridionale précisément, avec des cépages antiques comme le byblinos ou l’aminios – ce dernier est, par excellence, celui des crus romains, et il fut planté initialement en Calabre. Les Eubéens pratiquent la viticulture depuis plus d’un siècle sur leur île. Les colonies italiennes bénéficient aussitôt d’un essor de leur nouvelle économie et, très vite, les îles du Golfe de Naples, notamment Ischia - toujours célèbre pour ses vins blancs légers et gourmands, issus de cépages (actuels) comme les biancollela, falanghina et autre forastera – ainsi que la ravissante Procida – alors couverte davantage de vignes que de citronniers, comme aujourd’hui -, produisent leurs propres amphores afin d‘expédier leur vin à Carthage, ce dès le VIIè siècle av. J.-C. Les textes fondateurs des poètes latins, comme Virgile et Pline l’ancien, s’inspirent largement du savoir-faire grec. « Les Géorgiques », de Virgile, et l’« Histoire naturelle », de Pline, consignent avec force précisions les préceptes de cette nouvelle activité et fournissent ainsi de véritables manuels de viticulture aux agriculteurs italiens de la fin de la République et sous l’Empire. Ces textes seront des références pour le monde viticole européen dans son ensemble, des siècles durant. Leur ton direct et tutoyant rend l’apprentissage et les travaux pratiques de la « conduite de la vigne » (selon l’expression de Pline), on ne peut plus agréables. Exemple, pris chez Virgile, à propos de la plantation des rangées de ceps : « Si tu traces l’emplacement du vignoble dans une plaine grasse, plante serré (…), mais si tu choisis le versant d’une côte mamelonnée ou des pentes douces, espaces généreusement tes rangées. » Voici qui correspond parfaitement au vignoble italien, lequel se répand à une vitesse prodigieuse et ne tarde pas à couvrir des zones aujourd’hui emblématiques de la carte viticole du pays, Sicile comprise, jusqu’au Latium –la région de Rome, ainsi qu’en Etrurie, le territoire des Etrusques, soit l’actuelle Toscane. Les vins étrusques, conservés dans des amphores « italiques », sont abondamment exportés, dès cette époque, dans la plupart des pays du Bassin méditerranéen, y compris en Gaule à partir du VIè siècle av. J.-C. Les légions romaines découvriront un velours côtelé de vignes lors de leurs campagnes militaires au sud de la Botte et en Etrurie, dès le IIIè siècle av. J.-C., d’après Pierre Sillières (*). La plupart des raisins sont destinés à la vinification, dans cette Italie antique qui suit peu à peu les préceptes de Caton, de Columelle (dont le traité « De l’agriculture » , « De re rustica » demeure le plus grand traité d’agronomie que nous ait transmis l’Antiquité), ou encore de Varron, qui publient des ouvrages dans lesquels nous trouvons déjà – entre autres - les moyens de lutter contre les petits fléaux (insectes, notamment), y compris contre le gel (en arrosant la vigne afin de la tiédir). Mais contre la grêle, l’invocation des dieux était l’unique recours du viticulteur italien… Certains vignerons pionniers, notamment sur la côte napolitaine, vers Pompéi et au-delà (où les fouilles révélèrent tant d’indices), passerillaient le raisin, ou bien le consommaient frais, ou encore le conservaient dans des pots, mais l’écrasante majorité du produit de la vigne était dûment fermenté, après avoir été foulé et pressuré. Selon les recherches effectuées par Pierre Sillières, la vinification (la transformation du moût en vin), s’effectue alors dans de grandes jarres en céramique appelées dolia, pouvant contenir 10 hl chacune, et rangées semi-enterrées dans les chais. Il est à noter que la distinction entre vins ordinaires et vins fins se fait immédiatement et que les premiers sont destinés à la plèbe et à l’armée tandis que les seconds, que les Italiens entreprennent de laisser vieillir dans des jarres, et puis qui sont « mis en amphores » (bien que le vieillissement s’effectue également en amphore), sont naturellement destinés à des classes sociales plus élevées. Selon un autre chercheur, André Tchernia (**), tous les vins réputés de l’Antiquité provenaient d’une aire qui allait de Rome à Pompéi, soit du Latium à la Campanie, en particulier sur l’ensemble de la plaine côtière et jusqu’aux contreforts du Vésuve. Les trois vins (secs et doux) les plus recherchés sont le falerne, le vin des monts Albains et le cacube. Les règles élémentaires du commerce du vin – le commerce de proximité comme l’exportation – se mettent en place : les vins simples et nécessitant un transport coûteux sont consommés sur place et les vins « de garde » ou déjà réputés sont repérés, achetés et acheminés par des négociants, dont l’activité sera très prospère au IIIè et au IIè siècles av. J.-C. Celle-ci reposera sur le transport en bateaux d’énormes quantités d’amphores à destination de la Gaule ou de l’Hispanie, mais celles-ci commenceront elles aussi à cultiver la vigne et à consommer par conséquent ses propres vins (lire par ailleurs). Mieux (ou pire, pour l’Italie), dès le Ier siècle ap. J.-C., souligne André Tchernia, non seulement les clients historiques de la viticulture italienne disparaissent mais ils ne tardent pas à concurrencer les vins de la Botte et à narguer celle-ci en y exportant leur propre production à Rome même ! La capitale de l’Empire devient d’ailleurs,à la faveur de son expansion rapide et colossale, un si grand consommateur de vins indigènes que les vignes de Campanie, du Latium et d’Etrurie, mais également de la région de Ravenne, de la côte adriatique et de la plaine du Pô, car on cultive dès lors la vigne un peu partout dans le pays, ne suffisent parfois pas à étancher la soif d’un million de Romains, évaluée à environ 1,8 million d’hl annuels. A la fin du Ier siècle ap. J.C., la culture de la vigne s’étend parfois au détriment de celle du blé. Il est à noter qu’à la faveur des écrits lumineux, voire visionnaires, de Columelle, qui était lui-même vigneron et possédait des vignes dans divers zones propices d’Italie, une classification des crus se fait jour au IIè siècle de notre ère, en fonction de critères qualitatifs : il est déjà question de terroir, de robustesse, de fécondité.
Une législation tardive
Les invasions barbares (Goths, Lombards) réduisirent la viticulture à néant. Il faut attendre les effets bénéfiques de la christianisation – surtout au Moyen-Age, puis ceux de la Renaissance (XIIIè siècle), pour observer un renouveau de la culture de la vigne, Comme une revanche, elle fut étendue à toutes les régions susceptibles de l’accueillir, qu’elles soient de plaine, de piémont ou côtières. Le XVIè siècle, après la chute des Médicis, qui connaît le règne des Habsbourg, n’est pas non plus favorable au développement de la viticulture. Le phylloxéra et la Seconde Guerre mondiale produisent les effets d’arrêt brutaux que nous savons dans la plupart des pays européens. Longtemps synonymes de vins de quantité et de moindre qualité, les vins italiens ne souffrent plus aujourd’hui de connotations négatives, mais le laxisme législatif - il a mis près de trente ans après la France à établir des classifications claires -, a retardé d’autant la reconnaissance des grandes appellations et des grands vins italiens, et dieu sait s’ils sont nombreux. En effet, l’après-guerre ne fut pas favorable au développement qualitatif des vins italiens. « Faire pisser la vigne » afin d’exporter de la « bibine » étaient plutôt les maîtres mots. Ce n’est qu’en 1963 qu’une loi de première importance, portant sur les normes de dénomination s d’origines des vins, jette les bases de l’organisation de la viticulture moderne italienne. Elle donnera naissance à la fameuse loi Goria de 1992, qui établit la nouvelle réglementation des dénominations d’origine. Celle-ci est relativement simple, et elle ressemble aux législations européennes en vigueur un peu partout au sein de la communauté : nous trouvons les DOC (Dénomination d’origine contrôlée), les DOCG (Dénomination d’origine contrôlée garantie), les IGT (Indication géographique typique), les vins de table (vini da tavola) et les VDN (Vins doux naturels). L’Italie compte vingt régions viticoles (comme autant de régions politiques). Du nord au sud et d’ouest en est :Val d’Aoste, Piémont, Ligurie, Lombardie, Trentin-Haut-Adige, Vénétie, Frioul-Vénétie-Julienne, Emilie-Romagne, Toscane, Ombrie, Marches, Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Pouilles, Calabre, Sardaigne et Sicile. Les vins les plus réputés se trouvent au nord de la Botte : Piémont et Toscane. Le Piémont est le royaume du cépage nebbiolo (rouge) qui donne les célèbres Barolo et Barbaresco. La Toscane viticole rime avec Chianti (Classico ou Ruffino) et évoque aussitôt un cépage principal (rouge), le sangiovese. Cette région viticole bénie des dieux évoque aussi l’une des plus célèbres appellations (DOCG) en vins rouges italiens, le Brunello di Montalcino . On désigne par ailleurs sous l’appellation non contrôlée de « super-toscans », des vins d’exception comme le célébrissime Sassicaia, ou les non moins célèbres Solaia, et Tignanello. La classification des vins italiens est plus commode si nous la divisons par genre : il y a les spumante (mousseux), les frizzante (pétillants), les amabile (demi-sec), les doux (dolce), les abboccato (mi demi-sec, mi demi-doux), les passito (passerillés), à côté de l’armée des secco (secs : blancs, rosés ou rouges). Outre le Chianti Classico, longtemps présent sur les tables des pizzerias du monde entier, dans un flacon rond et habillé de paille tressée, le Lambrusco (Emilie-Romagne) , est sans doute le vin le plus connu hors des frontières italiennes. Le fameux blanc Orvieto provient d’Ombrie, le Frascati (issu du cépage trebbiano), du Latium. Quant au Greco di Tufo, il contribue à la réputation des vins blancs de Campanie, connue également pour son Lacryma Christi del Vesuvio (blanc ou rouge). Le Montepulciano d’Abruzzo vient évidemment des Abruzzes. Enfin, les grandes îles (Sardaigne et Sicile) donnent des rouges puissants et charpentés (issus pour la plupart de cépage canonnau), ainsi que des blancs raffinés (issus principalement du cépage vermentino). L.M.
(*) « La viticulture et le vin dans l’Antiquité », in « Voyage au pays du vin », (ouvrage collectif, Robert Laffont)
(**) « Le vin romain antique », de A.Tchernia et J.P.Brun (Glénat).
Frénésie
L’érudit Suétone (Ier siècle de notre ère), en guise de commentaire à la décision de l’empereur Domitien, prise en 92, de donner un coup d’arrêt à la frénésie de consommation de vins italiens par les Romains, mais aussi par les Gaulois et les Ibères, écrit ceci : « La surabondance du vin et la pénurie du blé étaient l’effet d’un engouement excessif pour la vigne, d’où résultait l’abandon des labours. C’est pourquoi l’empereur interdit , en Italie, toute plantation nouvelle et ordonna, dans les provinces, d’arracher au moins la moitié des vignobles. »
---
Cité par Roger Dion dans sa fameuse histoire de la vigne et du vin en France, et repris par Jean-Robert Pitte, in « Le désir du vin à la conquête du monde » (Fayard).
in L'EXPRESS, hors-série La Grande Guerre (en kiosque):
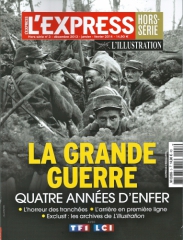 L’HORREUR AU QUOTIDIEN
L’HORREUR AU QUOTIDIEN
Par Léon Mazzella
D’abord il y a la mort. Omniprésente, pestilentielle, celle du copain déchiqueté sous les yeux du soldat, celle de l’ennemi, celle qui rôde, celle qui frappe sans prévenir, et que nul ne voit venir. Et puis il y a les « totos », ces poux qui grouillent et ne font pas davantage relâche que les puces, et de gros rats qui empêchent de dormir, dévorent tout, y compris les pieds et les nez des vivants. Il y a surtout la peur –cette indécollable peur au ventre, majuscule, chevillée, clouée, profonde et permanente. Qui a dit que les Poilus se faisaient parfois sous eux en jaillissant des tranchées quand il fallait y aller ? Pas les visuels rassurants des cartes postales, outil accessoire de propagande, qui montrent des soldats posant, souriants, sereins, lorsque la plupart crevaient de frousse et de maladie, agonisaient dans un trou, les jambes broyées et le cœur aussi, le corps gelé ou à demi noyé dans une boue aussi épaisse que de la crème de marrons. Même les livres emblématiques comme l’émouvant « Ceux de 14 » de Maurice Genevoix (1) disent l’horreur illimitée au quotidien, n’évoquent qu’avec tact et émotion contenue le sang, les tripes, les cris, les appels au secours, l’appel ultime à maman avant de basculer dans le néant. Lire « Sous Verdun », « La boue », « Les Eparges » (lire l’extrait ci-dessous), de Genevoix conjugue le plaisir du texte (il s’agit d’un grand moment de littérature) , et la sensation d’assister, in vivo, au quotidien du Poilu auquel Genevoix nous invite sans ambages ni précautions d’usage : son témoignage est aussi poignant que cru, aussi fort que vrai. La mort est une compagne. Un coup de pelle pour creuser une nouvelle tranchée fait tomber sur un corps en putréfaction. L’odeur de la mort est toujours là et celle des cigarettes ne parvient pas à en masquer l’indélébile trace. La mort se respire, la mort est en soi puisqu’elle attend le soldat à chaque instant. L’insoutenable légèreté de la survivance prend le poids d’un supplice, pour les Poilus que la mort côtoie de si près
La chasse aux rats
L’horreur, c’est aussi la chasse aux rats, parce que les rats, gras car repus de chair humaine, ont pris de l’assurance, de l’arrogance, de la présence ; de l’omniprésence. Les rats pullulent et envahissent la vie du Poilu. Au point que le haut commandement promet une prime de cinq sous à chaque prise. Ernst Jünger, dans « Orages d’acier » (2) autre journal de guerre emblématique –côté Allemand, cette fois-, a su décrire avec une pointe d’humour désabusé ce passe-temps : tirer les rats, les enflammer, les piéger, jouer avec la vermine. « La chasse aux rats offre une distraction fort goûtée dans le vide des gardes. On dépose un petit bout de pain en guise d’appât et on pointe le fusil sur lui, ou bien on répand dans les trous de la poudre prise aux obus non éclatés et on y met le feu. Ils en bondissent alors en couinant, le poil roussi. Ce sont des créatures répugnantes, et je ne puis m’empêcher de penser toujours à leur activité secrète de charognards, dans les caves de la bourgade… » Erich Maria Remarque, l’auteur de « A l’Ouest, rien de nouveau », roman pacifiste exemplaire sur la Grande Guerre, évoque les « rats de cadavre ». C’est dire. Et par-dessus le marché, « l’été, ce sont des essaims monstrueux de mouches qui viennent pondre dans les corps des soldats en décomposition », note Jean-Yves Le Naour (3). Aussi, le quotidien du soldat dans cette fichue guerre de position, est-il loin d’être idyllique et de ressembler aux images de propagande diffusées à grande échelle et destinées à rassurer le front arrière. Lequel n’était pas dupe, lorsqu’il recevait des nouvelles du front.
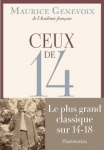
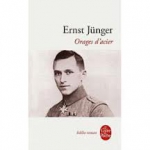
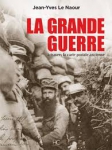 (1)Flammarion, 960 pages, 2013. Disponible également en Points/Roman et aux éd. Omnibus.
(1)Flammarion, 960 pages, 2013. Disponible également en Points/Roman et aux éd. Omnibus.
(2)« Orages d’acier », par Ernst Jünger (Le Livre de Poche, 1989).
(3)« La Grande Guerre à travers la carte postale ancienne » (HC éd. 2013).
**********
Bonnes feuilles :
LES EPARGES
 « Cela se passait aux Eparges, pendant une des attaques meurtrières du printemps 1915. On se souvient peut-être que sur cette butte des Hauts-de-Meuse, la bataille se prolongea deux mois. Une bataille sauvage, une suite presque ininterrompue d’attaques et de contre-attaques pour la conquête d’une colline de boue, dans des tranchées gluantes bouleversées par des milliers d’obus. Les havresacs, les armes, les cadavres s’enfonçaient lentement dans la glaise, des blessés perdus s’y noyaient. Chaque trou d’obus, les énormes entonnoirs creusés par l’explosion des mines devenaient autant de mares glacées, d’un jaune aigre et verdâtre empoisonné par l’hypérite (*). Et il flottait sur ce charnier une odeur fade et corrosive ensemble qui entrait loin dans la poitrine, semblait happer aux bronches comme la boue aux mains nues, aux genoux et aux reins.
« Cela se passait aux Eparges, pendant une des attaques meurtrières du printemps 1915. On se souvient peut-être que sur cette butte des Hauts-de-Meuse, la bataille se prolongea deux mois. Une bataille sauvage, une suite presque ininterrompue d’attaques et de contre-attaques pour la conquête d’une colline de boue, dans des tranchées gluantes bouleversées par des milliers d’obus. Les havresacs, les armes, les cadavres s’enfonçaient lentement dans la glaise, des blessés perdus s’y noyaient. Chaque trou d’obus, les énormes entonnoirs creusés par l’explosion des mines devenaient autant de mares glacées, d’un jaune aigre et verdâtre empoisonné par l’hypérite (*). Et il flottait sur ce charnier une odeur fade et corrosive ensemble qui entrait loin dans la poitrine, semblait happer aux bronches comme la boue aux mains nues, aux genoux et aux reins.
Chaque fois qu’un régiment montait, c’étaient mille hommes qui tombaient, plusieurs centaines de tués, des blessés affreusement déchiquetés par des obus de rupture énormes, quelques fous. Les survivants descendaient au repos, dans des villages déserts et bombardés où ils ne cessaient point d’entendre, jour et nuit, le grondement de l’interminable bataille. Des renforts arrivaient, comblant les vides des compagnies. Et ils remontaient aux Eparges.
Ils remontaient par les mêmes cheminements, les mêmes boyaux ruisselants ou gelés, vers les mêmes tranchées bouleversées, éternellement refaites et nivelées, où d’une relève à l’autre ils retrouvaient les mêmes cadavres, raidis encore dans l’attitude où la mort les avait saisis : celui-ci avec le même éclat brillant fiché dans son crâne nu comme un coin de bûcheron, cet autre avec sa main crispée par-dessus son épaule, dans la même moufle de laine bleue. Tous connus, tous reconnaissables, compagnons et frères d’hier qu’ils ne pouvaient s’empêcher de nommer, ceux qui s’étaient effondrés sans une plainte, ceux dont ils avaient écouté, dans la nuit, gémir la longue agonie. »
-----
Maurice Genevoix, « La Ferveur du souvenir » (pp.79-80, éd. établie par Laurence Campa, ©La Table ronde, 2013)
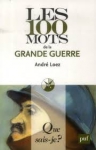 (*) Gaz moutarde : « On nomme ypérite le plus atroce des gaz de combat de la Grande Guerre », écrit l’historien André Loez, dans « Les 100 mots de la Grande Guerre » (PUF / Que sais-je ?), « du nom de la ville belge d’Ypres où il fut utilisé pour la première fois par l’Allemagne en juillet 1917. Egalement nommé gaz moutarde en raison de son odeur, il brûle la peau et les muqueuses, rendant inopérantes la protection des masques. »
(*) Gaz moutarde : « On nomme ypérite le plus atroce des gaz de combat de la Grande Guerre », écrit l’historien André Loez, dans « Les 100 mots de la Grande Guerre » (PUF / Que sais-je ?), « du nom de la ville belge d’Ypres où il fut utilisé pour la première fois par l’Allemagne en juillet 1917. Egalement nommé gaz moutarde en raison de son odeur, il brûle la peau et les muqueuses, rendant inopérantes la protection des masques. »
Nota : l'anachronisme figurant dans le texte de Genevoix - il évoque des faits qui se déroulent en 1915 - s'explique par la date de la rédaction de ses livres sur la Grande Guerre, largement postérieure à celle-ci. D'autres gaz -aveuglants - que le gaz moutarde, furent utilisés en 1915.
A propos de : 26 Villages, Jambons basques...
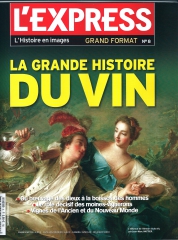 Papier introductif que j'ai écrit pour le hors-série (couv. ci-contre), en kiosque depuis cette semaine :
Papier introductif que j'ai écrit pour le hors-série (couv. ci-contre), en kiosque depuis cette semaine :
C’est communément vers l’Anatolie que l’on situe les premières tentatives de domestication de la vigne, liane sauvage, environ 7 000 ans avant notre ère. Mais les premiers vins ― les « paléovins » ― sont sans doute antérieurs à la culture de la vigne. Nos ancêtres du Néolithique se régalaient de boissons fermentées de céréale (bière), de miel (hydromel) ou de fruits (sureau et raisin sauvage, notamment). Des résidus d’acide tartrique, un des principaux composants du vin, ont ainsi été retrouvés sur les parois internes de poteries mises au jour sur le site de d’Hajji Firuz Tepe, en Iran. Leur datation nous ramène vers -7 500. De même, des traces de pépins de raisin fermentés, trouvées dans un village du sud-est de la Turquie, remontent au vie millénaire av. J.-C.. Favorisée, comme l’élevage, par la sédentarisation des peuplades, la viticulture se développe de la Turquie et de l’Iran vers la Mésopotamie, avant de rejoindre le Proche-Orient (-4 000), l’Egypte (-3 000), puis la Grèce et la Crète (-2 000). Elle apparaît par ailleurs en Inde, vers –500, mais rien ne permet d’y certifier la production de vin.
Sur les rivages de la Méditerranée, en revanche, pas de doute : l’archéobotanique nous renseigne avec précision de la fabrication d’une boisson à base de raisins fermentés. Les indices ne manquent pas, comme la forte concentration de pépins, notamment du côté de l’étang de Berre, sur l’île de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, et à Lattes (Hérault).
Tout porte à croire que ce sont les Grecs ― les Phocéens précisément ― qui auraient peu à peu converti nos ancêtres à apprécier le sang de la vigne. Ces premiers vins des Grecs installés à Massalia (Marseille) remontent à 600 av. J.-C. Le vignoble est planté en quantité autour de la cité, ainsi qu’à Agde, autre colonie. Le commerce va bon train et une amphore spéciale, la « massaliète » est même créée.
La culture de la vigne s’est ainsi rapidement répandue à travers toutes les civilisations qui bordent Mare Nostrum. Et comme partout dans le monde antique, y compris jusqu’en Chine, elle y joue presque toujours, un rôle religieux, voire mystique.
DU DIVIN AU PAÏEN
Si le vin existe depuis environ 9 000 ans, la vigne, Euvitis, qui compte une cinquantaine de variétés, dont Vitis vinifera, celle qui nous intéresse, existe depuis des millions d’années. L’homme préhistorique commence d’abord à consommer les raisins. Puis, il découvre la fermentation du raisin, les bienfaits de cette nouvelle boisson énergisante, ainsi que les vertiges de l’ivresse. Cela nous conduit à la Bible. Vigne et vin y sont signes de richesse et de bénédiction divine d’une part, et l’ivresse est à l’origine de la Faute, d’autre part.
Dans la Genèse, Noé, lorsque le Seigneur (YHWH) l’avertit qu’il s’apprête à détruire les humains au moyen du Déluge parce qu’ils se sont tous pervertis ― sauf lui, le brave Noé ― il lui ordonne de construire l’Arche pour sauver sa famille et les espèces animales. Noé a l’idée de préserver aussi des végétaux divers, comme la vigne, dont il emporte quelques ceps. Après quarante jours de déluge, la pluie cesse, les eaux ont recouvert la terre et l’Arche de Noé dérive aux confins de la Turquie et de l’Arménie, précisément où l’on a trouvé les plus anciens témoignages de vinification et où la vigne continue de donner du vin ― soit sur le mont Ararat…
Une légende similaire se retrouve dans l’Epopée du roi Gilgamesh, qui aurait lui aussi apporté le vin à l’Humanité. Selon un texte assyrien du viie siècle av. J.-C., le mythe babylonien d’Atrahasis évoque l’hypothèse mésopotamienne (Irak) de la « grande inondation », dans la onzième tablette de l’Epopée, pour être précis, laquelle s’inspire de l’épisode du Déluge dans la Bible : il suffit de changer Noé par Uta-Napishtim et le mont Ararat par le mont Nitsir pour savourer la même allégorie.
Revenons à Noé : c’est à partir de ses trois fils : Sem, Cham et Japhet, que la terre fut peuplée. Cham, vit un jour son père Noé, nu et ivre du vin de sa vigne. « Noé le cultivateur commença à planter la vigne » (Genèse). Noé est ainsi à la fois le premier agriculteur et le premier vigneron, et il est aussi le premier à saisir, certes à son corps défendant, le pouvoir (à la fois grisant et dévastateur) du jus de raisin fermenté. La tradition yahviste fait ainsi de la vigne le fruit de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, à l’instar de l’arc-en-ciel. La vigne et les effets (bénéfiques ou néfastes) qu’elle procure symbolisent l’ordre cosmique et la fécondité naturelle.
La mythologie perse nous propose une autre version de l’origine du sang de la vigne. Daté au alentour de –1 400, l’Avesta, texte sacré du zoroastrisme, fait mention de la découverte, fortuite, du vin par une femme. Au palais du légendaire shah Jamshid, une des épouses du harem, se sentant délaissée par le souverain, souhaitait en finir avec la vie. Aussi, choisit-elle de se noyer dans une jarre, où l’on conservait des raisins, remplie d’un liquide réputé toxique. Or, non seulement elle ne pérît pas, mais elle connaît l’ivresse et la gaîté que celle-ci procure. Ce qui lui permit de recouvrer les faveurs de Jamshid.
Les textes sumériens anciens, au iie millénaire av J.-C., s’intéressent aussi au vin, à qui, les premiers, ils confèrent une dimension divine. L’Epopée de Gilgamesh, précitée, fait le récit épique de la vie du roi de la cité d’Uruk (Mésopotamie). Celui-ci, désemparé par la mort de son compagnon d’armes s’en va consulter Uta-Napishtim, sauvé du Déluge par les dieux qui lui offrirent l’immortalité. Une version sumérienne - et antérieure - au Noé de la Bible. Mais à la différence du patriarche des Hébreux, l’ancien roi de Sumer ne fait pas de vin. Il se contente de boire celui tiré d’une vigne enchantée, qui donne la vie éternelle. Mais Gilgamesh ne pourra en profiter. Siduri, déesse babylonienne du vin lui rappelle que l’immortalité doit demeurer le privilège des dieux. Preuve que le vin est bien une boisson divine avant d'être celle des hommes.
Plus près de nous, le Cantique des cantiques offre au vin une place de choix, qu’il partage avec l’amour et l’érotisme. « Vos mamelles sont meilleures que le vin…. », « Ce qui sort de votre gorge est comme un vin excellent, digne d’être bu par mon bien-aimé et longtemps goûté entre ses lèvres et ses dents… », peut-on lire dans ce livre de la Bible, il est vrai connu pour sa poésie et sa sensualité. Par extension, l’exégèse perçoit dans la vigne, à travers ce texte sacré, la Sagesse divine et même le Sang de l’Eucharistie.
C’est en effet par le miracle de Cana (Galilée) que Jésus choisit de révéler sa divinité. En changeant l’eau de six jarres de pierre contenant 100 litres chacune, en excellent vin – tant qu’à faire ! – car il n’y en avait plus aux noces auxquelles il était convié, il est porteur d’un message d’amour de Dieu le père envers les hommes. Ce miracle s’inscrit par ailleurs dans la perspective de la Rédemption et il montre un Jésus aimant partager le vin. Les Evangiles (Luc et Paul notamment) ne cessent cependant de mettre en garde contre les dangers de l’ivresse.
Reste bien sûr la portée incommensurable du sang du Christ comme métaphore du vin et le message subliminal qu’elle contient pour réaliser combien cela a contribué à l’essor de la viticulture dans le monde chrétien : « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Depuis lors, tous les jours, à chaque office, les prêtres boivent une coupe de vin pour célébrer l’Eucharistie.
Dans la tradition juive, le vin est également omniprésent et recouvre les mêmes vertus positives, comme négatives, que dans la tradition chrétienne. « Il est le plus fidèle compagnon du monothéisme juif », écrit Jean-Robert Pitte (1). Avant de s’établir au pays de Canaan, dans la vallée du Jourdain, les Juifs avaient découvert les vertus du vin en Syrie, en Egypte, à Ur, à Babylone... Il y a une forte valeur symbolique dans le vin du shabbat, dans le vin à Rosh Hashana, à Pessah, à Pourim, comme à chaque fête, mariage et circoncision notamment.
Le paradoxe est que la consommation de tout alcool soit interdite par l’islam et que le vin coule à flot dans Les Mille et une nuit, dans les Robayat d’Omar Khayyâm, en Inde, en Perse et en Mésopotamie. Le Moyen-Orient a enfanté à lui seul une magnifique poésie bachique aux premiers siècles de la religion du Prophète, à la fois érotique et mystique. Et si de nombreuses sourates du Coran interdisent la consommation de vin sur la terre, elles en promettent en abondance aux élus dans l’au-delà. D’aucuns, parmi les historiens de l’islam autorisés, comme Malek Chebel (2), s’accordent malgré tout à reconnaître que, si « le vin continue à subir aujourd’hui les avanies d’une morale collective organisée et conduite par les valeurs religieuses, l’interdit de consommation demeure aussi vivace que l’est la transgression. » En réalité, chacun s’arrange à sa façon avec le ciel, et ainsi les vignerons peuvent continuer de travailler…
DIONYSOS ET BACCHUS
En Grèce, c’est à Oreste, fils d’Agamemnon et de Clytemnestre, que l’on doit la plantation de la première vigne (Amphictyon), et c’est à Dionysos (fils de Zeus et de la mortelle Sémélé), que revient l’art d’enseigner la viticulture. Le dieu hellène du vin (et de tous les sucs vitaux : sève, sperme, lait, sang) incarne avant tout la vigne et ses excès, soit à la fois la force végétale, la vivacité, la croissance, l’exubérance, la convivialité et aussi la violence, voire la transe que l’ivresse provoque parfois. Dans les récits d’Homère, les héros et les démiurges boivent une boisson appelée kykeon, mélange de vin, d’orge et de miel. Le vin qu’Ulysse emporte avec lui est mis sur le même plan que les sept talents d’or et le cratère géant. Il est question de vin noir (pur) ou rouge (coupé d’eau) dans L’Iliade et L’Odyssée.
Dionysos est un dieu errant, vagabond et déconcertant, qui surgit, comme Apollon, par épiphanies (apparitions soudaines et imprévisibles). Il symbolise la fermentation, le cycle végétal, la régénération et – ici aussi – l’immortalité que le vin peut aider à atteindre. Ses pouvoirs magiques sont séduisants, et chantés par les poètes comme Oppée (iie siècle de notre ère) : « D’une baguette de roseau qu’il coupait, il perçait les roches les plus dures, et de ces blessures le dieu faisait jaillir un vin délicieux. » Dans les récits mythologiques, Dionysos est accompagné de ses ménades, ces femmes qui célèbrent son culte en chantant et en dansant en état d’ivresse. Jean-Robert Pitte rapporte que, selon le poète Nonnos, « Ampélos, jeune satyre éclatant de beauté dont Dionysos est l’amant », trouve la mort, chargé par un taureau envoyé par Até, déesse de la mort. Dionysos lui dresse une sépulture et verse de l’ambroisie (boisson exclusive des dieux, à l’exception de Dionysos, qui n’en boit pas), sur les plaies du défunt. Zeus accorde alors une seconde vie à Ampélos en le changeant en vigne. « Dionysos la vendange et tire de ses fruits, qui ont le parfum de l’ambroisie, le premier vin dans lequel il s’abîme dans le souvenir d’Ampélos et qui sublime sa douleur en joie profonde. Il se confond alors avec le breuvage divin. » Ampélos a donné ampélographie, l’étude des cépages.
Dans la mythologie romaine, Bacchus est le pendant exact de Dionysos. Les ménades de l’un deviennent les Bacchantes de l’autre. Priape est l’ami de Bacchus, dieu de l’ivresse, du vin, des excès en tout genres, notamment sexuels et ses fêtes sont les fameuses bacchanales. Les femmes n’ont pourtant pas le droit de boire du vin, à Rome à l’époque de la République, car « il (leur) ferme le cœur à toutes ses vertus et l'ouvre à tous les vices », commente la lex romana.
Avec la christianisation de la Gaule, le culte de Dionysos-Bacchus va brusquement chuter. Ce culte avait été bien accueilli dans la culture gallo-romaine, au point que certains princes celtes se faisaient ensevelir avec force amphores pleines de vins, comme les pharaons, afin de faciliter leur passage dans l’au-delà. L’usage des amphores en guise d’urnes funéraires n’est pas rare non plus, qui signifie clairement la croyance dans le vin comme gage d’immortalité. Mais cet accueil païen, du dieu de l’ivresse et de la transgression fut inégal. Franchement accueilli en Italie et en Afrique du Nord, il le fut plus timidement et plus tardivement dans la Gaule romaine, où seul le dieu de la vigne et des vendanges fut hardiment célébré, comme le souligne Gilbert Carrier (3). « Puisque le vin est le sang du Christ et la matière première de la transsubstantiation, selon les paroles fondatrices de la Cène, sa consommation rituelle ouvre la voie de la vie éternelle. (…) Le vin est à la vigne ce que le sang est au corps et la cuve-sarcophage symbolise l’acte de séparation et de passage, en assurant au défunt un bain d’immortalité », écrit l’historien. Mais très vite, un peu comme la sévère République romaine à l’égard des cultes dionysiaques importés en Italie, au iie siècle avant notre ère, l’Eglise chrétienne constituée s’efforce d’éliminer les éléments païens qu’elle avait dû intégrer à l’origine. » Les évêques durcissent alors le ton à l’égard de l’ivrognerie, symbole de décadence, de dégradation et vouent aux gémonies tous ceux qui s’y adonnent. C’en est terminé de l’ivresse et des fêtes païennes. Bacchus a du plomb dans l’aile. L’esprit des lois, comme celle de M. Evin, pointe déjà son nez. L.M.
-----
QUAND LA CHINE VINIFIERA…
Des sources écrites datant de la dynastie chinoise Han, vers 126 av. J.-C., démontrent que Vitis vinifera était cultivée en grandes quantités le long de la Route de la soie, du côté de Samarkand et de Tachkent, en Ouzbékistan, et jusqu’aux confins de la Chine, dès le ive siècle avant notre ère. Cependant, la viticulture de l’Extrême-Orient en général, et chinoise en particulier, aurait été importée du Proche-Orient un peu avant notre ère, et pas dans l’Antiquité. C’est en tout cas la prudence à laquelle nous invite Jean-Robert Pitte (1). D’autres chercheurs, comme Patrick E. McGovern, sont en revanche persuadés qu’il existait une viticulture chinoise 7 000 ans av. J.-C., vers Jiahu, dans la province du Henan. Les Chinois buvaient alors un vin néolithique… mâtiné de bière et d’hydromel. C’est à la faveur de croyances conjuguées mêlant alimentation, médecine et religion, que le vin revêt, dès son apparition dans l’Empire Céleste, des vertus médicinales qui contribuent à son timide succès. Pitte oppose d’ailleurs une autre raison religieuse au faible et tardif développement de la viticulture chinoise : la plante alimentaire sacrée est le riz et la boisson fermentée qu’on en tire est le chemin du divin. Dès le départ, il n’y aurait donc pas eu de place pour le jus de raisin fermenté. Ce n’est que beaucoup plus tard, vers 600, au temps des empereurs Tang, que la viticulture devient une activité sérieuse, même si la consommation de vin, appelé « putaojiu », demeure encore confidentielle. La viticulture chinoise s’est depuis lors bien réveillée : elle s’est hissée au 6è rang de la production mondiale, et l’Empire du Milieu produit aujourd’hui 15 million d’hectolitres de vin. L.M.
-----
EGYPTE
Les Egyptiens cultivaient la vigne en pergolas, dans de grands jardins et souvent en complantation avec des figuiers. Le vin, « jrp », était blanc, rosé ou rouge. Le « paour » était sec, acide, amer même.
Toutankhamon, le fils du soleil, cultivait la vigne, les « vergers à vin » dans le Fayoum et dans le delta du Nil, au xive siècle av. J.-C. Réservé au souverain et à sa cour, le vin était consommé à leur table et servait également au culte des divinités. Ce sont des blancs doux, pour la plupart, comme le « shedeh » ou le « taniotique », à l’instar de ceux qui se trouvaient dans des amphores, dans le tombeau du fils du soleil et sur lesquelles on a pu lire la provenance exacte des nectars destinés à étancher la soif pharaonique dans l’au-delà, y compris leur âge : de 4 à 9 ans. Les autres vins produits en Egypte se nomment le « ndm », doux et recherché, le « nefer », très concentré. L.M.
(1) Le Désir du vin à la conquête du monde (Fayard).
(2) Anthologie du vin et de l’ivresse dans l’Islam (Seuil).
(3) Histoire sociale et culturelle du vin (Larousse).
Je recommande vivement la lecture de ce nouveau hors-série (auquel j'ai abondamment collaboré - Et allez! Un p'tit coup d'autopromo en passant...).
En kiosque depuis hier.
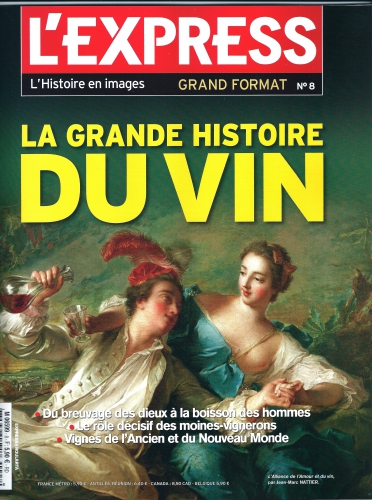
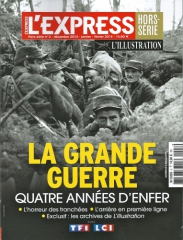 Papiers parus dans le mook (le gros hors-série de L'EXPRESS consacré à la GRANDE GUERRE (actuellement en kiosque) :
Papiers parus dans le mook (le gros hors-série de L'EXPRESS consacré à la GRANDE GUERRE (actuellement en kiosque) :
L'HONNEUR DES FEMMES
« Si les femmes qui travaillent dans les usines de guerre s’arrêtaient quinze minutes, la France perdrait la guerre ». Venant de Joffre –encore que l’authenticité des termes de cette phrase tonitruante et galvanisante ne soit pas totalement avérée, une telle déclaration souligne le dévouement, sous-payé, harassant, voire dangereux des « munitionnettes », ces 400 000 femmes venues en renfort des vieux, des éclopés, des réformés et autres trop jeunes ouvriers, qui voient d’ailleurs d’un mauvais œil ces femmes qui s’émancipent, coupent leurs cheveux –la coupe à la garçonne fait son apparition-, portent salopette ou pantalon (ce qui est pourtant interdit par la loi), se retroussent les manches… Mais menacent de faire aligner leurs bas salaires de « bonnes femmes » sur les leurs (une ouvrière perçoit en moyenne 0,15 F de l’heure, soit la moitié du salaire minimal). Broutilles, en regard de l’effort de guerre auquel les femmes contribueront de façon considérable : elles fabriqueront quelques 300 millions d’obus et 6 milliards de cartouches.
Aux champs et à l’usine
Et elles ne travaillent pas que dans l’industrie : les hommes sont au front et, dès l'été 14, il faut bien moissonner. Les bœufs, les chevaux ont été réquisitionnés pour nourrir et transporter l'infanterie. Les femmes moissonnent seules et vont par la suite labourer en remplaçant les bêtes de somme et de trait avec leurs petits bras. Les métiers traditionnellement masculins se féminisent nécessairement : ainsi apparaissent des femmes garde-champêtre, des femmes cochers, des institutrices dans les classes de garçons, des femmes postières –et dieu sait si l’acheminement de milliards de lettres durant toute la durée de la guerre est une activité capitale, car elle symbolise le cordon ombilical qui relie le front avant et le front arrière. On voit aussi des femmes entrer dans les écoles de commerce, des femmes maréchal-ferrant ou encore conductrices de trains et de tramways.
À la faveur de la guerre, la femme française s’émancipe donc, et elle assure. De toute façon, elle n’a pas le choix : elle doit être à la fois à la maison, à élever les enfants, et au travail, aux champs ou à l’usine d’armement. Elles sont plus de trois millions à être femmes d’agriculteurs, souvent seules adultes valides sur l’exploitation familiale. Et puis la femme écrit, car elle attend et espère. Les nouvelles du front disent au moins que l’homme est vivant, mais parfois c’est un télégramme qui annonce sèchement le décès du fiancé, du mari ou celui du fils. Les lettres d’amour sont légion, mais les divorces le seront aussi après le conflit (30 000 en 1920 lorsqu’ils étaient de quelques milliers avant la guerre), car la femme a conquis une certaine forme de liberté individuelle, une fierté certaine, une autonomie réelle. « J’ai quitté un agneau et j’ai retrouvé une lionne », écrit un Poilu de retour du front. La femme de 14-18, c’est aussi l’absence de femme pour le soldat –et l’absence d’homme pour la femme ! L’adultère sur le front arrière est sévèrement puni, car démoraliser le soldat de la sorte est un acte peu citoyen. Cependant, la plupart des femmes vivent douloureusement leur esseulement et sont davantage Pénélopes que volages.
Une émancipation qui tourne court
La femme de la Grande Guerre, c’est encore l’infirmière, la « dame blanche ». Qu’elles appartiennent à l’Union des femmes de France, à l’Association des dames françaises, à la Croix-Rouge ou encore à la Société de secours aux blessés militaires, elles sont plus de 71 000 infirmières françaises à soigner, panser, voire amputer d’innombrables blessés. Plusieurs centaines périssent sous les obus ou à cause de maladies contagieuses. Près de 400 seront néanmoins décorées de la Légion d’honneur.
Les femmes de l’arrière, ce sont bien sûr les nombreuses péripatéticiennes qui, comme dans tout conflit, servent dans les bordels improvisés à proximité du front, et où des milliers de Poilus défilent. Une flambée de maladies vénériennes (250 000 soldats atteints dès 1916), inquiéta fort le haut commandement militaire, le GQG (Grand quartier général, dirigé successivement par Joffre d’août 14 à décembre 16, par Nivelle de décembre 16 à mai 17 et par Pétain de mai 17 jusqu’à l’armistice).
La France ne sera cependant pas charitable avec cette femme guerrière sur le front arrière protéiforme où elle aura donné sans compter ; loin s’en faut. Tandis que l’Anglaise obtiendra le droit de vote, le Sénat la lui refusera en 1922 et alors que la jurisprudence sur l’avortement s’était assouplie, voilà que la doctrine juridique en durcit la répression par une loi de 1922. (Une autre loi de 1920 interdit, dans un pays exsangue, toute propagande en faveur de la contraception). Parmi toutes ces femmes, on dénombre enfin 636 000 sont veuves à la fin du conflit (et 700 000 enfants sont orphelins de père). Pour 1,4 million de « tués à l’ennemi ».
Léon Mazzella
---
Lire : "Les poilus", par Jean-Pierre Guéno (les arènes, 2013).
"La Grande Guerre à travers le carte postale ancienne", par Jen-Yves Le Naour (HC éd., 2013).
-------------------------------------
L'INFANTICIDE DEVIENT UN ACTE DE GUERRE
Le procès fit grand bruit, que l'on appela celui de l'enfant du viol boche.
-----
Il s’agit d’un fait divers, relaté et analysé par l’historien Stéphane Audoin-Rouzeau, et qui sert de point de départ à son livre L'enfant de l'ennemi. Viol, avortement, infanticide pendant la Grande Guerre (1), lequel réfléchit à l’image du corps du soldat -dans tous ses états-, mais aussi à celui de la femme en temps de guerre. En août 1916, un jeune domestique de vingt ans, réfugiée en Meurthe-et-Moselle, Joséphine Barthélémy, tue l’enfant qu’elle vient de mettre au monde. « Debout sur mon seau de toilette, dans lequel l’enfant est tombé, j’affirme qu'il n’a pas crié », déclarera-t-elle. Elle est jugée en cour d’assises pour infanticide, et même si l’avortement et l’infanticide bénéficient d’une indulgence considérable depuis le début du xixe siècle, elle risque d’écoper a minima de cinq années de prison. Avec un aplomb et une assurance confondants, Joséphine assume avoir prémédité son acte et avoir agi de façon délibérée, parce qu’elle ne voulait pas d’un « enfant de père boche ». « La femme victime d’un viol en temps de guerre, » souligne la journaliste américaine Susan Brownmiller, « est choisie non parce qu’elle est un représentant de l’ennemi, mais parce qu’elle est femme, et donc un ennemi » (2).
Une Jeanne d'Arc violée
La presse parisienne s'empare de l’affaire avec délectation. "L'Excelsior" évoque « la petite servante lorraine » en en faisant une sorte de Jeanne d’Arc violée. "Le Temps" titre « L’enfant du Boche » en pages intérieures et "Le Matin" (tirage : 1 million d’exemplaires en 1917) reprend ce même titre en Une. « Du jour où je m’aperçus que j’étais enceinte, ma résolution fut prise de supprimer l’enfant de mes bourreaux », déclare-t-elle au Petit Parisien (tirage : 1,7 million d’exemplaires en 1917). L'écho est immense. Dans sa plaidoirie, qui sera reproduite intégralement dans la "Revue des grands procès contemporains" (un honneur rare pour un juriste de 27 ans), Maître Loewel ne va pas de main morte. Il évoque, crescendo, « une maternité imposée par l’ennemi »… « Un instinct maternel qui n’a pas parlé. Un seul instinct la dirigeait : celui de la haine. » Stéphane Audoin-Rouzeau souligne : « Combattants français, femmes violées : l’avocat établit implicitement l’identité entre les deux formes de martyre et de sacrifice. Les termes sont révélateurs : les soldats aussi souffrent, pleurent, sont frappés dans leur chair, et, en esclaves du corps et de l'esprit, incarnent la France martyrisée. Cette comparaison entre la souffrance des femmes du fait du viol allemand et celle des soldats du fait de la guerre contre ces mêmes Allemands est mise en exergue… » L’infanticide commis par Joséphine Barthélémy devient alors un véritable acte de guerre, « un acte de soldat », dira son avocat, voire un acte de représailles. L’héroïne, qui n’est par conséquent pas davantage coupable d’avoir tué son enfant qu’un soldat d’avoir tué un ennemi sur le front, sera acquittée le 23 janvier 1917 et applaudie sur son passage.
L.M.
----
(1) Flammarion/Champs, rééd.2013.
(2) in Le Viol, Stock, 1976.
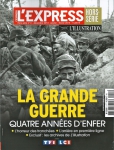 Papier paru dans le "mook" (gros hors-série) de L'EXPRESS sur la Grande Guerre (en kiosque depuis le 21 novembre) :
Papier paru dans le "mook" (gros hors-série) de L'EXPRESS sur la Grande Guerre (en kiosque depuis le 21 novembre) :
UN PAMPHLET PACIFISTE
Un jeune soldat américain, engagé volontaire, est atrocement mutilé par un obus aux derniers jours du conflit. Amputé des quatre membres, ayant perdu la parole, la vue, l’ouïe et l’odorat, c’est en apparence un légume de viande au visage défiguré. Mais il a gardé toute sa tête, et souffre d’entendre le monde sans le voir ni pouvoir communiquer avec lui. La médecine, qui le croit inconscient, s’acharne de surcroît ; à titre expérimental. « Je ne suis plus qu’un tas de chair qu’on maintient en vie », murmure le soldat Jo Bonham (Timothy Bottoms), à Jésus (Donald Sutherland), dans une scène onirique aussi émouvante que surréaliste (Luis Buñuel participa au scénario). Dalton Trumbo (1905-1976) réalisa lui-même « Johnny got is gun » (Prix spécial du jury à Cannes à sa sortie en 1971), son seul film, d’après son propre roman 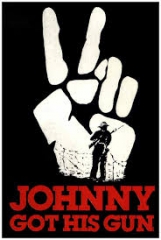 éponyme paru en 1939.
éponyme paru en 1939.
Voix off
Une relation se noue avec une infirmière bienveillante, tandis que Jo repasse le film de sa vie. Tout repose sur la voix intérieure du blessé, entre douceur et violence. Elle dit la sensibilité d’un jeune soldat détruit, et son impuissance à hurler sa souffrance. Le procédé (repris par Julian Schnabel avec « Le scaphandre et le papillon »), rend insoutenable un film culte, qui fut aussitôt désigné comme un grand pamphlet pacifiste. De même, l’alternance entre les scènes du réel : l’hôpital, le front, filmées en noir et blanc, et les scènes évoquant les rêves et les souvenirs de Jo, tournées en couleur, augmentent radicalement la force de la cassure. « Johnny » déploie sa dimension émotionnelle lorsque l’infirmière (superbe Diane Varsi) s’aperçoit, un soir de Noël, que l’être dont elle s’occupe chaque jour avec une étrange tendresse, a un cerveau et une peau, sur laquelle elle trace d’un doigt les lettres de Merry Christmas. Mais la morale de l’époque ne flirte pas avec l’euthanasie. De bouleversant, le film devient aussi poignant que révoltant. L.M.
En Français : Johnny s'en va-t-en guerre.
 Papier paru dans L'Express / La Grande Guerre, un mook : (gros) hors-série, en kiosque depuis le 21.
Papier paru dans L'Express / La Grande Guerre, un mook : (gros) hors-série, en kiosque depuis le 21.
Jean Echenoz, Jérôme Garcin, Pierre Lemaitre : trois talents distincts pour la dire autrement.
---
 « 14 » est le roman le plus dense et le plus fulgurant sur la Grande Guerre, paru ces dernières années. Jean Echenoz, dont la concision et la maîtrise atteignent ici leur paroxysme, circonscrit 14-18 en124 pages tendues, sobres, et d’une justesse pénétrante. L’histoire ? Cinq hommes simples se retrouvent au front, une femme, Blanche, attend leur retour : Echenoz écrit à hauteur d’homme, avec une acuité redoutable, sans emphase ni pathos, le quotidien d’une guerre avec sa boue, ses rats, ses horreurs. Anthime, Padioleau, Bossis, Charles, Arcenel, plongés à leur corps défendant dans les « boyaux » des tranchées, survivent à l’absurde comme ils peuvent. Deux épisodes possèdent la perfection de l’œuf : l’économie de mots pour décrire un éclat d’obus qui arrache un bras à Anthime, et le récit millimétré d’un combat aérien sont des bijoux d’anthologie.
« 14 » est le roman le plus dense et le plus fulgurant sur la Grande Guerre, paru ces dernières années. Jean Echenoz, dont la concision et la maîtrise atteignent ici leur paroxysme, circonscrit 14-18 en124 pages tendues, sobres, et d’une justesse pénétrante. L’histoire ? Cinq hommes simples se retrouvent au front, une femme, Blanche, attend leur retour : Echenoz écrit à hauteur d’homme, avec une acuité redoutable, sans emphase ni pathos, le quotidien d’une guerre avec sa boue, ses rats, ses horreurs. Anthime, Padioleau, Bossis, Charles, Arcenel, plongés à leur corps défendant dans les « boyaux » des tranchées, survivent à l’absurde comme ils peuvent. Deux épisodes possèdent la perfection de l’œuf : l’économie de mots pour décrire un éclat d’obus qui arrache un bras à Anthime, et le récit millimétré d’un combat aérien sont des bijoux d’anthologie.
Jérôme Garcin signe un roman historique en prenant pour sujet 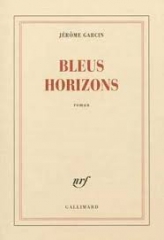 l’écrivain Bordelais Jean de La Ville de Mirmont, tombé au Chemin des Dames, « sous un ciel sans dieu », le 28 novembre 1914 à l’âge de 28 ans. À travers le prisme romanesque de Garcin, Jean de La Ville, dont l’œuvre est aussi mince que capitale, devient un personnage incandescent et tendre, à la fois avide d’en découdre et pourvu d’une sensibilité d’enfant perdu. « Bleus horizons », à l’écriture impeccable, est le roman le plus touchant sur le sujet. On n’oublie pas Louis Gémon, le narrateur. Survivant à Jean, son ami « jumeau » disparu avec « de grands départs inassouvis » en lui, il connaîtra une inconsolable mélancolie plus douloureuse qu’une amputation – un thème cher à l’auteur d’« Olivier ».
l’écrivain Bordelais Jean de La Ville de Mirmont, tombé au Chemin des Dames, « sous un ciel sans dieu », le 28 novembre 1914 à l’âge de 28 ans. À travers le prisme romanesque de Garcin, Jean de La Ville, dont l’œuvre est aussi mince que capitale, devient un personnage incandescent et tendre, à la fois avide d’en découdre et pourvu d’une sensibilité d’enfant perdu. « Bleus horizons », à l’écriture impeccable, est le roman le plus touchant sur le sujet. On n’oublie pas Louis Gémon, le narrateur. Survivant à Jean, son ami « jumeau » disparu avec « de grands départs inassouvis » en lui, il connaîtra une inconsolable mélancolie plus douloureuse qu’une amputation – un thème cher à l’auteur d’« Olivier ».
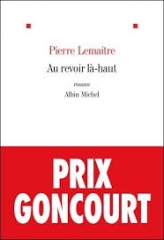 Le plus poignant et le plus puissant des romans les plus récents sur la Grande Guerre est sans conteste l’ample et somptueux « Au revoir là-haut », de Pierre Lemaitre –Prix Goncourt 2013. Ce roman de la colère s’ouvre sur un épisode grave qui montre les amis Edouard et Albert, deux soldats envoyés au feu par l’inhumain lieutenant Pradelle : ces 60 pages ciselées comme une nouvelle, disent à elles seules la guerre sous un aspect tranchant. Lemaître, qui possède le talent de happer son lecteur, plante aussitôt les deux rescapés dans une France d’après guerre méconnue : celle qui n’eut d’égards que pour ses glorieux morts, et qui traita ses fantomatiques survivants comme des parias. L.M.
Le plus poignant et le plus puissant des romans les plus récents sur la Grande Guerre est sans conteste l’ample et somptueux « Au revoir là-haut », de Pierre Lemaitre –Prix Goncourt 2013. Ce roman de la colère s’ouvre sur un épisode grave qui montre les amis Edouard et Albert, deux soldats envoyés au feu par l’inhumain lieutenant Pradelle : ces 60 pages ciselées comme une nouvelle, disent à elles seules la guerre sous un aspect tranchant. Lemaître, qui possède le talent de happer son lecteur, plante aussitôt les deux rescapés dans une France d’après guerre méconnue : celle qui n’eut d’égards que pour ses glorieux morts, et qui traita ses fantomatiques survivants comme des parias. L.M.
---
« 14 », par Jean Echenoz (Minuit, 2012).
« Bleus horizons », par Jérôme Garcin (Gallimard, 2013).
« Au revoir là-haut », par Pierre Lemaître (Albin Michel, 2013).
----------
Les poilus lisaient beaucoup
Pour tromper l’ennui, les poilus lisent de nombreux journaux et livres : « La Vie parisienne », « Le  Matin », leurs propres journaux des tranchées, mais aussi Zola, Kipling, Loti, Laclos, Jammes, Tolstoï, Féval, Verne –et bien sûr « Le Feu » de Barbusse ! Ils lisent des romans afin de moins penser à l’horreur, et la presse afin de ne pas être coupé de l’arrière. C’est ce que traduit une étude historique passionnante, signée Benjamin Gilles : « Lectures de poilus » (Autrement, 2013). L.M.
Matin », leurs propres journaux des tranchées, mais aussi Zola, Kipling, Loti, Laclos, Jammes, Tolstoï, Féval, Verne –et bien sûr « Le Feu » de Barbusse ! Ils lisent des romans afin de moins penser à l’horreur, et la presse afin de ne pas être coupé de l’arrière. C’est ce que traduit une étude historique passionnante, signée Benjamin Gilles : « Lectures de poilus » (Autrement, 2013). L.M.
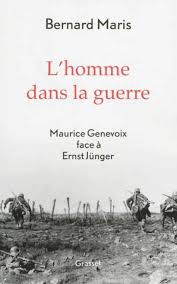 Papier paru dans le "mook" consacré à la Grande Guerre, de L'Express
Papier paru dans le "mook" consacré à la Grande Guerre, de L'Express
Deux visions de l'horreur
Gendre de Maurice Genevoix, veuf de Sylvie, le livre poignant de Bernard Maris est une ode, un hommage à deux écrivains majeurs de la Grande Guerre Genevoix et Jünger.
---
C’est un livre rédigé, de surcroît, à la table de Genevoix, au premier étage de la maison des Vernelles, en bords de cette Loire que l’auteur de « Raboliot » a tant aimée, tant évoquée dans ces inoubliables romans sauvages comme « La forêt perdue » et « La dernière harde ». Néanmoins, l’empathie de l’auteur lui fait naturellement prendre parti. Certes, il lit et continue de lire Jünger avec une ferveur égale depuis l’adolescence, mais il compare souvent et oppose parfois deux visions de la guerre : celle de Maurice Genevoix, l’auteur de l’immense « Ceux de 14 » (Albin Michel et Points/Roman), le classique du genre, et celle d’Ernst Jünger, l’auteur d’ « Orages d’acier » (Le livre de poche). Deux grands écrivains du XXè siècle. Deux livres essentiels sur la Grande Guerre. Le destin est parfois étrange, car les deux jeunes soldats se trouvaient l’un conte l’autre à la tranchée de Calonne, aux Eparges et ils y furent blessés le même jour ; le 25 avril 1915. Ce sont deux visions de l’horreur que Bernard Maris décrit. L’une, humaniste, tendre, observe les regards des poilus ses compagnons d’infortune, pleure leur mort brutale, décrit au plus près du réel une vie inhumaine dans les tranchées : c’est celle de Genevoix. L’autre vante les vertus guerrières et viriles et manque parfois d’empathie pour les blessés comme d’affect pour la mort des soldats amis ou ennemis. C’est celle de Jünger. Survivants de la grande boucherie, les deux écrivains ne se rencontreront jamais, car Genevoix ne le souhaitera pas. Il ne lira guère Jünger non plus. « Il y avait quelque chose d’inconciliable entre eux, et peut-être d’irréconciliable », écrit Maris. Genevoix est un naturaliste, pas un penseur. Jünger est davantage métaphysicien. La compassion lui est étrangère. Jünger est un écrivain-né et le choc de la Grande Guerre fera de Genevoix un écrivain de la nature, mais le gibier que l’on chasse et les arbres qu’on abat dans ses romans sont des soldats par métaphore. Dans les textes de Jünger, Maris souligne que « la race n’est pas loin et que l’auteur a déjà lu Nietzsche ». Et aussi que le sel de « Ceux de 14 » est dans l’attention infinie, d’entomologiste, clinique et passionnée, qu’il prête à ses hommes. Loin d’être manichéen, l’hommage appuyé à Genevoix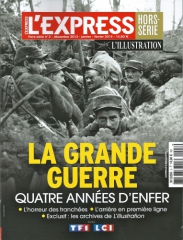 n’exclut cependant jamais l’admiration pour le Jünger écrivain. Tous deux décrivent admirablement la mort de près, la peur de la peur –celle qui coupe les jambes, les silences, l’angoisse, et les beautés apaisantes de la nature qui chante tout autour de l’enfer. Tous deux se rejoignent autour de cette phrase du premier, aujourd’hui gravée sur le monument aux morts des Eparges : « Ce que nous avons fait c’était plus que ce que l’on pouvait demander à des hommes, et nous l’avons fait ». Sauf qu’il ne s’agit pas, en l’occurrence, de surhumanité, mais de grandeur. L.M.
n’exclut cependant jamais l’admiration pour le Jünger écrivain. Tous deux décrivent admirablement la mort de près, la peur de la peur –celle qui coupe les jambes, les silences, l’angoisse, et les beautés apaisantes de la nature qui chante tout autour de l’enfer. Tous deux se rejoignent autour de cette phrase du premier, aujourd’hui gravée sur le monument aux morts des Eparges : « Ce que nous avons fait c’était plus que ce que l’on pouvait demander à des hommes, et nous l’avons fait ». Sauf qu’il ne s’agit pas, en l’occurrence, de surhumanité, mais de grandeur. L.M.
« L’homme dans la guerre. Maurice Genevoix face à Ernst Jünger », par Bernard Maris (Grasset, 2013).
 Dans Billebaude n°3, le magnifique "mook" des éditions Glénat consacré à la prédation cynégétique sous toutes ses formes : sensible, artistique, ethnologique, esthétique, historique, poétique, philosophique... Cet hommage : BILL3_P62-63_guetteuse.pdf
Dans Billebaude n°3, le magnifique "mook" des éditions Glénat consacré à la prédation cynégétique sous toutes ses formes : sensible, artistique, ethnologique, esthétique, historique, poétique, philosophique... Cet hommage : BILL3_P62-63_guetteuse.pdf
Deux papiers consacrés à quelques nouveaux Irish whiskeys et autres nouveaux champagnes, dans un dossier concocté sous la houlette de Philippe Bidalon :


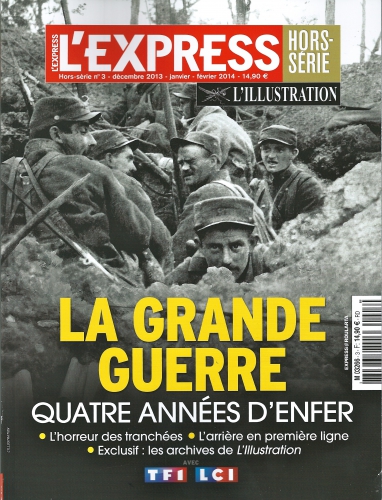
Il paraît demain. J'ai éprouvé un immense plaisir à copiloter ce "mook" (magazine/book), avec Philippe Bidalon (nous en sommes les rédacteurs en chef), et avec une précieuse équipe de réalisation : Letizia Dannery (secrétariat de rédaction), Isabelle Bidaut (maquette et conception graphique), Stéphanie Capitolin-Deleau (maquette), Michèle Benaïm (secrétariat de rédaction), Laure Vigouroux (secrétariat de rédaction), Nicole Nogrette (iconographie), sans oublier Clotilde Baste, stagiaire de grand r/secours - qui fut mon élève à l'Institut Européen de Journalisme (promotion 2011) et qui signe ici ses premiers papiers... Davantage qu'une expérience éditoriale intense, ce fut une aventure humaine profondément amicale. Nous aurons schtroumpffé notre quotidien -près de deux mois durant - à la sauce poilu. Cela s'appelle l'immersion, dans le jargon. Peu de terrain, certes (et pour cause), beaucoup de tranchées en pensée, en rêve aussi, mais pas mal de rencontres (donc d'entretiens), énormément de lectures, des milliers de photos de "L'Illustration" examinées, et beaucoup de textes écrits bien sûr, chacun avec un immense plaisir. Le résultat : un mook de 212 pages dont nous sommes fiers. J'espère que vous aurez à coeur de le lire, car il est vraiment beau, cet exceptionnel hors-série de L'Express.
Papier paru dans l'urban mag Paris by Crozes-Hermitage :
CONFONDANTES ANALOGIES
Ils ne sont que trois à Paris à exercer le métier de maître coloriste. Amateur de vins, Matthieu Le Tessier a l’impression de flirter avec le métier de vigneron, en assemblant ses pigments et en cherchant le colori parfait. Rencontre.
---
 Il joue avec les textures, avec les matières, les contrastes, il choisit les teintes, il assemble, il connaît au quotidien le plaisir du toucher du chanvre, du coton ou de la plume. Matthieu Le Tessier (photo ci-contre), 37 ans, originaire de Paimpol, a eu la révélation sur un golf de Saint-Brieuc, en faisant une rencontre décisive avec Daniel Duminy, décédé en août dernier, qui était l’un des premiers teinturiers coloristes à l’échantillon établi à Paris. Un maître coloriste. Quelqu’un qui travaille la colorimétrie, qui mélange donc les coloris, tandis que, jusque dans les années 70, les teinturiers étaient individuellement spécialistes d’une seule couleur. « Il existe plus de 6 millions de coloris et j’arrive à en voir 1,6 million environ, afin de pouvoir les distinguer sur un dégradé. Cette quantité est la partie du spectre des longueurs d’ondes que nous sommes capables de voir avec l’œil humain, de l’infrarouge à l’ultraviolet, en somme ». La passion, le destin de Matthieu ont donc été scellés sur un green. Aujourd’hui, dans son atelier de Belleville, il travaille, secondé par Irudayathan Luther, pour des clients allant de la haute couture (Lacroix, Dior), à Reporters sans frontières (pour teinter un gilet pare-balle du noir au vert), en passant par Cuisine TV (pour étalonner des vêtements de cuisiniers). « Il m’est arrivé de teinter un jean de Lenny Kravitz à peau de poisson (mulet) via John Galiano et je bosse pour les Folies Bergère en teignant des plumes. Lorsque je reçois un tissu, la première chose que je fais est de le toucher, puis j’examine sa blancheur ». Il se crée une relation sensuelle avec la matière. Je fais constamment la cuisine avec mes colorants. C’est comme si j’évaluais la vigne, sa maturation. J’avance en équilibrant, au milligramme près, comme on goûte à la cuve ; plus tard ». D’ailleurs, il arrive à Matthieu Le Tessier de tremper un doigt dans un bain acide ou bien alcalin afin de vérifier son bon PH (potentiel hydrogène). Il y a deux sortes de bains, en effet, et l’on retrouve encore une analogie avec l’univers de la dégustation : le bain en milieu acide est réservé aux matières animales (soie, laine, plume), tandis que le bain en milieu alcalin est réservé aux matières végétales (paille, coton, lin).
Il joue avec les textures, avec les matières, les contrastes, il choisit les teintes, il assemble, il connaît au quotidien le plaisir du toucher du chanvre, du coton ou de la plume. Matthieu Le Tessier (photo ci-contre), 37 ans, originaire de Paimpol, a eu la révélation sur un golf de Saint-Brieuc, en faisant une rencontre décisive avec Daniel Duminy, décédé en août dernier, qui était l’un des premiers teinturiers coloristes à l’échantillon établi à Paris. Un maître coloriste. Quelqu’un qui travaille la colorimétrie, qui mélange donc les coloris, tandis que, jusque dans les années 70, les teinturiers étaient individuellement spécialistes d’une seule couleur. « Il existe plus de 6 millions de coloris et j’arrive à en voir 1,6 million environ, afin de pouvoir les distinguer sur un dégradé. Cette quantité est la partie du spectre des longueurs d’ondes que nous sommes capables de voir avec l’œil humain, de l’infrarouge à l’ultraviolet, en somme ». La passion, le destin de Matthieu ont donc été scellés sur un green. Aujourd’hui, dans son atelier de Belleville, il travaille, secondé par Irudayathan Luther, pour des clients allant de la haute couture (Lacroix, Dior), à Reporters sans frontières (pour teinter un gilet pare-balle du noir au vert), en passant par Cuisine TV (pour étalonner des vêtements de cuisiniers). « Il m’est arrivé de teinter un jean de Lenny Kravitz à peau de poisson (mulet) via John Galiano et je bosse pour les Folies Bergère en teignant des plumes. Lorsque je reçois un tissu, la première chose que je fais est de le toucher, puis j’examine sa blancheur ». Il se crée une relation sensuelle avec la matière. Je fais constamment la cuisine avec mes colorants. C’est comme si j’évaluais la vigne, sa maturation. J’avance en équilibrant, au milligramme près, comme on goûte à la cuve ; plus tard ». D’ailleurs, il arrive à Matthieu Le Tessier de tremper un doigt dans un bain acide ou bien alcalin afin de vérifier son bon PH (potentiel hydrogène). Il y a deux sortes de bains, en effet, et l’on retrouve encore une analogie avec l’univers de la dégustation : le bain en milieu acide est réservé aux matières animales (soie, laine, plume), tandis que le bain en milieu alcalin est réservé aux matières végétales (paille, coton, lin).
Cet amateur de vins qui possède une cave depuis longtemps, parce que son père l’initia tôt, n’aime rien comme visiter des vignobles et écouter des vignerons. « Il y a de troublantes similitudes avec mon travail : l’association des cépages c’est mon association de colorants. Je décide, moi aussi, à un moment donné, d’arrêter le mélange des pigments lorsque j’atteins un but, une formule fixée au préalable –comme on veut faire un vin comme ci ou comme ça ». Matthieu aime la difficulté et préfère chercher tel orange à partir de jaunes et de rouges plutôt qu’à partir d’une gamme d’orangés, « c’est plus ludique, comme de tâtonner lorsqu’on vinifie ». Ses cuves de travail sont vivantes, comme le vin. L’instabilité les apparente à un être en mouvement. Reproduire un colori est chaque fois un recommencement, car cela ne dépend pas ici de la météo, mais de la « dureté » de l’eau (plus ou moins savonneuse) et des températures. Une idée surgit dans notre conversation, qui serait de reproduire l’exacte couleur des vins de chaque grande région viticole, avec les variétés spécifique de blancs et de rouges… À creuser. Reste l’étape fondamentale de la dégustation –celle du nez- qui échappe au travail de Matthieu Le Tessier, encore que les parfums des matières brutes existent bien, mais il convient de les neutraliser en les teintant. « Le toucher comme la vue (l’œil) sont ô combien servis. La bouche, vous avez vu qu’il m’arrivait de mettre un doigt dans le bain !.. Mais l’ouïe n’est pas en reste : le craquement de la soie me touche particulièrement ». Ne parle-t-on d’ailleurs pas de certains contrastes, en matière de dégustation : doux et rugueux, fondant et croquant, solide ou gazeux ?.. L.M.
Le Colorium, Paris 20.
http://www.vinetsociete.fr/magazine/article/le-vin-produit-en-voie-d-extinction-sur-internet
Faites passer, mobilisez-vous, (ré)agissons.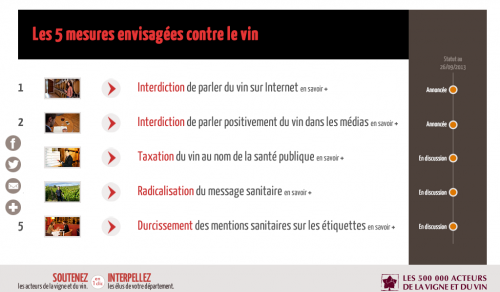

Il est vrai que je suis à fond pour le développement du... Rabelais, que là-bas, je bois le vin rouge local issu de cabernet franc, chinon rien... Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque je fus invité à être intronisé au sein de la confrérie des Entonneurs Rabelaisiens, en qualité de blogueur vins ! Cela se passait le 12 septembre dernier au Bistrot d'à côté (rue 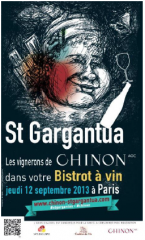 Lalande dans le 14 ème à Paris), à l'occasion de la Saint-Gargantua (en réalité la Saint-Apollinaire, sur le calendrier), qui fut célébrée dans 28 bistrots parisiens. Et c'est dans celui "d'à côté" que le chapitre des intronisations eut lieu. Parmi les nouveaux chevaliers, il y a, de gauche à droite sur la photo ci-dessus : mes consoeurs Ophélie Neiman (blogueuse vins : Miss Glou Glou) et Anne-Victoire Jocteur Monrozier (blogueuse vin : Vicky Wine, à qui j'ai l'impression d'en coller une en prêtant serment et c'est dommage car elle est très mignonne, mais on peut la voir plus bas et des centaines de fois sur son blog), ma pomme, Charlie Darenne (illustrateur), Thierry Cap de Coume (dessinateur, photographe) et Laurent Cazaux (du Bistrot qui nous accueillait). Avouez qu'on a l'air un peu benêts avec nos bavettes, puis avec nos diplômes de chevaliers et nos grosses médailles, mais bon, c'est ainsi. On assume; cul-sec (le deal était de jurer de défendre les vins de Chinon en tous lieux, puis de vider le vase afin d'obtenir la médaille. Et à 17 h, c'est pas facile...).
Lalande dans le 14 ème à Paris), à l'occasion de la Saint-Gargantua (en réalité la Saint-Apollinaire, sur le calendrier), qui fut célébrée dans 28 bistrots parisiens. Et c'est dans celui "d'à côté" que le chapitre des intronisations eut lieu. Parmi les nouveaux chevaliers, il y a, de gauche à droite sur la photo ci-dessus : mes consoeurs Ophélie Neiman (blogueuse vins : Miss Glou Glou) et Anne-Victoire Jocteur Monrozier (blogueuse vin : Vicky Wine, à qui j'ai l'impression d'en coller une en prêtant serment et c'est dommage car elle est très mignonne, mais on peut la voir plus bas et des centaines de fois sur son blog), ma pomme, Charlie Darenne (illustrateur), Thierry Cap de Coume (dessinateur, photographe) et Laurent Cazaux (du Bistrot qui nous accueillait). Avouez qu'on a l'air un peu benêts avec nos bavettes, puis avec nos diplômes de chevaliers et nos grosses médailles, mais bon, c'est ainsi. On assume; cul-sec (le deal était de jurer de défendre les vins de Chinon en tous lieux, puis de vider le vase afin d'obtenir la médaille. Et à 17 h, c'est pas facile...).



©KOEphotography.com
Voici un papier retrouvé à l'instant dans mes archives et que publia une revue d'histoire. A l'heure où l'on pense déjà fort au lauréat du plus prestigieux des prix littéraires français, voici une évocation historique de ce restaurant chargé d'anecdotes.
(Personnellement, et puisque personne ne me pose la question, je donne Jean-Philippe Toussaint -pour son roman Nue, que publie Minuit le 5 septembre prochain- vainqueur. Nue clôt le cycle romanesque consacré à Marie Madeleine Marguerite de Montalte, après Faire l'amour, Fuir, et La vérité sur Marie. Quatre bijoux). Et vous?
 « Drouant dérive du germanique drogo, qui signifie quelque chose comme le bon combat ». C’est Hervé Bazin qui parle. L’auteur de « Vipère au poing » qui fut un membre marquant de l’Académie Goncourt, savait de quoi il en retournait dans le salon du premier étage. Le bon combat demeure, qui fait triompher le livre, au restaurant Drouant, chaque année à l’heure du déjeuner, début novembre…
« Drouant dérive du germanique drogo, qui signifie quelque chose comme le bon combat ». C’est Hervé Bazin qui parle. L’auteur de « Vipère au poing » qui fut un membre marquant de l’Académie Goncourt, savait de quoi il en retournait dans le salon du premier étage. Le bon combat demeure, qui fait triompher le livre, au restaurant Drouant, chaque année à l’heure du déjeuner, début novembre…
Le génie d’un lieu provient du lien entre des êtres géniaux. Ici, l’escalier est signé Ruhlmann, la cuisine actuelle Antoine Westermann, l’atmosphère est résolument Art déco ; l’esprit, Goncourt.
L’âme du lieu est double : littéraire et gourmande. Gastronomie et littérature ont toujours fait bon ménage. La plume tombe vite le masque lorsque la fourchette montre les dents.
Le restaurant de la Place Gaillon (Paris 2ème), n’échappe pas à la règle. Mieux : il la dicte depuis un siècle et un an. Une paille !
Entrer chez Drouant, c’est pénétrer l’antre d’un club fermé et fixé à dix membres selon les vœux des frères Edmond et Jules de Goncourt.
L’Académie française a ses fauteuils, ses habits verts et ses épées pour ses pensionnaires. L’Académie Goncourt elle, a ses couverts gravés au nom de ses membres. Cela vous pose. « Cette nuance, soulignait Roland Dorgelès, aide à prouver combien les académiciens de la place Gaillon se veulent des copains au sens étymologique, « ceux qui partagent le pain ». Plus prosaïquement, ajoutait Dorgelès, on parle des déjeuners Goncourt et des séances du quai Conti ». Mais la querelle de bretteurs n’a pas eu lieu. Les Académies ne se tordent pas le nez et observent au contraire un respect mutuel qui n’a pas de prix.
Pour l’historien, Drouant évoque aussitôt Louis XV, qui aimait chasser au faucon à proximité de la porte Gaillon, l’une des six percées dans l’enceinte bastionnée dont Louis XIII avait ceinturé la capitale.
L’homme de lettres pense immédiatement à Zola, qui campa « Au bonheur des dames » dans ce quartier, et nourrit son livre des scènes de rue quotidienne de la place et ses alentours.
L’amateur gourmand pense à la boucherie Flesselles, qui fut célèbre dans les années 1870 et qui fut remplacée par le restaurant Drouant en 1880.
Lorsque l’Alsacien Charles Drouant, échouant à Paris, ouvre alors un modeste café-tabac, il est loin d’imaginer que son nom va se perpétuer ainsi. Il l’agrandit néanmoins sa petite échoppe, en fait un bistrot que des artistes et des écrivains ont la bonne idée de fréquenter : Pissaro, Daudet père et fils, Renoir, Rodin, … La bande d’intellos artistes s’agrandit, peintres, sculpteurs, poètes, journalistes, romanciers, agrandissent le cercle et en font leur repaire. Leur rituel dîner du vendredi forge la célébrité du lieu dans le métal le plus résistant.
Le prix Goncourt existe depuis 1903 (il fut attribué pour la première fois, le 28 août de cette année-là, à Jean-Antoine Nau pour son roman « Force ennemie ». Déjà tout un programme qui renvoie à la sagacité de Bazin à propos de « Drouant / drogo »…).
Le prix ne commencera à être décerné chez Drouant que le 31 octobre 1914 par la Société littéraire des Goncourt. Le prix ne fut pas décerné cette année-là pour cause de guerre (et il fut par ailleurs refusé une seule fois, en 1951 par Julien Gracq -photo-, pour son magnifique roman « Le rivage des Syrtes ». L’immense écrivain eut toujours « La littérature à l’estomac » et pas devant les flashes et les caméras…).
L’Académie est donc fidèle à Drouant depuis 1914. Le testament d’Edmond de Goncourt résume l’affaire : « Je nomme pour exécuteur testamentaire mon ami Alphonse Daudet, à la charge pour lui de constituer dans l’année de mon décès, à perpétuité, une société littéraire dont la fondation a été, tout le temps de notre vie d’hommes de lettres, la pensée de mon frère et la mienne, et qui a pour objet la création d’un prix de 5000F destiné à un ouvrage d’imagination en prose paru dans l’année, d’une rente annuelle de 6000F au profit de chacun des membres de la société » .
Il est précisé que les dix membres désignés se réuniront pendant les mois de novembre, janvier, février, mars, avril, mai et que le prix sera décerné dans le dîner de décembre… Les frères Goncourt avaient en effet voulu recréer l’atmosphère des salons littéraires du XVIIIème siècle, et aussi l’ambiance des déjeuners et dîners littéraires mondains du XIXème, comme les fameux dîners Magny. Jules meurt trop tôt, en 1870. Edmond anime alors seul le Grenier, puis la Société littéraire, qui devient Académie afin de se démarquer de l’autre, la Française du quai Conti, parce qu’elle refusa l’immortalité à de nombreux grands écrivains comme Flaubert, Zola, Balzac, Baudelaire et Maupassant.
Encore le bon combat. Et c’est à vous donner envie de paraphraser Sacha Guitry lorsqu’il conchiait la Légion d’Honneur : «il l’avait, encore eut-il fallu qu’il ne l’eut pas mérité »…
48 heures après la mort d’Edmond en 1896 –il avait 74 ans-, son notaire, Maître Duplan, lisait ainsi à Alphonse Daudet et Léon Hennique, ses légataires universels, le testament précité. L’aventure était lancée.
Depuis, le Goncourt est le plus convoité des très nombreux prix littéraires français. « Il y en a davantage que des fromages », plaisantait François Nourissier. Il assure gloire et fortune à un auteur et à son éditeur. Le restaurant Drouant bénéficie par conséquent depuis longtemps du mythe Goncourt. Abriter l’Académie équivaut à posséder le Trésor des Pirates. Un trésor métaphysique.
À l’étage, chez Drouant, nous trouvons les Salons Goncourt, Apollinaire, Colette, Ravel et Rodin. Il est très agréable d’y déjeuner ou dîner dans la grande salle du rez-de-chaussée, près du monumental escalier.
La veille de notre visite au restaurant, j’y avais retrouvé le lauréat 1976, Patrick Grainville, afin de lui demander un texte pour les éditions que je dirigeais alors.
Lors de notre second passage, Jorge Semprun (mort depuis) y mangeait en agréable compagnie à une table voisine. Juillet tirait à sa fin. L’esprit du lieu était habité à tous les étages par l’Académie. Nous prenions notre repas en bas, avec une amie.
La mosaïque bleue travaillée à la feuille d’or, le fer forgé, les glaces immenses pour « narcisser » entre la poire et le fromage ou parmi les superbes peintures qui ornent les murs, le service élégant et discret, prévenant et jamais obséquieux, escortèrent avec grâce le foie de canard marbré de pigeon et sa gaufre au lard fumé, la blanquette de barbue et de queues de langoustines et le risotto à la truffe d’été, le carré d’agneau et son gnocchi… Les fameuses feuilles de chocolat en hommage à Jules et Edmond sont un dessert des éditions… Ganache, reconnues dans le village « germanopralin ». Le vin de Vacqueyras fut parfait du début à la fin. Joie ! C’est à peu près le menu qui fut servi en 1903 lors de l’attribution du premier Goncourt (bisque d’écrevisse, barbue sauce poivrade, terrine de foie gras…), chez Champeaux.
Les membres de l’illustre Académie doivent leurs couverts à leur nom, à André Billy (académicien de 1943 à 1971, qui en suggéra la création. Et c’est Mr Odiot, fondeur en vermeil de la Place de la Madeleine qui grava fourchettes et couteaux. De là à penser avec feru Robert Sabatier, que c’est avec ceux-ci que l’on fait de la cuisine littéraire, il n’y a qu’un « plat » que nous ne franchirons pas.
Plutôt citer Jacques de Lacretelle, qui résumait merveilleusement l’alliance de la littérature avec la gastronomie. Composer un roman ou un menu relèverait d’une alchimie voisine : « C’est un art (la gastronomie) où il faut suivre une tradition, mais où l’on peut tout inventer. Je ne vois pas de plus belle définition pour dire ce qu’est le talent littéraire ». L.M.
TROIS DE MES RÉCENTES CHRONIQUES PARUES DANS TÉLÉ 7 JOURS
 Des noeuds d'acier, par Sandrine Collette
Des noeuds d'acier, par Sandrine Collette
Théo Béranger, quarante ans, vient de purger de longs mois de prison pour une rixe fratricide. La taule n’a pas réussi à briser ce costaud un peu violent. Il part en forêt pour faire le point. Tombe sur deux vieux fous armés qui le capturent et en font son esclave. Enchaîné, battu, sans eau, à peine nourri au fond d’une cave, corvéable à l’extrême, il perd toute humanité, devient moins qu’un chien. Cette terrifiante descente aux enfers décrite au scalpel tient en haleine et signe l’entrée fracassante dans le roman noir d’une auteure encore inconnue.
Roman, Denoël, Sueurs froides, 270 pages, 17€
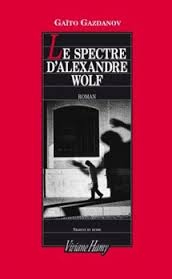 Le spectre d’Alexandre Wolf, par Gaïto Gazdanov
Le spectre d’Alexandre Wolf, par Gaïto Gazdanov
Un soldat russe blanc tue un soldat bolchevique un jour de 1917. Ce meurtre hante sa vie. Emigré à Paris, devenu journaliste, il tombe sur une nouvelle écrite par un certain Alexandre Wolf qui décrit précisément l’épisode obsédant. Le narrateur n’a alors de cesse de vouloir trouver cet auteur. Une histoire d’amour fou pour la fascinante Elena ajoutera du mystère à sa quête. La rencontre avec Wolf, spectre vivant, aura lieu, mais ne fera que corser l’ensemble d’un roman captivant où l’intensité de la narration et la force des personnages rappellent Dostoïevski.
Roman, éditions Viviane Hamy, 172 pages, 18€
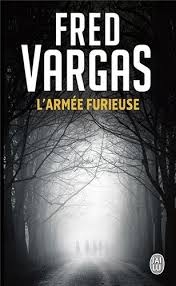 L’armée furieuse, par Fred Vargas
L’armée furieuse, par Fred Vargas
Un meurtre par étouffement à la mie de pain ouvre les nouvelles aventures de l’attachant commissaire béarnais Jean-Baptiste Adamsberg, flanqué de son complice Danglard et ici de son fils Zerk ainsi que d’un pigeon blessé aux pattes. Puis c’est le mystère d’une légende tenace du XI ème siècle, celle de l’Armée furieuse, des revenants qui chevauchent deux ou trois fois par siècle et se saisissent des méchants pour les tuer d’atroces façons dans le bocage normand, vers Ordebec, qui va hanter ce roman aux rebondissements captivants. Adamsberg n’y croit pas, mais il enquête depuis qu’une femme, Lina, prétend avoir vu passer l’Armée, car des personnages disparaissent... Rustique, poétique, fantastique, la magie Vargas opère.
Roman, 442 pages, J’ai Lu, 7,90€
Piqure de rappel : papier paru il y a un an jour pour jour pour évoquer une sorte de vide historique : LE MONDE 6:7:12.pdf
Ce reportage paraît dans le n° spécial Pays basque de Pyrénées magazine : PPYRH0052Mauléon.pdf
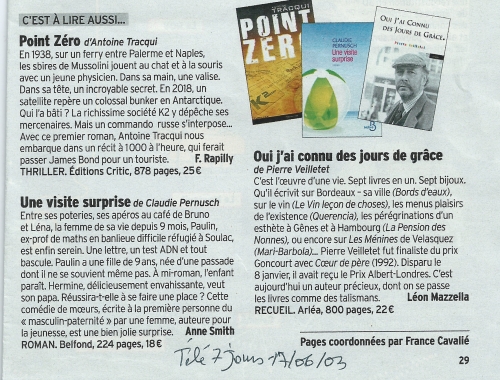
Nota : Le prix Albert-Londres récompensa le journaliste Pierre Veilletet (texte paru cette semaine dans Télé 7 Jours).

Tel est le titre du long papier introductif (qui suit un bel édito), du numéro spécial Pays basque que publie Pyrénées magazine pour l'été 2013, sous la houlette de Marie Grenier (actuellement en kiosque, couverture ci-dessus). J'y signe aussi Les fêtes de Mauléon, un reportage réalisé en juillet dernier. Ca me fait drôle, car j'ai été rédacteur en chef de Pyrénées magazine et je suis un peu à l'origine de Pays basque magazine. Bon, voilà le truc sur cette indéfinissable âme basque :
----------
Dans mon pays, on remercie. Ce trait lapidaire de l’immense poète provençal René Char peut s’appliquer à l’âme basque. Ici aussi, on remercie. On reconnaît. On sait reconnaître d’un coup d’œil l’authenticité, on sait distinguer le passager sincère du faisan, on décline l’invitation du bavard, on observe le taiseux, on se toise d’un regard droit comme une pelote bien frappée. La suite appartient au temps. Celui que l’on sait donner sans compter si l’autre se montre digne de. De quoi au juste. Oh, de pas grand-chose de palpable à vrai dire, mais de tellement important, de si capital à la vérité. Un truc, une complicité, un silence éloquent, un partage fort comme un frisson, un truc quoi. Le « ça ». Un je-ne-sais-quoi-de-presque-rien-du-tout, une connivencia. Sans ça, tu passes pas, tu restes là, voire tu rebrousses. Tu te casses quoi. C’est ainsi. Ainsi que la mémoire n’est pas trahie par de sournois virus, que le présent n’est pas empégué par de nuisibles invasions, que l’âme peut continuer de se sculpter au fil des jours et des nuits, à la faveur des étoiles et du savoir être de ceux qui remercient.
Qu’on ne se méprenne cependant pas : l’excès de méfiance nuit au développement de l’âme, la chose est entendue. Le message est passé. L’esprit n’est plus crispé sur ses traditions réputées intouchables selon une vieille rengaine devenue ringarde. Evoluons, disent les jeunes. On entend, disent les vieux. L’âme épouse l’histoire, bat la mesure de son temps, regarde devant, adossée au tronc de son précieux passé. Le tronc justement. Ce tronc commun qui n’est pas si singulier qu’il en a l’air. Qui force le respect, attire la curiosité. À présent, il convient de définir les contours, de croquer cette âme au fusain à la manière d’un jardinier paysagiste. Car elle est vaste, protéiforme, complexe et d’un bloc, paradoxalement. La nature, tantôt rugueuse, tantôt clémente du Pays a forgé l’âme basque.
Demandons-nous s’il est nécessaire de n’être pas Basque pour définir cette essence, à l’instar des historiens subtils de la psychologie sociale des peuples, comme le Britannique Théodore Zeldin qui a su mieux que n’importe quel observateur définir les passions françaises. Mieux vaut être un brin étranger à la cause, ou du moins avoir en soi la distance nécessaire pour pouvoir évaluer un esprit, soupeser cette fameuse âme à défaut de savoir la circonscrire exactement. Toute personne en empathie physique, géographique, sentimentale, ayant des attachements –réputés bien plus forts que d’ordinaires attaches-, avec la terre du Pays basque, peut éprouver des sensations qui touchent à cet impalpable recherché, à ce quasi-indéfinissable. « La voix, c’est ce que l’on a de plus précieux, c’est presque l’âme », me chuchote souvent une amie. Il y a un peu de cela dans l’âme basque. Au-delà du silence essentiel qui en dit long sur l’acceptation de l’un par l’autre, il y a comme une voix, une parole qui chuchote à qui sait écouter, indique le chemin ; montre la voie en somme.
Si nous décidons de bâtir notre demeure en terre basque, si celle-ci devient la terre élue comme on le dit d’un peuple, la résidence choisie comme on le dit de l’immigration, un courant certain, fluide et franc surtout, passe. Car c’est sur cette terre à l’âpreté profondément humaine que l’on peut se sentir habiter le monde. Le Pays basque happe. Un mot de Jorge Luis Borgès l’exprime avec une infinie justesse : « J’habitais déjà ici et ensuite j’y suis né ». Grandir, évoluer en terre basque permet d’en ressentir les bonheurs de l’enracinement serein, progressif ; souple. Se frotter aux êtres comme aux éléments permet d’en éprouver leur rigueur et leur exigence. Le Pays basque est une région de confins, ouverte sur le monde avec son balcon atlantique, qui se noie quelque peu dans des cultures cousines du Sud-Ouest et s’adosse aux Pyrénées pour mieux se tenir face aux vents. Ainsi fiance-t-il avec talent paysages et caractères. Le Pays basque s’offre à l’autre en le voyant venir. La vie d’un homme dépend tellement du génie des lieux et du beau hasard des rencontres qu’il convient d’en rater le moins possible. Davantage qu’ailleurs peut-être, le Pays basque sculpte l’autre. Nous y éprouvons avec force le sens de la fidélité et celui du bonheur. Nous y apprenons chaque jour l’amour et l’amitié qui dessinent notre géographie intérieure et délimitent nos frontières affectives. Ce territoire est une aporie heureuse. La chose est rare et par conséquent à préserver. Nous y cherchons ce qui est juste et bien. La tranquillité de l’esprit. Le repos du corps vivifié. La stimulation de la parole, le courage de regarder.
Le Pays basque est peuplé de femmes et d’hommes jamais blasés de leur enviable quotidien. Ils s’émerveillent sans forfanterie du pur plaisir d’exister. Cette terre enseigne le dédain du chiqué. Nos frères de joie vivent selon l’humeur des éléments : l’océan, les caprices du climat, la douceur des villages, le vent du Sud qui monte les esprits comme du lait, la montagne qui dit non. Cette façon d’être paysanne –un œil au ciel, l’autre sur la terre et cet instinct de cueilleur –saisir le bonheur, oiseau migrateur, à chaque éclaircie, apparentent l’homme d’ici à un épicurien forcé de limiter ses désirs. C’est pourquoi il est étincelant. Sa manière de vivre est une philosophie de l’instant partagé. Ce n’est pas un sage. Il sait que la parole économise l’action, mais il préfère agir, donner son pays. C’est un passeur. Ici, on s’ouvre à l’autre de manière oblative et sans se mentir à soi-même. L’âme du Pays basque est aussi une morale. Milesker. L.M.
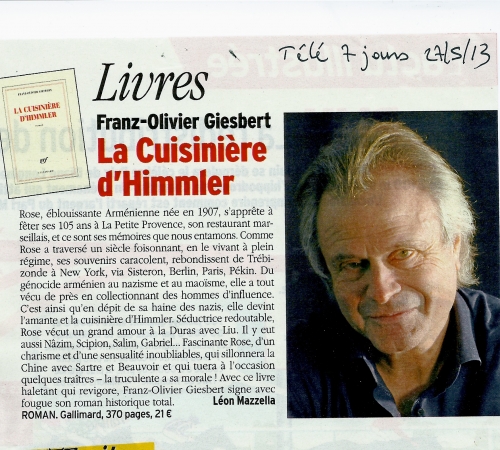
Trois de mes récentes petites chroniques parues dans Télé 7 Jours.
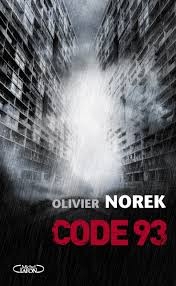 Code 93, par Olivier Norek
Code 93, par Olivier Norek
L’auteur, lieutenant de police à la section Enquête et Recherche du SDPJ 93, le Service départemental de police judiciaire de Seine Saint-Denis, sait ce qu’il endure. Du lourd chaque jour. Soit des crimes gratuits, des violences extrêmes, une jeunesse qui se bousille, les drames de la banlieue. Ce premier roman n’est pas du Fred Vargas, mais si ça y ressemble. Un air des scénarios d’Olivier Marchal flotte entre ses pages. Il y a beaucoup d’hémoglobine, des faits dingues comme un mort qui se réveille en pleine autopsie ou un toxico qui périt par autocombustion et surtout Coste, double de l’auteur, flic sensible, mystérieux, attachant, à la fois dur à cuire et cœur d’artichaut. Code 93 se lit comme on regarde Les Experts : avec un plaisir vrai.
Roman, Michel Lafon, 300 pages, 19€
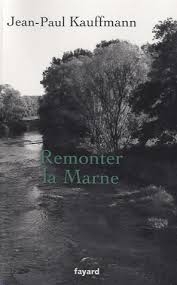 Remonter la Marne, par Jean-Paul Kauffmann
Remonter la Marne, par Jean-Paul Kauffmann
L’écrivain décida de remonter à pied les 520 km de la rivière depuis sa confluence avec la Seine aux portes de Paris jusqu’à sa source sur le plateau de Langres, lesté d’un sac à dos de 30 kg contenant notamment une provision de cigares. Le voyage à pied permet de scruter une région chargée d’histoire, d’observer les paysages avec un regard de géographe et les riverains avec un œil d’ethnologue bienveillant. Il nécessite surtout un talent de prosateur à l’écriture somptueuse. Jean-Paul Kauffmann a le don du mot juste. Ce récit est aussi celui des sens, surtout celui de l’olfaction. « Chemin faisant », la Marne devient un être vivant. Nous croisons des écrivains locaux comme Bossuet et des compagnons de marche : Bachelard, Ponge. Et surtout des citoyens de bords de Marne indociles appelés « conjurateurs ». Un voyage profondément humain et au plus près de la nature, au cœur d’un extrait de France comme on le dit d’un livre.
Fayard, 264 pages, 19,50€
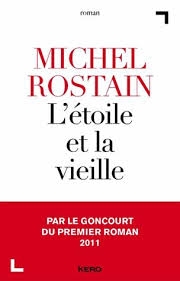 L’étoile et la vieille, par Michel Rostain
L’étoile et la vieille, par Michel Rostain
L’étoile, c’est Odette, célèbre accordéoniste qui marqua la France des années 50. La vieille, c’est encore elle, l’artiste qui refuse d’admettre que les désastres de la vieillesse pourraient l’empêcher d’effectuer sa dernière tournée. Odette, c’est Yvette Horner, une étoile qui ne brille plus. Le livre conte l’histoire forte entre la star et son « metteur » (en scène), double de M.Rostain, au cours des répétitions quotidiennes ; jusqu’à l’annulation du spectacle. « Un artiste meurt toujours une première fois avant de mourir physiquement ». Un roman poignant à partir d’une histoire vraie, par l'auteur du" Fils", Goncourt du premier roman 2011.
Roman, Kero, 222 pages, 17€
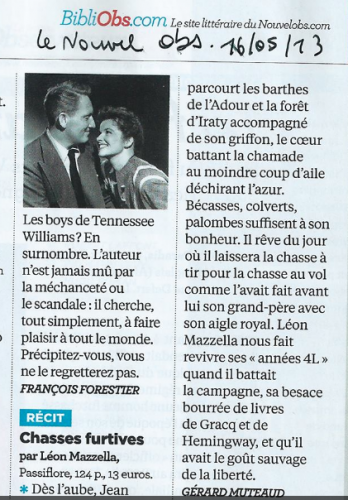

Chez votre libraire, ou bien directement chez l'éditeur (même prix : port offert) : http://bit.ly/Z0xUXT
Quelques unes de mes chroniques parues récemment dans Télé7jours.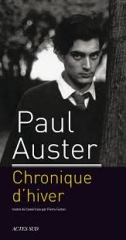
Chronique d’hiver, par Paul Auster
À l’âge de 64 ans, un grand écrivain américain se penche sur son passé à la deuxième personne. En se parlant à lui-même, il nous tutoie. Un homme est entré dans l’hiver de sa vie et se souvient. Ce premier volume de mémoires (le second aura trait au travail d’écriture) saisit l’auteur à l’âge de 3,5 ans lorsqu’une glissade lui fait frôler la mort. Avec une sincère lucidité, Paul Auster revisite les moments saillants –et anodins, donc universels-, d’une existence traversée depuis 30 ans par l’amour total -pour et- d’une seule femme, l’écrivain Siri Hustvedt. On y croise leur fille Sophie, des êtres qui comptent et surtout une multitude de faits quotidiens, consignés ici parce qu’ils devaient frapper la porte de l’esprit. Crépusculaire, grave et beau, c’est le livre le plus touchant d’Auster. L.M.
Mémoires, Actes Sud, 252 pages, 22,50€
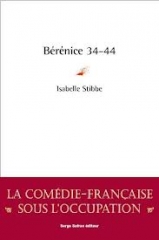
Bérénice 34-44, par Isabelle Stibbe
Son prénom la prédestinait. Sa vocation sûre de comédienne la fera entrer au Conservatoire, puis à la Comédie-Française en 1937 contre l’avis de son père, le fourreur parisien Maurice Capel, né Moïshe Kapelouchnik. C’est la consécration à 18 ans pour Bérénice de Lignères (son nom d’artiste). Mais la seconde guerre éclate et la barbarie nazie n’épargne pas la Maison de Molière, où nous croisons notamment Louis Jouvet. Ce premier roman à l’écriture enveloppante conte le destin d’une femme courageuse dont les origines juives seront dénoncées, dans un Paris occupé admirablement décrit. L.M.
Roman, Serge Safran éditeur, 320 pages, 18€
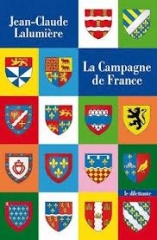
La Campagne de France, de Jean-Claude Lalumière
Installés à Biarritz, Alexandre et Otto donnent dans le voyage culturel. Forcés de revoir leurs ambitions à la baisse, ils inscrivent Bergues (Bienvenue chez les Ch’tis) à leur programme, via quand même la Gironde de François Mauriac, Oradour-sur-Glane et le Limousin de Jean Giraudoux. Leur « Cultibus » embarque douze retraités Luziens forts en gueule et aux préoccupations terre-à-terre. Cela donne une comédie désopilante et burlesque fleurie d’une kyrielle d’aventures rocambolesques. L’équipée est gratinée et l’auteur excelle dans la satire raffinée. L.M.
Roman, le dilettante, 288 pages, 17,50€

La montée des cendres, par Pierre Patrolin
Dans ce roman singulier, il pleut sur Paris. Beaucoup. Et puis il neige. Et la Seine grossit. Un homme, qui vient d’emménager au cœur de la capitale, a trouvé un briquet laissé à côté de sa cheminée. Dès lors, alors que la ville se noie, ce Robinson urbain se sent investi d’une mission : entretenir la flamme fragile que, par réflexe, il a allumée en s’installant chez lui. Mettre la main sur tout ce qui brûle, dans les rues, les jardins, devient son obsession… Où cela peut-il le conduire ? Une fable poétique, dans la veine de La Route, de McCarthy. L.M.
Roman. P.O.L., 188 p., 16 €
 Ignacio Ramonet (Le Monde diplomatique) livre une histoire synthétique de la presse écrite française et surtout des crises qu'elle traverse, dans son précieux essai intitulé L'explosion du journalisme. Des médias de masse à la masse des médias (folio actuel). La révolution numérique, les réseaux sociaux qui font de n'importe qui un producteur d'informations capable de s'improviser journaliste et qui sacralisent ainsi l'amateurisme; le phénomène Wikileaks (un journalisme sans journalistes), la crise grave bien sûr qui rend le lecteur de presse papier rétif à l'achat d'un contenu qu'il prend l'habitude de lire désormais sur sa tablette, son ordi, son téléphone -et aussi en raison d'une perte de crédibilité aiguë de la presse en général; la pub qui déserte les supports traditionnels, la fermeture des kiosques, Presstalis, principal acteur chargé d'acheminer notre canard préféré dans lesdits kiosques qui licencie 50% de son personnel, faute de taff, les charrettes dans les rédac invitant à passer au guichet en zappant l'étape caisse, etc. De Sud-Ouest à El Pais en passant par tant de confrères, nous en connaissons hélas la musique... Le tableau est noir mais dopant, à la réflexion, car Gutenberg n'est pas mort, même si on annonce sa disparition depuis plus d'un siècle; la presse n'ayant pas encore vécu son Age d'or.
Ignacio Ramonet (Le Monde diplomatique) livre une histoire synthétique de la presse écrite française et surtout des crises qu'elle traverse, dans son précieux essai intitulé L'explosion du journalisme. Des médias de masse à la masse des médias (folio actuel). La révolution numérique, les réseaux sociaux qui font de n'importe qui un producteur d'informations capable de s'improviser journaliste et qui sacralisent ainsi l'amateurisme; le phénomène Wikileaks (un journalisme sans journalistes), la crise grave bien sûr qui rend le lecteur de presse papier rétif à l'achat d'un contenu qu'il prend l'habitude de lire désormais sur sa tablette, son ordi, son téléphone -et aussi en raison d'une perte de crédibilité aiguë de la presse en général; la pub qui déserte les supports traditionnels, la fermeture des kiosques, Presstalis, principal acteur chargé d'acheminer notre canard préféré dans lesdits kiosques qui licencie 50% de son personnel, faute de taff, les charrettes dans les rédac invitant à passer au guichet en zappant l'étape caisse, etc. De Sud-Ouest à El Pais en passant par tant de confrères, nous en connaissons hélas la musique... Le tableau est noir mais dopant, à la réflexion, car Gutenberg n'est pas mort, même si on annonce sa disparition depuis plus d'un siècle; la presse n'ayant pas encore vécu son Age d'or.
Le vrai journalisme : de terrain, de reportage, d'investigation, a du plomb dans l'aile car il est devenu coûteux, voire jugé inutile (par certaines rédactions qui sont tombées sur la tête!) dans un monde en pleine mutation technologique et où l'accès instantané à une overdose d'informations planétaire, mondialisée permet de faire l'économie du terrain... Et donc de la qualité (qui dit reportage dit automatiquement terrain et un papier fait sans terrain est un papier sans saveurs, voire sans consistance; de toute façon sans grand intérêt). Mais cette forme de journalisme, rigoureux par essence (et cela devrait être un pléonasme), reste justement le dernier rempart contre la médiocrité de la course à l'info (la dictature de l'urgence, voire du sensationnel seulement), qui néglige jusqu'à la vérification élémentaire de la véracité et propage la rumeur à l'occasion, entretenant ainsi une diminution de l'exigence d'un lecteur saoulé, eu égard à la faiblesse neuronale d'une certaine offre éditoriale. Car le terrain est gage de qualité s'il est assorti du travail normal de décryptage, d'analyse, de mise à distance du sujet : le B.A BA.
Et cela, seule la presse écrite -de qualité- peut encore l'offrir à un lecteur conscient 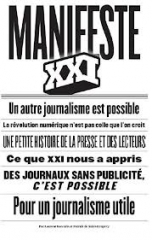 de la valeur du travail correctement fait ; car il en reste, de ces lecteurs. Ramonet dresse par ailleurs un tableau complet de l'univers de l'information reloaded : le Web, les sites d'info gratuits, les payants (aucun n'ayant encore trouvé un modèle économique qui pourrait être suivi), les pure players, le pari fait par certains groupes de presse sur la tablette comme outil miraculeux et garant de l'avenir de la presse "écrite", etc.
de la valeur du travail correctement fait ; car il en reste, de ces lecteurs. Ramonet dresse par ailleurs un tableau complet de l'univers de l'information reloaded : le Web, les sites d'info gratuits, les payants (aucun n'ayant encore trouvé un modèle économique qui pourrait être suivi), les pure players, le pari fait par certains groupes de presse sur la tablette comme outil miraculeux et garant de l'avenir de la presse "écrite", etc.
L'essai vivifiant quant au fond, d'Ignacio Ramonet est à rapprocher du passionnant Manifeste (une plaquette de vingt pages) que le mook XXI offre avec son n°21 : Un autre journalisme est possible, disent ses rédacteurs (Patrick de St-Exupéry et Laurent Beccaria), car parier aveuglément sur la révolution numérique est peut-être un leurre, que des journaux sans publicité sont possibles, et qu'un journalisme utile a un bel avenir devant lui, pour peu qu'il revienne un peu aux "fondamentaux" : le temps, le terrain, le rôle capital de l'image, la cohérence; l'indépendance, l'audace, le désir de refonder une presse pour un lecteur et non pas pour des annonceurs. Cette plaquette aura beaucoup fait parler d'elle dans le Landerneau et au-delà heureusement -preuve qu'un certain nombre de lecteurs s'interrogent sérieusement à propos des dérives d'une certaine presse sans qualités et qui pourrait devenir une nouvelle norme si l'on n'y prend pas garde.
En cela, le rôle du journaliste éclairé rejoint celui du  philosophe dans la cité. C'est à lui que revient le rôle d'éveilleur des esprits lorsque ceux-ci sont atteints des syndrômes du laisser-faire, de la banalité du mal (cher à Hannah Arendt); bref lorsqu'ils sont sous anesthésie sociale. L'aiguillon, la mouche du coche, l'empêcheur de penser en rond, c'est autant ce grain de sable qui dérange (le journaliste selon Edwy Plenel), que le philosophe. Socrate n'a-t-il pas un peu inventé une certaine forme de journalisme de qualité, avec la fameuse ironie qui
philosophe dans la cité. C'est à lui que revient le rôle d'éveilleur des esprits lorsque ceux-ci sont atteints des syndrômes du laisser-faire, de la banalité du mal (cher à Hannah Arendt); bref lorsqu'ils sont sous anesthésie sociale. L'aiguillon, la mouche du coche, l'empêcheur de penser en rond, c'est autant ce grain de sable qui dérange (le journaliste selon Edwy Plenel), que le philosophe. Socrate n'a-t-il pas un peu inventé une certaine forme de journalisme de qualité, avec la fameuse ironie qui 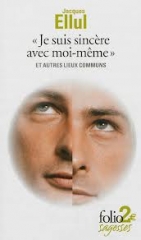 caractérise sa réthorique (lorsqu'il s'adressait aux Sophistes ou aux simples citoyens d'Athènes et qui séduisit tant le Camus journaliste*), et même l'art de conduire un reportage, avec la maïeutique, ou l'art d'accoucher les esprits?
caractérise sa réthorique (lorsqu'il s'adressait aux Sophistes ou aux simples citoyens d'Athènes et qui séduisit tant le Camus journaliste*), et même l'art de conduire un reportage, avec la maïeutique, ou l'art d'accoucher les esprits?
Ce sont autant de (re)lectures passionnantes, auxquelles il conviendra d'ajouter une réédition d'un livre de Jacques Ellul : "Je suis sincère avec moi-même" et autres lieux communs (folio 2€) : extraits d'Exégèse des nouveaux lieux communs, et la publication éclairante de Hériter d'Ellul (actes des conférences du 12 mai dernier à l'occasion du centenaire de sa naissance), qui contient notamment les contributions précieuses de Simon Charbonneau, Sébastien Morillon et Jean-Luc Porquet (la collection La Petite Vermillon, de La Table ronde, poursuit -et c'est admirable-, la publication de l'oeuvre capitale d'Ellul : 13 titres sont déjà parus). Ellul, qui répétait à l'envi dans son cours sur La pensée marxiste à Sciences-Po Bordeaux (j'en ai le vif souvenir) : Exister c'est résister, Ellul pour finir, donc, cité dans le Manifeste XXI : Ce qui nous menace ce n'est pas l'excès d'information, mais l'excès d'insignifiance. Dont acte.
*Lire Les devoirs du journaliste, d'Albert Camus, dans Le Monde daté du 17 mars 2012
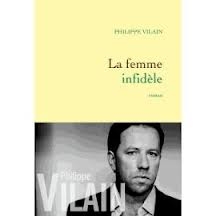 La femme infidèle, de Philippe Vilain
La femme infidèle, de Philippe Vilain
Pierre Grimaldi, expert-comptable, a épousé Morgan Lorenz, consultante. Ils ont 35 ans, pas d’enfant, vivent paisiblement à Paris depuis 8 ans lorsque Pierre découvre que sa femme le trompe. Atterré, il ne parvient pas à l’affronter, l’espionne sans conviction. Ce long monologue comme une lettre à un inconnu explore la psychologie du couple avec talent et mièvrerie mêlés.Un voyage à Naples où l’aveu sera fait, une virée à Capri de Pierre seul, dénoueront l’esprit d’un homme soudain conscient qu’il a droit à plusieurs vies. Lui aussi. Grasset, 160 pages, 14,95€
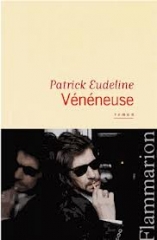 Vénéneuse, de Patrick Eudeline
Vénéneuse, de Patrick Eudeline
Antoine, écrivain parisien branché, tombe fou amoureux de Camille, de 30 ans sa cadette. Elle est « l’Enfer et le Paradis réunis ». Cette Nîmoise déjantée va les engouffrer dans une passion guidée par le sexe. Roman très contemporain à l’écriture hachée (l’auteur est très rock), Vénéneuse fleure le Paris futile des night people en quête et en perte d’eux-mêmes. On y lit l’aveuglement d’un quinqua qu’une beauté volage, attirée par un certain Peter puis par des apprentis toreros, rendra fou. Ce qui rend attachant ce roman trépidant. Flammarion 240 pages, 19€
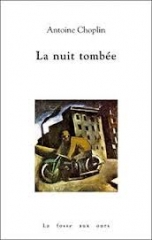 La nuit tombe, d’Antoine Choplin
La nuit tombe, d’Antoine ChoplinGouri prend la route de Kiev à Pripiat, à proximité de Tchernobyl, avec sa moto et une remorque. Il retourne dans la zone interdite où errent des gardes et des voleurs. Fait halte chez d’anciens amis reclus ; irradiés. Resserrés dans l’hébétude comme des animaux dans le froid, ils attendent et se souviennent de la pluie noire. Un silence lourd habite ce road-roman à l’écriture hiératique. Retourner dans la ville fantôme est une folie. Mais Gouri veut revoir son appartement et en rapporter une porte.Son ami Kouzma l’accompagnera.Un air d’apocalypse flotte, qui rappelle « La route » de Cormac McCarthy. La Fosse aux Ours, 128 pages, 16€ Prix France Télévisions.
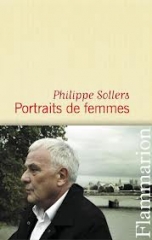
Portraits de femmes, de Philippe Sollers
Voici un livre vrai qui dépeint avec tendresse les femmes qui ont jalonné la vie de Sollers l’érudit. Sa mère d’abord, « bourgeoise décalée », Eugenia, l’employée de maison qui le déniaisa à l’âge de 15 ans, l’écrivain Dominique Rolin, de 23 ans son aînée –une histoire forte, la psychanalyste Julia Kristeva, l’épouse depuis 1967, offrent les pages les plus émouvantes de ce bilan qui dévoile aussi les prénoms des femmes qui ont nourri chacun des livres d’un auteur amoureux des héroïnes de la littérature et de l’Histoire. Un hommage sensible. Flammarion, 160 pages, 15€.
Quatre de mes chroniques plus ou moins hebdomadaires données à Télé 7 Jours (A suivre)
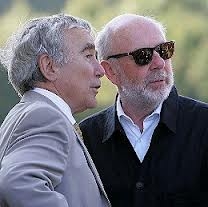 C'est un grand journaliste doublé d'un écrivain précieux, précis qui vient de quitter ce monde à l'âge de 69 ans, le 8 janvier dernier. A Bordeaux. Sa ville. Né à Momuy dans les Landes et d'origine flamande par ailleurs, Pierre Veilletet aura effectué une brillante carrière au journal Sud-Ouest, qu'il pilota, jusqu'à son éviction brutale en 2000 -qu'il ne digéra pas. Prix Albert-Londres 1976 pour ses reportages sur l'agonie de Franco, il préféra rester le premier à Bordeaux au lieu d'être un numéro à Paris. C'était un maître à l'écriture rigoureuse, au ton singulier, hiératique et profond. Un styliste. Un observateur d'une finesse désarçonnante. Un taiseux au sourire rare aussi. Un personnage un rien intimidant mais toujours prompt à lancer un trait d'esprit pour détendre une atmosphère qu'il savait avoir rendue pesante, dans son bureau au journal ou ailleurs par hasard dans les rues de la ville. Veilletet avait le tact inscrit en lui. Et une délicatesse parfois gauche mais jamais empruntée. Il n'était pas d'accès libre. Ce n'est qu'à l'âge de 43 ans qu'il publia son premier livre, le court et dense roman La pension des nonnes, chez Arléa, maison cofondée avec ses amis Jean-Claude et Catherine Guillebaud et à laquelle il restera aussi fidèle que Julien Gracq le demeura à José Corti. L'allusion vaut rapprochement : le choix scrupuleux de l'adjectif, l'usage de l'italique pour appuyer comme on adresse un clin d'oeil entendu, rendent l'écriture de Veilletet voisine, sinon cousine de celle du grand écrivain de Saint-Florent-le-Vieil. Si Querencia et autres lieux sûrs peut faire penser à La première gorgée de bière de Philippe Delerm pour sa thématique, mais avec une autre tenue, une exigence altière, ce recueil de courts textes qui sont autant de bijoux ciselés évoque davantage les Préférences ainsi que Liberté grande, de Gracq, tant par sa subjectivité que par sa prose somptueuse. Le journaliste aura marqué Sud-Ouest Dimanche, qu'il dirigea dès 1979 de main de maître. Je le connus là, en 1981. Il fut mon premier rédacteur en chef et me permit d'écrire notamment des critiques de livres durant des années. J'entrais dans ma vie d'homme. François Mitterrand venait d'accéder au pouvoir et j'achevais mes études. Étrangement (encore que...), j'ai toujours trouvé en Veilletet un indéniable côté mitterrandien, dû sans doute à sa timidité -qui pouvait passer pour de la froideur et que l'on résumait en disant que c'était son côté British qui dépassait le côté Bordelais d'un homme à la casquette en tweed distincte de ses vestes de la même étoffe -qui le faisaient ressembler, physiquement aussi, au "Prince des reporters". L'homme impressionnait. Je n'oublierai pas ces inconnus célèbres (les seconds couteaux de la littérature que nous chérissions : Forton, Gadenne, Bousquet, Guérin, Perros, Augiéras, De Richaud, Henein, Vialatte, Calet...), dont nous fîmes une série dans le journal, avec Yves Harté -l'autre grande plume, qui lui succéda à Sud-Ouest Dimanche. Je n'oublierai jamais ce soir de 1986 copieusement arrosé que nous passâmes tous les trois (Yves Harté, Pierre Veilletet et moi), pour fêter la parution imminente de La pension des nonnes. En fin de soirée, nous avions porté à bout d'épaules un Pierre Veilletet ivre de bordeaux et de bonheur, de chez moi à chez lui ou jusqu'à un taxi, je ne me souviens plus très bien. Je garde précieusement le "tapuscrit" de ce roman, qui porte un titre originel schubertien : Un voyage d'hiver. Veilletet connaissait les vins et la tauromachie sur le bout des doigts et il a écrit des textes magnifiques sur ces sujets solaires qui le passionnaient.
C'est un grand journaliste doublé d'un écrivain précieux, précis qui vient de quitter ce monde à l'âge de 69 ans, le 8 janvier dernier. A Bordeaux. Sa ville. Né à Momuy dans les Landes et d'origine flamande par ailleurs, Pierre Veilletet aura effectué une brillante carrière au journal Sud-Ouest, qu'il pilota, jusqu'à son éviction brutale en 2000 -qu'il ne digéra pas. Prix Albert-Londres 1976 pour ses reportages sur l'agonie de Franco, il préféra rester le premier à Bordeaux au lieu d'être un numéro à Paris. C'était un maître à l'écriture rigoureuse, au ton singulier, hiératique et profond. Un styliste. Un observateur d'une finesse désarçonnante. Un taiseux au sourire rare aussi. Un personnage un rien intimidant mais toujours prompt à lancer un trait d'esprit pour détendre une atmosphère qu'il savait avoir rendue pesante, dans son bureau au journal ou ailleurs par hasard dans les rues de la ville. Veilletet avait le tact inscrit en lui. Et une délicatesse parfois gauche mais jamais empruntée. Il n'était pas d'accès libre. Ce n'est qu'à l'âge de 43 ans qu'il publia son premier livre, le court et dense roman La pension des nonnes, chez Arléa, maison cofondée avec ses amis Jean-Claude et Catherine Guillebaud et à laquelle il restera aussi fidèle que Julien Gracq le demeura à José Corti. L'allusion vaut rapprochement : le choix scrupuleux de l'adjectif, l'usage de l'italique pour appuyer comme on adresse un clin d'oeil entendu, rendent l'écriture de Veilletet voisine, sinon cousine de celle du grand écrivain de Saint-Florent-le-Vieil. Si Querencia et autres lieux sûrs peut faire penser à La première gorgée de bière de Philippe Delerm pour sa thématique, mais avec une autre tenue, une exigence altière, ce recueil de courts textes qui sont autant de bijoux ciselés évoque davantage les Préférences ainsi que Liberté grande, de Gracq, tant par sa subjectivité que par sa prose somptueuse. Le journaliste aura marqué Sud-Ouest Dimanche, qu'il dirigea dès 1979 de main de maître. Je le connus là, en 1981. Il fut mon premier rédacteur en chef et me permit d'écrire notamment des critiques de livres durant des années. J'entrais dans ma vie d'homme. François Mitterrand venait d'accéder au pouvoir et j'achevais mes études. Étrangement (encore que...), j'ai toujours trouvé en Veilletet un indéniable côté mitterrandien, dû sans doute à sa timidité -qui pouvait passer pour de la froideur et que l'on résumait en disant que c'était son côté British qui dépassait le côté Bordelais d'un homme à la casquette en tweed distincte de ses vestes de la même étoffe -qui le faisaient ressembler, physiquement aussi, au "Prince des reporters". L'homme impressionnait. Je n'oublierai pas ces inconnus célèbres (les seconds couteaux de la littérature que nous chérissions : Forton, Gadenne, Bousquet, Guérin, Perros, Augiéras, De Richaud, Henein, Vialatte, Calet...), dont nous fîmes une série dans le journal, avec Yves Harté -l'autre grande plume, qui lui succéda à Sud-Ouest Dimanche. Je n'oublierai jamais ce soir de 1986 copieusement arrosé que nous passâmes tous les trois (Yves Harté, Pierre Veilletet et moi), pour fêter la parution imminente de La pension des nonnes. En fin de soirée, nous avions porté à bout d'épaules un Pierre Veilletet ivre de bordeaux et de bonheur, de chez moi à chez lui ou jusqu'à un taxi, je ne me souviens plus très bien. Je garde précieusement le "tapuscrit" de ce roman, qui porte un titre originel schubertien : Un voyage d'hiver. Veilletet connaissait les vins et la tauromachie sur le bout des doigts et il a écrit des textes magnifiques sur ces sujets solaires qui le passionnaient.
Attiré par l'Espagne autant que par l'Italie et par certaines villes du Nord, par les ports et par les fleuves, il plaçait l'exigence journalistique et la littérature au-dessus de tout. Il procurait, avec ses articles que nous guettions, ce plaisir du texte que l'on ne trouve plus guère dans les journaux et qui était alors flatté, encouragé à Sud-Ouest, journal de plumes donnant d'excellents papiers. Dans ses livres, que je relis depuis trois jours avec un plaisir mâtiné de tristesse, il donnait tout simplement la mesure d'une littérature de haut-vol. Car c'était un grand. Un très grand.
Lire (j'espère qu'Arléa aura la bonne idée de publier une compil°, un "Tout-Veilletet" comme cet éditeur de qualité a publié la totale d'Albert Londres, câbles compris, ou les Essais de Montaigne reloaded par Claude Pinganaud, ou bien comme il existe un Bouquins/Laffont des oeuvres d'Antoine Blondin, histoire de nous éclipser et de le relire peinard, à l'écart, comme un chien s'en va ronger au fond du jardin). Lire donc : Querencia et autres lieux sûrs (Mots et merveilles en collection de poche), La pension des nonnes, Bords d'eaux, Coeur de père, Mari-Barbola, Le vin, leçon de choses, Le prix du sang, Le cadeau du moine (tous chez Arléa); Le peuple du toro (Hermé), De l'esprit des vins (Adam Biro).
Photo : Pierre Veilletet (lunettes) avec Jean-Claude Guillebaud (Prix Albert-Londres en 1972. Yves Harté le fut en 1990), dans le sannées 2000 : © Archives Philippe Taris/Sud-Ouest.
P.S. : "l'avantage" d'un blog sur une publication dans la presse traditionnelle (je pense immédiatement et quasi exclusivement au support papier : je suis old school et j'aime ça), est de pouvoir s'autoriser des digressions personnelles, de se mettre en avant, ce qui est bien sûr proscrit partout ailleurs. C'est pourquoi je me suis laissé allé ci-dessus à partager une ou deux anecdotes, des souvenirs qui parlent de toute façon directement de Pierre Veilletet.
...Ce papier de Benoît Lasserre paru le 29 décembre dernier.

29/12/2012 | Voyage sur les barthes de l'Adour, côté Landes, au dessus pic d'Iraty, au Pays-basque, sous la plume de Leon Mazzella

 |
Chasses furtives est un roman solitaire, un roman d'amour entre un jeune homme et la Nature. A l'âge où les garçons découvrent les filles, Jean et son chien chassent dans les barthes des Landes, « son jardin des délices ». Le lecteur découvre une nature sauvage érotisée par l'auteur. « Il caressa le couple d'oiseaux, embrassa leur poitrine comme chaque fois. » Il peut sentir l'odeur de la terre mouillée, entendre le fracas des ailes des oiseaux et voir la lumière glisser entre les arbres.
Léon Mazzella nous offre aussi dans Chasses furtives une poésie secrète des barthes de l'Adour, côté landais, par temps bleu et froid. « Marais pris en écharpe par le brouillard (...) qui exhale, comme une immense tisane glacée, ses aromates nocturnes. Ou encore : Le marais est un immense frémissement(...) une mosaïque de flaques de cristal brisées de joncs, couleur mi-lune, mi-étain. » Puis les couleurs du marais contrastent avec la blancheur de l'hôpital où agonise son grand-père tant-aimé. La description de la mort, passage particulièrement beau du roman, montre la profondeur d'écriture d'un jeune écrivain de 23 ans devenu grand auteur du savoir-vivre.
Un chasseur de saisonsRoman couleur d'automne jusqu'à la mort du grand-père d'adoption, « le grand-père était mort en hiver », puis le livre voyage au printemps dans les Pyrénées basques au dessus de la forêt d'Iraty et devient roman d'été lorsque Jean se souvient des après-midi écrasées de soleil en Algérie, au pays des clémentiniers, des orangers et des citronniers. Mais ce sont toujours les oiseaux qui rythment les pages de Mazzella, chasseur de saison en saison. « Un pollen tardif chargeait un air tiède. Les Milans et les Buses paradaient encore. Les hirondelles et les tourterelles des bois se rassemblaient pour le grand départ vers le Sud. La saison de chasse allait recommencer. »
Jean a rencontré au printemps cette « femme-renarde », Marie qui « exhalait un parfum sauvage, mélange de cèpe, de lichen et de paille brûlée qui le transportait dans un sous-bois trempé d'automne ». Mais le songe d'une bécasse jaillissant des roseaux, le claquement des ailes et le regard du chien rappelaient Jean à la chasse. « Non retour. Seul avec son esprit traqué par la disparition des êtres et par la transparence des choses. » Le sentiment de contingence de Jean exigeait qu'il s'entoure dès que possible de l'existence de la Nature.

Olivier Darrioumerle
Crédit Photo : Passiflores
...De ce matin (signé Emmanuel Planes). Bon, bé, ça sent Noël tout ça :

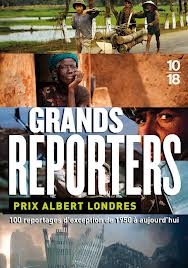
Voici un 10/18, Grands reporters, à garder précieusement. Plus de 800 pages de pur talent. Cent reportages d'exception de 1950 à aujourd'hui, choisis par d'anciens Prix Albert-Londres et parmi les reportages qu'ils ont particulièrement aimé écrire, au-delà de ceux qui leur ont valu le prestigieux prix.
Un pur régal en somme. Henri de Turenne, Yves Courrière, Jean Lartéguy, Henri Amouroux, Josette Alia, Jean-Claude Guillebaud ouvrent le bal. Excusez du peu. Suivent des perles : Veilletet, Pomonti, Niedergang, Kravetz, Hoche, Ullmann, Chalandon, Caradec'h... Les signatures de nos années de formation, d'éveil au métier. Celles que nous guettions au kiosque et que nous dévorions avec autant d'avidité que les nouveaux livres de nos auteurs préférés en librairie.
Et cela fait un bien fou de lire ou relire leurs récits, leurs impressions, leurs propos recueillis au Vietnam, en Espagne, à Prague, en Afrique, dans le djebel, en banlieue ou à Jérusalem. Un tel bouquin nous enchante autant qu'un recueil de reportages d'Albert Londres, le maestro, dont le nom désigne donc le prix qui récompense les meilleurs reportages et les meilleures plumes de l'année.
C'est truculent, ça swingue à chaque chapitre, car une nouvelle personnalité apparaît, s'imprime dans l'esprit, s'impose à force de mots choisis façon percutante et que le journalisme, écrire pour le journal, c'est ça aussi.
Une tribune sur le 5 juillet 1962 à Oran : cliquez sur le lien ci-dessous pour pouvoir la lire (ou bien vous allez sur le site du Monde) :
En version papier (texte légèrement raccourci), cela donne ceci (page 15), mais une grève empêche Le Monde de paraître aujourd'hui. En vieil aficionado indécrottable de la presse écrite, je râle de ne pas pouvoir tenir le journal entre mes mains...

Papier paru ce matin dans Le Nouvel Observateur, CinéTéléObs/Oxygène (avec d'autres papiers - à suivre ici - consacrés à l'année Klimt à Vienne et à une balade ornitho autour des lacs de Champagne).
-------
Qui mieux qu’un écrivain entiché sait lire le paysage sensuel de ce département protéiforme ?

 Du cru, ou bien frappés par cette terre, les écrivains distinguent les Landes de sable et de pins de celles vallonnées de Chalosse, les plates girondines du Tursan qui mamelonne, l’océan de maïs du silence de la haute-lande, les côteaux griffés de vignes des plages droites, le Bas-Adour drainé de fleuves du Marensin agricole, les grands étangs qui trouent la forêt de l’airial qui l’aère, le front de mer d’Hossegor des villages d’Armagnac. Les Landes sont une invitation au voyage. Immobile si l’on feuillette « l’Enterrement à Sabres » (Poésie/Gallimard), l’immense chanson de gestes hugolienne et gasconne de Bernard Manciet, l’écrivain de Trensacq, poète de
Du cru, ou bien frappés par cette terre, les écrivains distinguent les Landes de sable et de pins de celles vallonnées de Chalosse, les plates girondines du Tursan qui mamelonne, l’océan de maïs du silence de la haute-lande, les côteaux griffés de vignes des plages droites, le Bas-Adour drainé de fleuves du Marensin agricole, les grands étangs qui trouent la forêt de l’airial qui l’aère, le front de mer d’Hossegor des villages d’Armagnac. Les Landes sont une invitation au voyage. Immobile si l’on feuillette « l’Enterrement à Sabres » (Poésie/Gallimard), l’immense chanson de gestes hugolienne et gasconne de Bernard Manciet, l’écrivain de Trensacq, poète de  génie disparu en 2005. Ou bien en s’allongeant en pleine forêt sur un tapis d’aiguilles de pins et de fougères, le regard planté à la cime des arbres qui dansent. Il suffit alors de fermer les yeux pour confondre, comme le faisait François Mauriac, le bruissement permanent du vent dans les branches avec celui de l’océan. Le
génie disparu en 2005. Ou bien en s’allongeant en pleine forêt sur un tapis d’aiguilles de pins et de fougères, le regard planté à la cime des arbres qui dansent. Il suffit alors de fermer les yeux pour confondre, comme le faisait François Mauriac, le bruissement permanent du vent dans les branches avec celui de l’océan. Le 
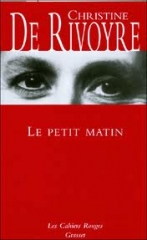 Bordelais Mauriac n’aimait rien comme planter ses fictions dans l’âpre lande : le village d’Argelouse est à jamais marqué par « Thérèse Desqueyroux », l’un de ses plus célèbres romans(Livre de poche). Montaigne, qui voyageait à cheval, a nourri ses « Essais » (Arléa) de centaines de chevauchées à travers les Landes. Il vante même les mérites des sources thermales de Préchacq-les-Bains dans son œuvre-vie. Jean-Paul Kauffmann a donné un livre magnifique, « La maison du retour » (folio), qui raconte comment il choisit justement de s’établir de temps à autre en forêt, à Pissos. Plus bas, on peut se promener du côté d’Onesse-et-Laharie, à la recherche de la maison des sœurs de Rivoyre, échouer à la trouver et relire « Le petit matin » (Grasset), de Christine, « la Colette des Landes », au café du coin. Les Landes, c’est la place centrale de Mont-de-Marsan à l’ouverture du premier café que l’on prend en pensant aux frères Boni : Guy et André Boniface, rugbymen de légende. Un stade porte leur nom à Montfort-en-Chalosse. Denis Lalanne, qui donna comme son ami Antoine Blondin des papiers « de garde » à « L’Equipe », écrivit un livre hommage
Bordelais Mauriac n’aimait rien comme planter ses fictions dans l’âpre lande : le village d’Argelouse est à jamais marqué par « Thérèse Desqueyroux », l’un de ses plus célèbres romans(Livre de poche). Montaigne, qui voyageait à cheval, a nourri ses « Essais » (Arléa) de centaines de chevauchées à travers les Landes. Il vante même les mérites des sources thermales de Préchacq-les-Bains dans son œuvre-vie. Jean-Paul Kauffmann a donné un livre magnifique, « La maison du retour » (folio), qui raconte comment il choisit justement de s’établir de temps à autre en forêt, à Pissos. Plus bas, on peut se promener du côté d’Onesse-et-Laharie, à la recherche de la maison des sœurs de Rivoyre, échouer à la trouver et relire « Le petit matin » (Grasset), de Christine, « la Colette des Landes », au café du coin. Les Landes, c’est la place centrale de Mont-de-Marsan à l’ouverture du premier café que l’on prend en pensant aux frères Boni : Guy et André Boniface, rugbymen de légende. Un stade porte leur nom à Montfort-en-Chalosse. Denis Lalanne, qui donna comme son ami Antoine Blondin des papiers « de garde » à « L’Equipe », écrivit un livre hommage 
 aux frangins : « Le temps des Boni » (La petite vermillon). Il vit aujourd’hui paisiblement à Hossegor. Le lire, c’est retrouver le rugby rustique de village, où les déménageurs de pianos sont plus nombreux que les joueurs du même instrument. Un autre écrivain journaliste parti trop tôt (en 2004), Patrick Espagnet, de Grignols (plus haut dans les Landes girondines), possédait une plume forgée à l’ovale. Ses nouvelles : « Les Noirs », « La Gueuze », « XV histoires de rugby » (Culture Suds), sont des chefs-d’œuvre du genre. Les Landes, ce sont ces belles fermes à colombages avec leurs murs à briquettes en forme de fougère, qui se dressent
aux frangins : « Le temps des Boni » (La petite vermillon). Il vit aujourd’hui paisiblement à Hossegor. Le lire, c’est retrouver le rugby rustique de village, où les déménageurs de pianos sont plus nombreux que les joueurs du même instrument. Un autre écrivain journaliste parti trop tôt (en 2004), Patrick Espagnet, de Grignols (plus haut dans les Landes girondines), possédait une plume forgée à l’ovale. Ses nouvelles : « Les Noirs », « La Gueuze », « XV histoires de rugby » (Culture Suds), sont des chefs-d’œuvre du genre. Les Landes, ce sont ces belles fermes à colombages avec leurs murs à briquettes en forme de fougère, qui se dressent  grassement sur leur airial. La plus emblématique se trouve au sein du Parc régional de Marquèze, à Sabres, où l’ombre tutélaire de Félix Arnaudin, l’écrivain photographe un brin ethnographe, plane comme un milan royal en maraude. Les clichés d’Arnaudin sont aussi précieux que ses recueils de contes (Confluences). L’un d’eux montre un
grassement sur leur airial. La plus emblématique se trouve au sein du Parc régional de Marquèze, à Sabres, où l’ombre tutélaire de Félix Arnaudin, l’écrivain photographe un brin ethnographe, plane comme un milan royal en maraude. Les clichés d’Arnaudin sont aussi précieux que ses recueils de contes (Confluences). L’un d’eux montre un 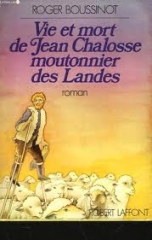
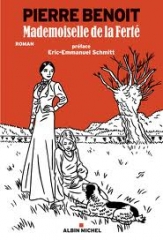 jeune berger, Bergerot au Pradeou, dressé dans l’immensité plate comme la main. Et évoque le tendre roman de Roger Boussinot, « Vie et mort de Jean Chalosse, moutonnier des Landes » (Livre de poche). C’est encore le souvenir de Pierre Benoît, l’auteur de « Mademoiselle de La Ferté », de « La chatelaîne du Liban » et d’Axelle » (repris le mois dernier par Albin Michel), originaire de Saint-Vincent-de-Paul, près de Dax, où il vécut « une sorte de vie animale et sylvestre » jusqu’à l’âge de seize ans. Les Landes, ce sont
jeune berger, Bergerot au Pradeou, dressé dans l’immensité plate comme la main. Et évoque le tendre roman de Roger Boussinot, « Vie et mort de Jean Chalosse, moutonnier des Landes » (Livre de poche). C’est encore le souvenir de Pierre Benoît, l’auteur de « Mademoiselle de La Ferté », de « La chatelaîne du Liban » et d’Axelle » (repris le mois dernier par Albin Michel), originaire de Saint-Vincent-de-Paul, près de Dax, où il vécut « une sorte de vie animale et sylvestre » jusqu’à l’âge de seize ans. Les Landes, ce sont 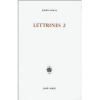 enfin les inoubliables passages de Julien Gracq, dans « Lettrines 2» (José Corti). Le grand écrivain s’émeut avec l’acuité du géographe : « Jamais je ne l’ai prise (la route des Landes) sans être habité du sentiment profond d’aborder une pente heureuse, une longue glissade protégée, privilégiée, vers le bonheur » (…) « Maintenant se fait entendre dans le paysage une note plus ample et plus grave, que l’oreille surprend déjà dans le nom de Grandes Landes par lequel on désigne le massif le plus épais et le plus compact, le recès central du labyrinthe, et vraiment le cœur de la forêt. Non pas tant une forêt que plutôt une province des arbres, ce que les Anglais appelleraient woodland … »
enfin les inoubliables passages de Julien Gracq, dans « Lettrines 2» (José Corti). Le grand écrivain s’émeut avec l’acuité du géographe : « Jamais je ne l’ai prise (la route des Landes) sans être habité du sentiment profond d’aborder une pente heureuse, une longue glissade protégée, privilégiée, vers le bonheur » (…) « Maintenant se fait entendre dans le paysage une note plus ample et plus grave, que l’oreille surprend déjà dans le nom de Grandes Landes par lequel on désigne le massif le plus épais et le plus compact, le recès central du labyrinthe, et vraiment le cœur de la forêt. Non pas tant une forêt que plutôt une province des arbres, ce que les Anglais appelleraient woodland … »
L.M.
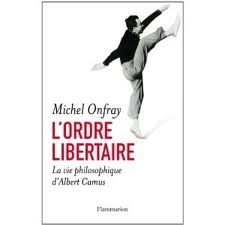 Onfray a des ennemis et j’aime ce qu’il écrit, donc je n'aime guère ses ennemis. Certes, il se répète beaucoup, à l’envi, comme un distributeur de litanies, dans le présent livre aussi, et si je me livrais à un exercice journalistique classique, celui du SR (secrétaire de rédaction), je saisirais les ciseaux de Sainte-Anastase et je taillerai là-dedans, je veux dire dans son dernier gros opus : « L’Ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert Camus » (Flammarion) pour ôter environ 150 pages de redondances aux 600 que j’ai cependant dévorées avec un immense plaisir et sans en sauter une demi-ligne.
Onfray a des ennemis et j’aime ce qu’il écrit, donc je n'aime guère ses ennemis. Certes, il se répète beaucoup, à l’envi, comme un distributeur de litanies, dans le présent livre aussi, et si je me livrais à un exercice journalistique classique, celui du SR (secrétaire de rédaction), je saisirais les ciseaux de Sainte-Anastase et je taillerai là-dedans, je veux dire dans son dernier gros opus : « L’Ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert Camus » (Flammarion) pour ôter environ 150 pages de redondances aux 600 que j’ai cependant dévorées avec un immense plaisir et sans en sauter une demi-ligne.
C’est un grand livre. Certes un chouia hagiographique, certes un poil anti-sartrien bichrome (c’est black or white), voire manichéen par endroits, avec force flot de citations à charge. Certes c’est également une espèce d’autobiographie (Nietzsche : « Toute philosophie constitue une autobiographie masquée ») :
PARALLÈLES
Camus et Onfray ont, il faut le préciser, un parcours comparable. Mêmes origines sociales -pauvres-, même mépris pour les paillettes germanopratines, mêmes inspirations nietzschéennes, voire gramsciennes (pas convaincu par le chapitre ad hoc, et je pense bien connaître mon Gramsci), même énergie solaire (sauf que Onfray n’est pas Méditerranéen, que l’on sache), même accueil par une certaine dictature du savoir et du pouvoir éditorial (laquelle vire peu à peu à l’endogamie mentale à force de manquer d’air –mais c’est tant pis pour elle. Même cette civilisation, par ailleurs mortifère, est mortelle!).
Même destinée libertaire aussi, voire anarchiste… Onfray n’a pas publié de fictions comme Camus, cependant. Et nous savons, à la lumière de cet essai brillant, combien « Noces », « L’Eté », « La Peste », « La chute », « L’Exil et le Royaume », etc., contiennent dans leur ventre une portée philosophique, à côté de laquelle nous étions passés jusque là, en nous attachant exclusivement à la prose sensuelle, solaire, méditerranéenne, hédoniste, algérienne, salée, profondément libre de notre Camus préféré. (Relire aussitôt « Noces », et « L’Eté », au sortir de la bio d’Onfray, fut un bonheur frais et comme neuf : garanti pièces et main d’oeuvre).
OBSCURES RANCOEURS
Mais il s’agit d’abord d’une biographie philosophique. Après avoir flingué Freud à la mitrailleuse lourde (« Le crépuscule d’une idole », Grasset), voici Michel Onfray en verve pour réhabiliter, car cela semblait nécessaire, le Camus philosophe pour classe d’agrég. (et non pas pour classes Terminales, pour paraphraser le titre d’un pamphlet qui m’opposa constamment à son auteur et ami, feu Jean-Jacques Brochier).
L’Ordre libertaire est un grand bouquin parce qu’il règle les comptes avec une certaine société parisienne nombriliste, étriquée, auto-intelligentisalisée et propriétaire (putschiste) du droit de dire, de publier, de faire et de défaire, mais dans un cercle tellement restreint qu’il semble (à le renifler et tant il est nauséabond au fil du temps), avoir oublié les structures élémentaires de la parenté. Autrement dit, la prohibition (métaphysique) de l’inceste (mental) ne semble pas avoir cours dans ce marigot-là. La suffisance semble gouverner sa morgue. Ainsi que la reproduction entre soi, façon « Les héritiers » selon Bourdieu & Passeron.
Du coup, Albert Camus le pied-noir, fils d’un père ouvrier mort au front en 14 et d’une mère analphabète (elle n'a jamais lu son fils!), n’ayant fait ni "H. IV", ni Ulm (Normale Sup), ne fait pas partie du Club Mickey, donc du sérail, de la famille bourgeoise bien-pensante. D’où leur haine, leur jalousie lorsque l’auteur de « L’étranger » obtint le Nobel en 57 (« Devant ma mère, je sens que je suis d’une race noble : celle qui n’envie rien », in « Le Premier homme »). Entre autres exemples.
Sur cet aspect de l’homme et du ressentiment parisien, Onfray excelle. Nous sentons un Camus décidé à ne pas s’approcher trop près de ces virus, qui préfère la compagnie de l'ami absolu et total, René Char, et la perspective de vivre à Lourmarin (où il repose d’ailleurs) plutôt que rue de Chanaleilles, même si c’était bien, le temps passé là-bas.
UN HOMME SIMPLE ET SOLAIRE
Ce qui séduit d’emblée dans le livre d’Onfray, c’est de retrouver un Camus absolument solaire (et c’est la première fois que je lis cela, car ni Emmanuel Roblès pourtant, ni José Lenzini, et même Frédéric Musso, ni Morvan Lebesque, ni Abdelkader Djemaï, ni Jean Daniel, Jean Grenier à peine, Macha Séry un tout petit peu, n'étaient parvenus à retranscrire cela avec autant de talent et d’exactitude), un Camus résolument hédoniste et tout entier tourné vers la sensualité de la vie intellectuelle, avec le corps et l’esprit.
Onfray fait de Camus un Zarathoustra venu d’Algérie. Et le prouve (le bonhomme connaît son Nietzsche sur le bout des doigts), mais on pourrait être tenté de lui reprocher de forcer le trait pour nous persuader de ses convictions. C’est le jeu. On le joue.
Plus intéressante est la manière dont Onfray souligne l’attachement inaliénable de Camus à la pauvreté dont il est issu et qui l’a forgé (les livres lui furent une conquête et pas un héritage, comme cela fut le cas pour un Sartre), ainsi qu'aux humiliés, aux taiseux comme sa mère, et donc au courage, à la noblesse humaine la plus nue, à la loyauté, au courage d’être un homme, au sens de l’honneur, à la dignité de son modeste rang ; à la philosophie d’une morale vraie, en somme.
UNE BIO EN EMPATHIE
Avec ce livre, nous sommes loin des gros pavés qui font autorité, comme le Herbert R. Lottman (monumentale enquête biographique à l’anglo-saxonne, irréprochable, totale, et d’une précision d’horloger genevois croisé avec une entomologiste teutonne), ou le Todd (Olivier), que j’aime moins, mais passons. Ici, avec Onfray, tout fait bonheur, poésie, liberté, détachement, regard vers le soleil les yeux ouverts, appel à Diogène et volonté de jouissance…
Onfray combat la légende : Non, Camus n’est pas un philosophe pour futurs bacheliers, ni un romancier à la prose douce et facile. Oui, Camus est un philosophe profond dans ses essais fameux comme « L’homme révolté » et dans ses œuvres de fiction. Oui, Camus est un anticolonialiste engagé mais mesuré, singulièrement consensuel dans une époque radicale (« la radicalité de la nuance », c’est de lui, et je n’ai pas retrouvé la formule dans le livre d'Onfray).
Oui Camus est un païen pragmatique, un homme droit qui se souvient de l’unique leçon de son père disparu trop tôt : « un homme, ça s’empêche ». C'est encore un homme fidèle aux siens –même contre la Justice. Fidèle à sa mère d’abord, fidèle à son instituteur Louis Germain (le « Discours de Suède » rappelle cela avec superbe) fidèle à cet espèce de père de substitution.
Fidèle aussi au maître absolu que fut Jean Grenier, son prof de philo et auteur des « Îles » et de « Inspirations méditerranéennes », qui lui fit lire aussi « La douleur », d’André de Richaud, lecture décisive. Mais avant tout parce que le professeur Grenier déclencha en Camus le désir d’écrire!..
Camus est un disciple du « Gai savoir » et du précepte nietzschéen fameux : « Deviens celui que tu es », il est un homme qui ne cessera de faire savoir qu’il faut faire en sorte que ne doivent exister ni bourreau, ni victime.
AU-DELA DU BAEDEKER
Bien sûr, il est aussi question dans ce livre de Belcourt, d'Alger, de la tuberculose à dix-sept ans, des femmes, du séducteur, de son look Bogart, des clopes, de Maria Casarès, du foot, du théâtre, de Francine après Hélène, d'« Alger Républicain », de « Combat », de Paris, de l’accident fatal dans la Facel-Vega conduite par Michel Gallimard, du manuscrit du "Premier homme"... tout cela que l'on sait déjà (peu ou prou), du succès de « La Peste », de l’arbre "Etranger" qui cache la forêt d'une oeuvre puissante et protéiforme (« Meursault c’est moi », eut pu dire "Albert Flaubert", à cause du soleil), de Tipasa enfin, et du retour à. Etc.
Tout le Baedeker Camus est forcément dans ce livre, mais par petites touches délicates. Onfray s’attachant à démontrer (avec talent et superbe) la dimension philosophique de Camus, son livre est un bréviaire indispensable. Cette dimension, incontestable pourtant, un certain Paris vétilleux, pincé du nez, coincé des neurones, refuse toujours de la reconnaître à l’auteur de « L’envers et l’endroit ».
Camus nous apparaît sous les traits d’un philosophe artiste –et adepte d’un art de vivre en temps de catastrophes, à l’aise dans son corps qu’il laisse s’exprimer en plongeant, en nageant, en faisant l'amour, en écrivant, en transpirant, en jouant, en lisant, en déclamant des auteurs grecs, en shootant dans un ballon rond, en chuchotant, en observant en silence l’horizon méditerranéen depuis la plage...
Car Camus possède le « castizo » espagnol, cette fierté si bien décrite par Michel del Castillo ici et là, ce cran donquichottesque qui n’ignore pas sa folie douce. Camus est un être charnel, exposé à la brûlure du soleil, au sel, à la cuirasse d’argent de la mer. Il n'est pas un de ces anémiés du 6ème arrondissement, perclus de rancoeurs, de jalousies et de comptes à régler avec ceux qui pourraient pisser peut-être plus loin qu'eux! –d’où les névroses auxquelles Albert est fondamentalement étranger, surtout vues depuis Alger ou Oran. Car tout cela manquerait un peu d'horizon. (Les natifs d’Oran -dont je suis- pardonnent à Camus de n’avoir pas aimé cette ville, cadre de sa "Peste", et de lui avoir préféré Alger).
UNE PULSION DE VIE SPINOZIENNE
Camus nomme imbécile "celui qui a peur de jouir parce qu’il n’éprouve pas de honte à être heureux".
Son hédonisme, avec les événements historiques dont il sera le témoin durant sa courte vie, est un antifascisme. La pulsion de vie, quasi spinozienne, de Camus, forge sa force. Celle qui lui fera éviter les pièges du communisme aveugle et ses haines recuites, sans oublier son cruel désir de vengeance. Nul ressentiment chez Camus, souligne avec bonheur Onfray. Juste un jugement mesuré. Antimarxiste, soit anti-obtus. Il estime qu'il serait encore possible de faire cohabiter les cultures arabes et européennes sur le sol algérien, aux premiers moments durs des « événements », qu’il ne connut qu’à peine.
Camus est enfant du melting-pot pied-noir, enfant d’un bouillon de culture sain, vivant, prodigieusement débarrassé de l’acnée parisienne et des remugles racistes ayant largement cours bien au-dessus de Gibraltar. Il est fils de l’ouverture, de l’écoute, de l’altérité, du soleil et des bonheurs simples.
Il se choisit Grec. Il appartient de toute façon –qui le contesterait ?- à la gauche dionysienne et laisse sur le bas-côté du chemin la gauche apollinienne, chichiteuse, pluvieuse, grisâtre, revancharde, aigrie toujours, et aussi exsangue du corps comme du cerveau.
Camus est un homme placé de naissance du côté de l’hospitalité et du cosmopolitisme, de la fierté castillane, de la loyauté, de l’héroïsme hérités de Cervantès.
L’armée et l’université ont refusé son admission lorsqu’il était jeune. A cause de sa santé faible. Camus taillera sa sculpture solaire dans ces refus aux relents métropolitains. Onfray circonscrit cela avec une grand justesse : Camus est un philosophe qui privilégie la sensation, l’émotion, la perception, sur le concept, l’idée, la théorie. Et c’est pourquoi il nous est si proche, si tutoyant, si populaire, si accessible aussi. Ce que d’aucuns lui reprochent, car il ne reproduisit aucun de leurs codes moisis.
UN TROPISME LIBERTAIRE
A commencer par le tropisme arriviste du Rastignac de sous-préfecture -ce que Camus n'est pas : il n’envie pas Paris. Comment pourrait-il avoir le désir de sa conquête ? Paris lui fera payer très cher ses origines modestes, son existence de petit pied-noir qui défendit même ceux-ci –ce qui constitua un crime de lèse-pensée-unique à l’époque des porteurs de valises, , et de France Observateur, des livres (admirables, d’ailleurs) publiés clandestinement par les éditions de Minuit (et qui ressortent ces jours-ci)… Même son insolence politique, ses prises de position méfiantes face à un Parti communiste avaleur et destructeur à l’époque, furent inscrites au débit de son compte…
La grandeur de Camus se trouve là aussi. Comme dans les métaphores de sa vie que sont ses pièces (« Caligula », « Les Justes », ou ses adaptations dramaturgiques diverses). Onfray souligne que Camus n’est pas un contre-révolutionnaire, mais un révolutionnaire contre. La nuance est de taille.
Je relisais hier « Misère dans la Kabylie », après avoir refermé le Onfray et avoir lu qu’il y neigeait en ce moment, comme souvent d'ailleurs. Les récits de Camus (ou reportages à rendre jaloux jusqu’à la torture, un BHL, mais certainement pas un J. Littell à propos de la Syrie –admirable série dans « Le Monde » de la semaine dernière), rappellent les journaux africains de Gide. Le talent narratif est là, profondément tourné vers l’Autre, ce qui est salutaire, et l'on trouve aussi une dimension lyrique qui fait souvent défaut dans les textes de ce genre.
Sur la Guerre d’Algérie (elle touche ma mémoire familiale), je juge utile de citer seulement ceci, de Camus : « Quatre-vingt pour cent des Français d’Algérie ne sont pas des colons, mais des salariés ou des commerçants ». Camus ne souscrivit jamais à la justice sélective, ni à la « justice française » de la torture, pas plus qu’à la « justice nationale » des massacres.
Il considèrera jusqu’au bout que les Pieds-Noirs, eu égard à l’histoire de l’Algérie (ses invasions successives depuis l'Antiquité l’ayant construite) étaient des indigènes (provisoires) comme tous les autres. Camus paiera cher pour cette loyauté-là, pour sa rectitude, son bon sens, ses fidélités (ma mère contre la justice des terroristes...).
Même des esprits réputés éclairés (Bernard Frank par exemple) le traînèrent dans la boue, suivant sûrement un courant de pensée comme on monte dans un train en marche : nous pardonnerons par conséquent beaucoup au ventriloque Frank de ce « mundillo » en mal d’espace et d’horizon...
A la sortie de ce monument à la gloire d’un philosophe négligé, nous n’avons qu’un désir : le relire, et donc le prolonger. "Le faire passer", encore et toujours. Sans oublier les Sartre et autres bâtisseurs de lotissements d’une tenue autre, certes.
Mais surtout de faire passer cet hédonisme de la jouissance du corps et de l’esprit mêlés, qui font trop souvent défaut au centralisme intellectuel de notre république des lettres.
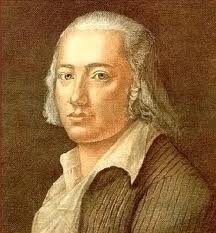 A la terrasse d'un café, je feuillette des magazines. Les pages de rédaction consacrées à la mode et les pages de publicité pour des marques de prêt-à-porter ne montrent que des personnages à la plastique parfaite, mais qui transportent avec une étrange ostentation une morgue terrifiante, au fond de leurs regards vides. L'absence totale du moindre sourire me fait froid dans le dos. Ces robocops de studio-photo semblent nés sans muscles zygomatiques. Ces visages profondément apathiques sont le reflet de notre temps, qui peine à jouir, voire à rire; à peine. Et de la météo du jour aussi -il ne fait pas froid que dans le dos. Malgré nous, le goût de vivre, et celui même d'exister s'amenuisent. Cela sèche imperceptiblement comme flaque au soleil. L'esprit d'innocence s'étiole, la fraîcheur de l'enfance fait la brasse coulée en chacun de nous, l'humour est en berne et la joie d'être au monde m'apparaît en jachère commandée par un moisi ambiant. Je reprends un quotidien que je n'ai pas eu le temps de lire. J'y trouve une phrase lumineuse, sertie dans l'adresse donnée par François Hollande à Libé, le 3 janvier, comme on tombe sur un bouquet de primevères au jaune pâle mais éclatant en cherchant des cèpes dans un sous-bois : L'espérance : je veux retrouver le rêve français. Celui qui permet à la génération qui vient de mieux vivre que la nôtre. Ces mots simples me bouleversent, sans doute parce que ma sensibilité se trouve ponctuellement (hy)perméable. Je souhaite tant que mes enfants connaissent le bonheur simple et l'insouciance solaire de leurs grands-parents. Je voudrais tant qu'ils vivent la jeunesse radieuse de mes parents, comme je l'ai seulement ressentie, gamin, plein d'une immense joie contemplative. Je repense au poème Ressouvenir, de Hölderlin (photo) -Apprendre, c'est se ressouvenir de ce que l'on avait oublié, me chuchote au passage Socrate-, car il s'achève par ces mots "en bleu adorable" : La mer enlève et rend la mémoire, l'amour / De ses yeux jamais las fixe et contemple, / Mais les poètes seuls fondent ce qui demeure. Je me dis benoîtement que la poésie nous tirera toujours vers le haut, hors des draps, loin du bruit méchant, vers la lumière et dans l'air vivifiant de l'aube. Et je m'efforce de le croire.
A la terrasse d'un café, je feuillette des magazines. Les pages de rédaction consacrées à la mode et les pages de publicité pour des marques de prêt-à-porter ne montrent que des personnages à la plastique parfaite, mais qui transportent avec une étrange ostentation une morgue terrifiante, au fond de leurs regards vides. L'absence totale du moindre sourire me fait froid dans le dos. Ces robocops de studio-photo semblent nés sans muscles zygomatiques. Ces visages profondément apathiques sont le reflet de notre temps, qui peine à jouir, voire à rire; à peine. Et de la météo du jour aussi -il ne fait pas froid que dans le dos. Malgré nous, le goût de vivre, et celui même d'exister s'amenuisent. Cela sèche imperceptiblement comme flaque au soleil. L'esprit d'innocence s'étiole, la fraîcheur de l'enfance fait la brasse coulée en chacun de nous, l'humour est en berne et la joie d'être au monde m'apparaît en jachère commandée par un moisi ambiant. Je reprends un quotidien que je n'ai pas eu le temps de lire. J'y trouve une phrase lumineuse, sertie dans l'adresse donnée par François Hollande à Libé, le 3 janvier, comme on tombe sur un bouquet de primevères au jaune pâle mais éclatant en cherchant des cèpes dans un sous-bois : L'espérance : je veux retrouver le rêve français. Celui qui permet à la génération qui vient de mieux vivre que la nôtre. Ces mots simples me bouleversent, sans doute parce que ma sensibilité se trouve ponctuellement (hy)perméable. Je souhaite tant que mes enfants connaissent le bonheur simple et l'insouciance solaire de leurs grands-parents. Je voudrais tant qu'ils vivent la jeunesse radieuse de mes parents, comme je l'ai seulement ressentie, gamin, plein d'une immense joie contemplative. Je repense au poème Ressouvenir, de Hölderlin (photo) -Apprendre, c'est se ressouvenir de ce que l'on avait oublié, me chuchote au passage Socrate-, car il s'achève par ces mots "en bleu adorable" : La mer enlève et rend la mémoire, l'amour / De ses yeux jamais las fixe et contemple, / Mais les poètes seuls fondent ce qui demeure. Je me dis benoîtement que la poésie nous tirera toujours vers le haut, hors des draps, loin du bruit méchant, vers la lumière et dans l'air vivifiant de l'aube. Et je m'efforce de le croire.

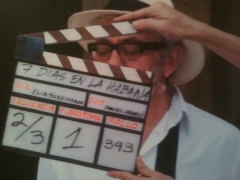

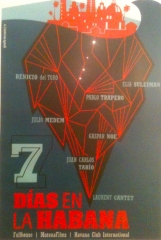
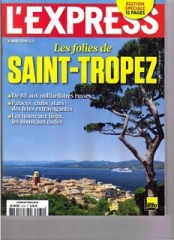 Retour de Procida...
Retour de Procida...
Au courrier, je trouve L'Express et le dossier que j'ai écrit dans l'édition datée du 27 juillet au 2 août. Il comprend 12 papiers, avec ses encadrés et ses manchettes. Voici celui qui ouvre l'ensemble :
De BB à Abramovitch
LOIN DU BLING-BLING
Les traces des années B.B. sont dans les mémoires. Elles ont sculpté un Saint-Tropez inaltérable, aujourd’hui davantage tourné vers une certaine conception de la dolce vita.
---


 jamais compter. Il a oublié que Mick Jagger s’est marié ici avec Bianca en 1971, il se souvient en revanche qu’il a une autre affaire à faire tourner à Courchevel, en relais de celle-ci sur le port, en deçà ou sur une plage de Pampelonne. Car aujourd’hui, il convient de suivre le VIP à la trace, dans les sillages uniformément blancs comme la fameuse Soirée –et de son yacht et de son avion privé. Le nouveau visage de St-Trop’ est davantage cosmopolite, plus exigeant, plus arrogant aussi. Les maîtres du monde, s’ils possèdent encore, parfois, le tact et l’intelligence effacée, exposent plus fréquemment des attitudes d’enfants gâtés qui veulent tout tout de suite. « Le risque est qu’ils fichent le camp ailleurs, puisque les côtes de la planète leur sont ouvertes », dit Kaled, inquiet militant de l’avenir des plages de Ramatuelle. En attendant les suites d’un éternel imbroglio (voir plus loin), Abramovitch, Paris Hilton, tel Emir, tel rock-star ou king du basket, tel président d’un fonds de pension américain aussi influent qu’un Bill
jamais compter. Il a oublié que Mick Jagger s’est marié ici avec Bianca en 1971, il se souvient en revanche qu’il a une autre affaire à faire tourner à Courchevel, en relais de celle-ci sur le port, en deçà ou sur une plage de Pampelonne. Car aujourd’hui, il convient de suivre le VIP à la trace, dans les sillages uniformément blancs comme la fameuse Soirée –et de son yacht et de son avion privé. Le nouveau visage de St-Trop’ est davantage cosmopolite, plus exigeant, plus arrogant aussi. Les maîtres du monde, s’ils possèdent encore, parfois, le tact et l’intelligence effacée, exposent plus fréquemment des attitudes d’enfants gâtés qui veulent tout tout de suite. « Le risque est qu’ils fichent le camp ailleurs, puisque les côtes de la planète leur sont ouvertes », dit Kaled, inquiet militant de l’avenir des plages de Ramatuelle. En attendant les suites d’un éternel imbroglio (voir plus loin), Abramovitch, Paris Hilton, tel Emir, tel rock-star ou king du basket, tel président d’un fonds de pension américain aussi influent qu’un Bill  Gates, mais transparent avec son tee-shirt imprimé et ses Havaïanas aux pieds, et dans une moindre mesure un Jean-Michel Jarre ou un Alexandre Jardin croisés ce 5 juillet au fil des quais et aux bras de leur dulcinée, fabriquent le Saint-Tropez d’aujourd’hui. Celui-ci tient du zoo, lorsqu’on se trouve devant ces yachts dont on ne sait pas qui sont les singes : ceux qui les occupent, là-haut, ou bien les humbles qui,
Gates, mais transparent avec son tee-shirt imprimé et ses Havaïanas aux pieds, et dans une moindre mesure un Jean-Michel Jarre ou un Alexandre Jardin croisés ce 5 juillet au fil des quais et aux bras de leur dulcinée, fabriquent le Saint-Tropez d’aujourd’hui. Celui-ci tient du zoo, lorsqu’on se trouve devant ces yachts dont on ne sait pas qui sont les singes : ceux qui les occupent, là-haut, ou bien les humbles qui, menton dressé et appareil photo prêt à tirer, guettent leurs occupants et se photographient devant des pavillons de complaisance évoquant les îles lointaines ? Il relève de la réserve d’Indiens : les Bateaux Verts proposent pour 9€ une balade en navette à la découverte des « villas de célébrités ». St-Trop’ tient encore du hameau charmant, lorsque l’on emprunte, depuis les quais et jusqu’à la Place des Lices, cette ravissante ruelle Etienne Berny chargée du parfum des figuiers qui dégringolent, et où deux piétons ne peuvent se croiser. Le village magique tient de l’inaltérable enfin, lorsque, devant soi, au cœur de la nuit, à l’heure où l’on quitte hagard les Caves du Roy, un nanti indien proche de la famille Mital (propriétaire dans les environs), évoquant en Anglais son dîner au Polo Club (la cuisine, italienne, y est remarquable), achète, pour se refaire, un panini à 5,40€, ni vu ni reconnu. Record absolu.
menton dressé et appareil photo prêt à tirer, guettent leurs occupants et se photographient devant des pavillons de complaisance évoquant les îles lointaines ? Il relève de la réserve d’Indiens : les Bateaux Verts proposent pour 9€ une balade en navette à la découverte des « villas de célébrités ». St-Trop’ tient encore du hameau charmant, lorsque l’on emprunte, depuis les quais et jusqu’à la Place des Lices, cette ravissante ruelle Etienne Berny chargée du parfum des figuiers qui dégringolent, et où deux piétons ne peuvent se croiser. Le village magique tient de l’inaltérable enfin, lorsque, devant soi, au cœur de la nuit, à l’heure où l’on quitte hagard les Caves du Roy, un nanti indien proche de la famille Mital (propriétaire dans les environs), évoquant en Anglais son dîner au Polo Club (la cuisine, italienne, y est remarquable), achète, pour se refaire, un panini à 5,40€, ni vu ni reconnu. Record absolu.
L.M.
PS : L'Express a signé à tort mon dossier du nom de Léon Mazzella di Borgo, or je m'appelle di Bosco. Pfff...
Photos (©LM) : vue du village depuis les abords du cimetière marin, des gosses qui plongent dans la crique de La Ponche depuis la Grange batelière, Tony Parker au VIP, la lampe Kalachnikov dorée qui trône sur le bureau de Grégoire Chaix (vigneron), le seau de mon rosé au Club 55.
C'est le titre du dossier de 12 pages que je signe dans L'Express paru mercredi dernier. Pas encore vu. Ici (sur l'île de Procida depuis le 15), on ne trouve pas grand chose et c'est tant mieux. Tout peut attendre. A Procida, je me réconcilie avec la vie lorsque celle-ci glisse entre les yeux. Cette île irradie en moi. Elle m'inonde de benessere, je m'y inscris comme un fleuve finit en mer.
 Dans L'Express de cette semaine, je publie trois papiers sur le thème des grandes familles paloises : la saga des Biraben (foies gras éponymes et chevaux de course), des Escudé (sportifs de haut niveau : foot et tennis) et celle des Loustalan (presse quotidienne régionale). Il se trouve qu'en 1984, j'ai travaillé à Pau à Pyrénées Presse (La République des Pyrénées et L'Eclair des Pyrénées). Voici pourquoi je choisis de coller ci-dessous le papier qui évoque les Loustalan. Nota : ce dossier est uniquement diffusé en Béarn.
Dans L'Express de cette semaine, je publie trois papiers sur le thème des grandes familles paloises : la saga des Biraben (foies gras éponymes et chevaux de course), des Escudé (sportifs de haut niveau : foot et tennis) et celle des Loustalan (presse quotidienne régionale). Il se trouve qu'en 1984, j'ai travaillé à Pau à Pyrénées Presse (La République des Pyrénées et L'Eclair des Pyrénées). Voici pourquoi je choisis de coller ci-dessous le papier qui évoque les Loustalan. Nota : ce dossier est uniquement diffusé en Béarn.
L'engagement au quotidien
Albert, Henri, François, Bruno. Quatre Loustalan, trois générations de patrons de presse, un titre emblématique : L’Eclair, et un fil d’Ariane : porter un vrai courant de pensée en faisant d’un quotidien beaucoup plus qu’un journal.
-------
En 1898, deux quotidiens palois, l’un royaliste et ultra catho, Le Mémorial, l’autre anticlérical, L’Indépendant, poussent l’abbé Pon à quitter le Grand Séminaire et Albert Loustalan à quitter à 28 ans un poste confortable de banquier, pour fonder Le Patriote, journal d’informations démocrate chrétien, afin de créer un juste milieu dans un paysage béarnais qui compte encore aujourd’hui trois quotidiens (*). Le grand père Albert contribue rapidement à la prospérité financière du titre, qui affichait 25 000 exemplaires vendus chaque jour à la veille de la Seconde guerre mondiale. Modéré, Le Patriote comprend une majorité de laïcs dans son capital, et sa rédaction, d’obédience catholique, ne donne pas dans l’obscurantisme. La lutte est âpre et les lecteurs fidèles à chacun de ces titres. « Pau a toujours été une ville où l’on débat sur la place publique, au café comme au Zénith, lance François, petit-fils d’Albert, aujourd’hui âgé de 62 ans. » Quand Le Mémorial cesse de paraître en 1911, puis que L’Indépendant est happé par La Petite Gironde, ancêtre de Sud-Ouest, Le Patriote poursuit son aventure. Mais pendant l’Occupation –le grand-père Albert a disparu en 1936, le journal accepte la censure et la propagande, et voit un rédacteur en chef collabo continuer de noircir le journal… À la Libération, les « Rad-Soc » prennent le pouvoir et traînent Le Patriote en justice. Acquitté, il est déjà trop tard pour qu’il reparaisse, fut-ce nimbé d’une nouvelle virginité : La République des Pyrénées vient de naître, qui rafle un lectorat affamé de presse. Henri Loustalan, qui a appris le métier aux côtés de son père Albert, est un jeune docteur en Droit auteur d’une thèse sur le droit de la publicité dans la presse. Avec sa bande de potes : l’équipe des Chrétiens Sociaux de la Résistance, qui comptent à leur tête Louis Bidau, syndicaliste agricole qui sera à l’origine de la culture intensive du maïs et de la création de l’actuel consortium Euralys, ainsi que Mgr Annat, ils fondent L’Eclair des Pyrénées en octobre 1944. La ligne éditoriale du Patriote des belles années se retrouve : L’Eclair ne sera jamais un suppôt du clergé, mais il défendra des convictions, « un vrai courant de pensée » comme se plaisent à le souligner François et son frère cadet Bruno. L’Eclair étend rapidement son aire de diffusion aux « trois B » : Béarn, Basque, Bigorre et son lectorat demeure aujourd’hui encore rural et démocrate chrétien, tandis que La République est davantage située à gauche, et Sud-Ouest… au milieu sans être au Centre. Henri, qui a 35 ans à la création de L’Eclair dirige le quotidien (de directeur administratif, il deviendra vite PDG), et s’accroche, même s’il vend trois fois moins que « La Rép. » (7000 ex. contre environ 25000ex.). La Dépêche du Midi en Bigorre et La République en Béarn sont des concurrents sérieux du petit Eclair. Quant à Sud-Ouest, il est présent dans les « 3B » et au-delà. Le grand virage s’effectue au début des années 70, lorsque Henri se rapproche du groupe Sud-Ouest. L’empathie est immédiate avec le PDG Jean-François Lemoîne, qui soutient L’Eclair et garantit sa ligne éditoriale. Plus tard, Sud-Ouest rachètera La République pour ne pas la laisser au « papivore » Hersant ou, pire, à La Dépêche de la famille Baylet, et le Groupement d’Intérêt Economique Pyrénées Presse, qui englobe La République et L’Eclair, voit le jour en 1976. Ca se complique… On partage l’imprimerie, la régie publicitaire, deux journaux en guerre depuis toujours sont forcés de devenir des frères ennemis, les locaux sont communs, mais « au plomb », les ouvriers du Livre dressent des panneaux de séparation entre les tables de montage. François, ingénieur en électronique ayant déjà bourlingué, est appelé en 1984 par son père pour diriger le journal à ses côtés. Il en deviendra PDG, directeur de la publication par la suite (Henri meurt en 1998). Fidèle à la philosophie Loustalan, Henri et François développent les manifestations autour du journal, avec le Club des Amis de L’Eclair, l’Université de la Citoyenneté, le magazine Pyrène… Le jeune Bruno se destine à l’audiovisuel. Or, il effectue en 1978 un stage de 2 mois à L’Eclair, à la demande de son père, renonce à Sud Radio. Le « stage » durera 18 ans. Sa carrière se poursuivra jusqu’en 2009 au sein du groupe Sud-Ouest, à la direction du magazine Surf Session. C’est à la mort de J.F. Lemoîne en 2001 que les difficultés deviennent insurmontables : La République et L’Eclair sont désormais bonnet blanc et blanc bonnet avec une rédaction en chef commune. « Inconcevable! ». Bruno a déjà quitté le navire. François le fera en 2004. Aujourd’hui, les Loustalan brothers ont créé Valeurs du Sud qui édite un hebdo gratuit de 24 pages, L’Hebdo+, dont les caractéristiques sont d’être positif, « on ne parle jamais de ce qui fâche », d’être nourri d’infos qui remontent de la société civile et d’être alimenté par un flux constant sur le Web. L’esprit citoyen, la circulation d’un courant de pensée désormais affranchi de connotations religieuses, se retrouvent « dans un média qui fait avancer le territoire, dans un contexte où la pluralité et la complémentarité, disparaissaient de la société française et renaissent sur la Toile », précise François. Et le fil d’Ariane est à nouveau tendu comme le zig-zag d’un éclair puisque, après les lancements de L’Hebdo+ Béarn et de L’Hebdo+ Pays Basque, L’Hebdo+ Bigorre a vu le jour en juin 2011. Revoilà « les 3B » !
Léon MAZZELLA
(*) Sud-Ouest, La République des Pyrénées et L’Eclair des Pyrénées, propriétés du Groupe Sud-Ouest.
Pour les oreilles que cela intéresse, je tchatche une heure durant avec Thierry Simon, qui m'interviewe (le prétexte est mon livre Landes, les sentiers du ciel, avec des photos splendides de Frédérick Vézia, éd. Privat) dans le cadre de son émission A l'ombre des pins, dimanche prochain 29 mai de 18h à 19h sur ma vie (mes bouquins, mes papiers, mon enfance, Bayonne, mes projets, la mer, la Locale : la presse quot. régionale) -pas sur mes amis, mes emmerrrrdes, car il aurait fallu bloquer le studio toute la journée!.. Sur les ondes de France Bleu Gascogne : en direct sur le Net : http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-bleu/?tag=gascogne ou bien, pour les veinards qui seront sur place, sur 100.5 (Pays basque + Nord Espagne), 98.8 (Landes) et 103.4 (Gironde).
Un lynchage dont la presse est responsable : merci confrères!
Une dictature aveugle de l'humeur, propagée à la vitesse de la lumière : sympa la Toile!
L'omnipotence du préjugé.
La propagation de la rumeur en toute impunité -pire : relayée par une opinion qui se moque de n'entendre qu'une version de prétendus faits.
L'indécence.
L'oubli fondamental de la circonspection, de l'observation silencieuse, de la patience, de l'écoute, de l'enquête, de la froideur nécessaire aussi.
Quid de la présomption d'innocence, aux USA, avec un tel ramdam?
Le règne d'une pudibonderie nauséabonde.
L'inintelligence, au fond.
La bêtise qui s'assume.
L'aplomb des cons qui jugent, aboient, bêlent.
Et qui n'ont même pas conscience de la honte qui les fige.
Nous voilà revenus au temps des tribunaux expéditifs et fantaisistes de l'Inquisition, aux procès en sorcellerie, au tabassages de rue : lynchage, ratonnade. A l'esprit Dupont la joie, le film.
Au réflexe insensé du groupe animal en migration : gnous, étourneaux.
Au chien abattu par son maître qui l'accusait de la rage...
Panurge.
Sans parler d'un possible complot, ou réglement de compte, en provenance de la droite française ou des ennemis de DSK au FMI -il en a tant.
(Et si je puis me permettre, en pleine politique-fiction, un voeu totalement subjectif : Vivement que cet homme brillant qui aime les femmes qui l'aiment -et alors?- soit blanchi, que d'odieux coupables soient menottés à leur tour et qu'il ambitionne de présider un jour la France).
Je recommande l'opinion libre de Christophe Deloire, directeur du CFJ (Centre de formation des journalistes, à Paris) et auteur de Sexus politicus (Albin Michel), que publie Le Monde et lemonde.fr, cet après-midi. Extrait :
"Se garder de propager les rumeurs, tel est notre devoir. Les laisser se propager sans avoir la curiosité de les vérifier est une erreur. Nous devons avoir la décence commune, comme dans le poème de Rudyard Kipling, Tu seras un homme mon fils, de recevoir d'un même front "deux menteurs", le triomphe et la défaite, et ne pas mentir d'un seul mot. Le rôle des journalistes ne consiste pas plus à accabler Dominique Strauss-Kahn qu'à faire office de témoins de moralité, il consiste à approcher au plus près de la vérité, sans jamais considérer qu'un procès-verbal même avec un tampon officiel, est une parole d'Evangile, sans jamais nous autoriser non plus à ne pas savoir faute d'avoir cherché."
Papier paru dans TéléParis Obs (Le Nouvel Observateur)
de cette semaine (7-13 mai)
Observez cette étrange et belle façon qu'ont les villages basques – à l'image parfaite d'Ainhoa –, de faire d'un accotement de maisons typiques un vrai village. Pour notre bonheur, Zugarramurdi n'échappe pas à la règle. Ici, le mot immeuble doit être rarement prononcé et l'etxe (la maison basque) vit épaule contre épaule. Autrement dit, chacune d'elles pourrait aussi bien vivre sa vie en plein champ. Zugarramurdi, au-delà de Sare et aux portes de la vallée du Baztán, est célèbre pour sa grotte (qui se visite) appelée Akelarren-leze et qui fut réputée comme refuge de sorcières jusqu'aux 7 et 8 novembre 1610, dates funestes qui virent trois cents personnes inculpées par le sieur de Lancre pour délits de sorcellerie dont une douzaine brûlées sur un bûcher.
Akelarre désigne l'aire plane située devant la grotte de Zugarramurdi. Le mot vient du basque ake : bouc et larre : pré et signifie réunion de sorcières. Zugarramurdi est donc le village des sorcières comme Lourdes est la ville de la Vierge. À chacun sa grotte. Celle de Zugarramurdi possède une sorte de fenêtre, d'où Aker, le diable à forme de bouc, convoquait sorciers et sorcières, soit ses dévots. Au bout d'Akelarren-leze, se trouve Sorguinen-leze : la grotte des sorcières proprement dite, un havre de fraîcheur au creux duquel coule un ruisseau, Infernuko Erreka (le ruisseau de l'Enfer) ; un lieu propice au laisser-courre de l'imagination.
À la venta-bar-tabac-épicerie et bricoles en tous genres située au centre du village, on évoque avec ravissement le calme de son village. Une sérénité certaine se lit sur le visage du « taulier ». Elle exprime un esperanto du regard et des traits : il suffit de regarder le taulier pour comprendre que la paix l'habite comme elle habite les lieux, même si l'on ne comprend pas un mot de son espagnol prononcé du bout des lèvres, car Pepe n'a plus de dents.
Et les sorcières, aujourd'hui, que sont-elles devenues ?
Pepe rit, dit qu'il n'y en a plus depuis longtemps, évoque ces agapes étranges du 15 août célébrées par les anciens du village, au cours desquelles deux moutons sont tués dans la grotte, puis grillés et mangés sur place, puis il réfléchit en silence, se ravise, sourit et lâche : les sorcières ? Chaque femme en est une, mais ce sont de bonnes sorcières, des fées ensorcelantes !
Son brujas de suerte, des sorcières de bonheur.
Nous marchons doucement jusqu'à sa maison. La vie paisible coule à Zugarramurdi comme le ruisseau de la grotte. C'est à peine si un écho parvient à troubler la surface des choses et l'enveloppe de l'atmosphère. On se prend à rêver d'un passage de sorcières comme d'un vol de palombes, pour réveiller les esprits et mettre le village en émoi. Le poulailler, plongé dans une obscurité à faire frémir les pinceaux d'un Georges de La Tour navarrais, sent le chaud et la paille usée par le cul des poules. Un âne bascule son long museau par-dessus les planches, souffle bruyamment et couche ses oreilles. L'oeil de Pepe s'éclaire soudain. Il se tait. Rêve.
À l'intérieur, sa sorcière de femme est en train d'achever de préparer le déjeuner. Una cocina de bruja buena. Me revient à l'esprit le nom d'une excellente table de San Sebastian, tenue de main de maître par un certain Pedro Subijana et qui s'appele «Akelare» (avec un seul r ). Y voir un signe n'est pas sorcier.
© L.M.
Si la visite des grottes de Zugarramurdi et de Sare ne vous suffit pas, faites une balade cool à pied (ou à cheval) autour de ces deux villages, et suivez une partie du long sentier des contrebandiers jusqu’aux cols de Lizarietta et de Lizuniaga, au cône de l’Ibanteli, en pensant à « Ramuntcho », le roman de Pierre Loti. Durée à la carte : 1, 2, 4 heures et plus. Carte IGN TOP25 n° 1245OT.
Autre rando possible : jusqu’à Etxalar, visite de la palombière aux filets verticaux (pantières), et halte à la « venta » Halty, en revenant vers Zugarramurdi, pour reprendre des forces à base de charcuterie espagnole et de vins de Navarre…
Y aller :
TGV jusqu’à Bayonne (env. 5 h depuis Paris-Montparnasse), puis route de Sare. Zugarramurdi est à 4 km du fameux village des contrebandiers.
Manger et dormir :
À Sare : Hôtel restaurant Arraya. Une institution au cœur du village. Formidable cuisine basque « reloaded », chambres cosy. Achetez leur gâteau basque en partant. Tél : 05 59 54 20 46.
À Zugarramurdi : auberge (hôtel-restaurant) Graxiana : belles chambres spacieuses, cuisine navarraise rustique et généreuse. Tél : +34 675 711 498 (Espagne).
Voici la première, consacrée aux grands lacs pyrénéens, du côté du Néouvielle, en plein Parc national.
 Voyage en altitude dans la réserve du Néouvielle
Voyage en altitude dans la réserve du NéouvielleFaune étrange et flore rarissime attendent le randonneur autour des grands lacs d’altitude, dans la réserve du Néouvielle, en plein Parc national. Les Pyrénées à l’état sauvage et beau.
La forêt de pins à crochets, aux alentours du lac de Cap de Long, c’est Brocéliande revue et corrigée à la manière des estampes japonaises. Rares sont les oiseaux. Tous se taisent. Des branches craquent ici et là et sous nos pieds. Et toujours ce bruit torrentiel de cascades qui dialoguent d’une paroi l’autre…
Le massif du Néouvielle expose ses grandes eaux : lacs d’Orédon, d’Aubert, d’Aumar, de Cap de Long et de l’Oule. Et ses laquettes. La plus grande conduit au barrage d’Aubert. Le décor est vaste et planté de pins à crochets pluricentenaires. Nous sommes au pays des marmottes. Les rhododendrons et les raisins d’ours, les gentianes, les anémones couvrent les landes aux airs de pelouses rasées de frais. Tout autour, des chemins sont des invitations à grimper. Les grands pics, de 3000 et plus, ou moins, qu’importe (lorsqu’on aime la montagne, on ne compte pas), semblent s’être donné rendez-vous. Néouvielle, Ramoun, Campbieil, Lustou, Batoua. Depuis le col d’Estoudou, via le GR10, le lac d’Orédon à ses pieds, le randonneur se sent pousser les ailes de Zarathoustra. Magie de la réserve du Néouvielle. Laquettes enchâssées. L’insouciance des paysages. Leur rudesse. Ces troncs tordus –certains très vieux pins à crochets des bords du lac d’Aubert ressemblent à des aussières aux torons serrés, nerveux, torturés à mort. Gris scintillant, presque métallisé. Massif granitique. Aiguilles de pierre. De la Hourquette d’Aubert, une forêt antique cache à peine le pic du Néouvielle. Aumar et Aubert sont à nos pieds. L’expression « grands espaces » saute comme un lapin, du stylo au carnet.
Projet. Aller voir le Gourg de Rabas. Pour son nom étrange. Et rien d’autre. Lac d’Aubert, col de Madamète. Le Gourg est décrit poétiquement comme « un petit lac lové dans une cuvette de granit. » Le crapaud accoucheur y bat son record d’altitude : 2400 mètres. Deux bonnes raisons de serrer les lacets et de repartir. Arrivé dans la grande Réserve, par Orédon, un sentiment Canadien étreint le voyageur. La brume répugne à se dissiper, de surcroît, sur la nappe d’Orédon, augmentant ainsi ses mystères de Grand Ouest devenant Grand Nord. Le bruit sourd d’une cascade rappelle l’océan déchaîné, la nuit. Un vent tempétueux à la cime d’une forêt de plaine. Dans cette espèce d’obscurité blanche, un lac –deviné-, devient une fosse aux secrets, un abîme insondable. Une invitation au voyage au centre de la Terre.

Ici des renoncules à feuilles capillaires et des laiches des rivières. Là des grassettes, des droseras et des sphaignes, signalent la présence de tourbières près des grands lacs. Il est étrange de marcher sur le sol meuble, mouvant par endroits, des prairies tourbeuses « qui sont le résultat de la décomposition de déchets et de restes végétaux accumulés au fil du temps », lit-on sur un panneau du Parc. Nous passons du Canada à l’Irlande. De l’immensité du lac évoquant une mer intérieure à la spongiosité, à la sensation du gorgé d’eau qui happe le pied. Magie des lacs d’altitude. Prairies tourbeuses, végétation éponge, tourbières lacustres qui comblent peu à peu les lacs de faible profondeur. La tourbe gagne par le fond. Il ne manque que des bécassines égarées au bord de cette laquette. Envie légitime d’une Guinness pression…
Montée vers Cap de Long. Tout à coup, le ciel s’ouvre, débarrasse la table, tire la nappe à lui, les nuages se dispersent plus vite qu’un troupeau de moutons effrayés, ils ouvrent la voie, découvrent en contrebas le lac d’Orédon et la forêt de pins à crochets aux troncs bandés comme des arcs, qui l’environne. Fourrure protectrice. Le mauve et le jaune des fleurs illuminent un paysage qui sort de l’ombre. Phares. Fleurs sauvages, granit sec, pentes anguleuses et coupantes. Comment ce pin-ci peut-il rester planter là ? Escarpement, hostilité, paysage en rasoir.
Un grand corbeau traverse, royal, de part en part, le paysage suspendu au-dessus du lac, comme un funambule qui danserait sur son fil au-dessus d’un grand Canyon.
Le brouillard nous enveloppe à nouveau, nous caresse, nous humecte les cils ; nous noie enfin. Englouti, nous devenons avion plongé dans un bain de nuages. Les phares blancs, cette fois, de pâquerettes tout autour, tremblent légèrement au passage d’une bise timide. Le soleil persiste à vouloir percer, qui plante la fine lance d’un rayon dans nos yeux.
Une fenêtre de ciel bleu dans la brume, pointe Cap de Long du doigt. Il est tour à tour gris granit des origines, minier, et gris souris, puis gris étain, ou plomb fondu, gris noir enfin, de cette teinte trop mate pour un Pantonier que seuls les dieux pourraient dessiner, avec le recours de la lumière. Et la facétie de ses jeux et ballets incessants.

Même mieux caché qu’un trésor par une épaisse purée de pois blanchâtre, un lac demeure une présence grande. Un quai des brumes. Nous l’entendons bruire, clapoter, couler, sourdre, cogner à ses bords. Bateau à quai. Alors nous le sentons, ce lac, nous éprouvons sa vérité de monstre assoupi. Nous le guettons en silence, par crainte d’éveiller sa tension en mode pause. Deviner le lac relève de la chasse à l’approche.
Texte & photos.
Pratique :
- Y aller : Paris-Tarbes en TGV via Bordeaux. 5 h environ. Puis prendr el aroute des
- Manger et dormir : A Luz-St-Sauveur : Hôtel-restaurant le Montaigu, 0562928171
Auberge du Lienz chez Louisette, à Barèges 0899022096
Hôtel restaurant Le Viscos à St-Savin (gastro), 0562970228
Refuge, sur place (aux portes du Parc, à 1820 m d’altitude) : celui du Lac de l’Oule, proche de Saint-Lary et sur la route d’Espiaube 0562984862
- Carte IGN TOP 25 1748 ET
- Lire : Lacs et barrages des Pyrénées, Privat, textes : ma pomme. Aquarelles de Philippe Lhez.
Je les signe les 3. Elles ont des thèmes distincts :
la première, nature à fond, s'intitule Pêcher à la mouche dans l'Allier et ses affluents. Parce que le fly-fishing de truites sauvages dans un département aussi préservé vaut son pesant de mouches artificielles.
La seconde est une balade littéraire : La Charente est un songe. Ses compagnons se nomment Chardonne, Loti, Vigny, sans oublier la BD, et Georges Monti, éditeur singulier à l'enseigne du temps qu'il fait.
La troisième touche à l'art moderne et contemporain à Barcelone : C'est par l'art qu'on entre ici, ou comment en finir avec l'envahissant Gaudi en allant directement voir Tapiès, Miro et Picasso.
Télé Paris OBS du 9 au 15 mai, paru ce jeudi 7, pages 22-23 et 30-31.
Voici la littéraire :
LA CHARENTE EST UN SONGE
La Charente a eu Vigny et son chantre se nomme Chardonne. C’est aujourd’hui le cœur du sujet BD. Promenade avec incursion maritime, pour saluer Loti, et la lumière de Ronce...
« Pour moi, la Charente est un songe ; pays plus rêvé que réel. Pays marin par sa lumière, ses nuages lourds entre des percées d’azur, ses pluies qui ont tant de force. La mer est proche, même si l’on habite Barbezieux. » Difficile d’évoquer la Charente littéraire sans dégainer la prose douce et crémeuse et néanmoins envoûtante de Jacques Chardonne. En dépit de son passé collaborationniste qui lui valut d’être emprisonné à la Libération, et à condition de vouloir un instant distinguer l’homme de l’œuvre (comment lire Céline, sinon ?), l’envie est donc grande de citer « l’écrivain du couple » que François Mitterrand –un voisin de Jarnac, admirait et aimait tant lire, et qui décrivit la Charente avec la sensibilité d’un Vuillard peignant.
Barbezieux ne serait qu’une ville de province banale sans l’aide de Chardonne. Son livre « Le bonheur de Barbezieux » la métamorphose : « Cette cité éphémère sur la place du Château, ses rumeurs, ses senteurs, ont contenu pour moi l’exotisme du monde. Plus tard, dans mes voyages, mes amours, je n’ai rien connu de plus brûlant ; et je sens toujours ce qui m’aurait manqué, quand le goût me vient d’écrire, si je n’avais pas été enfant dans une petite ville. » Notons que la maison natale de l’écrivain ne se visite pas et filons vers le Nord-Ouest.
À Cognac, le festival de Littératures européennes, qui accueillera l’Espagne en novembre prochain, est devenu un rendez-vous capital. Né en 1988 à l’occasion du centenaire de la naissance de Jean Monnet, ce festival est devenu un véritable carrefour des littératures où l’on débat trois jours durant, où les Prix Jean-Monnet et Prix Bouchons de culture sont décernés, et où l’on discute avec de nombreux auteurs, car le festival se veut avant tout un « lieu de rencontres et de dialogue entre les écrivains et le public ».
Cognac est aussi la ville d’un éditeur singulier, Le temps qu’il fait, créé par Georges Monti en 1981. Cet éditeur exigeant, de la trempe d’un José Corti, d’un Verdier ou encore de L’Escampette, que dirige son voisin (de Chauvigny, dans la Vienne) et ami Claude Rouquet, a des noms prestigieux à son catalogue riche de plus de 500 titres, tous joliment imprimés de surcroît :Il n’est qu’à citer Armand Robin, Jean Paulhan, Christian Bobin, Jean-Loup Trassard, Jean-Claude Pirotte, Jean-Pierre Abraham, André Frénaud, François Augiéras, Philippe Jaccottet, Georges Perros, pour se convaincre de la qualité d’un éditeur pour lequel la littérature est « cette science subtile de l’égarement », selon le mot d’André Dhôtel. Cap à l’Est, à présent.
À Angoulême, c’est bien entendu le festival international de la BD qui se tient chaque année à la fin du mois de janvier, qui est associé depuis plus de trente ans à cette ville. La Cité internationale de la BD et de l’image, avec son musée, sa bibliothèque, sa maison des auteurs, ses expos, rencontres, colloques, projections, animations pour les enfants à longueur d’année a renforcé le prestige, et donné à la capitale de la Saintonge de solides galons en matière de 9ème art (après le cinéma et la télévision –l’expression fut trouvée par Morris en 1964).
À Champagne-Vigny, situé à environ 20 km au sud d’Angoulême, se trouve une propriété viticole où l’on produit du cognac, du pineau et du vin, Le Maine Giraud, ou Logis Alfred de Vigny. Il s’agit d’un musée et d’un chai doublé d’une distillerie. La tour d’ivoire du poète de « La mort du loup » se visite. Vigny appelait sa propriété « ma sainte solitude ».
Sauter par-dessus les limites administratives et se risquer vers la mer pour mieux revenir dans les terres, est le propre de l’écrivain. Ainsi, de Royan, Chardonne préfère évoquer la forêt voisine de Braconne plutôt que les plages surpeuplées l’été. Puis, il contourne, prend le lecteur par la main et le conduit à Ronce-les-Bains, « où la Seudre s’étale dans l’océan. La somptueuse route qui vient d’atteindre la Coubre à grands frais n’a pas encore déversé sa furie dans la forêt de Ronce. À Ronce, la mer se retire si loin qu’elle semble disparaître découvrant un désert mouillé, une étendue de sable et de vase mauve… » S’il n’avait pas signé tant de romans d’amour, Chardonne pourrait passer pour un écrivain régionaliste : « À Ronce, le soir, qui délaisse la côte pour l’intérieur, quand la mer est basse sur l’étendue de sable mouillé, palette brune, des reflets concentrés se déposent en taches huileuses, rouges, verts, ors violents, vite dissipés, et qui reviendront à l’aube prochaine, dilués dans les nuées de nacre et d’ambre. »
Evoquer ici le Rochefort de Pierre Loti signifie carrément braconner en Charente-Maritime, mais la maison-musée (visites sur rendez-vous) de Julien Viaud, alias Pierre Loti, aussi somptueuse qu’extravagante car elle reflète l’exotisme des nombreux voyages du capitaine de vaisseau écrivain que fut l’auteur de « Pêcheur d’Islande » et de « Ramuntcho », vaut franchement que l’on pousse jusque là.
Et c’est à 32 km de là, à Ronce encore que, feuilletant Chardonne, nous avons envie de retourner pour achever cette balade. « Ici, la lumière existe en soi, onctueuse, teintée de nacre, comme indépendante des choses qu’elle éclaire ; lumière vibrante des terres basses, pareille en Hollande ; un nuage brusquement s’ouvre comme une fleur bleue ; beauté indéfinissable, telles ces nuances de la vie, ces choses qui sont et ne sont pas, qui dépendent du regard… »
©L.M.
-----------------
De Jacques Chardonne, sur la Charente, lire notamment « Propos comme çà », « Matinales », « Le Bonheur de Barbezieux » et « Le ciel dans la fenêtre » (Grasset, Albin Michel, Stock, La Table ronde).
http://www.livre-poitoucharentes.org
Cognac : http://www.litteratures-europeennes.com
BD : www.bdangouleme.com
Vigny : http://www.mainegiraud.com
Maison de Pierre Loti : http://www.ville-rochefort.fr Tél. 05 46 82 91 90
---
- S’y rendre :
TGV Paris-Angoulême (2h30 env.)
En voiture : A10 (4h env.)
- Se loger :
Angoulême : Le Palma, 0545952289
Cognac : Héritage, 0545820126
Rochefort : Palmier sur Cour, 0546995454
Ronce : Le Grand Chalet, 0546360641
- Se nourrir :
Angoulême : Agape, 0545951813
Cognac : La Courtine, 0545823478
Rochefort : La Belle Poule, 0546997187
Ronce : Le Grand Chalet, 0546360641 (restaurant de l’hôtel)
Le lecteur s’émancipe. A l'instar de l'amateur de vins, il est de moins en moins buveur d'étiquettes. Il va au fond en faisant fi de la forme. C'est merveilleux! Fini les repères obligés, les canaux en dehors desquels toute circulation conduit à une impasse. Deux succès actuels montrent une fois de plus cette belle maturité, cette intelligence affranchie.
Celui de Stéphane Hessel, « Indignez-vous ! » (lire plus bas), plaquette à 3€ (on en acquiert plusieurs d’un coup, on l'offre à tout va… et on se rémunère au passage en s’achetant une bonne conscience généreuse), est placé sous les auspices de la Résistance et il flingue Israël sans sommations, mais bon. Je l’offre, moi aussi… L’article (13 pages sur 20) a dépassé les 500 000 ex. en deux mois (enfoncés, les Houellebecq, Lévy –Marc-, Pancol et autres pavés), et atteindra 800 000 sous peu. Il est en voie de traduction dans plus de trente langues. Un phénomène est né. Personnellement, je me réjouis pour son petit éditeur montpelliérain au nez creux !
L’autre phénomène est comparable, toutes proportions gardées : « Crise au Sarkozistan », de Daniel Schneidermann (l’ex-chroniqueur ne signe que la préface, mais il semblerait qu'il ne trompe personne sur les 96 pages de ce pamphlet…), est « sorti » sur Internet peu avant Noël chez un éditeur Béarnais (d'Orthez) à peu près inconnu, LePublieur.com Résultat : 20 000 ex. déjà vendus (10€+port) exclusivement sur le Net donc ! (J'ajoute que je ne l'ai lu que les extraits disponibles sur le site dédié).
Je trouve sains ces phénomènes d’édition : foin des codes traditionnels et par trop poussiéreux : gros éditeurs du village parisien (2,5 arrondissements) suffisants car confits dans la graisse de leur incontournabilitude, dirait Ségolène (les best-sellers évoqués sont publiés en province), circuit exclusif des libraires, promotion/prostitution à la télé…
Dans ces deux cas, il y a certes la notoriété irréprochable d’un sage, M. Hessel. Et de l’autre, le si salutaire engouement pour l’antisarkozysme. Un papier ici ou une note sur un blog influent là, ont certes boosté un processus déjà enclenché. Car c’est le bouche à oreille qui a fait le boulot pour la plaquette de Hessel, relayé -d'accord! d'accord..., par la mise en place juteuse pour tout le monde du libelle aux caisses de toutes les librairies. (Même si certains libraires amis, comme Michèle Ignazi par exemple, ont pu se plaindre que la crise avait conduit le lecteur a se contenter d'offrir un bouquin à 3€ pour les étrennes...). Rappelons qu'il y a l'inconsciente sensation d'agir bien, si utile à notre moral en ces temps de neige sociale, ainsi qu'un certain investissement dans la confiance (à bas prix, ça fonctionne mieux).
Et enfin (surtout?) l’envie d’en découdre, puisqu’il ne s’agit pas de fictions, mais de coups de gueule contre une France moisie…
C'est un livre qui paraît aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai le plaisir -et l'honneur- de l'avoir préfacé. Son auteur, une amie et consoeur, Colette Larraburu, s'est livrée à une enquête historique et sociologique, étalée sur trente ans, du Café des Pyrénées, bar emblématique bayonnais. Dire que les cafés sont des lieux de vie, d'échanges, de socialisation et d'information est une tautologie. Etudiant à Sciences Po, j'avais eu le bonheur de pouvoir choisir, pour sujet de mémoire de fin d'études, le "décortiquage" sociologique (la mode était à Bourdieu, à l'époque), linguistique, économique, social, etc., une année durant, d'un bar de Bordeaux, L'Oriental, Place de la Victoire (il changea par la suite plusieurs fois de nom -il était déjà rebaptisé Le Central à la fin de mon enquête de terrain). C'est dire si la proposition de préfacer un tel livre m'a aussitôt séduit! L'Oriental, Les Pyrénées, je repense, une fois de plus, à la parole si juste, si profonde de l'écrivain portugais Miguel Torga : L'universel, c'est le local moins les murs...
Alors Bravo Colette! Il me tarde de recevoir le bouquin et de le lire! (J'y reviendrai donc). Il est publié aux éditions Elkar : Rendez-vous Place Saint-André. Et voici ce que Emmanuel Planes en dit ce matin dans le journal Sud-Ouest :
http://www.sudouest.fr/2010/12/10/le-cafe-des-pyrenees-un-balcon-sur-saint-andre-263243-4018.php
Le Comité Départemental du Tourisme a été primé pour son magazine 64 au Grand Prix Stratégies de la Communication éditoriale 2010.
Cela me fait très plaisir car j'ai pas mal donné (en textes) pour ce splendide magazine.
Bravo à toute l'équipe (le CDT, l'agence Because...) !
La romancière italienne -d'expression française- Simonetta Greggio (*), auteur notamment de Dolce vita (Stock), a eu la délicatesse de lire des extraits de mon article paru dans Le Monde du 12 novembre sur Le dernier ours (lire plus bas, ici même) au cours de l'émission 5 7 Boulevard, sur France Inter hier après-midi vers 18h47.
Sur le podcast du site http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/cinq-sept-boulevard/, c'est, vers la fin de l'émission, entre les minutes 11'43" et 10'35" (à rebours donc) que vous pourrez entendre la jolie voix d'une romancière qui compte. Merci Simonetta. Puissent ces témoignages éveiller les consciences sur la disparition d'une part de notre patrimoine naturel et culturel.
-----
(*) Lire la note récente ici même sur l'Interallié, qu'elle a injustement raté... A cause de la sénilité des jurés qui ont voulu faire un cadeau (d'adieu?) au vieux -et néanmoins infiniment respectable dénicheur de livres, et proustien de talent- Bernard de Fallois, éditeur par ailleurs d'un journaliste suisse inconnu -mais je n'ai pas lu le bouquin de ce dernier; alors je me tais...

Lundi dernier, j'ai participé, à Montpellier, à un jury de dégustation de vins bio venus de toute l'Europe, et force fut de reconnaître, en dégustant des petites merveilles, que les vins bio -et bons- étaient plus nombreux, plus adultes, moins foireux qu'il y a peu et que les règles drastiques, nécessaires à l'obtention du label bio n'empêchaient plus la qualité. J'ai retenu, à ma table de dégustation, plusieurs costières-de-nîmes à suivre de près (décidément, mes rendez-vous gustatifs récents avec cette appellation sont formidables) et, une fois toutes les bouteilles démaillotées, de splendides vins italiens et espagnols notamment, ainsi que des côtes-du-rhône d'exception. Sur le site, se trouvent les infos sur cette grande dégustation et le Salon qui la suivra en janvier. Le palmarès de ce grand jury, avec les médailles d'or et autres métaux est ci-dessous :
Palmares - medal winners - Challenge Mill Bio 2011.pdf
Je regrette personnellement que Jardin secret, cuvée prestige 2009 de Cabanis à Vauvert, en appellation costières-de-nîmes, n'ait eu qu'une médaille d'argent, car il méritait l'or (selon mes papilles).
http://www.challenge-millesime-bio.com/
Mention spéciale à l'organisation minutieuse et irréprochable de AIVB-LR : association interprofessionnelle des vins biologiques du languedoc roussillon (merci à Cendrine Vimont) et special kiss to l'agence Clair de Lune (notamment Amandine Rostaing et Marie Gaudel) comme d'habitude parfaite dans son job d'agence de comm. spécialisée dans les (bons) vins, surtout ceux du Sud.
Clin d'oeil au Bistro! Chez Boris, (Montpellier) où le pot-au-feu est excellent. Ah! L'os à moelle -et ce bouillon sans "yeux"!.. Surtout avec La Baronne Les Chemins, magnifique corbières (2008) délicatement "carignanné", ainsi que le Domaine des Carabiniers, côtes-du-rhône (2008) sis à Roquemaure, remarquable pour la fraîcheur de ses grenaches.
 Je publie, ce 12 novembre, une tribune dans
Je publie, ce 12 novembre, une tribune dans
uniquement lisible sur le site du journal, à propos du dernier ours de souche pyrénéenne... (cliquez sur le lien ci-dessus pour la lire directement sur le site. Son titre : Le dernier ours, dans la rubrique Débats, pages Idées. Je le reproduis également en annexe de cette note, ce 16 novembre, car il disparaîtra du site en lecture gratuite à la fin du mois).
J'attends vos réactions sur la disparition de ce Grand cru classé, laquelle semble laisser indifférents la majorité d'entre nous...
J'ajoute -je ne l'ai pas précisé dans l'article, que la maladie de peau dont l'ours Camille était atteint, trouverait sa cause dans le stress, lequel était dû à son manque de femelle. Célibataire obligé, eu égard à l'extrême rareté de ses congénères, "veuf" depuis des années, cet ours rongeait son frein.
Sans anthropomorphisme aucun -je me défends à chaque instant contre ce chamallow-virus et je le combats chez l'autre, je suis sensible à l'image donnée par ce passage, ultime, d'un pan de notre patrimoine, devant une espèce de radar dissimulé... Et cela, tout cela, la cause de sa maladie de peau, son inéluctable disparition surtout, me laissent très songeur.
Voyez-vous comme, sur cette ultime photo (un document!) de lui, prise le 5 février par un appareil à déclenchement automatique planqué dans la montagne aragonaise, sur une voie de passage habituelle du plantigrade, celui-ci semble s'éclipser, quitter ce monde de dingues, parce qu'il n'y a plus sa place? Sa démarche est celle d'un géant, d'un monument, d'un résigné aussi, et cela ne manque ni de classe ni de mélancolie. J'en suis bouleversé. C'est ainsi : les choses de la Nature parviendront toujours à m'émouvoir davantage que les choses d'un rapport plus direct au commerce humain, si couard, si décevant en somme.
----
POINT DE VUE
Camille, le dernier ours autochtone de souche pyrénéenne, serait mort. Avec lui disparaît une espèce présente dans nos montagnes depuis 250 000 ans. Et donc une part de notre patrimoine.
Point de vue
LEMONDE.FR | 12.11.10 | 08h21 • Mis à jour le 12.11.10 | 11h23
Âgé d'une trentaine d'années, atteint d'une maladie de peau, la sarna, la dernière photo de l'ours Camille, prise le 5 février dans la vallée d'Anso en Aragon, où le plantigrade avait établi ses quartiers depuis quelques années, avec la vallée voisine de Roncal en Navarre (il évoluait auparavant en vallée d'Aspe), le montre l'échine pelée. Les appareils à déclenchement automatique éparpillés dans la montagne prenaient jusqu'à plusieurs dizaines de clichés de lui chaque année. Eu égard à la faiblesse de Camille, il est peu probable qu'il se soit déplacé. D'où la funeste conclusion qui s'impose peu à peu. S'il en est ainsi, avec lui c'est le dernier vrai ours des Pyrénées qui s'efface.
C'est bien de l'extinction d'une espèce, présente de façon permanente depuis plus de 250 000 ans qu'il s'agit. La vingtaine d'autres ours qui ont été lâchés dans les Pyrénées depuis une dizaine d'années provient de Slovénie. La souche slovène est identique à la souche pyrénéenne. D'un point de vue biologique, c'est le même ours. Mais le symbole, lui, s'éteint comme un pan de culture se trouve pulvérisé.
Les associations françaises et espagnoles à l'unisson, le Fonds d'intervention éco pastoral (FIEP), le Fonds pour la protection des animaux sauvages (FAPAS), ou encore Ecologistas en Accion, déplorent l'inertie des pouvoirs publics des deux côtés des Pyrénées.
Chantal Jouanno, secrétaire d'Etat à l'écologie annonçait en juillet dernier à Toulouse que le plan de réintroduction systématique avait vécu et qu'il y aurait désormais des lâchers ciblés visant à remplacer les ours tués accidentellement. Une nouvelle ourse slovène devrait ainsi être relâchée dans une vallée du Béarn au printemps prochain. Trop tard pour sauver l'identité pyrénéenne de l'ours brun. Cannelle, morte le 1er novembre 2004, était la dernière ourse de souche autochtone.
Avec Camille, c'est un peu comme si l'on arrachait les dernières vignes d'un Grand cru classé ou si l'on brûlait la dernière toile d'un maître. Nous avions pourtant fini par nous habituer à une forme d'interventionnisme que d'aucuns peuvent encore condamner, au nom d'un respect absolu de la vie sauvage. Ainsi qu'à une forme d'anthropomorphisme, voire d'une certaine zoolâtrie dans de rares propos ultra.
Il est question d'un animal mythique dont la charge affective est immense. Nommer les ours avec des prénoms portés par nos enfants peut surprendre. Mais force est de reconnaître qu'il fallait bien agir et ranger certains états d'âme. Le risque de transformer le massif pyrénéen en parc d'attractions est encore loin. Les ours de souche comme les ours slovènes ont su garder leur sauvagerie intacte, malgré les colliers émetteurs et les équipes de surveillance. Cependant rien n'y fit. Voilà l'ours des Pyrénées au musée. Bientôt classé.
Deux nouvelles naissances, suite au dernier lâcher de cinq ours slovènes en 2006 (deux ont péri depuis), ont été authentifiées au printemps dernier. "L'ours semblable" parvient à se reproduire correctement, par ici. C'est un immense espoir. Il n'aura pas sauvé notre ours local, mais gageons que dans vingt, trente ans, il prospèrera sur les deux versants, de l'Atlantique à la Méditerranée. Et qu'un solidemodus vivendi aura été trouvé avec les bergers, dont les brebis subissent de fortes déprédations. Slovènes ou Pyrénéennes, les griffes d'ours ont la même force : européenne.
Léon Mazzella tient un blog.
Léon Mazzella, journaliste et écrivain
 Voilà un beau cadeau de derrière les fagots, ou les tiroirs, c'est comme on voudra. Les éditions Finitude (magnifique catalogue comme on les aime, façon Le temps qu'il fait ou le dilettante des débuts, http://www.finitude.fr), ont râtissé quelques belles feuilles éparses, pas mortes non, mais veinées et vives comme la chaux de la prose de Robert-Louis Stevenson, dont la réflexion sur la description littéraire du génie d'un lieu est splendide, la poésie pavesienne, aux échos camusiens, ensoleillés, de Raymond Guérin, la mélancolie -et l'humour aussi, de Marc Bernard, le désespoir de Jean-Pierre Martinet, l'habituelle folie verbale de Michel Ohl... Sont autant de pâtisseries que l'on déguste à la fraîche. Le sommaire du numéro 1 de cette précieuse revue, Capharnaüm, me rappelle la longue série d'articles que j'ai co-écrit avec Pierre Veilletet dans les colonnes de Sud-Ouest Dimanche, de 1984 à 1987, et que nous avions intitulée Les inconnus célèbres. Nous redonnions ainsi un peu de vie à ces auteurs, ainsi qu'à une pelletée d'autres : Calet, Gadenne, Perros, Augiéras, Blanchard, de Richaud, Luccin, Delteil, Forton, Cailleux... Je me souviens de mon bonheur de replonger dans ces oeuvres subtiles, oubliées, négligées surtout, et d'en faire écho. Comme on revient de mission. Voir les éditions Finitude (*) exhumer, non pas des fonds de malles propres à faire la Une du Monde des Livres, comme le texte liminaire prévient avec humour, mais des fonds de tiroirs, est un ravissement. Simplement.
Voilà un beau cadeau de derrière les fagots, ou les tiroirs, c'est comme on voudra. Les éditions Finitude (magnifique catalogue comme on les aime, façon Le temps qu'il fait ou le dilettante des débuts, http://www.finitude.fr), ont râtissé quelques belles feuilles éparses, pas mortes non, mais veinées et vives comme la chaux de la prose de Robert-Louis Stevenson, dont la réflexion sur la description littéraire du génie d'un lieu est splendide, la poésie pavesienne, aux échos camusiens, ensoleillés, de Raymond Guérin, la mélancolie -et l'humour aussi, de Marc Bernard, le désespoir de Jean-Pierre Martinet, l'habituelle folie verbale de Michel Ohl... Sont autant de pâtisseries que l'on déguste à la fraîche. Le sommaire du numéro 1 de cette précieuse revue, Capharnaüm, me rappelle la longue série d'articles que j'ai co-écrit avec Pierre Veilletet dans les colonnes de Sud-Ouest Dimanche, de 1984 à 1987, et que nous avions intitulée Les inconnus célèbres. Nous redonnions ainsi un peu de vie à ces auteurs, ainsi qu'à une pelletée d'autres : Calet, Gadenne, Perros, Augiéras, Blanchard, de Richaud, Luccin, Delteil, Forton, Cailleux... Je me souviens de mon bonheur de replonger dans ces oeuvres subtiles, oubliées, négligées surtout, et d'en faire écho. Comme on revient de mission. Voir les éditions Finitude (*) exhumer, non pas des fonds de malles propres à faire la Une du Monde des Livres, comme le texte liminaire prévient avec humour, mais des fonds de tiroirs, est un ravissement. Simplement.
Alors bravo !
(*) J'avais quand même été alerté par un papier de Jérôme Garcin (L'Obs) et par un autre de l'ami Didier Pourquery (Le Monde Magazine) : deux secousses, quand même!
Feuilletez cela, lisez : il suffit de zoomer (j'y ai pas mal donné et j'ai eu plaisir à écrire ces textes), vous verrez, c'est chic, il y a du caractère, forcément, c'est bien ficelé. Bravo à l'équipe du CDT. .
Voici la fin du papier que je consacre à Noël Labourdette (cigare le Navarre), dans le dernier n° de "Maisons Sud-Ouest" (le reste en kiosque, avec notamment un portrait d'Ivan Levaï et un compte-rendu de visite-test au SPA du Grand-Hôtel de St-Jean-de-Luz. La vie est dure) :
"..Noël Labourdette voulait que la terre choisisse la variété du tabac. Ainsi, plusieurs furent travaillées à l’aveugle. Au fil des ans, Labourdette et son commando de choc travaillèrent les techniques de séchage, de fermentation, avant de trouver un endroit pour installer la manufacture, proche des plants, pour ne pas faire « voyager » le tabac. À Navarrenx, seize personnes travaillent, dont neuf rouleuses de cigares. Quatre sont Cubaines : Olga, Daymi, Greta et Maory. Christophe, tabaculteur, ou « veguero », vit sur la plantation –dont il est propriétaire-, et veille, avec quinze autres personnes, aux séchoirs et aux « tapados », ces voiles de mousseline qui filtrent 17 à 20% du rayonnement solaire et protègent ainsi les précieuses et fragiles feuilles de cape. Comme à Cuba. « Mieux ! Mes capes sont parmi les meilleures du monde, selon certains acheteurs mondiaux, dit Noël. Mes méthodes de fermentation sont uniques, bien qu’inspirées du travail de la vigne. Je tiens à diriger la fermentation afin de contrôler parfaitement la qualité de chaque feuille de cape. Je définis les degrés d’humidité et de chaleur nécessités par chaque type de feuille : capes, hautes (pour la force), basses (pour la combustion), moyennes (pour les arômes). Les capes ne sont jamais en contact avec l’eau, fut-ce en micro gouttelettes. » Cuba a commencé de s’inspirer de la méthode, « pour améliorer leur production, pas pour m’imiter ! », précise Noël, modeste.
L’eau qui descend de la Pierre Saint-Martin en devenant la Mielle, rivière d’une pureté rare, arrose le tabac. L’absence de culture intensive et la très faible utilisation d’engrais chimiques autour de la plantation de Moumour sont avérées. La plantation a minoré par quinze les engrais nécessaires au tabac. Le taux de substances cancérigènes y est dix fois inférieur à la moyenne nationale. Nous pouvons écrire que Noël a inventé le cigare bio. Le cigare français bio. Mieux : le cigare béarnais bio.
En dix ans, Labourdette a réussi le pari difficile de l’élégance, dans un monde de brutes où la subtilité devient rare. Il pourrait faire des cigares « markettés », virils, comme un vigneron peut faire du vin sur concentré, façon confiture de mûres, pour plaire à un Parker au goût étrange mais terriblement prescripteur. Non. Labourdette donne dans le cousu main, il fait naître, élabore, élève des cigares pourvus d’une belle progression de fumage, dotés d’une suavité et d’une complexité étendues. Le Navarre n’est pas un cigare racoleur. Il exige une attention particulière. Sa palette aromatique a même élargi le vocabulaire dédié : on parle de figue fraîche, de châtaigne, à propos du seul Navarre, cigare synonyme de raffinement ; pas le luxe. Labourdette est d’ailleurs tout sauf un homme ostentatoire. C’est un hédoniste discret qui n’entend pas dévier du chemin de la qualité extrême."
Lisez M, le nouveau mensuel du journal Le Monde, qui paraît cet après-midi à Paris (gratuit avec le journal) et demain en province. Ce lien permet de le découvrir en avant-première. Personnellement, j'y écrirai sur les voyages, européens et lointains, et tiendrai la chronique vins (laquelle a sauté pour sa première apparition, à cause d'une page de pub... C'est bon signe et tant mieux, en ces temps de morosité ambiante!). Vive l'énergie positive, celle qui va de l'avant et répond à la crise par l'initiative.
Hélène est malade à l’automne, dans son restaurant de la rue d’Assas à Paris, ou au Connaught à Londres, dont elle dirige les cuisines une semaine sur deux (d’un mercredi à l’autre), car elle est loin des Landes et de leurs couleurs, de leurs parfums de sous-bois, de champignons, elle se sent loin des ambiances de palombière, où l’on rigole et ripaille avant tout. Ses Landes lui manquent plus que jamais à cette période de l’année, car elles la renvoient à son enfance, lorsqu’elle relevait les matoles à ortolans avec son père. Elle se souvient des sorties dans la vieille Peugeot blanche de son grand-père, pour aller cueillir les fraises des bois à Vielle-Soubiran, ou bien ramasser des asperges : « c’est l’odeur d’humidité, le journal mouillé sur lequel on les dépose, le « clac » quand on les cueille. » Hélène se rappelle des dimanches soir au restaurant familial de Villeneuve-de-Marsan, lorsque les chasseurs arrivaient avec des sangliers entiers qui la terrorisaient, et les producteurs qui passaient en semaine avec leurs cageots de cèpes et leur canards gras… (la suite du portrait d'Hélène Darroze, que j'ai donné à Maisons Sud-Ouest? -Au kiosque, té! ©L.M.)
Ce matin, lorsque j’ai ouvert les deux battants de la porte et que je suis sorti sur le seuil, un chevreuil a fui, le feu aux quatre pieds, en aboyant de surprise. À son passage, le givre qui avait recouvert d’un voile sucré les prairies alentour, crissa. Un soleil timide mais franc du rayon caressait le velours côtelé des vignes pelées, au-delà du fleuve et de la hêtraie…
Les bûches qui ont dormi dehors sont congelées. Les braises les feront péter doucement, tandis que le café passera. Hier soir, ce sont des sarcelles qui sont passées en rasant l’étang voisin, alors que nous attaquions l’apéro dans le jardin, emmitouflés, avec un foie gras mi-cuit escorté d’un blanc de Cérons, pour changer. Puis, nous avons testé en famille une recette du bouquin d’Hélène, par envie de cèpes et de girolles. Il faut que j’appelle Catherine, tout à l’heure, pour qu’elle m’apporte quelques bocaux de cous farcis et l’irouléguy sans étiquette de son oncle. Un mail de Beñat vient de tomber : il confirme notre virée d’après-demain du côté d’Izotges, près de Riscle, pour saluer Gégé, et chiner un peu sur les marchés, car Beñat a besoin de décorer la grange qu’il a fini de retaper. Puis nous remonterons tranquillement vers l’île de Ré, juste pour les grandes marées, en faisant une halte à Bordeaux, histoire de remplir la malle de flacons. Sur la photo de l’an dernier, Pierrot et Manou, en waders, ont l’air de pingouins chez les scaphandriers, mais ils sont capables de ramasser des coques pour une équipe de rugby. Té, justement, le programme du Tournoi me tente avec Irlande-France, ou France-Galles… Mais j’aimerais mieux refaire le match Toulouse-Bayonne, avec des copains Toulousains et Bayonnais !.. Les autres pages du journal sont désespérantes : la crise mondiale grignote toujours plus de terrain et d’énergies. L’humour est en berne, la bonne humeur vagabonde, la croissance buissonnière et les profils, bas. La frilosité et le repli ne peuvent pas donner le change aux guerres et aux fléaux. Je plie le quotidien et le bazardes de dépit, dans le panier à petit bois et vieux papiers. Face au chaos, « Maisons Sud-Ouest » agira encore comme un rempart contre la déprime, un chasse-spleen inoxydable, une bouffée d’air pur, une poignée de mains. C’est une valeur sûre. ©L.M. (Edito de "Maisons Sud-Ouest" n°34, Hiver 2008/2009).
Le nouveau magazine MAISONS ET OCEAN (la côte atlantique dans toutes ses splendeurs). En kiosque, comme VSD spécial JO de Pékin.
VSD hors serie_COUV Essai3.pdf
VSD HORS-SÉRIE
JEUX OLYMPIQUES PÉKIN 2008
J'ai créé au cours de l'été dernier imazz communication, structure légère capable de fournir clés en mains (prêts à imprimer) hors-série, numéros spéciaux, livres, à un groupe de presse, un éditeur (toutes thématiques).
Première réalisation : le hors-série rugby de VSD, vrai succès en kiosque.

A bon entendeur...
ou : faites passer!
i.mazz@yahoo.fr
http://mireille.free.fr/sud-ouest.html
Cliquez! C'est un somptueux reportage photographique sur l'Ethiopie, que l'on doit à Mireille Jeanjean.