La vie dans les tranchées
in L'EXPRESS, hors-série La Grande Guerre (en kiosque):
 L’HORREUR AU QUOTIDIEN
L’HORREUR AU QUOTIDIEN
Par Léon Mazzella
D’abord il y a la mort. Omniprésente, pestilentielle, celle du copain déchiqueté sous les yeux du soldat, celle de l’ennemi, celle qui rôde, celle qui frappe sans prévenir, et que nul ne voit venir. Et puis il y a les « totos », ces poux qui grouillent et ne font pas davantage relâche que les puces, et de gros rats qui empêchent de dormir, dévorent tout, y compris les pieds et les nez des vivants. Il y a surtout la peur –cette indécollable peur au ventre, majuscule, chevillée, clouée, profonde et permanente. Qui a dit que les Poilus se faisaient parfois sous eux en jaillissant des tranchées quand il fallait y aller ? Pas les visuels rassurants des cartes postales, outil accessoire de propagande, qui montrent des soldats posant, souriants, sereins, lorsque la plupart crevaient de frousse et de maladie, agonisaient dans un trou, les jambes broyées et le cœur aussi, le corps gelé ou à demi noyé dans une boue aussi épaisse que de la crème de marrons. Même les livres emblématiques comme l’émouvant « Ceux de 14 » de Maurice Genevoix (1) disent l’horreur illimitée au quotidien, n’évoquent qu’avec tact et émotion contenue le sang, les tripes, les cris, les appels au secours, l’appel ultime à maman avant de basculer dans le néant. Lire « Sous Verdun », « La boue », « Les Eparges » (lire l’extrait ci-dessous), de Genevoix conjugue le plaisir du texte (il s’agit d’un grand moment de littérature) , et la sensation d’assister, in vivo, au quotidien du Poilu auquel Genevoix nous invite sans ambages ni précautions d’usage : son témoignage est aussi poignant que cru, aussi fort que vrai. La mort est une compagne. Un coup de pelle pour creuser une nouvelle tranchée fait tomber sur un corps en putréfaction. L’odeur de la mort est toujours là et celle des cigarettes ne parvient pas à en masquer l’indélébile trace. La mort se respire, la mort est en soi puisqu’elle attend le soldat à chaque instant. L’insoutenable légèreté de la survivance prend le poids d’un supplice, pour les Poilus que la mort côtoie de si près
La chasse aux rats
L’horreur, c’est aussi la chasse aux rats, parce que les rats, gras car repus de chair humaine, ont pris de l’assurance, de l’arrogance, de la présence ; de l’omniprésence. Les rats pullulent et envahissent la vie du Poilu. Au point que le haut commandement promet une prime de cinq sous à chaque prise. Ernst Jünger, dans « Orages d’acier » (2) autre journal de guerre emblématique –côté Allemand, cette fois-, a su décrire avec une pointe d’humour désabusé ce passe-temps : tirer les rats, les enflammer, les piéger, jouer avec la vermine. « La chasse aux rats offre une distraction fort goûtée dans le vide des gardes. On dépose un petit bout de pain en guise d’appât et on pointe le fusil sur lui, ou bien on répand dans les trous de la poudre prise aux obus non éclatés et on y met le feu. Ils en bondissent alors en couinant, le poil roussi. Ce sont des créatures répugnantes, et je ne puis m’empêcher de penser toujours à leur activité secrète de charognards, dans les caves de la bourgade… » Erich Maria Remarque, l’auteur de « A l’Ouest, rien de nouveau », roman pacifiste exemplaire sur la Grande Guerre, évoque les « rats de cadavre ». C’est dire. Et par-dessus le marché, « l’été, ce sont des essaims monstrueux de mouches qui viennent pondre dans les corps des soldats en décomposition », note Jean-Yves Le Naour (3). Aussi, le quotidien du soldat dans cette fichue guerre de position, est-il loin d’être idyllique et de ressembler aux images de propagande diffusées à grande échelle et destinées à rassurer le front arrière. Lequel n’était pas dupe, lorsqu’il recevait des nouvelles du front.

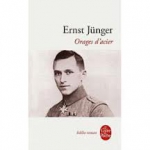
 (1)Flammarion, 960 pages, 2013. Disponible également en Points/Roman et aux éd. Omnibus.
(1)Flammarion, 960 pages, 2013. Disponible également en Points/Roman et aux éd. Omnibus.
(2)« Orages d’acier », par Ernst Jünger (Le Livre de Poche, 1989).
(3)« La Grande Guerre à travers la carte postale ancienne » (HC éd. 2013).
**********
Bonnes feuilles :
LES EPARGES
 « Cela se passait aux Eparges, pendant une des attaques meurtrières du printemps 1915. On se souvient peut-être que sur cette butte des Hauts-de-Meuse, la bataille se prolongea deux mois. Une bataille sauvage, une suite presque ininterrompue d’attaques et de contre-attaques pour la conquête d’une colline de boue, dans des tranchées gluantes bouleversées par des milliers d’obus. Les havresacs, les armes, les cadavres s’enfonçaient lentement dans la glaise, des blessés perdus s’y noyaient. Chaque trou d’obus, les énormes entonnoirs creusés par l’explosion des mines devenaient autant de mares glacées, d’un jaune aigre et verdâtre empoisonné par l’hypérite (*). Et il flottait sur ce charnier une odeur fade et corrosive ensemble qui entrait loin dans la poitrine, semblait happer aux bronches comme la boue aux mains nues, aux genoux et aux reins.
« Cela se passait aux Eparges, pendant une des attaques meurtrières du printemps 1915. On se souvient peut-être que sur cette butte des Hauts-de-Meuse, la bataille se prolongea deux mois. Une bataille sauvage, une suite presque ininterrompue d’attaques et de contre-attaques pour la conquête d’une colline de boue, dans des tranchées gluantes bouleversées par des milliers d’obus. Les havresacs, les armes, les cadavres s’enfonçaient lentement dans la glaise, des blessés perdus s’y noyaient. Chaque trou d’obus, les énormes entonnoirs creusés par l’explosion des mines devenaient autant de mares glacées, d’un jaune aigre et verdâtre empoisonné par l’hypérite (*). Et il flottait sur ce charnier une odeur fade et corrosive ensemble qui entrait loin dans la poitrine, semblait happer aux bronches comme la boue aux mains nues, aux genoux et aux reins.
Chaque fois qu’un régiment montait, c’étaient mille hommes qui tombaient, plusieurs centaines de tués, des blessés affreusement déchiquetés par des obus de rupture énormes, quelques fous. Les survivants descendaient au repos, dans des villages déserts et bombardés où ils ne cessaient point d’entendre, jour et nuit, le grondement de l’interminable bataille. Des renforts arrivaient, comblant les vides des compagnies. Et ils remontaient aux Eparges.
Ils remontaient par les mêmes cheminements, les mêmes boyaux ruisselants ou gelés, vers les mêmes tranchées bouleversées, éternellement refaites et nivelées, où d’une relève à l’autre ils retrouvaient les mêmes cadavres, raidis encore dans l’attitude où la mort les avait saisis : celui-ci avec le même éclat brillant fiché dans son crâne nu comme un coin de bûcheron, cet autre avec sa main crispée par-dessus son épaule, dans la même moufle de laine bleue. Tous connus, tous reconnaissables, compagnons et frères d’hier qu’ils ne pouvaient s’empêcher de nommer, ceux qui s’étaient effondrés sans une plainte, ceux dont ils avaient écouté, dans la nuit, gémir la longue agonie. »
-----
Maurice Genevoix, « La Ferveur du souvenir » (pp.79-80, éd. établie par Laurence Campa, ©La Table ronde, 2013)
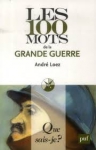 (*) Gaz moutarde : « On nomme ypérite le plus atroce des gaz de combat de la Grande Guerre », écrit l’historien André Loez, dans « Les 100 mots de la Grande Guerre » (PUF / Que sais-je ?), « du nom de la ville belge d’Ypres où il fut utilisé pour la première fois par l’Allemagne en juillet 1917. Egalement nommé gaz moutarde en raison de son odeur, il brûle la peau et les muqueuses, rendant inopérantes la protection des masques. »
(*) Gaz moutarde : « On nomme ypérite le plus atroce des gaz de combat de la Grande Guerre », écrit l’historien André Loez, dans « Les 100 mots de la Grande Guerre » (PUF / Que sais-je ?), « du nom de la ville belge d’Ypres où il fut utilisé pour la première fois par l’Allemagne en juillet 1917. Egalement nommé gaz moutarde en raison de son odeur, il brûle la peau et les muqueuses, rendant inopérantes la protection des masques. »
Nota : l'anachronisme figurant dans le texte de Genevoix - il évoque des faits qui se déroulent en 1915 - s'explique par la date de la rédaction de ses livres sur la Grande Guerre, largement postérieure à celle-ci. D'autres gaz -aveuglants - que le gaz moutarde, furent utilisés en 1915.
Commentaires
Magnifique et déchirant. Merci Léon.
Merci Christiane. J'invite à aller voir l'ensemble (212 pages que j'ai eu à coeur de copiloter et d'écrire d'abondance). Je ne soupçonnais pas un instant que je serai si happé par le sujet; passionnant lorsqu'on le fouille.
Un pan de l'histoire dont le souvenir, à l'instar de quelques autres, se doit d'être transmis aux générations qui nous suivent...
Un véritable travail d'orfèvre l'ami, totalement subjuguant. Merci.
Tu as donc examiné la bête de près, Sylvain - merci, amigo. Je crois qu'on a fait un bon boulot, en équipe réduite et en cinq semaines environ. En tout cas nous en sommes fiers, et il paraît qu'il cartonne en kiosque...
Vous pouvez l'être. Une telle rigueur en si peu de temps se doit d'être saluée. Et toujours cette passion communicative, quel que soit le sujet. Hâte de découvrir vers quels horizons tu vas te diriger...