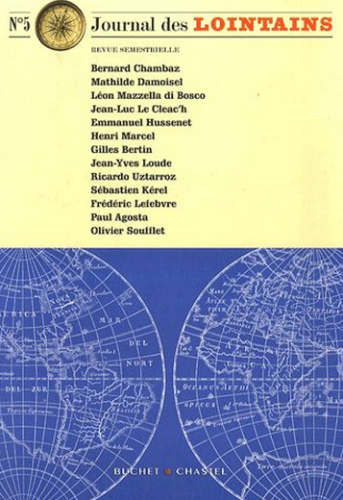 L'une des magies d'Internet est de retomber sur un texte ancien, de le relire et de se dire : ça tient encore la piste (ayant davantage emprunté des chemins de traverse qui ont toujours engendré mes chemins d'écriture -que des routes droites et balisées), et de se dire donc : tiens, et si je le mettais en ligne, celui-ci... En voici donc un, dans les archives, qui fut publié par feu Le Journal des Lointains, que l'écrivain Marc Trillard dirigeait chez Buchet-Chastel. Une revue-livre littéraire dédiée au grand reportage; un ancêtre des mooks d'aujourd'hui, abondamment illustrés -à l'instar de l'emblématique revue XXI (Les Arènes), ou bien du jeune Long Cours (L'Express). Cela se passait au Kazakhstan en 1997. Et fut publié dix ans après (en général, je publie dix ans après).
L'une des magies d'Internet est de retomber sur un texte ancien, de le relire et de se dire : ça tient encore la piste (ayant davantage emprunté des chemins de traverse qui ont toujours engendré mes chemins d'écriture -que des routes droites et balisées), et de se dire donc : tiens, et si je le mettais en ligne, celui-ci... En voici donc un, dans les archives, qui fut publié par feu Le Journal des Lointains, que l'écrivain Marc Trillard dirigeait chez Buchet-Chastel. Une revue-livre littéraire dédiée au grand reportage; un ancêtre des mooks d'aujourd'hui, abondamment illustrés -à l'instar de l'emblématique revue XXI (Les Arènes), ou bien du jeune Long Cours (L'Express). Cela se passait au Kazakhstan en 1997. Et fut publié dix ans après (en général, je publie dix ans après).
Nota Bene : c’était à la période où Lady Di mourût. Je l’appris avec une semaine de retard. Dans la steppe où je me trouvais –à huit mille cinq cents kilomètres de Paris, trois mille cinq cents de Pékin, à cinq heures de piste d’un premier village et à dix-huit du premier centre de soins hospitaliers, le monde pouvait tourner en vrille sans que je le sache. Et c’était bien ainsi… Surtout de réaliser qu'avec mes compagnons de fortune, nous faisions partie des rares humains qui apprenaient cette nouvelle planétaire avec tant de retard, en tombant sur ses portraits qui inondaient le kiosque à journaux de l'aéroport d'Istanbul, au retour de notre longue virée.
AU CUL DES COQS DANS LA BRUYERE KAZAKH
29 août. Vol Paris-Istanbul. Escale dans la capitale turque. Eternelle magie du voyage. Jusque dans les façons de faire pour reconnaître individuellement ses bagages sur la piste, avant de remonter dans l’avion... Ce qui me ravit délicieusement énerve toujours quelques grincheux qui ont vite recours à l’adjectif sauvage pour désigner les us d’une civilisation étrangère. C’est affligeant. Les veneurs qui sont du voyage et qui tenteront de prendre un cerf maral –le plus gros du monde- avec leur meute de quarante-deux chiens solognots et les petits chevaux kazakhs, sont moins cul pincé que je ne le craignais. Ils sont même assez chauds : chaque femme qui passe est déshabillée du regard et abordée sans ambages. Ils aiment aussi l’alcool et les cigares et semblent peu habitués à voyager. C’est de bon augure. Touffeur. Attente. Retard (prévisible) de l’avion pour Alma-Ata (j’ai du mal à dire ou à écrire Almaty car Alma-Ata, c’est comme Samarkand et Zanzibar, comme la route de la soie ou celle des épices : du rêve brut). Vendeurs de loukoums. La photo de Carole Bouquet au duty-free. Bu une bière tiède. 21 heures (locales). L’avion est plein. Beaucoup de chinois et de mongols, j’avoue ne pas les distinguer avec certitude.
Vol Istanbul - Alma-Ata. 4 h 45 dans les airs. Il sera environ cinq heures du matin à l’arrivée (heure kazakh), soit environ deux heures du matin ce samedi 30 août en France. Là, nous avons le choix entre une visite de la capitale du Kazakhstan (aux allures de cité russe formée de gros cubes de béton triste), puis prendre un avion réputé improbable, voire périlleux (2 h 30 de vol) ou bien se taper, avec les chiens, environ trente heures de bus sur les « routes » …
Autrement écrit, mon choix est fait. Je testerai le talent des pilotes de la Kazakhstan Airlines.
Almaty signifie « le village des pommiers ». Kazakh, selon la même source –une brochure égarée-, signifie brigand, rebelle, guerrier nomade en lutte contre l’Etat, et ses compatriotes. De tels éclairages laissent à penser qu’un tel pays ne peut pas avoir de mauvais fond.
Alma-Ata est appelée Almaty depuis le printemps 1993. Je reprends mes deux vieux Hemingway dans l’édition de La Pléiade. Les exemplaires sont fatigués, usés par les voyages que nous avons faits ensemble. Mais là, c’est différent, je les sors de la routine africaine, puisque je les ai emmenés en Asie.
31 août. Après le vol Almaty – Ust-Kamenogorsk (vite surnommé : Ouste ! Calmez les gosses), à bord d’un avion d’une vétusté de cheval fourbu et de camion retraité -il n’y avait même pas de ceinture de sécurité à mon siège- , nous avons pris la route. Huit heures de bus prévues. Il y en aura dix-huit.
Nous sommes déjà dimanche matin, il est 7 h 30, et nous avons dormi dans le bus, habillés, sur des sièges durs comme du bois ; au bord d’un lac immense, en attendant le bac qui doit nous faire passer. Malgré nos fusées éclairantes et notre klaxon qui déchirait un silence de nuit dans le désert, il n’est pas arrivé à l’heure, hier soir. L’explication est simple, et courante : l’équipage était fin saoul, à bord. Nous entendions leurs chants d’ivresse. Le bac a passé la nuit en face… Aube. Un vol de canards passe au ras de l’eau. Il y a des mouettes et, curieusement, des pigeons bisets surgis de nulle part, et une longue file de camions et de voitures derrière nous. Les Russes qui nous accompagnent sont toujours souriants et aimables. Depuis hier, nous mangeons un pain dur et gris, du saucisson de cheval, une sorte de gros fromage de vache à pâte molle, des petits-beurre et de l’eau gazeuse légèrement salée dans des bouteilles de plastique trop mou. Ce matin, ils ont trouvé le moyen de faire du thé : un bonheur ! Hier soir, l’atterrissage de notre petit Tupolev sur la piste d’Ust-Kamenogorsk fut splendide. Il était environ 19 heures, la lumière était douce et le paysage infiniment serein, vert amande. Rivière argentée, montagnes au loin, longue, longue plaine à donner envie de chevaucher sans fin. Un paysage de film russe. Nuit dans le bus qui cahotait, puis, à l’arrêt, dans le même bus, à la recherche du sommeil, entassé comme les autres sur les sacs et les sièges, la tête contre mon barda, dur, avec la mallette à cartouches pour oreiller, ma veste de chasse pour couverture et mes pataugas aux pieds depuis maintenant plus de 48 heures. Nous sommes précisément à Buhtarma. Cette première nuit kazakh fut si étoilée que j’ai trouvé –pour la première fois -, qu’il y en avait trop ! Et toujours ce temps superbe, bleu dur.
Traversée en bus de la steppe. Je me serais cru dans « Urga » et dans « Soleil trompeur », les films magnifiques de Nikita Mikhalkov, surtout lorsque nous avons perdu notre route (l’épisode fameux du camion qui cherche à retrouver son chemin, dans « Soleil trompeur », et qui traverse tout le film, ne quittera pas mon esprit pendant tout le voyage).
Arrivée après 5 h 30 de chaleur, de poussière fine et pénétrante, de chaos qui faisaient ruer le camion-bus, au campement de yourtes. Le paysage immédiat est montagneux. Nous sommes à 1500 mètres d’altitude. Tout autour du campement,une large plaine sauvage d’herbes sèches qui alterne curieusement avec des champs de blé, car on a de la peine à imaginer que l’homme puisse travailler le sol ou autre chose, ici, si loin de tout.
J’ai vu une énorme crotte d’ours fraîche, en partant pour la première chasse. Charmant, lorsque l’on s’en va chercher des petits coqs de bruyère. Les ours viennent dans les champs, la nuit. Il y en a beaucoup, paraît il. C’est un brun assez semblable au notre. Les loups aussi sont nombreux par ici. Les tétras-lyre sont en revanche assez rares. Le paysage m’évoque les plateaux de Castille. Je retrouve aussi la Russie des grands tétras. Mais foin des comparaisons, je découvre surtout le Kazakhstan dans toute sa beauté sauvage. Pas un avion ne passe, pas une trace blanche, donc, pour rayer le ciel bleu, ni l’écho d’un bruit. Cela devient rare. Au cours du premier dîner sous la yourte-restaurant, un chasseur de maral cita cette phrase fameuse de Charles X, dans une lettre à sa femme : « Madame, il fait grand vent et j’ai pris trois loups »…
1 septembre. Aujourd’hui, je n’ai tiré que deux cartouches avec mon petit calibre vingt : deux tétras au tableau (pourvu que ça dure). Les paysages sont splendides. Les couleurs d’automne : mordoré, jaune, rouge, habillent les arbres dont les tons changent vite. La montagne est sèche, l’herbe et les bois cassants. Le vent est tiède et très desséchant aussi. Nos lèvres gercent et se fendent. Le guide de chasse kazakh fut un peu benêt : il semblait découvrir les territoires en même temps que nous, mais la journée fut belle. Nous avons trouvé un piège à ours artisanal : un braconnier avait installé une carcasse de cheval (et une autre de chien, ou bien c’était la victime du piège devenue appât). L’entrée du piège était barrée d’un fil de pêche tendu à hauteur d’un ours marchant à quatre pattes. Une grosse branche avait été disposée pour forcer l’animal à entrer ainsi car, au bout du fil, la détente d’un vieux fusil à un coup du type Simplex ou Baïkal, solidement attaché et dissimulé, devait porter un coup de feu à la tête et à bout portant. C’était la seule entrée du piège : les trois autres côtés étaient barrés par d’épais branchages. Les braconniers font cela pour la peau de l’ours.
Au retour, je me suis baigné dans l’eau glacée d’un torrent, sous l’œil d’un aigle (et de Samia, l’unique femme de l’équipée. Elle a dix-neuf ans, son bac en poche, et s’offre un grand voyage dépaysant parce qu’elle adore la chasse. Elle est très belle. Très blonde. D’origine Germanique. Vierge, sans doute). Vivifiant à crier ; le bain.
La soirée fut longue et arrosée, placée sous les signes entrelacés de la vodka et des chansons ; nous avons ri sous les étoiles très tard dans la nuit, avec nos compagnons kazakhs, jusqu’à ce qu’un chasseur se mette à hurler depuis sa yourte, « vos gueules ! ».
Bonne nuit.
Mardi 2 septembre. Ce matin, réveil vers 9 h 30, calmement. Nous allons monter les chevaux kazakhs. Aucune chasse n’est prévue, sauf que j’ai envie, avec mes deux compagnons de chambrée (ou de yourte) d’aller faire un tour à cheval, carabine en bandoulière, là où passent parfois les loups, selon les guides ; puis de vérifier si la bécassine solitaria, qu’un veneur m’affirme avoir levé, se trouve encore autour du petit marigot, au-delà du campement. L’équipe de TF1 est arrivée dans la nuit. Ils dorment, sauf Christophe, qui prépare le tournage en lisant sa documentation. Il fait grand vent (doux) et je n’ai pas vu, pas pris, de loup…
J’ai bu l’eau de la rivière et ne fut pas dérangé. Il est recommandé, avant cela, de vérifier si une carcasse de cheval ne traîne pas dans l’eau, en amont ; les kazakhs ayant la fâcheuse manie d’abandonner dans le courant et pas sur l’herbe. Nous sommes au cœur de la civilisation du cheval : le peuple kazakh, nomade, le monte (ils semblent nés sur une selle) et le mange.
Merveille de pouvoir ainsi boire l’eau pure d’un pays sauvage, préservé (je serai sourd, tout au long du séjour, aux dires concernant les essais nucléaires répétés –mais où ?- et sur la radioactivité élevée du pays)… Après-midi douce. Lumière extraordinaire, à rendre fou un photographe. Les bouleaux prennent un peu plus d’automne chaque jour. Monter à cheval dans un tel paysage n’a pas d’équivalent. Nous avons tourné ensemble, avec TF1, notre recherche de la bécassine solitaire. Nous n’en avons vu (et pris) qu’une ordinaire. Et examiné de belles crottes d’ours pleines de baies à peine digérées. Certains ont aperçu des loups. Demain, les veneurs chasseront. Les chasseurs à tir comme moi pourront les suivre à cheval ou bien marcher derrière les coqs de bruyère, ailleurs. Je ne partirai pas avec les veneurs à cause des plaies que la selle kazakh, a déjà infligé à mes fesses. Il est question de faire une battue au loup, après-demain. Puis de partir vers un camp volant dans les parages duquel vivraient quelques chevreuils de Sibérie et de nombreux tétras. Chouette programme en perspective. L’impression de dépaysement que je ressens est telle que le mot dépaysement me paraît désuet. J’ai la flemme de chercher le mot ad hoc.
De là, nous passerons à nouveau par Ust-Kamenogorsk.
Bonheur de se laver dans la rivière ou de prendre un banhia, cette sorte de sauna russe improvisé sous une yourte hermétique, qui garde la chaleur d’un poêle. De laver mes vêtements dans le courant du ruisseau, d’observer ces ciels incroyablement étoilés. Samia, dans la yourte qui abrite le banhia, m’a appelé pour que je vienne lui frotter le dos. Je l’ai fait avec reconnaissance.
Isolement et bonheur simple. Ce soir, les veneurs et leurs 42 chiens sont partis bivouaquer loin d’ici, pour chasser de bonne heure demain. Sans les aboiements incessants de la meute, parquée dans un chenil de fortune, la nuit sera plus calme.
Mercredi 3 septembre. Ce matin tôt, quatre loups sont passés en trottant sur la crête au-dessus du campement, à une centaine de mètres, tandis que j’achevais mon thé. Un cheval découpé hier, et dont les restes ont été laissés sur place, à proximité des yourtes, les aura attirés. Ils se sont arrêtés, m’ont regardé, et disparu dans la coupure du jour, à l’embrasement de l’aube. Le camp est vide, nous partons chasser le coq. Il fait froid la nuit, et chaud durant la journée. A huit heures, le pull-over devient incommodant. Journée dure (physiquement) mais saine, beaucoup d’oiseaux défendant chèrement leur peau, crapahut sur des crêtes et des pentes escarpées, échappée belle et montagnarde. Comme j’aime. Nous avons appris à boire l’eau des ruisseaux, à plat ventre, à l’aide d’une paille que l’on confectionne en coupant une branche de sureau. Bain, presque nus, dans la rivière. Le bonheur inouï procuré par la première gorgée de cette bière locale, même tiède, appelée « Faxe », lorsqu’on ne l’attend pas, ou plus…
Et cette soif immense, ce bonheur de boire à une source qu’il faut imaginer pure, ou bien à laquelle il vaut mieux ne pas penser. Volodia, le chauffeur, m’a tendu depuis son camion un verre de vodka kazakh, au moment où le soleil disparaissait à l’horizon et où des tétras-lyre quittaient les vallées fraîches pour se rendre au gagnage dans les champs de blé, sur les plateaux. Plaine rase et paysage infini de montagnes mauves. Au cours du dîner, les veneurs ont raconté comment ils avaient « attaqué » un cerf maral ce matin, puis leur déconvenue, la perte de plusieurs chiens. Le banhia fut salutaire, après cette journée écrasante de chaleur. Je me serais cru à nouveau sur les plateaux de Castille en août, lorsque l’on y chasse la caille ; ou en Corse –le grésillement perpétuel des insectes en moins. Avant de dîner, j’ai pris un cheval sellé et, carabine dans le dos, suis parti au-delà des collines qui entourent le campement, avec l’espoir d’apercevoir encore quelque loup…
Je repense aux quatre silhouettes de l’aube. Longtemps, je les verrai repasser dans ma tête, sur cette crête découpée comme une mâchoire.
Jeudi 4 septembre. Affût à l’ours, très tôt. Nous sommes partis chevaucher vers 5 heures 30 et nous nous sommes postés loin de nos chevaux, éloignés de plus de quatre cents mètres les uns des autres, derrière des rochers. J’étais flanqué de l’équipe de TF1, qui a l’habitude de rester immobile et silencieuse. À midi, nous avions pour invités quelques apparatchiks locaux, sans doute attirés par un possible bakchich. Les organisateurs français de ces chasses doivent savoir les flatter de temps à autre… Ce soir, je reprendrai un cheval sellé et je repartirai en balade jusqu’au couchant, ma carabine dans le dos et les jumelles battant mon ventre, « dans la nature, heureux comme avec une femme » (Rimbaud) à moins que Samia ne veuille m’accompagner.
Vendredi cinq septembre. Temps couvert. Je n’ai pas eu le courage de me lever à 5 heures pour aller à la rencontre des loups avec mes compagnons de yourte, et je m’en veux. Une grande battue collective est organisée aujourd’hui. Ours, loups, marals, chevreuils de Sibérie et autres lynx peuvent être aperçus. Nous ne verrons rien. Sauf un paysage grandiose et des lumières d’une beauté rare. Le meilleur, ce fut de retourner à cheval jusqu’au campement (l’aller avait été effectué en camion) : deux heures trente de galop et de trot, à cinq cavaliers, dont un kazakh facétieux qui veillait sur nous et s’amusait à tenter d’attraper nos chevaux au lasso, et à essayer de dénouer nos selles pendant le galop. Nous avons fait la course sur les chemins avec eux, et j’étais comme un cosaque de sous-préfecture.
Samedi six septembre. Il a plu toute la nuit et il ne fait plus chaud mais assez frais. Il paraît que la neige peut arriver très vite et qu’en quelques jours nous passions d’un climat estival à l’hiver, le vrai, avec une épaisse couche de neige. Les kazakhs commencent d’ailleurs à démonter quelques yourtes. Le campement sera bientôt déplacé vers une zone plus clémente. Chasse au tétras. Le peu d’oiseaux que nous réussissons à capturer améliorent l’ordinaire, fait de cheval à midi et de cheval le soir… Nous avons dormi sur les chaumes, à l’abri du camion, après le casse-croûte de midi. Passée aux coqs, le soir. Les voir planer, ailes arquées, comme des bolides d’un autre temps, est un ravissement. Je ne peux me résoudre à les tirer, ce soir. Les copains s’en chargent. Nous en plumerons pour le dîner.
Dimanche sept septembre. Nous quittons le campement. Le long trajet de retour commence. Journée passée dans le bus, depuis les yourtes que nous avons longtemps regardées derrière nous et à travers le nuage de poussière du camion, jusqu’à Ust-Kamenogorsk, via le bac qu’il fallut bakchicher de plus de 200 dollars afin qu’il parte plus vite, ceci pour ne pas rater l’avion. Nous l’avons eu (nouveaux bakchichs et palabres interminables avec les autorités pour les armes et l’excédent de poids, qui grève nos réserves en liquidités).
Délices et affres du voyage dans un bus fatigué de rouler comme un vieux canasson fourbu. Les arrêts, les pauses, les petites pannes et ça repart, les sautes d’humeur du moteur, la côte qui essouffle le vieux cheval de métal jusqu’à l’inquiétude, l’inconfort auquel personne ne fait plus attention ; la beauté salutaire, salvatrice, des paysages immenses et ces lumières splendides du Kazakhstan effacent tous les déboires ordinaires –lesquels, de toute façon, font le piment de tout voyage. « Sérénité crispée », préciserait René Char.
Au bac, devant le lac, des gamins qui ne semblent rien posséder nous ont offert des poissons séchés, un homme nous a servi de la vodka maison qui tenait de l’éther et du désinfectant domestique, et une femme est venue ajouter une pastèque à ces dons du fond du cœur. Vive émotion parmi nous (si j’excepte les propos déplacés, mais vite matés, sur la nourriture pleine de microbes qu’il ne faut pas toucher…). Dîner rapide à Ust-K., dans un restaurant sinistre, dans cette ville sinistre elle aussi. Le Tupolev, aussi usé que le bus, a péniblement décollé pour Alma-Ata. Une hôtesse est venue me demander si je possédais un revolver. Ma voisine de gauche sera habitée par le soupçon jusqu’à l’arrêt complet de l’appareil à l’arrivée. Au restaurant, quelques heures auparavant, nous fûmes comme des enfants, plantés devant une grande glace : après tant de jours sans nouvelles du monde ni de nous-même, certains se sont trouvés amaigris et bronzés.
Sur le trajet du retour, lors de haltes dans des hameaux, j’ai offert quelques couteaux de poche et des dizaines de stylos. Les couteaux pour les hommes, les stylos pour les enfants (et des regards pour les femmes) parce que la culture se transmet par le trait (par l’écrit ou par le dessin). Et que donner un stylo (là où on n’en trouve aucun) me semble être un geste symbolique fort, davantage que l’illustration caricaturale du colonisateur qui jette les bics aux gamins africains, du haut de son 4x4 filant à vive allure…
Lundi 8 septembre. Départ d’Alma-Ata après une courte nuit à l’hôtel. Blattes, robinetterie défectueuse, eau brune, personnel froid, lit passable, interminables formalités administratives avant d’obtenir la clé de la chambre ne m’ont jamais exaspéré. Ailleurs comme ici. Surtout ici où, dès lors que l’on est immergé dans les difficultés locales, notre patience se renforce et le chasseur voyageur acquiert une certaine sérénité devant toute difficulté.
Vol pour Paris via Istanbul. Survol magnifique de la Géorgie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie. Ciel bleu dense et montagnes enneigées. Nous sommes passés juste au-dessus de Tbilissi. Transit en Turquie. Certains d’entre nous en ont marre : c’est ce fameux empressement de retrouver son chez soi aussitôt que nous sommes sur le chemin du retour… Plusieurs d’entre nous toussent ; moi, j’ai mal à la gorge et ne parviens pas à faire cesser un saignement de nez intermittent depuis plusieurs jours. D’autres ont de sérieux problèmes intestinaux, c’est la « tourista » de règle (transit double). Dans la salle d’embarquement, bigarrée comme j’aime, le contraste saisissant d’une jeune fille en gandoura noire et tchador jusqu’aux yeux, chaussée de baskets vert cru très tendance, aux semelles compensées et walkman sur les oreilles. Je mange des loukoums. Des bébés braillent dans tous les coins. Et il y a toujours un imbécile (blanc) pour se plaindre des étranges manières des étrangers, chez eux... Nous apercevons la ville d’Istanbul au-delà des avions. Elle est très proche. Il est toujours un peu frustrant de ne pouvoir visiter une telle ville lorsque l’on se trouve ainsi entre deux vols ; assignés à résidence. Les yeux verts et les yeux bleus, si clairs, des visages turcs. Leur beauté paysanne rugueuse et forte. Visages d’hommes rudes, durs, comme dans les films de Ylmaz Güney, notamment « Yol ». À côté d’eux, les canons de la beauté dominante, internationale, blonde et pâle, me semblent anémiés, privés de force et de caractère. L’avion est plein d’enfants. Les passagers sont presque tous Turcs. Vont-ils tenter une autre vie en France ? Couleurs, voiles, yeux clairs, regards droits. Paris est raide, devant. Et possède encore le goût rogue de la fadeur jalouse. Partir, vite. Repartir…
©LM






 C’est la plus grande hêtraie d’Europe. A cheval sur la France (province basque de Soule) et l’Espagne (Navarre), avec ses 17 000 hectares, c’est une forêt certes exploitée mais très sauvage, où la profondeur du silence n’est troublée à l’automne que par le brame du cerf et le craquement d’une brindille sous le pas d’un chercheur de champignons ou plus rarement sous celui d’un chasseur de bécasse, eu égard à la pente du terrain, qui en rebute plus d'un. Les cèpes d’Iraty se conquièrent car la montagne s’apprivoise, mais celle-ci est relativement douce et la forêt correctement balisée. En octobre, elle se pare d’un mantille rouge, or, mordorée et brune qui n’a rien à envier au manteau forestier québécois. La forêt résonne de cervidés, sangliers et toutes sortes d’oiseaux (palombes, pics, vautours fauves, milans noirs et royaux, grues cendrées, passereaux divers, du pipit à la grive draine) la survolent. L’hiver, lorsque la neige recouvre les cols et le sol de la forêt, Iraty propose 4 pistes de ski de fond (35 km au total) ainsi que des itinéraires balisés pour les randonnées en raquettes : un must ! Se promener une journée dans la forêt en raquettes à la recherche des traces laissées par les animaux sur « le livre de la neige » est un pur bonheur. Le reste de l’année, les sentiers de randonnées sont nombreux en forêt (80 km de pistes forestières au total) et sur les crêtes. Une balade classique mène au Pic des Escaliers, une autre conduit au majestueux Pic d’Orhy (2017m, le point culminant), via la route des cols de chasse à la palombe : Millagate, Odixar, Tharta ou encore Sensibil. On trouve également le GR10 au départ des Chalets d’Iraty. Non loin de là se trouve la crête douce d’Orgambidexka, le « col libre », qui sert de site d’observation privilégié
C’est la plus grande hêtraie d’Europe. A cheval sur la France (province basque de Soule) et l’Espagne (Navarre), avec ses 17 000 hectares, c’est une forêt certes exploitée mais très sauvage, où la profondeur du silence n’est troublée à l’automne que par le brame du cerf et le craquement d’une brindille sous le pas d’un chercheur de champignons ou plus rarement sous celui d’un chasseur de bécasse, eu égard à la pente du terrain, qui en rebute plus d'un. Les cèpes d’Iraty se conquièrent car la montagne s’apprivoise, mais celle-ci est relativement douce et la forêt correctement balisée. En octobre, elle se pare d’un mantille rouge, or, mordorée et brune qui n’a rien à envier au manteau forestier québécois. La forêt résonne de cervidés, sangliers et toutes sortes d’oiseaux (palombes, pics, vautours fauves, milans noirs et royaux, grues cendrées, passereaux divers, du pipit à la grive draine) la survolent. L’hiver, lorsque la neige recouvre les cols et le sol de la forêt, Iraty propose 4 pistes de ski de fond (35 km au total) ainsi que des itinéraires balisés pour les randonnées en raquettes : un must ! Se promener une journée dans la forêt en raquettes à la recherche des traces laissées par les animaux sur « le livre de la neige » est un pur bonheur. Le reste de l’année, les sentiers de randonnées sont nombreux en forêt (80 km de pistes forestières au total) et sur les crêtes. Une balade classique mène au Pic des Escaliers, une autre conduit au majestueux Pic d’Orhy (2017m, le point culminant), via la route des cols de chasse à la palombe : Millagate, Odixar, Tharta ou encore Sensibil. On trouve également le GR10 au départ des Chalets d’Iraty. Non loin de là se trouve la crête douce d’Orgambidexka, le « col libre », qui sert de site d’observation privilégié  Ardi gasna (fromage de brebis des bergers du cru, achetez-le chez Mayté, le spécialiste du jambon Ibaïona, qui est excellent, à St-Jean-le-Vieux, avant de monter). Irouléguy (passez chez Jean et Martine Brana à St-Jean-Pied-de-Port et prenez aussi la prune ou la poire, pour la flasque). Pain (si vous montez par l'autre côté, prenez la fougasse -pas trop cuite- à Tardets, dans le virage à la sortie).
Ardi gasna (fromage de brebis des bergers du cru, achetez-le chez Mayté, le spécialiste du jambon Ibaïona, qui est excellent, à St-Jean-le-Vieux, avant de monter). Irouléguy (passez chez Jean et Martine Brana à St-Jean-Pied-de-Port et prenez aussi la prune ou la poire, pour la flasque). Pain (si vous montez par l'autre côté, prenez la fougasse -pas trop cuite- à Tardets, dans le virage à la sortie).  Lire : le must de la poésie de Philippe Jaccottet : L'encre serait
Lire : le must de la poésie de Philippe Jaccottet : L'encre serait de l'ombre (Poésie/Gallimard), Aphorismes sous la lune, de Sylvain Tesson (Pocket), le dernier livre (deux novelas, genre où il excelle) de (Big) Jim Harrison, et qui arrive ce matin en librairie : Nageur de rivière (Flammarion), ou encore un ou deux classiques comme
de l'ombre (Poésie/Gallimard), Aphorismes sous la lune, de Sylvain Tesson (Pocket), le dernier livre (deux novelas, genre où il excelle) de (Big) Jim Harrison, et qui arrive ce matin en librairie : Nageur de rivière (Flammarion), ou encore un ou deux classiques comme 
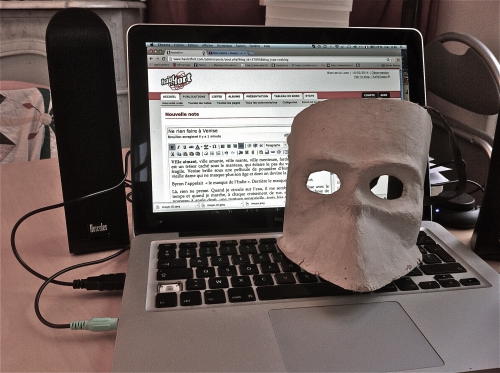 Ville aimant, ville amante, ville mante, ville menteuse, fardée, ville phare, Venise est un trésor caché sous le manteau, qui éclaire le pas du voyageur. Une flamme fragile. Venise brille sous une pellicule de poussière d’histoires, Venise est une vieille dame qui ne masque plus son âge et dont on devine la beauté enfuie.
Ville aimant, ville amante, ville mante, ville menteuse, fardée, ville phare, Venise est un trésor caché sous le manteau, qui éclaire le pas du voyageur. Une flamme fragile. Venise brille sous une pellicule de poussière d’histoires, Venise est une vieille dame qui ne masque plus son âge et dont on devine la beauté enfuie.
 Lorsque Gargantua vint au monde, il s’écria : « A boire ! À boire ! ».Dans le jargon rabelaisien, un tel cri ne réclame pas un bol de Loire mais plutôt un verre de Chinon, en dépit de l’omniprésence bienfaitrice du fleuve-mère, à l’instar du Rhône dans d’autres vallées. Le Val de Loire englobe une grande mosaïque d’appellations plus prestigieuses les unes que les autres, qui courent du Pays Nantais au Centre-Loire, en passant par l’Anjou et la Touraine. Il n’est qu’à citer des noms magiques comme Sancerre, Savennières, Pouilly-Fumé, Côteaux du Loir, Muscadet, Vouvray, Montlouis-sur-Loire, Quarts de Chaume, Saumur-Champigny, Reuilly, Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Quincy pour s’en convaincre. Quatre cépages se taillent la part du lion : chenin et sauvignon côté blanc, cabernet-franc et gamay côté rouge. Treize autres sont néanmoins utilisés.
Lorsque Gargantua vint au monde, il s’écria : « A boire ! À boire ! ».Dans le jargon rabelaisien, un tel cri ne réclame pas un bol de Loire mais plutôt un verre de Chinon, en dépit de l’omniprésence bienfaitrice du fleuve-mère, à l’instar du Rhône dans d’autres vallées. Le Val de Loire englobe une grande mosaïque d’appellations plus prestigieuses les unes que les autres, qui courent du Pays Nantais au Centre-Loire, en passant par l’Anjou et la Touraine. Il n’est qu’à citer des noms magiques comme Sancerre, Savennières, Pouilly-Fumé, Côteaux du Loir, Muscadet, Vouvray, Montlouis-sur-Loire, Quarts de Chaume, Saumur-Champigny, Reuilly, Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Quincy pour s’en convaincre. Quatre cépages se taillent la part du lion : chenin et sauvignon côté blanc, cabernet-franc et gamay côté rouge. Treize autres sont néanmoins utilisés.  l’Ancien l’évoque dans ses écrits. Au Vème siècle, nous devons le premier essor du vignoble aux moines qui ont à cœur de développer la culture de la vigne. La commercialisation des vins est favorisée par la Sèvre, la Maine, les marais de Goulaine, qui sont autant d’accès privilégiés à la Loire et qui complètent les voies romaines. A la suite des moines, les gouvernants contribuent à l’envolée des vignobles de France : ainsi Henri II Plantagenêt, comte d’Anjou, en devenant roi d’Angleterre en 1154, exporta-t-il les vins de sa région. La bourgeoisie reprend le flambeau du Moyen-Age au XVè siècle. Les rois de France contribueront à leur tour, au succès des vins qui naissent parfois jusque devant les nombreux « châteaux de la Loire ». Le commerce –notamment avec la Hollande, sera lui aussi facilité par les affluents du grand fleuve. Les guerres de Vendée freineront l’économie : les années de la Révolution seront en effet dévastatrices pour le vignoble ligérien. Puis le phylloxera sera le gros coup dur. Et tout repartira de plus belle : les premières AOC voient le jour en 1936. En 2000, le Val de Loire est classé au Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco. Le prestige des vins de Loire dans leur ensemble s’en trouve accru.
l’Ancien l’évoque dans ses écrits. Au Vème siècle, nous devons le premier essor du vignoble aux moines qui ont à cœur de développer la culture de la vigne. La commercialisation des vins est favorisée par la Sèvre, la Maine, les marais de Goulaine, qui sont autant d’accès privilégiés à la Loire et qui complètent les voies romaines. A la suite des moines, les gouvernants contribuent à l’envolée des vignobles de France : ainsi Henri II Plantagenêt, comte d’Anjou, en devenant roi d’Angleterre en 1154, exporta-t-il les vins de sa région. La bourgeoisie reprend le flambeau du Moyen-Age au XVè siècle. Les rois de France contribueront à leur tour, au succès des vins qui naissent parfois jusque devant les nombreux « châteaux de la Loire ». Le commerce –notamment avec la Hollande, sera lui aussi facilité par les affluents du grand fleuve. Les guerres de Vendée freineront l’économie : les années de la Révolution seront en effet dévastatrices pour le vignoble ligérien. Puis le phylloxera sera le gros coup dur. Et tout repartira de plus belle : les premières AOC voient le jour en 1936. En 2000, le Val de Loire est classé au Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco. Le prestige des vins de Loire dans leur ensemble s’en trouve accru. Si « la Loire coule de source », selon un mot fameux, ou bien –selon un jeu de mots, si « Nul n’est censé ignorer la Loire », il faut encore savoir que sans son cheminement au gré du vallon qu’elle creuse en s’élargissant plus ou moins, et où elle sinue, s’insinue, irrigue, aère à qui mieux mieux, selon que l’on se situe dans le Val d’Anjou, ou vers Ponts-de-Cé et Angers, le vignoble ne serait pas ce qu’il est.
Si « la Loire coule de source », selon un mot fameux, ou bien –selon un jeu de mots, si « Nul n’est censé ignorer la Loire », il faut encore savoir que sans son cheminement au gré du vallon qu’elle creuse en s’élargissant plus ou moins, et où elle sinue, s’insinue, irrigue, aère à qui mieux mieux, selon que l’on se situe dans le Val d’Anjou, ou vers Ponts-de-Cé et Angers, le vignoble ne serait pas ce qu’il est.  terroir : ce fleuve dont la largeur est légendaire, a creusé son lit pour mieux irriguer des sols d’une variété et d’une richesse rares, et pour donner naissance à une grande diversité de terroirs, sur lesquels une mosaïque d’appellations prospèrent, en élaborant des vins à partir d’une gamme de cépages unique au monde et pour la plupart vernaculaires.
terroir : ce fleuve dont la largeur est légendaire, a creusé son lit pour mieux irriguer des sols d’une variété et d’une richesse rares, et pour donner naissance à une grande diversité de terroirs, sur lesquels une mosaïque d’appellations prospèrent, en élaborant des vins à partir d’une gamme de cépages unique au monde et pour la plupart vernaculaires.  À chaque région bénie des dieux ses problèmes de luxe, pourrions-nous avancer avec le Val de Loire. Car lorsqu’on a la chance de posséder une telle diversité, une région de crus ne peut qu’exprimer une richesse et une complexité à rendre jaloux la plupart des vignobles devant se contenter d’une unité, soit géologique, soit climatique, ou encore organoleptique si l’on est en présence d’un cépage pas partageur, ou encore tapageur. Ces richesses-là, plus monolithiques, le vignoble du Val de Loire les laissent au profit d’une théorie de la palette. Car la peinture des terroirs donne autant de familles, de types de vins distincts, au caractère singulier, voire unique sur certaines micro-appellations comme Anjou-coteaux-de-la-Loire (30ha), ou des micro-vignobles comme Pissotte (20 ha) en Pays Nantais, qu’il y a de variétés de micro-terroirs, tout au long de ce fleuve miraculeux appelé Loire –colonne vertébrale d’un vaste vignoble aux multiples facettes. Le vignoble ligérien jouit aussi de micro-climats, comme sur les Coteaux-du-Layon, tellement méditerranéen. Ainsi, l’Anjou-Saumur donne par exemple des blancs secs et liquoreux d’une tendresse forte, des rosés gastronomiques, des rouges souples et puissants et enfin des effervescents qui ont peu à envier à certains champenois. L.M.
À chaque région bénie des dieux ses problèmes de luxe, pourrions-nous avancer avec le Val de Loire. Car lorsqu’on a la chance de posséder une telle diversité, une région de crus ne peut qu’exprimer une richesse et une complexité à rendre jaloux la plupart des vignobles devant se contenter d’une unité, soit géologique, soit climatique, ou encore organoleptique si l’on est en présence d’un cépage pas partageur, ou encore tapageur. Ces richesses-là, plus monolithiques, le vignoble du Val de Loire les laissent au profit d’une théorie de la palette. Car la peinture des terroirs donne autant de familles, de types de vins distincts, au caractère singulier, voire unique sur certaines micro-appellations comme Anjou-coteaux-de-la-Loire (30ha), ou des micro-vignobles comme Pissotte (20 ha) en Pays Nantais, qu’il y a de variétés de micro-terroirs, tout au long de ce fleuve miraculeux appelé Loire –colonne vertébrale d’un vaste vignoble aux multiples facettes. Le vignoble ligérien jouit aussi de micro-climats, comme sur les Coteaux-du-Layon, tellement méditerranéen. Ainsi, l’Anjou-Saumur donne par exemple des blancs secs et liquoreux d’une tendresse forte, des rosés gastronomiques, des rouges souples et puissants et enfin des effervescents qui ont peu à envier à certains champenois. L.M. Curnonsky tenait en effet la Coulée de Serrant pour l’un des cinq meilleurs vins blancs de France. Alexandre Dumas l’évoque dans son célèbre Dictionnaire de cuisine. L’aire de l’appellation Savennières, qui englobe les deux micro appellations prestigieuses (reconnues en novembre 2011) Savennières-roche-aux-moines et Savennières-coulée-de-serrant, s’étend sur 350 ha à peine, dont le tiers est planté en vignes, et couvre trois communes : Savennières, Bouchemaine et La Poissonnière. Un terroir unique, la sublimation du chenin, voilà Savennières dans toute la beauté de son expression. L’exceptionnel coteau qui surplombe la rive droite de la Loire, à quinze kilomètres d’Angers, est à cet endroit-là une bande de faible largeur (entre 500 et 3000 mètres) sur une dizaine de kilomètres, d’une qualité de sols et d’exposition qui frôle la pureté. Quatre petits coteaux orientés sud-sud-est, perpendiculaires à la Loire voisine, abritent le vignoble des orages et le maintient dans un parfait bain de douceur… angevine. Le chenin s’y révèle corsé en diable, séveux à souhait, élégamment chargé de flaveurs mielleuses, florales et fruitées. Idéalement acide grâce au sol de schistes, il produit un blanc sec total. La
Curnonsky tenait en effet la Coulée de Serrant pour l’un des cinq meilleurs vins blancs de France. Alexandre Dumas l’évoque dans son célèbre Dictionnaire de cuisine. L’aire de l’appellation Savennières, qui englobe les deux micro appellations prestigieuses (reconnues en novembre 2011) Savennières-roche-aux-moines et Savennières-coulée-de-serrant, s’étend sur 350 ha à peine, dont le tiers est planté en vignes, et couvre trois communes : Savennières, Bouchemaine et La Poissonnière. Un terroir unique, la sublimation du chenin, voilà Savennières dans toute la beauté de son expression. L’exceptionnel coteau qui surplombe la rive droite de la Loire, à quinze kilomètres d’Angers, est à cet endroit-là une bande de faible largeur (entre 500 et 3000 mètres) sur une dizaine de kilomètres, d’une qualité de sols et d’exposition qui frôle la pureté. Quatre petits coteaux orientés sud-sud-est, perpendiculaires à la Loire voisine, abritent le vignoble des orages et le maintient dans un parfait bain de douceur… angevine. Le chenin s’y révèle corsé en diable, séveux à souhait, élégamment chargé de flaveurs mielleuses, florales et fruitées. Idéalement acide grâce au sol de schistes, il produit un blanc sec total. La  Roche aux Moines et la célébrissime Coulée de Serrant de Nicolas Joly, l’un des premiers papes et apôtres de la conduite de la vigne en biodynamie, sont situées sur l’éperon rocheux le plus jalousé de la Loire pour son exposition idéale. Le lieu est propice à l’apparition de la pourriture noble, le fameux champignon nommé botrytis cinerea qui attaque la baie avant qu’elle ne soit « surmûrie », à l’heure où la plupart des vendanges sont faites (bien qu’il ne s’agisse pas ici de vins dits de « vendanges tardives ») et à la faveur de brouillards matinaux conjugués avec la fraîcheur humide d’un fleuve accorte. Selon la vinification, les vins sont soit secs, soit demi-secs. Question de savoir-faire humain. La Coulée de Serrant (une appellation monopole de la famille Joly) est un domaine chargé d’histoire. Plantée en vignes dès 1130 par des moines cisterciens, elle n’a connu que des vendanges consécutives (la vendange 2013 est la 883ème). Nicolas Joly, son actuel propriétaire, y pratique donc la biodynamie en pionnier scrupuleux d’une osmose de la nature avec l’homme et de l’utilisation raisonnée des rapports de forces, de ce qui donne « vie » à la plante, du système solaire à la gravité de la terre. Sans utiliser bien sûr le moindre intrant chimique et en favorisant par exemple le labour avec des chevaux!.. L’ancien monastère précité, classé à l’inventaire des monuments historiques, n’est pas très éloigné de la forteresse de la Roche aux Moines, où le fils de Philippe Auguste vainquit en 1214 Jean Sans Terre, fils de Richard Cœur de Lion. Les vignerons du cru doivent à la comtesse de Serrant d’avoir introduit le vin de Savennières à la cour de Napoléon I er. Mais dès le XIIème siècle, ce sont les moines de Saint-Nicolas d’Angers qui développèrent de façon décisive la culture de cette vigne. Les seigneurs angevins, puis la bourgeoisie, poursuivirent cette œuvre en faveur des vins de Savennières, qui avait débuté à l’époque romaine. Les vins issus de ces trois AOC doivent impérativement provenir de raisins (de chenin exclusivement) titrant au minimum 212 grammes de sucre par litre. Et comme nul fait du savennières comme bon lui semble, les rendements de base de 50 hl / ha sont ramenés à 40 hl / ha. C’est en réalité des rendements encore moindres qui sont pratiqués –parmi les plus faibles de France pour des blancs secs (jusqu’à 20-25 hl/ha)-, afin de concentrer ces vins nectars, au nom de la recherche permanente d’une qualité toujours dépassée. L.M.
Roche aux Moines et la célébrissime Coulée de Serrant de Nicolas Joly, l’un des premiers papes et apôtres de la conduite de la vigne en biodynamie, sont situées sur l’éperon rocheux le plus jalousé de la Loire pour son exposition idéale. Le lieu est propice à l’apparition de la pourriture noble, le fameux champignon nommé botrytis cinerea qui attaque la baie avant qu’elle ne soit « surmûrie », à l’heure où la plupart des vendanges sont faites (bien qu’il ne s’agisse pas ici de vins dits de « vendanges tardives ») et à la faveur de brouillards matinaux conjugués avec la fraîcheur humide d’un fleuve accorte. Selon la vinification, les vins sont soit secs, soit demi-secs. Question de savoir-faire humain. La Coulée de Serrant (une appellation monopole de la famille Joly) est un domaine chargé d’histoire. Plantée en vignes dès 1130 par des moines cisterciens, elle n’a connu que des vendanges consécutives (la vendange 2013 est la 883ème). Nicolas Joly, son actuel propriétaire, y pratique donc la biodynamie en pionnier scrupuleux d’une osmose de la nature avec l’homme et de l’utilisation raisonnée des rapports de forces, de ce qui donne « vie » à la plante, du système solaire à la gravité de la terre. Sans utiliser bien sûr le moindre intrant chimique et en favorisant par exemple le labour avec des chevaux!.. L’ancien monastère précité, classé à l’inventaire des monuments historiques, n’est pas très éloigné de la forteresse de la Roche aux Moines, où le fils de Philippe Auguste vainquit en 1214 Jean Sans Terre, fils de Richard Cœur de Lion. Les vignerons du cru doivent à la comtesse de Serrant d’avoir introduit le vin de Savennières à la cour de Napoléon I er. Mais dès le XIIème siècle, ce sont les moines de Saint-Nicolas d’Angers qui développèrent de façon décisive la culture de cette vigne. Les seigneurs angevins, puis la bourgeoisie, poursuivirent cette œuvre en faveur des vins de Savennières, qui avait débuté à l’époque romaine. Les vins issus de ces trois AOC doivent impérativement provenir de raisins (de chenin exclusivement) titrant au minimum 212 grammes de sucre par litre. Et comme nul fait du savennières comme bon lui semble, les rendements de base de 50 hl / ha sont ramenés à 40 hl / ha. C’est en réalité des rendements encore moindres qui sont pratiqués –parmi les plus faibles de France pour des blancs secs (jusqu’à 20-25 hl/ha)-, afin de concentrer ces vins nectars, au nom de la recherche permanente d’une qualité toujours dépassée. L.M.



 Là, cadeau : deux des 26 villages de mon nouveau livre, pris au hasard, Balthazar. Juste pour donner à voir ou plutôt à lire. Histoire de vous donner envie d'aller acheter le bouquin, té!..
Là, cadeau : deux des 26 villages de mon nouveau livre, pris au hasard, Balthazar. Juste pour donner à voir ou plutôt à lire. Histoire de vous donner envie d'aller acheter le bouquin, té!.. C’est un village où chaque demeure, blanche et rouge piment sec plutôt que sang, prend ses aises et aime contempler l'autre en prenant de la mesure et la distance nécessaire au jugement définitif. Ce village vous toise lorsque vous y êtes. Il apparaît éparpillé, dispersé. Saint-Etienne de Baïgorry est en soi un bouquet de quartiers épars : Occos, Urdos, Lezaratzu et Etxauz enfin, soulignent d'un second trait, périphérique celui-là, cet état de dispersion, d'autonomie et ce souci de l'espace personnel.
C’est un village où chaque demeure, blanche et rouge piment sec plutôt que sang, prend ses aises et aime contempler l'autre en prenant de la mesure et la distance nécessaire au jugement définitif. Ce village vous toise lorsque vous y êtes. Il apparaît éparpillé, dispersé. Saint-Etienne de Baïgorry est en soi un bouquet de quartiers épars : Occos, Urdos, Lezaratzu et Etxauz enfin, soulignent d'un second trait, périphérique celui-là, cet état de dispersion, d'autonomie et ce souci de l'espace personnel.

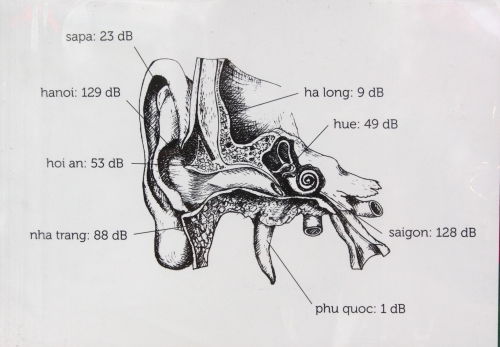

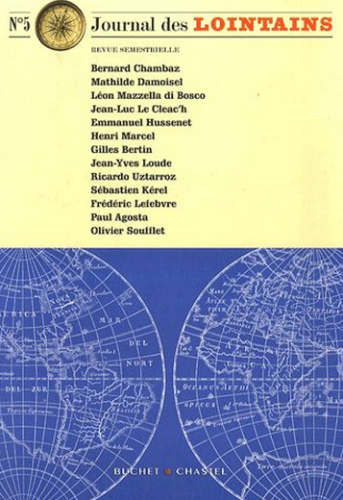 L'une des magies d'Internet est de retomber sur un texte ancien, de le relire et de se dire : ça tient encore la piste (ayant davantage emprunté des chemins de traverse qui ont toujours engendré mes chemins d'écriture -que des routes droites et balisées), et de se dire donc : tiens, et si je le mettais en ligne, celui-ci... En voici donc un, dans les archives, qui fut publié par feu Le Journal des Lointains, que l'écrivain Marc Trillard dirigeait chez Buchet-Chastel. Une revue-livre littéraire dédiée au grand reportage; un ancêtre des mooks d'aujourd'hui, abondamment illustrés -à l'instar de l'emblématique revue XXI (Les Arènes), ou bien du jeune Long Cours (L'Express). Cela se passait au Kazakhstan en 1997. Et fut publié dix ans après (en général, je publie dix ans après).
L'une des magies d'Internet est de retomber sur un texte ancien, de le relire et de se dire : ça tient encore la piste (ayant davantage emprunté des chemins de traverse qui ont toujours engendré mes chemins d'écriture -que des routes droites et balisées), et de se dire donc : tiens, et si je le mettais en ligne, celui-ci... En voici donc un, dans les archives, qui fut publié par feu Le Journal des Lointains, que l'écrivain Marc Trillard dirigeait chez Buchet-Chastel. Une revue-livre littéraire dédiée au grand reportage; un ancêtre des mooks d'aujourd'hui, abondamment illustrés -à l'instar de l'emblématique revue XXI (Les Arènes), ou bien du jeune Long Cours (L'Express). Cela se passait au Kazakhstan en 1997. Et fut publié dix ans après (en général, je publie dix ans après).
 individuels, l'épaisseur des tranches de pain, l'embase des verres de margarita, la quadrature des lits, l'espace des chambres d'hôtel, la proéminence des ventres, la profondeur des fauteuils, la cuvette des toilettes, la visière des casquettes, la largeur des tables au restaurant, le volume des voitures et
individuels, l'épaisseur des tranches de pain, l'embase des verres de margarita, la quadrature des lits, l'espace des chambres d'hôtel, la proéminence des ventres, la profondeur des fauteuils, la cuvette des toilettes, la visière des casquettes, la largeur des tables au restaurant, le volume des voitures et 
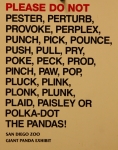 Marine- a établi ses quartiers les plus gigantesques des USA; avec trois autres confrères : une Italienne, un Espagnol et un Norvégien (invités par British Airways à tester la somptueuse nouvelle classe Premium à bord du vol Londres-San Diego. Cela est indécent, je sais).
Marine- a établi ses quartiers les plus gigantesques des USA; avec trois autres confrères : une Italienne, un Espagnol et un Norvégien (invités par British Airways à tester la somptueuse nouvelle classe Premium à bord du vol Londres-San Diego. Cela est indécent, je sais). bien rangé. Rien ne dépasse, à San Diego. L'ordre règne en silence et chaque activité a son espace dédié, y compris la promenade des chiens. Chacun cultive
bien rangé. Rien ne dépasse, à San Diego. L'ordre règne en silence et chaque activité a son espace dédié, y compris la promenade des chiens. Chacun cultive  son corps comme un jardin, circule gadgetisé, soit
son corps comme un jardin, circule gadgetisé, soit  public
public  mondialement connu, une Université prestigieuse... Mais le voyageur cherche l'âme dans tout cela, et échoue à la trouver. Sauf peut-être dans Little Italy, où l'on assiste à des scènes qui semblent empruntées à la série The Soprano, dans Old Town aussi, le San Diego mexicain (la frontière est à quelques kilomètres seulement, Tijuana à un quart d'heure de route) et ce malgré
mondialement connu, une Université prestigieuse... Mais le voyageur cherche l'âme dans tout cela, et échoue à la trouver. Sauf peut-être dans Little Italy, où l'on assiste à des scènes qui semblent empruntées à la série The Soprano, dans Old Town aussi, le San Diego mexicain (la frontière est à quelques kilomètres seulement, Tijuana à un quart d'heure de route) et ce malgré  les nombreuses boutiques de souvenirs et d'artisanat de pacotille, mais moins à Down Town, la ville moderne et son Waterfront garni de quelques gratte-ciel face à d'anciens bateaux, comme la goélette Star of India qui abrite un intéressant Musée de la Marine, deux ou trois sous-marins et le porte-avion Midway, reconverti en gigantesque musée. Pas davantage de supplément d'âme à La Jolla,
les nombreuses boutiques de souvenirs et d'artisanat de pacotille, mais moins à Down Town, la ville moderne et son Waterfront garni de quelques gratte-ciel face à d'anciens bateaux, comme la goélette Star of India qui abrite un intéressant Musée de la Marine, deux ou trois sous-marins et le porte-avion Midway, reconverti en gigantesque musée. Pas davantage de supplément d'âme à La Jolla, sorte de zone ouvertement huppée collée à la côte. A peine à Balboa, où de nombreux musées (admirables musée des Beaux-Arts, et de la Photo) ont investi les bâtiments baroques (façon Prado) des Expositions universelles de 1915 et 1935. Torrey Pines est plus sauvage, avec ses falaises et sa côte déchiquetée, à quelques kilomètres du centre et
sorte de zone ouvertement huppée collée à la côte. A peine à Balboa, où de nombreux musées (admirables musée des Beaux-Arts, et de la Photo) ont investi les bâtiments baroques (façon Prado) des Expositions universelles de 1915 et 1935. Torrey Pines est plus sauvage, avec ses falaises et sa côte déchiquetée, à quelques kilomètres du centre et  juste devant des bâtiments universitaires plutôt bien lotis, question environnement. L'avantage de San Diego est finalement d'être à la fois une immense ville aux dimensions suffisamment confortables pour que l'on ne s'y sente jamais oppressé (du coup, son côté suisse est moins palpable) est surtout sa proximité immédiate avec une côte sauvage et un arrière-pays qui l'est tout autant -lesquels procèdent du charme singulier de la cité.
juste devant des bâtiments universitaires plutôt bien lotis, question environnement. L'avantage de San Diego est finalement d'être à la fois une immense ville aux dimensions suffisamment confortables pour que l'on ne s'y sente jamais oppressé (du coup, son côté suisse est moins palpable) est surtout sa proximité immédiate avec une côte sauvage et un arrière-pays qui l'est tout autant -lesquels procèdent du charme singulier de la cité. 

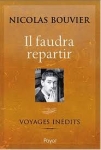 De Nicolas Bouvier, L’Usage du monde (PBP) est devenue la bible, le bréviaire du voyageur et du travel-writer. Voici que Payot nous donne des voyages inédits, avec un titre magnifique : Il faudra repartir, dont Cendrars aurait pu être jaloux. J’y ai retenu les pages admirables sur l’Algérie, que Bouvier traverse en 1958. Sa perception fine du petit peuple d’Oran, très Espagnol, très Juif aussi, constamment mêlé aux Arabes, laisse à penser que d’aucuns, dans ces années-là, auraient été bien inspirés d’écouter un observateur comme l’auteur du Journal d’Aran, dire qu’ici, les choses peuvent s’arranger, à cause des sangs mêlés justement. Mais il s’agit de melting-pot davantage que de métissage. En cela, Jules Roy avait raison de dire que là-bas, on était tous frères, mais rarement beaux-frères… Très belles pages également sur la Chine, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l’Indonésie.
De Nicolas Bouvier, L’Usage du monde (PBP) est devenue la bible, le bréviaire du voyageur et du travel-writer. Voici que Payot nous donne des voyages inédits, avec un titre magnifique : Il faudra repartir, dont Cendrars aurait pu être jaloux. J’y ai retenu les pages admirables sur l’Algérie, que Bouvier traverse en 1958. Sa perception fine du petit peuple d’Oran, très Espagnol, très Juif aussi, constamment mêlé aux Arabes, laisse à penser que d’aucuns, dans ces années-là, auraient été bien inspirés d’écouter un observateur comme l’auteur du Journal d’Aran, dire qu’ici, les choses peuvent s’arranger, à cause des sangs mêlés justement. Mais il s’agit de melting-pot davantage que de métissage. En cela, Jules Roy avait raison de dire que là-bas, on était tous frères, mais rarement beaux-frères… Très belles pages également sur la Chine, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l’Indonésie. Dans la même veine de ces écrivains-reporters-observateurs, capables de décrire un simple fait divers, une scène de rue a priori ordinaire et d’en faire un moment de littérature, prenez Vu sur la mer, de Jean Rolin (La Table ronde / La petite vermillon), recueil de reportages donnés à Lui, Libération, Géo… L’auteur nous embarque sur le fleuve Congo et nous pensons au Cœur des ténèbres de Conrad, bien sûr, il nous propulse à Singapour parmi des pirates, nous fait voyager à bord d’un port-conteneur depuis St-Louis-du-Rhône, Camargue, ou bien d’un autre bateau semblable, le Ville de Bordeaux qui croise en Mer Rouge, il nous décrit « les voyageurs de l’amer »; et c’est chaque fois un ravissement. La prose de grand vent -salé, cette fois- de Rolin sonne juste, car elle est forte comme un rhum cul-sec.
Dans la même veine de ces écrivains-reporters-observateurs, capables de décrire un simple fait divers, une scène de rue a priori ordinaire et d’en faire un moment de littérature, prenez Vu sur la mer, de Jean Rolin (La Table ronde / La petite vermillon), recueil de reportages donnés à Lui, Libération, Géo… L’auteur nous embarque sur le fleuve Congo et nous pensons au Cœur des ténèbres de Conrad, bien sûr, il nous propulse à Singapour parmi des pirates, nous fait voyager à bord d’un port-conteneur depuis St-Louis-du-Rhône, Camargue, ou bien d’un autre bateau semblable, le Ville de Bordeaux qui croise en Mer Rouge, il nous décrit « les voyageurs de l’amer »; et c’est chaque fois un ravissement. La prose de grand vent -salé, cette fois- de Rolin sonne juste, car elle est forte comme un rhum cul-sec. Cela n’a rien à voir, mais le Guide de poche des oiseaux de France (Seuil / Points2) est un microscopique ouvrage d’ornithologie très précisément illustré et qui est extrêmement fiable, car fondé sur les données irréprochables contenues dans les fameux guides du naturaliste des éditions Delachaux & Niestlé. 200 espèces d’oiseaux des jardins, des forêts, des bords de mer… y sont habilement décrits. Indispensable (à glisser dans le jean d'un gamin dont vous ne voulez plus qu'il vous dise : tous les oiseaux se ressemblent)...
Cela n’a rien à voir, mais le Guide de poche des oiseaux de France (Seuil / Points2) est un microscopique ouvrage d’ornithologie très précisément illustré et qui est extrêmement fiable, car fondé sur les données irréprochables contenues dans les fameux guides du naturaliste des éditions Delachaux & Niestlé. 200 espèces d’oiseaux des jardins, des forêts, des bords de mer… y sont habilement décrits. Indispensable (à glisser dans le jean d'un gamin dont vous ne voulez plus qu'il vous dise : tous les oiseaux se ressemblent)... Si l’on souhaite seulement découvrir à vélo et seuls cette forêt de 15000ha, de 100 km de circonférence (comme Paris) et de 2000 km de chemins balisés, empruntez la Voie verte (ouverte donc aux rollers, poussettes et autres roulettes), soit une piste cyclable de 50 km, qui fait une boucle et sur laquelle on pédale tranquillou au milieu d’une splendide forêt.
Si l’on souhaite seulement découvrir à vélo et seuls cette forêt de 15000ha, de 100 km de circonférence (comme Paris) et de 2000 km de chemins balisés, empruntez la Voie verte (ouverte donc aux rollers, poussettes et autres roulettes), soit une piste cyclable de 50 km, qui fait une boucle et sur laquelle on pédale tranquillou au milieu d’une splendide forêt. La côte sauvage irlandaise, du côté du Ring of Kerry, a la magie des îles du Nord, vertes et pourtant si rudes. Cette côte déchiquetée qu’on longe en voiture et qu’une mer d’Irlande qui a englouti tant de navires bat froid, possède l’attirance violente des femmes renardes. Mi-ange, mi-démon, la côte irlandaise aimante. Rien n’est plus vivifiant que se réveiller de bonne heure et de partir marcher dans la campagne irlandaise, n’importe où dans les moors (étendues de bruyère), et les tourbières (prévoir des bottes) entre deux bushes (buissons épais), emmitouflé dans une veste imperméable (la pluie irlandaise ignore les saisons). Le ring of Kerry est cependant bien ensoleillé et l’arrière printemps y est propice à toutes sortes d’activités de plein vent : équitation, golf, pêche à la mouche, observation des oiseaux… L’idée est de séjourner à Waterville et de rayonner autour de ce village calme de bord de mer où Charlie Chaplin aimait passer ses vacances en famille, au Butler Arms Hôtel. Waterville est baignée, comme chaque village irlandais, par l’odeur âcre et légèrement goudronnée de la tourbe qui flambe lentement dans chaque cheminée. Les habitants de Waterville se retrouvent le soir au Pub, notamment au Lobster’s Pub, pour savourer un hot whiskey (avec un « e ») et disputer une partie de fléchettes, ou revoir un match de rugby en buvant lentement une pinte de Guinness. La bière brune symbolise cette Irlande « rough », taiseuse et sauvage. Sa mousse si douce, couleur ventre de bécasse, à la fraîcheur idéale (la servir glacée est une hérésie) et d’une onctuosité de chantilly, résume la sérénité d’une fin de journée passée à pêcher, à monter à cheval ou simplement à se promener le long de
La côte sauvage irlandaise, du côté du Ring of Kerry, a la magie des îles du Nord, vertes et pourtant si rudes. Cette côte déchiquetée qu’on longe en voiture et qu’une mer d’Irlande qui a englouti tant de navires bat froid, possède l’attirance violente des femmes renardes. Mi-ange, mi-démon, la côte irlandaise aimante. Rien n’est plus vivifiant que se réveiller de bonne heure et de partir marcher dans la campagne irlandaise, n’importe où dans les moors (étendues de bruyère), et les tourbières (prévoir des bottes) entre deux bushes (buissons épais), emmitouflé dans une veste imperméable (la pluie irlandaise ignore les saisons). Le ring of Kerry est cependant bien ensoleillé et l’arrière printemps y est propice à toutes sortes d’activités de plein vent : équitation, golf, pêche à la mouche, observation des oiseaux… L’idée est de séjourner à Waterville et de rayonner autour de ce village calme de bord de mer où Charlie Chaplin aimait passer ses vacances en famille, au Butler Arms Hôtel. Waterville est baignée, comme chaque village irlandais, par l’odeur âcre et légèrement goudronnée de la tourbe qui flambe lentement dans chaque cheminée. Les habitants de Waterville se retrouvent le soir au Pub, notamment au Lobster’s Pub, pour savourer un hot whiskey (avec un « e ») et disputer une partie de fléchettes, ou revoir un match de rugby en buvant lentement une pinte de Guinness. La bière brune symbolise cette Irlande « rough », taiseuse et sauvage. Sa mousse si douce, couleur ventre de bécasse, à la fraîcheur idéale (la servir glacée est une hérésie) et d’une onctuosité de chantilly, résume la sérénité d’une fin de journée passée à pêcher, à monter à cheval ou simplement à se promener le long de  la côte. Les nombreux lacs et rivières avec des pools (parcours de remontée) de la région sont réputés dans toute l’Europe. La pêche ouvre mi-janvier et ferme fin septembre. Les lacs comme Lough Currane, Lough Deriana, Lough Cloonaghlin ou Lough Namona sont riches de saumons et de truites de mer. Remonter la Cummeragh river est un autre plaisir de « moucheur ». On peut aussi pêcher en mer, ou bien depuis le rivage. Une sortie jusqu’à l’île de Valentia est conseillée. Là-bas, vous aurez l’impression d’être revenu au temps des Vikings. Autour de Waterville, une virée à Killorglin –gros bourg traversé par la Luane river, riche en truites farios-, est souhaitable, au moins pour d’autres balades dans les bushes, sur les landes de tourbe infinies. Pour les amateurs de golf, c’est un paradis. Les lacs y sont nombreux et la pêche une activité courante. On peut aussi acheter son saumon fumé directement à la fumerie locale de Killorglin. A deux pas, le restaurant Nicks propose une cuisine marine et des bordeaux à prix plancher. Tralee Barrow et Killarney sont des destinations de la même eau : à fond nature et avec des pubs chaleureux pour les retours de balades « roots » et humides. Car un plaisir singulier est de s’exténuer dehors, puis de s’affaler devant un feu de tourbe, d’ôter ses bottes et de les regarder fumer tandis que nous nous repassons le film de la journée.
la côte. Les nombreux lacs et rivières avec des pools (parcours de remontée) de la région sont réputés dans toute l’Europe. La pêche ouvre mi-janvier et ferme fin septembre. Les lacs comme Lough Currane, Lough Deriana, Lough Cloonaghlin ou Lough Namona sont riches de saumons et de truites de mer. Remonter la Cummeragh river est un autre plaisir de « moucheur ». On peut aussi pêcher en mer, ou bien depuis le rivage. Une sortie jusqu’à l’île de Valentia est conseillée. Là-bas, vous aurez l’impression d’être revenu au temps des Vikings. Autour de Waterville, une virée à Killorglin –gros bourg traversé par la Luane river, riche en truites farios-, est souhaitable, au moins pour d’autres balades dans les bushes, sur les landes de tourbe infinies. Pour les amateurs de golf, c’est un paradis. Les lacs y sont nombreux et la pêche une activité courante. On peut aussi acheter son saumon fumé directement à la fumerie locale de Killorglin. A deux pas, le restaurant Nicks propose une cuisine marine et des bordeaux à prix plancher. Tralee Barrow et Killarney sont des destinations de la même eau : à fond nature et avec des pubs chaleureux pour les retours de balades « roots » et humides. Car un plaisir singulier est de s’exténuer dehors, puis de s’affaler devant un feu de tourbe, d’ôter ses bottes et de les regarder fumer tandis que nous nous repassons le film de la journée.








 génie disparu en 2005. Ou bien en s’allongeant en pleine forêt sur un tapis d’aiguilles de pins et de fougères, le regard planté à la cime des arbres qui dansent. Il suffit alors de fermer les yeux pour confondre, comme le faisait François Mauriac, le bruissement permanent du vent dans les branches avec celui de l’océan. Le
génie disparu en 2005. Ou bien en s’allongeant en pleine forêt sur un tapis d’aiguilles de pins et de fougères, le regard planté à la cime des arbres qui dansent. Il suffit alors de fermer les yeux pour confondre, comme le faisait François Mauriac, le bruissement permanent du vent dans les branches avec celui de l’océan. Le 
 Bordelais Mauriac n’aimait rien comme planter ses fictions dans l’âpre lande : le village d’Argelouse est à jamais marqué par « Thérèse Desqueyroux », l’un de ses plus célèbres romans(Livre de poche). Montaigne, qui voyageait à cheval, a nourri ses « Essais » (Arléa) de centaines de chevauchées à travers les Landes. Il vante même les mérites des sources thermales de Préchacq-les-Bains dans son œuvre-vie. Jean-Paul Kauffmann a donné un livre magnifique, « La maison du retour » (folio), qui raconte comment il choisit justement de s’établir de temps à autre en forêt, à Pissos. Plus bas, on peut se promener du côté d’Onesse-et-Laharie, à la recherche de la maison des sœurs de Rivoyre, échouer à la trouver et relire « Le petit matin » (Grasset), de Christine, « la Colette des Landes », au café du coin. Les Landes, c’est la place centrale de Mont-de-Marsan à l’ouverture du premier café que l’on prend en pensant aux frères Boni : Guy et André Boniface, rugbymen de légende. Un stade porte leur nom à Montfort-en-Chalosse. Denis Lalanne, qui donna comme son ami Antoine Blondin des papiers « de garde » à « L’Equipe », écrivit un livre hommage
Bordelais Mauriac n’aimait rien comme planter ses fictions dans l’âpre lande : le village d’Argelouse est à jamais marqué par « Thérèse Desqueyroux », l’un de ses plus célèbres romans(Livre de poche). Montaigne, qui voyageait à cheval, a nourri ses « Essais » (Arléa) de centaines de chevauchées à travers les Landes. Il vante même les mérites des sources thermales de Préchacq-les-Bains dans son œuvre-vie. Jean-Paul Kauffmann a donné un livre magnifique, « La maison du retour » (folio), qui raconte comment il choisit justement de s’établir de temps à autre en forêt, à Pissos. Plus bas, on peut se promener du côté d’Onesse-et-Laharie, à la recherche de la maison des sœurs de Rivoyre, échouer à la trouver et relire « Le petit matin » (Grasset), de Christine, « la Colette des Landes », au café du coin. Les Landes, c’est la place centrale de Mont-de-Marsan à l’ouverture du premier café que l’on prend en pensant aux frères Boni : Guy et André Boniface, rugbymen de légende. Un stade porte leur nom à Montfort-en-Chalosse. Denis Lalanne, qui donna comme son ami Antoine Blondin des papiers « de garde » à « L’Equipe », écrivit un livre hommage 
 aux frangins : « Le temps des Boni » (La petite vermillon). Il vit aujourd’hui paisiblement à Hossegor. Le lire, c’est retrouver le rugby rustique de village, où les déménageurs de pianos sont plus nombreux que les joueurs du même instrument. Un autre écrivain journaliste parti trop tôt (en 2004), Patrick Espagnet, de Grignols (plus haut dans les Landes girondines), possédait une plume forgée à l’ovale. Ses nouvelles : « Les Noirs », « La Gueuze », « XV histoires de rugby » (Culture Suds), sont des chefs-d’œuvre du genre. Les Landes, ce sont ces belles fermes à colombages avec leurs murs à briquettes en forme de fougère, qui se dressent
aux frangins : « Le temps des Boni » (La petite vermillon). Il vit aujourd’hui paisiblement à Hossegor. Le lire, c’est retrouver le rugby rustique de village, où les déménageurs de pianos sont plus nombreux que les joueurs du même instrument. Un autre écrivain journaliste parti trop tôt (en 2004), Patrick Espagnet, de Grignols (plus haut dans les Landes girondines), possédait une plume forgée à l’ovale. Ses nouvelles : « Les Noirs », « La Gueuze », « XV histoires de rugby » (Culture Suds), sont des chefs-d’œuvre du genre. Les Landes, ce sont ces belles fermes à colombages avec leurs murs à briquettes en forme de fougère, qui se dressent  grassement sur leur airial. La plus emblématique se trouve au sein du Parc régional de Marquèze, à Sabres, où l’ombre tutélaire de Félix Arnaudin, l’écrivain photographe un brin ethnographe, plane comme un milan royal en maraude. Les clichés d’Arnaudin sont aussi précieux que ses recueils de contes (Confluences). L’un d’eux montre un
grassement sur leur airial. La plus emblématique se trouve au sein du Parc régional de Marquèze, à Sabres, où l’ombre tutélaire de Félix Arnaudin, l’écrivain photographe un brin ethnographe, plane comme un milan royal en maraude. Les clichés d’Arnaudin sont aussi précieux que ses recueils de contes (Confluences). L’un d’eux montre un 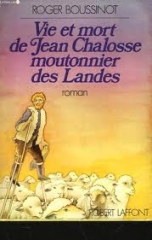
 jeune berger, Bergerot au Pradeou, dressé dans l’immensité plate comme la main. Et évoque le tendre roman de Roger Boussinot, « Vie et mort de Jean Chalosse, moutonnier des Landes » (Livre de poche).
jeune berger, Bergerot au Pradeou, dressé dans l’immensité plate comme la main. Et évoque le tendre roman de Roger Boussinot, « Vie et mort de Jean Chalosse, moutonnier des Landes » (Livre de poche).  enfin les inoubliables passages de Julien
enfin les inoubliables passages de Julien  C'est l'année Klimt : ça ne se rate pas, si l'on aime ce peintre génial. Et l'occasion d'aller voir plus de toiles du maître Gustav Klimt qu'il n'y en a jamais eu à Vienne, est aussi celle de contempler l'oeuvre de son disciple Egon Schiele (sans Klimt, pas de Schiele). Pour cela seulement, et à condition d'admirer l'un et l'autre peintres, le voyage est indispensable en 2012 (rendez vous aux musées Leopold et Belvedere, principalement). Vienne, c'est aussi se faire plaisir en revoyant des toiles fétiches, un petit Friedrich ici, un Velasquez là. Cette ville musée, qui est aussi celle du bon café,
C'est l'année Klimt : ça ne se rate pas, si l'on aime ce peintre génial. Et l'occasion d'aller voir plus de toiles du maître Gustav Klimt qu'il n'y en a jamais eu à Vienne, est aussi celle de contempler l'oeuvre de son disciple Egon Schiele (sans Klimt, pas de Schiele). Pour cela seulement, et à condition d'admirer l'un et l'autre peintres, le voyage est indispensable en 2012 (rendez vous aux musées Leopold et Belvedere, principalement). Vienne, c'est aussi se faire plaisir en revoyant des toiles fétiches, un petit Friedrich ici, un Velasquez là. Cette ville musée, qui est aussi celle du bon café,  du bon chocolat et des bars à vins, est également le repaire d'une certaine mémoire littéraire que l'on s'efforce de chercher en flânant dans les rues, en traînant dans les cafés (certains ont conservé
du bon chocolat et des bars à vins, est également le repaire d'une certaine mémoire littéraire que l'on s'efforce de chercher en flânant dans les rues, en traînant dans les cafés (certains ont conservé 
 tombai en arrêt, littéralement, devant ma peinture préférée à cette époque et dont j'avais une copie à l'échelle 1 dans ma chambre d'adolescent -nous vivions ensemble, en quelque sorte (il s'agit des "Chasseurs dans la neige", de Bruegel) et comme j'ignorais que l'original se trouvait là, ce me fut un choc pictural énorme. Revoir ce tableau la semaine dernière fut forcément moins terrible. De même, tandis qu'on cherche dans la nuit viennoise et dans un dédale de ruelles un bon Heurige (taverne à vins), tomber
tombai en arrêt, littéralement, devant ma peinture préférée à cette époque et dont j'avais une copie à l'échelle 1 dans ma chambre d'adolescent -nous vivions ensemble, en quelque sorte (il s'agit des "Chasseurs dans la neige", de Bruegel) et comme j'ignorais que l'original se trouvait là, ce me fut un choc pictural énorme. Revoir ce tableau la semaine dernière fut forcément moins terrible. De même, tandis qu'on cherche dans la nuit viennoise et dans un dédale de ruelles un bon Heurige (taverne à vins), tomber
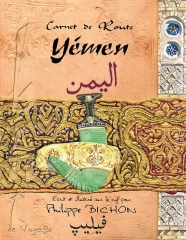 Il s'agit d'un énorme travail, d'une somme, d'une sensibilité avant tout, d'une poésie
Il s'agit d'un énorme travail, d'une somme, d'une sensibilité avant tout, d'une poésie  Pas mal de poches, surtout des folio et des Poésie/Gallimard, dégustés ces jours-ci. A commencer par l'anthologie personnelle de Philippe Jaccottet, immense poète que j'adore et que je lis et relis depuis 34 ans déjà. Cela s'appelle L'encre serait de l'ombre, notes, proses et poèmes (1946-2008) choisis par l'auteur, et si vous n'avez qu'un livre à acheter du poète de Grignan, grand traducteur par ailleurs, prenez celui-ci. 560 pages de bonheur poétique absolu. Dans la même collection Poésie de Gallimard, citons Mon beau navire, ô ma
Pas mal de poches, surtout des folio et des Poésie/Gallimard, dégustés ces jours-ci. A commencer par l'anthologie personnelle de Philippe Jaccottet, immense poète que j'adore et que je lis et relis depuis 34 ans déjà. Cela s'appelle L'encre serait de l'ombre, notes, proses et poèmes (1946-2008) choisis par l'auteur, et si vous n'avez qu'un livre à acheter du poète de Grignan, grand traducteur par ailleurs, prenez celui-ci. 560 pages de bonheur poétique absolu. Dans la même collection Poésie de Gallimard, citons Mon beau navire, ô ma mémoire, sous-titré Un siècle de poésie française. C'est une anthologie plutôt bien ficelée, de belle facture : honnête et pas scolaire, avec son content de grands classiques et sa dose de modernité, mais où l'on trouve, à l'instar d'une arête dans le poisson (je chipote, je sais) un poème de Rilke, qui était né à Praque et de langue allemande (mais il est vrai qu'il écrivit en français ses dernières oeuvres, notamment
mémoire, sous-titré Un siècle de poésie française. C'est une anthologie plutôt bien ficelée, de belle facture : honnête et pas scolaire, avec son content de grands classiques et sa dose de modernité, mais où l'on trouve, à l'instar d'une arête dans le poisson (je chipote, je sais) un poème de Rilke, qui était né à Praque et de langue allemande (mais il est vrai qu'il écrivit en français ses dernières oeuvres, notamment  Vergers, dont est extrait le poème choisi dans la présente anthologie -et traduit d'ailleurs par Jaccottet). Mention spéciale (en Poésie/Gallimard, toujours) à l'oeuvre complète magnifique (1954-2004) du Nobel 2011, le grand poète suédois Tomas Tranströmer, Baltiques, car il s'agit vraiment d'une formidable découverte.
Vergers, dont est extrait le poème choisi dans la présente anthologie -et traduit d'ailleurs par Jaccottet). Mention spéciale (en Poésie/Gallimard, toujours) à l'oeuvre complète magnifique (1954-2004) du Nobel 2011, le grand poète suédois Tomas Tranströmer, Baltiques, car il s'agit vraiment d'une formidable découverte. 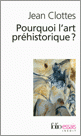
 plus, titre très derridien que Etienne Bimbenet donne à ce copieux et souvent ardu (mais passionnant de bout en bout) essai sur l'origine animale de l'homme -pour faire très court. En clair, l'homme est un animal humain. Et le rapport de l'homme à l'animal, dans cette étude philosophique, va bien au-delà de l'éthologie.
plus, titre très derridien que Etienne Bimbenet donne à ce copieux et souvent ardu (mais passionnant de bout en bout) essai sur l'origine animale de l'homme -pour faire très court. En clair, l'homme est un animal humain. Et le rapport de l'homme à l'animal, dans cette étude philosophique, va bien au-delà de l'éthologie.  Philippe Sollers continue de compiler pour notre bonheur ses articles littéraires donnés ici et là (l'Obs, Le Monde...) et cela produit à chaque fois un folio de 1000 pages et plus. Le dernier opus se nomme Discours parfait (il était paru il y a moins de deux ans en Blanche) : de l'intelligence à l'état pur, mâtinée d'une mégalomanie que l'on a fini par pardonner, ou sur laquelle nous glissons car le personnage est aussi attachant qu'irritant... tant il est brillant. Admirables pages sur Shakespeare, Montaigne, Saint-Simon, Van Gogh, Venise, Stendhal à Bordeaux... Entre autres analyses subtilement circonscrites, avec tact, érudition et talent, bien sûr.
Philippe Sollers continue de compiler pour notre bonheur ses articles littéraires donnés ici et là (l'Obs, Le Monde...) et cela produit à chaque fois un folio de 1000 pages et plus. Le dernier opus se nomme Discours parfait (il était paru il y a moins de deux ans en Blanche) : de l'intelligence à l'état pur, mâtinée d'une mégalomanie que l'on a fini par pardonner, ou sur laquelle nous glissons car le personnage est aussi attachant qu'irritant... tant il est brillant. Admirables pages sur Shakespeare, Montaigne, Saint-Simon, Van Gogh, Venise, Stendhal à Bordeaux... Entre autres analyses subtilement circonscrites, avec tact, érudition et talent, bien sûr.  De Modiano, voyez L'horizon, qui n'est pas son plus mauvais roman sur le seul et (désespérément) unique sujet de son oeuvre : l'Occupation.
De Modiano, voyez L'horizon, qui n'est pas son plus mauvais roman sur le seul et (désespérément) unique sujet de son oeuvre : l'Occupation.  originale publiée Au Diable Vauvert, signé Macha Séry. Revivre l'aventure de la jeunesse algérienne de l'auteur du Premier homme, à Alger en 1930 donc, entre matches de foot, bistrots, copains, filles, soleil et... une tuberculose qui entre sans frapper, est vivifiant. Cela remet nos idées en place sur le Camus journaliste débutant, le jeune essayiste, le séducteur, l'homme lucide surtout. Captivant (en attendant la bio de Camus que Michel Onfray publie ce mois-ci chez Flammarion...).
originale publiée Au Diable Vauvert, signé Macha Séry. Revivre l'aventure de la jeunesse algérienne de l'auteur du Premier homme, à Alger en 1930 donc, entre matches de foot, bistrots, copains, filles, soleil et... une tuberculose qui entre sans frapper, est vivifiant. Cela remet nos idées en place sur le Camus journaliste débutant, le jeune essayiste, le séducteur, l'homme lucide surtout. Captivant (en attendant la bio de Camus que Michel Onfray publie ce mois-ci chez Flammarion...). Retour à Killybegs, qui a valu le Grand Prix du roman de l'Académie française à Sorj Chalandon (Grasset) est un bon et solide roman sur la trahison, qui fera sans doute date. Sur fond de combats de l'IRA, c'est fort comme un hot whiskey au retour d'une chasse à la bécasse dans les bushes, c'est franc comme un coup de poing bien assené et sec comme le regard d'un ami frappé de déception : cela ne cille ni ne ploie. Je ne citerai que la phrase placée en exergue du roman, relevée sur un mur de Belfast : Savez-vous ce que disent les arbres lorsque la hache entre dans la forêt? Regardez! Le manche est l'un des nôtres!
Retour à Killybegs, qui a valu le Grand Prix du roman de l'Académie française à Sorj Chalandon (Grasset) est un bon et solide roman sur la trahison, qui fera sans doute date. Sur fond de combats de l'IRA, c'est fort comme un hot whiskey au retour d'une chasse à la bécasse dans les bushes, c'est franc comme un coup de poing bien assené et sec comme le regard d'un ami frappé de déception : cela ne cille ni ne ploie. Je ne citerai que la phrase placée en exergue du roman, relevée sur un mur de Belfast : Savez-vous ce que disent les arbres lorsque la hache entre dans la forêt? Regardez! Le manche est l'un des nôtres! Dire que je n'ai pas du tout aimé La Guerre sans l'aimer, de Bernard-Henri Lévy (Grasset, 648 p.), est un euphémisme. Je voulais quand même feuilleter abondamment, m'arrêter ici ou là, tenter de comprendre la pathologie de ce Journal d'un écrivain au coeur du printemps libyen. Mais les bras m'en sont tombés. J'ai repensé à une formule de Cornelius Castoriadis à propos de "l'
Dire que je n'ai pas du tout aimé La Guerre sans l'aimer, de Bernard-Henri Lévy (Grasset, 648 p.), est un euphémisme. Je voulais quand même feuilleter abondamment, m'arrêter ici ou là, tenter de comprendre la pathologie de ce Journal d'un écrivain au coeur du printemps libyen. Mais les bras m'en sont tombés. J'ai repensé à une formule de Cornelius Castoriadis à propos de "l'
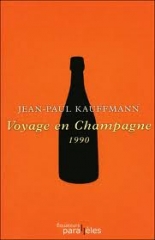 Lumineuse, l'idée d'Olivier Frébourg, patron des éditions des Equateurs, de reprendre dans sa petite collection Parallèles, deux textes splendides de Jean-Paul Kauffmann, l'un sur Bordeaux : Voyage à Bordeaux 1989 (que je suis fier de posséder dans son introuvable édition originale, celle de la Caisse des Dépôts et Consignations publiée à l'intention du notariat français, illustrée par Michel Guillard, mise en pages par le talentueux Marc Walter et préfacée par Jacques Chaban-Delmas!), l'autre sur le champagne : Voyage en Champagne 1990. Il s'agit de textes très littéraires sur les vins, les paysages, les hommes de la vigne. C'est précis et pêchu comme toujours avec Kauffmann, voire précieux dans l'écriture (comme du Veilletet, du Gracq) et surtout profond : le bordeaux est une initiation, prévient-il. Et le champagne est fils de l'air.
Lumineuse, l'idée d'Olivier Frébourg, patron des éditions des Equateurs, de reprendre dans sa petite collection Parallèles, deux textes splendides de Jean-Paul Kauffmann, l'un sur Bordeaux : Voyage à Bordeaux 1989 (que je suis fier de posséder dans son introuvable édition originale, celle de la Caisse des Dépôts et Consignations publiée à l'intention du notariat français, illustrée par Michel Guillard, mise en pages par le talentueux Marc Walter et préfacée par Jacques Chaban-Delmas!), l'autre sur le champagne : Voyage en Champagne 1990. Il s'agit de textes très littéraires sur les vins, les paysages, les hommes de la vigne. C'est précis et pêchu comme toujours avec Kauffmann, voire précieux dans l'écriture (comme du Veilletet, du Gracq) et surtout profond : le bordeaux est une initiation, prévient-il. Et le champagne est fils de l'air. 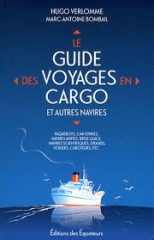 Voyages en Cargo et autres navires, de Hugo Verlomme et Marc-Antoine Bombail. Slow is beautiful lancent avec justesse les auteurs. Un livre unique pour tout savoir sur les possibilités de voyages à bord de paquebots, cargos, car-ferries, navires mixtes, brise-glace, grands voiliers, caboteurs et autres vieux grééments, baliseurs ou navires scientifiques... Sur les océans et les mers du monde entier.
Voyages en Cargo et autres navires, de Hugo Verlomme et Marc-Antoine Bombail. Slow is beautiful lancent avec justesse les auteurs. Un livre unique pour tout savoir sur les possibilités de voyages à bord de paquebots, cargos, car-ferries, navires mixtes, brise-glace, grands voiliers, caboteurs et autres vieux grééments, baliseurs ou navires scientifiques... Sur les océans et les mers du monde entier. Mon amour est le titre donné à une épatante anthologie de textes amoureux (folio, sous un coffret rouge ravissant bardé d'un ruban imprimé aux mots de je t'aime) que l'on a envie d'offrir -et c'est le premier but d'une telle démarche éditoriale! (Saint-Valentin oblige). Stendhal, Ovide, Proust, Cohen, Aragon, Duras, Shakespeare, Verlaine, Labé, Neruda, Eluard... Ils sont tous là et, curieusement, parmi ces classiques magnifiques, on trouve un seul contemporain peu connu pour ses textes amoureux : Jean-Christophe Rufin! Allez comprendre, des fois...
Mon amour est le titre donné à une épatante anthologie de textes amoureux (folio, sous un coffret rouge ravissant bardé d'un ruban imprimé aux mots de je t'aime) que l'on a envie d'offrir -et c'est le premier but d'une telle démarche éditoriale! (Saint-Valentin oblige). Stendhal, Ovide, Proust, Cohen, Aragon, Duras, Shakespeare, Verlaine, Labé, Neruda, Eluard... Ils sont tous là et, curieusement, parmi ces classiques magnifiques, on trouve un seul contemporain peu connu pour ses textes amoureux : Jean-Christophe Rufin! Allez comprendre, des fois... La revue (mauvais esprit) Ravages publie son nouveau numéro sur le thème : Slow! Comme toujours, c'est décapant, irrévérencieux, rentre-dedans, franc du collier et salutaire, et la maquette est redoutablement chic-efficace. Slow citta, slow food, slow life, slow money, slow travel, slow drive, slow industry, slow management... Tout est passé en revue, et des signatures prestigieuses comme celle d'Edgar Morin donnent dans Ravages. Bravo!
La revue (mauvais esprit) Ravages publie son nouveau numéro sur le thème : Slow! Comme toujours, c'est décapant, irrévérencieux, rentre-dedans, franc du collier et salutaire, et la maquette est redoutablement chic-efficace. Slow citta, slow food, slow life, slow money, slow travel, slow drive, slow industry, slow management... Tout est passé en revue, et des signatures prestigieuses comme celle d'Edgar Morin donnent dans Ravages. Bravo! l'originalité et la beauté de leurs publications (déjà remarquées ici même) : Les Miscellanées du jardin, de Guillaume Pellerin et Cléophée de Turckheim, sont par exemple un chef d'euvre d'édition audacieuse, tant pour l'illustration que pour le propos. Ce petit bijou nous apprend des tas de choses sur les mots du jardin, des anecdotes, des petits trucs, et c'est captivant, élégant, subtil et surtout bourré d'infos originales et sincèrement enrichissantes.
l'originalité et la beauté de leurs publications (déjà remarquées ici même) : Les Miscellanées du jardin, de Guillaume Pellerin et Cléophée de Turckheim, sont par exemple un chef d'euvre d'édition audacieuse, tant pour l'illustration que pour le propos. Ce petit bijou nous apprend des tas de choses sur les mots du jardin, des anecdotes, des petits trucs, et c'est captivant, élégant, subtil et surtout bourré d'infos originales et sincèrement enrichissantes. Toujours chez Ulmer, Les Jardins à vivre de Pierre-Alexandre Risser (20 ans de jardin à Paris et ailleurs) est un ouvrage splendide sur l'oeuvre d'un paysagiste de grand talent, un créateur de jardins et de terrasses en ville beaux toute l'année, en somme. Photos remarquables.
Toujours chez Ulmer, Les Jardins à vivre de Pierre-Alexandre Risser (20 ans de jardin à Paris et ailleurs) est un ouvrage splendide sur l'oeuvre d'un paysagiste de grand talent, un créateur de jardins et de terrasses en ville beaux toute l'année, en somme. Photos remarquables. 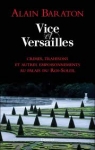 désopilant signé Alain Baraton (Grasset), jardinier en chef du parc de Versailles et du Trianon : cela regorge et dégorge d'intrigues, de meurtres, de coups fourrés sanglants. On se croirait chez les Borgia. Et c'est, de surcroît, écrit dans un style enlevé!
désopilant signé Alain Baraton (Grasset), jardinier en chef du parc de Versailles et du Trianon : cela regorge et dégorge d'intrigues, de meurtres, de coups fourrés sanglants. On se croirait chez les Borgia. Et c'est, de surcroît, écrit dans un style enlevé!


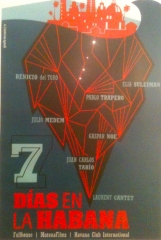











 Euprocte. Et aussi desman, cincle plongeur... Les lacs engendrent du bizarre. À côté de cette faune rare qui se cache, la truite fario et la bergeronnette des ruisseaux deviennent des passants ordinaires. On prête moins attention au moucheté des flancs de l’une et au ventre jaune de la seconde. Nous recherchons l’exceptionnelle rencontre avec ces étranges petites traces de la Préhistoire, à ces jolis cadeaux endémiques. Un lac d’altitude est prodigue, exotique, surprenant, généreux. À ses abords, les cadeaux abondent. C’est un Cabinet de curiosités. Un cadeau de Noël peut surgir à chaque pas.
Euprocte. Et aussi desman, cincle plongeur... Les lacs engendrent du bizarre. À côté de cette faune rare qui se cache, la truite fario et la bergeronnette des ruisseaux deviennent des passants ordinaires. On prête moins attention au moucheté des flancs de l’une et au ventre jaune de la seconde. Nous recherchons l’exceptionnelle rencontre avec ces étranges petites traces de la Préhistoire, à ces jolis cadeaux endémiques. Un lac d’altitude est prodigue, exotique, surprenant, généreux. À ses abords, les cadeaux abondent. C’est un Cabinet de curiosités. Un cadeau de Noël peut surgir à chaque pas. La surface du lac, vue d’en haut, à toucher presque Cap de Long, et un léger clapot provoqué par des langues de vent râpeuses, figurent un toit de grange ariégeoise, aux reflets d’ardoise, qui n’aurait pas de fin, comme on en trouve, assoupies par le temps, nichées au fond de la vallée de Bethmale, en Couserans ; leurs ailes grises étendues comme celles d’un albatros mises à sécher.
La surface du lac, vue d’en haut, à toucher presque Cap de Long, et un léger clapot provoqué par des langues de vent râpeuses, figurent un toit de grange ariégeoise, aux reflets d’ardoise, qui n’aurait pas de fin, comme on en trouve, assoupies par le temps, nichées au fond de la vallée de Bethmale, en Couserans ; leurs ailes grises étendues comme celles d’un albatros mises à sécher.  lacs, jusqu’à celui d’Orédon.
lacs, jusqu’à celui d’Orédon.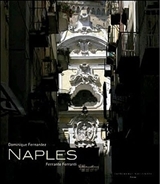 Connnaissez-vous la napolitude
Connnaissez-vous la napolitude 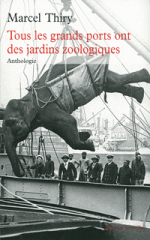
 cherche un vers qui se dérobe, on aperçoit des marins dont les rêves sont pleins de femmes aussi, le lent départ de transatlantiques aveugles, des brumes fantômes, d'autres femmes au regard de danger, comme cette étrangère qui dormait, blonde dans un wagon de seconde. Il y a encore des îles tristes, et puis Anvers, Londres, Hambourg, Amsterdam, Archangel(sk), la Mer de la Tranquillité, mais elle est dans la lune. Il y a aussi des lits d'hôtel et un huître de Claire qui épouse un vin gris, des enfants qui s'éloignent pour grandir à l'infini et des souvenirs qui semblent devenus poèmes rien que pour dater les tristesses (Baudelaire). Et c'est ainsi que ce bouquet de 430 pages devient précieux comme un alcool d'Apollinaire.
cherche un vers qui se dérobe, on aperçoit des marins dont les rêves sont pleins de femmes aussi, le lent départ de transatlantiques aveugles, des brumes fantômes, d'autres femmes au regard de danger, comme cette étrangère qui dormait, blonde dans un wagon de seconde. Il y a encore des îles tristes, et puis Anvers, Londres, Hambourg, Amsterdam, Archangel(sk), la Mer de la Tranquillité, mais elle est dans la lune. Il y a aussi des lits d'hôtel et un huître de Claire qui épouse un vin gris, des enfants qui s'éloignent pour grandir à l'infini et des souvenirs qui semblent devenus poèmes rien que pour dater les tristesses (Baudelaire). Et c'est ainsi que ce bouquet de 430 pages devient précieux comme un alcool d'Apollinaire. 
 Penta di Casinca est le seul village corse entièrement classé, en l’occurrence comme « site pittoresque », depuis 1973. Perché sur un éperon rocheux à 400 mètres au-dessus de la mer, au bout d’une route
Penta di Casinca est le seul village corse entièrement classé, en l’occurrence comme « site pittoresque », depuis 1973. Perché sur un éperon rocheux à 400 mètres au-dessus de la mer, au bout d’une route sous les châtaigniers et dominée au loin
sous les châtaigniers et dominée au loin
 jusqu’à Bastia. Après, louer une voiture ou une moto. Bastia est à 34 km et Poretta, son aéroport, à 17 km de Penta di Casinca.
jusqu’à Bastia. Après, louer une voiture ou une moto. Bastia est à 34 km et Poretta, son aéroport, à 17 km de Penta di Casinca. Il faut en finir avec les adresses réputées indéboulonnables : la pizzeria Da Michele (1, via Sersale) fait l'unanimité à Naples -en tout cas dans les guides touristiques. Or, la pizzeria Trianon Da Ciro (voisine : 44-46 via Colletta) ainsi que la pizzeria Vesi (115,
Il faut en finir avec les adresses réputées indéboulonnables : la pizzeria Da Michele (1, via Sersale) fait l'unanimité à Naples -en tout cas dans les guides touristiques. Or, la pizzeria Trianon Da Ciro (voisine : 44-46 via Colletta) ainsi que la pizzeria Vesi (115, 







 Une semaine sur l'île de Procida regonfle, donne envie de continuer d'écrire, d'écrire là-bas aussi, à défaut d'y vivre; entre deux balades en scooter d'une plage l'autre, et deux terrasses de restaurants de poissons et de fruits de mer. L'île n'est-elle pas devenue un jardin d'écriture, où Elsa Morante écrivit plusieurs de ses livres, dans la propriété Mazzella di Bosco ou hôtel Eldorado (
Une semaine sur l'île de Procida regonfle, donne envie de continuer d'écrire, d'écrire là-bas aussi, à défaut d'y vivre; entre deux balades en scooter d'une plage l'autre, et deux terrasses de restaurants de poissons et de fruits de mer. L'île n'est-elle pas devenue un jardin d'écriture, où Elsa Morante écrivit plusieurs de ses livres, dans la propriété Mazzella di Bosco ou hôtel Eldorado ( Corricella, avec la côte amalfitaine et Capri à l'horiz
Corricella, avec la côte amalfitaine et Capri à l'horiz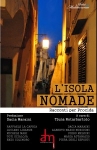 de récits sur Procida rassemblés par Tjuna Notarbartolo, écrivain et présidente du Prix Elsa-Morante, augmente cette fois d'une joie singulière, celle qui rassérène car elle est fleurie de promesses et de bonheurs à venir, encore, bientôt ; là-bas.
de récits sur Procida rassemblés par Tjuna Notarbartolo, écrivain et présidente du Prix Elsa-Morante, augmente cette fois d'une joie singulière, celle qui rassérène car elle est fleurie de promesses et de bonheurs à venir, encore, bientôt ; là-bas. 

 Voilà un beau cadeau de derrière les fagots, ou les tiroirs, c'est comme on voudra. Les éditions Finitude (magnifique catalogue comme on les aime, façon Le temps qu'il fait ou le dilettante des débuts,
Voilà un beau cadeau de derrière les fagots, ou les tiroirs, c'est comme on voudra. Les éditions Finitude (magnifique catalogue comme on les aime, façon Le temps qu'il fait ou le dilettante des débuts, 
 Byron l’appelait « le masque de l’Italie ». Derrière le masque, je vois Vénus.
Byron l’appelait « le masque de l’Italie ». Derrière le masque, je vois Vénus. composent les Sestieri, les six quartiers principaux : Castello, San Piero, l’Arsenal, San Marco, Canal Grande et Canareggio. Certaines rues ont des noms étranges, comme la rue « du soleil qui mène à la cour des ordures ». D’autres finissent en cul-de-sac, version locale : au hasard de ces rues noires où l’on n’entend que ses propres pas et où nous ne croisons que des amoureux et des chats, il arrive de trouver un canal pour seule issue. J’aime particulièrement San Michele, l’île cimetière, parce qu’elle sent la résine, la tulipe et la terre fraîchement retournée. L’herbe caresse nonchalamment les tombes comme des anémones de mer et les cyprès, raides comme des morts debout, y figurent un orgue gigantesque et silencieux.
composent les Sestieri, les six quartiers principaux : Castello, San Piero, l’Arsenal, San Marco, Canal Grande et Canareggio. Certaines rues ont des noms étranges, comme la rue « du soleil qui mène à la cour des ordures ». D’autres finissent en cul-de-sac, version locale : au hasard de ces rues noires où l’on n’entend que ses propres pas et où nous ne croisons que des amoureux et des chats, il arrive de trouver un canal pour seule issue. J’aime particulièrement San Michele, l’île cimetière, parce qu’elle sent la résine, la tulipe et la terre fraîchement retournée. L’herbe caresse nonchalamment les tombes comme des anémones de mer et les cyprès, raides comme des morts debout, y figurent un orgue gigantesque et silencieux.


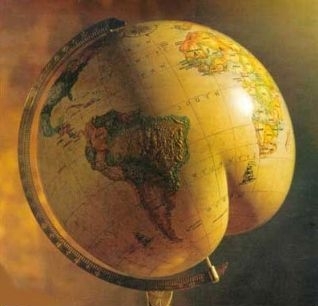















 L'incidence de l'Histoire et de notre écume culturelle font que nous appréhendons un pays avec l'empreinte intérieure d'une non-réalité. Souvent d'un anachronisme doublé d'une idéalisation. Ainsi de la Grèce où je me trouve. Je m'attendais très stupidement à croiser Socrate dans Plaka, à proximité de l'Agora. Sur les plages de Martselo et de Malatesta,
L'incidence de l'Histoire et de notre écume culturelle font que nous appréhendons un pays avec l'empreinte intérieure d'une non-réalité. Souvent d'un anachronisme doublé d'une idéalisation. Ainsi de la Grèce où je me trouve. Je m'attendais très stupidement à croiser Socrate dans Plaka, à proximité de l'Agora. Sur les plages de Martselo et de Malatesta, sur l'île de Paros ce matin, je me suis étonné de ne pas voir Achille pleurant Patrocle. Un remous dans l'eau et je pensais très connement à Poseidon. Je dois ces visions à des lectures matinales (mon viatique grec se compose d'une carte Visa, d'une brosse à dents, de tissus divers et de:Vidal-Naquet, Homère, Vernant, Lacarrière, Veyne, Citati). Le mérite de cette imprégnation est de devenir (presque) aveugle au tourisme qui
sur l'île de Paros ce matin, je me suis étonné de ne pas voir Achille pleurant Patrocle. Un remous dans l'eau et je pensais très connement à Poseidon. Je dois ces visions à des lectures matinales (mon viatique grec se compose d'une carte Visa, d'une brosse à dents, de tissus divers et de:Vidal-Naquet, Homère, Vernant, Lacarrière, Veyne, Citati). Le mérite de cette imprégnation est de devenir (presque) aveugle au tourisme qui  m'entoure. Cela ne durera pas. Déjà, les voix indécentes des touristes gagnent le silence qui habitait la Baie de Parikia depuis l'aube. Les touristes ont des moeurs exactement inverses à ceux de la population locale, sous ces latitudes : ils sortent et s'exposent au grill du soleil aux heures les plus folles, lorsque le Grec se terre à l'ombre et au frais; jusqu'à l'heure exquise de l'ouzo... La non-réalité c'est que le Grec qui vit de la viande touristique, porte une casquette NY, un faux tee-shirt Von Dutch, des tongs comme vous et moi et qu'il ignore peut-être tout de la geste homérique, comme l'Espagnol de la Costa Brava connaît le Quichotte par si-dire et le franchouille de Palavas ou de Bénodet, La Recherche à travers... rien. Voyager n'est pas décevant pour autant. Ou si peu. Le regard porte loin lorsqu'on sait dépasser. La vérité est souvent dans le dépassement...
m'entoure. Cela ne durera pas. Déjà, les voix indécentes des touristes gagnent le silence qui habitait la Baie de Parikia depuis l'aube. Les touristes ont des moeurs exactement inverses à ceux de la population locale, sous ces latitudes : ils sortent et s'exposent au grill du soleil aux heures les plus folles, lorsque le Grec se terre à l'ombre et au frais; jusqu'à l'heure exquise de l'ouzo... La non-réalité c'est que le Grec qui vit de la viande touristique, porte une casquette NY, un faux tee-shirt Von Dutch, des tongs comme vous et moi et qu'il ignore peut-être tout de la geste homérique, comme l'Espagnol de la Costa Brava connaît le Quichotte par si-dire et le franchouille de Palavas ou de Bénodet, La Recherche à travers... rien. Voyager n'est pas décevant pour autant. Ou si peu. Le regard porte loin lorsqu'on sait dépasser. La vérité est souvent dans le dépassement...

 Ville aimant, ville amante, ville mante, ville menteuse, fardée, ville phare, Venise est un trésor caché sous le manteau qui éclaire le pas du voyageur. Une flamme fragile. Venise brille sous une pellicule de poussière d’histoires. Venise est une vieille dame qui ne masque plus son âge et dont on devine la beauté enfuie. Lauren Bacall à la terrasse des Deux Magots, certains matins encore...
Ville aimant, ville amante, ville mante, ville menteuse, fardée, ville phare, Venise est un trésor caché sous le manteau qui éclaire le pas du voyageur. Une flamme fragile. Venise brille sous une pellicule de poussière d’histoires. Venise est une vieille dame qui ne masque plus son âge et dont on devine la beauté enfuie. Lauren Bacall à la terrasse des Deux Magots, certains matins encore... Comment croire, lorsque la rue Dieu, dans ce quartier où j'ai vécu, est une impasse?..
Comment croire, lorsque la rue Dieu, dans ce quartier où j'ai vécu, est une impasse?.. Mon pote Marc Trillard, écrivain, bourlingueur (si on ne parle pas de ses potes ici, hein!), dirige la revue-livre littéraire JOURNAL DES LOINTAINS (éd. Buchet-Chastel, 17€). Le n°5 vient de paraître. J'y publie AU CUL DES COQS DANS LA BRUYERE KAZAKH, fragments d'un journal tenu là-bas. Cela s'appelle de la promo. De l'auto promo même. So what?!...
Mon pote Marc Trillard, écrivain, bourlingueur (si on ne parle pas de ses potes ici, hein!), dirige la revue-livre littéraire JOURNAL DES LOINTAINS (éd. Buchet-Chastel, 17€). Le n°5 vient de paraître. J'y publie AU CUL DES COQS DANS LA BRUYERE KAZAKH, fragments d'un journal tenu là-bas. Cela s'appelle de la promo. De l'auto promo même. So what?!...





 Reportage pour Le Nouvel Obs (côte des Ajoncs, puis celle de Granit rose, départ Paimpol, puis Tréguier etc, et Perros-Guirec etc). Superbe côte, si douce, si calme en septembre... J'écrirai le papier demain. Voici quelques images, pour donner une idée...
Reportage pour Le Nouvel Obs (côte des Ajoncs, puis celle de Granit rose, départ Paimpol, puis Tréguier etc, et Perros-Guirec etc). Superbe côte, si douce, si calme en septembre... J'écrirai le papier demain. Voici quelques images, pour donner une idée... Comme on dirait Un balcon en forêt, ou : Un barrage contre le Pacifique.
Comme on dirait Un balcon en forêt, ou : Un barrage contre le Pacifique.




 Sidi Bou Said, la semaine dernière (un reportage à faire sur la fleur de jasmin). Ville bleue et blanche, comme Paros, Naxos, chaque île des Cyclades. Etrange sensation. Etre en Tunisie et se sentir en Grèce. Pouvoir de l'architecture de la couleur. Puissance du génie du lieu.
Sidi Bou Said, la semaine dernière (un reportage à faire sur la fleur de jasmin). Ville bleue et blanche, comme Paros, Naxos, chaque île des Cyclades. Etrange sensation. Etre en Tunisie et se sentir en Grèce. Pouvoir de l'architecture de la couleur. Puissance du génie du lieu.
 Sana’a scotche. Aube de juillet dans la vieille ville. La beauté bouleversante des maisons-tours se laisse caresser par un soleil timide comme un puceau. Les odeurs s’insinuent dans les rues. Ni bonnes, ni mauvaises : fortes. Miasmes et parfums mêlés de cardamome, de girofle, de cumin et de pisse de dromadaire. Un café au gingembre avalé brûlant. L’échange de deux ou trois mots, d’un sourire, d’un vrai regard, avec l’inconnu qui vous donne la moitié de son petit pain rond et chaud sans se retourner, ni attendre un quelconque merci, et la magie opère. Etablit ses quartiers. Comme çà. C’est le fameux « don du rien ». La légendaire hospitalité yéménite… Ce demi pain est un ciment : « souviens-toi que je t’ai donné la moitié de mon pain, un jour ». Le don est une philosophie plus dépaysante qu’un climat. La vérité de l’aube exige une cité de caractère. Sana’a a cette trempe recherchée. Ca le fait.
Sana’a scotche. Aube de juillet dans la vieille ville. La beauté bouleversante des maisons-tours se laisse caresser par un soleil timide comme un puceau. Les odeurs s’insinuent dans les rues. Ni bonnes, ni mauvaises : fortes. Miasmes et parfums mêlés de cardamome, de girofle, de cumin et de pisse de dromadaire. Un café au gingembre avalé brûlant. L’échange de deux ou trois mots, d’un sourire, d’un vrai regard, avec l’inconnu qui vous donne la moitié de son petit pain rond et chaud sans se retourner, ni attendre un quelconque merci, et la magie opère. Etablit ses quartiers. Comme çà. C’est le fameux « don du rien ». La légendaire hospitalité yéménite… Ce demi pain est un ciment : « souviens-toi que je t’ai donné la moitié de mon pain, un jour ». Le don est une philosophie plus dépaysante qu’un climat. La vérité de l’aube exige une cité de caractère. Sana’a a cette trempe recherchée. Ca le fait. Sana’a est un choc. Passés les abords en ébullition et en croissance exponentielle, depuis la première guerre du Golfe, de la « nouvelle » ville, qui a depuis longtemps noyé sa ceinture, le Ring Road, comme l’écorce du platane avale un vieux cerceau de fer avec les années, et tout en dévoyant son architecture au profit d’un style pâtisserie nouveau riche, la vieille ville de Sana’a s’impose au regard comme un cadeau du ciel. C’est sans doute l’un des paysages architecturaux les plus fascinants, les plus subtils, les plus esthétiques qui soient. L’Unesco ne s’est pas trompé, qui a classé la zone intouchable. Le touriste, espèce rarissime, en jouit donc avec la sérénité du dégustateur solitaire. Chaque maison, en terre brune et pisé, avec ses fameuses ouvertures étroites, carrées et rondes, pour partie en vitraux (les qamariyas, en demi-lune), voire en albâtre, entourées de goss blanc –repeintes avec stuc, gypse et fierté chaque année-, et agglomérées les unes aux autres, donnent au vieux Sana’a, comme à chaque village du Yémen, une expression culturelle inflexible. Chaque Yéménite est un peu architecte. Pour preuve, l’appel à la rescousse qui leur fut fait pour aider à la reconstruction délicate des monuments londoniens, après le bombardement de la ville.
Sana’a est un choc. Passés les abords en ébullition et en croissance exponentielle, depuis la première guerre du Golfe, de la « nouvelle » ville, qui a depuis longtemps noyé sa ceinture, le Ring Road, comme l’écorce du platane avale un vieux cerceau de fer avec les années, et tout en dévoyant son architecture au profit d’un style pâtisserie nouveau riche, la vieille ville de Sana’a s’impose au regard comme un cadeau du ciel. C’est sans doute l’un des paysages architecturaux les plus fascinants, les plus subtils, les plus esthétiques qui soient. L’Unesco ne s’est pas trompé, qui a classé la zone intouchable. Le touriste, espèce rarissime, en jouit donc avec la sérénité du dégustateur solitaire. Chaque maison, en terre brune et pisé, avec ses fameuses ouvertures étroites, carrées et rondes, pour partie en vitraux (les qamariyas, en demi-lune), voire en albâtre, entourées de goss blanc –repeintes avec stuc, gypse et fierté chaque année-, et agglomérées les unes aux autres, donnent au vieux Sana’a, comme à chaque village du Yémen, une expression culturelle inflexible. Chaque Yéménite est un peu architecte. Pour preuve, l’appel à la rescousse qui leur fut fait pour aider à la reconstruction délicate des monuments londoniens, après le bombardement de la ville. Comme il est cohérent de se promener seul dans les nombreux souks de la Médina, mieux : de se perdre dans le lacis des ruelles pas larges d’épaules, sans craindre le mythe du kidnapping de touristes, lequel demeure un sport national, certes, mais sans grand risque pour l’hôte de luxe attrapé, et ce sport se pratique loin, dans quelques zones reculées et circonscrites du pays, où l’escorte militaire est obligatoire, et où les Qabîlis (les hommes des tribus –le Yémen repose sur un système tribal très puissant et à l’autonomie extrêmement structurée par rapport au pouvoir gouvernemental), se servent des enlevés comme d’une monnaie d’échange ou d’un moyen de pression local. C’est, disons, « culturel ». C’est comme cela que ça marche, ici. Kalashnikov et jambiya (le poignard recourbé porté à la ceinture par chaque mâle en âge de marcher), sont des outils dissuasifs plus qu’amortis. D’ailleurs, le prix de la première augmentant, son usage se restreint et son port devient prohibé dans l’enceinte des grandes cités. Le président Ali Abdullah Saleh a tout compris du pays qu’il dirige depuis 28 ans. Il peaufine chaque jour les fruits de sa connaissance. Le 24 juin dernier, deux millions de personnes venues dans la nuit à pied, à dos d’âne, ou en Toyota déglinguée, des villages de la montagne et des faubourgs tentaculaires de Sana’a, ont manifesté sur la gigantesque Place des 70 jours, (où s’achève lentement l’érection d’une mosquée pharaonique), parce que leur président plébiscité à vie, avait menacé la veille, à la télé, de se retirer de la course à la présidentielle de septembre prochain. Habile Abdallah. Et fiers Yéménites qui firent une fête de tous les Diables, quelques heures plus tard, lorsque le président, sous pression annoncée, revint sur ses paroles…
Comme il est cohérent de se promener seul dans les nombreux souks de la Médina, mieux : de se perdre dans le lacis des ruelles pas larges d’épaules, sans craindre le mythe du kidnapping de touristes, lequel demeure un sport national, certes, mais sans grand risque pour l’hôte de luxe attrapé, et ce sport se pratique loin, dans quelques zones reculées et circonscrites du pays, où l’escorte militaire est obligatoire, et où les Qabîlis (les hommes des tribus –le Yémen repose sur un système tribal très puissant et à l’autonomie extrêmement structurée par rapport au pouvoir gouvernemental), se servent des enlevés comme d’une monnaie d’échange ou d’un moyen de pression local. C’est, disons, « culturel ». C’est comme cela que ça marche, ici. Kalashnikov et jambiya (le poignard recourbé porté à la ceinture par chaque mâle en âge de marcher), sont des outils dissuasifs plus qu’amortis. D’ailleurs, le prix de la première augmentant, son usage se restreint et son port devient prohibé dans l’enceinte des grandes cités. Le président Ali Abdullah Saleh a tout compris du pays qu’il dirige depuis 28 ans. Il peaufine chaque jour les fruits de sa connaissance. Le 24 juin dernier, deux millions de personnes venues dans la nuit à pied, à dos d’âne, ou en Toyota déglinguée, des villages de la montagne et des faubourgs tentaculaires de Sana’a, ont manifesté sur la gigantesque Place des 70 jours, (où s’achève lentement l’érection d’une mosquée pharaonique), parce que leur président plébiscité à vie, avait menacé la veille, à la télé, de se retirer de la course à la présidentielle de septembre prochain. Habile Abdallah. Et fiers Yéménites qui firent une fête de tous les Diables, quelques heures plus tard, lorsque le président, sous pression annoncée, revint sur ses paroles… Le mieux est d’arriver à Béziers par le train et de laisser paradoxalement le Sud pour filer droit vers Pézenas. De là, au Nord, direction Servian. L’aire de notre randonnée oenophile est traversée par la Thongue, la rivière qui prête son nom aux vignobles.
Le mieux est d’arriver à Béziers par le train et de laisser paradoxalement le Sud pour filer droit vers Pézenas. De là, au Nord, direction Servian. L’aire de notre randonnée oenophile est traversée par la Thongue, la rivière qui prête son nom aux vignobles. C’est un coin de verdure situé dans le nord-est de la presqu’île du Cotentin, où il fait bon passer un week-end. Tranquille, loin de la torpeur. Balade en Val de Saire.
C’est un coin de verdure situé dans le nord-est de la presqu’île du Cotentin, où il fait bon passer un week-end. Tranquille, loin de la torpeur. Balade en Val de Saire.

 Les bateaux de pêches sont fatigués, rouillés mais fiers. Les filets s’amoncellent sur le quai. À la terrasse d’un restaurant, des gens vous hèlent en vous invitant à partager l’apéro. Au Café de France, il y a une atmosphère Amsterdam (la chanson de Brel), les marins jouent de leurs larges paluches, au 421 ou aux dominos, et les pintes de bière défilent au pas de gymnastique.
Les bateaux de pêches sont fatigués, rouillés mais fiers. Les filets s’amoncellent sur le quai. À la terrasse d’un restaurant, des gens vous hèlent en vous invitant à partager l’apéro. Au Café de France, il y a une atmosphère Amsterdam (la chanson de Brel), les marins jouent de leurs larges paluches, au 421 ou aux dominos, et les pintes de bière défilent au pas de gymnastique.
