ARMAGNAC & CIGARES Cela pourrait commencer comme une petite annonce, genre : princes de sang cherchent temps libre pour union voluptueuse de courte mais d’intense durée. Les mariages de goût ne sont pas ceux qui durent le plus longtemps.
-----
A l’heure où un parfum de prohibition plane sur notre quotidien, que d’aucuns lorgnent sur les salles de restaurants comme sur feu les wagons fumeurs, à l ‘heure où l’alcootest devient une épée de Damoclès au-dessus de chacune de nos soirées dehors, à l’heure où notre société réputée permissive donne des petits coups de psschhitt liberticides par-ci, par-là, et je t’en remets un petit coup –tiens ! , oser le mariage si voluptueux de l’armagnac avec le cigare en fin de repas relève de l’audace la plus inconsciente, de la décadence totale et d’une inconséquence pour tous, à commencer pour ses propres artères, qui frise la déviance sociale. Enfermez-nous alors.
Car c’est ainsi, le cigare avec l’armagnac, c’est bon. Très bon. C’est même excellent.
En l’occurrence, il faut confesser d’emblée un droit de préférence : en matière d’eau-de-vie comme de politique, de musique ou de littérature, chacun sa religion. Vous êtes de gauche ou de droite, davantage Vivaldi que Bach, plutôt Beatles que Stones, Flaubert bien sûr, Beigbeder pas du tout ; armagnac ou cognac.
Ce papier choisit donc de parler de l’armagnac (le cognac sait, ô combien, attendre). Et de cigares, en deçà et au-delà des havanes.
Mais évoquons en préambule ce plaisir « cubanolandais » qui consiste à déguster un « Grand-Bas » (armagnac) en compagnie de Pierre Laberdolive ; chez lui, à Labastide d’Armagnac, 40.
Au domaine de Jaurrey. De préférence dans le chai plutôt que dans la salle de dégustation, par trop empruntée et dédiée aux débouchages convenus et aux visites collectives. Et de l’écouter disserter à l’infini sur l’épreuve du verre sec. Le verre sec, c’est celui que l’on a bu et que l’on respire les yeux fermés. Plutôt le lendemain matin, après avoir vidé les cendriers pleins de pieds de havanes. Ces parfums de noyaux de pruneau confit, de réglisse, de bitume même, sont l’âme de l’Armagnac. Laberdolive est fabriquant des Rolls de cet alcool, que les gens du Cognac jalousent en secret et en rongeant leur freins à disques rayés. Parmi les belles carrosseries dégustées récemment, le 1979, à la belle robe ambrée, au nez abricoté et grillé, à la finale délicatement boisée et chargée légèrement d’épices douces, genre poivre blanc, est une insolente provocation. Seuls un double corona et une conversation amicale peuvent l’escorter correctement. Au-delà, lorsque la nuit étoilée est avancée, la rêverie du promeneur solitaire s’occupe du reste…
Laberdolive fait donc de l’armagnac comme Hélène Darroze ou Alain Dutournier, ses compères landais de Villeneuve-de-Marsan (rue d’Assas à Paris) et de Cagnotte (rue de Castiglione à Paris), font la cuisine : avec l’immense talent que l’on sait.
A une heure et demie de route de là en remontant des terres d’Armagnac vers Paris, à Bordeaux, une autre célébrité des fourneaux et des bons petits bordeaux dénichés comme des cèpes sous la feuille morte, Jean-Pierre Xiradakis, dit Xira, règne sur La Tupina (lire à ce propos son livre « La cuisine de la Tupina », éditions Milan, car c’est un vrai bonheur, gourmand en diable, de lecture et de savoir-vivre). Xira est le chantre de la cuisine authentiquement sud-ouest, généreuse, simple et gouailleuse, avé l’accent des bonnes choses qui ont tous les bons goûts, celui de l’enfance compris. Xira aime les cigares. Et l’armagnac. Chez lui, que des havanes « parce que c’est comme çà », mais plus de quatre-vingt armagnacs différents. Il a un peu de mal à définir le mariage idéal, car il n’est pas partisan des alliances qui se superposent ni des mariages de raison mais plutôt des alliances qui se juxtaposent et s’entrelacent, se nouent et se défont mais se refont l’instant d’après, à la sauvage ou à la hussarde. Bref, plutôt un mariage qui bouge ! donc un armagnac un peu alcoolisé, « de l’armagnac qui te change la bouche à chaque gorgée plutôt qu’un armagnac élégant, fragile, pour escorter un cigare ». Là, Xira avoue être un inconditionnel du D4 de Partagas, le fameux robusto à bague rouge. « Parce que je préfère un cigare qui tire bien –et le D4 a un tirage merveilleux et toujours égal-, à tout autre cigare plus difficile à fumer ». Le D4 possède la puissance et la complexité aromatique pour affronter un grand armagnac en un moment très fort. Car pas de mariage de ce type sans moment rare. « Le contexte, c’est le plaisir, la rareté, le début et plus souvent la fin d’un repas, généralement un dîner d’ailleurs (sinon l’après-midi les clients sont out), donc un moment précieux ; subtil. Pour moi, le moment idéal pour l’alliance d’un armagnac et d’un havane, c’est chez Dutournier à Cagnotte après une belle corrida à Dax ». Oui, bon mais là, Jean-Pierre, c’est pas possible : la saison n’a pas encore commencé.
« Mes clients, je les sonde d’abord à l’œil nu après leur repas : si je sens qu’ils sont mûrs pour s’asseoir et qu’ils me demandent de leur choisir un armagnac, j’y vais franco et avec joie ! Un armagnac vif et nerveux plutôt qu’un vieux précieux, style Dupuis 1981 ou 1982, sur un D4 donc, et c’est parti : aucun déçu à ce jour ». Parce qu’il y a ce truc qui fonctionne, le réveil-matin dans la bouche à chaque bouffée, chaque gorgée. Evidemment, si le client exige un vieux Laberdolive, ça le regarde, mais c’est souvent dommage car il vaut mieux répugner à ouvrir un premier grand cru en fin de repas lorsque les papilles sont saturées et les neurones chargés : c’est du gâchis. C’est pourquoi Xira est partisan des plaisirs d’amont et d’à jeun : le cigare de dix heures du matin, ou de celui de dix-sept heures, avec de l’armagnac celui-là, soit lorsque les papilles sont affamées, érectiles et donc très réceptives. Mais il est difficile de proposer ce mariage avant le dîner, sauf à la jouer salon de lecture anglais, fumoir et fauteuils clubs –on est prié de laisser sa montre à l’entrée, avec les soucis-, et roule ! « Les vrais amateurs fument à ce moment-là, quitte à ne pas fumer d’autres cigares après le dîner », ajoute Xira. « Je suis pour les alliances avec mesure, pas pour la démesure. J’aime proposer aussi un Obus n°2 de Montecristo, au tirage exceptionnel lui aussi, mais plus long à fumer, avec un armagnac classique : Laubade 1971 ou 1972. C’est rond, ça ronronne, et la nuit peut continuer ». Si l’amitié est au salon, que les femmes sont belles, il n’y a plus qu’à changer le monde. Avant de vider les cendriers.
Reste que Jean-Pierre Xiradakis avoue en chuchotant, la main ouverte contre la bouche, que son mariage préféré demeure le havane allumé le cul sur une souche, qu’importe l’heure, après une marche d’une trentaine de kilomètres en pleine nature, avec une gorgée d’armagnac à même la flasque qui niche dans la poche intérieure. Pas deux ! Une suffit. Et le plaisir s’installe et prend toute la place. Olé !
Arrivé à Paris, cap est mis sur l’Aiguière, une bonne table du onzième, au 37 bis ru de Montreuil. C’est Patrick Masbatin qui dirige l’établissement. Il en est également le chef sommelier. Et comme il a suivi une formation à la dégustation de cigares, il lui arrive d’animer des ateliers-découverte : vins, eaux-de-cie et cigares. Il est en plein dans le sujet, Masbatin. Et son complice Pascal Viallet officie en cuisine. C’est le champion de la queue de bœuf croustillante aux noix de Saint-Jacques (et purée de céleri), ou du foie gras et cuisses de grenouilles aux asperges vertes. Entre autres merveilles. Patrick a comme un don d’ubiquité doublé d’un strabisme divergent et imperceptible, façon caméléon : il a l’œil à tout et rien ne lui échappe : il discute alliances en servant un coteaux de l’Aubance, se lève prestement pour engueuler gentiment un stagiaire de deux jours, remet deux cartes à un couple de jeunes amoureux, sourire large, s’asseoit, lance un ordre et attrape un bouteille bien froide de chardonnay du Clocher de Roquetaillade (Limoux). Hop ! Bonhomme, le regard suraigü, le mot tentateur au bous tes lèvres : « les bons desserts se commandent en début de repas », la voix gourmande, il déclare : « plus de 400 références à mon livre de cave et nous proposons notamment un menu accord mets-vins». Avis aux buveurs d’eau. Déjà, dans l’entrée, l’ambiance est dressée et la bonne humeur, mise : le meuble à cigares trône à droite et celui des fromages lui fait face. Avis aux allergiques de la belle vie. Il y a un vrai compartiment fumeurs dans ce train-ci.
Masbatin amène le client au mariage armagnac-cigare en douceur ; avec psychologie. « Cela dépend du moment et de la clientèle. La mienne est essentiellement composée d’hommes d’affaires, un rien inhibés par la fumée et l’alcool fort en fin de repas. Je propose des cigares de Saint-Domingue s’ils ne veulent pas de havanes. Ce sont pour la plupart des fumeurs de robustos ». Pressés. Les clients de l’Aiguière sont des avertis : « ils exigent leur armagnac et leur cigare habituels. J’ai beau proposer des vieux rhums, des calvados de haut-vol, rien n’y fait, c’est l’armagnac qu’ils veulent ». Patrick Masbatin propose alors toute la gamme des armagnacs de Laubade, à Nogaro, 32, dont il est un inconditionnel. Et Dieu sait si elle est vaste ! Des bas-armagnacs de 1961, 1954, 1955, « un 1947 –l’idéal sur un grand cigare, ajoute-t-il-, ou mieux : un 1939, le top ».
Son mariage préféré ? L’Intemporel n°5 de Laubade (clin d’œil à Chanel. Il existe aussi des intemporels n°3, 7…), d’un âge qui se situe entre trente-cinq et cinquante ans, qui est composé de baco 22A, d’ugni blanc, de colombard et de folle blanche de Bas-Armagnac. Avec un double coronas plutôt qu’avec un robusto, pour que le plaisir dure jusqu’à la fin du verre. Mais cet armagnac suave et pas rustique du tout, il l’apprécie et le fait découvrir chaque fois que possible, accompagné aussi d’un demi-tasse de Dunhill ou d’un Pluton de Pléiades, « parce qu’il n’y a pas que les havanes ! », ou alors, d’accord, avec un Hoyo du Prince (Hoyo de Monterrey) ou un Panatela de Rafael Gonzales.
« Si je peux initier une femme au cigare, je le fais volontiers. Je pense alors à lui faire découvrir l’armagnac à l ‘œil, au nez puis en bouche, si elle ne connaît encore rien de la magie de cet alcool, et je lui propose un demi-tasse de Davidoff avec un armagnac vieux ou « intermédiaire » (entre vingt et trente ans), un De Castelfort par exemple. Ou bien alors un Laubade 1929,42,49, 51 (mon année de naissance ! , précise Patrick), 55, 62,65. Il y a l’embarras du choix et tout le temps nécessaire pour partir à leur découverte, en compagnie d’un Epicure n°2. Un cigare d’élégance, avec un millésime d’élégance (le 1947 surtout), fondu, floral, sans agressivité ; c’est merveilleux ».
Sur un D4 de Partagas, Masbatin propose volontiers un Laubade des années soixante-dix, plus puissant car plus jeune.
Sur un Cohiba comme le Siglo I, il proposera un Laubade 1939 pour sa capacité a générer une rétro-olfaction de pruneau, son côté miel fondu, sa finesse, sa force aromatique. Racé, le Siglo I se déguste lentement et dure longtemps. Et à l’Aiguière, Patrick Masbatin semble vouloir barrer la porte de sortie aux clients, tant il aime constater de visu que le plaisir passe, lorsqu’il se pose à une table, qu’il prend en eux, et qu’il parvient à partager parfois en leur compagnie, un moment d’exception, comme ces mariages classiques mais tellement forts d’un armagnac avec un cigare judicieusement choisis par quelqu’un qui en connaît un rayon et qui aime donner du temps au temps.
A une encâblure et des poussières de la rue de Montreuil, nous avons poussé la lourde porte à tourniquet du Lutetia, boulevard Raspail, pour nous asseoir au bar ; directement. Inutile en effet de questionner Philippe, chef sommelier du restaurant, lequel règne sur un meuble de grands bas-armagnacs rangés comme des peupliers et sur un large humidificateur en bois précieux bourré de nombreuses références. Il sait en parler avec intelligence, mais cela n’a rien d’étonnant. Ici comme chez Trama à Puymirol, 47, au Georges V près des Champs-Elysées ou bien à Cala Rossa, à Porto-Vecchio (Corse du Sud), il y a un spécialiste pour discourir savamment du mariage qui nous préoccupe. Donc, le bar !
Sébastien est humble, il se dit pauvre en références mais il sait allier l’une avec l’autre. Lorsqu’on possède peu (à offrir), on fait au mieux avec ce que l’on a, non ? « D’abord, les gens viennent généralement avec leurs cigares. Sinon, nous leur ouvrons l’humedor ». Nous y trouvons (la liste des modules est courte comme un menu-carte qui repose des épais cahiers plastifiés des restaurants asiatiques). On y trouve donc le robusto de Cohiba, le D4 de Partagas, le petit coronas de Bolivar et un double coronas de Quai d’Orsay. Côté armagnacs, que des Bas d’abord. Ah, mais ! Laberdolive 1954 trône. Se pose comme une Aston Martin devant la porte à tourniquet précitée, à côté du voiturier et du chasseur. Loin derrière, trois armagnacs de la maison Castarède « on est tellement content d’elle qu’on ne veut surtout pas en changer » : le vsop, le hors-d’âge et un cabriolet au ventre plein de chevaux-vapeur : le 1976.
Évidemment, Sébastien se plaint de la baisse vertigineuse de consommation d’eaux-de-vie et autres alcools forts par les temps qui courent, depuis longtemps maintenant. Ces mariages n’attirent que les derniers des Mohicans du bon goût, disions-nous différemment en attaque.
Mais Sébastien aime proposer un armagnac, « car c’est un produit noble, pas un produit issu d’assemblages comme le cognac, d’ailleurs on fait des cocktails avec du cognac et on ne mélange pas l’armagnac, ou si rarement… ». A la carte du Lutetia bar, trois armagnacs figurent seulement. « Le Laberdolive c’est pour les connaisseurs, on le propose à la voix ». Si un client désire célébrer un mariage, Sébastien demande d’abord de combien de temps il dispose, car le cigare (et l’armagnac), c’est surtout une question de temps suspendu, presque arrêté. Puis il demande : corsé ou pas. Avec le Laberdolive 1954, le D4 est suggéré avec appui. « Cet armagnac est puissant mais doux, enrobé donc pourvu d’une robe et sans agressivité. Le D4 est rond en bouche et pas agressif non plus : l’alliance va de soi entre deux produits qui se ressemblent et s’assemblent par conséquent avec aisance ». Un débutant avouant l’être se verra proposer un vsop avec le petit bolivar. Celui qui choisira le cohiba parce que voilà, sera orienté vers le 1976 de Castarède. Comme quoi, avec peu, il est possible de proposer des alliances agréables sans malice, en un endroit rêvé pour s’enfoncer dans un fauteuil en cuir, regarder passer les gens, écouter un pianiste pianoter, en compagnie d’un module propre à effacer les soucis et d’une eau-de-vie gasconne capable de vous métamorphoser en mousquetaire avant l’indispensable épreuve du verre sec.
Léon MAZZELLA
La Tupina , 6, rue Porte-de-la-Monnaie, 33000 Bordeaux, 0556915637
L’Aiguière , 37 bis, rue de Montreuil, 75011 Paris, 0143724232
Le Lutetia Bar, 45 boulevard Raspail, 75006 Paris, 0149544646
 Elle a le regard noir mais doux et lumineux comme le charbon prêt à rougir. Son jeans aussi est noir. Comme son chemisier. Et ses cheveux, noir jais. L’escalier en colimaçon qui transperce son appartement conduit à un atelier de peintre. C’est le temple du paisible. De la clarté des jeunes filles en fleur, calmes, sereines. Lascives comme on le dirait des Vahinées de Gauguin.
Elle a le regard noir mais doux et lumineux comme le charbon prêt à rougir. Son jeans aussi est noir. Comme son chemisier. Et ses cheveux, noir jais. L’escalier en colimaçon qui transperce son appartement conduit à un atelier de peintre. C’est le temple du paisible. De la clarté des jeunes filles en fleur, calmes, sereines. Lascives comme on le dirait des Vahinées de Gauguin.  peint des jeunes filles et a une vie rêvée : le matin, ses modèles posent pour elle dans l’atelier, et l’après-midi, Francine peaufine, met de la couleur, rehausse les traits, cisèle les regards, et remet sur la toile des objets fétiches (ses madeleines) qui apparaissent sur la plupart de ses œuvres : la vieille robe rouge, le petit sac rond en cuir, la théière, le bol ébréché, la chaise à moustaches de sa belle-mère, les chaises et les bancs du Jardin du Luxembourg (à Paris) –sa nature-, le vieux jeans 501 complètement
peint des jeunes filles et a une vie rêvée : le matin, ses modèles posent pour elle dans l’atelier, et l’après-midi, Francine peaufine, met de la couleur, rehausse les traits, cisèle les regards, et remet sur la toile des objets fétiches (ses madeleines) qui apparaissent sur la plupart de ses œuvres : la vieille robe rouge, le petit sac rond en cuir, la théière, le bol ébréché, la chaise à moustaches de sa belle-mère, les chaises et les bancs du Jardin du Luxembourg (à Paris) –sa nature-, le vieux jeans 501 complètement  délavé et qui a habillé, à l’instar de la robe rouge, presque tous ses modèles. Francine a un professorat de dessin, mais enseigner l’a vite ennuyée : c’était dans un lycée (de jeunes filles
délavé et qui a habillé, à l’instar de la robe rouge, presque tous ses modèles. Francine a un professorat de dessin, mais enseigner l’a vite ennuyée : c’était dans un lycée (de jeunes filles de Strasbourg, dans les années 1963-64). Alors elle peint pour le plaisir, sous contrat exclusif avec la galerie Alain et Michèle Blondel à Paris, depuis vingt-six ans. Sa production est restreinte : une douzaine de toiles par an. Cela suffit...
de Strasbourg, dans les années 1963-64). Alors elle peint pour le plaisir, sous contrat exclusif avec la galerie Alain et Michèle Blondel à Paris, depuis vingt-six ans. Sa production est restreinte : une douzaine de toiles par an. Cela suffit... 
 nombreuses cartes postales qui reproduisent ses dessins. L’une d’elles m'a servi à illustrer la couverture de mon livre Femmes de soie (Séguier). C'est la troisième du petit triptyque ci-dessus. Le modèle de cette couverture s’appelle Anne, toujours représentée de dos. L’œuvre s’intitule : « Ôte-toi de mon soleil ! ». Cela me fait penser à l’insolence magnifique de Diogène (voir la note intitulée « CrateSo, Yo ! »). Le style Van Hove ? Classique et résolument figuratif. Lorsque tous ses condisciples donnaient dans l’abstrait, elle peignait déjà ces jeunes filles d’une sensualité
nombreuses cartes postales qui reproduisent ses dessins. L’une d’elles m'a servi à illustrer la couverture de mon livre Femmes de soie (Séguier). C'est la troisième du petit triptyque ci-dessus. Le modèle de cette couverture s’appelle Anne, toujours représentée de dos. L’œuvre s’intitule : « Ôte-toi de mon soleil ! ». Cela me fait penser à l’insolence magnifique de Diogène (voir la note intitulée « CrateSo, Yo ! »). Le style Van Hove ? Classique et résolument figuratif. Lorsque tous ses condisciples donnaient dans l’abstrait, elle peignait déjà ces jeunes filles d’une sensualité  extrême, à demi nues, au corps de rêve et au regard tendre. Jamais nues, mais toujours infiniment désirables. Ne pas tout montrer mais suggérer pourrait être son credo. Son mari, artiste lui aussi, en supporter amoureux, l’a très tôt encouragée à peindre ce qu’elle voulait, sans se soucier de quoi que ce soit, fut-ce les tendances de l’art, et à n’écouter que son inspiration. Puis, l’expérience de la peinture sur tissu fut un détonateur. Un boulot de
extrême, à demi nues, au corps de rêve et au regard tendre. Jamais nues, mais toujours infiniment désirables. Ne pas tout montrer mais suggérer pourrait être son credo. Son mari, artiste lui aussi, en supporter amoureux, l’a très tôt encouragée à peindre ce qu’elle voulait, sans se soucier de quoi que ce soit, fut-ce les tendances de l’art, et à n’écouter que son inspiration. Puis, l’expérience de la peinture sur tissu fut un détonateur. Un boulot de commande pour une styliste : Francine s’aperçut qu’elle pouvait peindre et en vivre. Son style propre, loin de l’école qui privilégie l’empâtement, l’épaisseur, est fait de légèreté, de fluidité, de silence et de douceur. Elle n’a jamais peint d’homme nu ou à peine dévêtu. Elle tourne avec cinq modèles, un par jour. Son premier, Marie-Odile, a posé en 1972. Elles se voient toujours, Marie-Odile, danseuse professionnelle, a 56 ans aujourd’hui. La doyenne peut avoir 40 ans, la plus jeune 18 ou 19 ans. Côté casting, la couleur de la peau est déterminante : « Je suis anti-bronzage. J’aime les peaux pâles ». Elle aime les corps architecturés, les filles pas trop minces, avec des
commande pour une styliste : Francine s’aperçut qu’elle pouvait peindre et en vivre. Son style propre, loin de l’école qui privilégie l’empâtement, l’épaisseur, est fait de légèreté, de fluidité, de silence et de douceur. Elle n’a jamais peint d’homme nu ou à peine dévêtu. Elle tourne avec cinq modèles, un par jour. Son premier, Marie-Odile, a posé en 1972. Elles se voient toujours, Marie-Odile, danseuse professionnelle, a 56 ans aujourd’hui. La doyenne peut avoir 40 ans, la plus jeune 18 ou 19 ans. Côté casting, la couleur de la peau est déterminante : « Je suis anti-bronzage. J’aime les peaux pâles ». Elle aime les corps architecturés, les filles pas trop minces, avec des  formes pleines. Mais elles ont toutes un air de famille, à y regarder de près. Un modèle l’a marquée, il y a six ans : Alexandra, « une Tunisienne qui possède la beauté d’un Delacroix avec les couleurs de Rubens ! », me confia-t-elle. Ses peintures ne disent presque rien, et c’est ce qui les rend si attachantes. Ses personnages
formes pleines. Mais elles ont toutes un air de famille, à y regarder de près. Un modèle l’a marquée, il y a six ans : Alexandra, « une Tunisienne qui possède la beauté d’un Delacroix avec les couleurs de Rubens ! », me confia-t-elle. Ses peintures ne disent presque rien, et c’est ce qui les rend si attachantes. Ses personnages prennent le petit-déjeuner, lisent un livre, ou Le Monde, elles rêvent, dorment. Elles ne sont que relâchement. Elles sont imprégnées de cette lascivité qui ne ressemble à rien de pervers. Aucune invitation à la luxure. Aucune parenté avec Balthus, ni Bellmer bien sûr, ou tant d’autres. Les jeunes filles de Van Hove sont dans l’abandon progressif, le glissement, dans ce que Barthes nomme joliment le fading dans ses Fragments d’un discours amoureux (voir la note éponyme). C’est davantage du côté des photographes comme J.F. Jonvelle ou J.L. Sieff que Francine pourrait jeter des passerelles. La représentation pudique et sensible des jeunes filles se
prennent le petit-déjeuner, lisent un livre, ou Le Monde, elles rêvent, dorment. Elles ne sont que relâchement. Elles sont imprégnées de cette lascivité qui ne ressemble à rien de pervers. Aucune invitation à la luxure. Aucune parenté avec Balthus, ni Bellmer bien sûr, ou tant d’autres. Les jeunes filles de Van Hove sont dans l’abandon progressif, le glissement, dans ce que Barthes nomme joliment le fading dans ses Fragments d’un discours amoureux (voir la note éponyme). C’est davantage du côté des photographes comme J.F. Jonvelle ou J.L. Sieff que Francine pourrait jeter des passerelles. La représentation pudique et sensible des jeunes filles se
 retrouve dans ses toiles, où le plaisir simple de l’après-midi, d’une sieste en été, sont là comme l'évidence du soleil…
retrouve dans ses toiles, où le plaisir simple de l’après-midi, d’une sieste en été, sont là comme l'évidence du soleil…

 On dit du tango que c’est un sentiment qui se danse. Le flamenco est au-delà : c’est un sentiment dansé. Le flamenco est un tesson de tragédie en travers d’une gorge éraillée qui chante la douleur du monde, et en particulier celle de l’amour. C’est un éclat noir sous lequel on devine le sang et l’eau, le cœur et la sueur, le sein et le suaire. Le cri. Le flamenco est un sentiment qui se creuse pour cambrer la parole. Et le regard. Cette concentration, ce ramassé comme on le dit d’un félin prêt à bondir sur sa proie qu’il tient déjà entre ses yeux, cette chispa (étincelle), est une façon d’être. D’habiter le monde. Etre flamenco… Comme on naît torero. Les coplas flamencas, ces haïkus andalous issus de l’âme gitane noire, incandescente, indomptable, fière, sont les paraboles de l’amour dansé : Ton visage, c’est la Sierra Morena, et tes yeux, les bandits qu’on y rencontre. Le flamenco, c’est cette Lointaine solitude sonore dont parle l’immense poète Rafael Alberti, Source sans fin d’insomnie d’où jaillit, du toreo la musique tue. Le flamenco, c’est à peine une ombre portée, un poignet cassé, un regard plus noir que la nuit, une cuisse dénudée. Le flamenco traduit avec douleur, mais les dents serrées (en parlant bouche fermée), la langue noueuse du corps à cœur : Va et que l’on te tire dessus avec la poudre de mes yeux et les balles de mes soupirs.
On dit du tango que c’est un sentiment qui se danse. Le flamenco est au-delà : c’est un sentiment dansé. Le flamenco est un tesson de tragédie en travers d’une gorge éraillée qui chante la douleur du monde, et en particulier celle de l’amour. C’est un éclat noir sous lequel on devine le sang et l’eau, le cœur et la sueur, le sein et le suaire. Le cri. Le flamenco est un sentiment qui se creuse pour cambrer la parole. Et le regard. Cette concentration, ce ramassé comme on le dit d’un félin prêt à bondir sur sa proie qu’il tient déjà entre ses yeux, cette chispa (étincelle), est une façon d’être. D’habiter le monde. Etre flamenco… Comme on naît torero. Les coplas flamencas, ces haïkus andalous issus de l’âme gitane noire, incandescente, indomptable, fière, sont les paraboles de l’amour dansé : Ton visage, c’est la Sierra Morena, et tes yeux, les bandits qu’on y rencontre. Le flamenco, c’est cette Lointaine solitude sonore dont parle l’immense poète Rafael Alberti, Source sans fin d’insomnie d’où jaillit, du toreo la musique tue. Le flamenco, c’est à peine une ombre portée, un poignet cassé, un regard plus noir que la nuit, une cuisse dénudée. Le flamenco traduit avec douleur, mais les dents serrées (en parlant bouche fermée), la langue noueuse du corps à cœur : Va et que l’on te tire dessus avec la poudre de mes yeux et les balles de mes soupirs. Car je l’aime de toutes mes cellules et j’aime chacune des siennes. Je l’aime toute. Entièrement. J’aime son corps, j’aime son esprit, j’aime sa morale, j’aime sa liberté, j’aime sa force de caractère, j’aime lorsqu’elle jouit, j’aime lorsqu’elle éclate de rire, j’aime lorsqu’elle mange du nutella, j’aime quand elle lit avec ses lunettes sur le nez, j'aime sa clairvoyance, j’aime sa voix, j’aime ses yeux et je suis fou de ses regards, j’aime sa sagacité et sa franchise, j’aime son indéfectible rectitude car elle ne s’apparente jamais à la rigidité, j’aime ses seins, j'aime ses reins, j'aime ses mains, j’aime son ventre, j'aime mo
Car je l’aime de toutes mes cellules et j’aime chacune des siennes. Je l’aime toute. Entièrement. J’aime son corps, j’aime son esprit, j’aime sa morale, j’aime sa liberté, j’aime sa force de caractère, j’aime lorsqu’elle jouit, j’aime lorsqu’elle éclate de rire, j’aime lorsqu’elle mange du nutella, j’aime quand elle lit avec ses lunettes sur le nez, j'aime sa clairvoyance, j’aime sa voix, j’aime ses yeux et je suis fou de ses regards, j’aime sa sagacité et sa franchise, j’aime son indéfectible rectitude car elle ne s’apparente jamais à la rigidité, j’aime ses seins, j'aime ses reins, j'aime ses mains, j’aime son ventre, j'aime mo n manque d'elle, j’aime son sexe, j’aime sa bouche, j'aime lorsqu'elle s'énerve, j'aime sa sauvage beauté, j'aime ses cheveux, j'aime ses ongles, j’aime ses baisers, j’aime ses attentions, j'aime sa nuque, j'aime son indépendance, j'aime son instinct d'ourse, j’aime son inquiétude, j’aime son oubli d’elle-même, j'aime ses bains, j'aime son cou des deux côtés, j’aime son amour, je
n manque d'elle, j’aime son sexe, j’aime sa bouche, j'aime lorsqu'elle s'énerve, j'aime sa sauvage beauté, j'aime ses cheveux, j'aime ses ongles, j’aime ses baisers, j’aime ses attentions, j'aime sa nuque, j'aime son indépendance, j'aime son instinct d'ourse, j’aime son inquiétude, j’aime son oubli d’elle-même, j'aime ses bains, j'aime son cou des deux côtés, j’aime son amour, je  n'aime pas ce qui l'exaspère, j’aime ses jambes, j’aime sa radicalité et j’aime aussi ses nuances, j'aime ses fesses, j’aime ses grains de beauté et ses abandons dans le sommeil, j’aime lorsqu’elle rote et j’aime ses cadeaux subtils, j’aime son goût pour le thé vert à la menthe et j’aime sa tanière où elle se sent mieux qu'ailleurs, j'aime lorsqu'elle parle après une longue réflexion, j'aime sa sagesse de vieil Indien, j'aime ses froncements de sourcils, j'aime sa
n'aime pas ce qui l'exaspère, j’aime ses jambes, j’aime sa radicalité et j’aime aussi ses nuances, j'aime ses fesses, j’aime ses grains de beauté et ses abandons dans le sommeil, j’aime lorsqu’elle rote et j’aime ses cadeaux subtils, j’aime son goût pour le thé vert à la menthe et j’aime sa tanière où elle se sent mieux qu'ailleurs, j'aime lorsqu'elle parle après une longue réflexion, j'aime sa sagesse de vieil Indien, j'aime ses froncements de sourcils, j'aime sa fragilité, j’aime ses mots et j’aime son écriture -car elle écrit bien, j'aime son côté chaman, j’aime lorsqu’elle lit près du feu, en silence, et que sa main caresse doucement la mienne, j’aime l’idée de partir avec elle et partir avec elle, j’aime revenir avec elle car nous pensons à repartir ensemble, j’aime caresser ses pieds, les masser sous la table, j'aime qu'elle n'aime pas faire de sport, j'aime qu'elle refuse que j'oriente ses lectures, j’aime ses sourires au téléphone et sa respiration lorsque je lui dis des mots d’amour, j'aime ses désirs, j'aime son gôut pour le sommeil, j’aime mon envie d’elle et j’aime ses silences, j’aime leur langueur et ce qu’ils me disent, j'aime sa détermination, j'aime sa droiture je l'ai déjà écrit, j’aime les synonymes qu’elle n’emploie pas avec le langage pour me dire qu’elle m’aime.
fragilité, j’aime ses mots et j’aime son écriture -car elle écrit bien, j'aime son côté chaman, j’aime lorsqu’elle lit près du feu, en silence, et que sa main caresse doucement la mienne, j’aime l’idée de partir avec elle et partir avec elle, j’aime revenir avec elle car nous pensons à repartir ensemble, j’aime caresser ses pieds, les masser sous la table, j'aime qu'elle n'aime pas faire de sport, j'aime qu'elle refuse que j'oriente ses lectures, j’aime ses sourires au téléphone et sa respiration lorsque je lui dis des mots d’amour, j'aime ses désirs, j'aime son gôut pour le sommeil, j’aime mon envie d’elle et j’aime ses silences, j’aime leur langueur et ce qu’ils me disent, j'aime sa détermination, j'aime sa droiture je l'ai déjà écrit, j’aime les synonymes qu’elle n’emploie pas avec le langage pour me dire qu’elle m’aime.
 "Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles semblent difficiles."
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles semblent difficiles." finalement, avec prudence, A. lanca à sa mère une salve d'espoir, d'énergie positive et d'avenir. Loin d'être affectée, elle regonfla sa mère, qui fut stupéfaite.
finalement, avec prudence, A. lanca à sa mère une salve d'espoir, d'énergie positive et d'avenir. Loin d'être affectée, elle regonfla sa mère, qui fut stupéfaite. Lorsque L. a chuchoté à sa fille M., hier soir, que si ses deux belles pistes de boulot échouaient, il serait mal, M., 17 ans, lui rappela une troisième piste, mince, mais... Dans laquelle il ne lui resterait plus qu'à s'engouffrer en se défoncant. L. fut également stupéfait.
Lorsque L. a chuchoté à sa fille M., hier soir, que si ses deux belles pistes de boulot échouaient, il serait mal, M., 17 ans, lui rappela une troisième piste, mince, mais... Dans laquelle il ne lui resterait plus qu'à s'engouffrer en se défoncant. L. fut également stupéfait.
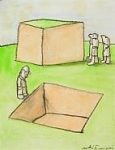 Walt Whitman (Feuilles d'herbe) :
Walt Whitman (Feuilles d'herbe) : Le souvenir frais de la peau la plus douce de la création
Le souvenir frais de la peau la plus douce de la création c'est de camus (le titre), et cela m'évoque cette ambiance consommatrice, du tout jetable, du rien réparable.
c'est de camus (le titre), et cela m'évoque cette ambiance consommatrice, du tout jetable, du rien réparable. C’est un coin de verdure situé dans le nord-est de la presqu’île du Cotentin, où il fait bon passer un week-end. Tranquille, loin de la torpeur. Balade en Val de Saire.
C’est un coin de verdure situé dans le nord-est de la presqu’île du Cotentin, où il fait bon passer un week-end. Tranquille, loin de la torpeur. Balade en Val de Saire.

 Les bateaux de pêches sont fatigués, rouillés mais fiers. Les filets s’amoncellent sur le quai. À la terrasse d’un restaurant, des gens vous hèlent en vous invitant à partager l’apéro. Au Café de France, il y a une atmosphère Amsterdam (la chanson de Brel), les marins jouent de leurs larges paluches, au 421 ou aux dominos, et les pintes de bière défilent au pas de gymnastique.
Les bateaux de pêches sont fatigués, rouillés mais fiers. Les filets s’amoncellent sur le quai. À la terrasse d’un restaurant, des gens vous hèlent en vous invitant à partager l’apéro. Au Café de France, il y a une atmosphère Amsterdam (la chanson de Brel), les marins jouent de leurs larges paluches, au 421 ou aux dominos, et les pintes de bière défilent au pas de gymnastique.





 C'est la recherche du si lent silence du geste.
C'est la recherche du si lent silence du geste.
 Sa voix rectifie la nuit
Sa voix rectifie la nuit

 "C'est à la poésie
"C'est à la poésie "Sur toute chose la neige a posé une nappe de silence.
"Sur toute chose la neige a posé une nappe de silence.
 Les jours rallongent et les jupes raccourcissent. Les mimosas fleurissent. En ville comme à la campagne, les palombes paradent vertigineusement : les mâles montent, planent et se laissent tomber. Les femelles ne regardent même pas.
Les jours rallongent et les jupes raccourcissent. Les mimosas fleurissent. En ville comme à la campagne, les palombes paradent vertigineusement : les mâles montent, planent et se laissent tomber. Les femelles ne regardent même pas.

 Le salaire de l’approche, c’était ma flasque qui me le remettait en mains propres et en liquide. Mais d’abord, par le nez, je m’octroyais licence de flairer le goulot comme on respire une fleur, un cou adoré. L’éducation du coût des choses vraies passe par là. (L’augmentation du goût de la vie aussi). Le bonheur est dans le près. Le très près. Comprenne qui sniffera.
Le salaire de l’approche, c’était ma flasque qui me le remettait en mains propres et en liquide. Mais d’abord, par le nez, je m’octroyais licence de flairer le goulot comme on respire une fleur, un cou adoré. L’éducation du coût des choses vraies passe par là. (L’augmentation du goût de la vie aussi). Le bonheur est dans le près. Le très près. Comprenne qui sniffera.
 « J’aimerais que ma vie ne laissât pas après elle d’autre murmure que celui d’une chanson de guetteur,
« J’aimerais que ma vie ne laissât pas après elle d’autre murmure que celui d’une chanson de guetteur,
 Picoré dans" Villa Amalia", le dernier Quignard (Gallimard), qui se passe à Ischia, où Anne Hidden fuit et se reconstruit...
Picoré dans" Villa Amalia", le dernier Quignard (Gallimard), qui se passe à Ischia, où Anne Hidden fuit et se reconstruit... Je me précipite dans un bar wifi pour l’écrire. Dans une urgence déplacée ; voire inutile.
Je me précipite dans un bar wifi pour l’écrire. Dans une urgence déplacée ; voire inutile. Et parfois du songe. Pas toujours rêveur, le songe. Plutôt simiesque justement : lorsque la pub et le marketing se mettent à singer la réalité masculine en la caricaturant, cela donne des créations qui ressemblent davantage à des vues de l’esprit qu’à des reflets du réel.
Et parfois du songe. Pas toujours rêveur, le songe. Plutôt simiesque justement : lorsque la pub et le marketing se mettent à singer la réalité masculine en la caricaturant, cela donne des créations qui ressemblent davantage à des vues de l’esprit qu’à des reflets du réel. Café stretto dans un bar de L., tandis que C. prend son long bain rituel et sacré. Je repense à l’Ivoirienne qui a jeté par la fenêtre de son appartement en feu de la rue du Roi Doré, au 4ème étage, son enfant de six ans. Pour le sauver des flammes. Il est mort dans l’ambulance qui le conduisait à l'hôpital Necker. Je pense au geste désespéré, à l’enfant jeté, à sa conscience avant de mourir -des mains de sa mère et du vent de la chute. Je pense au feu, à la nuit. Je pense au geste maternel. À cette brève existence dans un squatt honteux. En plein Marais (à Paris). La mère est morte aussi. C’est mieux ainsi. Je me risque à le penser.
Café stretto dans un bar de L., tandis que C. prend son long bain rituel et sacré. Je repense à l’Ivoirienne qui a jeté par la fenêtre de son appartement en feu de la rue du Roi Doré, au 4ème étage, son enfant de six ans. Pour le sauver des flammes. Il est mort dans l’ambulance qui le conduisait à l'hôpital Necker. Je pense au geste désespéré, à l’enfant jeté, à sa conscience avant de mourir -des mains de sa mère et du vent de la chute. Je pense au feu, à la nuit. Je pense au geste maternel. À cette brève existence dans un squatt honteux. En plein Marais (à Paris). La mère est morte aussi. C’est mieux ainsi. Je me risque à le penser. 6
6 Le cante jondo (hondo), le chant profond, exprime le génie dramatique, l’essence même du flamenco. Il peut jaillir n’importe où, souligne Michel del Castillo, qui écrit notamment : « Le flamenco est un style, une manière de se tenir debout, les reins cambrés, le menton relevé (…). C’est une posture de défi ironique, une attitude d’indifférence et de mépris. On feint d’ignorer le danger, on s’amuse avec lui »…
Le cante jondo (hondo), le chant profond, exprime le génie dramatique, l’essence même du flamenco. Il peut jaillir n’importe où, souligne Michel del Castillo, qui écrit notamment : « Le flamenco est un style, une manière de se tenir debout, les reins cambrés, le menton relevé (…). C’est une posture de défi ironique, une attitude d’indifférence et de mépris. On feint d’ignorer le danger, on s’amuse avec lui »… Au cours d’une conférence que Federico Garcia Lorca donna sur le sujet : « Jeu et théorie du duende », il cita un ami qui lui dit ceci en écoutant la musique de Manuel de Falla : « Tout ce qui a des sons noirs a du duende ».
Au cours d’une conférence que Federico Garcia Lorca donna sur le sujet : « Jeu et théorie du duende », il cita un ami qui lui dit ceci en écoutant la musique de Manuel de Falla : « Tout ce qui a des sons noirs a du duende ».

 « J’AIME QUI M’ÉBLOUIT
« J’AIME QUI M’ÉBLOUIT matin que je peux , et comme c’est jour de marché, après les poules, les fromages et les foies gras sur les quais de la Nive, j’achète la presse et je fais ma tournée. J’ai le sentiment étrange que les livres y ont l’accent. C’est un peu comme le pigeon ramier : c’est un grand migrateur qui ne fait que passer au-dessus du Sud-Ouest, or ici, nous l’avons baptisé palombe et nous la tutoyons parce que nous nous sommes un peu approprié l’oiseau : il est sédentarisé dans notre affection. Pareil pour les bouquins (un terme qui désigne les lièvres mâles en période nuptiale : le lièvre bouquine au printemps. Le bouquinage désigne cette période de reproduction. J’aime assez l’idée sémantique qui confond faire l’amour et lire. Et lièvre n’a qu’un « e » à l'accent grave, de plus que livre).
matin que je peux , et comme c’est jour de marché, après les poules, les fromages et les foies gras sur les quais de la Nive, j’achète la presse et je fais ma tournée. J’ai le sentiment étrange que les livres y ont l’accent. C’est un peu comme le pigeon ramier : c’est un grand migrateur qui ne fait que passer au-dessus du Sud-Ouest, or ici, nous l’avons baptisé palombe et nous la tutoyons parce que nous nous sommes un peu approprié l’oiseau : il est sédentarisé dans notre affection. Pareil pour les bouquins (un terme qui désigne les lièvres mâles en période nuptiale : le lièvre bouquine au printemps. Le bouquinage désigne cette période de reproduction. J’aime assez l’idée sémantique qui confond faire l’amour et lire. Et lièvre n’a qu’un « e » à l'accent grave, de plus que livre). Un jour, un lion, un regard, une éternité, une minute, un échange plus fort que la parole, un jour un lion, dans la brousse, entre les pailles, un lion dont j'ai croisé le regard, m'a dit.
Un jour, un lion, un regard, une éternité, une minute, un échange plus fort que la parole, un jour un lion, dans la brousse, entre les pailles, un lion dont j'ai croisé le regard, m'a dit. 3
3
 Retrouver avec une avidité animale l'odeur de l'autre : aisselles, sexe, cou, souffle. Garder un vêtement -qui enferme son odeur-, en cas d'absence. Nous le faisons depuis notre premier amour. C'est chien. Mon chien avait aussi besoin d'un de mes vêtements lorsque je partais en voyage. Il m'aimait.
Retrouver avec une avidité animale l'odeur de l'autre : aisselles, sexe, cou, souffle. Garder un vêtement -qui enferme son odeur-, en cas d'absence. Nous le faisons depuis notre premier amour. C'est chien. Mon chien avait aussi besoin d'un de mes vêtements lorsque je partais en voyage. Il m'aimait. 1
1 Ernesto Che Guevara
Ernesto Che Guevara Pendant des années, la seule vue d’une trace blanche d’avion dans le ciel bleu de l’aube en montagne, au marais, suffisait à lui déchirer le cœur. Loin des hommes, près de la vie sauvage, il apprenait les saisons et le végétal. Chaque jour augmentait sa connaissance du monde animal. La psychologie des femmes lui était étrangère. Il savait ramper, grimper. Pas encore embrasser ni caresser. Il savait le mimétisme et l’approche. Mais il ignorait tout du tact et des préséances…
Pendant des années, la seule vue d’une trace blanche d’avion dans le ciel bleu de l’aube en montagne, au marais, suffisait à lui déchirer le cœur. Loin des hommes, près de la vie sauvage, il apprenait les saisons et le végétal. Chaque jour augmentait sa connaissance du monde animal. La psychologie des femmes lui était étrangère. Il savait ramper, grimper. Pas encore embrasser ni caresser. Il savait le mimétisme et l’approche. Mais il ignorait tout du tact et des préséances…



 Tout se joue le matin, aux alentours de onze heures et dans le rond, même les passes de cape plus que parfaites : celles que la cuadrilla d’occasion effectue juste après le paseo, avec des toros imaginaires pourtant tenus derrière la porte, et qui jailliront un par un, là, maintenant (ça sonne).
Tout se joue le matin, aux alentours de onze heures et dans le rond, même les passes de cape plus que parfaites : celles que la cuadrilla d’occasion effectue juste après le paseo, avec des toros imaginaires pourtant tenus derrière la porte, et qui jailliront un par un, là, maintenant (ça sonne).


 Le flamenco se découvre vers l’âge de trois ans, en disant, regard froncé, à ses géniteurs : "je serai torero, plus tard" ("ou chirurgien pour sauver des vies humaines"). Le gamin n'a alors de cesse de toréer les voitures du bout du chandail, du bout d’une voix frêle et du bout des rêves. Il n’a jamais cessé de le faire, depuis. C’est plus fort que lui, il faut qu'il fasse des passes aux voitures avec un journal, n’importe quoi. Il "flamenquise" sa vie avec une suite de "desplante" qui frisent le ridicule.
Le flamenco se découvre vers l’âge de trois ans, en disant, regard froncé, à ses géniteurs : "je serai torero, plus tard" ("ou chirurgien pour sauver des vies humaines"). Le gamin n'a alors de cesse de toréer les voitures du bout du chandail, du bout d’une voix frêle et du bout des rêves. Il n’a jamais cessé de le faire, depuis. C’est plus fort que lui, il faut qu'il fasse des passes aux voitures avec un journal, n’importe quoi. Il "flamenquise" sa vie avec une suite de "desplante" qui frisent le ridicule.

 3h45 du matin. Le thé vert à la menthe est brûlant. Je reprends « Vie secrète », de Pascal Quignard dans la bibliothèque, comme on casse une barre de chocolat aux noisettes –en appuyant fermement sur la tablette, puis en ôtant le papier aluminium déchiré.
3h45 du matin. Le thé vert à la menthe est brûlant. Je reprends « Vie secrète », de Pascal Quignard dans la bibliothèque, comme on casse une barre de chocolat aux noisettes –en appuyant fermement sur la tablette, puis en ôtant le papier aluminium déchiré. y a sa désertion. Il y a l’ivresse, l’apnée et le vertige. Il y a l’incomplétude et la vulnérabilité. Il y a la fascination et il y a la patience. Il y a le plaisir –pulvérisateur du désir, et il y a la fulgurance : le coup de feu ; de foudre. Il y a l’anagramme troublante : sidérée, désirée. Il y a le fond de ton ventre et la périphérie, où rôdent les fauves. Il y a l’espace et il y a la tanière. Il y a la connivencia et il y a l’ineffable. Il y a les nuages et il y a deux amoureux –forcément coupés du monde. Il y a le silence sonore et il y a la solitude sonore, aussi. Il y a une haie tout au bout du pré, et des grives dedans qui jailliront à ton approche. Mais il en restera toujours une ou deux pour fuir du buis et du roncier, dans un fracas de plumes et de peur, lorsque tu seras à les toucher. Ce sont tes frères d’émotion. Tes compagnons de l’aube. Toujours recommencée. Veille sur eux.
y a sa désertion. Il y a l’ivresse, l’apnée et le vertige. Il y a l’incomplétude et la vulnérabilité. Il y a la fascination et il y a la patience. Il y a le plaisir –pulvérisateur du désir, et il y a la fulgurance : le coup de feu ; de foudre. Il y a l’anagramme troublante : sidérée, désirée. Il y a le fond de ton ventre et la périphérie, où rôdent les fauves. Il y a l’espace et il y a la tanière. Il y a la connivencia et il y a l’ineffable. Il y a les nuages et il y a deux amoureux –forcément coupés du monde. Il y a le silence sonore et il y a la solitude sonore, aussi. Il y a une haie tout au bout du pré, et des grives dedans qui jailliront à ton approche. Mais il en restera toujours une ou deux pour fuir du buis et du roncier, dans un fracas de plumes et de peur, lorsque tu seras à les toucher. Ce sont tes frères d’émotion. Tes compagnons de l’aube. Toujours recommencée. Veille sur eux. « Il n’est de vraie révolution que longue,
« Il n’est de vraie révolution que longue, le visuel d'abord : un mec, genre top model dans la haute finance, en costume smalto, impeccablement bien sûr lui, un tiroir façon magritte en plein dans la gueule, les mains posées bien à plat (j'assure!), sur la pierre (philosophale).
le visuel d'abord : un mec, genre top model dans la haute finance, en costume smalto, impeccablement bien sûr lui, un tiroir façon magritte en plein dans la gueule, les mains posées bien à plat (j'assure!), sur la pierre (philosophale). décorez-moi : j'ai vu basic instinct, deux (comme d'autres lisent deception point, ou d'autres encore vont à lourdes -pfff! les deux, à côté du grand cloué, ils sont même pas sur la photo!). sharon est toujours la plus belle blonde du monde, celle qui, par surcroît, préfère relire tout garcia marquez que se rebronzer le coeur ("car à la fin il faut que le coeur se brise ou se bronze", n'est-ce pas?), celle qui a oublié d'être tarte (et rien dans ma cuisine, hélas... mais "la chair est triste et j'ai lu tous les livres"). elle a du botox plein les nibards, une garde-robe de tarée, une coupe de cheveux qui va faire jurisprudence, un regard dévastateur ayayaye, elle fume comme un gainsbarre, conduit comme un fangio, séduit comme un don juan, mectonne les hommes, et elle possède une nonchalance attractive (genre : bon, c'est fini, ce tournage, je n'ai vraiment pas que ça à faire, moi), des plus délicieuses, au fond = elle se fout carrément du film, sharon, j'en suis convaincu. et ça, c'est vraiment fort! non, pas de décoration, finalement...
décorez-moi : j'ai vu basic instinct, deux (comme d'autres lisent deception point, ou d'autres encore vont à lourdes -pfff! les deux, à côté du grand cloué, ils sont même pas sur la photo!). sharon est toujours la plus belle blonde du monde, celle qui, par surcroît, préfère relire tout garcia marquez que se rebronzer le coeur ("car à la fin il faut que le coeur se brise ou se bronze", n'est-ce pas?), celle qui a oublié d'être tarte (et rien dans ma cuisine, hélas... mais "la chair est triste et j'ai lu tous les livres"). elle a du botox plein les nibards, une garde-robe de tarée, une coupe de cheveux qui va faire jurisprudence, un regard dévastateur ayayaye, elle fume comme un gainsbarre, conduit comme un fangio, séduit comme un don juan, mectonne les hommes, et elle possède une nonchalance attractive (genre : bon, c'est fini, ce tournage, je n'ai vraiment pas que ça à faire, moi), des plus délicieuses, au fond = elle se fout carrément du film, sharon, j'en suis convaincu. et ça, c'est vraiment fort! non, pas de décoration, finalement...


 La seule chose que je reproche à la pilule quotidienne nommée Socrate, c’est de ne pas contenir dans sa formule (j ‘ai vérifié sur le papier), un anti douleur fondamental, réputé apaiser les frustrations d'enfants gâtés que nous ommetous un jour ou l'autre : Nicolas Grimaldi, (dont je buvais les paroles lorsqu’il enseignait « Le désir et le temps » à la Fac de Lettres de Bordeaux, il y a quelque temps déjà), le résume ainsi, dans « Socrate, le sorcier »
La seule chose que je reproche à la pilule quotidienne nommée Socrate, c’est de ne pas contenir dans sa formule (j ‘ai vérifié sur le papier), un anti douleur fondamental, réputé apaiser les frustrations d'enfants gâtés que nous ommetous un jour ou l'autre : Nicolas Grimaldi, (dont je buvais les paroles lorsqu’il enseignait « Le désir et le temps » à la Fac de Lettres de Bordeaux, il y a quelque temps déjà), le résume ainsi, dans « Socrate, le sorcier » 
 Je reviendrai sur Socrate (parce qu’on revient toujours à lui, t’y peux rien, man…). Saluti, je va me faire un café et mettre
Je reviendrai sur Socrate (parce qu’on revient toujours à lui, t’y peux rien, man…). Saluti, je va me faire un café et mettre Socrate toujours. Comment se passer d'air? De sang? D'électricité dans les veines du cerveau et de l'âme/corps? Sans Socrate, tu meurs! Laisse Platon, son exégète, son scribe. Prends Socrate, et re-sache que tu ne sais rien. Sache que tu sais NADA. Et va nu. Sois. Deviens (si tu veux) celui que tu es, ou pense être. Deviens sage : sois ouverture, rigueur, courage, endurance, engagement, humilité. Ne déçois plus jamais. Apprends à comprendre ton être de tout ton être. Moi, un jour, je me suis dit "ptain, ces hogan elles sont trop!", et j'ai croisé un mec sans pompes, avec du journal ficelé autour des pieds. Je me suis satisfait de mes pompes. (Être riche, c'est n'avoir rien à perdre). Même si ce que j'ai dit est mon maître, et ce que je n'ai pas encore dit est mon esclave, je me sens avant tout tissé de l'étoffe dont sont faits les rêves dont je ne me souviens pas.
Socrate toujours. Comment se passer d'air? De sang? D'électricité dans les veines du cerveau et de l'âme/corps? Sans Socrate, tu meurs! Laisse Platon, son exégète, son scribe. Prends Socrate, et re-sache que tu ne sais rien. Sache que tu sais NADA. Et va nu. Sois. Deviens (si tu veux) celui que tu es, ou pense être. Deviens sage : sois ouverture, rigueur, courage, endurance, engagement, humilité. Ne déçois plus jamais. Apprends à comprendre ton être de tout ton être. Moi, un jour, je me suis dit "ptain, ces hogan elles sont trop!", et j'ai croisé un mec sans pompes, avec du journal ficelé autour des pieds. Je me suis satisfait de mes pompes. (Être riche, c'est n'avoir rien à perdre). Même si ce que j'ai dit est mon maître, et ce que je n'ai pas encore dit est mon esclave, je me sens avant tout tissé de l'étoffe dont sont faits les rêves dont je ne me souviens pas. Le lieu, c’est ce blog. Le génie, c’est l’imprévu. La rencontre. Le piège, parfois. Le beau piège : le piège amoureux, celui qui tend le ressort avec le risque de se le prendre dans la gueule (tel est pris qui…). « Va vers ton risque »… Le génie du lieu, c’est le génie de l’inattendu, de l’improviste retrouvée, d’un certain naturel perdu et revenu au galop. Le génie, c’est l’échange entre Ottawa et là, entre une Roumanie imaginaire et soi. Entre toi et moi. Le génie, c’est l’art du synonyme. Sans masque. Un art nouveau.
Le lieu, c’est ce blog. Le génie, c’est l’imprévu. La rencontre. Le piège, parfois. Le beau piège : le piège amoureux, celui qui tend le ressort avec le risque de se le prendre dans la gueule (tel est pris qui…). « Va vers ton risque »… Le génie du lieu, c’est le génie de l’inattendu, de l’improviste retrouvée, d’un certain naturel perdu et revenu au galop. Le génie, c’est l’échange entre Ottawa et là, entre une Roumanie imaginaire et soi. Entre toi et moi. Le génie, c’est l’art du synonyme. Sans masque. Un art nouveau.



 ...Comme "il y a des jours, où l'on se sent comme un couteau sans lame auquel manque le manche" (Lichtenberg).
...Comme "il y a des jours, où l'on se sent comme un couteau sans lame auquel manque le manche" (Lichtenberg).