 Il n’y a pas de mauvais sujet. C’est ce que l’on répète au journaliste stagiaire faisant la fine bouche parce qu’on l’envoie couvrir un marronnier. C’est comme ça que le métier rentre, assène-t-on. A priori, mener une enquête très approfondie sur l’univers du fast-food, si l’on n’est pas un McDolescent attardé, en focalisant forcément celle-ci sur la gigantesque entreprise aux arches jaunes, peut sembler sinon suspect, au moins audacieux. Didier Pourquery, sans doute aficionado léger du petit pain rond et mou, régressif et transgressif, nocif parce qu’addictif, l’a menée car il souhaitait le faire depuis longtemps, lui qui dévora avec plaisir son premier hamburger-frites à l’âge de 17 ans, en 1971, et pas n’importe où : dans un Dairy Queen Brazier de Chicago. Ça marque. Et nous lisons, grâce à son talent narratif, un essai comme on lit une (belle) histoire avec des personnages, tout ça. Découpée en tranches, l’étude : historique, sociologique (les rites), géographique, économique bien sûr, et aussi sur le plan capital de la nutrition (ça nuit grave !), celui de la mode (comment ça mute ?), et enfin sous l’angle du mauvais esprit, confesse d’emblée l’auteur. Mais l’analyse est totalement sérieuse, d’une précision d’horloger genevois, gavée de références, c’est bien sourcé comme on dit, c’est drôle souvent, et l’on sent le journaliste scrupuleux glissant tantôt vers l’aveu culpabilisant (j’aime ça), tantôt vers l’affirmation dédouanante (c’est vraiment dégueu, tant le système précis mis en place pour « piéger » le consommateur, quelle que soit sa culture, que la charge en lipides et en glucides de tout hamburger-frites). Grâce à plusieurs brassées de chiffres, de statistiques, nous apprenons énormément de choses sur l’univers, la grosse machine dissimulée sous ce « simulacre de repas ». Pourquery se réfère immédiatement au chapitre des « Mythologies » de Roland Barthes (1961) consacré au bifteck-frites (*). L’emblématique plat français, en terre de gastronomie, qui résonnait « sang », a depuis longtemps été détrôné par le hamburger, lequel résonne « sans » : bientôt sans viande, sans bœuf, sans personnel humain... 1961 voit aussi l’apparition des restaurants de fast-food Wimpy, en écho à Popeye, dont le personnage goinfre nommé Gontran dans l’adaptation française, ami de Popeye, se nomme J. Wellington Wimpy. C’est le premier addict aux hamburgers. Jacques Borel, célèbre pour les restauroutes, ouvrit cette année-là le premier Wimpy français. En 1972, le premier McDonald’s de France ouvre à Créteil. Depuis, on en compte 1 300 au pays du foie gras et des grands crus classés, et la filiale française est la plus rentable au monde derrière le réseau US. Déroutante France. C’est le French paradox... Le bouquin de Didier Pourquery devient captivant au fil des pages, car outre l’histoire des KFC, Burger King, Freetime (souvenez-vous de Christophe Salengro disant : my teinturier is rich), et autres concurrents du géant McDo et ses 37 000 « restaurants », la préhistoire du hamburger (Hambourg), l’histoire du steack haché, l’idée de le placer entre deux tranches de pain, jusqu’à la Hamburger University, « le Princeton du fast-food » qui a déjà form(at)é 80 000 managers de McDo, dans les veines desquels on est en droit de se demander si ce n’est pas du ketchup qui circule, il y a le décodage sociologique et psychologique de l’acte de se rendre dans un fast-food et d’y consommer, auquel se livre l’auteur avec un savoir et un tact qui emporte le lecteur. Il est question d’« expérience » pour désigner ces actes, de la « production d’une histoire comestible plus que d’une nourriture concrète ». Chacun sait que c’est de la junk-food, soit de la malbouffe, mais nous savons que les horribles photos qui ornent les paquets de cigarettes n’empêchent pas davantage le fumeur de tirer sur sa clope (12 millions de décès dans le monde dus à la malbouffe, contre 7 millions au tabac en 2015. Quand même...). Cela m’évoque les épouvantails dans les champs sur lesquels se posent les oiseaux... L'efficacité des firmes de fast-food est vraiment redoutable. Pourquery s’attarde à juste titre sur des petites choses, comme ça, qui relèvent du rite : manger – forcément - avec ses mains, piquer une frite sur le plateau avant de s’asseoir, puis dans le plateau de l'autre, cette lenteur que nous craignons, et notre impatience qui monte comme du lait dans la casserole lorsque la commande n’arrive pas dans la seconde, les néo-burgers revisitant aujourd’hui le mythe et le simulacre en même temps, en tentant de « purifier » tout ça. L’archétype étant la petite chaîne tellement friendly Big Fernand. Le moment le plus tragique peut-être est cet article de Lorraine de Foucher paru dans Le Monde du 2 novembre 2018, intitulé « Le McDo a remplacé le café du village », cité par Didier Pourquery. Ce papier m'avait alerté. Le mot village y est un peu exagéré, car la chaîne ne s’installe pas encore dans de petits bleds désormais dépourvus d’école, d’épicerie fourre-tout, où un office mensuel est célébré à l’église, et où le dernier bar, en fermant définitivement sa porte, sonne le glas de la dernière possibilité de se retrouver, d’être encore socialisés, ensemble – au moins entre hommes, comme dans le baitemannageo, ou « maison des hommes » bâti au centre de chaque village Bororo, et décrit par Claude Lévi-Strauss dans « Tristes Tropiques » (Plon/Terre Humaine, page 248). Mais force est d’admettre que dans des bourgs et des villes de petite taille, lorsqu’un McDo ouvre, c’est un peu de vie qui revient... dans un cadre particulier. Reste que cette « Histoire de hamburger-frites » sous-titrée « comment un simulacre de repas a-t-il séduit le monde entier ? » se lit comme on boit un demi un jour de canicule, ou comme on dévore un Big Mac. L.M.
Il n’y a pas de mauvais sujet. C’est ce que l’on répète au journaliste stagiaire faisant la fine bouche parce qu’on l’envoie couvrir un marronnier. C’est comme ça que le métier rentre, assène-t-on. A priori, mener une enquête très approfondie sur l’univers du fast-food, si l’on n’est pas un McDolescent attardé, en focalisant forcément celle-ci sur la gigantesque entreprise aux arches jaunes, peut sembler sinon suspect, au moins audacieux. Didier Pourquery, sans doute aficionado léger du petit pain rond et mou, régressif et transgressif, nocif parce qu’addictif, l’a menée car il souhaitait le faire depuis longtemps, lui qui dévora avec plaisir son premier hamburger-frites à l’âge de 17 ans, en 1971, et pas n’importe où : dans un Dairy Queen Brazier de Chicago. Ça marque. Et nous lisons, grâce à son talent narratif, un essai comme on lit une (belle) histoire avec des personnages, tout ça. Découpée en tranches, l’étude : historique, sociologique (les rites), géographique, économique bien sûr, et aussi sur le plan capital de la nutrition (ça nuit grave !), celui de la mode (comment ça mute ?), et enfin sous l’angle du mauvais esprit, confesse d’emblée l’auteur. Mais l’analyse est totalement sérieuse, d’une précision d’horloger genevois, gavée de références, c’est bien sourcé comme on dit, c’est drôle souvent, et l’on sent le journaliste scrupuleux glissant tantôt vers l’aveu culpabilisant (j’aime ça), tantôt vers l’affirmation dédouanante (c’est vraiment dégueu, tant le système précis mis en place pour « piéger » le consommateur, quelle que soit sa culture, que la charge en lipides et en glucides de tout hamburger-frites). Grâce à plusieurs brassées de chiffres, de statistiques, nous apprenons énormément de choses sur l’univers, la grosse machine dissimulée sous ce « simulacre de repas ». Pourquery se réfère immédiatement au chapitre des « Mythologies » de Roland Barthes (1961) consacré au bifteck-frites (*). L’emblématique plat français, en terre de gastronomie, qui résonnait « sang », a depuis longtemps été détrôné par le hamburger, lequel résonne « sans » : bientôt sans viande, sans bœuf, sans personnel humain... 1961 voit aussi l’apparition des restaurants de fast-food Wimpy, en écho à Popeye, dont le personnage goinfre nommé Gontran dans l’adaptation française, ami de Popeye, se nomme J. Wellington Wimpy. C’est le premier addict aux hamburgers. Jacques Borel, célèbre pour les restauroutes, ouvrit cette année-là le premier Wimpy français. En 1972, le premier McDonald’s de France ouvre à Créteil. Depuis, on en compte 1 300 au pays du foie gras et des grands crus classés, et la filiale française est la plus rentable au monde derrière le réseau US. Déroutante France. C’est le French paradox... Le bouquin de Didier Pourquery devient captivant au fil des pages, car outre l’histoire des KFC, Burger King, Freetime (souvenez-vous de Christophe Salengro disant : my teinturier is rich), et autres concurrents du géant McDo et ses 37 000 « restaurants », la préhistoire du hamburger (Hambourg), l’histoire du steack haché, l’idée de le placer entre deux tranches de pain, jusqu’à la Hamburger University, « le Princeton du fast-food » qui a déjà form(at)é 80 000 managers de McDo, dans les veines desquels on est en droit de se demander si ce n’est pas du ketchup qui circule, il y a le décodage sociologique et psychologique de l’acte de se rendre dans un fast-food et d’y consommer, auquel se livre l’auteur avec un savoir et un tact qui emporte le lecteur. Il est question d’« expérience » pour désigner ces actes, de la « production d’une histoire comestible plus que d’une nourriture concrète ». Chacun sait que c’est de la junk-food, soit de la malbouffe, mais nous savons que les horribles photos qui ornent les paquets de cigarettes n’empêchent pas davantage le fumeur de tirer sur sa clope (12 millions de décès dans le monde dus à la malbouffe, contre 7 millions au tabac en 2015. Quand même...). Cela m’évoque les épouvantails dans les champs sur lesquels se posent les oiseaux... L'efficacité des firmes de fast-food est vraiment redoutable. Pourquery s’attarde à juste titre sur des petites choses, comme ça, qui relèvent du rite : manger – forcément - avec ses mains, piquer une frite sur le plateau avant de s’asseoir, puis dans le plateau de l'autre, cette lenteur que nous craignons, et notre impatience qui monte comme du lait dans la casserole lorsque la commande n’arrive pas dans la seconde, les néo-burgers revisitant aujourd’hui le mythe et le simulacre en même temps, en tentant de « purifier » tout ça. L’archétype étant la petite chaîne tellement friendly Big Fernand. Le moment le plus tragique peut-être est cet article de Lorraine de Foucher paru dans Le Monde du 2 novembre 2018, intitulé « Le McDo a remplacé le café du village », cité par Didier Pourquery. Ce papier m'avait alerté. Le mot village y est un peu exagéré, car la chaîne ne s’installe pas encore dans de petits bleds désormais dépourvus d’école, d’épicerie fourre-tout, où un office mensuel est célébré à l’église, et où le dernier bar, en fermant définitivement sa porte, sonne le glas de la dernière possibilité de se retrouver, d’être encore socialisés, ensemble – au moins entre hommes, comme dans le baitemannageo, ou « maison des hommes » bâti au centre de chaque village Bororo, et décrit par Claude Lévi-Strauss dans « Tristes Tropiques » (Plon/Terre Humaine, page 248). Mais force est d’admettre que dans des bourgs et des villes de petite taille, lorsqu’un McDo ouvre, c’est un peu de vie qui revient... dans un cadre particulier. Reste que cette « Histoire de hamburger-frites » sous-titrée « comment un simulacre de repas a-t-il séduit le monde entier ? » se lit comme on boit un demi un jour de canicule, ou comme on dévore un Big Mac. L.M.
---
(*) « Une histoire de hamburger-frites », par Didier Pourquery, Robert Laffont, collection Nouvelles Mytholgies, 12€
Si je puis me permettre l'encadré qui suit...
Anecdote perso, pour finir (mais ici, je m'autorise à peu près tout) : je confesse, moi le critique gastro qui ai notamment dirigé la rédaction de GaultMillau, moi qui suis entré pour la dernière fois dans un fast-food (il faut dire que c’est le plus beau du monde. Je désigne le McDo de la plage de La Barre, à Anglet – il a les pieds dans le sable -, avec mes deux enfants il y a au moins une quinzaine d’années. Puis, rien depuis, sinon des ortolans et du champagne), prévoyant de lire ce livre à la faveur d’un bon trajet en train (le lieu idéal), j’ai poussé la porte d’un McDo comme on entre par effraction dans une banque la nuit, cagoulé et à la vitesse du chat (pourvu que personne ne m'ait vu!), et j’ai d’abord été confronté à des écrans tactiles géants (bonjour l’échange de bactéries avec nos index !), ayant remplacé un personnel humain à casquette en carton débitant un questionnaire derrière une caisse, je me souviens, et d’ailleurs ça stressait car il fallait commander fissa pronto, le dos à une file d'attente, que j’ai emporté non pas un, mais deux hamburgers : un big bacon et un autre dont j'ai oublié le nom, animé soudain d’une faim viscérale, physique oui (et irrationnelle) de hamburgers de chez McDonald’s, que je n’ai pas attendu une seconde (en plus ça refroidit volontairement vite), que j’en ai entamé un dans ma voiture avant de démarrer celle-ci, et que j’ai englouti les deux en un quart d’heure, une fois passée la cinquième vitesse sur une route de campagne (en m'en foutant un peu partout). Et bé... Je n’ai pas trouvé ça bon. Était-ce dû au savoir-faire relatif de cette franchise-là ? Je n’ai retrouvé aucune saveur, aucune sensation positive, rien. Puis, j’ai lu le bouquin de Pourquery entre les deux gares, et ce fut bien meilleur. Parvenu à destination, je racontai cette anecdote et commençai d’embêter mes amis en tentant de les intéresser au sujet de ma lecture toute chaude. Il me fut répondu : « Assieds-toi, la côte de bœuf maturée un mois est bleue comme tu l’aimes, c’est une Blonde d’Aquitaine, elle n’attend pas. Tu veux aussi son prénom ?.. »
 Voici un petit livre à l’insolence tranquille, au ton nonchalant qui fait penser à la voix de François Simon – c’est, comment dire... slow. Voilà. Diablement efficace. Et remarquablement écrit, précis, scrupuleux, ironique souvent, caustique aussi, acide parfois, vrai et semblable toujours. Lorsqu’on peut être soi-même l’objet, voire la cible d’un tel opuscule (nous pratiquons le métier d’explorer et noter tables, chambres, bouteilles, assiettes depuis 1987, même si l’on est un peu rangé des fourchettes, mais pas encore des verres), on se cale bien pour lire ce mini traité d’observation d’un microcosme, d’une petite tribu où chacun lorgne l’autre, le méprise ou le jalouse, le toise ou le peinturlure d’un onguent faux-cul. Tailler une plume, titre sibyllin pour qui connait l’argot, sous-titré croquons la critique gastronomique, signé par l’un de nos pairs, Stéphane Méjanès, est publié aux délicieuses éditions de l’épure de la gourmande libre, de l’hédoniste dans les grandes largeurs Sabine Bucquet-Grenet. 90 pages sans vitriol, composées comme une galerie de portraits, à la manière des Caractères de La Bruyère. Je vous récite le sommaire : la diva, le stakhanoviste, le pique-assiette, l’incognito, l’influenceur, le glouton, le blasé, le tyran, l’antique, l’ingénu. Il ne manque personne à l’appel. Ces portraits fictifs, car sans aucun doute échafaudés à partir d’une galerie de personnages-types, façon puzzle agrégé, sont tellement réels. Et avant tout savoureux, drôles, pertinents davantage qu'impertinents, car subtils, et pointus – ils piquent là où il faut. Côté style, nous avons annoté en marge pas mal d’images justes, de traits, de formules qui font mouche. Un petit régal, à l’instar du goût d’un blanc sur une fine appellation. Mesdames... L.M.
Voici un petit livre à l’insolence tranquille, au ton nonchalant qui fait penser à la voix de François Simon – c’est, comment dire... slow. Voilà. Diablement efficace. Et remarquablement écrit, précis, scrupuleux, ironique souvent, caustique aussi, acide parfois, vrai et semblable toujours. Lorsqu’on peut être soi-même l’objet, voire la cible d’un tel opuscule (nous pratiquons le métier d’explorer et noter tables, chambres, bouteilles, assiettes depuis 1987, même si l’on est un peu rangé des fourchettes, mais pas encore des verres), on se cale bien pour lire ce mini traité d’observation d’un microcosme, d’une petite tribu où chacun lorgne l’autre, le méprise ou le jalouse, le toise ou le peinturlure d’un onguent faux-cul. Tailler une plume, titre sibyllin pour qui connait l’argot, sous-titré croquons la critique gastronomique, signé par l’un de nos pairs, Stéphane Méjanès, est publié aux délicieuses éditions de l’épure de la gourmande libre, de l’hédoniste dans les grandes largeurs Sabine Bucquet-Grenet. 90 pages sans vitriol, composées comme une galerie de portraits, à la manière des Caractères de La Bruyère. Je vous récite le sommaire : la diva, le stakhanoviste, le pique-assiette, l’incognito, l’influenceur, le glouton, le blasé, le tyran, l’antique, l’ingénu. Il ne manque personne à l’appel. Ces portraits fictifs, car sans aucun doute échafaudés à partir d’une galerie de personnages-types, façon puzzle agrégé, sont tellement réels. Et avant tout savoureux, drôles, pertinents davantage qu'impertinents, car subtils, et pointus – ils piquent là où il faut. Côté style, nous avons annoté en marge pas mal d’images justes, de traits, de formules qui font mouche. Un petit régal, à l’instar du goût d’un blanc sur une fine appellation. Mesdames... L.M. Il n’y a pas de mauvais sujet. C’est ce que l’on répète au journaliste stagiaire faisant la fine bouche parce qu’on l’envoie couvrir un marronnier. C’est comme ça que le métier rentre, assène-t-on. A priori, mener une enquête très approfondie sur l’univers du fast-food, si l’on n’est pas un McDolescent attardé, en focalisant forcément celle-ci sur la gigantesque entreprise aux arches jaunes, peut sembler sinon suspect, au moins audacieux. Didier Pourquery, sans doute aficionado léger du petit pain rond et mou, régressif et transgressif, nocif parce qu’addictif, l’a menée car il souhaitait le faire depuis longtemps, lui qui dévora avec plaisir son premier hamburger-frites à l’âge de 17 ans, en 1971, et pas n’importe où : dans un Dairy Queen Brazier de Chicago. Ça marque. Et nous lisons, grâce à son talent narratif, un essai comme on lit une (belle) histoire avec des personnages, tout ça. Découpée en tranches, l’étude : historique, sociologique (les rites), géographique, économique bien sûr, et aussi sur le plan capital de la nutrition (ça nuit grave !), celui de la mode (comment ça mute ?), et enfin sous l’angle du mauvais esprit, confesse d’emblée l’auteur. Mais l’analyse est totalement sérieuse, d’une précision d’horloger genevois, gavée de références, c’est bien sourcé comme on dit, c’est drôle souvent, et l’on sent le journaliste scrupuleux glissant tantôt vers l’aveu culpabilisant (j’aime ça), tantôt vers l’affirmation dédouanante (c’est vraiment dégueu, tant le système précis mis en place pour « piéger » le consommateur, quelle que soit sa culture, que la charge en lipides et en glucides de tout hamburger-frites). Grâce à plusieurs brassées de chiffres, de statistiques, nous apprenons énormément de choses sur l’univers, la grosse machine dissimulée sous ce « simulacre de repas ». Pourquery se réfère immédiatement au chapitre des « Mythologies » de Roland Barthes (1961) consacré au bifteck-frites (*). L’emblématique plat français, en terre de gastronomie, qui résonnait « sang », a depuis longtemps été détrôné par le hamburger, lequel résonne « sans » : bientôt sans viande, sans bœuf, sans personnel humain... 1961 voit aussi l’apparition des restaurants de fast-food Wimpy, en écho à Popeye, dont le personnage goinfre nommé Gontran dans l’adaptation française, ami de Popeye, se nomme J. Wellington Wimpy. C’est le premier addict aux hamburgers. Jacques Borel, célèbre pour les restauroutes, ouvrit cette année-là le premier Wimpy français. En 1972, le premier McDonald’s de France ouvre à Créteil. Depuis, on en compte 1 300 au pays du foie gras et des grands crus classés, et la filiale française est la plus rentable au monde derrière le réseau US. Déroutante France. C’est le French paradox... Le bouquin de Didier Pourquery devient captivant au fil des pages, car outre l’histoire des KFC, Burger King, Freetime (souvenez-vous de Christophe Salengro disant : my teinturier is rich), et autres concurrents du géant McDo et ses 37 000 « restaurants », la préhistoire du hamburger (Hambourg), l’histoire du steack haché, l’idée de le placer entre deux tranches de pain, jusqu’à la Hamburger University, « le Princeton du fast-food » qui a déjà form(at)é 80 000 managers de McDo, dans les veines desquels on est en droit de se demander si ce n’est pas du ketchup qui circule, il y a le décodage sociologique et psychologique de l’acte de se rendre dans un fast-food et d’y consommer, auquel se livre l’auteur avec un savoir et un tact qui emporte le lecteur. Il est question d’« expérience » pour désigner ces actes, de la « production d’une histoire comestible plus que d’une nourriture concrète ». Chacun sait que c’est de la junk-food, soit de la malbouffe, mais nous savons que les horribles photos qui ornent les paquets de cigarettes n’empêchent pas davantage le fumeur de tirer sur sa clope (12 millions de décès dans le monde dus à la malbouffe, contre 7 millions au tabac en 2015. Quand même...). Cela m’évoque les épouvantails dans les champs sur lesquels se posent les oiseaux... L'efficacité des firmes de fast-food est vraiment redoutable. Pourquery s’attarde à juste titre sur des petites choses, comme ça, qui relèvent du rite : manger – forcément - avec ses mains, piquer une frite sur le plateau avant de s’asseoir, puis dans le plateau de l'autre, cette lenteur que nous craignons, et notre impatience qui monte comme du lait dans la casserole lorsque la commande n’arrive pas dans la seconde, les néo-burgers revisitant aujourd’hui le mythe et le simulacre en même temps, en tentant de « purifier » tout ça. L’archétype étant la petite chaîne tellement friendly Big Fernand. Le moment le plus tragique peut-être est cet article de Lorraine de Foucher paru dans Le Monde du 2 novembre 2018, intitulé « Le McDo a remplacé le café du village », cité par Didier Pourquery. Ce papier m'avait alerté. Le mot village y est un peu exagéré, car la chaîne ne s’installe pas encore dans de petits bleds désormais dépourvus d’école, d’épicerie fourre-tout, où un office mensuel est célébré à l’église, et où le dernier bar, en fermant définitivement sa porte, sonne le glas de la dernière possibilité de se retrouver, d’être encore socialisés, ensemble – au moins entre hommes, comme dans le baitemannageo, ou « maison des hommes » bâti au centre de chaque village Bororo, et décrit par Claude Lévi-Strauss dans « Tristes Tropiques » (Plon/Terre Humaine, page 248). Mais force est d’admettre que dans des bourgs et des villes de petite taille, lorsqu’un McDo ouvre, c’est un peu de vie qui revient... dans un cadre particulier. Reste que cette « Histoire de hamburger-frites » sous-titrée « comment un simulacre de repas a-t-il séduit le monde entier ? » se lit comme on boit un demi un jour de canicule, ou comme on dévore un Big Mac. L.M.
Il n’y a pas de mauvais sujet. C’est ce que l’on répète au journaliste stagiaire faisant la fine bouche parce qu’on l’envoie couvrir un marronnier. C’est comme ça que le métier rentre, assène-t-on. A priori, mener une enquête très approfondie sur l’univers du fast-food, si l’on n’est pas un McDolescent attardé, en focalisant forcément celle-ci sur la gigantesque entreprise aux arches jaunes, peut sembler sinon suspect, au moins audacieux. Didier Pourquery, sans doute aficionado léger du petit pain rond et mou, régressif et transgressif, nocif parce qu’addictif, l’a menée car il souhaitait le faire depuis longtemps, lui qui dévora avec plaisir son premier hamburger-frites à l’âge de 17 ans, en 1971, et pas n’importe où : dans un Dairy Queen Brazier de Chicago. Ça marque. Et nous lisons, grâce à son talent narratif, un essai comme on lit une (belle) histoire avec des personnages, tout ça. Découpée en tranches, l’étude : historique, sociologique (les rites), géographique, économique bien sûr, et aussi sur le plan capital de la nutrition (ça nuit grave !), celui de la mode (comment ça mute ?), et enfin sous l’angle du mauvais esprit, confesse d’emblée l’auteur. Mais l’analyse est totalement sérieuse, d’une précision d’horloger genevois, gavée de références, c’est bien sourcé comme on dit, c’est drôle souvent, et l’on sent le journaliste scrupuleux glissant tantôt vers l’aveu culpabilisant (j’aime ça), tantôt vers l’affirmation dédouanante (c’est vraiment dégueu, tant le système précis mis en place pour « piéger » le consommateur, quelle que soit sa culture, que la charge en lipides et en glucides de tout hamburger-frites). Grâce à plusieurs brassées de chiffres, de statistiques, nous apprenons énormément de choses sur l’univers, la grosse machine dissimulée sous ce « simulacre de repas ». Pourquery se réfère immédiatement au chapitre des « Mythologies » de Roland Barthes (1961) consacré au bifteck-frites (*). L’emblématique plat français, en terre de gastronomie, qui résonnait « sang », a depuis longtemps été détrôné par le hamburger, lequel résonne « sans » : bientôt sans viande, sans bœuf, sans personnel humain... 1961 voit aussi l’apparition des restaurants de fast-food Wimpy, en écho à Popeye, dont le personnage goinfre nommé Gontran dans l’adaptation française, ami de Popeye, se nomme J. Wellington Wimpy. C’est le premier addict aux hamburgers. Jacques Borel, célèbre pour les restauroutes, ouvrit cette année-là le premier Wimpy français. En 1972, le premier McDonald’s de France ouvre à Créteil. Depuis, on en compte 1 300 au pays du foie gras et des grands crus classés, et la filiale française est la plus rentable au monde derrière le réseau US. Déroutante France. C’est le French paradox... Le bouquin de Didier Pourquery devient captivant au fil des pages, car outre l’histoire des KFC, Burger King, Freetime (souvenez-vous de Christophe Salengro disant : my teinturier is rich), et autres concurrents du géant McDo et ses 37 000 « restaurants », la préhistoire du hamburger (Hambourg), l’histoire du steack haché, l’idée de le placer entre deux tranches de pain, jusqu’à la Hamburger University, « le Princeton du fast-food » qui a déjà form(at)é 80 000 managers de McDo, dans les veines desquels on est en droit de se demander si ce n’est pas du ketchup qui circule, il y a le décodage sociologique et psychologique de l’acte de se rendre dans un fast-food et d’y consommer, auquel se livre l’auteur avec un savoir et un tact qui emporte le lecteur. Il est question d’« expérience » pour désigner ces actes, de la « production d’une histoire comestible plus que d’une nourriture concrète ». Chacun sait que c’est de la junk-food, soit de la malbouffe, mais nous savons que les horribles photos qui ornent les paquets de cigarettes n’empêchent pas davantage le fumeur de tirer sur sa clope (12 millions de décès dans le monde dus à la malbouffe, contre 7 millions au tabac en 2015. Quand même...). Cela m’évoque les épouvantails dans les champs sur lesquels se posent les oiseaux... L'efficacité des firmes de fast-food est vraiment redoutable. Pourquery s’attarde à juste titre sur des petites choses, comme ça, qui relèvent du rite : manger – forcément - avec ses mains, piquer une frite sur le plateau avant de s’asseoir, puis dans le plateau de l'autre, cette lenteur que nous craignons, et notre impatience qui monte comme du lait dans la casserole lorsque la commande n’arrive pas dans la seconde, les néo-burgers revisitant aujourd’hui le mythe et le simulacre en même temps, en tentant de « purifier » tout ça. L’archétype étant la petite chaîne tellement friendly Big Fernand. Le moment le plus tragique peut-être est cet article de Lorraine de Foucher paru dans Le Monde du 2 novembre 2018, intitulé « Le McDo a remplacé le café du village », cité par Didier Pourquery. Ce papier m'avait alerté. Le mot village y est un peu exagéré, car la chaîne ne s’installe pas encore dans de petits bleds désormais dépourvus d’école, d’épicerie fourre-tout, où un office mensuel est célébré à l’église, et où le dernier bar, en fermant définitivement sa porte, sonne le glas de la dernière possibilité de se retrouver, d’être encore socialisés, ensemble – au moins entre hommes, comme dans le baitemannageo, ou « maison des hommes » bâti au centre de chaque village Bororo, et décrit par Claude Lévi-Strauss dans « Tristes Tropiques » (Plon/Terre Humaine, page 248). Mais force est d’admettre que dans des bourgs et des villes de petite taille, lorsqu’un McDo ouvre, c’est un peu de vie qui revient... dans un cadre particulier. Reste que cette « Histoire de hamburger-frites » sous-titrée « comment un simulacre de repas a-t-il séduit le monde entier ? » se lit comme on boit un demi un jour de canicule, ou comme on dévore un Big Mac. L.M. Splendide Moulin-à-Vent AOC, le Domaine de la Tour de Bief 2018, un 100% gamay d’une pureté inouïe, due peut-être à son élevage exclusif en cuves. C’est mûr, puissant sans être agressif, suave même. Il fut dégusté seul, pour lui-même. Signe d’une autosuffisance rare et permettant la concentration.
Splendide Moulin-à-Vent AOC, le Domaine de la Tour de Bief 2018, un 100% gamay d’une pureté inouïe, due peut-être à son élevage exclusif en cuves. C’est mûr, puissant sans être agressif, suave même. Il fut dégusté seul, pour lui-même. Signe d’une autosuffisance rare et permettant la concentration.
 une chiffonnade de jambon de Parme, L’Absolu 2018, en AOC Bordeaux rosé, issu de merlot et de cabernet-sauvignon, avec son nez discret de fraise, sa bouche d’un bel équilibre, sans acidité, le disputait - en qualité -, avec C’est la vie! 2018, AOC Bordeaux blanc, de la même famille Rochet. Cette cuvée quasi confidentielle (2 000 cols), est issue de sémillon à 100%. Son habillage moderne est rigolo (une 2CV sur papier craft, et un stop-gouttes détachable offert en guise de collerette, des plus élégants). Le vin s’affirme par un nez agréable de pêche blanche, de raisin croquant, et avec une bouche qui ne manque pas de vivacité. Le tartare de thon à l’huile d’olive vierge, à peine citronné, lui alla comme un gant.
une chiffonnade de jambon de Parme, L’Absolu 2018, en AOC Bordeaux rosé, issu de merlot et de cabernet-sauvignon, avec son nez discret de fraise, sa bouche d’un bel équilibre, sans acidité, le disputait - en qualité -, avec C’est la vie! 2018, AOC Bordeaux blanc, de la même famille Rochet. Cette cuvée quasi confidentielle (2 000 cols), est issue de sémillon à 100%. Son habillage moderne est rigolo (une 2CV sur papier craft, et un stop-gouttes détachable offert en guise de collerette, des plus élégants). Le vin s’affirme par un nez agréable de pêche blanche, de raisin croquant, et avec une bouche qui ne manque pas de vivacité. Le tartare de thon à l’huile d’olive vierge, à peine citronné, lui alla comme un gant. À Sancerre, la Famille Bourgeois propose son fleuron, La Bourgeoise, dans le millésime 2016. Ce 100% pinot noir est d’une finesse et d’une douceur remarquables. Robe profonde, nez de fruits noirs, rouges et légèrement épicé, frais et ample en bouche, avec une note minérale qui rappelle le terroir de silex où naissent ses vignes, ainsi qu’une touche vanillée due à l’élevage en fûts d’environ une année. Idéal sur une belle entrecôte de bœuf saisie à la plancha.
À Sancerre, la Famille Bourgeois propose son fleuron, La Bourgeoise, dans le millésime 2016. Ce 100% pinot noir est d’une finesse et d’une douceur remarquables. Robe profonde, nez de fruits noirs, rouges et légèrement épicé, frais et ample en bouche, avec une note minérale qui rappelle le terroir de silex où naissent ses vignes, ainsi qu’une touche vanillée due à l’élevage en fûts d’environ une année. Idéal sur une belle entrecôte de bœuf saisie à la plancha. propose, au sein de sa Grande Réserve, une production limitée, parcellaire, du Domaine Guenault, propriété historique sise à Saint-Georges-sur-Cher. Baptisée Confidences, cette cuvée 2018 est un 100% sauvignon blanc aux arômes délicats d’agrumes, de foin fraîchement coupé et des notes légères de cassis. Formidable sur les fromages des 48 chèvres, frais et moelleux, du Bois Buisson, de Véronique Quinet, à Courgeout (61), qui travaille seule et à qui nous tirons notre béret.
propose, au sein de sa Grande Réserve, une production limitée, parcellaire, du Domaine Guenault, propriété historique sise à Saint-Georges-sur-Cher. Baptisée Confidences, cette cuvée 2018 est un 100% sauvignon blanc aux arômes délicats d’agrumes, de foin fraîchement coupé et des notes légères de cassis. Formidable sur les fromages des 48 chèvres, frais et moelleux, du Bois Buisson, de Véronique Quinet, à Courgeout (61), qui travaille seule et à qui nous tirons notre béret. La Grande Chevalerie du château La Varière, issu à 100% de cabernet-sauvignon d’une belle maturité, et offrant ainsi une complexité aromatique que l’on peut attribuer aussi au passage d’un an « sous bois ». Un flacon sérieux signé Jacques Beaujeau, à la robe profonde, au nez de mûre et de cassis, légèrement vanillé, et une bouche intense avec des notes torréfiées et cacaotées. Puissant et souple à la fois. Un vrai vin de garde, à tester en saison avec du gibier à poil. L.M.
La Grande Chevalerie du château La Varière, issu à 100% de cabernet-sauvignon d’une belle maturité, et offrant ainsi une complexité aromatique que l’on peut attribuer aussi au passage d’un an « sous bois ». Un flacon sérieux signé Jacques Beaujeau, à la robe profonde, au nez de mûre et de cassis, légèrement vanillé, et une bouche intense avec des notes torréfiées et cacaotées. Puissant et souple à la fois. Un vrai vin de garde, à tester en saison avec du gibier à poil. L.M.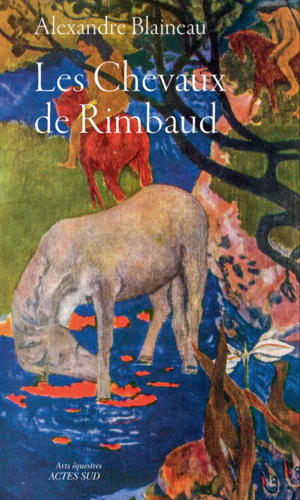 Nous avions beaucoup aimé Montaigne à cheval (Points/Seuil), du regretté Jean Lacouture, car le livre caracolait et nous montrait un Montaigne toujours en selle, avide d’en découdre avec la découverte du monde qui l’entourait, du Périgord à l’Italie. Voici Les Chevaux de Rimbaud, d’Alexandre Blaineau, un spécialiste de la littérature équestre (Actes Sud, en librairie le 4 septembre), bouquin captivant qui dévoile un Voyant méconnu, et qui n’aima rien comme chevaucher, lui aussi. Nous l’imaginions exclusivement marcheur, picoté par les blés, foulant l’herbe ardennaise menue... Il monta pourtant abondamment, dans la seconde partie de sa vie. À Chypre, et surtout dans l’Afrique orientale qu’il aima et qui l’aimât tant. Le désert Somali qu’il traverse durant vingt jours le cul sur une selle, Harar bien sûr, et durablement, où il fit commerce (et se laissa photographier une fois), l’immense plateau de Boubassa, les rives de la mer Rouge, Barr-Adjam, Aden, le Yémen entier le virent aller l’amble, trottant, galopant, (se) fuyant peut-être ; sans doute... Rimbaud l’Abyssin fut ainsi, et aussi, un homme aux chevaux de vent. Semelles dans les étriers. Par bonheur sans plomb dans la cervelle. Nous l’imaginons alors comme un second Lawrence d’Arabie, la tête enveloppée d’un chech blanc crème, les paupières poussiéreuses, la peau cuivrée, tannée, la gorge sèche comme un oued en août, le regard bleu peut-être. Qui peut me dire quelle fut la couleur des yeux d’Arthur, car j’ai égaré le 06 de Verlaine ? Le « marchand cavalier » qui désespère les mauvaises récoltes de café et menace cent fois d’acheter un cheval et de (re)foutre le camp, celui qui cherche un beau jour à faire l’acquisition de quatre baudets étalons, qui écrit à sa famille de taiseux (son frère Frédéric, alcoolo, l’était plus que les autres), le 25 février 1890, « Il faut se taire », est infiniment touchant dans sa vie orientale narrée ici avec talent et précision, comme à chaque page, vers, mot d’Une Saison en Enfer. En refermant ce livre érudit, captivant, nourri d’histoires et de recherches pointues sur un Rimbaud « exilé fictif », ayant dans le regard l’expression du « défi résigné », ses longues jambes, ses bras ballants (rien de commun avec Jack Kerouac, quoique d’aucuns soient tentés de...), ce livre citant avec plaisir Thomas Mayne Reid, le père du roman d’aventures façon western, méconnu hélas, ce livre qui nous rappelle ceux du rimbaldien absolu, shooté aux Illuminations Alain Borer (en particulier son Rimbaud en Abyssinie), il devient impossible de ne pas trouver en chaque cheval aperçu un rien, un brin rimbaldien, de ressentir autrement les mouvements de sa crinière comme ceux de son « épaule qui frissonne sans cause » dit Julien Gracq dans Liberté grande, et de voir en chaque cavalier croisé désormais un nomade, impatient comme un orage désiré, allant en avant, calme et... en zigzag vers la mer, ou n’importe quoi, voire l’éternité, té!.. L.M.
Nous avions beaucoup aimé Montaigne à cheval (Points/Seuil), du regretté Jean Lacouture, car le livre caracolait et nous montrait un Montaigne toujours en selle, avide d’en découdre avec la découverte du monde qui l’entourait, du Périgord à l’Italie. Voici Les Chevaux de Rimbaud, d’Alexandre Blaineau, un spécialiste de la littérature équestre (Actes Sud, en librairie le 4 septembre), bouquin captivant qui dévoile un Voyant méconnu, et qui n’aima rien comme chevaucher, lui aussi. Nous l’imaginions exclusivement marcheur, picoté par les blés, foulant l’herbe ardennaise menue... Il monta pourtant abondamment, dans la seconde partie de sa vie. À Chypre, et surtout dans l’Afrique orientale qu’il aima et qui l’aimât tant. Le désert Somali qu’il traverse durant vingt jours le cul sur une selle, Harar bien sûr, et durablement, où il fit commerce (et se laissa photographier une fois), l’immense plateau de Boubassa, les rives de la mer Rouge, Barr-Adjam, Aden, le Yémen entier le virent aller l’amble, trottant, galopant, (se) fuyant peut-être ; sans doute... Rimbaud l’Abyssin fut ainsi, et aussi, un homme aux chevaux de vent. Semelles dans les étriers. Par bonheur sans plomb dans la cervelle. Nous l’imaginons alors comme un second Lawrence d’Arabie, la tête enveloppée d’un chech blanc crème, les paupières poussiéreuses, la peau cuivrée, tannée, la gorge sèche comme un oued en août, le regard bleu peut-être. Qui peut me dire quelle fut la couleur des yeux d’Arthur, car j’ai égaré le 06 de Verlaine ? Le « marchand cavalier » qui désespère les mauvaises récoltes de café et menace cent fois d’acheter un cheval et de (re)foutre le camp, celui qui cherche un beau jour à faire l’acquisition de quatre baudets étalons, qui écrit à sa famille de taiseux (son frère Frédéric, alcoolo, l’était plus que les autres), le 25 février 1890, « Il faut se taire », est infiniment touchant dans sa vie orientale narrée ici avec talent et précision, comme à chaque page, vers, mot d’Une Saison en Enfer. En refermant ce livre érudit, captivant, nourri d’histoires et de recherches pointues sur un Rimbaud « exilé fictif », ayant dans le regard l’expression du « défi résigné », ses longues jambes, ses bras ballants (rien de commun avec Jack Kerouac, quoique d’aucuns soient tentés de...), ce livre citant avec plaisir Thomas Mayne Reid, le père du roman d’aventures façon western, méconnu hélas, ce livre qui nous rappelle ceux du rimbaldien absolu, shooté aux Illuminations Alain Borer (en particulier son Rimbaud en Abyssinie), il devient impossible de ne pas trouver en chaque cheval aperçu un rien, un brin rimbaldien, de ressentir autrement les mouvements de sa crinière comme ceux de son « épaule qui frissonne sans cause » dit Julien Gracq dans Liberté grande, et de voir en chaque cavalier croisé désormais un nomade, impatient comme un orage désiré, allant en avant, calme et... en zigzag vers la mer, ou n’importe quoi, voire l’éternité, té!.. L.M.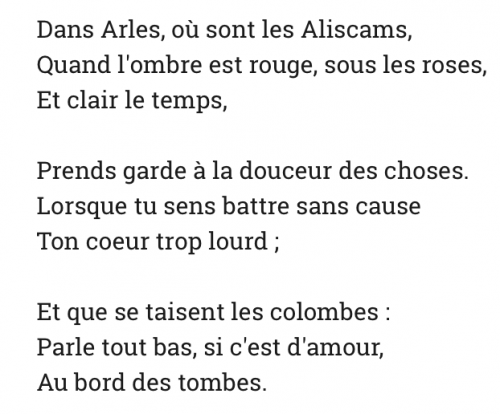
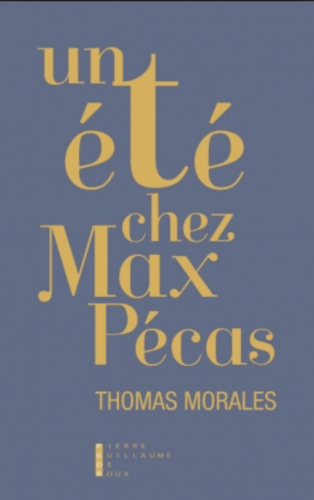




 incomparable, mais hélas éphémère : dépêchez-vous donc de le déboucher. Robe claire et brillante, nez de mirabelle et de pêche blanche. Bouche souple puis intense, tendue même en finale, comme souvent avec les chardonnays de cette zone d’élection originelle. Flacon formidable en compagnie d’une bourriche d’huîtres de chez l'ami Joël Dupuch, et de quelques tourteaux (sans mayo !).
incomparable, mais hélas éphémère : dépêchez-vous donc de le déboucher. Robe claire et brillante, nez de mirabelle et de pêche blanche. Bouche souple puis intense, tendue même en finale, comme souvent avec les chardonnays de cette zone d’élection originelle. Flacon formidable en compagnie d’une bourriche d’huîtres de chez l'ami Joël Dupuch, et de quelques tourteaux (sans mayo !).
 domaine Laroche, de la superbe cuvée Saint-Martin 2018 (certifié HVE niveau 3 : le must! env. 20€), et son beau flacon, d'une grande fraîcheur, d'une très belle minéralité (typique avec les beaunnois, ou chardonnays, de ce terroir), et d'une force contenue en finale des plus agréables. Robe pâle à reflets bleutés. Nez crayeux, puis subtil de fleurs blanches, de beurre frais, avec une note de pomme. Bouche légèrement boisée (cèdre, sous-bois), voire toastée en finale. Superbe à avec de l'iode à pleines mains : vite, un plateau de fruits de mer!
domaine Laroche, de la superbe cuvée Saint-Martin 2018 (certifié HVE niveau 3 : le must! env. 20€), et son beau flacon, d'une grande fraîcheur, d'une très belle minéralité (typique avec les beaunnois, ou chardonnays, de ce terroir), et d'une force contenue en finale des plus agréables. Robe pâle à reflets bleutés. Nez crayeux, puis subtil de fleurs blanches, de beurre frais, avec une note de pomme. Bouche légèrement boisée (cèdre, sous-bois), voire toastée en finale. Superbe à avec de l'iode à pleines mains : vite, un plateau de fruits de mer!





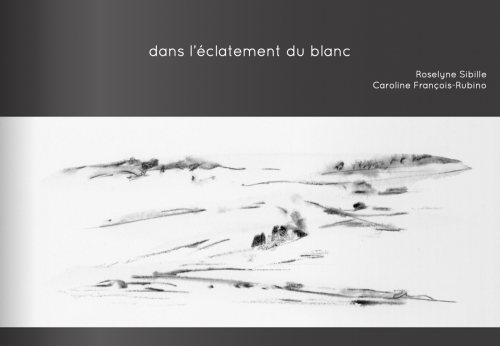


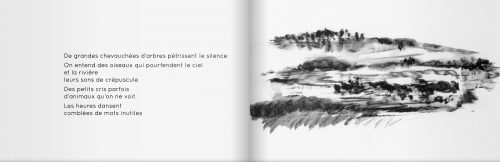
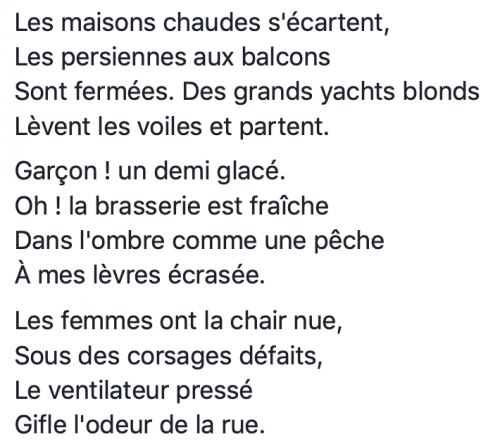
 Ce sont des flacons aux noms qui résonnent jusqu’au point d’orgue car ils sont longs en bouche, et évoquent une musique, ou la musique.
Ce sont des flacons aux noms qui résonnent jusqu’au point d’orgue car ils sont longs en bouche, et évoquent une musique, ou la musique.  Carcastel, en appellation Fitou (où les progrès techniques hissent les vins depuis quelques années). C’est gourmand, racé, présent en bouche (carignan, grenache) et d’une généreuse fraîcheur. À partager « à la tiède », escorté de charcuterie, pieds nus dans l’herbe.
Carcastel, en appellation Fitou (où les progrès techniques hissent les vins depuis quelques années). C’est gourmand, racé, présent en bouche (carignan, grenache) et d’une généreuse fraîcheur. À partager « à la tiède », escorté de charcuterie, pieds nus dans l’herbe. 13€), envoûtant Chignin-bergeron (Savoie). 100% roussanne d'une teneur, d'une présence, et d'une complexité aromatique confondante. C'est généreux, la robe d'or à reflets cuivrés en impose, acacia, abricot mûr, léger réglissé au nez, amplitude et suavité en bouche. Persistant. Musical. Magnifique!
13€), envoûtant Chignin-bergeron (Savoie). 100% roussanne d'une teneur, d'une présence, et d'une complexité aromatique confondante. C'est généreux, la robe d'or à reflets cuivrés en impose, acacia, abricot mûr, léger réglissé au nez, amplitude et suavité en bouche. Persistant. Musical. Magnifique! Il y a C’est pas du pipeau (blanc, 2018, 21€), superbe Collioure du domaine Coume del Mas (Banyuls), à l'étiquette chatoyante. Vermentino et roussanne s’y donnent à cœur joie, en bouche, et c’est fort agréable avec un poulet yassa.
Il y a C’est pas du pipeau (blanc, 2018, 21€), superbe Collioure du domaine Coume del Mas (Banyuls), à l'étiquette chatoyante. Vermentino et roussanne s’y donnent à cœur joie, en bouche, et c’est fort agréable avec un poulet yassa.  Vous pensez encore que les rosés sont de faux vins ? Certains sont splendides, surtout en Provence du côté des Baux, des coteaux d’Aix, dans le grand maquis des Côtes-de-Provence en allant à La Londe, ou en se dirigeant vers Sainte-Victoire, du côté de Cassis, de Tavel, de Bandol bien sûr, de la presqu’île de Saint-Tropez, en appellation Palette, en Corse, mais aussi en Loire, dans le Sud-Ouest, sans oublier quelques clairets bordelais. Cela ne fait plus de doute car les progrès ont été considérables en quelques années et l'augmentation de la qualité est bien réelle.
Vous pensez encore que les rosés sont de faux vins ? Certains sont splendides, surtout en Provence du côté des Baux, des coteaux d’Aix, dans le grand maquis des Côtes-de-Provence en allant à La Londe, ou en se dirigeant vers Sainte-Victoire, du côté de Cassis, de Tavel, de Bandol bien sûr, de la presqu’île de Saint-Tropez, en appellation Palette, en Corse, mais aussi en Loire, dans le Sud-Ouest, sans oublier quelques clairets bordelais. Cela ne fait plus de doute car les progrès ont été considérables en quelques années et l'augmentation de la qualité est bien réelle.  cuvée Classique (10€), reconnaissable à la forme de sa bouteille, est somptueuse de délicatesse et de suavité, avec de jolis arômes de reine-claude. C’est un rosé aérien et gastronomique (de tout un repas).
cuvée Classique (10€), reconnaissable à la forme de sa bouteille, est somptueuse de délicatesse et de suavité, avec de jolis arômes de reine-claude. C’est un rosé aérien et gastronomique (de tout un repas).  car il s'agit d'un rosé plus floral que fruité, enchanteur, d’une force soutenue face à une grillade saignante, et doté d'une séduisante minéralité en fin de bouche.
car il s'agit d'un rosé plus floral que fruité, enchanteur, d’une force soutenue face à une grillade saignante, et doté d'une séduisante minéralité en fin de bouche. 



