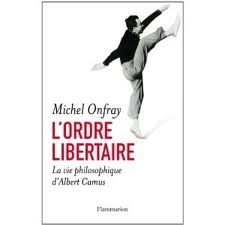 Onfray a des ennemis et j’aime ce qu’il écrit, donc je n'aime guère ses ennemis. Certes, il se répète beaucoup, à l’envi, comme un distributeur de litanies, dans le présent livre aussi, et si je me livrais à un exercice journalistique classique, celui du SR (secrétaire de rédaction), je saisirais les ciseaux de Sainte-Anastase et je taillerai là-dedans, je veux dire dans son dernier gros opus : « L’Ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert Camus » (Flammarion) pour ôter environ 150 pages de redondances aux 600 que j’ai cependant dévorées avec un immense plaisir et sans en sauter une demi-ligne.
Onfray a des ennemis et j’aime ce qu’il écrit, donc je n'aime guère ses ennemis. Certes, il se répète beaucoup, à l’envi, comme un distributeur de litanies, dans le présent livre aussi, et si je me livrais à un exercice journalistique classique, celui du SR (secrétaire de rédaction), je saisirais les ciseaux de Sainte-Anastase et je taillerai là-dedans, je veux dire dans son dernier gros opus : « L’Ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert Camus » (Flammarion) pour ôter environ 150 pages de redondances aux 600 que j’ai cependant dévorées avec un immense plaisir et sans en sauter une demi-ligne.
C’est un grand livre. Certes un chouia hagiographique, certes un poil anti-sartrien bichrome (c’est black or white), voire manichéen par endroits, avec force flot de citations à charge. Certes c’est également une espèce d’autobiographie (Nietzsche : « Toute philosophie constitue une autobiographie masquée ») :
PARALLÈLES
Camus et Onfray ont, il faut le préciser, un parcours comparable. Mêmes origines sociales -pauvres-, même mépris pour les paillettes germanopratines, mêmes inspirations nietzschéennes, voire gramsciennes (pas convaincu par le chapitre ad hoc, et je pense bien connaître mon Gramsci), même énergie solaire (sauf que Onfray n’est pas Méditerranéen, que l’on sache), même accueil par une certaine dictature du savoir et du pouvoir éditorial (laquelle vire peu à peu à l’endogamie mentale à force de manquer d’air –mais c’est tant pis pour elle. Même cette civilisation, par ailleurs mortifère, est mortelle!).
Même destinée libertaire aussi, voire anarchiste… Onfray n’a pas publié de fictions comme Camus, cependant. Et nous savons, à la lumière de cet essai brillant, combien « Noces », « L’Eté », « La Peste », « La chute », « L’Exil et le Royaume », etc., contiennent dans leur ventre une portée philosophique, à côté de laquelle nous étions passés jusque là, en nous attachant exclusivement à la prose sensuelle, solaire, méditerranéenne, hédoniste, algérienne, salée, profondément libre de notre Camus préféré. (Relire aussitôt « Noces », et « L’Eté », au sortir de la bio d’Onfray, fut un bonheur frais et comme neuf : garanti pièces et main d’oeuvre).
OBSCURES RANCOEURS
Mais il s’agit d’abord d’une biographie philosophique. Après avoir flingué Freud à la mitrailleuse lourde (« Le crépuscule d’une idole », Grasset), voici Michel Onfray en verve pour réhabiliter, car cela semblait nécessaire, le Camus philosophe pour classe d’agrég. (et non pas pour classes Terminales, pour paraphraser le titre d’un pamphlet qui m’opposa constamment à son auteur et ami, feu Jean-Jacques Brochier).
L’Ordre libertaire est un grand bouquin parce qu’il règle les comptes avec une certaine société parisienne nombriliste, étriquée, auto-intelligentisalisée et propriétaire (putschiste) du droit de dire, de publier, de faire et de défaire, mais dans un cercle tellement restreint qu’il semble (à le renifler et tant il est nauséabond au fil du temps), avoir oublié les structures élémentaires de la parenté. Autrement dit, la prohibition (métaphysique) de l’inceste (mental) ne semble pas avoir cours dans ce marigot-là. La suffisance semble gouverner sa morgue. Ainsi que la reproduction entre soi, façon « Les héritiers » selon Bourdieu & Passeron.
Du coup, Albert Camus le pied-noir, fils d’un père ouvrier mort au front en 14 et d’une mère analphabète (elle n'a jamais lu son fils!), n’ayant fait ni "H. IV", ni Ulm (Normale Sup), ne fait pas partie du Club Mickey, donc du sérail, de la famille bourgeoise bien-pensante. D’où leur haine, leur jalousie lorsque l’auteur de « L’étranger » obtint le Nobel en 57 (« Devant ma mère, je sens que je suis d’une race noble : celle qui n’envie rien », in « Le Premier homme »). Entre autres exemples.
Sur cet aspect de l’homme et du ressentiment parisien, Onfray excelle. Nous sentons un Camus décidé à ne pas s’approcher trop près de ces virus, qui préfère la compagnie de l'ami absolu et total, René Char, et la perspective de vivre à Lourmarin (où il repose d’ailleurs) plutôt que rue de Chanaleilles, même si c’était bien, le temps passé là-bas.
UN HOMME SIMPLE ET SOLAIRE
Ce qui séduit d’emblée dans le livre d’Onfray, c’est de retrouver un Camus absolument solaire (et c’est la première fois que je lis cela, car ni Emmanuel Roblès pourtant, ni José Lenzini, et même Frédéric Musso, ni Morvan Lebesque, ni Abdelkader Djemaï, ni Jean Daniel, Jean Grenier à peine, Macha Séry un tout petit peu, n'étaient parvenus à retranscrire cela avec autant de talent et d’exactitude), un Camus résolument hédoniste et tout entier tourné vers la sensualité de la vie intellectuelle, avec le corps et l’esprit.
Onfray fait de Camus un Zarathoustra venu d’Algérie. Et le prouve (le bonhomme connaît son Nietzsche sur le bout des doigts), mais on pourrait être tenté de lui reprocher de forcer le trait pour nous persuader de ses convictions. C’est le jeu. On le joue.
Plus intéressante est la manière dont Onfray souligne l’attachement inaliénable de Camus à la pauvreté dont il est issu et qui l’a forgé (les livres lui furent une conquête et pas un héritage, comme cela fut le cas pour un Sartre), ainsi qu'aux humiliés, aux taiseux comme sa mère, et donc au courage, à la noblesse humaine la plus nue, à la loyauté, au courage d’être un homme, au sens de l’honneur, à la dignité de son modeste rang ; à la philosophie d’une morale vraie, en somme.
UNE BIO EN EMPATHIE
Avec ce livre, nous sommes loin des gros pavés qui font autorité, comme le Herbert R. Lottman (monumentale enquête biographique à l’anglo-saxonne, irréprochable, totale, et d’une précision d’horloger genevois croisé avec une entomologiste teutonne), ou le Todd (Olivier), que j’aime moins, mais passons. Ici, avec Onfray, tout fait bonheur, poésie, liberté, détachement, regard vers le soleil les yeux ouverts, appel à Diogène et volonté de jouissance…
Onfray combat la légende : Non, Camus n’est pas un philosophe pour futurs bacheliers, ni un romancier à la prose douce et facile. Oui, Camus est un philosophe profond dans ses essais fameux comme « L’homme révolté » et dans ses œuvres de fiction. Oui, Camus est un anticolonialiste engagé mais mesuré, singulièrement consensuel dans une époque radicale (« la radicalité de la nuance », c’est de lui, et je n’ai pas retrouvé la formule dans le livre d'Onfray).
Oui Camus est un païen pragmatique, un homme droit qui se souvient de l’unique leçon de son père disparu trop tôt : « un homme, ça s’empêche ». C'est encore un homme fidèle aux siens –même contre la Justice. Fidèle à sa mère d’abord, fidèle à son instituteur Louis Germain (le « Discours de Suède » rappelle cela avec superbe) fidèle à cet espèce de père de substitution.
Fidèle aussi au maître absolu que fut Jean Grenier, son prof de philo et auteur des « Îles » et de « Inspirations méditerranéennes », qui lui fit lire aussi « La douleur », d’André de Richaud, lecture décisive. Mais avant tout parce que le professeur Grenier déclencha en Camus le désir d’écrire!..
Camus est un disciple du « Gai savoir » et du précepte nietzschéen fameux : « Deviens celui que tu es », il est un homme qui ne cessera de faire savoir qu’il faut faire en sorte que ne doivent exister ni bourreau, ni victime.
AU-DELA DU BAEDEKER
Bien sûr, il est aussi question dans ce livre de Belcourt, d'Alger, de la tuberculose à dix-sept ans, des femmes, du séducteur, de son look Bogart, des clopes, de Maria Casarès, du foot, du théâtre, de Francine après Hélène, d'« Alger Républicain », de « Combat », de Paris, de l’accident fatal dans la Facel-Vega conduite par Michel Gallimard, du manuscrit du "Premier homme"... tout cela que l'on sait déjà (peu ou prou), du succès de « La Peste », de l’arbre "Etranger" qui cache la forêt d'une oeuvre puissante et protéiforme (« Meursault c’est moi », eut pu dire "Albert Flaubert", à cause du soleil), de Tipasa enfin, et du retour à. Etc.
Tout le Baedeker Camus est forcément dans ce livre, mais par petites touches délicates. Onfray s’attachant à démontrer (avec talent et superbe) la dimension philosophique de Camus, son livre est un bréviaire indispensable. Cette dimension, incontestable pourtant, un certain Paris vétilleux, pincé du nez, coincé des neurones, refuse toujours de la reconnaître à l’auteur de « L’envers et l’endroit ».
Camus nous apparaît sous les traits d’un philosophe artiste –et adepte d’un art de vivre en temps de catastrophes, à l’aise dans son corps qu’il laisse s’exprimer en plongeant, en nageant, en faisant l'amour, en écrivant, en transpirant, en jouant, en lisant, en déclamant des auteurs grecs, en shootant dans un ballon rond, en chuchotant, en observant en silence l’horizon méditerranéen depuis la plage...
Car Camus possède le « castizo » espagnol, cette fierté si bien décrite par Michel del Castillo ici et là, ce cran donquichottesque qui n’ignore pas sa folie douce. Camus est un être charnel, exposé à la brûlure du soleil, au sel, à la cuirasse d’argent de la mer. Il n'est pas un de ces anémiés du 6ème arrondissement, perclus de rancoeurs, de jalousies et de comptes à régler avec ceux qui pourraient pisser peut-être plus loin qu'eux! –d’où les névroses auxquelles Albert est fondamentalement étranger, surtout vues depuis Alger ou Oran. Car tout cela manquerait un peu d'horizon. (Les natifs d’Oran -dont je suis- pardonnent à Camus de n’avoir pas aimé cette ville, cadre de sa "Peste", et de lui avoir préféré Alger).
UNE PULSION DE VIE SPINOZIENNE
Camus nomme imbécile "celui qui a peur de jouir parce qu’il n’éprouve pas de honte à être heureux".
Son hédonisme, avec les événements historiques dont il sera le témoin durant sa courte vie, est un antifascisme. La pulsion de vie, quasi spinozienne, de Camus, forge sa force. Celle qui lui fera éviter les pièges du communisme aveugle et ses haines recuites, sans oublier son cruel désir de vengeance. Nul ressentiment chez Camus, souligne avec bonheur Onfray. Juste un jugement mesuré. Antimarxiste, soit anti-obtus. Il estime qu'il serait encore possible de faire cohabiter les cultures arabes et européennes sur le sol algérien, aux premiers moments durs des « événements », qu’il ne connut qu’à peine.
Camus est enfant du melting-pot pied-noir, enfant d’un bouillon de culture sain, vivant, prodigieusement débarrassé de l’acnée parisienne et des remugles racistes ayant largement cours bien au-dessus de Gibraltar. Il est fils de l’ouverture, de l’écoute, de l’altérité, du soleil et des bonheurs simples.
Il se choisit Grec. Il appartient de toute façon –qui le contesterait ?- à la gauche dionysienne et laisse sur le bas-côté du chemin la gauche apollinienne, chichiteuse, pluvieuse, grisâtre, revancharde, aigrie toujours, et aussi exsangue du corps comme du cerveau.
Camus est un homme placé de naissance du côté de l’hospitalité et du cosmopolitisme, de la fierté castillane, de la loyauté, de l’héroïsme hérités de Cervantès.
L’armée et l’université ont refusé son admission lorsqu’il était jeune. A cause de sa santé faible. Camus taillera sa sculpture solaire dans ces refus aux relents métropolitains. Onfray circonscrit cela avec une grand justesse : Camus est un philosophe qui privilégie la sensation, l’émotion, la perception, sur le concept, l’idée, la théorie. Et c’est pourquoi il nous est si proche, si tutoyant, si populaire, si accessible aussi. Ce que d’aucuns lui reprochent, car il ne reproduisit aucun de leurs codes moisis.
UN TROPISME LIBERTAIRE
A commencer par le tropisme arriviste du Rastignac de sous-préfecture -ce que Camus n'est pas : il n’envie pas Paris. Comment pourrait-il avoir le désir de sa conquête ? Paris lui fera payer très cher ses origines modestes, son existence de petit pied-noir qui défendit même ceux-ci –ce qui constitua un crime de lèse-pensée-unique à l’époque des porteurs de valises, , et de France Observateur, des livres (admirables, d’ailleurs) publiés clandestinement par les éditions de Minuit (et qui ressortent ces jours-ci)… Même son insolence politique, ses prises de position méfiantes face à un Parti communiste avaleur et destructeur à l’époque, furent inscrites au débit de son compte…
La grandeur de Camus se trouve là aussi. Comme dans les métaphores de sa vie que sont ses pièces (« Caligula », « Les Justes », ou ses adaptations dramaturgiques diverses). Onfray souligne que Camus n’est pas un contre-révolutionnaire, mais un révolutionnaire contre. La nuance est de taille.
Je relisais hier « Misère dans la Kabylie », après avoir refermé le Onfray et avoir lu qu’il y neigeait en ce moment, comme souvent d'ailleurs. Les récits de Camus (ou reportages à rendre jaloux jusqu’à la torture, un BHL, mais certainement pas un J. Littell à propos de la Syrie –admirable série dans « Le Monde » de la semaine dernière), rappellent les journaux africains de Gide. Le talent narratif est là, profondément tourné vers l’Autre, ce qui est salutaire, et l'on trouve aussi une dimension lyrique qui fait souvent défaut dans les textes de ce genre.
Sur la Guerre d’Algérie (elle touche ma mémoire familiale), je juge utile de citer seulement ceci, de Camus : « Quatre-vingt pour cent des Français d’Algérie ne sont pas des colons, mais des salariés ou des commerçants ». Camus ne souscrivit jamais à la justice sélective, ni à la « justice française » de la torture, pas plus qu’à la « justice nationale » des massacres.
Il considèrera jusqu’au bout que les Pieds-Noirs, eu égard à l’histoire de l’Algérie (ses invasions successives depuis l'Antiquité l’ayant construite) étaient des indigènes (provisoires) comme tous les autres. Camus paiera cher pour cette loyauté-là, pour sa rectitude, son bon sens, ses fidélités (ma mère contre la justice des terroristes...).
Même des esprits réputés éclairés (Bernard Frank par exemple) le traînèrent dans la boue, suivant sûrement un courant de pensée comme on monte dans un train en marche : nous pardonnerons par conséquent beaucoup au ventriloque Frank de ce « mundillo » en mal d’espace et d’horizon...
A la sortie de ce monument à la gloire d’un philosophe négligé, nous n’avons qu’un désir : le relire, et donc le prolonger. "Le faire passer", encore et toujours. Sans oublier les Sartre et autres bâtisseurs de lotissements d’une tenue autre, certes.
Mais surtout de faire passer cet hédonisme de la jouissance du corps et de l’esprit mêlés, qui font trop souvent défaut au centralisme intellectuel de notre république des lettres.
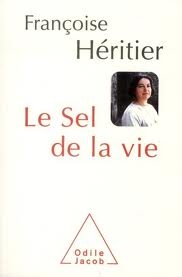 C'est un petit livre touchant, qui vous atteint au plus profond, comme le "Je me souviens" de Pérec a pu nous atteindre, ainsi que le fameux jeu de Barthes sur "j'aime - j'aime pas". Françoise Héritier, la grande anthropologue, publie un petit livre intime et sensuel (entendez : qui vient de ses cinq sens et qui va à nos cinq sens de lecteurs) chez Odile Jacob. Cela s'appele simplement "Le Sel de la vie". Sous forme de lettre à un ami médecin réputé, qui prend des vacances ultra-méritées en s'excusant -ce faisant- de "voler" du temps, cette adresse devient prétexte à une énumération infinie (mais qui se termine néanmoins) de ce qui a fait et qui continue de faire le sel de la vie de l'auteur -autrement dit du temps pas volé, mais revendiqué comme prise légitime sur l'existence, voire comme dû âprement conquis à coups d'heures, chaque jour -Non?.. Cela en devient magique, tant ce catalogue de menus plaisirs (loin de ceux de Delerm, plus riches en tous cas), est enjoué, gai, dicté par le bonheur simple et le désir de partage. Jamais ennuyeuse, bien au contraire, la liste de Françoise Héritier va d'un speculoos devant lequel elle craque à une piste africaine cabossée, une nuit, ou d'un film, d'une robe portée jadis, du passage d'une hirondelle, au seul fait d'effleurer des sensitives; à l'attente mollement agacée d'un être cher... Écoutons l'auteur : "Il s'agit tout simplement de la manière de faire de chaque épisode de sa vie un trésor de beauté et de grâce qui s'accroît sans cesse, tout seul, et où l'on peut se ressourcer chaque jour". Il est par conséquent, davantage que du Souvenir, question de la mémoire sensuelle de notre corps (et de notre esprit). Ce sont là de petites touches éparses, petits cailloux luminescents; des madeleines proustiennes. "Chacun les miennes", certes, mais justement : cela peut devenir un exercice. (Je sens que je vais lister le sel de ma vie...). Faites passer.
C'est un petit livre touchant, qui vous atteint au plus profond, comme le "Je me souviens" de Pérec a pu nous atteindre, ainsi que le fameux jeu de Barthes sur "j'aime - j'aime pas". Françoise Héritier, la grande anthropologue, publie un petit livre intime et sensuel (entendez : qui vient de ses cinq sens et qui va à nos cinq sens de lecteurs) chez Odile Jacob. Cela s'appele simplement "Le Sel de la vie". Sous forme de lettre à un ami médecin réputé, qui prend des vacances ultra-méritées en s'excusant -ce faisant- de "voler" du temps, cette adresse devient prétexte à une énumération infinie (mais qui se termine néanmoins) de ce qui a fait et qui continue de faire le sel de la vie de l'auteur -autrement dit du temps pas volé, mais revendiqué comme prise légitime sur l'existence, voire comme dû âprement conquis à coups d'heures, chaque jour -Non?.. Cela en devient magique, tant ce catalogue de menus plaisirs (loin de ceux de Delerm, plus riches en tous cas), est enjoué, gai, dicté par le bonheur simple et le désir de partage. Jamais ennuyeuse, bien au contraire, la liste de Françoise Héritier va d'un speculoos devant lequel elle craque à une piste africaine cabossée, une nuit, ou d'un film, d'une robe portée jadis, du passage d'une hirondelle, au seul fait d'effleurer des sensitives; à l'attente mollement agacée d'un être cher... Écoutons l'auteur : "Il s'agit tout simplement de la manière de faire de chaque épisode de sa vie un trésor de beauté et de grâce qui s'accroît sans cesse, tout seul, et où l'on peut se ressourcer chaque jour". Il est par conséquent, davantage que du Souvenir, question de la mémoire sensuelle de notre corps (et de notre esprit). Ce sont là de petites touches éparses, petits cailloux luminescents; des madeleines proustiennes. "Chacun les miennes", certes, mais justement : cela peut devenir un exercice. (Je sens que je vais lister le sel de ma vie...). Faites passer. 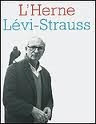 quelques jours, qui fut l'époux de Françoise Héritier, et que j'ai eu le bonheur de connaître car nous habitions le même immeuble pendant sept années. Tous deux sont parmi les plus éminents disciples de Claude Lévi-Strauss. Françoise Héritier a succédé au maître du structuralisme, comme titulaire de la chaire d'anthropologie au Collège de France, et c'est Philippe Descola qui a succédé à Françoise Héritier. Michel Izard, directeur de recherche émérite au CNRS, fut dès 1960 membre du Laboratoire d'anthropologie sociale créé par Lévi-Strauss au Collège de France, et il a notamment publié un manuel devenu un classique : "Le dictionnaire de l'ethnologiue et de l'anthropologie" (avec Pierre Bonte, aux PUF), et dirigé le Cahier de L'Herne consacré à l'auteur de "Tristes tropiques", paru en 2004. J'ai une pensée spéciale, enfin, pour Marie Mauzé, la dernière femme de Michel Izard; que j'embrasse ici. Anthropologue elle aussi, chercheur au CNRS, elle a rejoint le Laboratoire d'anthropologie sociale précité en 1986.
quelques jours, qui fut l'époux de Françoise Héritier, et que j'ai eu le bonheur de connaître car nous habitions le même immeuble pendant sept années. Tous deux sont parmi les plus éminents disciples de Claude Lévi-Strauss. Françoise Héritier a succédé au maître du structuralisme, comme titulaire de la chaire d'anthropologie au Collège de France, et c'est Philippe Descola qui a succédé à Françoise Héritier. Michel Izard, directeur de recherche émérite au CNRS, fut dès 1960 membre du Laboratoire d'anthropologie sociale créé par Lévi-Strauss au Collège de France, et il a notamment publié un manuel devenu un classique : "Le dictionnaire de l'ethnologiue et de l'anthropologie" (avec Pierre Bonte, aux PUF), et dirigé le Cahier de L'Herne consacré à l'auteur de "Tristes tropiques", paru en 2004. J'ai une pensée spéciale, enfin, pour Marie Mauzé, la dernière femme de Michel Izard; que j'embrasse ici. Anthropologue elle aussi, chercheur au CNRS, elle a rejoint le Laboratoire d'anthropologie sociale précité en 1986. j'ai d'abord pensé à coller un morceau de musique baroque très austère, façon viole de gambe, luth théorbe, ou voix de la très-très regrettée Montserrat Figueras. Et puis non : ce morceau de Cranberries est bien mieux ici. Qu'ailleurs.
j'ai d'abord pensé à coller un morceau de musique baroque très austère, façon viole de gambe, luth théorbe, ou voix de la très-très regrettée Montserrat Figueras. Et puis non : ce morceau de Cranberries est bien mieux ici. Qu'ailleurs.  C'est l'année Klimt : ça ne se rate pas, si l'on aime ce peintre génial. Et l'occasion d'aller voir plus de toiles du maître Gustav Klimt qu'il n'y en a jamais eu à Vienne, est aussi celle de contempler l'oeuvre de son disciple Egon Schiele (sans Klimt, pas de Schiele). Pour cela seulement, et à condition d'admirer l'un et l'autre peintres, le voyage est indispensable en 2012 (rendez vous aux musées Leopold et Belvedere, principalement). Vienne, c'est aussi se faire plaisir en revoyant des toiles fétiches, un petit Friedrich ici, un Velasquez là. Cette ville musée, qui est aussi celle du bon café,
C'est l'année Klimt : ça ne se rate pas, si l'on aime ce peintre génial. Et l'occasion d'aller voir plus de toiles du maître Gustav Klimt qu'il n'y en a jamais eu à Vienne, est aussi celle de contempler l'oeuvre de son disciple Egon Schiele (sans Klimt, pas de Schiele). Pour cela seulement, et à condition d'admirer l'un et l'autre peintres, le voyage est indispensable en 2012 (rendez vous aux musées Leopold et Belvedere, principalement). Vienne, c'est aussi se faire plaisir en revoyant des toiles fétiches, un petit Friedrich ici, un Velasquez là. Cette ville musée, qui est aussi celle du bon café,  du bon chocolat et des bars à vins, est également le repaire d'une certaine mémoire littéraire que l'on s'efforce de chercher en flânant dans les rues, en traînant dans les cafés (certains ont conservé
du bon chocolat et des bars à vins, est également le repaire d'une certaine mémoire littéraire que l'on s'efforce de chercher en flânant dans les rues, en traînant dans les cafés (certains ont conservé 
 tombai en arrêt, littéralement, devant ma peinture préférée à cette époque et dont j'avais une copie à l'échelle 1 dans ma chambre d'adolescent -nous vivions ensemble, en quelque sorte (il s'agit des "Chasseurs dans la neige", de Bruegel) et comme j'ignorais que l'original se trouvait là, ce me fut un choc pictural énorme. Revoir ce tableau la semaine dernière fut forcément moins terrible. De même, tandis qu'on cherche dans la nuit viennoise et dans un dédale de ruelles un bon Heurige (taverne à vins), tomber
tombai en arrêt, littéralement, devant ma peinture préférée à cette époque et dont j'avais une copie à l'échelle 1 dans ma chambre d'adolescent -nous vivions ensemble, en quelque sorte (il s'agit des "Chasseurs dans la neige", de Bruegel) et comme j'ignorais que l'original se trouvait là, ce me fut un choc pictural énorme. Revoir ce tableau la semaine dernière fut forcément moins terrible. De même, tandis qu'on cherche dans la nuit viennoise et dans un dédale de ruelles un bon Heurige (taverne à vins), tomber
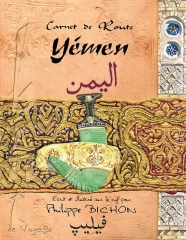 Il s'agit d'un énorme travail, d'une somme, d'une sensibilité avant tout, d'une poésie
Il s'agit d'un énorme travail, d'une somme, d'une sensibilité avant tout, d'une poésie 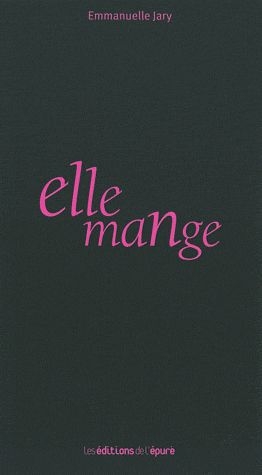
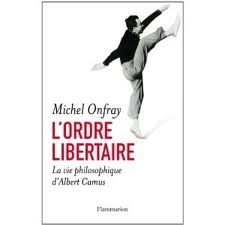
 On ne s’y attend pas. Claude Simon (disparu il y a six ans et demi), dans le texte d’une conférence qu’il donna en 1980 sur Proust, intitulée "Le poisson cathédrale", (in "Quatre conférences"
On ne s’y attend pas. Claude Simon (disparu il y a six ans et demi), dans le texte d’une conférence qu’il donna en 1980 sur Proust, intitulée "Le poisson cathédrale", (in "Quatre conférences"

