Voici un extrait de mon livre Philosophie intime du Sud-Ouest (Les Equateurs, 14€ : c'est pas la mort), qui évoque ma ville d'adoption. Parce que ce soir, à Paris, elle me manque comme une femme. Comprenne qui voudra bien essayer de piger le truc.
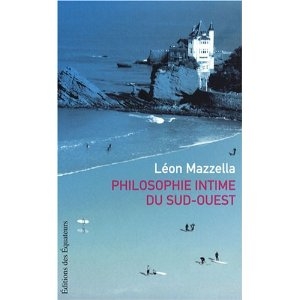 Ouverte au vent océanique et aussi à Aïce Hegoa, le vent du Sud, à la montagne douce, à la campagne mamelonnée, à l’Espagne complice, Bayonne se fout des métropoles. Elle est mon aimant. Paris est loin, Bordeaux davantage. Certaines cités se donnent des airs. Bayonne n’en manque pas. Il souffle les nuits de Fêtes jusqu’aux aurores qui hésitent entre Nive et Adour, à l’heure du partage des eaux et des dégâts collatéraux, des bleus à l’âme et des pansements distribués par l’amitié. Bayonne partage le pain et le vin avec l’inconnu. Bien sûr s’il franchit avec succès l’initiation infligée par tout Bayonnais. Il faut avoir l’accent, connaître le surnom du nouveau président de l’Aviron, le résultat des matches dominicaux.
Ouverte au vent océanique et aussi à Aïce Hegoa, le vent du Sud, à la montagne douce, à la campagne mamelonnée, à l’Espagne complice, Bayonne se fout des métropoles. Elle est mon aimant. Paris est loin, Bordeaux davantage. Certaines cités se donnent des airs. Bayonne n’en manque pas. Il souffle les nuits de Fêtes jusqu’aux aurores qui hésitent entre Nive et Adour, à l’heure du partage des eaux et des dégâts collatéraux, des bleus à l’âme et des pansements distribués par l’amitié. Bayonne partage le pain et le vin avec l’inconnu. Bien sûr s’il franchit avec succès l’initiation infligée par tout Bayonnais. Il faut avoir l’accent, connaître le surnom du nouveau président de l’Aviron, le résultat des matches dominicaux.
Le Bayonnais est partout. En sous-sol, où l’on conspire à l’aise et préfère cru le jambon, à la lumière : club, peña, cave garnie. En surface : zinc, resto, à la maison. À l’air libre mais circonscrit : terrasse, arènes, stade, plage proche, marché. Enfant, la rue Thiers me semblait plus large et l’Adour figurait le Mississipi de mes lectures. J’accompagnais ma mère Aux Dames de France, devenues Galeries Lafayette, Biarritz Bonheur aussi. Les toreros descendaient au Grand-Hôtel. Les Madrilènes venaient en limousines. Les frontaliers de « San Seba » sortaient par demi-douzaines de Fiat 500 blanches arquées sur roulettes. La cage d’ascenseur du hall de l’hôtel grinçait –j’en entends encore le cliquetis. À l’accueil, l’énorme Monsieur Léonard l’était vraiment. Il n’y avait pas trop de monde aux Fêtes. On ne s’habillait pas en rouge et blanc. Devenu Bayonnais du dimanche, je reviens sur mes années d’enfance et d’adolescence aux écoles Sévigné, Albert-1er, puis au Lycée, à Marracq. Les années surf et mobylette. Mon Bayonne est gris comme les remparts, vert comme les langues d’herbe un peu partout, marron de feuilles de platane en bouillie.
 Enfant, le jeudi était jour de coiffeur, au Parfum de Paris. Mario m’asseyait face à un meuble en bois sombre orné d’une plaque cuivrée à l’adresse du 11, rue Jean-Goujon. La glace sans tain. Le cuir pour aiguiser le rasoir qui raidissait la nuque en remontant. Je serrais les dents. Les flacons de parfum Old Spice sur l’étagère, voilier bleu dessiné sur fond blanc, bouchons à vis crantée rouge. Ça piquait.
Enfant, le jeudi était jour de coiffeur, au Parfum de Paris. Mario m’asseyait face à un meuble en bois sombre orné d’une plaque cuivrée à l’adresse du 11, rue Jean-Goujon. La glace sans tain. Le cuir pour aiguiser le rasoir qui raidissait la nuque en remontant. Je serrais les dents. Les flacons de parfum Old Spice sur l’étagère, voilier bleu dessiné sur fond blanc, bouchons à vis crantée rouge. Ça piquait.
Avec mon père, nous gobions des huîtres sous les arceaux rue Port-Neuf, le dimanche matin, Le Su’Ouess plié sous le bras. On ne parlait pas encore de (bons) vins du pays –les irouléguy blancs de Brana, de Peïo Espil. On ne trouvait qu’une piquette rouge baptisée Makila, du nom du bâton basque en néflier. Il fallait se cogner du muscadet pour faire passer. Et ça passait.
Le bonheur d’apercevoir le cloître de la cathédrale chaque mercredi de cours de dessin, chez Madame Chaudière, l’année du bac, avant de jeter le vélo contre le mur.
Les goélands et les vanneaux se posaient innocemment sur la pelouse maigre et gelée du stade Saint-Léon, rebaptisé Jean-Dauger, les après-midi d’hiver, à l’entraino, un de ces jours glacés où il fallait se pisser dans la combi en se jetant sur la planche de surf, à la Chambre d’Amour.
Bayonne, c’est se garer au plus près des Arènes à cinq heures, les après-midi de corrida, boire un demi avant et une manzanilla après, sur le montón du Cercle Taurin.
La subtilité des accents désigne le rang social, le quartier d’habitation, la marque de voiture. Les origines de chacun sont identiques. Chaque gorge racle un fond de terroir. C’est mas o menos pointu, traînant, sur le S ou sur le R. Avec des Bah ! Pareil ! Sûr ! Signes de distinction affirmés haut et rouge, l’air de rien : chemise Paseo, polo 64, tee-shirt Kukuxumusu. C’est dîner à La Grange, chez Diharce et l’abono aux arènes de Lachepaillet. Ou bien un taloa au xingar, casse-croûte à la ventrèche, un rosé rue Pannecau et chanter avec les copains jusqu’à plus soif. Ou encore lancer une ligne depuis le pont Saint-Esprit et rêver de louvines grosses comme ça en remontant un muge, puis aller taper le carton rue Maubec.
Bayonne possède un port sensuel à la courbe de l’Adour. Un croissant de lune s’y perd en étendant le bras au-delà de Blancpignon, « au soufre », la SNPA. Au soufre, j’accompagnais mon père, les yeux protégés par un masque de ski noir acheté chez le shipchandler. Il y en avait toujours deux paires sur le tableau de bord de la DS.
 Le pont Grenet rouge vif ne laisse plus passer les cargos. Côté Boucau, le port prend des allures de vieux jeune homme bien mis. Quais pavés, grues arquées, pontons de bois et cormorans qui sèchent leurs ailes, juchés sur des bouées, tandis que le sillage de la vedette du Pilotage leur offre une danse du ventre. Ça sent le mazout, la peinture au minium, l’aussière salée. Les moineaux ont toujours été nombreux à picorer tout ce qui échouait au creux des rails désaffectés. Sans jamais entamer ce que le port a gardé de mystères marseillais, d’histoires biscayennes, de légendes russes et de fantômes de complaisance.
Le pont Grenet rouge vif ne laisse plus passer les cargos. Côté Boucau, le port prend des allures de vieux jeune homme bien mis. Quais pavés, grues arquées, pontons de bois et cormorans qui sèchent leurs ailes, juchés sur des bouées, tandis que le sillage de la vedette du Pilotage leur offre une danse du ventre. Ça sent le mazout, la peinture au minium, l’aussière salée. Les moineaux ont toujours été nombreux à picorer tout ce qui échouait au creux des rails désaffectés. Sans jamais entamer ce que le port a gardé de mystères marseillais, d’histoires biscayennes, de légendes russes et de fantômes de complaisance.
Bayonne, c’était les jouets d’Armada, les habits d’enfants à la mode chez Mamby, le faux-filet chez Bourdalès, la vraie Jacqueline au comptoir du Perroquet, la fraîcheur de la rue Gosse, l’attitude noble du paysan de pierre adossé à un bœuf, au Monument aux morts. La crampe menaçante du Cardinal Lavigerie statufié, entre les deux ponts qui partagent les eaux comme Dieu les coups de cornes. Pas toujours équitablement. L’étroite Nive n’est pas rancunière. Je lui suis reconnaissant de n’avoir pas été basse, lorsque j’ai plongé en elle depuis le pont Pannecau, au cœur d’une nuit de Fêtes.
Le cinéma s’appelait La Feria, nous achetions des Batna à l’entracte. La librairie c’était Mon Livre rue Thiers. Marcel Dangou s’y rendait chaque soir en claudiquant pour ramasser la caisse. La boulangerie des sœurs Lascoutxs –étaient-elles nées vieilles, rue d’Espagne, sentait le Zan. Je revois leur nez maigre avec une goutte au bout. Elles vendaient bonbecs et chocolatines. Après l’école, on y chipait oursons en guimauve et carambars par poignées. À côté, farces et attrapes ne valaient rien. Émile tenait le magasin Tixit. Nous passions des après-midi à écouter des 33 tours à Disco Shop. Un jour d’octobre, tout le monde leva la tête : un vol de palombes mit l’éternité à passer, couvrit le ciel et le bruit de la ville. Un vieux crachait sans cesse de sa fenêtre du premier, en face de chez Campistron l’épicier. « Chez Campistron, tout est bon ! ».
Aucun Bayonnais ne peut oublier son premier chocolat chez Cazenave. La mousse, les demi-toasts beurrés à chaud, la vaisselle fleurie, le petit plateau, le tablier blanc à dentelles des dames en noir.
Mon Bayonne du ouiquende commence par le plaisir de faire la tournée des popotes, les librairies. Je traîne au marché ouvert où l’on ne trouve plus de volaille vivante, grignote une entame de fromage, feuillette le journal en buvant un coup au Mastroquet des Halles, picore un morceau de jambon Ibaï Ona tendu par Georges devant la boucherie Montauzer, passe à la librairie de La rue en pente. Je m’y sens chez moi.
 La nuit, les brouillards sur l’Adour étouffent nos pas dans les rues sombres qui bordent la Villa Chagrin, la prison.
La nuit, les brouillards sur l’Adour étouffent nos pas dans les rues sombres qui bordent la Villa Chagrin, la prison.
Le sportif à la démarche montée sur ressorts, se plie au rituel des courses en ville avec sa femme, les veilles de match. Bayonne, c’est une partie de pelote au Trinquet moderne, une volaille rôtie à l’Asador, un jaune au Clou ou au Machicoulis, un footing sur le chemin de halage depuis l’Aviron jusqu’aux contreforts d’Ustaritz et retour. Puis c’est l’heure du txakoli et des tapas à Ibaïa ou à Txotx, quai Jauréguiberry. Suivent, au choix, la pipérade chez Joséphine, au Bar du Marché (elle aura peut-être des cèpes pour l’omelette et nous nous calerons au fond, tranquilles), ou les huîtres chez Joël Dupuch, lunettes de soleil sur le nez.
Revoir un petit Dürer au Musée Bonnat. Traîner sans raison un après-midi pluvieux. Fumer un havane à l’ombre des remparts proches de la cathédrale. S’ennuyer peut être délicieux dans les rues mortes de la ville, si on sait éprouver jusqu’au vertige le silence du désert, rue Orbe, un après-midi de match, entre deux essais. En contrepoint, le souvenir du cliquetis de la machine à faire les cartouches de Bernizan, rue des Basques, derrière le long comptoir en bois fatigué, relève de la musique.
Bayonne, c’est se moquer de Biarritz et ignorer Dax (trop loin). Affecter l’indifférence à l’égard de la politique locale et de ses collusions séculaires avec le sport.
Penser à revenir à Bayonne. Pour de bon.
© L.M. (texte et photos prises pendant la rédaction de ce truc)
 Paisible échappée à Bayonne, ses abords et ses atours, ses Adours, mes amours, alentour et dedans. Flâner, saluer, chipironer, trinquer, déguster la lumière de l'aube sur la Nive, et celle du couchant sur la dune d'Ilbarritz -comme on prend un pintxo de jamon et una copita de navarra. Lire à peine, car ici le regard se lève de la page pour contempler devant et autour. La beauté empêche. Et je pêche la beauté à la ligne d'horizon de mes désirs, au-delà du fleuve et sous les arbres. Ici, on envisage, on ne dévisage pas. Je prends place dans ma querencia atlantique à la manière d'un chien qui gratte et tourne en rond avant de s'affaler comme un sac de farine épaulé-jeté. Car Paris au mois d'août me va comme un polo moulant à col roulé en rilsan® à même la peau : ça me gratte.
Paisible échappée à Bayonne, ses abords et ses atours, ses Adours, mes amours, alentour et dedans. Flâner, saluer, chipironer, trinquer, déguster la lumière de l'aube sur la Nive, et celle du couchant sur la dune d'Ilbarritz -comme on prend un pintxo de jamon et una copita de navarra. Lire à peine, car ici le regard se lève de la page pour contempler devant et autour. La beauté empêche. Et je pêche la beauté à la ligne d'horizon de mes désirs, au-delà du fleuve et sous les arbres. Ici, on envisage, on ne dévisage pas. Je prends place dans ma querencia atlantique à la manière d'un chien qui gratte et tourne en rond avant de s'affaler comme un sac de farine épaulé-jeté. Car Paris au mois d'août me va comme un polo moulant à col roulé en rilsan® à même la peau : ça me gratte.

 ©L.M. Juillet 2011.
©L.M. Juillet 2011.
 (banal), va sur un rouge léger : le jus de raisin fermenté bio de Thierry Germain : Domaine des Roches Neuves, en 2010. C'est un saumur-champigny qui se croque, il est frais comme une place de village genre Uzès sous les platanes à l'heure de la belote, et gourmand comme les draps un rien rêches et raides à l'heure de la sieste d'un juin forcément érotique.
(banal), va sur un rouge léger : le jus de raisin fermenté bio de Thierry Germain : Domaine des Roches Neuves, en 2010. C'est un saumur-champigny qui se croque, il est frais comme une place de village genre Uzès sous les platanes à l'heure de la belote, et gourmand comme les draps un rien rêches et raides à l'heure de la sieste d'un juin forcément érotique. Pour finir, au salon en écoutant de la viole de gambe, un limoncello della casa mazzella di bosco, ça te dit?..
Pour finir, au salon en écoutant de la viole de gambe, un limoncello della casa mazzella di bosco, ça te dit?..
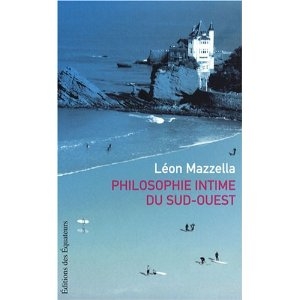 Ouverte au vent océanique et aussi à Aïce Hegoa, le vent du Sud, à la montagne douce, à la campagne mamelonnée, à l’Espagne complice, Bayonne se fout des métropoles. Elle est mon aimant. Paris est loin, Bordeaux davantage. Certaines cités se donnent des airs. Bayonne n’en manque pas. Il souffle les nuits de Fêtes jusqu’aux aurores qui hésitent entre Nive et Adour, à l’heure du partage des eaux et des dégâts collatéraux, des bleus à l’âme et
Ouverte au vent océanique et aussi à Aïce Hegoa, le vent du Sud, à la montagne douce, à la campagne mamelonnée, à l’Espagne complice, Bayonne se fout des métropoles. Elle est mon aimant. Paris est loin, Bordeaux davantage. Certaines cités se donnent des airs. Bayonne n’en manque pas. Il souffle les nuits de Fêtes jusqu’aux aurores qui hésitent entre Nive et Adour, à l’heure du partage des eaux et des dégâts collatéraux, des bleus à l’âme et Enfant, le jeudi était jour de coiffeur, au Parfum de Paris. Mario m’asseyait face à un meuble en bois sombre orné d’une plaque cuivrée à l’adresse du 11, rue Jean-Goujon. La glace sans tain. Le cuir pour aiguiser le rasoir qui raidissait la nuque en remontant. Je serrais les dents. Les flacons de parfum Old Spice sur l’étagère, voilier bleu dessiné sur fond blanc, bouchons à vis crantée rouge. Ça piquait.
Enfant, le jeudi était jour de coiffeur, au Parfum de Paris. Mario m’asseyait face à un meuble en bois sombre orné d’une plaque cuivrée à l’adresse du 11, rue Jean-Goujon. La glace sans tain. Le cuir pour aiguiser le rasoir qui raidissait la nuque en remontant. Je serrais les dents. Les flacons de parfum Old Spice sur l’étagère, voilier bleu dessiné sur fond blanc, bouchons à vis crantée rouge. Ça piquait.  Le pont Grenet rouge vif ne laisse plus passer les cargos. Côté Boucau, le port prend des allures de vieux jeune homme bien mis. Quais pavés, grues arquées, pontons de bois et cormorans qui sèchent leurs ailes, juchés sur des bouées, tandis que le sillage de la vedette du Pilotage leur offre une danse du ventre. Ça sent le mazout, la peinture au minium, l’aussière salée. Les moineaux ont toujours été nombreux à picorer tout ce qui échouait au creux des rails désaffectés. Sans jamais entamer ce que le port a gardé de mystères marseillais, d’histoires biscayennes, de légendes russes et de fantômes de complaisance.
Le pont Grenet rouge vif ne laisse plus passer les cargos. Côté Boucau, le port prend des allures de vieux jeune homme bien mis. Quais pavés, grues arquées, pontons de bois et cormorans qui sèchent leurs ailes, juchés sur des bouées, tandis que le sillage de la vedette du Pilotage leur offre une danse du ventre. Ça sent le mazout, la peinture au minium, l’aussière salée. Les moineaux ont toujours été nombreux à picorer tout ce qui échouait au creux des rails désaffectés. Sans jamais entamer ce que le port a gardé de mystères marseillais, d’histoires biscayennes, de légendes russes et de fantômes de complaisance.  La nuit, les brouillards sur l’Adour étouffent nos pas dans les rues sombres qui bordent la Villa Chagrin, la prison.
La nuit, les brouillards sur l’Adour étouffent nos pas dans les rues sombres qui bordent la Villa Chagrin, la prison. 








 Rendez-vous, Place Saint-André, de Colette Larraburu
Rendez-vous, Place Saint-André, de Colette Larraburu  Penta di Casinca est le seul village corse entièrement classé, en l’occurrence comme « site pittoresque », depuis 1973. Perché sur un éperon rocheux à 400 mètres au-dessus de la mer, au bout d’une route
Penta di Casinca est le seul village corse entièrement classé, en l’occurrence comme « site pittoresque », depuis 1973. Perché sur un éperon rocheux à 400 mètres au-dessus de la mer, au bout d’une route sous les châtaigniers et dominée au loin
sous les châtaigniers et dominée au loin
 jusqu’à Bastia. Après, louer une voiture ou une moto. Bastia est à 34 km et Poretta, son aéroport, à 17 km de Penta di Casinca.
jusqu’à Bastia. Après, louer une voiture ou une moto. Bastia est à 34 km et Poretta, son aéroport, à 17 km de Penta di Casinca. Une semaine sur l'île de Procida regonfle, donne envie de continuer d'écrire, d'écrire là-bas aussi, à défaut d'y vivre; entre deux balades en scooter d'une plage l'autre, et deux terrasses de restaurants de poissons et de fruits de mer. L'île n'est-elle pas devenue un jardin d'écriture, où Elsa Morante écrivit plusieurs de ses livres, dans la propriété Mazzella di Bosco ou hôtel Eldorado (
Une semaine sur l'île de Procida regonfle, donne envie de continuer d'écrire, d'écrire là-bas aussi, à défaut d'y vivre; entre deux balades en scooter d'une plage l'autre, et deux terrasses de restaurants de poissons et de fruits de mer. L'île n'est-elle pas devenue un jardin d'écriture, où Elsa Morante écrivit plusieurs de ses livres, dans la propriété Mazzella di Bosco ou hôtel Eldorado ( Corricella, avec la côte amalfitaine et Capri à l'horiz
Corricella, avec la côte amalfitaine et Capri à l'horiz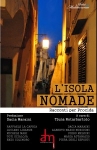 de récits sur Procida rassemblés par Tjuna Notarbartolo, écrivain et présidente du Prix Elsa-Morante, augmente cette fois d'une joie singulière, celle qui rassérène car elle est fleurie de promesses et de bonheurs à venir, encore, bientôt ; là-bas.
de récits sur Procida rassemblés par Tjuna Notarbartolo, écrivain et présidente du Prix Elsa-Morante, augmente cette fois d'une joie singulière, celle qui rassérène car elle est fleurie de promesses et de bonheurs à venir, encore, bientôt ; là-bas. 
 C'est un refrain : il faut en voir beaucoup pour... Ainsi ces derniers jours, aux arènes de Bayonne et de Dax, parfois matin et soir...
C'est un refrain : il faut en voir beaucoup pour... Ainsi ces derniers jours, aux arènes de Bayonne et de Dax, parfois matin et soir... Devant un si brillant humour (basque), respect...
Devant un si brillant humour (basque), respect...

