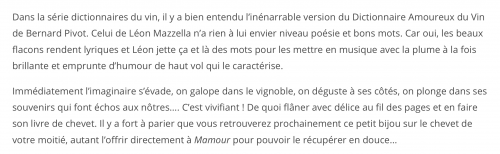Gracq, dix ans après
 Paris, 22 décembre 2007. Nous prenons la route pour Bayonne avec les enfants afin d'aller passer Noël en famille lorsque C., que nous venons juste de quitter, m’apprend la nouvelle d’un coup de téléphone bref, comme si elle annonçait la disparition d’un proche. Un flash radio et puis voilà. Julien Gracq vient de mourir.
Paris, 22 décembre 2007. Nous prenons la route pour Bayonne avec les enfants afin d'aller passer Noël en famille lorsque C., que nous venons juste de quitter, m’apprend la nouvelle d’un coup de téléphone bref, comme si elle annonçait la disparition d’un proche. Un flash radio et puis voilà. Julien Gracq vient de mourir.
Parvenus sur l'autoroute, je téléphone à mon ami Benoît Lasserre, grand reporter à Sud-Ouest, ainsi qu’à mon pote Didier Pourquery, qui dirige alors la rédaction de Libération tout en prévenant ma fille et mon fils : le voyage va être particulier. J’ai besoin de m’exprimer d’urgence. Un tic de journaliste. Et de lecteur « partisan », disait-il lorsque j’évoquais ses livres…
Je dicte le texte pour Sud-Ouest à ma fille qui le saisit sur un petit ordinateur tandis que je conduis sur l’A10. Tu as intérêt à te presser mon vieux, il me faut ton papier avant 16h si tu veux qu'il paraisse demain, avait prévenu Benoît. Par chance, une station-service d’autoroute accueillît une clé USB et procéda à l'envoi d'un e-mail. Je donnais un texte plus long à Libé après Noël depuis un hôtel de Fontarrabie, qui parut aux premiers jours de janvier.
Ce besoin de rendre hommage. Julien Gracq n’était plus. Je pensais égoïstement : fini ses livres à venir (*), adieu lettres, visites à Saint-Florent-le-Vieil, agapes à La Gabelle, tout ça.
Dix ans après, ce 22 décembre 2017, je me souviens d'un Gracq serein face à l’idée de la mort : Je suis en surnuméraire, disait-il en évoquant ses pairs. D’aucuns me pensent déjà mort depuis longtemps, lancait-il avec une espièglerie qui dissimulait mal une peine légère, en dentelle. Je quitterai ce monde sans regret (tant je ne m'y reconnais plus), assénait-il.
Je pense à la radicalité de ses nuances, au non qui ouvrait chacune de ses phrases, aux silences, à la Loire juste devant le salon où il recevait les groupies dont j’étais, je le relis au hasard, ayant un « commerce » (au sens où Montaigne emploie ce mot) avec les volumes usés de son oeuvre, qui sont devenus des potes, un chien que l’on caresse négligemment en regardant le feu; des compagnons nourrissants.
Un écrivain ne meurt que lorsque nous l’avons oublié. Aucun risque avec un tel monument. Je me réjouis de savoir que 5 000 Rivage des Syrtes sortent des presses chaque année (il m’avait fièrement donné le chiffre). Sans parler des vingt autres titres. Le cercle des initiés s’agrandit. Gracq est devenu un classique.
Je donnais une conférence à son sujet le 7 novembre dernier à l’Institut français de la mode, sollicité par l'ami Lucas Delattre, et que France Culture diffusa le lendemain. Il y avait là un parterre d’étudiants attentifs (quatre à peine sur une cinquantaine avaient entendu parler de l'auteur du Beau ténébreux), voire pressés d’en découdre avec son oeuvre, puisqu'ils commandaient les ouvrages sur Internet avant la fin de l'intervention.
Cela fait du bien de savoir que le mélancolique aspirant Grange, la sensuelle et féline Mona, l'austère et altier Aldo, la mystérieuse et envoûtante Vanessa, la poésie en prose droite d'une Sieste en Flandre hollandaise, le cours capricieux et digitalisant des Eaux étroites, les fragments buissonniers mais précis qui irriguent les Carnets du grand chemin, les essais salutaires, secs, rigoureux de En lisant en écrivant rencontrent de nouveaux lecteurs, soit des passeurs en puissance.
Passer, faire passer. Rien ne compte davantage. C’est à la belle santé de ces nouveaux passeurs que je pense d'abord, ce matin.
L.M.
---
(*) Depuis, sont parus Manuscrits de guerre et Les Terres du couchant (Corti).