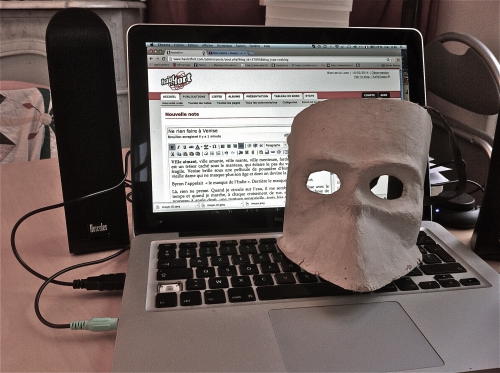 Ville aimant, ville amante, ville mante, ville menteuse, fardée, ville phare, Venise est un trésor caché sous le manteau, qui éclaire le pas du voyageur. Une flamme fragile. Venise brille sous une pellicule de poussière d’histoires, Venise est une vieille dame qui ne masque plus son âge et dont on devine la beauté enfuie.
Ville aimant, ville amante, ville mante, ville menteuse, fardée, ville phare, Venise est un trésor caché sous le manteau, qui éclaire le pas du voyageur. Une flamme fragile. Venise brille sous une pellicule de poussière d’histoires, Venise est une vieille dame qui ne masque plus son âge et dont on devine la beauté enfuie.
Byron l’appelait « le masque de l’Italie ». Derrière le masque, je vois Vénus.
Là, rien ne presse. Quand je circule sur l’eau, il me semble que je glisse avec le temps et quand je marche, à chaque croisement de rue, surgit quelque chose de nouveau à angle droit, une rupture sensorielle, trois fois rien : un gosse accroupi près d’une rigole, une façade de marbre usée, du linge aux fenêtres, des enfants qui courent (ils sont bien les seuls à le faire dans cette ville) après les pigeons.
Dans le silence du matin, une gondole semble ouvrir l’eau du canal comme une nappe de tissu et derrière elle, l’eau ne cicatrise jamais tout à fait. Cette impression revient sans cesse à moi. Dans la brume, lorsque l’eau coule comme du plomb fondu, la gondole apparaît comme une maquette de vaisseau fantôme et je pense à Pandora, le film. C’est avec Ava Gardner que j’aurais aimé faire l’amour à Venise, lorsque je m’y suis rendu la première fois (j'avais quatorze ans, je suivais mes parents et mes soeurs). La gondole est un long cercueil de poèmes chuchotés derrière le masque de satin des soirées louches. Moins classe, mais plus agréable, le vaporetto me transporte et plus encore. L’accelerato (le plus lent, curieusement), en hiver, permet de circuler à l’aise dans une Venise prise, en partie paralysée par le letargo, cette léthargie qui donne à la cité la silhouette d’une belle allongée sur les eaux dormantes, façon Kawabata.
Les noms des îles principales évoquent un animal monstrueux : Dorsoduro (rond et dur comme le dos),
Spinalunga (échine longue), Cannareggio (touffes de roseaux dressés sur les eaux). L’animal fétiche de Venise, c’est le lion. Volontiers ailé place Saint-Marc, il balise la ville et certains attribuent l’origine de Pantalone à pianta leone en référence à la manie du marchand vénitien de planter des lions sur toute terre conquise, à compter des années 828.
Les pigeons vénitiens sont paresseux. Cocteau disait qu’ici, « les pigeons marchaient et les lions volaient ».
J’aime marcher jusqu’à me perdre dans le labyrinthe des rues et des fondamente cousus de ponts et de sottoportici (passages voûtés) qui composent les Sestieri, les six quartiers principaux : Castello, San Piero, l’Arsenal, San Marco, Canal Grande et Canareggio. Certaines rues ont des noms étranges, comme la rue « du soleil qui mène à la cour des ordures ». D’autres finissent en cul-de-sac, version locale : au hasard de ces rues noires où l’on n’entend que ses propres pas et où nous ne croisons que des amoureux et des chats, il arrive de trouver un canal pour seule issue. J’aime particulièrement San Michele, l’île cimetière, parce qu’elle sent la résine, la tulipe et la terre fraîchement retournée. L’herbe caresse nonchalamment les tombes comme des anémones de mer et les cyprès, raides comme des morts debout, y figurent un orgue gigantesque et silencieux. J'ai écrit une nouvelle sur San Michele (in Les Bonheurs de l'aube, LTR), Cantos épuisants, car une forte crise d'asthme nocturne, lors de ce premier voyage adolescent, de cette prise de contact avec celle que je me refuse à appeler la Sérénissime, ne fut apaisée que lorsque je finis par m'allonger sur la tombe d'Ezra Pound, à l'aube. Allez comprendre, des fois...
La meilleure raison d’aller à Venise et de ne rien y faire, de se prélasser à la terrasse du Florian et d’y compter les pigeons –et les canards de l’orchestre qui joue chaque soir des airs vieillots. De marcher le long du Lido, aux charmes comparables, en hiver, aux longues plages landaises et à celle de Biarritz sous les embruns, lorsque l’hôtel du Palais est fermé. Loin du centre très touristique, les Vénitiens vivent leur ville. Le silence habille le geste lent du fabricant de gondoles, le pas du chat et les mouvements de tête de la vieille veuve noire qui se chauffe sur une chaise au soleil.
Parenthèse : la prochaine fois, je me risquerai jusqu'à l'île tranquille de San Erasmo, pour voir les vignes d'Orto, un vin blanc formidable, issu d'une malvoisie locale (malvasia istriana), pensé et ressuscité par les époux Bourguignon, toubibs de génie du vignoble, d'Alain Graillot, personnage respecté en Crozes-Hermitage et de Tandem, cette surprenante syrah marocaine - un vignoble bijou que possède Michel Thoulouze.
Venise elle-même se laisse aller. Elle s’abandonne à son destin sous-marin, mais sans précipiter le cours des choses. Elle s’enfonce de quatre millimètres par an dans la lagune, ai-je appris. L’acqua alta projette à période fixe ce qu’elle sera. Son matelas de bois ne la soutient plus. À Venise, les arbres sont sous les pieds du voyageur : douze millions de troncs venus des Alpes et des Balkans supportent la cité à bout de bras, et sont aujourd’hui à bout de forces. J’aimerais recouvrir Venise d’une cloche de verre pour la préserver encore, ou la piquer à je ne sais quoi pour retarder sa disparition. Au moins l’adoucir. Venise s’engloutit sans se hâter, à la manière d’un transatlantique sombrant vers une cité engloutie.
J’en aime l’idée…
Léon Mazzella
(Texte et photo).
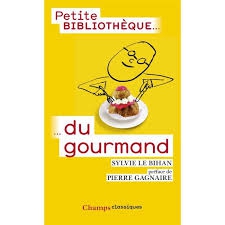

 Ramon del Valle-Inclan
Ramon del Valle-Inclan




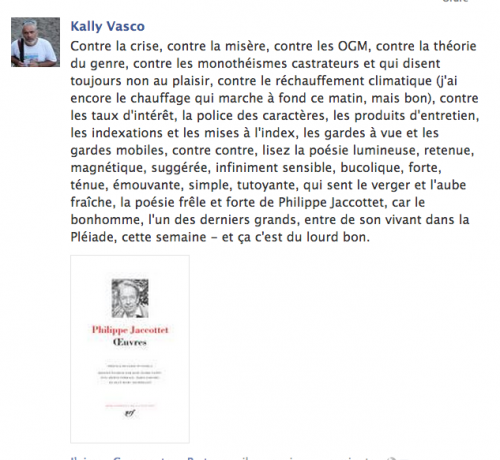
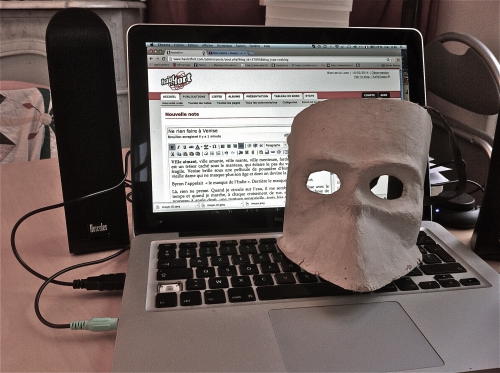 Ville aimant, ville amante, ville mante, ville menteuse, fardée, ville phare, Venise est un trésor caché sous le manteau, qui éclaire le pas du voyageur. Une flamme fragile. Venise brille sous une pellicule de poussière d’histoires, Venise est une vieille dame qui ne masque plus son âge et dont on devine la beauté enfuie.
Ville aimant, ville amante, ville mante, ville menteuse, fardée, ville phare, Venise est un trésor caché sous le manteau, qui éclaire le pas du voyageur. Une flamme fragile. Venise brille sous une pellicule de poussière d’histoires, Venise est une vieille dame qui ne masque plus son âge et dont on devine la beauté enfuie.